Par Henri Goursau100 célébrités
des Hautes-Pyrénées
Découvrez les biographies de 100 célébrités des Hautes-Pyrénées.
100 célébrités des Hautes-Pyrénées
Il y a actuellement 122 noms dans ce répertoire.
ABADIE François (1930-2001)
Homme politique, maire de Lourdes, secrétaire d’État
 François ABADIE, né le 19 juin 1930 à Lourdes et mort le 2 mars 2001 à Paris, à l’âge de 70 ans. Issu d'une vieille famille lourdaise, cet homme au caractère bien trempé laisse derrière lui une carrière politique fort bien remplie. Comme maire de la cité mariale de Lourdes de 1971 à 1989, il a fortement marqué la vie politique des Hautes-Pyrénées. Il enchaîna trois mandats successifs avant d'être battu par un jeune médecin de centre-droit Philippe Douste-Blazy en 1989. Une défaite qui l’avait profondément marqué. Tour à tour, il a endossé mandat électif sur mandat électif. Il a tout connu : les postes de conseiller général, maire, député, secrétaire d'État et sénateur. François Abadie entre précocement en politique sous le double patronage du Parti radical, qu'il rejoint dès 1946, et de René Billères, dont il est le secrétaire particulier et le plus proche collaborateur dès 1947, et qui sera son mentor en politique tout au long de sa carrière. Membre de plusieurs cabinets ministériels de ministres radicaux entre 1953 et 1958 (ceux de René Billères, mais aussi de Paul Devinat, Henry Laforest, Henri Longchambon ou Édouard Ramonet), il occupe en outre des fonctions à la direction nationale des jeunesses radicales de 1953 à 1956, mais s'éloigne de ce parti par hostilité aux positions de Pierre Mendès France sur la question algérienne : en octobre 1956, Mendès France déclare ainsi accepter sa démission « avec plaisir ». Candidat suppléant de Jean Baylot (auparavant impliqué dans l'Affaire des fuites) à Paris aux élections législatives de 1956, il entame après 1958 une traversée du désert, pendant laquelle il occupe les fonctions de directeur commercial des ventes dans une entreprise de machines-outils. Revenu au parti radical à la fin des années 1960, François Abadie reste bien introduit dans les milieux politiques haut-pyrénéens. Après avoir conquis, en 1970, le poste de conseiller général du canton de Lourdes-Est, détenu de longue date par la droite locale et qu'il conservera vingt-quatre années d'affilée, il devient, l'année suivante, en 1971, à 41 ans, maire de Lourdes, avant d'être élu député sous l'étiquette du Mouvement des radicaux de gauche (MRG) à l'occasion des élections législatives de 1973. Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, puis, à partir de 1978, de la commission de la défense et des forces armées, secrétaire de l'Assemblée nationale en 1979, François Abadie est un parlementaire peu actif en séance : seul, lors de la discussion des projets de lois de finance, l'examen du budget militaire, plus particulièrement du service des essences, lui donne l'occasion d'intervenir en tribune. Par ailleurs, il ne présente aucun rapport, pas plus qu'il ne dépose de proposition de loi. Le cœur de son activité politique est ailleurs : son très fort ancrage local - cette mainmise, diront ses opposants - ne se démentira pas pendant près de vingt ans. Réélu maire de Lourdes en 1977 et en 1983 dès le premier tour, il obtient en 1988 la Marianne d'or récompensant son dynamisme à la tête de Lourdes, où il a notamment organisé de somptueuses célébrations pour la venue du Pape Jean-Paul II, en août 1983. Anticlérical, il prit cependant l’astucieuse précaution d’accueillir le Pape aux portes de la ville et non à la mairie, sous un dais. Par ailleurs, au sein du MRG, il défend ardemment une unité d'action avec les socialistes, s'opposant en 1981 à la candidature présidentielle de Michel Crépeau pour lui préférer François Mitterrand dès le premier tour. C'est en tant que président de la fédération départementale du MRG qu'il avait appelé à voter dès le premier tour des présidentielles pour François Mitterrand. Ces raisons contribuent sans doute à sa nomination, le 22 mai 1981, comme secrétaire d'État auprès du ministre du temps libre, chargé du tourisme, sous le gouvernement Mauroy. Il endosse ce rôle de secrétaire d'État chargé du tourisme de 1981 à 1983, après avoir cédé son siège de député à Jean Duprat. Son bilan gouvernemental reste toutefois modeste : impuissant face à l'augmentation de la taxation de l'hôtellerie de luxe, il ne parvient pas à faire voter par l'Assemblée nationale une réforme des structures régionales du tourisme, et semble marquer une certaine lassitude face aux contraintes gouvernementales qui l'éloignent de sa gestion municipale. Le 26 septembre 1983, second sur la liste du sénateur sortant Hubert Peyou, François Abadie est élu sénateur, renonçant par là même à son mandat de député et à son secrétariat d'État : candidat unique de la gauche au second tour, il l'emporte largement face au candidat de l'Union pour la démocratie française (UDF) Louis Larrieu, et récupère le siège que René Billères lui avait laissé. Il devra toutefois faire face, l'année suivante, à une demande de levée d'immunité parlementaire, finalement repoussée : lors d'un débat assez vif au conseil municipal de Lourdes, il avait en effet remis en cause la vertu et le patriotisme des parents du chef de l'opposition municipale, José Marthe. François Abadie appartient au groupe de la Gauche démocratique, puis du Rassemblement démocratique européen (RDE), hormis une éphémère participation à l'aventure du groupe Entente radicale écologiste pour les États-Unis d'Europe (ERE) à proximité des élections européennes de 1984, puis devient dans les années 1990 président de l'association nationale des élus de la gauche radicale. Enfin, il est élu conseiller régional de la région Midi-Pyrénées en 1986, mais doit démissionner de cette fonction, en raison de la législation sur le cumul des mandats. Membre de la commission des affaires économiques de 1983 à 1989, puis de la commission des affaires étrangères jusqu'à la fin de son mandat, François Abadie n'intervient que rarement en séance publique, et se signale par quelques propositions de loi, ou des interventions appelant à des investissements publics pour son département. Ses votes montrent une certaine prise de distance à l'égard des gouvernements de gauche. Il s'abstient lors du vote instituant le revenu minimum d'insertion (RMI) le 27 novembre 1988, approuve le traité de Maastricht le 16 juin 1992, et vote contre le projet de loi sur la réduction du temps de travail, le 4 mars 1998. Tête de liste de l'union de la gauche, il est réélu sénateur au premier tour en septembre 1992, malgré la candidature dissidente d'Hubert Peyou. Néanmoins, cette large réélection apparaît alors comme une surprise aux observateurs : en mars 1989, François Abadie avait en effet perdu, dès le premier tour, sa mairie de Lourdes au profit de Philippe Douste-Blazy. Cette défaite l'affectera durement : après un nouveau revers contre Philippe Douste-Blazy à l'occasion des élections cantonales de 1994, il démissionne du conseil municipal, déclarant : « J'ai mieux à faire au Sénat qu'à m'occuper de gens qui semblent me considérer maintenant sur une voie de garage ». En proie à des soucis de santé, François Abadie renonce précocement à tout nouveau mandat sénatorial, puis est exclu du Parti radical de gauche en août 2000, après avoir tenu, pour manifester son opposition au pacte civil de solidarité, des propos homophobes. Il meurt le 2 mars 2001, laissant son mandat à son suppléant et successeur désigné, François Fortassin. Entré très jeune dans la vie politique, François Abadie devint vite secrétaire général puis président des jeunesses radicales. Sous la IVème République, c'est bien dans le sillage du député haut-pyrénéen, René Billères, que François Abadie occupa tour à tour des fonctions d'attaché ou de chef de cabinet auprès de toute une série de ministres et de secrétaires d'État. Ses mandats nationaux : Maire de Lourdes 1971 à 1989 ; Député radical de gauche des Hautes-Pyrénées de 1973 à 1981 (il a été élu trois fois député successivement en 1973, 1978 et 1981. La première fois, c'est avec plus de 60 % des suffrages exprimés qu'il s'impose sur le sortant) ; Sénateur des Hautes-Pyrénées de 1983 à 2001 (juste après avoir quitté le premier gouvernement de gauche de la Vème République, il devient alors sénateur des Hautes-Pyrénées, un poste abandonné à son décès en mars 2001). Ses fonctions ministérielles : Secrétaire d'État au Tourisme du 22 mai 1981 au 24 mars 1983. L’été 2000, affaibli par un accident cérébral, il avait annoncé qu'il ne briguerait plus de nouveau mandat électif. C'est donc en juillet 2000 qu'il avait décidé de mettre un terme définitif à cette longue et riche carrière politique. À quelques mois de laisser son fauteuil de sénateur, c'est dans ces conditions dramatiques qu'il confie malgré lui son siège à son suppléant mais surtout ami, le président du conseil général des Hautes-Pyrénées : François Fortassin, lequel devint sénateur le 3 mars 2001. Décédé le 2 mars 2001 à son domicile parisien, les obsèques de François Abadie se déroulèrent à Lourdes. La cérémonie religieuse s’étant tenue le mercredi 7 mars 2001 en l'église paroissiale du Sacré-Cœur de Lourdes. Il avait préféré renoncer à une carrière nationale ministérielle pour se consacrer à la politique dans le département et au développement de Lourdes. Pendant ses 18 années de mandat municipal, il a préparé Lourdes au XXIe siècle par des aménagements structurants. C'était un homme politique au parler vrai qui faisait passer avant tout le côté affectif et il se souciait moins de l'image que du ressenti. C'était surtout un homme de conviction, de fidélité et de foucades qui cachait une très grande sensibilité. Il aimait cette ville de Lourdes par-dessus tout et était très attaché à son équipe de rugby. Il a montré une grande capacité de gestionnaire durant ses années de maire à Lourdes. « Un homme qui avait toujours le courage de dire ce qu'il pensait même si cela dérangeait, un homme avec le cœur sur la main », dira de lui, Pierre Forgues. Les Lourdais lui doivent la salle des fêtes, le palais des congrès, la bibliothèque, les foyers de l’Ophite et de Lannedarré, la piscine couverte, les courts de tennis, le golf, le terrain de football de Lannedarré et la station de ski du Hautacam… François Abadie était chevalier des Palmes académiques. Il avait le titre de Vénérable de la loge « L’Internationale » et de la loge « La Renaissance de Paris ». Une avenue de Lourdes ainsi que le Palais des Sports ont été baptisés de son nom.
François ABADIE, né le 19 juin 1930 à Lourdes et mort le 2 mars 2001 à Paris, à l’âge de 70 ans. Issu d'une vieille famille lourdaise, cet homme au caractère bien trempé laisse derrière lui une carrière politique fort bien remplie. Comme maire de la cité mariale de Lourdes de 1971 à 1989, il a fortement marqué la vie politique des Hautes-Pyrénées. Il enchaîna trois mandats successifs avant d'être battu par un jeune médecin de centre-droit Philippe Douste-Blazy en 1989. Une défaite qui l’avait profondément marqué. Tour à tour, il a endossé mandat électif sur mandat électif. Il a tout connu : les postes de conseiller général, maire, député, secrétaire d'État et sénateur. François Abadie entre précocement en politique sous le double patronage du Parti radical, qu'il rejoint dès 1946, et de René Billères, dont il est le secrétaire particulier et le plus proche collaborateur dès 1947, et qui sera son mentor en politique tout au long de sa carrière. Membre de plusieurs cabinets ministériels de ministres radicaux entre 1953 et 1958 (ceux de René Billères, mais aussi de Paul Devinat, Henry Laforest, Henri Longchambon ou Édouard Ramonet), il occupe en outre des fonctions à la direction nationale des jeunesses radicales de 1953 à 1956, mais s'éloigne de ce parti par hostilité aux positions de Pierre Mendès France sur la question algérienne : en octobre 1956, Mendès France déclare ainsi accepter sa démission « avec plaisir ». Candidat suppléant de Jean Baylot (auparavant impliqué dans l'Affaire des fuites) à Paris aux élections législatives de 1956, il entame après 1958 une traversée du désert, pendant laquelle il occupe les fonctions de directeur commercial des ventes dans une entreprise de machines-outils. Revenu au parti radical à la fin des années 1960, François Abadie reste bien introduit dans les milieux politiques haut-pyrénéens. Après avoir conquis, en 1970, le poste de conseiller général du canton de Lourdes-Est, détenu de longue date par la droite locale et qu'il conservera vingt-quatre années d'affilée, il devient, l'année suivante, en 1971, à 41 ans, maire de Lourdes, avant d'être élu député sous l'étiquette du Mouvement des radicaux de gauche (MRG) à l'occasion des élections législatives de 1973. Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, puis, à partir de 1978, de la commission de la défense et des forces armées, secrétaire de l'Assemblée nationale en 1979, François Abadie est un parlementaire peu actif en séance : seul, lors de la discussion des projets de lois de finance, l'examen du budget militaire, plus particulièrement du service des essences, lui donne l'occasion d'intervenir en tribune. Par ailleurs, il ne présente aucun rapport, pas plus qu'il ne dépose de proposition de loi. Le cœur de son activité politique est ailleurs : son très fort ancrage local - cette mainmise, diront ses opposants - ne se démentira pas pendant près de vingt ans. Réélu maire de Lourdes en 1977 et en 1983 dès le premier tour, il obtient en 1988 la Marianne d'or récompensant son dynamisme à la tête de Lourdes, où il a notamment organisé de somptueuses célébrations pour la venue du Pape Jean-Paul II, en août 1983. Anticlérical, il prit cependant l’astucieuse précaution d’accueillir le Pape aux portes de la ville et non à la mairie, sous un dais. Par ailleurs, au sein du MRG, il défend ardemment une unité d'action avec les socialistes, s'opposant en 1981 à la candidature présidentielle de Michel Crépeau pour lui préférer François Mitterrand dès le premier tour. C'est en tant que président de la fédération départementale du MRG qu'il avait appelé à voter dès le premier tour des présidentielles pour François Mitterrand. Ces raisons contribuent sans doute à sa nomination, le 22 mai 1981, comme secrétaire d'État auprès du ministre du temps libre, chargé du tourisme, sous le gouvernement Mauroy. Il endosse ce rôle de secrétaire d'État chargé du tourisme de 1981 à 1983, après avoir cédé son siège de député à Jean Duprat. Son bilan gouvernemental reste toutefois modeste : impuissant face à l'augmentation de la taxation de l'hôtellerie de luxe, il ne parvient pas à faire voter par l'Assemblée nationale une réforme des structures régionales du tourisme, et semble marquer une certaine lassitude face aux contraintes gouvernementales qui l'éloignent de sa gestion municipale. Le 26 septembre 1983, second sur la liste du sénateur sortant Hubert Peyou, François Abadie est élu sénateur, renonçant par là même à son mandat de député et à son secrétariat d'État : candidat unique de la gauche au second tour, il l'emporte largement face au candidat de l'Union pour la démocratie française (UDF) Louis Larrieu, et récupère le siège que René Billères lui avait laissé. Il devra toutefois faire face, l'année suivante, à une demande de levée d'immunité parlementaire, finalement repoussée : lors d'un débat assez vif au conseil municipal de Lourdes, il avait en effet remis en cause la vertu et le patriotisme des parents du chef de l'opposition municipale, José Marthe. François Abadie appartient au groupe de la Gauche démocratique, puis du Rassemblement démocratique européen (RDE), hormis une éphémère participation à l'aventure du groupe Entente radicale écologiste pour les États-Unis d'Europe (ERE) à proximité des élections européennes de 1984, puis devient dans les années 1990 président de l'association nationale des élus de la gauche radicale. Enfin, il est élu conseiller régional de la région Midi-Pyrénées en 1986, mais doit démissionner de cette fonction, en raison de la législation sur le cumul des mandats. Membre de la commission des affaires économiques de 1983 à 1989, puis de la commission des affaires étrangères jusqu'à la fin de son mandat, François Abadie n'intervient que rarement en séance publique, et se signale par quelques propositions de loi, ou des interventions appelant à des investissements publics pour son département. Ses votes montrent une certaine prise de distance à l'égard des gouvernements de gauche. Il s'abstient lors du vote instituant le revenu minimum d'insertion (RMI) le 27 novembre 1988, approuve le traité de Maastricht le 16 juin 1992, et vote contre le projet de loi sur la réduction du temps de travail, le 4 mars 1998. Tête de liste de l'union de la gauche, il est réélu sénateur au premier tour en septembre 1992, malgré la candidature dissidente d'Hubert Peyou. Néanmoins, cette large réélection apparaît alors comme une surprise aux observateurs : en mars 1989, François Abadie avait en effet perdu, dès le premier tour, sa mairie de Lourdes au profit de Philippe Douste-Blazy. Cette défaite l'affectera durement : après un nouveau revers contre Philippe Douste-Blazy à l'occasion des élections cantonales de 1994, il démissionne du conseil municipal, déclarant : « J'ai mieux à faire au Sénat qu'à m'occuper de gens qui semblent me considérer maintenant sur une voie de garage ». En proie à des soucis de santé, François Abadie renonce précocement à tout nouveau mandat sénatorial, puis est exclu du Parti radical de gauche en août 2000, après avoir tenu, pour manifester son opposition au pacte civil de solidarité, des propos homophobes. Il meurt le 2 mars 2001, laissant son mandat à son suppléant et successeur désigné, François Fortassin. Entré très jeune dans la vie politique, François Abadie devint vite secrétaire général puis président des jeunesses radicales. Sous la IVème République, c'est bien dans le sillage du député haut-pyrénéen, René Billères, que François Abadie occupa tour à tour des fonctions d'attaché ou de chef de cabinet auprès de toute une série de ministres et de secrétaires d'État. Ses mandats nationaux : Maire de Lourdes 1971 à 1989 ; Député radical de gauche des Hautes-Pyrénées de 1973 à 1981 (il a été élu trois fois député successivement en 1973, 1978 et 1981. La première fois, c'est avec plus de 60 % des suffrages exprimés qu'il s'impose sur le sortant) ; Sénateur des Hautes-Pyrénées de 1983 à 2001 (juste après avoir quitté le premier gouvernement de gauche de la Vème République, il devient alors sénateur des Hautes-Pyrénées, un poste abandonné à son décès en mars 2001). Ses fonctions ministérielles : Secrétaire d'État au Tourisme du 22 mai 1981 au 24 mars 1983. L’été 2000, affaibli par un accident cérébral, il avait annoncé qu'il ne briguerait plus de nouveau mandat électif. C'est donc en juillet 2000 qu'il avait décidé de mettre un terme définitif à cette longue et riche carrière politique. À quelques mois de laisser son fauteuil de sénateur, c'est dans ces conditions dramatiques qu'il confie malgré lui son siège à son suppléant mais surtout ami, le président du conseil général des Hautes-Pyrénées : François Fortassin, lequel devint sénateur le 3 mars 2001. Décédé le 2 mars 2001 à son domicile parisien, les obsèques de François Abadie se déroulèrent à Lourdes. La cérémonie religieuse s’étant tenue le mercredi 7 mars 2001 en l'église paroissiale du Sacré-Cœur de Lourdes. Il avait préféré renoncer à une carrière nationale ministérielle pour se consacrer à la politique dans le département et au développement de Lourdes. Pendant ses 18 années de mandat municipal, il a préparé Lourdes au XXIe siècle par des aménagements structurants. C'était un homme politique au parler vrai qui faisait passer avant tout le côté affectif et il se souciait moins de l'image que du ressenti. C'était surtout un homme de conviction, de fidélité et de foucades qui cachait une très grande sensibilité. Il aimait cette ville de Lourdes par-dessus tout et était très attaché à son équipe de rugby. Il a montré une grande capacité de gestionnaire durant ses années de maire à Lourdes. « Un homme qui avait toujours le courage de dire ce qu'il pensait même si cela dérangeait, un homme avec le cœur sur la main », dira de lui, Pierre Forgues. Les Lourdais lui doivent la salle des fêtes, le palais des congrès, la bibliothèque, les foyers de l’Ophite et de Lannedarré, la piscine couverte, les courts de tennis, le golf, le terrain de football de Lannedarré et la station de ski du Hautacam… François Abadie était chevalier des Palmes académiques. Il avait le titre de Vénérable de la loge « L’Internationale » et de la loge « La Renaissance de Paris ». Une avenue de Lourdes ainsi que le Palais des Sports ont été baptisés de son nom.
 François ABADIE, né le 19 juin 1930 à Lourdes et mort le 2 mars 2001 à Paris, à l’âge de 70 ans. Issu d'une vieille famille lourdaise, cet homme au caractère bien trempé laisse derrière lui une carrière politique fort bien remplie. Comme maire de la cité mariale de Lourdes de 1971 à 1989, il a fortement marqué la vie politique des Hautes-Pyrénées. Il enchaîna trois mandats successifs avant d'être battu par un jeune médecin de centre-droit Philippe Douste-Blazy en 1989. Une défaite qui l’avait profondément marqué. Tour à tour, il a endossé mandat électif sur mandat électif. Il a tout connu : les postes de conseiller général, maire, député, secrétaire d'État et sénateur. François Abadie entre précocement en politique sous le double patronage du Parti radical, qu'il rejoint dès 1946, et de René Billères, dont il est le secrétaire particulier et le plus proche collaborateur dès 1947, et qui sera son mentor en politique tout au long de sa carrière. Membre de plusieurs cabinets ministériels de ministres radicaux entre 1953 et 1958 (ceux de René Billères, mais aussi de Paul Devinat, Henry Laforest, Henri Longchambon ou Édouard Ramonet), il occupe en outre des fonctions à la direction nationale des jeunesses radicales de 1953 à 1956, mais s'éloigne de ce parti par hostilité aux positions de Pierre Mendès France sur la question algérienne : en octobre 1956, Mendès France déclare ainsi accepter sa démission « avec plaisir ». Candidat suppléant de Jean Baylot (auparavant impliqué dans l'Affaire des fuites) à Paris aux élections législatives de 1956, il entame après 1958 une traversée du désert, pendant laquelle il occupe les fonctions de directeur commercial des ventes dans une entreprise de machines-outils. Revenu au parti radical à la fin des années 1960, François Abadie reste bien introduit dans les milieux politiques haut-pyrénéens. Après avoir conquis, en 1970, le poste de conseiller général du canton de Lourdes-Est, détenu de longue date par la droite locale et qu'il conservera vingt-quatre années d'affilée, il devient, l'année suivante, en 1971, à 41 ans, maire de Lourdes, avant d'être élu député sous l'étiquette du Mouvement des radicaux de gauche (MRG) à l'occasion des élections législatives de 1973. Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, puis, à partir de 1978, de la commission de la défense et des forces armées, secrétaire de l'Assemblée nationale en 1979, François Abadie est un parlementaire peu actif en séance : seul, lors de la discussion des projets de lois de finance, l'examen du budget militaire, plus particulièrement du service des essences, lui donne l'occasion d'intervenir en tribune. Par ailleurs, il ne présente aucun rapport, pas plus qu'il ne dépose de proposition de loi. Le cœur de son activité politique est ailleurs : son très fort ancrage local - cette mainmise, diront ses opposants - ne se démentira pas pendant près de vingt ans. Réélu maire de Lourdes en 1977 et en 1983 dès le premier tour, il obtient en 1988 la Marianne d'or récompensant son dynamisme à la tête de Lourdes, où il a notamment organisé de somptueuses célébrations pour la venue du Pape Jean-Paul II, en août 1983. Anticlérical, il prit cependant l’astucieuse précaution d’accueillir le Pape aux portes de la ville et non à la mairie, sous un dais. Par ailleurs, au sein du MRG, il défend ardemment une unité d'action avec les socialistes, s'opposant en 1981 à la candidature présidentielle de Michel Crépeau pour lui préférer François Mitterrand dès le premier tour. C'est en tant que président de la fédération départementale du MRG qu'il avait appelé à voter dès le premier tour des présidentielles pour François Mitterrand. Ces raisons contribuent sans doute à sa nomination, le 22 mai 1981, comme secrétaire d'État auprès du ministre du temps libre, chargé du tourisme, sous le gouvernement Mauroy. Il endosse ce rôle de secrétaire d'État chargé du tourisme de 1981 à 1983, après avoir cédé son siège de député à Jean Duprat. Son bilan gouvernemental reste toutefois modeste : impuissant face à l'augmentation de la taxation de l'hôtellerie de luxe, il ne parvient pas à faire voter par l'Assemblée nationale une réforme des structures régionales du tourisme, et semble marquer une certaine lassitude face aux contraintes gouvernementales qui l'éloignent de sa gestion municipale. Le 26 septembre 1983, second sur la liste du sénateur sortant Hubert Peyou, François Abadie est élu sénateur, renonçant par là même à son mandat de député et à son secrétariat d'État : candidat unique de la gauche au second tour, il l'emporte largement face au candidat de l'Union pour la démocratie française (UDF) Louis Larrieu, et récupère le siège que René Billères lui avait laissé. Il devra toutefois faire face, l'année suivante, à une demande de levée d'immunité parlementaire, finalement repoussée : lors d'un débat assez vif au conseil municipal de Lourdes, il avait en effet remis en cause la vertu et le patriotisme des parents du chef de l'opposition municipale, José Marthe. François Abadie appartient au groupe de la Gauche démocratique, puis du Rassemblement démocratique européen (RDE), hormis une éphémère participation à l'aventure du groupe Entente radicale écologiste pour les États-Unis d'Europe (ERE) à proximité des élections européennes de 1984, puis devient dans les années 1990 président de l'association nationale des élus de la gauche radicale. Enfin, il est élu conseiller régional de la région Midi-Pyrénées en 1986, mais doit démissionner de cette fonction, en raison de la législation sur le cumul des mandats. Membre de la commission des affaires économiques de 1983 à 1989, puis de la commission des affaires étrangères jusqu'à la fin de son mandat, François Abadie n'intervient que rarement en séance publique, et se signale par quelques propositions de loi, ou des interventions appelant à des investissements publics pour son département. Ses votes montrent une certaine prise de distance à l'égard des gouvernements de gauche. Il s'abstient lors du vote instituant le revenu minimum d'insertion (RMI) le 27 novembre 1988, approuve le traité de Maastricht le 16 juin 1992, et vote contre le projet de loi sur la réduction du temps de travail, le 4 mars 1998. Tête de liste de l'union de la gauche, il est réélu sénateur au premier tour en septembre 1992, malgré la candidature dissidente d'Hubert Peyou. Néanmoins, cette large réélection apparaît alors comme une surprise aux observateurs : en mars 1989, François Abadie avait en effet perdu, dès le premier tour, sa mairie de Lourdes au profit de Philippe Douste-Blazy. Cette défaite l'affectera durement : après un nouveau revers contre Philippe Douste-Blazy à l'occasion des élections cantonales de 1994, il démissionne du conseil municipal, déclarant : « J'ai mieux à faire au Sénat qu'à m'occuper de gens qui semblent me considérer maintenant sur une voie de garage ». En proie à des soucis de santé, François Abadie renonce précocement à tout nouveau mandat sénatorial, puis est exclu du Parti radical de gauche en août 2000, après avoir tenu, pour manifester son opposition au pacte civil de solidarité, des propos homophobes. Il meurt le 2 mars 2001, laissant son mandat à son suppléant et successeur désigné, François Fortassin. Entré très jeune dans la vie politique, François Abadie devint vite secrétaire général puis président des jeunesses radicales. Sous la IVème République, c'est bien dans le sillage du député haut-pyrénéen, René Billères, que François Abadie occupa tour à tour des fonctions d'attaché ou de chef de cabinet auprès de toute une série de ministres et de secrétaires d'État. Ses mandats nationaux : Maire de Lourdes 1971 à 1989 ; Député radical de gauche des Hautes-Pyrénées de 1973 à 1981 (il a été élu trois fois député successivement en 1973, 1978 et 1981. La première fois, c'est avec plus de 60 % des suffrages exprimés qu'il s'impose sur le sortant) ; Sénateur des Hautes-Pyrénées de 1983 à 2001 (juste après avoir quitté le premier gouvernement de gauche de la Vème République, il devient alors sénateur des Hautes-Pyrénées, un poste abandonné à son décès en mars 2001). Ses fonctions ministérielles : Secrétaire d'État au Tourisme du 22 mai 1981 au 24 mars 1983. L’été 2000, affaibli par un accident cérébral, il avait annoncé qu'il ne briguerait plus de nouveau mandat électif. C'est donc en juillet 2000 qu'il avait décidé de mettre un terme définitif à cette longue et riche carrière politique. À quelques mois de laisser son fauteuil de sénateur, c'est dans ces conditions dramatiques qu'il confie malgré lui son siège à son suppléant mais surtout ami, le président du conseil général des Hautes-Pyrénées : François Fortassin, lequel devint sénateur le 3 mars 2001. Décédé le 2 mars 2001 à son domicile parisien, les obsèques de François Abadie se déroulèrent à Lourdes. La cérémonie religieuse s’étant tenue le mercredi 7 mars 2001 en l'église paroissiale du Sacré-Cœur de Lourdes. Il avait préféré renoncer à une carrière nationale ministérielle pour se consacrer à la politique dans le département et au développement de Lourdes. Pendant ses 18 années de mandat municipal, il a préparé Lourdes au XXIe siècle par des aménagements structurants. C'était un homme politique au parler vrai qui faisait passer avant tout le côté affectif et il se souciait moins de l'image que du ressenti. C'était surtout un homme de conviction, de fidélité et de foucades qui cachait une très grande sensibilité. Il aimait cette ville de Lourdes par-dessus tout et était très attaché à son équipe de rugby. Il a montré une grande capacité de gestionnaire durant ses années de maire à Lourdes. « Un homme qui avait toujours le courage de dire ce qu'il pensait même si cela dérangeait, un homme avec le cœur sur la main », dira de lui, Pierre Forgues. Les Lourdais lui doivent la salle des fêtes, le palais des congrès, la bibliothèque, les foyers de l’Ophite et de Lannedarré, la piscine couverte, les courts de tennis, le golf, le terrain de football de Lannedarré et la station de ski du Hautacam… François Abadie était chevalier des Palmes académiques. Il avait le titre de Vénérable de la loge « L’Internationale » et de la loge « La Renaissance de Paris ». Une avenue de Lourdes ainsi que le Palais des Sports ont été baptisés de son nom.
François ABADIE, né le 19 juin 1930 à Lourdes et mort le 2 mars 2001 à Paris, à l’âge de 70 ans. Issu d'une vieille famille lourdaise, cet homme au caractère bien trempé laisse derrière lui une carrière politique fort bien remplie. Comme maire de la cité mariale de Lourdes de 1971 à 1989, il a fortement marqué la vie politique des Hautes-Pyrénées. Il enchaîna trois mandats successifs avant d'être battu par un jeune médecin de centre-droit Philippe Douste-Blazy en 1989. Une défaite qui l’avait profondément marqué. Tour à tour, il a endossé mandat électif sur mandat électif. Il a tout connu : les postes de conseiller général, maire, député, secrétaire d'État et sénateur. François Abadie entre précocement en politique sous le double patronage du Parti radical, qu'il rejoint dès 1946, et de René Billères, dont il est le secrétaire particulier et le plus proche collaborateur dès 1947, et qui sera son mentor en politique tout au long de sa carrière. Membre de plusieurs cabinets ministériels de ministres radicaux entre 1953 et 1958 (ceux de René Billères, mais aussi de Paul Devinat, Henry Laforest, Henri Longchambon ou Édouard Ramonet), il occupe en outre des fonctions à la direction nationale des jeunesses radicales de 1953 à 1956, mais s'éloigne de ce parti par hostilité aux positions de Pierre Mendès France sur la question algérienne : en octobre 1956, Mendès France déclare ainsi accepter sa démission « avec plaisir ». Candidat suppléant de Jean Baylot (auparavant impliqué dans l'Affaire des fuites) à Paris aux élections législatives de 1956, il entame après 1958 une traversée du désert, pendant laquelle il occupe les fonctions de directeur commercial des ventes dans une entreprise de machines-outils. Revenu au parti radical à la fin des années 1960, François Abadie reste bien introduit dans les milieux politiques haut-pyrénéens. Après avoir conquis, en 1970, le poste de conseiller général du canton de Lourdes-Est, détenu de longue date par la droite locale et qu'il conservera vingt-quatre années d'affilée, il devient, l'année suivante, en 1971, à 41 ans, maire de Lourdes, avant d'être élu député sous l'étiquette du Mouvement des radicaux de gauche (MRG) à l'occasion des élections législatives de 1973. Membre de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, puis, à partir de 1978, de la commission de la défense et des forces armées, secrétaire de l'Assemblée nationale en 1979, François Abadie est un parlementaire peu actif en séance : seul, lors de la discussion des projets de lois de finance, l'examen du budget militaire, plus particulièrement du service des essences, lui donne l'occasion d'intervenir en tribune. Par ailleurs, il ne présente aucun rapport, pas plus qu'il ne dépose de proposition de loi. Le cœur de son activité politique est ailleurs : son très fort ancrage local - cette mainmise, diront ses opposants - ne se démentira pas pendant près de vingt ans. Réélu maire de Lourdes en 1977 et en 1983 dès le premier tour, il obtient en 1988 la Marianne d'or récompensant son dynamisme à la tête de Lourdes, où il a notamment organisé de somptueuses célébrations pour la venue du Pape Jean-Paul II, en août 1983. Anticlérical, il prit cependant l’astucieuse précaution d’accueillir le Pape aux portes de la ville et non à la mairie, sous un dais. Par ailleurs, au sein du MRG, il défend ardemment une unité d'action avec les socialistes, s'opposant en 1981 à la candidature présidentielle de Michel Crépeau pour lui préférer François Mitterrand dès le premier tour. C'est en tant que président de la fédération départementale du MRG qu'il avait appelé à voter dès le premier tour des présidentielles pour François Mitterrand. Ces raisons contribuent sans doute à sa nomination, le 22 mai 1981, comme secrétaire d'État auprès du ministre du temps libre, chargé du tourisme, sous le gouvernement Mauroy. Il endosse ce rôle de secrétaire d'État chargé du tourisme de 1981 à 1983, après avoir cédé son siège de député à Jean Duprat. Son bilan gouvernemental reste toutefois modeste : impuissant face à l'augmentation de la taxation de l'hôtellerie de luxe, il ne parvient pas à faire voter par l'Assemblée nationale une réforme des structures régionales du tourisme, et semble marquer une certaine lassitude face aux contraintes gouvernementales qui l'éloignent de sa gestion municipale. Le 26 septembre 1983, second sur la liste du sénateur sortant Hubert Peyou, François Abadie est élu sénateur, renonçant par là même à son mandat de député et à son secrétariat d'État : candidat unique de la gauche au second tour, il l'emporte largement face au candidat de l'Union pour la démocratie française (UDF) Louis Larrieu, et récupère le siège que René Billères lui avait laissé. Il devra toutefois faire face, l'année suivante, à une demande de levée d'immunité parlementaire, finalement repoussée : lors d'un débat assez vif au conseil municipal de Lourdes, il avait en effet remis en cause la vertu et le patriotisme des parents du chef de l'opposition municipale, José Marthe. François Abadie appartient au groupe de la Gauche démocratique, puis du Rassemblement démocratique européen (RDE), hormis une éphémère participation à l'aventure du groupe Entente radicale écologiste pour les États-Unis d'Europe (ERE) à proximité des élections européennes de 1984, puis devient dans les années 1990 président de l'association nationale des élus de la gauche radicale. Enfin, il est élu conseiller régional de la région Midi-Pyrénées en 1986, mais doit démissionner de cette fonction, en raison de la législation sur le cumul des mandats. Membre de la commission des affaires économiques de 1983 à 1989, puis de la commission des affaires étrangères jusqu'à la fin de son mandat, François Abadie n'intervient que rarement en séance publique, et se signale par quelques propositions de loi, ou des interventions appelant à des investissements publics pour son département. Ses votes montrent une certaine prise de distance à l'égard des gouvernements de gauche. Il s'abstient lors du vote instituant le revenu minimum d'insertion (RMI) le 27 novembre 1988, approuve le traité de Maastricht le 16 juin 1992, et vote contre le projet de loi sur la réduction du temps de travail, le 4 mars 1998. Tête de liste de l'union de la gauche, il est réélu sénateur au premier tour en septembre 1992, malgré la candidature dissidente d'Hubert Peyou. Néanmoins, cette large réélection apparaît alors comme une surprise aux observateurs : en mars 1989, François Abadie avait en effet perdu, dès le premier tour, sa mairie de Lourdes au profit de Philippe Douste-Blazy. Cette défaite l'affectera durement : après un nouveau revers contre Philippe Douste-Blazy à l'occasion des élections cantonales de 1994, il démissionne du conseil municipal, déclarant : « J'ai mieux à faire au Sénat qu'à m'occuper de gens qui semblent me considérer maintenant sur une voie de garage ». En proie à des soucis de santé, François Abadie renonce précocement à tout nouveau mandat sénatorial, puis est exclu du Parti radical de gauche en août 2000, après avoir tenu, pour manifester son opposition au pacte civil de solidarité, des propos homophobes. Il meurt le 2 mars 2001, laissant son mandat à son suppléant et successeur désigné, François Fortassin. Entré très jeune dans la vie politique, François Abadie devint vite secrétaire général puis président des jeunesses radicales. Sous la IVème République, c'est bien dans le sillage du député haut-pyrénéen, René Billères, que François Abadie occupa tour à tour des fonctions d'attaché ou de chef de cabinet auprès de toute une série de ministres et de secrétaires d'État. Ses mandats nationaux : Maire de Lourdes 1971 à 1989 ; Député radical de gauche des Hautes-Pyrénées de 1973 à 1981 (il a été élu trois fois député successivement en 1973, 1978 et 1981. La première fois, c'est avec plus de 60 % des suffrages exprimés qu'il s'impose sur le sortant) ; Sénateur des Hautes-Pyrénées de 1983 à 2001 (juste après avoir quitté le premier gouvernement de gauche de la Vème République, il devient alors sénateur des Hautes-Pyrénées, un poste abandonné à son décès en mars 2001). Ses fonctions ministérielles : Secrétaire d'État au Tourisme du 22 mai 1981 au 24 mars 1983. L’été 2000, affaibli par un accident cérébral, il avait annoncé qu'il ne briguerait plus de nouveau mandat électif. C'est donc en juillet 2000 qu'il avait décidé de mettre un terme définitif à cette longue et riche carrière politique. À quelques mois de laisser son fauteuil de sénateur, c'est dans ces conditions dramatiques qu'il confie malgré lui son siège à son suppléant mais surtout ami, le président du conseil général des Hautes-Pyrénées : François Fortassin, lequel devint sénateur le 3 mars 2001. Décédé le 2 mars 2001 à son domicile parisien, les obsèques de François Abadie se déroulèrent à Lourdes. La cérémonie religieuse s’étant tenue le mercredi 7 mars 2001 en l'église paroissiale du Sacré-Cœur de Lourdes. Il avait préféré renoncer à une carrière nationale ministérielle pour se consacrer à la politique dans le département et au développement de Lourdes. Pendant ses 18 années de mandat municipal, il a préparé Lourdes au XXIe siècle par des aménagements structurants. C'était un homme politique au parler vrai qui faisait passer avant tout le côté affectif et il se souciait moins de l'image que du ressenti. C'était surtout un homme de conviction, de fidélité et de foucades qui cachait une très grande sensibilité. Il aimait cette ville de Lourdes par-dessus tout et était très attaché à son équipe de rugby. Il a montré une grande capacité de gestionnaire durant ses années de maire à Lourdes. « Un homme qui avait toujours le courage de dire ce qu'il pensait même si cela dérangeait, un homme avec le cœur sur la main », dira de lui, Pierre Forgues. Les Lourdais lui doivent la salle des fêtes, le palais des congrès, la bibliothèque, les foyers de l’Ophite et de Lannedarré, la piscine couverte, les courts de tennis, le golf, le terrain de football de Lannedarré et la station de ski du Hautacam… François Abadie était chevalier des Palmes académiques. Il avait le titre de Vénérable de la loge « L’Internationale » et de la loge « La Renaissance de Paris ». Une avenue de Lourdes ainsi que le Palais des Sports ont été baptisés de son nom.ABADIE Henri (1963-XXXX)
Coureur cycliste professionnel
 Henri ABADIE, né le 13 février 1963 à Tarbes est un coureur cycliste professionnel. Licencié à l'Union Cycliste Tarbes il se fait remarquer en 1985 en remportant l’étape du Puy-de-Dôme de la Route de France et en se classant 2e du Tour de Gironde. Il passe professionnel en 1986 à l’âge de 22 ans, dans l'équipe Fagor. Après une première victoire obtenue dès sa première saison sur la 15e étape du Tour du Portugal, il s'affirme comme un bon grimpeur en 1987, terminant 19e du Critérium du Dauphiné libéré, et deux fois 2e d'étape sur le Tour d'Espagne. Ses nombreuses échappées sur cette course lui permettent de remporter le classement des sprints intermédiaires. En 1988, il rejoint l'équipe Z-Peugeot. Il y termine 4e du Grand Prix de Plumelec, puis remporte en 1989 sa première et unique course d'un jour, le Trophée des grimpeurs à Chanteloup, ainsi que des étapes de la Route du Sud, puis du Grand Prix du Midi Libre en 1990 (1er de la 1ère étape), où il porte le maillot jaune trois jours durant. L’année 1989, il termine aussi 12e de la classique belge Liège-Bastogne-Liège, ce qui lui permet de figurer à la 192e place du classement FICP, son meilleur classement. À l'occasion de sa première participation au Tour de France, il bénéficia d'une popularité inattendue grâce à la sympathie qu'éprouvait pour lui le présentateur vedette Jacques Chancel, qui en fera une des mascottes de son émission de télévision « À chacun son tour ». En 1991, il rejoint Toshiba, où il remporte son dernier succès, la 4e étape du Critérium du Dauphiné libéré. Il met fin à sa carrière professionnelle en 1992, alors qu'il court pour Chazal. Il participa à deux Tours de France, en 1988 où il se classera 44ème et en 1991 où il terminera 108ème. En 1988, lors de l’étape Morzine - l’Alpe-d’Huez, il passa en tête au sommet du col de la Madeleine (1993m). Il courut aussi deux Tours d’Italie en 1986 (114e) et en 1990 (48e). Aujourd’hui Henri ABADIE exerce comme kinésithérapeute à Tarbes.
Henri ABADIE, né le 13 février 1963 à Tarbes est un coureur cycliste professionnel. Licencié à l'Union Cycliste Tarbes il se fait remarquer en 1985 en remportant l’étape du Puy-de-Dôme de la Route de France et en se classant 2e du Tour de Gironde. Il passe professionnel en 1986 à l’âge de 22 ans, dans l'équipe Fagor. Après une première victoire obtenue dès sa première saison sur la 15e étape du Tour du Portugal, il s'affirme comme un bon grimpeur en 1987, terminant 19e du Critérium du Dauphiné libéré, et deux fois 2e d'étape sur le Tour d'Espagne. Ses nombreuses échappées sur cette course lui permettent de remporter le classement des sprints intermédiaires. En 1988, il rejoint l'équipe Z-Peugeot. Il y termine 4e du Grand Prix de Plumelec, puis remporte en 1989 sa première et unique course d'un jour, le Trophée des grimpeurs à Chanteloup, ainsi que des étapes de la Route du Sud, puis du Grand Prix du Midi Libre en 1990 (1er de la 1ère étape), où il porte le maillot jaune trois jours durant. L’année 1989, il termine aussi 12e de la classique belge Liège-Bastogne-Liège, ce qui lui permet de figurer à la 192e place du classement FICP, son meilleur classement. À l'occasion de sa première participation au Tour de France, il bénéficia d'une popularité inattendue grâce à la sympathie qu'éprouvait pour lui le présentateur vedette Jacques Chancel, qui en fera une des mascottes de son émission de télévision « À chacun son tour ». En 1991, il rejoint Toshiba, où il remporte son dernier succès, la 4e étape du Critérium du Dauphiné libéré. Il met fin à sa carrière professionnelle en 1992, alors qu'il court pour Chazal. Il participa à deux Tours de France, en 1988 où il se classera 44ème et en 1991 où il terminera 108ème. En 1988, lors de l’étape Morzine - l’Alpe-d’Huez, il passa en tête au sommet du col de la Madeleine (1993m). Il courut aussi deux Tours d’Italie en 1986 (114e) et en 1990 (48e). Aujourd’hui Henri ABADIE exerce comme kinésithérapeute à Tarbes.
 Henri ABADIE, né le 13 février 1963 à Tarbes est un coureur cycliste professionnel. Licencié à l'Union Cycliste Tarbes il se fait remarquer en 1985 en remportant l’étape du Puy-de-Dôme de la Route de France et en se classant 2e du Tour de Gironde. Il passe professionnel en 1986 à l’âge de 22 ans, dans l'équipe Fagor. Après une première victoire obtenue dès sa première saison sur la 15e étape du Tour du Portugal, il s'affirme comme un bon grimpeur en 1987, terminant 19e du Critérium du Dauphiné libéré, et deux fois 2e d'étape sur le Tour d'Espagne. Ses nombreuses échappées sur cette course lui permettent de remporter le classement des sprints intermédiaires. En 1988, il rejoint l'équipe Z-Peugeot. Il y termine 4e du Grand Prix de Plumelec, puis remporte en 1989 sa première et unique course d'un jour, le Trophée des grimpeurs à Chanteloup, ainsi que des étapes de la Route du Sud, puis du Grand Prix du Midi Libre en 1990 (1er de la 1ère étape), où il porte le maillot jaune trois jours durant. L’année 1989, il termine aussi 12e de la classique belge Liège-Bastogne-Liège, ce qui lui permet de figurer à la 192e place du classement FICP, son meilleur classement. À l'occasion de sa première participation au Tour de France, il bénéficia d'une popularité inattendue grâce à la sympathie qu'éprouvait pour lui le présentateur vedette Jacques Chancel, qui en fera une des mascottes de son émission de télévision « À chacun son tour ». En 1991, il rejoint Toshiba, où il remporte son dernier succès, la 4e étape du Critérium du Dauphiné libéré. Il met fin à sa carrière professionnelle en 1992, alors qu'il court pour Chazal. Il participa à deux Tours de France, en 1988 où il se classera 44ème et en 1991 où il terminera 108ème. En 1988, lors de l’étape Morzine - l’Alpe-d’Huez, il passa en tête au sommet du col de la Madeleine (1993m). Il courut aussi deux Tours d’Italie en 1986 (114e) et en 1990 (48e). Aujourd’hui Henri ABADIE exerce comme kinésithérapeute à Tarbes.
Henri ABADIE, né le 13 février 1963 à Tarbes est un coureur cycliste professionnel. Licencié à l'Union Cycliste Tarbes il se fait remarquer en 1985 en remportant l’étape du Puy-de-Dôme de la Route de France et en se classant 2e du Tour de Gironde. Il passe professionnel en 1986 à l’âge de 22 ans, dans l'équipe Fagor. Après une première victoire obtenue dès sa première saison sur la 15e étape du Tour du Portugal, il s'affirme comme un bon grimpeur en 1987, terminant 19e du Critérium du Dauphiné libéré, et deux fois 2e d'étape sur le Tour d'Espagne. Ses nombreuses échappées sur cette course lui permettent de remporter le classement des sprints intermédiaires. En 1988, il rejoint l'équipe Z-Peugeot. Il y termine 4e du Grand Prix de Plumelec, puis remporte en 1989 sa première et unique course d'un jour, le Trophée des grimpeurs à Chanteloup, ainsi que des étapes de la Route du Sud, puis du Grand Prix du Midi Libre en 1990 (1er de la 1ère étape), où il porte le maillot jaune trois jours durant. L’année 1989, il termine aussi 12e de la classique belge Liège-Bastogne-Liège, ce qui lui permet de figurer à la 192e place du classement FICP, son meilleur classement. À l'occasion de sa première participation au Tour de France, il bénéficia d'une popularité inattendue grâce à la sympathie qu'éprouvait pour lui le présentateur vedette Jacques Chancel, qui en fera une des mascottes de son émission de télévision « À chacun son tour ». En 1991, il rejoint Toshiba, où il remporte son dernier succès, la 4e étape du Critérium du Dauphiné libéré. Il met fin à sa carrière professionnelle en 1992, alors qu'il court pour Chazal. Il participa à deux Tours de France, en 1988 où il se classera 44ème et en 1991 où il terminera 108ème. En 1988, lors de l’étape Morzine - l’Alpe-d’Huez, il passa en tête au sommet du col de la Madeleine (1993m). Il courut aussi deux Tours d’Italie en 1986 (114e) et en 1990 (48e). Aujourd’hui Henri ABADIE exerce comme kinésithérapeute à Tarbes.ADISSON Frank (1969-XXXX)
Kayakiste champion olympique
 Frank ADISSON, né le 24 juillet 1969 à Tarbes, est un sportif français, champion olympique de canoë biplace, médaillé de bronze aux Jeux olympiques à Barcelone en 1992 et médaillé d’or en 1996 aux JO d’été d’Atlanta avec Wilfrid Forgues, son coéquipier. Il avait déjà participé avec ce dernier lors de l'édition précédente à Barcelone, où ils avaient alors décroché la médaille de bronze. Ils ont également remporté plusieurs fois les championnats de France ainsi que les championnats du monde. Il a commencé à s’entraîner avec Wilfrid en 1984, et huit ans après ils ont eu une première médaille de bronze, et quatre ans après, ils sont devenus champions olympiques. Il a commenté le canoë-kayak lors des Jeux olympiques d'Athènes en 2004 avec Martial Fernandez et ceux de Pékin en 2008, de Londres en 2012 et de Rio en 2016 avec Richard Coffin. S’il est né dans les Hautes-Pyrénées, il habite depuis plusieurs années au pays des Écrins, où il est président du club de canoë kayak. Ses grands-parents pratiquaient déjà dans les années 40, où ils descendaient l’Ardèche en canoë sans croiser personne. Aussi, Frank pratique ce sport depuis qu’il était tout petit à Bagnères-de-Bigorre. Diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Lyon, il s’est reconverti dans le business de l’hydroélectricité, et dirige 4 entreprises. Il est directeur délégué de la Compagnie des Hautes Chutes de Roques, groupe qui exploite et gère 18 centrales hydroélectriques réparties sur les Alpes. Son palmarès : Médaille de bronze en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone en Espagne ; Médaille d'or en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta aux États-Unis ; Médailles d'or aux championnats du monde de slalom à Tacen en Slovénie en 1991 et à Tres Coroas au Brésil en 1997 ; Médaille d'argent au championnat du monde de slalom à Nottingham au Royaume-Uni en 1995 ; Médaille de bronze au championnat du monde à Mezzana en Italie en 1993 ; Médaille de bronze par équipe aux mondiaux de Seu d’Urgell en Espagne en 1999 ; 7ème place à une finale olympique à Sydney, en Australie, en 2000. L’or olympique est un métal précieux. Rares sont ceux qui le trouvent. Mais ils sont encore moins nombreux, après une carrière sportive réussie, à s’épanouir dans la vie normale. Frank Adisson, titré en 1996 aux JO d’Atlanta avec Wilfrid Forgues en canoë biplace, a connu le syndrome post-olympique. « En tant qu’athlète, j’étais totalement impliqué, concentré à 100 % vers mon objectif de l’année, qui était soit le championnat du monde, soit les Jeux olympiques. Je ne pouvais pas m’imaginer ce que c’était de travailler, c’était très théorique. » La pratique « dire oui à un chef, avoir des horaires fixes, travailler sans en comprendre la finalité » n’est pas à son goût. « Je ne me suis pas senti très heureux » se souvient-il. Au début des années 2000, le Bigourdan travaille dans la division marketing d’EDF. L’hydroélectricité, cette énergie verte, le fascine. « J’avais envie d’apporter ma pierre à la protection de l’environnement, mais de façon concrète. » Le canoéiste entend l’appel de la rivière. Il rejoint son oncle, qui possède de petites centrales dans les Pyrénées. Il se forme progressivement aux métiers de la branche, jusqu’à devenir un bon généraliste. L’entreprise Hydro Développement est créée en 2004 à L’Argentière-la-Bessée, dans les Hautes-Alpes, département dont Anne-Lise, sa femme, est originaire. « C’est une région que j’aime beaucoup, avec de belles rivières, parfaite pour les sports de plein air, et où on sent qu’il y a un bon accueil pour les entrepreneurs. » En 2006, lorsque l’État lance pour la première fois un appel d’offres pour la reprise d’une concession hydroélectrique arrivant à échéance, l’ex-champion se jette à l’eau pour obtenir le droit d’exploiter la Séveraisse, le torrent haut-alpin en question. « J’ai été très naïf : j’ai pensé que la mise en concurrence serait honnête. Dans le milieu d’où je viens, celui de la compétition, au départ on est tous à égalité. » D’autres estiment que les jeux sont faits, car EDF est candidate. Mais contre toute attente, David supplante Goliath. Aujourd’hui, l’entreprise fait partie du groupe Compagnie des Hautes Chutes de Roques (CHCR), dont Frank Adisson est le directeur général adjoint, et qui emploie 18 personnes entre Isère et Hautes-Alpes en exploitant 18 centrales. Le groupe poursuit son développement, mais aujourd’hui, le père de famille arrive à travailler moins, et profite de ses trois enfants. De sa passion, de toute façon, il ne voulait pas faire un métier. Il se contente donc de présider le club de canoë-kayak de L’Argentière-la-Bessée, où naviguent en famille les Adisson. Ô joie du temps retrouvé, le couple mythique Adisson-Forgues s’était même reformé dans le canoë. Pour se classer 10e français, après dix ans d’arrêt et sans s’entraîner ensemble ! Même « très, très loin des six meilleurs », l’alchimie demeure. « C’est magique, incroyable ! Mais quand il faut enchaîner quatre portes, physiquement, c’est dur… » De l’eau a coulé, depuis que Frank et Wilfried ont raccroché la pagaie. Même, l’entraîneur de Barcelone et d’Atlanta, est décédé. « Ça m’a fait un choc, des images hallucinantes sont remontées, comme si c’était hier. » Sauf que la ruée vers l’or en Amérique et le titre de Champion olympique, c’est vraiment du passé. Je regarde ça comme si c’était quelqu’un d’autre », réalise Frank Adisson. Peut-être est-ce parce qu’il a réussi sa reconversion, loin du sport. S’il devait donner un conseil aux athlètes de haut niveau, ce serait de prendre conscience qu’après la vie sportive, il y a un très long laps de temps qu’il faudra aussi réussir. « Quand on s’arrête à 30 ans, il en reste cinquante. Le bilan se tire à la fin. On peut avoir été très heureux en devenant champion olympique, et au final, être malheureux. » L’idéal serait, selon lui, que le champion trouve une autre passion, qui prendra la relève. « D’un point de vue professionnel, les sportifs de haut niveau sont souvent bons pour devenir entrepreneurs. Encore faut-il avoir la bonne idée. » Et ne pas en attendre trop, « se contenter du quotidien et des petits plaisirs ». Le bonheur est rare et précieux. Le bassin de slalom de Bagnères-de-Bigorre sur l’Adour porte les noms des deux coéquipiers. Licenciés à l’Amicale Laïque de canoë-kayak de Bagnères-de-Bigorre, l’équipage Franck Adisson et Wilfried (aujourd’hui Sandra) Forgues en canoë biplace avait commencé en catégorie cadet et ne cessera jusqu’à la fin de leur carrière couronnée par un sacre olympique. Ex-sportif de haut niveau, champion olympique, président-fondateur d’une première entreprise hydroélectrique, commentateur et consultant média à l'occasion de quatre éditions des Jeux olympiques d’été, fait Chevalier de la Légion d’honneur, notre céiste tarbais affiche un palmarès des plus impressionnants.
Frank ADISSON, né le 24 juillet 1969 à Tarbes, est un sportif français, champion olympique de canoë biplace, médaillé de bronze aux Jeux olympiques à Barcelone en 1992 et médaillé d’or en 1996 aux JO d’été d’Atlanta avec Wilfrid Forgues, son coéquipier. Il avait déjà participé avec ce dernier lors de l'édition précédente à Barcelone, où ils avaient alors décroché la médaille de bronze. Ils ont également remporté plusieurs fois les championnats de France ainsi que les championnats du monde. Il a commencé à s’entraîner avec Wilfrid en 1984, et huit ans après ils ont eu une première médaille de bronze, et quatre ans après, ils sont devenus champions olympiques. Il a commenté le canoë-kayak lors des Jeux olympiques d'Athènes en 2004 avec Martial Fernandez et ceux de Pékin en 2008, de Londres en 2012 et de Rio en 2016 avec Richard Coffin. S’il est né dans les Hautes-Pyrénées, il habite depuis plusieurs années au pays des Écrins, où il est président du club de canoë kayak. Ses grands-parents pratiquaient déjà dans les années 40, où ils descendaient l’Ardèche en canoë sans croiser personne. Aussi, Frank pratique ce sport depuis qu’il était tout petit à Bagnères-de-Bigorre. Diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Lyon, il s’est reconverti dans le business de l’hydroélectricité, et dirige 4 entreprises. Il est directeur délégué de la Compagnie des Hautes Chutes de Roques, groupe qui exploite et gère 18 centrales hydroélectriques réparties sur les Alpes. Son palmarès : Médaille de bronze en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone en Espagne ; Médaille d'or en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta aux États-Unis ; Médailles d'or aux championnats du monde de slalom à Tacen en Slovénie en 1991 et à Tres Coroas au Brésil en 1997 ; Médaille d'argent au championnat du monde de slalom à Nottingham au Royaume-Uni en 1995 ; Médaille de bronze au championnat du monde à Mezzana en Italie en 1993 ; Médaille de bronze par équipe aux mondiaux de Seu d’Urgell en Espagne en 1999 ; 7ème place à une finale olympique à Sydney, en Australie, en 2000. L’or olympique est un métal précieux. Rares sont ceux qui le trouvent. Mais ils sont encore moins nombreux, après une carrière sportive réussie, à s’épanouir dans la vie normale. Frank Adisson, titré en 1996 aux JO d’Atlanta avec Wilfrid Forgues en canoë biplace, a connu le syndrome post-olympique. « En tant qu’athlète, j’étais totalement impliqué, concentré à 100 % vers mon objectif de l’année, qui était soit le championnat du monde, soit les Jeux olympiques. Je ne pouvais pas m’imaginer ce que c’était de travailler, c’était très théorique. » La pratique « dire oui à un chef, avoir des horaires fixes, travailler sans en comprendre la finalité » n’est pas à son goût. « Je ne me suis pas senti très heureux » se souvient-il. Au début des années 2000, le Bigourdan travaille dans la division marketing d’EDF. L’hydroélectricité, cette énergie verte, le fascine. « J’avais envie d’apporter ma pierre à la protection de l’environnement, mais de façon concrète. » Le canoéiste entend l’appel de la rivière. Il rejoint son oncle, qui possède de petites centrales dans les Pyrénées. Il se forme progressivement aux métiers de la branche, jusqu’à devenir un bon généraliste. L’entreprise Hydro Développement est créée en 2004 à L’Argentière-la-Bessée, dans les Hautes-Alpes, département dont Anne-Lise, sa femme, est originaire. « C’est une région que j’aime beaucoup, avec de belles rivières, parfaite pour les sports de plein air, et où on sent qu’il y a un bon accueil pour les entrepreneurs. » En 2006, lorsque l’État lance pour la première fois un appel d’offres pour la reprise d’une concession hydroélectrique arrivant à échéance, l’ex-champion se jette à l’eau pour obtenir le droit d’exploiter la Séveraisse, le torrent haut-alpin en question. « J’ai été très naïf : j’ai pensé que la mise en concurrence serait honnête. Dans le milieu d’où je viens, celui de la compétition, au départ on est tous à égalité. » D’autres estiment que les jeux sont faits, car EDF est candidate. Mais contre toute attente, David supplante Goliath. Aujourd’hui, l’entreprise fait partie du groupe Compagnie des Hautes Chutes de Roques (CHCR), dont Frank Adisson est le directeur général adjoint, et qui emploie 18 personnes entre Isère et Hautes-Alpes en exploitant 18 centrales. Le groupe poursuit son développement, mais aujourd’hui, le père de famille arrive à travailler moins, et profite de ses trois enfants. De sa passion, de toute façon, il ne voulait pas faire un métier. Il se contente donc de présider le club de canoë-kayak de L’Argentière-la-Bessée, où naviguent en famille les Adisson. Ô joie du temps retrouvé, le couple mythique Adisson-Forgues s’était même reformé dans le canoë. Pour se classer 10e français, après dix ans d’arrêt et sans s’entraîner ensemble ! Même « très, très loin des six meilleurs », l’alchimie demeure. « C’est magique, incroyable ! Mais quand il faut enchaîner quatre portes, physiquement, c’est dur… » De l’eau a coulé, depuis que Frank et Wilfried ont raccroché la pagaie. Même, l’entraîneur de Barcelone et d’Atlanta, est décédé. « Ça m’a fait un choc, des images hallucinantes sont remontées, comme si c’était hier. » Sauf que la ruée vers l’or en Amérique et le titre de Champion olympique, c’est vraiment du passé. Je regarde ça comme si c’était quelqu’un d’autre », réalise Frank Adisson. Peut-être est-ce parce qu’il a réussi sa reconversion, loin du sport. S’il devait donner un conseil aux athlètes de haut niveau, ce serait de prendre conscience qu’après la vie sportive, il y a un très long laps de temps qu’il faudra aussi réussir. « Quand on s’arrête à 30 ans, il en reste cinquante. Le bilan se tire à la fin. On peut avoir été très heureux en devenant champion olympique, et au final, être malheureux. » L’idéal serait, selon lui, que le champion trouve une autre passion, qui prendra la relève. « D’un point de vue professionnel, les sportifs de haut niveau sont souvent bons pour devenir entrepreneurs. Encore faut-il avoir la bonne idée. » Et ne pas en attendre trop, « se contenter du quotidien et des petits plaisirs ». Le bonheur est rare et précieux. Le bassin de slalom de Bagnères-de-Bigorre sur l’Adour porte les noms des deux coéquipiers. Licenciés à l’Amicale Laïque de canoë-kayak de Bagnères-de-Bigorre, l’équipage Franck Adisson et Wilfried (aujourd’hui Sandra) Forgues en canoë biplace avait commencé en catégorie cadet et ne cessera jusqu’à la fin de leur carrière couronnée par un sacre olympique. Ex-sportif de haut niveau, champion olympique, président-fondateur d’une première entreprise hydroélectrique, commentateur et consultant média à l'occasion de quatre éditions des Jeux olympiques d’été, fait Chevalier de la Légion d’honneur, notre céiste tarbais affiche un palmarès des plus impressionnants.
 Frank ADISSON, né le 24 juillet 1969 à Tarbes, est un sportif français, champion olympique de canoë biplace, médaillé de bronze aux Jeux olympiques à Barcelone en 1992 et médaillé d’or en 1996 aux JO d’été d’Atlanta avec Wilfrid Forgues, son coéquipier. Il avait déjà participé avec ce dernier lors de l'édition précédente à Barcelone, où ils avaient alors décroché la médaille de bronze. Ils ont également remporté plusieurs fois les championnats de France ainsi que les championnats du monde. Il a commencé à s’entraîner avec Wilfrid en 1984, et huit ans après ils ont eu une première médaille de bronze, et quatre ans après, ils sont devenus champions olympiques. Il a commenté le canoë-kayak lors des Jeux olympiques d'Athènes en 2004 avec Martial Fernandez et ceux de Pékin en 2008, de Londres en 2012 et de Rio en 2016 avec Richard Coffin. S’il est né dans les Hautes-Pyrénées, il habite depuis plusieurs années au pays des Écrins, où il est président du club de canoë kayak. Ses grands-parents pratiquaient déjà dans les années 40, où ils descendaient l’Ardèche en canoë sans croiser personne. Aussi, Frank pratique ce sport depuis qu’il était tout petit à Bagnères-de-Bigorre. Diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Lyon, il s’est reconverti dans le business de l’hydroélectricité, et dirige 4 entreprises. Il est directeur délégué de la Compagnie des Hautes Chutes de Roques, groupe qui exploite et gère 18 centrales hydroélectriques réparties sur les Alpes. Son palmarès : Médaille de bronze en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone en Espagne ; Médaille d'or en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta aux États-Unis ; Médailles d'or aux championnats du monde de slalom à Tacen en Slovénie en 1991 et à Tres Coroas au Brésil en 1997 ; Médaille d'argent au championnat du monde de slalom à Nottingham au Royaume-Uni en 1995 ; Médaille de bronze au championnat du monde à Mezzana en Italie en 1993 ; Médaille de bronze par équipe aux mondiaux de Seu d’Urgell en Espagne en 1999 ; 7ème place à une finale olympique à Sydney, en Australie, en 2000. L’or olympique est un métal précieux. Rares sont ceux qui le trouvent. Mais ils sont encore moins nombreux, après une carrière sportive réussie, à s’épanouir dans la vie normale. Frank Adisson, titré en 1996 aux JO d’Atlanta avec Wilfrid Forgues en canoë biplace, a connu le syndrome post-olympique. « En tant qu’athlète, j’étais totalement impliqué, concentré à 100 % vers mon objectif de l’année, qui était soit le championnat du monde, soit les Jeux olympiques. Je ne pouvais pas m’imaginer ce que c’était de travailler, c’était très théorique. » La pratique « dire oui à un chef, avoir des horaires fixes, travailler sans en comprendre la finalité » n’est pas à son goût. « Je ne me suis pas senti très heureux » se souvient-il. Au début des années 2000, le Bigourdan travaille dans la division marketing d’EDF. L’hydroélectricité, cette énergie verte, le fascine. « J’avais envie d’apporter ma pierre à la protection de l’environnement, mais de façon concrète. » Le canoéiste entend l’appel de la rivière. Il rejoint son oncle, qui possède de petites centrales dans les Pyrénées. Il se forme progressivement aux métiers de la branche, jusqu’à devenir un bon généraliste. L’entreprise Hydro Développement est créée en 2004 à L’Argentière-la-Bessée, dans les Hautes-Alpes, département dont Anne-Lise, sa femme, est originaire. « C’est une région que j’aime beaucoup, avec de belles rivières, parfaite pour les sports de plein air, et où on sent qu’il y a un bon accueil pour les entrepreneurs. » En 2006, lorsque l’État lance pour la première fois un appel d’offres pour la reprise d’une concession hydroélectrique arrivant à échéance, l’ex-champion se jette à l’eau pour obtenir le droit d’exploiter la Séveraisse, le torrent haut-alpin en question. « J’ai été très naïf : j’ai pensé que la mise en concurrence serait honnête. Dans le milieu d’où je viens, celui de la compétition, au départ on est tous à égalité. » D’autres estiment que les jeux sont faits, car EDF est candidate. Mais contre toute attente, David supplante Goliath. Aujourd’hui, l’entreprise fait partie du groupe Compagnie des Hautes Chutes de Roques (CHCR), dont Frank Adisson est le directeur général adjoint, et qui emploie 18 personnes entre Isère et Hautes-Alpes en exploitant 18 centrales. Le groupe poursuit son développement, mais aujourd’hui, le père de famille arrive à travailler moins, et profite de ses trois enfants. De sa passion, de toute façon, il ne voulait pas faire un métier. Il se contente donc de présider le club de canoë-kayak de L’Argentière-la-Bessée, où naviguent en famille les Adisson. Ô joie du temps retrouvé, le couple mythique Adisson-Forgues s’était même reformé dans le canoë. Pour se classer 10e français, après dix ans d’arrêt et sans s’entraîner ensemble ! Même « très, très loin des six meilleurs », l’alchimie demeure. « C’est magique, incroyable ! Mais quand il faut enchaîner quatre portes, physiquement, c’est dur… » De l’eau a coulé, depuis que Frank et Wilfried ont raccroché la pagaie. Même, l’entraîneur de Barcelone et d’Atlanta, est décédé. « Ça m’a fait un choc, des images hallucinantes sont remontées, comme si c’était hier. » Sauf que la ruée vers l’or en Amérique et le titre de Champion olympique, c’est vraiment du passé. Je regarde ça comme si c’était quelqu’un d’autre », réalise Frank Adisson. Peut-être est-ce parce qu’il a réussi sa reconversion, loin du sport. S’il devait donner un conseil aux athlètes de haut niveau, ce serait de prendre conscience qu’après la vie sportive, il y a un très long laps de temps qu’il faudra aussi réussir. « Quand on s’arrête à 30 ans, il en reste cinquante. Le bilan se tire à la fin. On peut avoir été très heureux en devenant champion olympique, et au final, être malheureux. » L’idéal serait, selon lui, que le champion trouve une autre passion, qui prendra la relève. « D’un point de vue professionnel, les sportifs de haut niveau sont souvent bons pour devenir entrepreneurs. Encore faut-il avoir la bonne idée. » Et ne pas en attendre trop, « se contenter du quotidien et des petits plaisirs ». Le bonheur est rare et précieux. Le bassin de slalom de Bagnères-de-Bigorre sur l’Adour porte les noms des deux coéquipiers. Licenciés à l’Amicale Laïque de canoë-kayak de Bagnères-de-Bigorre, l’équipage Franck Adisson et Wilfried (aujourd’hui Sandra) Forgues en canoë biplace avait commencé en catégorie cadet et ne cessera jusqu’à la fin de leur carrière couronnée par un sacre olympique. Ex-sportif de haut niveau, champion olympique, président-fondateur d’une première entreprise hydroélectrique, commentateur et consultant média à l'occasion de quatre éditions des Jeux olympiques d’été, fait Chevalier de la Légion d’honneur, notre céiste tarbais affiche un palmarès des plus impressionnants.
Frank ADISSON, né le 24 juillet 1969 à Tarbes, est un sportif français, champion olympique de canoë biplace, médaillé de bronze aux Jeux olympiques à Barcelone en 1992 et médaillé d’or en 1996 aux JO d’été d’Atlanta avec Wilfrid Forgues, son coéquipier. Il avait déjà participé avec ce dernier lors de l'édition précédente à Barcelone, où ils avaient alors décroché la médaille de bronze. Ils ont également remporté plusieurs fois les championnats de France ainsi que les championnats du monde. Il a commencé à s’entraîner avec Wilfrid en 1984, et huit ans après ils ont eu une première médaille de bronze, et quatre ans après, ils sont devenus champions olympiques. Il a commenté le canoë-kayak lors des Jeux olympiques d'Athènes en 2004 avec Martial Fernandez et ceux de Pékin en 2008, de Londres en 2012 et de Rio en 2016 avec Richard Coffin. S’il est né dans les Hautes-Pyrénées, il habite depuis plusieurs années au pays des Écrins, où il est président du club de canoë kayak. Ses grands-parents pratiquaient déjà dans les années 40, où ils descendaient l’Ardèche en canoë sans croiser personne. Aussi, Frank pratique ce sport depuis qu’il était tout petit à Bagnères-de-Bigorre. Diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Lyon, il s’est reconverti dans le business de l’hydroélectricité, et dirige 4 entreprises. Il est directeur délégué de la Compagnie des Hautes Chutes de Roques, groupe qui exploite et gère 18 centrales hydroélectriques réparties sur les Alpes. Son palmarès : Médaille de bronze en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone en Espagne ; Médaille d'or en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta aux États-Unis ; Médailles d'or aux championnats du monde de slalom à Tacen en Slovénie en 1991 et à Tres Coroas au Brésil en 1997 ; Médaille d'argent au championnat du monde de slalom à Nottingham au Royaume-Uni en 1995 ; Médaille de bronze au championnat du monde à Mezzana en Italie en 1993 ; Médaille de bronze par équipe aux mondiaux de Seu d’Urgell en Espagne en 1999 ; 7ème place à une finale olympique à Sydney, en Australie, en 2000. L’or olympique est un métal précieux. Rares sont ceux qui le trouvent. Mais ils sont encore moins nombreux, après une carrière sportive réussie, à s’épanouir dans la vie normale. Frank Adisson, titré en 1996 aux JO d’Atlanta avec Wilfrid Forgues en canoë biplace, a connu le syndrome post-olympique. « En tant qu’athlète, j’étais totalement impliqué, concentré à 100 % vers mon objectif de l’année, qui était soit le championnat du monde, soit les Jeux olympiques. Je ne pouvais pas m’imaginer ce que c’était de travailler, c’était très théorique. » La pratique « dire oui à un chef, avoir des horaires fixes, travailler sans en comprendre la finalité » n’est pas à son goût. « Je ne me suis pas senti très heureux » se souvient-il. Au début des années 2000, le Bigourdan travaille dans la division marketing d’EDF. L’hydroélectricité, cette énergie verte, le fascine. « J’avais envie d’apporter ma pierre à la protection de l’environnement, mais de façon concrète. » Le canoéiste entend l’appel de la rivière. Il rejoint son oncle, qui possède de petites centrales dans les Pyrénées. Il se forme progressivement aux métiers de la branche, jusqu’à devenir un bon généraliste. L’entreprise Hydro Développement est créée en 2004 à L’Argentière-la-Bessée, dans les Hautes-Alpes, département dont Anne-Lise, sa femme, est originaire. « C’est une région que j’aime beaucoup, avec de belles rivières, parfaite pour les sports de plein air, et où on sent qu’il y a un bon accueil pour les entrepreneurs. » En 2006, lorsque l’État lance pour la première fois un appel d’offres pour la reprise d’une concession hydroélectrique arrivant à échéance, l’ex-champion se jette à l’eau pour obtenir le droit d’exploiter la Séveraisse, le torrent haut-alpin en question. « J’ai été très naïf : j’ai pensé que la mise en concurrence serait honnête. Dans le milieu d’où je viens, celui de la compétition, au départ on est tous à égalité. » D’autres estiment que les jeux sont faits, car EDF est candidate. Mais contre toute attente, David supplante Goliath. Aujourd’hui, l’entreprise fait partie du groupe Compagnie des Hautes Chutes de Roques (CHCR), dont Frank Adisson est le directeur général adjoint, et qui emploie 18 personnes entre Isère et Hautes-Alpes en exploitant 18 centrales. Le groupe poursuit son développement, mais aujourd’hui, le père de famille arrive à travailler moins, et profite de ses trois enfants. De sa passion, de toute façon, il ne voulait pas faire un métier. Il se contente donc de présider le club de canoë-kayak de L’Argentière-la-Bessée, où naviguent en famille les Adisson. Ô joie du temps retrouvé, le couple mythique Adisson-Forgues s’était même reformé dans le canoë. Pour se classer 10e français, après dix ans d’arrêt et sans s’entraîner ensemble ! Même « très, très loin des six meilleurs », l’alchimie demeure. « C’est magique, incroyable ! Mais quand il faut enchaîner quatre portes, physiquement, c’est dur… » De l’eau a coulé, depuis que Frank et Wilfried ont raccroché la pagaie. Même, l’entraîneur de Barcelone et d’Atlanta, est décédé. « Ça m’a fait un choc, des images hallucinantes sont remontées, comme si c’était hier. » Sauf que la ruée vers l’or en Amérique et le titre de Champion olympique, c’est vraiment du passé. Je regarde ça comme si c’était quelqu’un d’autre », réalise Frank Adisson. Peut-être est-ce parce qu’il a réussi sa reconversion, loin du sport. S’il devait donner un conseil aux athlètes de haut niveau, ce serait de prendre conscience qu’après la vie sportive, il y a un très long laps de temps qu’il faudra aussi réussir. « Quand on s’arrête à 30 ans, il en reste cinquante. Le bilan se tire à la fin. On peut avoir été très heureux en devenant champion olympique, et au final, être malheureux. » L’idéal serait, selon lui, que le champion trouve une autre passion, qui prendra la relève. « D’un point de vue professionnel, les sportifs de haut niveau sont souvent bons pour devenir entrepreneurs. Encore faut-il avoir la bonne idée. » Et ne pas en attendre trop, « se contenter du quotidien et des petits plaisirs ». Le bonheur est rare et précieux. Le bassin de slalom de Bagnères-de-Bigorre sur l’Adour porte les noms des deux coéquipiers. Licenciés à l’Amicale Laïque de canoë-kayak de Bagnères-de-Bigorre, l’équipage Franck Adisson et Wilfried (aujourd’hui Sandra) Forgues en canoë biplace avait commencé en catégorie cadet et ne cessera jusqu’à la fin de leur carrière couronnée par un sacre olympique. Ex-sportif de haut niveau, champion olympique, président-fondateur d’une première entreprise hydroélectrique, commentateur et consultant média à l'occasion de quatre éditions des Jeux olympiques d’été, fait Chevalier de la Légion d’honneur, notre céiste tarbais affiche un palmarès des plus impressionnants.AGUIRRE Jean-Michel (1951-XXXX)
Arrière international de rugby à XV dans les années 70
 Jean-Michel AGUIRRE, né le 2 novembre 1951 à Tostat est un joueur et entraîneur français de rugby à XV, évoluant au poste de demi de mêlée puis d’arrière. Il mesure 1m84 pour 85 kg. Il joua d’abord en 1968 à Tarbes en cadets puis à Bagnères-de-Bigorre. Il portera le maillot de l’équipe de France à 39 reprises, inscrivant 123 points. Jean-Michel Aguirre est pour toujours associé à Bagnères-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Il possédait un coup de pied particulièrement puissant, passant des pénalités de plus de 60 mètres. Le journaliste Jean-Paul Rey lui a consacré l'ouvrage « Aguirre, le rugby en plus » aux Éditions Calmann-Lévy, paru en 1977. En avril 1980, il joue deux matchs avec les Barbarians contre le Cardiff RFC puis le Swansea RFC, inscrivant douze points lors du premier match. Pendant sa carrière de joueur, il exerça la profession de professeur d'éducation physique à Tarbes. Au-delà de sa carrière d'entraîneur durant deux ans de l’équipe de Trévise en Italie (1989-1991) et de la Section paloise (1998-2000), il est cadre pendant vingt ans dans la collectivité territoriale, chargé de la culture et des sports à la mairie de Bagnères-de-Bigorre (1992-2002), puis directeur de la station de ski de La Mongie jusqu’en 2012. Il a également occupé le poste de consultant sportif sur RMC de 1983 à 1999, où il avait suivi et commenté dix-huit Tournois des Cinq nations, pour « garder l'esprit au rugby ». Son club fut le Stade bagnérais, qui a joué longtemps dans l’élite du rugby français. Son palmarès en club à Bagnères : finaliste du championnat de France en 1979 et 1981, aux côtés de Jean-François Gourdon et de Roland Bertranne. Au cours de sa carrière internationale, il fut sélectionné dans le XV tricolore à 39 reprises, comme demi de mêlée, puis essentiellement comme arrière de 1971 à 1980. Arrière du XV de France lors du Grand Chelem en 1977, durant la tournée d’été 1977 en Argentine il réussit à marquer 6 pénalités contre l'Argentine. La France battra la Nouvelle-Zélande le 11 novembre 1977, lors du test-match à Toulouse par 18 à 13, sauf qu’elle sera battue au match retour au Parc des Princes par 15 à 3. « Mais quand même en 1977, j'avais 26 ans et j'avais toute ma culture du rugby de ligne et de mouvement, que j'avais à Bagnères. » Un tournoi qui aura le plus marqué les gens dans l'histoire du rugby français. Remporter le Grand Chelem avec Jacques Fouroux, un capitaine qui sut mener ses hommes dans le Tournoi des Cinq nations : la France, l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande (vaincre tous ses adversaires sans perdre ni concéder de nul) en utilisant les mêmes joueurs lors des quatre matchs et sans encaisser d'essai. Du jamais vu et du jamais revu ! Ainsi, aujourd’hui encore, on chante leurs exploits : ils partirent à quinze, et sans aucun renfort, ils arrivèrent à quinze sans prendre un seul essai ! Sublime Grand Chelem ! « C'est-à-dire jouer avec les mêmes quinze joueurs et aussi sans encaisser d'essai. Et également parce qu'à l'époque, il y avait une grande équipe de rugby, le pays de Galles, qui était certainement la meilleure équipe au monde. C'est vrai que le remplacement existait à l'époque mais il fallait être quasiment mort ou saigner de partout. Seul le médecin disait qu'on pouvait être remplacé. Pourtant, dans ce tournoi, il y a eu des gars blessés mais ils sont restés sur le terrain. » Il fera partie deux ans plus tard du XV de France victorieux de l'équipe de Nouvelle-Zélande le 14 juillet 1979 à Auckland (24-19) sur la terre des mythiques All Blacks, Ce jour-là les Français, contre toute attente, sont allés s'imposer à Auckland face aux All Black, signant là la première victoire de l'équipe de France en terre néozélandaise. L’année 1979 marquera un tournant dans l'histoire du rugby français. Jean-Michel Aguirre vit aujourd'hui une retraite paisible sur la Côte basque, où il s'adonne le plus souvent au golf. Le président de l'association du Makila Golf club de Bassussarry, a gardé un œil attentif sur le rugby. Il sera également ambassadeur de la Fédération espagnole de Rugby auprès des clubs français. À l'heure des souvenirs, il évoque ce premier match au Parc des Princes contre le pays de Galles comme celui d'une finale qui ouvrait des horizons. La tension fut à son comble jusqu'à une pénalité que passa Romeu à la dernière minute. Les Français marquent deux essais grâce à des Toulousains : le premier par Jean-Claude Skrela, le futur sélectionneur des Bleus, et le second par Dominique Harize. Ajoutez à cela une transformation et deux pénalités : c’est une victoire française, 16 à 9. Voilà un très bon signe pour la suite du tournoi ! Un premier match du XV de France qui fut commenté sur Antenne 2 par Roger Couderc. Puis, le match contre l'Angleterre (4-3) au stade de Twickenham, qui se joua à guichets fermés devant 70.000 spectateurs. Un match très difficile, très âpre, dans une atmosphère calamiteuse. « On était arrivé avec une publicité assez négative. Ils nous avaient laissé une minute sous les huées et les sifflets du public. Dans le couloir, j'avais compris que le fair-play anglais n'était pas ce que je pensais puisqu'on s'était fait cracher dessus. Il s’en fallut de peu, mais le jeu musclé des Français leur offrit un surnom : la horde sauvage ! Ensuite, le 19 mars 1977, le match contre l'Écosse (23-3) était un match où on a envoyé du jeu, où il y a eu du mouvement, face à un adversaire relativement faible. » Et concernant l'Irlande (15-6) à Lansdowne Road, il se souvient parfaitement de l'essai point d'orgue du Grand Chelem d’anthologie du XV de France en 1977. « Cela part d'une conquête de balle, puis d'un coup de pied un peu difficile de Jean-Pierre Romeu sous pression, une récupération du ballon, une percée et l'essai de Jean-Pierre Bastiat bien aidé par un sprint de Jean-Michel Aguirre. » Ce sera donc le deuxième Grand Chelem pour le XV de France, qui cumule l'exploit de n'avoir encaissé aucun essai avec celui, plus exceptionnel, d'avoir aligné les mêmes quinze joueurs sur l'ensemble des quatre matches. Un exploit unique dans l'histoire du rugby et qui ne se renouvellera jamais. Ces quinze joueurs ne joueront plus jamais ensemble pour la France, pour le Tournoi, mais ils se retrouveront régulièrement dans le cadre des Barbarians français pour perpétuer la légende. Après 1980, Jean-Michel se consacra à son club de toujours, le Stade bagnérais, où, en qualité d'entraîneur, il essaya de faire « le lien entre l'ancien et le moderne ». Il avait brièvement tenté sa chance en Italie, à Trévise, puis il avait fait « un peu de rugby à sept » avec l'équipe de France. Jean-Michel Aguirre a été responsable de l'équipe de France de rugby à sept dans les années 90. En 1998, à quarante-sept ans, il effectuera une réapparition remarquée à l'avant-scène du rugby français, en acceptant le poste d'entraîneur de la Section paloise. En 2011, il a été fait Chevalier dans l'Ordre national du Mérite. Jean-Pierre Rives disait de Jean-Michel Aguirre, qu’il était le goal de Bagnères ! Ce qui le faisait rire. Sa première sélection, le 27 novembre 1971 contre l'Australie (18-9) et sa dernière sélection, le 1er mars 1980 contre l'Irlande (19-18). Joueur emblématique de Bagnères-de-Bigorre, arrière et demi de mêlée, qui a joué pour la France de 1971 à 1980, Jean-Michel Aguirre fut l’un des très grands joueurs français de rugby de ces années 70. Il fit sa première cape internationale quelques semaines seulement après son 20e anniversaire, endossant son premier maillot tricolore face à l'Australie en novembre 1971. Il a construit sa gloire et sa légende avec le Stade bagnérais et a marqué sa génération. Invité à « Radioscopie », il confiera à Jacques Chancel, cet autre Bigourdan : « Gagner est important mais l'essentiel est avant tout de prendre du plaisir, le rugby n'est qu'un jeu. »
Jean-Michel AGUIRRE, né le 2 novembre 1951 à Tostat est un joueur et entraîneur français de rugby à XV, évoluant au poste de demi de mêlée puis d’arrière. Il mesure 1m84 pour 85 kg. Il joua d’abord en 1968 à Tarbes en cadets puis à Bagnères-de-Bigorre. Il portera le maillot de l’équipe de France à 39 reprises, inscrivant 123 points. Jean-Michel Aguirre est pour toujours associé à Bagnères-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Il possédait un coup de pied particulièrement puissant, passant des pénalités de plus de 60 mètres. Le journaliste Jean-Paul Rey lui a consacré l'ouvrage « Aguirre, le rugby en plus » aux Éditions Calmann-Lévy, paru en 1977. En avril 1980, il joue deux matchs avec les Barbarians contre le Cardiff RFC puis le Swansea RFC, inscrivant douze points lors du premier match. Pendant sa carrière de joueur, il exerça la profession de professeur d'éducation physique à Tarbes. Au-delà de sa carrière d'entraîneur durant deux ans de l’équipe de Trévise en Italie (1989-1991) et de la Section paloise (1998-2000), il est cadre pendant vingt ans dans la collectivité territoriale, chargé de la culture et des sports à la mairie de Bagnères-de-Bigorre (1992-2002), puis directeur de la station de ski de La Mongie jusqu’en 2012. Il a également occupé le poste de consultant sportif sur RMC de 1983 à 1999, où il avait suivi et commenté dix-huit Tournois des Cinq nations, pour « garder l'esprit au rugby ». Son club fut le Stade bagnérais, qui a joué longtemps dans l’élite du rugby français. Son palmarès en club à Bagnères : finaliste du championnat de France en 1979 et 1981, aux côtés de Jean-François Gourdon et de Roland Bertranne. Au cours de sa carrière internationale, il fut sélectionné dans le XV tricolore à 39 reprises, comme demi de mêlée, puis essentiellement comme arrière de 1971 à 1980. Arrière du XV de France lors du Grand Chelem en 1977, durant la tournée d’été 1977 en Argentine il réussit à marquer 6 pénalités contre l'Argentine. La France battra la Nouvelle-Zélande le 11 novembre 1977, lors du test-match à Toulouse par 18 à 13, sauf qu’elle sera battue au match retour au Parc des Princes par 15 à 3. « Mais quand même en 1977, j'avais 26 ans et j'avais toute ma culture du rugby de ligne et de mouvement, que j'avais à Bagnères. » Un tournoi qui aura le plus marqué les gens dans l'histoire du rugby français. Remporter le Grand Chelem avec Jacques Fouroux, un capitaine qui sut mener ses hommes dans le Tournoi des Cinq nations : la France, l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande (vaincre tous ses adversaires sans perdre ni concéder de nul) en utilisant les mêmes joueurs lors des quatre matchs et sans encaisser d'essai. Du jamais vu et du jamais revu ! Ainsi, aujourd’hui encore, on chante leurs exploits : ils partirent à quinze, et sans aucun renfort, ils arrivèrent à quinze sans prendre un seul essai ! Sublime Grand Chelem ! « C'est-à-dire jouer avec les mêmes quinze joueurs et aussi sans encaisser d'essai. Et également parce qu'à l'époque, il y avait une grande équipe de rugby, le pays de Galles, qui était certainement la meilleure équipe au monde. C'est vrai que le remplacement existait à l'époque mais il fallait être quasiment mort ou saigner de partout. Seul le médecin disait qu'on pouvait être remplacé. Pourtant, dans ce tournoi, il y a eu des gars blessés mais ils sont restés sur le terrain. » Il fera partie deux ans plus tard du XV de France victorieux de l'équipe de Nouvelle-Zélande le 14 juillet 1979 à Auckland (24-19) sur la terre des mythiques All Blacks, Ce jour-là les Français, contre toute attente, sont allés s'imposer à Auckland face aux All Black, signant là la première victoire de l'équipe de France en terre néozélandaise. L’année 1979 marquera un tournant dans l'histoire du rugby français. Jean-Michel Aguirre vit aujourd'hui une retraite paisible sur la Côte basque, où il s'adonne le plus souvent au golf. Le président de l'association du Makila Golf club de Bassussarry, a gardé un œil attentif sur le rugby. Il sera également ambassadeur de la Fédération espagnole de Rugby auprès des clubs français. À l'heure des souvenirs, il évoque ce premier match au Parc des Princes contre le pays de Galles comme celui d'une finale qui ouvrait des horizons. La tension fut à son comble jusqu'à une pénalité que passa Romeu à la dernière minute. Les Français marquent deux essais grâce à des Toulousains : le premier par Jean-Claude Skrela, le futur sélectionneur des Bleus, et le second par Dominique Harize. Ajoutez à cela une transformation et deux pénalités : c’est une victoire française, 16 à 9. Voilà un très bon signe pour la suite du tournoi ! Un premier match du XV de France qui fut commenté sur Antenne 2 par Roger Couderc. Puis, le match contre l'Angleterre (4-3) au stade de Twickenham, qui se joua à guichets fermés devant 70.000 spectateurs. Un match très difficile, très âpre, dans une atmosphère calamiteuse. « On était arrivé avec une publicité assez négative. Ils nous avaient laissé une minute sous les huées et les sifflets du public. Dans le couloir, j'avais compris que le fair-play anglais n'était pas ce que je pensais puisqu'on s'était fait cracher dessus. Il s’en fallut de peu, mais le jeu musclé des Français leur offrit un surnom : la horde sauvage ! Ensuite, le 19 mars 1977, le match contre l'Écosse (23-3) était un match où on a envoyé du jeu, où il y a eu du mouvement, face à un adversaire relativement faible. » Et concernant l'Irlande (15-6) à Lansdowne Road, il se souvient parfaitement de l'essai point d'orgue du Grand Chelem d’anthologie du XV de France en 1977. « Cela part d'une conquête de balle, puis d'un coup de pied un peu difficile de Jean-Pierre Romeu sous pression, une récupération du ballon, une percée et l'essai de Jean-Pierre Bastiat bien aidé par un sprint de Jean-Michel Aguirre. » Ce sera donc le deuxième Grand Chelem pour le XV de France, qui cumule l'exploit de n'avoir encaissé aucun essai avec celui, plus exceptionnel, d'avoir aligné les mêmes quinze joueurs sur l'ensemble des quatre matches. Un exploit unique dans l'histoire du rugby et qui ne se renouvellera jamais. Ces quinze joueurs ne joueront plus jamais ensemble pour la France, pour le Tournoi, mais ils se retrouveront régulièrement dans le cadre des Barbarians français pour perpétuer la légende. Après 1980, Jean-Michel se consacra à son club de toujours, le Stade bagnérais, où, en qualité d'entraîneur, il essaya de faire « le lien entre l'ancien et le moderne ». Il avait brièvement tenté sa chance en Italie, à Trévise, puis il avait fait « un peu de rugby à sept » avec l'équipe de France. Jean-Michel Aguirre a été responsable de l'équipe de France de rugby à sept dans les années 90. En 1998, à quarante-sept ans, il effectuera une réapparition remarquée à l'avant-scène du rugby français, en acceptant le poste d'entraîneur de la Section paloise. En 2011, il a été fait Chevalier dans l'Ordre national du Mérite. Jean-Pierre Rives disait de Jean-Michel Aguirre, qu’il était le goal de Bagnères ! Ce qui le faisait rire. Sa première sélection, le 27 novembre 1971 contre l'Australie (18-9) et sa dernière sélection, le 1er mars 1980 contre l'Irlande (19-18). Joueur emblématique de Bagnères-de-Bigorre, arrière et demi de mêlée, qui a joué pour la France de 1971 à 1980, Jean-Michel Aguirre fut l’un des très grands joueurs français de rugby de ces années 70. Il fit sa première cape internationale quelques semaines seulement après son 20e anniversaire, endossant son premier maillot tricolore face à l'Australie en novembre 1971. Il a construit sa gloire et sa légende avec le Stade bagnérais et a marqué sa génération. Invité à « Radioscopie », il confiera à Jacques Chancel, cet autre Bigourdan : « Gagner est important mais l'essentiel est avant tout de prendre du plaisir, le rugby n'est qu'un jeu. »
 Jean-Michel AGUIRRE, né le 2 novembre 1951 à Tostat est un joueur et entraîneur français de rugby à XV, évoluant au poste de demi de mêlée puis d’arrière. Il mesure 1m84 pour 85 kg. Il joua d’abord en 1968 à Tarbes en cadets puis à Bagnères-de-Bigorre. Il portera le maillot de l’équipe de France à 39 reprises, inscrivant 123 points. Jean-Michel Aguirre est pour toujours associé à Bagnères-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Il possédait un coup de pied particulièrement puissant, passant des pénalités de plus de 60 mètres. Le journaliste Jean-Paul Rey lui a consacré l'ouvrage « Aguirre, le rugby en plus » aux Éditions Calmann-Lévy, paru en 1977. En avril 1980, il joue deux matchs avec les Barbarians contre le Cardiff RFC puis le Swansea RFC, inscrivant douze points lors du premier match. Pendant sa carrière de joueur, il exerça la profession de professeur d'éducation physique à Tarbes. Au-delà de sa carrière d'entraîneur durant deux ans de l’équipe de Trévise en Italie (1989-1991) et de la Section paloise (1998-2000), il est cadre pendant vingt ans dans la collectivité territoriale, chargé de la culture et des sports à la mairie de Bagnères-de-Bigorre (1992-2002), puis directeur de la station de ski de La Mongie jusqu’en 2012. Il a également occupé le poste de consultant sportif sur RMC de 1983 à 1999, où il avait suivi et commenté dix-huit Tournois des Cinq nations, pour « garder l'esprit au rugby ». Son club fut le Stade bagnérais, qui a joué longtemps dans l’élite du rugby français. Son palmarès en club à Bagnères : finaliste du championnat de France en 1979 et 1981, aux côtés de Jean-François Gourdon et de Roland Bertranne. Au cours de sa carrière internationale, il fut sélectionné dans le XV tricolore à 39 reprises, comme demi de mêlée, puis essentiellement comme arrière de 1971 à 1980. Arrière du XV de France lors du Grand Chelem en 1977, durant la tournée d’été 1977 en Argentine il réussit à marquer 6 pénalités contre l'Argentine. La France battra la Nouvelle-Zélande le 11 novembre 1977, lors du test-match à Toulouse par 18 à 13, sauf qu’elle sera battue au match retour au Parc des Princes par 15 à 3. « Mais quand même en 1977, j'avais 26 ans et j'avais toute ma culture du rugby de ligne et de mouvement, que j'avais à Bagnères. » Un tournoi qui aura le plus marqué les gens dans l'histoire du rugby français. Remporter le Grand Chelem avec Jacques Fouroux, un capitaine qui sut mener ses hommes dans le Tournoi des Cinq nations : la France, l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande (vaincre tous ses adversaires sans perdre ni concéder de nul) en utilisant les mêmes joueurs lors des quatre matchs et sans encaisser d'essai. Du jamais vu et du jamais revu ! Ainsi, aujourd’hui encore, on chante leurs exploits : ils partirent à quinze, et sans aucun renfort, ils arrivèrent à quinze sans prendre un seul essai ! Sublime Grand Chelem ! « C'est-à-dire jouer avec les mêmes quinze joueurs et aussi sans encaisser d'essai. Et également parce qu'à l'époque, il y avait une grande équipe de rugby, le pays de Galles, qui était certainement la meilleure équipe au monde. C'est vrai que le remplacement existait à l'époque mais il fallait être quasiment mort ou saigner de partout. Seul le médecin disait qu'on pouvait être remplacé. Pourtant, dans ce tournoi, il y a eu des gars blessés mais ils sont restés sur le terrain. » Il fera partie deux ans plus tard du XV de France victorieux de l'équipe de Nouvelle-Zélande le 14 juillet 1979 à Auckland (24-19) sur la terre des mythiques All Blacks, Ce jour-là les Français, contre toute attente, sont allés s'imposer à Auckland face aux All Black, signant là la première victoire de l'équipe de France en terre néozélandaise. L’année 1979 marquera un tournant dans l'histoire du rugby français. Jean-Michel Aguirre vit aujourd'hui une retraite paisible sur la Côte basque, où il s'adonne le plus souvent au golf. Le président de l'association du Makila Golf club de Bassussarry, a gardé un œil attentif sur le rugby. Il sera également ambassadeur de la Fédération espagnole de Rugby auprès des clubs français. À l'heure des souvenirs, il évoque ce premier match au Parc des Princes contre le pays de Galles comme celui d'une finale qui ouvrait des horizons. La tension fut à son comble jusqu'à une pénalité que passa Romeu à la dernière minute. Les Français marquent deux essais grâce à des Toulousains : le premier par Jean-Claude Skrela, le futur sélectionneur des Bleus, et le second par Dominique Harize. Ajoutez à cela une transformation et deux pénalités : c’est une victoire française, 16 à 9. Voilà un très bon signe pour la suite du tournoi ! Un premier match du XV de France qui fut commenté sur Antenne 2 par Roger Couderc. Puis, le match contre l'Angleterre (4-3) au stade de Twickenham, qui se joua à guichets fermés devant 70.000 spectateurs. Un match très difficile, très âpre, dans une atmosphère calamiteuse. « On était arrivé avec une publicité assez négative. Ils nous avaient laissé une minute sous les huées et les sifflets du public. Dans le couloir, j'avais compris que le fair-play anglais n'était pas ce que je pensais puisqu'on s'était fait cracher dessus. Il s’en fallut de peu, mais le jeu musclé des Français leur offrit un surnom : la horde sauvage ! Ensuite, le 19 mars 1977, le match contre l'Écosse (23-3) était un match où on a envoyé du jeu, où il y a eu du mouvement, face à un adversaire relativement faible. » Et concernant l'Irlande (15-6) à Lansdowne Road, il se souvient parfaitement de l'essai point d'orgue du Grand Chelem d’anthologie du XV de France en 1977. « Cela part d'une conquête de balle, puis d'un coup de pied un peu difficile de Jean-Pierre Romeu sous pression, une récupération du ballon, une percée et l'essai de Jean-Pierre Bastiat bien aidé par un sprint de Jean-Michel Aguirre. » Ce sera donc le deuxième Grand Chelem pour le XV de France, qui cumule l'exploit de n'avoir encaissé aucun essai avec celui, plus exceptionnel, d'avoir aligné les mêmes quinze joueurs sur l'ensemble des quatre matches. Un exploit unique dans l'histoire du rugby et qui ne se renouvellera jamais. Ces quinze joueurs ne joueront plus jamais ensemble pour la France, pour le Tournoi, mais ils se retrouveront régulièrement dans le cadre des Barbarians français pour perpétuer la légende. Après 1980, Jean-Michel se consacra à son club de toujours, le Stade bagnérais, où, en qualité d'entraîneur, il essaya de faire « le lien entre l'ancien et le moderne ». Il avait brièvement tenté sa chance en Italie, à Trévise, puis il avait fait « un peu de rugby à sept » avec l'équipe de France. Jean-Michel Aguirre a été responsable de l'équipe de France de rugby à sept dans les années 90. En 1998, à quarante-sept ans, il effectuera une réapparition remarquée à l'avant-scène du rugby français, en acceptant le poste d'entraîneur de la Section paloise. En 2011, il a été fait Chevalier dans l'Ordre national du Mérite. Jean-Pierre Rives disait de Jean-Michel Aguirre, qu’il était le goal de Bagnères ! Ce qui le faisait rire. Sa première sélection, le 27 novembre 1971 contre l'Australie (18-9) et sa dernière sélection, le 1er mars 1980 contre l'Irlande (19-18). Joueur emblématique de Bagnères-de-Bigorre, arrière et demi de mêlée, qui a joué pour la France de 1971 à 1980, Jean-Michel Aguirre fut l’un des très grands joueurs français de rugby de ces années 70. Il fit sa première cape internationale quelques semaines seulement après son 20e anniversaire, endossant son premier maillot tricolore face à l'Australie en novembre 1971. Il a construit sa gloire et sa légende avec le Stade bagnérais et a marqué sa génération. Invité à « Radioscopie », il confiera à Jacques Chancel, cet autre Bigourdan : « Gagner est important mais l'essentiel est avant tout de prendre du plaisir, le rugby n'est qu'un jeu. »
Jean-Michel AGUIRRE, né le 2 novembre 1951 à Tostat est un joueur et entraîneur français de rugby à XV, évoluant au poste de demi de mêlée puis d’arrière. Il mesure 1m84 pour 85 kg. Il joua d’abord en 1968 à Tarbes en cadets puis à Bagnères-de-Bigorre. Il portera le maillot de l’équipe de France à 39 reprises, inscrivant 123 points. Jean-Michel Aguirre est pour toujours associé à Bagnères-de-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. Il possédait un coup de pied particulièrement puissant, passant des pénalités de plus de 60 mètres. Le journaliste Jean-Paul Rey lui a consacré l'ouvrage « Aguirre, le rugby en plus » aux Éditions Calmann-Lévy, paru en 1977. En avril 1980, il joue deux matchs avec les Barbarians contre le Cardiff RFC puis le Swansea RFC, inscrivant douze points lors du premier match. Pendant sa carrière de joueur, il exerça la profession de professeur d'éducation physique à Tarbes. Au-delà de sa carrière d'entraîneur durant deux ans de l’équipe de Trévise en Italie (1989-1991) et de la Section paloise (1998-2000), il est cadre pendant vingt ans dans la collectivité territoriale, chargé de la culture et des sports à la mairie de Bagnères-de-Bigorre (1992-2002), puis directeur de la station de ski de La Mongie jusqu’en 2012. Il a également occupé le poste de consultant sportif sur RMC de 1983 à 1999, où il avait suivi et commenté dix-huit Tournois des Cinq nations, pour « garder l'esprit au rugby ». Son club fut le Stade bagnérais, qui a joué longtemps dans l’élite du rugby français. Son palmarès en club à Bagnères : finaliste du championnat de France en 1979 et 1981, aux côtés de Jean-François Gourdon et de Roland Bertranne. Au cours de sa carrière internationale, il fut sélectionné dans le XV tricolore à 39 reprises, comme demi de mêlée, puis essentiellement comme arrière de 1971 à 1980. Arrière du XV de France lors du Grand Chelem en 1977, durant la tournée d’été 1977 en Argentine il réussit à marquer 6 pénalités contre l'Argentine. La France battra la Nouvelle-Zélande le 11 novembre 1977, lors du test-match à Toulouse par 18 à 13, sauf qu’elle sera battue au match retour au Parc des Princes par 15 à 3. « Mais quand même en 1977, j'avais 26 ans et j'avais toute ma culture du rugby de ligne et de mouvement, que j'avais à Bagnères. » Un tournoi qui aura le plus marqué les gens dans l'histoire du rugby français. Remporter le Grand Chelem avec Jacques Fouroux, un capitaine qui sut mener ses hommes dans le Tournoi des Cinq nations : la France, l’Angleterre, le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande (vaincre tous ses adversaires sans perdre ni concéder de nul) en utilisant les mêmes joueurs lors des quatre matchs et sans encaisser d'essai. Du jamais vu et du jamais revu ! Ainsi, aujourd’hui encore, on chante leurs exploits : ils partirent à quinze, et sans aucun renfort, ils arrivèrent à quinze sans prendre un seul essai ! Sublime Grand Chelem ! « C'est-à-dire jouer avec les mêmes quinze joueurs et aussi sans encaisser d'essai. Et également parce qu'à l'époque, il y avait une grande équipe de rugby, le pays de Galles, qui était certainement la meilleure équipe au monde. C'est vrai que le remplacement existait à l'époque mais il fallait être quasiment mort ou saigner de partout. Seul le médecin disait qu'on pouvait être remplacé. Pourtant, dans ce tournoi, il y a eu des gars blessés mais ils sont restés sur le terrain. » Il fera partie deux ans plus tard du XV de France victorieux de l'équipe de Nouvelle-Zélande le 14 juillet 1979 à Auckland (24-19) sur la terre des mythiques All Blacks, Ce jour-là les Français, contre toute attente, sont allés s'imposer à Auckland face aux All Black, signant là la première victoire de l'équipe de France en terre néozélandaise. L’année 1979 marquera un tournant dans l'histoire du rugby français. Jean-Michel Aguirre vit aujourd'hui une retraite paisible sur la Côte basque, où il s'adonne le plus souvent au golf. Le président de l'association du Makila Golf club de Bassussarry, a gardé un œil attentif sur le rugby. Il sera également ambassadeur de la Fédération espagnole de Rugby auprès des clubs français. À l'heure des souvenirs, il évoque ce premier match au Parc des Princes contre le pays de Galles comme celui d'une finale qui ouvrait des horizons. La tension fut à son comble jusqu'à une pénalité que passa Romeu à la dernière minute. Les Français marquent deux essais grâce à des Toulousains : le premier par Jean-Claude Skrela, le futur sélectionneur des Bleus, et le second par Dominique Harize. Ajoutez à cela une transformation et deux pénalités : c’est une victoire française, 16 à 9. Voilà un très bon signe pour la suite du tournoi ! Un premier match du XV de France qui fut commenté sur Antenne 2 par Roger Couderc. Puis, le match contre l'Angleterre (4-3) au stade de Twickenham, qui se joua à guichets fermés devant 70.000 spectateurs. Un match très difficile, très âpre, dans une atmosphère calamiteuse. « On était arrivé avec une publicité assez négative. Ils nous avaient laissé une minute sous les huées et les sifflets du public. Dans le couloir, j'avais compris que le fair-play anglais n'était pas ce que je pensais puisqu'on s'était fait cracher dessus. Il s’en fallut de peu, mais le jeu musclé des Français leur offrit un surnom : la horde sauvage ! Ensuite, le 19 mars 1977, le match contre l'Écosse (23-3) était un match où on a envoyé du jeu, où il y a eu du mouvement, face à un adversaire relativement faible. » Et concernant l'Irlande (15-6) à Lansdowne Road, il se souvient parfaitement de l'essai point d'orgue du Grand Chelem d’anthologie du XV de France en 1977. « Cela part d'une conquête de balle, puis d'un coup de pied un peu difficile de Jean-Pierre Romeu sous pression, une récupération du ballon, une percée et l'essai de Jean-Pierre Bastiat bien aidé par un sprint de Jean-Michel Aguirre. » Ce sera donc le deuxième Grand Chelem pour le XV de France, qui cumule l'exploit de n'avoir encaissé aucun essai avec celui, plus exceptionnel, d'avoir aligné les mêmes quinze joueurs sur l'ensemble des quatre matches. Un exploit unique dans l'histoire du rugby et qui ne se renouvellera jamais. Ces quinze joueurs ne joueront plus jamais ensemble pour la France, pour le Tournoi, mais ils se retrouveront régulièrement dans le cadre des Barbarians français pour perpétuer la légende. Après 1980, Jean-Michel se consacra à son club de toujours, le Stade bagnérais, où, en qualité d'entraîneur, il essaya de faire « le lien entre l'ancien et le moderne ». Il avait brièvement tenté sa chance en Italie, à Trévise, puis il avait fait « un peu de rugby à sept » avec l'équipe de France. Jean-Michel Aguirre a été responsable de l'équipe de France de rugby à sept dans les années 90. En 1998, à quarante-sept ans, il effectuera une réapparition remarquée à l'avant-scène du rugby français, en acceptant le poste d'entraîneur de la Section paloise. En 2011, il a été fait Chevalier dans l'Ordre national du Mérite. Jean-Pierre Rives disait de Jean-Michel Aguirre, qu’il était le goal de Bagnères ! Ce qui le faisait rire. Sa première sélection, le 27 novembre 1971 contre l'Australie (18-9) et sa dernière sélection, le 1er mars 1980 contre l'Irlande (19-18). Joueur emblématique de Bagnères-de-Bigorre, arrière et demi de mêlée, qui a joué pour la France de 1971 à 1980, Jean-Michel Aguirre fut l’un des très grands joueurs français de rugby de ces années 70. Il fit sa première cape internationale quelques semaines seulement après son 20e anniversaire, endossant son premier maillot tricolore face à l'Australie en novembre 1971. Il a construit sa gloire et sa légende avec le Stade bagnérais et a marqué sa génération. Invité à « Radioscopie », il confiera à Jacques Chancel, cet autre Bigourdan : « Gagner est important mais l'essentiel est avant tout de prendre du plaisir, le rugby n'est qu'un jeu. »ARMARY Louis (1963-XXXX)
Joueur de rugby à XV, pilier international
 Louis ARMARY, alias « Louisou » né le 24 juillet 1963 à Betpouey, est un joueur de rugby à XV qui fut sacré champion de France en 1995 avec Lourdes face à Romans. Louis Armary a occupé le poste de pilier gauche au FC Lourdes, et en sélection nationale, où il joua durant les saisons 1988, 1989 et 1990, fréquemment aux côtés de son compère de club Jean-Pierre Garuet-Lempirou, dit Garuche (Armary occupa cependant le poste de talonneur durant l’édition 1990 du tournoi). Il mesure 1m83 pour 102 kg. D'un poids modeste pour un pilier gauche international, il était cependant redouté dans l'épreuve de la mêlée fermée où sa technique et la puissance de son dos faisaient subir un véritable calvaire à ses adversaires. Le 1er mai 1980, il participe au premier match des Barbarians français contre l'Écosse à Agen. Les Baa-Baas l'emportent 26 à 22. Il a participé aux éditions 1987, 1991 et 1995 de la Coupe du monde. Il vainquit également les Sud-Africains lors de la tournée de 1993, et les All Blacks lors de celle de 1994. En mars 2015, il est élu conseiller départemental du canton de la Vallée des Gaves en tandem avec Chantal Robin-Rodrigo. Suite à son entrée au conseil départemental des Hautes-Pyrénées, il devient, le 7 mai 2015, président de l'Office départemental des Sports (ODS). Son palmarès : 46 sélections avec le XV de France (8 comme talonneur), du 28 mai 1987 (face à la Roumanie) au 17 juin 1995 (face à l'Afrique du Sud). Un essai lors du second test-match de la tournée en Australie, le 24 juin 1990 ; Vainqueur de trois tournois des Cinq Nations, en 1988 (ex æquo avec le Pays de Galles), 1989, 1993 et demi-finaliste de la Coupe du monde en 1995 ; Champion de France du groupe B avec Lourdes en 1995 contre Romans. Ses clubs d’attache : 1980-2000 FC Lourdes ; 2000-2001 Union Sportive (US) Argelès-Gazost (entraîneur et joueur). Skieur de 8 à 14 ans, à 17 ans il choisit le rugby et le FC Lourdes forcément pour vingt ans de fidélité. Pilier gauche de Lourdes, où il a effectué toute sa carrière de rugbyman entre 1980 et 2000, avant d’effectuer une pige comme entraîneur-joueur à l’US Argelès-Gazost, Louis Armary, habite à Ouzous, un petit village sur les hauteurs d’Argelès-Gazost. Il fut un temps où les joueurs ne changeaient pas de club. « Nous, à l’époque, on avait le clocher, le maillot, on était amateurs et pas professionnels », explique-t-il. Avec son compère Jean-Pierre Garuet, il aura eu une carrière exemplaire en Bigorre comme avec le XV de France, qu'il quitta sur la terrible demi-finale de Coupe du monde 1995. Salarié à la Lyonnaise des Eaux depuis 1986, il s’est toujours impliqué dans le rugby, comme joueur d’abord, puis comme éducateur à Argelès-Gazost ou élu au Comité Armagnac-Bigorre. Mais comment faire autrement lorsque ses deux fistons Geoffrey et Alexis manient l'ovale. Son fils Alexis, un solide gaillard d’1m92 pour 99 kg, a signé au Valence-Romans Drôme Rugby (VRDR) pour un nouveau challenge, après huit saisons disputées sous les couleurs du Stado Tarbes-Pyrénées Rugby (TPR). Si « Louisou » ne joue plus au rugby, il a troqué le ballon pour un vélo, qui dit-il le fait fondre et lui maintient la forme ! Étiqueté « Radical de gauche », il est à présent conseiller départemental du canton de la Vallée des Gaves et adjoint au maire d’Ouzous. Et même si sa notoriété n’est pas celle des Sella, Berbizier ou autres Blanco avec lesquels il a pourtant échangé le cuir, « Louisou » affiche pourtant un palmarès et un nombre de sélections à faire pâlir la jeune génération. Avec 46 capes, l’ex pilier gauche a battu les All Blacks, les Sud-Africains et participé à 3 coupes du monde ! En janvier 2020, Louis Armary, a été désigné en qualité de référent « Terre de Jeux 2024 ». Il fera le lien entre le département des Hautes-Pyrénées et le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris.
Louis ARMARY, alias « Louisou » né le 24 juillet 1963 à Betpouey, est un joueur de rugby à XV qui fut sacré champion de France en 1995 avec Lourdes face à Romans. Louis Armary a occupé le poste de pilier gauche au FC Lourdes, et en sélection nationale, où il joua durant les saisons 1988, 1989 et 1990, fréquemment aux côtés de son compère de club Jean-Pierre Garuet-Lempirou, dit Garuche (Armary occupa cependant le poste de talonneur durant l’édition 1990 du tournoi). Il mesure 1m83 pour 102 kg. D'un poids modeste pour un pilier gauche international, il était cependant redouté dans l'épreuve de la mêlée fermée où sa technique et la puissance de son dos faisaient subir un véritable calvaire à ses adversaires. Le 1er mai 1980, il participe au premier match des Barbarians français contre l'Écosse à Agen. Les Baa-Baas l'emportent 26 à 22. Il a participé aux éditions 1987, 1991 et 1995 de la Coupe du monde. Il vainquit également les Sud-Africains lors de la tournée de 1993, et les All Blacks lors de celle de 1994. En mars 2015, il est élu conseiller départemental du canton de la Vallée des Gaves en tandem avec Chantal Robin-Rodrigo. Suite à son entrée au conseil départemental des Hautes-Pyrénées, il devient, le 7 mai 2015, président de l'Office départemental des Sports (ODS). Son palmarès : 46 sélections avec le XV de France (8 comme talonneur), du 28 mai 1987 (face à la Roumanie) au 17 juin 1995 (face à l'Afrique du Sud). Un essai lors du second test-match de la tournée en Australie, le 24 juin 1990 ; Vainqueur de trois tournois des Cinq Nations, en 1988 (ex æquo avec le Pays de Galles), 1989, 1993 et demi-finaliste de la Coupe du monde en 1995 ; Champion de France du groupe B avec Lourdes en 1995 contre Romans. Ses clubs d’attache : 1980-2000 FC Lourdes ; 2000-2001 Union Sportive (US) Argelès-Gazost (entraîneur et joueur). Skieur de 8 à 14 ans, à 17 ans il choisit le rugby et le FC Lourdes forcément pour vingt ans de fidélité. Pilier gauche de Lourdes, où il a effectué toute sa carrière de rugbyman entre 1980 et 2000, avant d’effectuer une pige comme entraîneur-joueur à l’US Argelès-Gazost, Louis Armary, habite à Ouzous, un petit village sur les hauteurs d’Argelès-Gazost. Il fut un temps où les joueurs ne changeaient pas de club. « Nous, à l’époque, on avait le clocher, le maillot, on était amateurs et pas professionnels », explique-t-il. Avec son compère Jean-Pierre Garuet, il aura eu une carrière exemplaire en Bigorre comme avec le XV de France, qu'il quitta sur la terrible demi-finale de Coupe du monde 1995. Salarié à la Lyonnaise des Eaux depuis 1986, il s’est toujours impliqué dans le rugby, comme joueur d’abord, puis comme éducateur à Argelès-Gazost ou élu au Comité Armagnac-Bigorre. Mais comment faire autrement lorsque ses deux fistons Geoffrey et Alexis manient l'ovale. Son fils Alexis, un solide gaillard d’1m92 pour 99 kg, a signé au Valence-Romans Drôme Rugby (VRDR) pour un nouveau challenge, après huit saisons disputées sous les couleurs du Stado Tarbes-Pyrénées Rugby (TPR). Si « Louisou » ne joue plus au rugby, il a troqué le ballon pour un vélo, qui dit-il le fait fondre et lui maintient la forme ! Étiqueté « Radical de gauche », il est à présent conseiller départemental du canton de la Vallée des Gaves et adjoint au maire d’Ouzous. Et même si sa notoriété n’est pas celle des Sella, Berbizier ou autres Blanco avec lesquels il a pourtant échangé le cuir, « Louisou » affiche pourtant un palmarès et un nombre de sélections à faire pâlir la jeune génération. Avec 46 capes, l’ex pilier gauche a battu les All Blacks, les Sud-Africains et participé à 3 coupes du monde ! En janvier 2020, Louis Armary, a été désigné en qualité de référent « Terre de Jeux 2024 ». Il fera le lien entre le département des Hautes-Pyrénées et le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris.
 Louis ARMARY, alias « Louisou » né le 24 juillet 1963 à Betpouey, est un joueur de rugby à XV qui fut sacré champion de France en 1995 avec Lourdes face à Romans. Louis Armary a occupé le poste de pilier gauche au FC Lourdes, et en sélection nationale, où il joua durant les saisons 1988, 1989 et 1990, fréquemment aux côtés de son compère de club Jean-Pierre Garuet-Lempirou, dit Garuche (Armary occupa cependant le poste de talonneur durant l’édition 1990 du tournoi). Il mesure 1m83 pour 102 kg. D'un poids modeste pour un pilier gauche international, il était cependant redouté dans l'épreuve de la mêlée fermée où sa technique et la puissance de son dos faisaient subir un véritable calvaire à ses adversaires. Le 1er mai 1980, il participe au premier match des Barbarians français contre l'Écosse à Agen. Les Baa-Baas l'emportent 26 à 22. Il a participé aux éditions 1987, 1991 et 1995 de la Coupe du monde. Il vainquit également les Sud-Africains lors de la tournée de 1993, et les All Blacks lors de celle de 1994. En mars 2015, il est élu conseiller départemental du canton de la Vallée des Gaves en tandem avec Chantal Robin-Rodrigo. Suite à son entrée au conseil départemental des Hautes-Pyrénées, il devient, le 7 mai 2015, président de l'Office départemental des Sports (ODS). Son palmarès : 46 sélections avec le XV de France (8 comme talonneur), du 28 mai 1987 (face à la Roumanie) au 17 juin 1995 (face à l'Afrique du Sud). Un essai lors du second test-match de la tournée en Australie, le 24 juin 1990 ; Vainqueur de trois tournois des Cinq Nations, en 1988 (ex æquo avec le Pays de Galles), 1989, 1993 et demi-finaliste de la Coupe du monde en 1995 ; Champion de France du groupe B avec Lourdes en 1995 contre Romans. Ses clubs d’attache : 1980-2000 FC Lourdes ; 2000-2001 Union Sportive (US) Argelès-Gazost (entraîneur et joueur). Skieur de 8 à 14 ans, à 17 ans il choisit le rugby et le FC Lourdes forcément pour vingt ans de fidélité. Pilier gauche de Lourdes, où il a effectué toute sa carrière de rugbyman entre 1980 et 2000, avant d’effectuer une pige comme entraîneur-joueur à l’US Argelès-Gazost, Louis Armary, habite à Ouzous, un petit village sur les hauteurs d’Argelès-Gazost. Il fut un temps où les joueurs ne changeaient pas de club. « Nous, à l’époque, on avait le clocher, le maillot, on était amateurs et pas professionnels », explique-t-il. Avec son compère Jean-Pierre Garuet, il aura eu une carrière exemplaire en Bigorre comme avec le XV de France, qu'il quitta sur la terrible demi-finale de Coupe du monde 1995. Salarié à la Lyonnaise des Eaux depuis 1986, il s’est toujours impliqué dans le rugby, comme joueur d’abord, puis comme éducateur à Argelès-Gazost ou élu au Comité Armagnac-Bigorre. Mais comment faire autrement lorsque ses deux fistons Geoffrey et Alexis manient l'ovale. Son fils Alexis, un solide gaillard d’1m92 pour 99 kg, a signé au Valence-Romans Drôme Rugby (VRDR) pour un nouveau challenge, après huit saisons disputées sous les couleurs du Stado Tarbes-Pyrénées Rugby (TPR). Si « Louisou » ne joue plus au rugby, il a troqué le ballon pour un vélo, qui dit-il le fait fondre et lui maintient la forme ! Étiqueté « Radical de gauche », il est à présent conseiller départemental du canton de la Vallée des Gaves et adjoint au maire d’Ouzous. Et même si sa notoriété n’est pas celle des Sella, Berbizier ou autres Blanco avec lesquels il a pourtant échangé le cuir, « Louisou » affiche pourtant un palmarès et un nombre de sélections à faire pâlir la jeune génération. Avec 46 capes, l’ex pilier gauche a battu les All Blacks, les Sud-Africains et participé à 3 coupes du monde ! En janvier 2020, Louis Armary, a été désigné en qualité de référent « Terre de Jeux 2024 ». Il fera le lien entre le département des Hautes-Pyrénées et le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris.
Louis ARMARY, alias « Louisou » né le 24 juillet 1963 à Betpouey, est un joueur de rugby à XV qui fut sacré champion de France en 1995 avec Lourdes face à Romans. Louis Armary a occupé le poste de pilier gauche au FC Lourdes, et en sélection nationale, où il joua durant les saisons 1988, 1989 et 1990, fréquemment aux côtés de son compère de club Jean-Pierre Garuet-Lempirou, dit Garuche (Armary occupa cependant le poste de talonneur durant l’édition 1990 du tournoi). Il mesure 1m83 pour 102 kg. D'un poids modeste pour un pilier gauche international, il était cependant redouté dans l'épreuve de la mêlée fermée où sa technique et la puissance de son dos faisaient subir un véritable calvaire à ses adversaires. Le 1er mai 1980, il participe au premier match des Barbarians français contre l'Écosse à Agen. Les Baa-Baas l'emportent 26 à 22. Il a participé aux éditions 1987, 1991 et 1995 de la Coupe du monde. Il vainquit également les Sud-Africains lors de la tournée de 1993, et les All Blacks lors de celle de 1994. En mars 2015, il est élu conseiller départemental du canton de la Vallée des Gaves en tandem avec Chantal Robin-Rodrigo. Suite à son entrée au conseil départemental des Hautes-Pyrénées, il devient, le 7 mai 2015, président de l'Office départemental des Sports (ODS). Son palmarès : 46 sélections avec le XV de France (8 comme talonneur), du 28 mai 1987 (face à la Roumanie) au 17 juin 1995 (face à l'Afrique du Sud). Un essai lors du second test-match de la tournée en Australie, le 24 juin 1990 ; Vainqueur de trois tournois des Cinq Nations, en 1988 (ex æquo avec le Pays de Galles), 1989, 1993 et demi-finaliste de la Coupe du monde en 1995 ; Champion de France du groupe B avec Lourdes en 1995 contre Romans. Ses clubs d’attache : 1980-2000 FC Lourdes ; 2000-2001 Union Sportive (US) Argelès-Gazost (entraîneur et joueur). Skieur de 8 à 14 ans, à 17 ans il choisit le rugby et le FC Lourdes forcément pour vingt ans de fidélité. Pilier gauche de Lourdes, où il a effectué toute sa carrière de rugbyman entre 1980 et 2000, avant d’effectuer une pige comme entraîneur-joueur à l’US Argelès-Gazost, Louis Armary, habite à Ouzous, un petit village sur les hauteurs d’Argelès-Gazost. Il fut un temps où les joueurs ne changeaient pas de club. « Nous, à l’époque, on avait le clocher, le maillot, on était amateurs et pas professionnels », explique-t-il. Avec son compère Jean-Pierre Garuet, il aura eu une carrière exemplaire en Bigorre comme avec le XV de France, qu'il quitta sur la terrible demi-finale de Coupe du monde 1995. Salarié à la Lyonnaise des Eaux depuis 1986, il s’est toujours impliqué dans le rugby, comme joueur d’abord, puis comme éducateur à Argelès-Gazost ou élu au Comité Armagnac-Bigorre. Mais comment faire autrement lorsque ses deux fistons Geoffrey et Alexis manient l'ovale. Son fils Alexis, un solide gaillard d’1m92 pour 99 kg, a signé au Valence-Romans Drôme Rugby (VRDR) pour un nouveau challenge, après huit saisons disputées sous les couleurs du Stado Tarbes-Pyrénées Rugby (TPR). Si « Louisou » ne joue plus au rugby, il a troqué le ballon pour un vélo, qui dit-il le fait fondre et lui maintient la forme ! Étiqueté « Radical de gauche », il est à présent conseiller départemental du canton de la Vallée des Gaves et adjoint au maire d’Ouzous. Et même si sa notoriété n’est pas celle des Sella, Berbizier ou autres Blanco avec lesquels il a pourtant échangé le cuir, « Louisou » affiche pourtant un palmarès et un nombre de sélections à faire pâlir la jeune génération. Avec 46 capes, l’ex pilier gauche a battu les All Blacks, les Sud-Africains et participé à 3 coupes du monde ! En janvier 2020, Louis Armary, a été désigné en qualité de référent « Terre de Jeux 2024 ». Il fera le lien entre le département des Hautes-Pyrénées et le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris.AYACHE William (1961-XXXX)
Footballeur professionnel champion olympique
 William AYACHE, est un footballeur professionnel puis entraîneur français, né le 10 janvier 1961 à Alger, en Algérie. En tant que Junior, et jusqu’en 1979, il joue au Tarbes Pyrénées Football, club phare des Hautes-Pyrénées. Il évolue au poste de défenseur latéral droit ou gauche de la fin des années 1970 au milieu des années 1990. Depuis août 2014, il est chargé avec Olivier Monterrubio et Bernard Blanchet du recrutement au sein du FC Nantes. Il dispute son premier match en D1 en 1979 avec le FC Nantes et connaît la consécration, au point de connaître sa première sélection avec l'équipe de France A le 5 octobre 1983, pour la rencontre France-Espagne (1-1). Lors des JO de Los Angeles en 1984 il est sacré champion olympique avec l'Équipe de France, ce qui lui permet de s'imposer dans le groupe de l'Équipe de France A, et logiquement il est sélectionné pour la Coupe du monde 1986. Après la Coupe du monde, il quitte Nantes pour rejoindre le PSG, champion en titre. Il n'y reste qu'une saison pour rejoindre l'Olympique de Marseille, mais ne parvenant pas à avoir un temps de jeu conséquent, il revient à Nantes pour la saison 1988-1989. Une bonne saison, qui lui permet de signer chez les Girondins de Bordeaux, mais n'y dispute qu'un seul match, subissant l'éclosion de Bixente Lizarazu. Il signe au Montpellier HSC et remporte la Coupe de France. La saison suivante, il connaît une saison blanche, d'abord avec l'OGC Nice, puis en jouant avec la réserve de l'Olympique de Marseille. En 1991, il signe au Nîmes Olympique en compagnie de deux autres anciens marseillais et joueurs de l'équipe de France : Philippe Vercruysse et Éric Cantona. William Ayache ne reste qu'un an dans le club gardois puis signe en Division 2 à l'AS Cannes, fraîchement relégué. Il restera au club jusqu'à la fin de sa carrière, au terme de la saison 1995-96. Sa carrière de joueur achevée, il entame une carrière d'entraîneur en rentrant dans le staff de Luis Fernandez, à Cannes un temps, puis à l'Athletic Bilbao jusqu’en 2000. Il ne fait pas partie de l'aventure parisienne. Le club amateur de Mougins l'accueille. Il est par la suite consultant pour la chaîne Canal+ puis pour beIN SPORTS. Son palmarès en club : 1er match dans l'élite (Lens-Nantes, score 1-3, le 03/08/1979) ; Champion de France en 1980 et en 1983 avec le FC Nantes ; Vainqueur de la Coupe des Alpes en 1982 avec le FC Nantes ; Vice-champion de France en 1981, en 1985 et en 1986 avec le FC Nantes ; Finaliste de la Coupe de France en 1983 avec le FC Nantes ; 1/2 finaliste de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe de football en 1980 avec le FC Nantes et en 1988 avec l'Olympique de Marseille ; Vainqueur de la Coupe de France en 1990 avec le Montpellier HSC. En tout, 347 matchs de Division 1 pour 4 buts marqués et 31 matchs de Division 2. Son palmarès en Équipe de France : 20 sélections entre 1983 et 1988 ; Champion olympique en 1984 avec l’Équipe de France de football ; Vainqueur de la Coupe Intercontinentale des Nations en 1985 ; Troisième de la Coupe du Monde en 1986 ; Finaliste du Tournoi de Toulon en 1980 avec les Espoirs ; Participation à la Coupe du Monde en 1986 (3e). Son palmarès comme entraîneur : Vice-champion d'Espagne en 1998 avec l'Athletic Bilbao, en tant qu'adjoint de Luis Fernandez. Ses clubs successifs : jusqu’au 07/1979 Tarbes PF ; du 07/1979 au 07/1986 FC Nantes ; du 07/1986 au 06/1987 Paris Saint-Germain FC ; du 07/1987 au 07/1988 Olympique de Marseille ; du 07/1988 au 07/1989 FC Nantes ; du 07/1989 au 11/1989 FC Girondins de Bordeaux ; du 11/1989 au 07/1990 Montpellier HSC ; du 07/1990 au 07/1991 OGC Nice ; du 07/1991 au 07/1992 Nîmes Olympique ; du 07/1992 au 07/1995 AS Cannes. L'ex footballeur international a gardé quelques bons amis à Tarbes, la ville où il a appris, tout petit, à taper dans un ballon sous le maillot du Stado : Pierre Vallé, ancien joueur puis président du club de foot tarbais est son ami. Et avant de grimper sur le toit de l'Olympe, William Ayache décrochait le titre de Ligue 1974, sous le maillot du Stado. Mais sa vie l'a éloigné des Pyrénées dès l'âge de 18 ans quand il a rejoint le FC Nantes, son club chéri. Après une carrière achevée à Cannes en 1995, son rêve était de redevenir l'adjoint d'un entraîneur de Ligue1, ainsi parle le papa de deux filles. Le Bigourdan William Ayache a vécu des moments d'exception avec l'équipe de France de football, à commencer par son titre olympique décroché aux Jeux de Los Angeles, en 1984. Au terme d'une finale indécise, Brisson et Xuereb offrirent finalement à l'équipe de France de football sa première médaille d'or olympique (2-0). Mais si William Ayache, qui a grandi à Tarbes, se sent « Bigourdan » et avoue profiter d'un « retour aux sources » plusieurs fois par an, c'est bien loin de la Bigorre qu'il aura vécu ses plus belles aventures sportives. « C'est à Tarbes que j'ai découvert le foot. J'avais aussi des aptitudes à l'athlétisme, mais ce sont les éducateurs du Stado qui m'ont donné envie de jouer au ballon. » Par ces mots, William Ayache rappelle son attachement à la Bigorre.
William AYACHE, est un footballeur professionnel puis entraîneur français, né le 10 janvier 1961 à Alger, en Algérie. En tant que Junior, et jusqu’en 1979, il joue au Tarbes Pyrénées Football, club phare des Hautes-Pyrénées. Il évolue au poste de défenseur latéral droit ou gauche de la fin des années 1970 au milieu des années 1990. Depuis août 2014, il est chargé avec Olivier Monterrubio et Bernard Blanchet du recrutement au sein du FC Nantes. Il dispute son premier match en D1 en 1979 avec le FC Nantes et connaît la consécration, au point de connaître sa première sélection avec l'équipe de France A le 5 octobre 1983, pour la rencontre France-Espagne (1-1). Lors des JO de Los Angeles en 1984 il est sacré champion olympique avec l'Équipe de France, ce qui lui permet de s'imposer dans le groupe de l'Équipe de France A, et logiquement il est sélectionné pour la Coupe du monde 1986. Après la Coupe du monde, il quitte Nantes pour rejoindre le PSG, champion en titre. Il n'y reste qu'une saison pour rejoindre l'Olympique de Marseille, mais ne parvenant pas à avoir un temps de jeu conséquent, il revient à Nantes pour la saison 1988-1989. Une bonne saison, qui lui permet de signer chez les Girondins de Bordeaux, mais n'y dispute qu'un seul match, subissant l'éclosion de Bixente Lizarazu. Il signe au Montpellier HSC et remporte la Coupe de France. La saison suivante, il connaît une saison blanche, d'abord avec l'OGC Nice, puis en jouant avec la réserve de l'Olympique de Marseille. En 1991, il signe au Nîmes Olympique en compagnie de deux autres anciens marseillais et joueurs de l'équipe de France : Philippe Vercruysse et Éric Cantona. William Ayache ne reste qu'un an dans le club gardois puis signe en Division 2 à l'AS Cannes, fraîchement relégué. Il restera au club jusqu'à la fin de sa carrière, au terme de la saison 1995-96. Sa carrière de joueur achevée, il entame une carrière d'entraîneur en rentrant dans le staff de Luis Fernandez, à Cannes un temps, puis à l'Athletic Bilbao jusqu’en 2000. Il ne fait pas partie de l'aventure parisienne. Le club amateur de Mougins l'accueille. Il est par la suite consultant pour la chaîne Canal+ puis pour beIN SPORTS. Son palmarès en club : 1er match dans l'élite (Lens-Nantes, score 1-3, le 03/08/1979) ; Champion de France en 1980 et en 1983 avec le FC Nantes ; Vainqueur de la Coupe des Alpes en 1982 avec le FC Nantes ; Vice-champion de France en 1981, en 1985 et en 1986 avec le FC Nantes ; Finaliste de la Coupe de France en 1983 avec le FC Nantes ; 1/2 finaliste de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe de football en 1980 avec le FC Nantes et en 1988 avec l'Olympique de Marseille ; Vainqueur de la Coupe de France en 1990 avec le Montpellier HSC. En tout, 347 matchs de Division 1 pour 4 buts marqués et 31 matchs de Division 2. Son palmarès en Équipe de France : 20 sélections entre 1983 et 1988 ; Champion olympique en 1984 avec l’Équipe de France de football ; Vainqueur de la Coupe Intercontinentale des Nations en 1985 ; Troisième de la Coupe du Monde en 1986 ; Finaliste du Tournoi de Toulon en 1980 avec les Espoirs ; Participation à la Coupe du Monde en 1986 (3e). Son palmarès comme entraîneur : Vice-champion d'Espagne en 1998 avec l'Athletic Bilbao, en tant qu'adjoint de Luis Fernandez. Ses clubs successifs : jusqu’au 07/1979 Tarbes PF ; du 07/1979 au 07/1986 FC Nantes ; du 07/1986 au 06/1987 Paris Saint-Germain FC ; du 07/1987 au 07/1988 Olympique de Marseille ; du 07/1988 au 07/1989 FC Nantes ; du 07/1989 au 11/1989 FC Girondins de Bordeaux ; du 11/1989 au 07/1990 Montpellier HSC ; du 07/1990 au 07/1991 OGC Nice ; du 07/1991 au 07/1992 Nîmes Olympique ; du 07/1992 au 07/1995 AS Cannes. L'ex footballeur international a gardé quelques bons amis à Tarbes, la ville où il a appris, tout petit, à taper dans un ballon sous le maillot du Stado : Pierre Vallé, ancien joueur puis président du club de foot tarbais est son ami. Et avant de grimper sur le toit de l'Olympe, William Ayache décrochait le titre de Ligue 1974, sous le maillot du Stado. Mais sa vie l'a éloigné des Pyrénées dès l'âge de 18 ans quand il a rejoint le FC Nantes, son club chéri. Après une carrière achevée à Cannes en 1995, son rêve était de redevenir l'adjoint d'un entraîneur de Ligue1, ainsi parle le papa de deux filles. Le Bigourdan William Ayache a vécu des moments d'exception avec l'équipe de France de football, à commencer par son titre olympique décroché aux Jeux de Los Angeles, en 1984. Au terme d'une finale indécise, Brisson et Xuereb offrirent finalement à l'équipe de France de football sa première médaille d'or olympique (2-0). Mais si William Ayache, qui a grandi à Tarbes, se sent « Bigourdan » et avoue profiter d'un « retour aux sources » plusieurs fois par an, c'est bien loin de la Bigorre qu'il aura vécu ses plus belles aventures sportives. « C'est à Tarbes que j'ai découvert le foot. J'avais aussi des aptitudes à l'athlétisme, mais ce sont les éducateurs du Stado qui m'ont donné envie de jouer au ballon. » Par ces mots, William Ayache rappelle son attachement à la Bigorre.
 William AYACHE, est un footballeur professionnel puis entraîneur français, né le 10 janvier 1961 à Alger, en Algérie. En tant que Junior, et jusqu’en 1979, il joue au Tarbes Pyrénées Football, club phare des Hautes-Pyrénées. Il évolue au poste de défenseur latéral droit ou gauche de la fin des années 1970 au milieu des années 1990. Depuis août 2014, il est chargé avec Olivier Monterrubio et Bernard Blanchet du recrutement au sein du FC Nantes. Il dispute son premier match en D1 en 1979 avec le FC Nantes et connaît la consécration, au point de connaître sa première sélection avec l'équipe de France A le 5 octobre 1983, pour la rencontre France-Espagne (1-1). Lors des JO de Los Angeles en 1984 il est sacré champion olympique avec l'Équipe de France, ce qui lui permet de s'imposer dans le groupe de l'Équipe de France A, et logiquement il est sélectionné pour la Coupe du monde 1986. Après la Coupe du monde, il quitte Nantes pour rejoindre le PSG, champion en titre. Il n'y reste qu'une saison pour rejoindre l'Olympique de Marseille, mais ne parvenant pas à avoir un temps de jeu conséquent, il revient à Nantes pour la saison 1988-1989. Une bonne saison, qui lui permet de signer chez les Girondins de Bordeaux, mais n'y dispute qu'un seul match, subissant l'éclosion de Bixente Lizarazu. Il signe au Montpellier HSC et remporte la Coupe de France. La saison suivante, il connaît une saison blanche, d'abord avec l'OGC Nice, puis en jouant avec la réserve de l'Olympique de Marseille. En 1991, il signe au Nîmes Olympique en compagnie de deux autres anciens marseillais et joueurs de l'équipe de France : Philippe Vercruysse et Éric Cantona. William Ayache ne reste qu'un an dans le club gardois puis signe en Division 2 à l'AS Cannes, fraîchement relégué. Il restera au club jusqu'à la fin de sa carrière, au terme de la saison 1995-96. Sa carrière de joueur achevée, il entame une carrière d'entraîneur en rentrant dans le staff de Luis Fernandez, à Cannes un temps, puis à l'Athletic Bilbao jusqu’en 2000. Il ne fait pas partie de l'aventure parisienne. Le club amateur de Mougins l'accueille. Il est par la suite consultant pour la chaîne Canal+ puis pour beIN SPORTS. Son palmarès en club : 1er match dans l'élite (Lens-Nantes, score 1-3, le 03/08/1979) ; Champion de France en 1980 et en 1983 avec le FC Nantes ; Vainqueur de la Coupe des Alpes en 1982 avec le FC Nantes ; Vice-champion de France en 1981, en 1985 et en 1986 avec le FC Nantes ; Finaliste de la Coupe de France en 1983 avec le FC Nantes ; 1/2 finaliste de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe de football en 1980 avec le FC Nantes et en 1988 avec l'Olympique de Marseille ; Vainqueur de la Coupe de France en 1990 avec le Montpellier HSC. En tout, 347 matchs de Division 1 pour 4 buts marqués et 31 matchs de Division 2. Son palmarès en Équipe de France : 20 sélections entre 1983 et 1988 ; Champion olympique en 1984 avec l’Équipe de France de football ; Vainqueur de la Coupe Intercontinentale des Nations en 1985 ; Troisième de la Coupe du Monde en 1986 ; Finaliste du Tournoi de Toulon en 1980 avec les Espoirs ; Participation à la Coupe du Monde en 1986 (3e). Son palmarès comme entraîneur : Vice-champion d'Espagne en 1998 avec l'Athletic Bilbao, en tant qu'adjoint de Luis Fernandez. Ses clubs successifs : jusqu’au 07/1979 Tarbes PF ; du 07/1979 au 07/1986 FC Nantes ; du 07/1986 au 06/1987 Paris Saint-Germain FC ; du 07/1987 au 07/1988 Olympique de Marseille ; du 07/1988 au 07/1989 FC Nantes ; du 07/1989 au 11/1989 FC Girondins de Bordeaux ; du 11/1989 au 07/1990 Montpellier HSC ; du 07/1990 au 07/1991 OGC Nice ; du 07/1991 au 07/1992 Nîmes Olympique ; du 07/1992 au 07/1995 AS Cannes. L'ex footballeur international a gardé quelques bons amis à Tarbes, la ville où il a appris, tout petit, à taper dans un ballon sous le maillot du Stado : Pierre Vallé, ancien joueur puis président du club de foot tarbais est son ami. Et avant de grimper sur le toit de l'Olympe, William Ayache décrochait le titre de Ligue 1974, sous le maillot du Stado. Mais sa vie l'a éloigné des Pyrénées dès l'âge de 18 ans quand il a rejoint le FC Nantes, son club chéri. Après une carrière achevée à Cannes en 1995, son rêve était de redevenir l'adjoint d'un entraîneur de Ligue1, ainsi parle le papa de deux filles. Le Bigourdan William Ayache a vécu des moments d'exception avec l'équipe de France de football, à commencer par son titre olympique décroché aux Jeux de Los Angeles, en 1984. Au terme d'une finale indécise, Brisson et Xuereb offrirent finalement à l'équipe de France de football sa première médaille d'or olympique (2-0). Mais si William Ayache, qui a grandi à Tarbes, se sent « Bigourdan » et avoue profiter d'un « retour aux sources » plusieurs fois par an, c'est bien loin de la Bigorre qu'il aura vécu ses plus belles aventures sportives. « C'est à Tarbes que j'ai découvert le foot. J'avais aussi des aptitudes à l'athlétisme, mais ce sont les éducateurs du Stado qui m'ont donné envie de jouer au ballon. » Par ces mots, William Ayache rappelle son attachement à la Bigorre.
William AYACHE, est un footballeur professionnel puis entraîneur français, né le 10 janvier 1961 à Alger, en Algérie. En tant que Junior, et jusqu’en 1979, il joue au Tarbes Pyrénées Football, club phare des Hautes-Pyrénées. Il évolue au poste de défenseur latéral droit ou gauche de la fin des années 1970 au milieu des années 1990. Depuis août 2014, il est chargé avec Olivier Monterrubio et Bernard Blanchet du recrutement au sein du FC Nantes. Il dispute son premier match en D1 en 1979 avec le FC Nantes et connaît la consécration, au point de connaître sa première sélection avec l'équipe de France A le 5 octobre 1983, pour la rencontre France-Espagne (1-1). Lors des JO de Los Angeles en 1984 il est sacré champion olympique avec l'Équipe de France, ce qui lui permet de s'imposer dans le groupe de l'Équipe de France A, et logiquement il est sélectionné pour la Coupe du monde 1986. Après la Coupe du monde, il quitte Nantes pour rejoindre le PSG, champion en titre. Il n'y reste qu'une saison pour rejoindre l'Olympique de Marseille, mais ne parvenant pas à avoir un temps de jeu conséquent, il revient à Nantes pour la saison 1988-1989. Une bonne saison, qui lui permet de signer chez les Girondins de Bordeaux, mais n'y dispute qu'un seul match, subissant l'éclosion de Bixente Lizarazu. Il signe au Montpellier HSC et remporte la Coupe de France. La saison suivante, il connaît une saison blanche, d'abord avec l'OGC Nice, puis en jouant avec la réserve de l'Olympique de Marseille. En 1991, il signe au Nîmes Olympique en compagnie de deux autres anciens marseillais et joueurs de l'équipe de France : Philippe Vercruysse et Éric Cantona. William Ayache ne reste qu'un an dans le club gardois puis signe en Division 2 à l'AS Cannes, fraîchement relégué. Il restera au club jusqu'à la fin de sa carrière, au terme de la saison 1995-96. Sa carrière de joueur achevée, il entame une carrière d'entraîneur en rentrant dans le staff de Luis Fernandez, à Cannes un temps, puis à l'Athletic Bilbao jusqu’en 2000. Il ne fait pas partie de l'aventure parisienne. Le club amateur de Mougins l'accueille. Il est par la suite consultant pour la chaîne Canal+ puis pour beIN SPORTS. Son palmarès en club : 1er match dans l'élite (Lens-Nantes, score 1-3, le 03/08/1979) ; Champion de France en 1980 et en 1983 avec le FC Nantes ; Vainqueur de la Coupe des Alpes en 1982 avec le FC Nantes ; Vice-champion de France en 1981, en 1985 et en 1986 avec le FC Nantes ; Finaliste de la Coupe de France en 1983 avec le FC Nantes ; 1/2 finaliste de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe de football en 1980 avec le FC Nantes et en 1988 avec l'Olympique de Marseille ; Vainqueur de la Coupe de France en 1990 avec le Montpellier HSC. En tout, 347 matchs de Division 1 pour 4 buts marqués et 31 matchs de Division 2. Son palmarès en Équipe de France : 20 sélections entre 1983 et 1988 ; Champion olympique en 1984 avec l’Équipe de France de football ; Vainqueur de la Coupe Intercontinentale des Nations en 1985 ; Troisième de la Coupe du Monde en 1986 ; Finaliste du Tournoi de Toulon en 1980 avec les Espoirs ; Participation à la Coupe du Monde en 1986 (3e). Son palmarès comme entraîneur : Vice-champion d'Espagne en 1998 avec l'Athletic Bilbao, en tant qu'adjoint de Luis Fernandez. Ses clubs successifs : jusqu’au 07/1979 Tarbes PF ; du 07/1979 au 07/1986 FC Nantes ; du 07/1986 au 06/1987 Paris Saint-Germain FC ; du 07/1987 au 07/1988 Olympique de Marseille ; du 07/1988 au 07/1989 FC Nantes ; du 07/1989 au 11/1989 FC Girondins de Bordeaux ; du 11/1989 au 07/1990 Montpellier HSC ; du 07/1990 au 07/1991 OGC Nice ; du 07/1991 au 07/1992 Nîmes Olympique ; du 07/1992 au 07/1995 AS Cannes. L'ex footballeur international a gardé quelques bons amis à Tarbes, la ville où il a appris, tout petit, à taper dans un ballon sous le maillot du Stado : Pierre Vallé, ancien joueur puis président du club de foot tarbais est son ami. Et avant de grimper sur le toit de l'Olympe, William Ayache décrochait le titre de Ligue 1974, sous le maillot du Stado. Mais sa vie l'a éloigné des Pyrénées dès l'âge de 18 ans quand il a rejoint le FC Nantes, son club chéri. Après une carrière achevée à Cannes en 1995, son rêve était de redevenir l'adjoint d'un entraîneur de Ligue1, ainsi parle le papa de deux filles. Le Bigourdan William Ayache a vécu des moments d'exception avec l'équipe de France de football, à commencer par son titre olympique décroché aux Jeux de Los Angeles, en 1984. Au terme d'une finale indécise, Brisson et Xuereb offrirent finalement à l'équipe de France de football sa première médaille d'or olympique (2-0). Mais si William Ayache, qui a grandi à Tarbes, se sent « Bigourdan » et avoue profiter d'un « retour aux sources » plusieurs fois par an, c'est bien loin de la Bigorre qu'il aura vécu ses plus belles aventures sportives. « C'est à Tarbes que j'ai découvert le foot. J'avais aussi des aptitudes à l'athlétisme, mais ce sont les éducateurs du Stado qui m'ont donné envie de jouer au ballon. » Par ces mots, William Ayache rappelle son attachement à la Bigorre.BARBARA (1930-1997)
Auteure-compositrice-interprète
 Barbara, née Monique Andrée Serf le 9 juin 1930 près du square des Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris et décédée le 24 novembre 1997 à Neuilly-sur-Seine. Elle est le deuxième enfant d’une famille qui en compte quatre. Elle a marqué la chanson française de sa musique poétique et passionnelle. Nombre de ses chansons sont devenues des classiques, notamment : « Dis, quand reviendras-tu ? », « Nantes », « Au bois de Saint-Amand », « Göttingen », « La solitude », « Une petite cantate », « La Dame brune », « L'Aigle noir », « Marienbad », « Ma plus belle histoire d’amour », « Pierre », « Le mal de vivre », « Vienne », « Drouot » ou encore « Si la photo est bonne ». Elle a joué dans trois films pour le cinéma « Aussi loin que l’amour » en 1971, « Franz » en 1972, « L’oiseau rare » en 1973 et dans deux pièces musicales sur scène : « Madame » en 1970, et « Lily passion » avec Gérard Depardieu en 1985. Depuis 2010, le « prix Barbara » récompense chaque année une jeune chanteuse francophone. Elle est la fille de Jacques Serf, un Juif alsacien, représentant de commerce en peaux et fourrures et d’Esther Brodsky, Juive née à Tiraspol (Moldavie), fonctionnaire à la préfecture de Paris. Monique Serf passe les premières années de sa vie dans ce coin des Batignolles, avec ses parents, sa grand-mère maternelle Hava Poustilnikov, née à Zlatopil (en Ukraine), et son frère aîné Jean, né en 1928. Sa jeunesse est marquée par des déménagements successifs, notamment en 1937, à Marseille, première étape d’un itinéraire sinueux, 1938, au 26, rue Mulsant à Roanne (Loire), où naît sa sœur Régine en août de la même année, en 1939, la famille quitte Roanne pour Le Vésinet dans la banlieue ouest de la capitale, où réside Jeanne Spire, la tante de Monsieur Serf. En septembre 1939 la guerre éclate et son père rejoint le front. Jeanne Spire, Jean et Monique rejoignent Poitiers, où un médecin les héberge. En 1940, sa mère travaille à la préfecture de Blois. Les deux aînés et leur grand-tante l’y rejoignent. Un bombardement de la ville s’annonce. Les deux enfants partent en train avec Jeanne Spire. Une attaque de l’aviation allemande vise le convoi en rase campagne. Les voyageurs resteront bloqués dans le train durant plusieurs jours. L’école communale de Préaux (Indre) accueille les réfugiés du train. Jeanne Spire loue deux chambres au-dessus du café Lanchais sur la place du village. Les deux enfants et Jeanne Spire resteront plus d’un an à Préaux. Ils s’intègrent à la vie du village, Monique et Jean vont à l’école communale. Fin 1941, par l’intermédiaire de la mairie de Préaux, leur grand-tante apprend que les parents résident à Tarbes, où Monsieur Serf est démobilisé. La famille se recompose immédiatement à Tarbes (Hautes-Pyrénées), au 3 bis, rue des Carmes. La tante Jeanne reste quelques mois avec eux. Claude, le jeune frère de Monique naît en mars 1942. Monique fréquente l’école communale. Mais la famille doit quitter rapidement Tarbes : un dénonciateur a informé la police qu’une famille juive vit rue des Carmes. Une menace de rafle dont les parents ont été informés. C'est la tante Jeanne qui avait été prévenue la veille du départ. Les déménagements redoublent sous l’Occupation pour fuir la traque nazie faite aux juifs. S’y ajoutent les séparations pour déjouer les dénonciations. De 1943 à octobre 1945, la famille se cache près de Chasseneuil-sur-Bonnieure en Charente, puis à Grenoble et à Saint-Marcellin en Isère. À la Libération, les membres de la famille quittent Saint-Marcellin pour Paris, d’abord au 131, rue Marcadet, puis dans un appartement rue Notre-Dame-de-Nazareth, puis dans un autre hôtel rue de Vaugirard, où ils se retrouvent tous. Barbara subira le comportement incestueux de son père pendant son enfance. Après Blois, Préaux, la voilà donc fin 1941 à Tarbes. Qui rêve spectacles, déguise ses voisins de la cour « et la petite fille de la propriétaire qui était rudement jolie et qui intéressait diablement mon frère Jean », se souvient-elle. Mais c'est un quotidien de cauchemar que vit la petite fille juive dans « une assez grande maison, 3 bis, rue des Carmes ». Son frère est premier en tout au lycée Théophile-Gautier. Elle est « très indisciplinée », « frondeuse », « désobéissante », disent ses livrets scolaires de la communale. Son père ne manque jamais une occasion de l'humilier. Sauf quand ils sont seuls tous les deux. Elle n'écrira jamais le mot. Mais « le soir, lorsque j'entends claquer le grand portail vert et les pas de mon père résonner dans la cour, je me prends à trembler ». Et les larmes lui viennent, confie-t-elle en révélant sans le dire l'inceste. Rappelant simplement « les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire ». C’est à Tarbes, alors qu'elle a à peine onze ans et demi, que son père abuse d'elle pour la première fois. "Un soir, à Tarbes, mon univers bascule dans l'horreur", écrit-elle. Personne ne dénonce l'inceste dans sa famille. Elle tente bien de s'adresser à une gendarmerie, au soir d'une fugue en Bretagne. On l'écoute mais sa plainte n'est pas enregistrée. Son père revient la chercher et laisse entendre qu'elle affabule. En 1949, alors qu'elle n'a que dix-neuf ans, le départ définitif du foyer familial de son père marque l'interruption de leurs rapports, mais elle n'en fait le récit que très tard, dans ses mémoires interrompus par sa mort en 1997, sans toutefois se décider à dire les mots de « viol » et d'« inceste ». « Tarbes a toujours été un souvenir très dur pour Barbara », confiera à la Dépêche du Midi, Marie Chaix, la secrétaire et biographe de la chanteuse Barbara. « Je ne chanterai pas à Tarbes », disait-elle. Plus tard, elle donnera un concert, finalement, mais à Ibos, au Parvis. C’est donc à Tarbes qu’elle vécut les pires moments de sa vie qui lui inspirèrent plus tard, la chanson « L’Aigle noir ». Beaucoup de personnes se sont interrogées sur le sens réel des paroles de « L'Aigle noir ». De son vivant, Barbara se dérobait à chaque fois, prétextant que cela ne concernait qu'elle : "Ce ne sont pas les paroles qui sont importantes...", disait-elle. Selon le chanteur Patrick Bruel, qui a repris le titre en 2015, ces paroles seraient une référence à l'emblème du Troisième Reich et à la vie d'errance et de danger durant l'enfance de la chanteuse. Le journaliste Pierre Adrian commente : "Après l'interprétation psychanalytique, voici l'interprétation historique". En 1946, la famille Self s’installe au Vésinet (Yvelines) à la pension des Trois Marroniers au 31 bis, rue Ernest-André, où la future Barbara prend ses premiers cours de chant chez Madame Madeleine Thomas-Dusséqué. À son contact, elle apprend le chant, le solfège et le piano, avant d'emménager au 50, rue de Vitruve dans le 20e arrondissement de Paris. Madame Dusséqué quitte le Vésinet pour Paris. Elle donne des cours salle Pleyel. Le 30 décembre 1946, sa grand-mère maternelle Hava Poustilnikov décède à Paris à son domicile 131, rue Marcadet, à l’âge de 66 ans. Cette femme comptait beaucoup pour Monique. Peu attirée par les études, elle ambitionne depuis longtemps de devenir pianiste mais son rêve est brisé depuis 1944, un kyste à la main droite ayant obligé les médecins de Grenoble à intervenir à sept reprises et sectionner les tendons. Ses parents promettent de lui offrir des cours de chant. Elle s’inscrit à ceux de Mme Dusséqué. Sa vie en est changée. Au bout de quelques leçons, sa professeure la présente à maître Paulet, enseignant au Conservatoire de Paris, qui la prend comme élève en 1947. Dans le nouvel appartement, un piano loué par son père est installé ; Monique en joue d’instinct, sans prendre de leçons. La jeune fille entre au Conservatoire comme auditrice, mais au répertoire de chant classique, qui l'ennuie, elle préfère celui de la chanson populaire, ayant rencontré à l'ABC l'univers de Piaf. Elle arrête les cours en 1948. La même année, après avoir passé une audition au théâtre Mogador, elle est engagée comme mannequin-choriste dans l’opérette « Violettes impériales ». Un jour de 1949, son père abandonne soudainement le foyer, pour ne plus revenir. Bientôt, la même année, la location du piano ne peut plus être honorée. Contrainte de s’en séparer, elle vit un déchirement. Voulant à tout prix concrétiser son rêve, devenir "pianiste chantante", elle quitte Paris en février 1950. Grâce à l’argent prêté par une amie, elle s’exile à Bruxelles chez un cousin, Sacha Piroutsky, qu’elle quitte au bout de deux mois car il devenait violent. Sans ressources ni connaissances, la vie est difficile. Au hasard d’une rencontre, elle rejoint une communauté d’artistes à Charleroi, qui se réunissent dans un local appelé La Mansarde. Là, elle trouve de l’aide et commence à chanter dans des cabarets sous le nom de Barbara Brodi (en l'honneur d'une de ses aïeules ukrainiennes appelée Varvara, ou de sa grand-mère Hava Brodsky). Son répertoire est constitué de chansons d’Édith Piaf, Marianne Oswald, Germaine Montero, Juliette Gréco. Chaque fois, le public la siffle copieusement. En 1950, elle rencontre Jacques Brel qui, comme elle, tente de percer en se produisant dans divers cabarets. Elle ajoute à son répertoire les premières chansons de cet auteur-compositeur en herbe avec qui elle va se lier d'une très grande amitié discrète mais indéfectible, pleine de complicité et d'admiration mutuelle. Plus tard, tandis que Barbara ne chante encore que des chansons écrites par d'autres, Brel l'encourage à écrire elle-même ses propres chansons ; il sera donc le premier à qui elle fera découvrir ses premiers textes, dont ses premiers succès. Brel dira « Barbara, c'est une fille bien. Elle a un grain, mais un beau grain. On est un peu amoureux, comme ça, depuis longtemps ». En 1971, il lui offrira un premier rôle dans son film Franz. À partir de 1981, soit trois ans après la mort de Brel, La Valse de Franz, composée par Brel, sera jouée dans tous les spectacles de Barbara, En 1990, elle créera au théâtre Mogador la chanson Gauguin (Lettre à Jacques Brel). Fin 1951, elle retourne vivre chez son oncle au 131, rue Marcadet à Paris pour des auditions sans lendemain, dont une au cabaret La Fontaine des Quatre-Saisons dont la programmation est déjà faite et où on lui propose une place de plongeuse pour un an. Elle peut toutefois y rencontrer et observer, sans jamais chanter, Boris Vian avec Henri Crolla et Louis Bessières ou encore Mouloudji. Elle revient à Bruxelles où un ami du groupe de Charleroi lui donne l’occasion de chanter. Elle est mise en relation avec Ethery Rouchadze, pianiste géorgienne qui accepte de l’accompagner et auprès de qui elle se perfectionnera au piano. Cette dernière lui présente Claude Sluys, jeune avocat. Habitué des lieux de spectacles, il se pique d’écrire quelques chansons. Fin 1952, il déniche le « théâtre du Cheval blanc » et use de ses relations pour y ouvrir un cabaret afin qu’elle s’y produise sous le nom de Barbara. Elle monte pour la première fois sur scène accompagnée de son piano, vêtue d’un châle noir et maquillée de khôl. Ainsi commence à se construire le personnage de la « dame en noir ». Le bouche à oreille aidant, le succès ne se fait pas attendre. Le 31 octobre 1953, Barbara épouse Claude Sluys. Au début de l’année 1955, elle enregistre deux chansons chez Decca : « Mon pote le gitan » et « L'œillet blanc » (parfois noté « L'œillet rouge »), diffusées en 78 tours et 45 tours. En 1955, les époux se séparent. À la fin de l'année, Barbara retourne à Paris où elle chante dans de petits cabarets : La Rose rouge en 1956, Chez Moineau en 1957, puis en 1958 à L’Écluse, où elle a déjà chanté pour de courts engagements. En 1958, elle réussit à s’imposer, sous le surnom de La Chanteuse de minuit, si bien que sa notoriété grandit et lui attire un public de fidèles, en particulier parmi les étudiants du Quartier latin. C’est sous le nom de « Barbara » qu’elle effectue son premier passage à la télévision, le 12 juillet 1958, sur l’unique chaîne de la RTF, dans l’émission Cabaret du Soir, où la présentatrice la compare à Yvette Guilbert et lui assure "qu’elle deviendra certainement une grande vedette". À cette époque, poussée par son ami Brel, elle commence à écrire. Remarquée et engagée par Pathé-Marconi, elle enregistre, sous le label « La Voix de son Maître », son premier Super 45 tours, « La Chanteuse de minuit », avec deux de ses propres chansons : « J’ai troqué » et « J’ai tué l’amour », et au printemps 1959 son premier 33 tours « Barbara à L’Écluse ». En décembre 1959, apprenant que son père, qui avait fui sur les routes pour noyer son crime dans le vagabondage et la déchéance, est mourant et la réclame auprès de lui à Nantes (Loire-Atlantique), elle s'y précipite, mais arrive trop tard. À la vue de son corps, à la morgue, ses sentiments oscillent entre fascination, panique, mépris, haine, d'une part, et un immense désespoir d'autre part. Au lendemain de l’enterrement, elle commence l’écriture de la chanson « Nantes », qu’elle achève quatre ans plus tard, quelques heures avant son passage au théâtre des Capucines, le 5 novembre 1963 ; ce sera l'une de ses plus grandes chansons. En 1960, elle change de maison de disque pour signer chez Odéon. Elle enregistre « Barbara chante Brassens » puis « Barbara chante Jacques Brel » : le premier de ces albums est couronné par l’Académie Charles-Cros dans la catégorie « Meilleure interprète ». En 1961, elle décroche un tour de chant du 9 au 20 février, en première partie de Félix Marten à Bobino. Sa performance est peu appréciée, sa présentation jugée austère, à l’évidence pas encore prête pour les grandes scènes. Loin de se décourager, elle reprend ses récitals à L’Écluse. La même année, elle se rend à Abidjan, où elle retrouve son amant, le diplomate Hubert Ballay ; elle lui écrira « Dis, quand reviendras-tu ? », avant de le quitter. Deux années plus tard, les mardis de novembre et décembre 1963, au théâtre des Capucines, elle retient et capte l’attention avec un répertoire nouveau comprenant deux de ses chansons : « Nantes » et « Dis, quand reviendras-tu ? ». Le succès est tel que la maison Philips va donner un véritable élan à sa carrière en lui signant un contrat. Séduit, Georges Brassens lui propose la première partie de son prochain spectacle à Bobino. En attendant, le 4 juillet 1964, elle se rend sans enthousiasme en Allemagne de l'Ouest, en réponse à l’invitation de Hans-Gunther Klein, directeur du Junges Theater de la ville universitaire de Göttingen. Agréablement surprise et touchée par l’accueil chaleureux qu’elle reçoit, elle prolonge son séjour d’une semaine. L'avant-veille de son départ, elle offre au public la chanson « Göttingen », qu’elle a écrite d’un trait dans les jardins du théâtre. En mai 1967, elle sera à Hambourg pour l’enregistrer, avec neuf autres titres, traduits en allemand, pour le 33 tours « Barbara singt Barbara », et retournera chanter à Göttingen le 4 octobre. Dans les années 1980, les hommes politiques se saisiront de la chanson pour promouvoir l'amitié franco-allemande. En 1988, Barbara recevra la Médaille d’honneur de Göttingen et l'ordre du Mérite fédéral. En 1992, à la veille d'un référendum, François Mitterrand choisira ce titre pour terminer un entretien télévisé. En 2002, Xavier Darcos, alors ministre délégué à l’enseignement scolaire, inscrira cette chanson aux programmes officiels des classes de l'école primaire : la chanson sera reprise dans les écoles en 2003 à l'occasion de la commémoration du quarantième anniversaire du traité d'amitié franco-allemand, dit traité de l'Élysée. Comme convenu, elle chante à Bobino avec Georges Brassens en « vedette » du 21 octobre au 9 novembre 1964. Le public est conquis et les critiques sont unanimes pour saluer sa prestation. Paris-presse, L’Intransigeant écrit qu’elle "fait presque oublier Brassens", L'Humanité : "Un faux pas de Brassens, une prouesse de Barbara." Le 14 mars 1965, sort son premier album Philips, « Barbara chante Barbara ». Il obtient le prix de l’Académie Charles-Cros et un réel succès commercial. Lors de la cérémonie, au palais d’Orsay, Barbara déchire son prix en quatre pour le distribuer aux techniciens, en témoignage de sa gratitude. La même année, elle obtient un grand succès à Bobino. Le 15 septembre, jour de la première, France Inter organise une journée Barbara sur ses ondes. La chanteuse est si profondément marquée par cette première qu’elle l'immortalise peu après dans l’une de ses plus grandes chansons : Ma plus belle histoire d’amour. « Ce fut, un soir, en septembre / Vous étiez venus m’attendre / Ici même, vous en souvenez-vous ? … ». En décembre 1966, Barbara se produit à nouveau à Bobino, où elle interprète notamment « Au cœur de la nuit » (titre que jamais plus elle n'inscrira à son tour de chant). Trois ans avant « L'Aigle noir », elle y évoque "un bruissement d'ailes qui effleure son visage", évoque la mort de son père et le pardon "pour qu'enfin tu puisses dormir, pour qu'enfin ton cœur repose, que tu finisses de mourir sous tes paupières déjà closes" (voir les albums Ma plus belle histoire d'amour, Bobino 1967). En 1967, elle écrit avec Georges Moustaki, « La Dame brune », chanson d'amour qu'ils interprètent en duo. Elle dira à son sujet : "Moustaki, c'est ma tendresse". Le 6 novembre 1967, alors en tournée en Italie, elle apprend la mort de sa mère. Elle a vécu au 14, rue de Rémusat de 1961 à 1967, date à laquelle elle quitte l'immeuble à la suite du décès de sa mère, ce qui lui inspire quelques années plus tard, en 1972, la chanson Rémusat, où elle évoque ce double départ. En février 1969, Barbara est à l’Olympia. À la fin de la dernière représentation, à la stupeur générale, elle annonce qu’elle arrête le tour de chant. Mais elle respecte ses engagements passés jusqu’en 1971. Toutefois, cet arrêt ne sera pas définitif. Elle a d'ailleurs déclaré qu'elle n'avait jamais fait d'adieux, mais qu'elle avait pris ses distances. La chanteuse reviendra sur les scènes du music-hall après trois ans d'absence. Début 1970, elle est au théâtre de la Renaissance dans « Madame », une pièce musicale, écrite par Rémo Forlani, dont elle signe la musique. Le rocking-chair du décor la suivra désormais dans tous ses tours de chant. Elle interprète une "tenancière de lupanar en Afrique". « Madame » est un échec, mais Barbara remet rapidement le pied à l’étrier grâce au succès de l’album studio L'Aigle noir, dont la chanson homonyme est l’un des plus gros succès discographiques de l’année. Barbara a dit de cette chanson qu'elle l'avait rêvée, "un rêve plus beau que la chanson elle-même". À la suite de la publication de ses mémoires en 1998, une interprétation bien plus sombre de « L'Aigle noir » fut supposée. En février 1972, Barbara est avec son ami Jacques Brel à l'affiche de « Franz ». Elle joue Léonie, femme laide, incapable de vivre l’amour dont elle rêve. Ce premier film réalisé par le chanteur obtient peu de succès. Deux ans plus tard, elle joue la diva délaissée du film « L'Oiseau rare », réalisé par Jean-Claude Brialy. Le danseur et chorégraphe Maurice Béjart, qui appréciait Barbara énormément, la fait tourner dans « Je suis né à Venise ». Dans ce film, qui ne sera diffusé qu’à la télévision, Barbara tient deux rôles : celui d'une chanteuse (elle interprète trois titres : L’Amour magicien, L’Homme en habit rouge et La Mort) et celui de La Dame de la nuit. Sa carrière musicale demeure active dans les années 1970 : à la télévision, en 1972, elle interprète un duo avec Johnny Hallyday, « Toi mon ombre, toi ma lumière ». Elle tourne au Japon, au Canada, en Belgique, en Israël, aux Pays-Bas et en Suisse. Barbara réalisera ses plus grands passages de sa carrière à la télévision pendant ses années ORTF, entre 1958 et 1974. En 1973, Barbara s'installe à Précy-sur-Marne, à trente kilomètres à l'est de Paris, dans une ancienne ferme villageoise au 2, rue de Verdun. Pour ses répétitions avant chaque spectacle, elle fait transformer la grange en théâtre, lui donnant le nom de « Grange au loup ». Dans le jardin enserré par les bâtiments de la ferme, elle découvre le plaisir de jardiner. Au petit matin du 5 juin 1974, les pompiers de Meaux découvrent son corps inanimé. Dans le coma, elle est conduite en urgence à l'hôpital. Plus tard, dans plusieurs entretiens, elle relate l'événement en expliquant que, n'arrivant pas à trouver le sommeil, elle a absorbé les cachets qu'elle avait sous la main. Lors d'un concert à Avignon, elle déclare : "Je n'ai pas voulu mourir, j'ai voulu dormir". Par décision, elle interrompt ses apparitions audiovisuelles en 1974. À partir de cette période, ses textes et ses choix musicaux évoluent en profondeur, et ses concerts de 1974, 1975 et 1978 accueillent de nouveaux titres importants. La chanson de 1974, « L’homme en habit rouge », évoque le souvenir de sa liaison avec son parolier de l’album La Louve, François Wertheimer, auquel Barbara avait offert le parfum Habit rouge de Guerlain. Pour cet album de 1973, Barbara demande à William Sheller de faire les orchestrations. De cette collaboration naît une amitié entre William et la Duchesse, comme celui-ci la surnomme affectueusement. C'est elle qui pousse alors William à devenir chanteur. Entre 1975 et 1976, elle a une aventure avec le comédien Pierre Arditi, de quatorze ans son cadet. Celui-ci se souvient d'avoir été comme "un adolescent énamouré" dans une liaison qu'il décrit comme "pas très longue mais marquante". Après leur séparation, ils sont restés très bons amis. En 1978, elle fait un retour remarqué à l'Olympia. Son album Seule est l’une des meilleures ventes de 1981. Son plus grand succès sur scène est celui qu’elle présente à l'automne de la même année à l’hippodrome de Pantin. Plus que de simples concerts, ses représentations sont, selon Jérôme Garcin, de véritables messes dont les rappels ininterrompus se prolongent jusque tard dans la nuit. Elle y interprète notamment « Regarde », chanson militante qu'elle a composée et chantée pour la campagne présidentielle de François Mitterrand, pour qui elle appela à voter, à partir du 8 avril 1981. C’est lors de ce spectacle que la voix de la chanteuse, pour la première fois, et irrémédiablement, se brise. Si au départ elle s'en affole, par la suite elle ne cherchera pas à le cacher mais saura au contraire se servir de cette voix, désormais "au crépuscule", pour renforcer l’aspect dramatique et authentique de son interprétation. Se renouvelant sans cesse, la chanteuse continue d’attirer un public très jeune. L’année suivante, elle reçoit le Grand prix national de la chanson en reconnaissance de sa contribution à la culture française. Par ailleurs, elle développe une relation de travail et d’amitié avec la vedette cinématographique montante Gérard Depardieu et son épouse Élisabeth. En 1985, elle coécrit avec Luc Plamondon la musique et le texte de la pièce Lily Passion, où elle joue et chante avec Gérard Depardieu. Sorte d’autobiographie romancée, c’est l’histoire d’une chanteuse qui voue toute sa vie à son public. La première représentation a lieu au Zénith de Paris, le 21 janvier 1986. L’été venu, elle est invitée sur la scène du Metropolitan Opera de New York pour un Gala Performance, donné le 8 juillet. Elle accompagne au piano son ami le danseur étoile Mikhaïl Barychnikov qui danse sur deux de ses chansons « Pierre » et « Le Mal de vivre ». À cette période, elle s'investit dans la collecte de fonds pour le traitement du Sida. Elle rend visite aux malades dans les hôpitaux et dans les prisons. Lors de ses concerts, elle met des corbeilles de préservatifs à la disposition des personnes venues l’écouter ; engagement dont témoigne artistiquement le titre « Sid’Amour à mort ». En 1987, elle monte pour la première fois sur la scène du théâtre du Châtelet, à Paris, pour une série de récitals pendant les mois de septembre et octobre, suivis d'une tournée en France, en Suisse, en Belgique, au Japon, au Canada et en Israël qui se termine en 1988. En 1988, elle est promue chevalier de la Légion d'honneur par le Président de la République François Mitterrand. L'année suivante, elle chante au théâtre Mogador à Paris de février à avril. Suivra une tournée en France et au Japon jusqu'en 1991. En 1991, elle enregistre « Lettres à un jeune poète » de Rainer Maria Rilke pour les Éditions Claudine Ducaté. Elle dédicacera cet enregistrement dans une librairie parisienne, la même année. En novembre et décembre 1993, Barbara est à nouveau sur la scène parisienne du théâtre du Châtelet, mais des problèmes de santé la contraignent à interrompre les représentations. Après quelques jours de repos, elle retrouve son public, le temps d’enregistrer le spectacle, puis renonce à poursuivre et annule les dernières représentations. En 1994, elle obtient la Victoire de l'artiste interprète féminine de l'année aux Victoires de la musique (une récompense qu'elle obtiendra une seconde fois en 1997). Son ultime tournée débute à Dijon, le 1er février. Sa dernière apparition sur scène a lieu le soir du samedi 26 mars 1994 au Centre de Congrès Vinci de la ville de Tours. Après seize années passées loin des studios, elle enregistre douze nouvelles chansons durant l'été 1996. Pour ce disque, Jean-Louis Aubert signe le texte « Vivant poème » et Guillaume Depardieu celui de « À force de ». Sorti le 6 novembre, cet album sobrement intitulé « Barbara » est son chant du cygne. Epuisée par les stimulants, les médicaments pris en dose massive pour soigner son angoisse ou les corticoïdes pour ses cordes vocales, affaiblie par une alimentation hasardeuse, elle consacre son temps à la rédaction de ses mémoires. Le 24 novembre 1997, elle est hospitalisée pour une pneumonie que les rumeurs transforment en mystère. Elle meurt à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine à l’âge de 67 ans, victime d’une infection respiratoire foudroyante. Elle disparaît juste après la sortie de « Femme Piano », regroupant ses plus belles chansons. Elle est enterrée trois jours plus tard au cimetière de Bagneux, entourée d’une foule d’amis et de fans. Allant totalement à l’encontre des modes de son temps, tant musicales que physiques, Barbara a pourtant su se faire sa place et s’imposer sur la scène de la chanson française. Toute son œuvre fut intimement liée à sa vie personnelle. Les mémoires posthumes de Barbara, « Il était un piano noir », révélèrent une déchirure d’enfance, un lourd secret à porter. Même si cela transpire tout au long de son œuvre, l’artiste ne pourra jamais l’aborder franchement sinon par des allusions très voilées, qui permettront à ses proches de sentir cette fêlure ineffaçable.
Barbara, née Monique Andrée Serf le 9 juin 1930 près du square des Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris et décédée le 24 novembre 1997 à Neuilly-sur-Seine. Elle est le deuxième enfant d’une famille qui en compte quatre. Elle a marqué la chanson française de sa musique poétique et passionnelle. Nombre de ses chansons sont devenues des classiques, notamment : « Dis, quand reviendras-tu ? », « Nantes », « Au bois de Saint-Amand », « Göttingen », « La solitude », « Une petite cantate », « La Dame brune », « L'Aigle noir », « Marienbad », « Ma plus belle histoire d’amour », « Pierre », « Le mal de vivre », « Vienne », « Drouot » ou encore « Si la photo est bonne ». Elle a joué dans trois films pour le cinéma « Aussi loin que l’amour » en 1971, « Franz » en 1972, « L’oiseau rare » en 1973 et dans deux pièces musicales sur scène : « Madame » en 1970, et « Lily passion » avec Gérard Depardieu en 1985. Depuis 2010, le « prix Barbara » récompense chaque année une jeune chanteuse francophone. Elle est la fille de Jacques Serf, un Juif alsacien, représentant de commerce en peaux et fourrures et d’Esther Brodsky, Juive née à Tiraspol (Moldavie), fonctionnaire à la préfecture de Paris. Monique Serf passe les premières années de sa vie dans ce coin des Batignolles, avec ses parents, sa grand-mère maternelle Hava Poustilnikov, née à Zlatopil (en Ukraine), et son frère aîné Jean, né en 1928. Sa jeunesse est marquée par des déménagements successifs, notamment en 1937, à Marseille, première étape d’un itinéraire sinueux, 1938, au 26, rue Mulsant à Roanne (Loire), où naît sa sœur Régine en août de la même année, en 1939, la famille quitte Roanne pour Le Vésinet dans la banlieue ouest de la capitale, où réside Jeanne Spire, la tante de Monsieur Serf. En septembre 1939 la guerre éclate et son père rejoint le front. Jeanne Spire, Jean et Monique rejoignent Poitiers, où un médecin les héberge. En 1940, sa mère travaille à la préfecture de Blois. Les deux aînés et leur grand-tante l’y rejoignent. Un bombardement de la ville s’annonce. Les deux enfants partent en train avec Jeanne Spire. Une attaque de l’aviation allemande vise le convoi en rase campagne. Les voyageurs resteront bloqués dans le train durant plusieurs jours. L’école communale de Préaux (Indre) accueille les réfugiés du train. Jeanne Spire loue deux chambres au-dessus du café Lanchais sur la place du village. Les deux enfants et Jeanne Spire resteront plus d’un an à Préaux. Ils s’intègrent à la vie du village, Monique et Jean vont à l’école communale. Fin 1941, par l’intermédiaire de la mairie de Préaux, leur grand-tante apprend que les parents résident à Tarbes, où Monsieur Serf est démobilisé. La famille se recompose immédiatement à Tarbes (Hautes-Pyrénées), au 3 bis, rue des Carmes. La tante Jeanne reste quelques mois avec eux. Claude, le jeune frère de Monique naît en mars 1942. Monique fréquente l’école communale. Mais la famille doit quitter rapidement Tarbes : un dénonciateur a informé la police qu’une famille juive vit rue des Carmes. Une menace de rafle dont les parents ont été informés. C'est la tante Jeanne qui avait été prévenue la veille du départ. Les déménagements redoublent sous l’Occupation pour fuir la traque nazie faite aux juifs. S’y ajoutent les séparations pour déjouer les dénonciations. De 1943 à octobre 1945, la famille se cache près de Chasseneuil-sur-Bonnieure en Charente, puis à Grenoble et à Saint-Marcellin en Isère. À la Libération, les membres de la famille quittent Saint-Marcellin pour Paris, d’abord au 131, rue Marcadet, puis dans un appartement rue Notre-Dame-de-Nazareth, puis dans un autre hôtel rue de Vaugirard, où ils se retrouvent tous. Barbara subira le comportement incestueux de son père pendant son enfance. Après Blois, Préaux, la voilà donc fin 1941 à Tarbes. Qui rêve spectacles, déguise ses voisins de la cour « et la petite fille de la propriétaire qui était rudement jolie et qui intéressait diablement mon frère Jean », se souvient-elle. Mais c'est un quotidien de cauchemar que vit la petite fille juive dans « une assez grande maison, 3 bis, rue des Carmes ». Son frère est premier en tout au lycée Théophile-Gautier. Elle est « très indisciplinée », « frondeuse », « désobéissante », disent ses livrets scolaires de la communale. Son père ne manque jamais une occasion de l'humilier. Sauf quand ils sont seuls tous les deux. Elle n'écrira jamais le mot. Mais « le soir, lorsque j'entends claquer le grand portail vert et les pas de mon père résonner dans la cour, je me prends à trembler ». Et les larmes lui viennent, confie-t-elle en révélant sans le dire l'inceste. Rappelant simplement « les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire ». C’est à Tarbes, alors qu'elle a à peine onze ans et demi, que son père abuse d'elle pour la première fois. "Un soir, à Tarbes, mon univers bascule dans l'horreur", écrit-elle. Personne ne dénonce l'inceste dans sa famille. Elle tente bien de s'adresser à une gendarmerie, au soir d'une fugue en Bretagne. On l'écoute mais sa plainte n'est pas enregistrée. Son père revient la chercher et laisse entendre qu'elle affabule. En 1949, alors qu'elle n'a que dix-neuf ans, le départ définitif du foyer familial de son père marque l'interruption de leurs rapports, mais elle n'en fait le récit que très tard, dans ses mémoires interrompus par sa mort en 1997, sans toutefois se décider à dire les mots de « viol » et d'« inceste ». « Tarbes a toujours été un souvenir très dur pour Barbara », confiera à la Dépêche du Midi, Marie Chaix, la secrétaire et biographe de la chanteuse Barbara. « Je ne chanterai pas à Tarbes », disait-elle. Plus tard, elle donnera un concert, finalement, mais à Ibos, au Parvis. C’est donc à Tarbes qu’elle vécut les pires moments de sa vie qui lui inspirèrent plus tard, la chanson « L’Aigle noir ». Beaucoup de personnes se sont interrogées sur le sens réel des paroles de « L'Aigle noir ». De son vivant, Barbara se dérobait à chaque fois, prétextant que cela ne concernait qu'elle : "Ce ne sont pas les paroles qui sont importantes...", disait-elle. Selon le chanteur Patrick Bruel, qui a repris le titre en 2015, ces paroles seraient une référence à l'emblème du Troisième Reich et à la vie d'errance et de danger durant l'enfance de la chanteuse. Le journaliste Pierre Adrian commente : "Après l'interprétation psychanalytique, voici l'interprétation historique". En 1946, la famille Self s’installe au Vésinet (Yvelines) à la pension des Trois Marroniers au 31 bis, rue Ernest-André, où la future Barbara prend ses premiers cours de chant chez Madame Madeleine Thomas-Dusséqué. À son contact, elle apprend le chant, le solfège et le piano, avant d'emménager au 50, rue de Vitruve dans le 20e arrondissement de Paris. Madame Dusséqué quitte le Vésinet pour Paris. Elle donne des cours salle Pleyel. Le 30 décembre 1946, sa grand-mère maternelle Hava Poustilnikov décède à Paris à son domicile 131, rue Marcadet, à l’âge de 66 ans. Cette femme comptait beaucoup pour Monique. Peu attirée par les études, elle ambitionne depuis longtemps de devenir pianiste mais son rêve est brisé depuis 1944, un kyste à la main droite ayant obligé les médecins de Grenoble à intervenir à sept reprises et sectionner les tendons. Ses parents promettent de lui offrir des cours de chant. Elle s’inscrit à ceux de Mme Dusséqué. Sa vie en est changée. Au bout de quelques leçons, sa professeure la présente à maître Paulet, enseignant au Conservatoire de Paris, qui la prend comme élève en 1947. Dans le nouvel appartement, un piano loué par son père est installé ; Monique en joue d’instinct, sans prendre de leçons. La jeune fille entre au Conservatoire comme auditrice, mais au répertoire de chant classique, qui l'ennuie, elle préfère celui de la chanson populaire, ayant rencontré à l'ABC l'univers de Piaf. Elle arrête les cours en 1948. La même année, après avoir passé une audition au théâtre Mogador, elle est engagée comme mannequin-choriste dans l’opérette « Violettes impériales ». Un jour de 1949, son père abandonne soudainement le foyer, pour ne plus revenir. Bientôt, la même année, la location du piano ne peut plus être honorée. Contrainte de s’en séparer, elle vit un déchirement. Voulant à tout prix concrétiser son rêve, devenir "pianiste chantante", elle quitte Paris en février 1950. Grâce à l’argent prêté par une amie, elle s’exile à Bruxelles chez un cousin, Sacha Piroutsky, qu’elle quitte au bout de deux mois car il devenait violent. Sans ressources ni connaissances, la vie est difficile. Au hasard d’une rencontre, elle rejoint une communauté d’artistes à Charleroi, qui se réunissent dans un local appelé La Mansarde. Là, elle trouve de l’aide et commence à chanter dans des cabarets sous le nom de Barbara Brodi (en l'honneur d'une de ses aïeules ukrainiennes appelée Varvara, ou de sa grand-mère Hava Brodsky). Son répertoire est constitué de chansons d’Édith Piaf, Marianne Oswald, Germaine Montero, Juliette Gréco. Chaque fois, le public la siffle copieusement. En 1950, elle rencontre Jacques Brel qui, comme elle, tente de percer en se produisant dans divers cabarets. Elle ajoute à son répertoire les premières chansons de cet auteur-compositeur en herbe avec qui elle va se lier d'une très grande amitié discrète mais indéfectible, pleine de complicité et d'admiration mutuelle. Plus tard, tandis que Barbara ne chante encore que des chansons écrites par d'autres, Brel l'encourage à écrire elle-même ses propres chansons ; il sera donc le premier à qui elle fera découvrir ses premiers textes, dont ses premiers succès. Brel dira « Barbara, c'est une fille bien. Elle a un grain, mais un beau grain. On est un peu amoureux, comme ça, depuis longtemps ». En 1971, il lui offrira un premier rôle dans son film Franz. À partir de 1981, soit trois ans après la mort de Brel, La Valse de Franz, composée par Brel, sera jouée dans tous les spectacles de Barbara, En 1990, elle créera au théâtre Mogador la chanson Gauguin (Lettre à Jacques Brel). Fin 1951, elle retourne vivre chez son oncle au 131, rue Marcadet à Paris pour des auditions sans lendemain, dont une au cabaret La Fontaine des Quatre-Saisons dont la programmation est déjà faite et où on lui propose une place de plongeuse pour un an. Elle peut toutefois y rencontrer et observer, sans jamais chanter, Boris Vian avec Henri Crolla et Louis Bessières ou encore Mouloudji. Elle revient à Bruxelles où un ami du groupe de Charleroi lui donne l’occasion de chanter. Elle est mise en relation avec Ethery Rouchadze, pianiste géorgienne qui accepte de l’accompagner et auprès de qui elle se perfectionnera au piano. Cette dernière lui présente Claude Sluys, jeune avocat. Habitué des lieux de spectacles, il se pique d’écrire quelques chansons. Fin 1952, il déniche le « théâtre du Cheval blanc » et use de ses relations pour y ouvrir un cabaret afin qu’elle s’y produise sous le nom de Barbara. Elle monte pour la première fois sur scène accompagnée de son piano, vêtue d’un châle noir et maquillée de khôl. Ainsi commence à se construire le personnage de la « dame en noir ». Le bouche à oreille aidant, le succès ne se fait pas attendre. Le 31 octobre 1953, Barbara épouse Claude Sluys. Au début de l’année 1955, elle enregistre deux chansons chez Decca : « Mon pote le gitan » et « L'œillet blanc » (parfois noté « L'œillet rouge »), diffusées en 78 tours et 45 tours. En 1955, les époux se séparent. À la fin de l'année, Barbara retourne à Paris où elle chante dans de petits cabarets : La Rose rouge en 1956, Chez Moineau en 1957, puis en 1958 à L’Écluse, où elle a déjà chanté pour de courts engagements. En 1958, elle réussit à s’imposer, sous le surnom de La Chanteuse de minuit, si bien que sa notoriété grandit et lui attire un public de fidèles, en particulier parmi les étudiants du Quartier latin. C’est sous le nom de « Barbara » qu’elle effectue son premier passage à la télévision, le 12 juillet 1958, sur l’unique chaîne de la RTF, dans l’émission Cabaret du Soir, où la présentatrice la compare à Yvette Guilbert et lui assure "qu’elle deviendra certainement une grande vedette". À cette époque, poussée par son ami Brel, elle commence à écrire. Remarquée et engagée par Pathé-Marconi, elle enregistre, sous le label « La Voix de son Maître », son premier Super 45 tours, « La Chanteuse de minuit », avec deux de ses propres chansons : « J’ai troqué » et « J’ai tué l’amour », et au printemps 1959 son premier 33 tours « Barbara à L’Écluse ». En décembre 1959, apprenant que son père, qui avait fui sur les routes pour noyer son crime dans le vagabondage et la déchéance, est mourant et la réclame auprès de lui à Nantes (Loire-Atlantique), elle s'y précipite, mais arrive trop tard. À la vue de son corps, à la morgue, ses sentiments oscillent entre fascination, panique, mépris, haine, d'une part, et un immense désespoir d'autre part. Au lendemain de l’enterrement, elle commence l’écriture de la chanson « Nantes », qu’elle achève quatre ans plus tard, quelques heures avant son passage au théâtre des Capucines, le 5 novembre 1963 ; ce sera l'une de ses plus grandes chansons. En 1960, elle change de maison de disque pour signer chez Odéon. Elle enregistre « Barbara chante Brassens » puis « Barbara chante Jacques Brel » : le premier de ces albums est couronné par l’Académie Charles-Cros dans la catégorie « Meilleure interprète ». En 1961, elle décroche un tour de chant du 9 au 20 février, en première partie de Félix Marten à Bobino. Sa performance est peu appréciée, sa présentation jugée austère, à l’évidence pas encore prête pour les grandes scènes. Loin de se décourager, elle reprend ses récitals à L’Écluse. La même année, elle se rend à Abidjan, où elle retrouve son amant, le diplomate Hubert Ballay ; elle lui écrira « Dis, quand reviendras-tu ? », avant de le quitter. Deux années plus tard, les mardis de novembre et décembre 1963, au théâtre des Capucines, elle retient et capte l’attention avec un répertoire nouveau comprenant deux de ses chansons : « Nantes » et « Dis, quand reviendras-tu ? ». Le succès est tel que la maison Philips va donner un véritable élan à sa carrière en lui signant un contrat. Séduit, Georges Brassens lui propose la première partie de son prochain spectacle à Bobino. En attendant, le 4 juillet 1964, elle se rend sans enthousiasme en Allemagne de l'Ouest, en réponse à l’invitation de Hans-Gunther Klein, directeur du Junges Theater de la ville universitaire de Göttingen. Agréablement surprise et touchée par l’accueil chaleureux qu’elle reçoit, elle prolonge son séjour d’une semaine. L'avant-veille de son départ, elle offre au public la chanson « Göttingen », qu’elle a écrite d’un trait dans les jardins du théâtre. En mai 1967, elle sera à Hambourg pour l’enregistrer, avec neuf autres titres, traduits en allemand, pour le 33 tours « Barbara singt Barbara », et retournera chanter à Göttingen le 4 octobre. Dans les années 1980, les hommes politiques se saisiront de la chanson pour promouvoir l'amitié franco-allemande. En 1988, Barbara recevra la Médaille d’honneur de Göttingen et l'ordre du Mérite fédéral. En 1992, à la veille d'un référendum, François Mitterrand choisira ce titre pour terminer un entretien télévisé. En 2002, Xavier Darcos, alors ministre délégué à l’enseignement scolaire, inscrira cette chanson aux programmes officiels des classes de l'école primaire : la chanson sera reprise dans les écoles en 2003 à l'occasion de la commémoration du quarantième anniversaire du traité d'amitié franco-allemand, dit traité de l'Élysée. Comme convenu, elle chante à Bobino avec Georges Brassens en « vedette » du 21 octobre au 9 novembre 1964. Le public est conquis et les critiques sont unanimes pour saluer sa prestation. Paris-presse, L’Intransigeant écrit qu’elle "fait presque oublier Brassens", L'Humanité : "Un faux pas de Brassens, une prouesse de Barbara." Le 14 mars 1965, sort son premier album Philips, « Barbara chante Barbara ». Il obtient le prix de l’Académie Charles-Cros et un réel succès commercial. Lors de la cérémonie, au palais d’Orsay, Barbara déchire son prix en quatre pour le distribuer aux techniciens, en témoignage de sa gratitude. La même année, elle obtient un grand succès à Bobino. Le 15 septembre, jour de la première, France Inter organise une journée Barbara sur ses ondes. La chanteuse est si profondément marquée par cette première qu’elle l'immortalise peu après dans l’une de ses plus grandes chansons : Ma plus belle histoire d’amour. « Ce fut, un soir, en septembre / Vous étiez venus m’attendre / Ici même, vous en souvenez-vous ? … ». En décembre 1966, Barbara se produit à nouveau à Bobino, où elle interprète notamment « Au cœur de la nuit » (titre que jamais plus elle n'inscrira à son tour de chant). Trois ans avant « L'Aigle noir », elle y évoque "un bruissement d'ailes qui effleure son visage", évoque la mort de son père et le pardon "pour qu'enfin tu puisses dormir, pour qu'enfin ton cœur repose, que tu finisses de mourir sous tes paupières déjà closes" (voir les albums Ma plus belle histoire d'amour, Bobino 1967). En 1967, elle écrit avec Georges Moustaki, « La Dame brune », chanson d'amour qu'ils interprètent en duo. Elle dira à son sujet : "Moustaki, c'est ma tendresse". Le 6 novembre 1967, alors en tournée en Italie, elle apprend la mort de sa mère. Elle a vécu au 14, rue de Rémusat de 1961 à 1967, date à laquelle elle quitte l'immeuble à la suite du décès de sa mère, ce qui lui inspire quelques années plus tard, en 1972, la chanson Rémusat, où elle évoque ce double départ. En février 1969, Barbara est à l’Olympia. À la fin de la dernière représentation, à la stupeur générale, elle annonce qu’elle arrête le tour de chant. Mais elle respecte ses engagements passés jusqu’en 1971. Toutefois, cet arrêt ne sera pas définitif. Elle a d'ailleurs déclaré qu'elle n'avait jamais fait d'adieux, mais qu'elle avait pris ses distances. La chanteuse reviendra sur les scènes du music-hall après trois ans d'absence. Début 1970, elle est au théâtre de la Renaissance dans « Madame », une pièce musicale, écrite par Rémo Forlani, dont elle signe la musique. Le rocking-chair du décor la suivra désormais dans tous ses tours de chant. Elle interprète une "tenancière de lupanar en Afrique". « Madame » est un échec, mais Barbara remet rapidement le pied à l’étrier grâce au succès de l’album studio L'Aigle noir, dont la chanson homonyme est l’un des plus gros succès discographiques de l’année. Barbara a dit de cette chanson qu'elle l'avait rêvée, "un rêve plus beau que la chanson elle-même". À la suite de la publication de ses mémoires en 1998, une interprétation bien plus sombre de « L'Aigle noir » fut supposée. En février 1972, Barbara est avec son ami Jacques Brel à l'affiche de « Franz ». Elle joue Léonie, femme laide, incapable de vivre l’amour dont elle rêve. Ce premier film réalisé par le chanteur obtient peu de succès. Deux ans plus tard, elle joue la diva délaissée du film « L'Oiseau rare », réalisé par Jean-Claude Brialy. Le danseur et chorégraphe Maurice Béjart, qui appréciait Barbara énormément, la fait tourner dans « Je suis né à Venise ». Dans ce film, qui ne sera diffusé qu’à la télévision, Barbara tient deux rôles : celui d'une chanteuse (elle interprète trois titres : L’Amour magicien, L’Homme en habit rouge et La Mort) et celui de La Dame de la nuit. Sa carrière musicale demeure active dans les années 1970 : à la télévision, en 1972, elle interprète un duo avec Johnny Hallyday, « Toi mon ombre, toi ma lumière ». Elle tourne au Japon, au Canada, en Belgique, en Israël, aux Pays-Bas et en Suisse. Barbara réalisera ses plus grands passages de sa carrière à la télévision pendant ses années ORTF, entre 1958 et 1974. En 1973, Barbara s'installe à Précy-sur-Marne, à trente kilomètres à l'est de Paris, dans une ancienne ferme villageoise au 2, rue de Verdun. Pour ses répétitions avant chaque spectacle, elle fait transformer la grange en théâtre, lui donnant le nom de « Grange au loup ». Dans le jardin enserré par les bâtiments de la ferme, elle découvre le plaisir de jardiner. Au petit matin du 5 juin 1974, les pompiers de Meaux découvrent son corps inanimé. Dans le coma, elle est conduite en urgence à l'hôpital. Plus tard, dans plusieurs entretiens, elle relate l'événement en expliquant que, n'arrivant pas à trouver le sommeil, elle a absorbé les cachets qu'elle avait sous la main. Lors d'un concert à Avignon, elle déclare : "Je n'ai pas voulu mourir, j'ai voulu dormir". Par décision, elle interrompt ses apparitions audiovisuelles en 1974. À partir de cette période, ses textes et ses choix musicaux évoluent en profondeur, et ses concerts de 1974, 1975 et 1978 accueillent de nouveaux titres importants. La chanson de 1974, « L’homme en habit rouge », évoque le souvenir de sa liaison avec son parolier de l’album La Louve, François Wertheimer, auquel Barbara avait offert le parfum Habit rouge de Guerlain. Pour cet album de 1973, Barbara demande à William Sheller de faire les orchestrations. De cette collaboration naît une amitié entre William et la Duchesse, comme celui-ci la surnomme affectueusement. C'est elle qui pousse alors William à devenir chanteur. Entre 1975 et 1976, elle a une aventure avec le comédien Pierre Arditi, de quatorze ans son cadet. Celui-ci se souvient d'avoir été comme "un adolescent énamouré" dans une liaison qu'il décrit comme "pas très longue mais marquante". Après leur séparation, ils sont restés très bons amis. En 1978, elle fait un retour remarqué à l'Olympia. Son album Seule est l’une des meilleures ventes de 1981. Son plus grand succès sur scène est celui qu’elle présente à l'automne de la même année à l’hippodrome de Pantin. Plus que de simples concerts, ses représentations sont, selon Jérôme Garcin, de véritables messes dont les rappels ininterrompus se prolongent jusque tard dans la nuit. Elle y interprète notamment « Regarde », chanson militante qu'elle a composée et chantée pour la campagne présidentielle de François Mitterrand, pour qui elle appela à voter, à partir du 8 avril 1981. C’est lors de ce spectacle que la voix de la chanteuse, pour la première fois, et irrémédiablement, se brise. Si au départ elle s'en affole, par la suite elle ne cherchera pas à le cacher mais saura au contraire se servir de cette voix, désormais "au crépuscule", pour renforcer l’aspect dramatique et authentique de son interprétation. Se renouvelant sans cesse, la chanteuse continue d’attirer un public très jeune. L’année suivante, elle reçoit le Grand prix national de la chanson en reconnaissance de sa contribution à la culture française. Par ailleurs, elle développe une relation de travail et d’amitié avec la vedette cinématographique montante Gérard Depardieu et son épouse Élisabeth. En 1985, elle coécrit avec Luc Plamondon la musique et le texte de la pièce Lily Passion, où elle joue et chante avec Gérard Depardieu. Sorte d’autobiographie romancée, c’est l’histoire d’une chanteuse qui voue toute sa vie à son public. La première représentation a lieu au Zénith de Paris, le 21 janvier 1986. L’été venu, elle est invitée sur la scène du Metropolitan Opera de New York pour un Gala Performance, donné le 8 juillet. Elle accompagne au piano son ami le danseur étoile Mikhaïl Barychnikov qui danse sur deux de ses chansons « Pierre » et « Le Mal de vivre ». À cette période, elle s'investit dans la collecte de fonds pour le traitement du Sida. Elle rend visite aux malades dans les hôpitaux et dans les prisons. Lors de ses concerts, elle met des corbeilles de préservatifs à la disposition des personnes venues l’écouter ; engagement dont témoigne artistiquement le titre « Sid’Amour à mort ». En 1987, elle monte pour la première fois sur la scène du théâtre du Châtelet, à Paris, pour une série de récitals pendant les mois de septembre et octobre, suivis d'une tournée en France, en Suisse, en Belgique, au Japon, au Canada et en Israël qui se termine en 1988. En 1988, elle est promue chevalier de la Légion d'honneur par le Président de la République François Mitterrand. L'année suivante, elle chante au théâtre Mogador à Paris de février à avril. Suivra une tournée en France et au Japon jusqu'en 1991. En 1991, elle enregistre « Lettres à un jeune poète » de Rainer Maria Rilke pour les Éditions Claudine Ducaté. Elle dédicacera cet enregistrement dans une librairie parisienne, la même année. En novembre et décembre 1993, Barbara est à nouveau sur la scène parisienne du théâtre du Châtelet, mais des problèmes de santé la contraignent à interrompre les représentations. Après quelques jours de repos, elle retrouve son public, le temps d’enregistrer le spectacle, puis renonce à poursuivre et annule les dernières représentations. En 1994, elle obtient la Victoire de l'artiste interprète féminine de l'année aux Victoires de la musique (une récompense qu'elle obtiendra une seconde fois en 1997). Son ultime tournée débute à Dijon, le 1er février. Sa dernière apparition sur scène a lieu le soir du samedi 26 mars 1994 au Centre de Congrès Vinci de la ville de Tours. Après seize années passées loin des studios, elle enregistre douze nouvelles chansons durant l'été 1996. Pour ce disque, Jean-Louis Aubert signe le texte « Vivant poème » et Guillaume Depardieu celui de « À force de ». Sorti le 6 novembre, cet album sobrement intitulé « Barbara » est son chant du cygne. Epuisée par les stimulants, les médicaments pris en dose massive pour soigner son angoisse ou les corticoïdes pour ses cordes vocales, affaiblie par une alimentation hasardeuse, elle consacre son temps à la rédaction de ses mémoires. Le 24 novembre 1997, elle est hospitalisée pour une pneumonie que les rumeurs transforment en mystère. Elle meurt à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine à l’âge de 67 ans, victime d’une infection respiratoire foudroyante. Elle disparaît juste après la sortie de « Femme Piano », regroupant ses plus belles chansons. Elle est enterrée trois jours plus tard au cimetière de Bagneux, entourée d’une foule d’amis et de fans. Allant totalement à l’encontre des modes de son temps, tant musicales que physiques, Barbara a pourtant su se faire sa place et s’imposer sur la scène de la chanson française. Toute son œuvre fut intimement liée à sa vie personnelle. Les mémoires posthumes de Barbara, « Il était un piano noir », révélèrent une déchirure d’enfance, un lourd secret à porter. Même si cela transpire tout au long de son œuvre, l’artiste ne pourra jamais l’aborder franchement sinon par des allusions très voilées, qui permettront à ses proches de sentir cette fêlure ineffaçable.
 Barbara, née Monique Andrée Serf le 9 juin 1930 près du square des Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris et décédée le 24 novembre 1997 à Neuilly-sur-Seine. Elle est le deuxième enfant d’une famille qui en compte quatre. Elle a marqué la chanson française de sa musique poétique et passionnelle. Nombre de ses chansons sont devenues des classiques, notamment : « Dis, quand reviendras-tu ? », « Nantes », « Au bois de Saint-Amand », « Göttingen », « La solitude », « Une petite cantate », « La Dame brune », « L'Aigle noir », « Marienbad », « Ma plus belle histoire d’amour », « Pierre », « Le mal de vivre », « Vienne », « Drouot » ou encore « Si la photo est bonne ». Elle a joué dans trois films pour le cinéma « Aussi loin que l’amour » en 1971, « Franz » en 1972, « L’oiseau rare » en 1973 et dans deux pièces musicales sur scène : « Madame » en 1970, et « Lily passion » avec Gérard Depardieu en 1985. Depuis 2010, le « prix Barbara » récompense chaque année une jeune chanteuse francophone. Elle est la fille de Jacques Serf, un Juif alsacien, représentant de commerce en peaux et fourrures et d’Esther Brodsky, Juive née à Tiraspol (Moldavie), fonctionnaire à la préfecture de Paris. Monique Serf passe les premières années de sa vie dans ce coin des Batignolles, avec ses parents, sa grand-mère maternelle Hava Poustilnikov, née à Zlatopil (en Ukraine), et son frère aîné Jean, né en 1928. Sa jeunesse est marquée par des déménagements successifs, notamment en 1937, à Marseille, première étape d’un itinéraire sinueux, 1938, au 26, rue Mulsant à Roanne (Loire), où naît sa sœur Régine en août de la même année, en 1939, la famille quitte Roanne pour Le Vésinet dans la banlieue ouest de la capitale, où réside Jeanne Spire, la tante de Monsieur Serf. En septembre 1939 la guerre éclate et son père rejoint le front. Jeanne Spire, Jean et Monique rejoignent Poitiers, où un médecin les héberge. En 1940, sa mère travaille à la préfecture de Blois. Les deux aînés et leur grand-tante l’y rejoignent. Un bombardement de la ville s’annonce. Les deux enfants partent en train avec Jeanne Spire. Une attaque de l’aviation allemande vise le convoi en rase campagne. Les voyageurs resteront bloqués dans le train durant plusieurs jours. L’école communale de Préaux (Indre) accueille les réfugiés du train. Jeanne Spire loue deux chambres au-dessus du café Lanchais sur la place du village. Les deux enfants et Jeanne Spire resteront plus d’un an à Préaux. Ils s’intègrent à la vie du village, Monique et Jean vont à l’école communale. Fin 1941, par l’intermédiaire de la mairie de Préaux, leur grand-tante apprend que les parents résident à Tarbes, où Monsieur Serf est démobilisé. La famille se recompose immédiatement à Tarbes (Hautes-Pyrénées), au 3 bis, rue des Carmes. La tante Jeanne reste quelques mois avec eux. Claude, le jeune frère de Monique naît en mars 1942. Monique fréquente l’école communale. Mais la famille doit quitter rapidement Tarbes : un dénonciateur a informé la police qu’une famille juive vit rue des Carmes. Une menace de rafle dont les parents ont été informés. C'est la tante Jeanne qui avait été prévenue la veille du départ. Les déménagements redoublent sous l’Occupation pour fuir la traque nazie faite aux juifs. S’y ajoutent les séparations pour déjouer les dénonciations. De 1943 à octobre 1945, la famille se cache près de Chasseneuil-sur-Bonnieure en Charente, puis à Grenoble et à Saint-Marcellin en Isère. À la Libération, les membres de la famille quittent Saint-Marcellin pour Paris, d’abord au 131, rue Marcadet, puis dans un appartement rue Notre-Dame-de-Nazareth, puis dans un autre hôtel rue de Vaugirard, où ils se retrouvent tous. Barbara subira le comportement incestueux de son père pendant son enfance. Après Blois, Préaux, la voilà donc fin 1941 à Tarbes. Qui rêve spectacles, déguise ses voisins de la cour « et la petite fille de la propriétaire qui était rudement jolie et qui intéressait diablement mon frère Jean », se souvient-elle. Mais c'est un quotidien de cauchemar que vit la petite fille juive dans « une assez grande maison, 3 bis, rue des Carmes ». Son frère est premier en tout au lycée Théophile-Gautier. Elle est « très indisciplinée », « frondeuse », « désobéissante », disent ses livrets scolaires de la communale. Son père ne manque jamais une occasion de l'humilier. Sauf quand ils sont seuls tous les deux. Elle n'écrira jamais le mot. Mais « le soir, lorsque j'entends claquer le grand portail vert et les pas de mon père résonner dans la cour, je me prends à trembler ». Et les larmes lui viennent, confie-t-elle en révélant sans le dire l'inceste. Rappelant simplement « les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire ». C’est à Tarbes, alors qu'elle a à peine onze ans et demi, que son père abuse d'elle pour la première fois. "Un soir, à Tarbes, mon univers bascule dans l'horreur", écrit-elle. Personne ne dénonce l'inceste dans sa famille. Elle tente bien de s'adresser à une gendarmerie, au soir d'une fugue en Bretagne. On l'écoute mais sa plainte n'est pas enregistrée. Son père revient la chercher et laisse entendre qu'elle affabule. En 1949, alors qu'elle n'a que dix-neuf ans, le départ définitif du foyer familial de son père marque l'interruption de leurs rapports, mais elle n'en fait le récit que très tard, dans ses mémoires interrompus par sa mort en 1997, sans toutefois se décider à dire les mots de « viol » et d'« inceste ». « Tarbes a toujours été un souvenir très dur pour Barbara », confiera à la Dépêche du Midi, Marie Chaix, la secrétaire et biographe de la chanteuse Barbara. « Je ne chanterai pas à Tarbes », disait-elle. Plus tard, elle donnera un concert, finalement, mais à Ibos, au Parvis. C’est donc à Tarbes qu’elle vécut les pires moments de sa vie qui lui inspirèrent plus tard, la chanson « L’Aigle noir ». Beaucoup de personnes se sont interrogées sur le sens réel des paroles de « L'Aigle noir ». De son vivant, Barbara se dérobait à chaque fois, prétextant que cela ne concernait qu'elle : "Ce ne sont pas les paroles qui sont importantes...", disait-elle. Selon le chanteur Patrick Bruel, qui a repris le titre en 2015, ces paroles seraient une référence à l'emblème du Troisième Reich et à la vie d'errance et de danger durant l'enfance de la chanteuse. Le journaliste Pierre Adrian commente : "Après l'interprétation psychanalytique, voici l'interprétation historique". En 1946, la famille Self s’installe au Vésinet (Yvelines) à la pension des Trois Marroniers au 31 bis, rue Ernest-André, où la future Barbara prend ses premiers cours de chant chez Madame Madeleine Thomas-Dusséqué. À son contact, elle apprend le chant, le solfège et le piano, avant d'emménager au 50, rue de Vitruve dans le 20e arrondissement de Paris. Madame Dusséqué quitte le Vésinet pour Paris. Elle donne des cours salle Pleyel. Le 30 décembre 1946, sa grand-mère maternelle Hava Poustilnikov décède à Paris à son domicile 131, rue Marcadet, à l’âge de 66 ans. Cette femme comptait beaucoup pour Monique. Peu attirée par les études, elle ambitionne depuis longtemps de devenir pianiste mais son rêve est brisé depuis 1944, un kyste à la main droite ayant obligé les médecins de Grenoble à intervenir à sept reprises et sectionner les tendons. Ses parents promettent de lui offrir des cours de chant. Elle s’inscrit à ceux de Mme Dusséqué. Sa vie en est changée. Au bout de quelques leçons, sa professeure la présente à maître Paulet, enseignant au Conservatoire de Paris, qui la prend comme élève en 1947. Dans le nouvel appartement, un piano loué par son père est installé ; Monique en joue d’instinct, sans prendre de leçons. La jeune fille entre au Conservatoire comme auditrice, mais au répertoire de chant classique, qui l'ennuie, elle préfère celui de la chanson populaire, ayant rencontré à l'ABC l'univers de Piaf. Elle arrête les cours en 1948. La même année, après avoir passé une audition au théâtre Mogador, elle est engagée comme mannequin-choriste dans l’opérette « Violettes impériales ». Un jour de 1949, son père abandonne soudainement le foyer, pour ne plus revenir. Bientôt, la même année, la location du piano ne peut plus être honorée. Contrainte de s’en séparer, elle vit un déchirement. Voulant à tout prix concrétiser son rêve, devenir "pianiste chantante", elle quitte Paris en février 1950. Grâce à l’argent prêté par une amie, elle s’exile à Bruxelles chez un cousin, Sacha Piroutsky, qu’elle quitte au bout de deux mois car il devenait violent. Sans ressources ni connaissances, la vie est difficile. Au hasard d’une rencontre, elle rejoint une communauté d’artistes à Charleroi, qui se réunissent dans un local appelé La Mansarde. Là, elle trouve de l’aide et commence à chanter dans des cabarets sous le nom de Barbara Brodi (en l'honneur d'une de ses aïeules ukrainiennes appelée Varvara, ou de sa grand-mère Hava Brodsky). Son répertoire est constitué de chansons d’Édith Piaf, Marianne Oswald, Germaine Montero, Juliette Gréco. Chaque fois, le public la siffle copieusement. En 1950, elle rencontre Jacques Brel qui, comme elle, tente de percer en se produisant dans divers cabarets. Elle ajoute à son répertoire les premières chansons de cet auteur-compositeur en herbe avec qui elle va se lier d'une très grande amitié discrète mais indéfectible, pleine de complicité et d'admiration mutuelle. Plus tard, tandis que Barbara ne chante encore que des chansons écrites par d'autres, Brel l'encourage à écrire elle-même ses propres chansons ; il sera donc le premier à qui elle fera découvrir ses premiers textes, dont ses premiers succès. Brel dira « Barbara, c'est une fille bien. Elle a un grain, mais un beau grain. On est un peu amoureux, comme ça, depuis longtemps ». En 1971, il lui offrira un premier rôle dans son film Franz. À partir de 1981, soit trois ans après la mort de Brel, La Valse de Franz, composée par Brel, sera jouée dans tous les spectacles de Barbara, En 1990, elle créera au théâtre Mogador la chanson Gauguin (Lettre à Jacques Brel). Fin 1951, elle retourne vivre chez son oncle au 131, rue Marcadet à Paris pour des auditions sans lendemain, dont une au cabaret La Fontaine des Quatre-Saisons dont la programmation est déjà faite et où on lui propose une place de plongeuse pour un an. Elle peut toutefois y rencontrer et observer, sans jamais chanter, Boris Vian avec Henri Crolla et Louis Bessières ou encore Mouloudji. Elle revient à Bruxelles où un ami du groupe de Charleroi lui donne l’occasion de chanter. Elle est mise en relation avec Ethery Rouchadze, pianiste géorgienne qui accepte de l’accompagner et auprès de qui elle se perfectionnera au piano. Cette dernière lui présente Claude Sluys, jeune avocat. Habitué des lieux de spectacles, il se pique d’écrire quelques chansons. Fin 1952, il déniche le « théâtre du Cheval blanc » et use de ses relations pour y ouvrir un cabaret afin qu’elle s’y produise sous le nom de Barbara. Elle monte pour la première fois sur scène accompagnée de son piano, vêtue d’un châle noir et maquillée de khôl. Ainsi commence à se construire le personnage de la « dame en noir ». Le bouche à oreille aidant, le succès ne se fait pas attendre. Le 31 octobre 1953, Barbara épouse Claude Sluys. Au début de l’année 1955, elle enregistre deux chansons chez Decca : « Mon pote le gitan » et « L'œillet blanc » (parfois noté « L'œillet rouge »), diffusées en 78 tours et 45 tours. En 1955, les époux se séparent. À la fin de l'année, Barbara retourne à Paris où elle chante dans de petits cabarets : La Rose rouge en 1956, Chez Moineau en 1957, puis en 1958 à L’Écluse, où elle a déjà chanté pour de courts engagements. En 1958, elle réussit à s’imposer, sous le surnom de La Chanteuse de minuit, si bien que sa notoriété grandit et lui attire un public de fidèles, en particulier parmi les étudiants du Quartier latin. C’est sous le nom de « Barbara » qu’elle effectue son premier passage à la télévision, le 12 juillet 1958, sur l’unique chaîne de la RTF, dans l’émission Cabaret du Soir, où la présentatrice la compare à Yvette Guilbert et lui assure "qu’elle deviendra certainement une grande vedette". À cette époque, poussée par son ami Brel, elle commence à écrire. Remarquée et engagée par Pathé-Marconi, elle enregistre, sous le label « La Voix de son Maître », son premier Super 45 tours, « La Chanteuse de minuit », avec deux de ses propres chansons : « J’ai troqué » et « J’ai tué l’amour », et au printemps 1959 son premier 33 tours « Barbara à L’Écluse ». En décembre 1959, apprenant que son père, qui avait fui sur les routes pour noyer son crime dans le vagabondage et la déchéance, est mourant et la réclame auprès de lui à Nantes (Loire-Atlantique), elle s'y précipite, mais arrive trop tard. À la vue de son corps, à la morgue, ses sentiments oscillent entre fascination, panique, mépris, haine, d'une part, et un immense désespoir d'autre part. Au lendemain de l’enterrement, elle commence l’écriture de la chanson « Nantes », qu’elle achève quatre ans plus tard, quelques heures avant son passage au théâtre des Capucines, le 5 novembre 1963 ; ce sera l'une de ses plus grandes chansons. En 1960, elle change de maison de disque pour signer chez Odéon. Elle enregistre « Barbara chante Brassens » puis « Barbara chante Jacques Brel » : le premier de ces albums est couronné par l’Académie Charles-Cros dans la catégorie « Meilleure interprète ». En 1961, elle décroche un tour de chant du 9 au 20 février, en première partie de Félix Marten à Bobino. Sa performance est peu appréciée, sa présentation jugée austère, à l’évidence pas encore prête pour les grandes scènes. Loin de se décourager, elle reprend ses récitals à L’Écluse. La même année, elle se rend à Abidjan, où elle retrouve son amant, le diplomate Hubert Ballay ; elle lui écrira « Dis, quand reviendras-tu ? », avant de le quitter. Deux années plus tard, les mardis de novembre et décembre 1963, au théâtre des Capucines, elle retient et capte l’attention avec un répertoire nouveau comprenant deux de ses chansons : « Nantes » et « Dis, quand reviendras-tu ? ». Le succès est tel que la maison Philips va donner un véritable élan à sa carrière en lui signant un contrat. Séduit, Georges Brassens lui propose la première partie de son prochain spectacle à Bobino. En attendant, le 4 juillet 1964, elle se rend sans enthousiasme en Allemagne de l'Ouest, en réponse à l’invitation de Hans-Gunther Klein, directeur du Junges Theater de la ville universitaire de Göttingen. Agréablement surprise et touchée par l’accueil chaleureux qu’elle reçoit, elle prolonge son séjour d’une semaine. L'avant-veille de son départ, elle offre au public la chanson « Göttingen », qu’elle a écrite d’un trait dans les jardins du théâtre. En mai 1967, elle sera à Hambourg pour l’enregistrer, avec neuf autres titres, traduits en allemand, pour le 33 tours « Barbara singt Barbara », et retournera chanter à Göttingen le 4 octobre. Dans les années 1980, les hommes politiques se saisiront de la chanson pour promouvoir l'amitié franco-allemande. En 1988, Barbara recevra la Médaille d’honneur de Göttingen et l'ordre du Mérite fédéral. En 1992, à la veille d'un référendum, François Mitterrand choisira ce titre pour terminer un entretien télévisé. En 2002, Xavier Darcos, alors ministre délégué à l’enseignement scolaire, inscrira cette chanson aux programmes officiels des classes de l'école primaire : la chanson sera reprise dans les écoles en 2003 à l'occasion de la commémoration du quarantième anniversaire du traité d'amitié franco-allemand, dit traité de l'Élysée. Comme convenu, elle chante à Bobino avec Georges Brassens en « vedette » du 21 octobre au 9 novembre 1964. Le public est conquis et les critiques sont unanimes pour saluer sa prestation. Paris-presse, L’Intransigeant écrit qu’elle "fait presque oublier Brassens", L'Humanité : "Un faux pas de Brassens, une prouesse de Barbara." Le 14 mars 1965, sort son premier album Philips, « Barbara chante Barbara ». Il obtient le prix de l’Académie Charles-Cros et un réel succès commercial. Lors de la cérémonie, au palais d’Orsay, Barbara déchire son prix en quatre pour le distribuer aux techniciens, en témoignage de sa gratitude. La même année, elle obtient un grand succès à Bobino. Le 15 septembre, jour de la première, France Inter organise une journée Barbara sur ses ondes. La chanteuse est si profondément marquée par cette première qu’elle l'immortalise peu après dans l’une de ses plus grandes chansons : Ma plus belle histoire d’amour. « Ce fut, un soir, en septembre / Vous étiez venus m’attendre / Ici même, vous en souvenez-vous ? … ». En décembre 1966, Barbara se produit à nouveau à Bobino, où elle interprète notamment « Au cœur de la nuit » (titre que jamais plus elle n'inscrira à son tour de chant). Trois ans avant « L'Aigle noir », elle y évoque "un bruissement d'ailes qui effleure son visage", évoque la mort de son père et le pardon "pour qu'enfin tu puisses dormir, pour qu'enfin ton cœur repose, que tu finisses de mourir sous tes paupières déjà closes" (voir les albums Ma plus belle histoire d'amour, Bobino 1967). En 1967, elle écrit avec Georges Moustaki, « La Dame brune », chanson d'amour qu'ils interprètent en duo. Elle dira à son sujet : "Moustaki, c'est ma tendresse". Le 6 novembre 1967, alors en tournée en Italie, elle apprend la mort de sa mère. Elle a vécu au 14, rue de Rémusat de 1961 à 1967, date à laquelle elle quitte l'immeuble à la suite du décès de sa mère, ce qui lui inspire quelques années plus tard, en 1972, la chanson Rémusat, où elle évoque ce double départ. En février 1969, Barbara est à l’Olympia. À la fin de la dernière représentation, à la stupeur générale, elle annonce qu’elle arrête le tour de chant. Mais elle respecte ses engagements passés jusqu’en 1971. Toutefois, cet arrêt ne sera pas définitif. Elle a d'ailleurs déclaré qu'elle n'avait jamais fait d'adieux, mais qu'elle avait pris ses distances. La chanteuse reviendra sur les scènes du music-hall après trois ans d'absence. Début 1970, elle est au théâtre de la Renaissance dans « Madame », une pièce musicale, écrite par Rémo Forlani, dont elle signe la musique. Le rocking-chair du décor la suivra désormais dans tous ses tours de chant. Elle interprète une "tenancière de lupanar en Afrique". « Madame » est un échec, mais Barbara remet rapidement le pied à l’étrier grâce au succès de l’album studio L'Aigle noir, dont la chanson homonyme est l’un des plus gros succès discographiques de l’année. Barbara a dit de cette chanson qu'elle l'avait rêvée, "un rêve plus beau que la chanson elle-même". À la suite de la publication de ses mémoires en 1998, une interprétation bien plus sombre de « L'Aigle noir » fut supposée. En février 1972, Barbara est avec son ami Jacques Brel à l'affiche de « Franz ». Elle joue Léonie, femme laide, incapable de vivre l’amour dont elle rêve. Ce premier film réalisé par le chanteur obtient peu de succès. Deux ans plus tard, elle joue la diva délaissée du film « L'Oiseau rare », réalisé par Jean-Claude Brialy. Le danseur et chorégraphe Maurice Béjart, qui appréciait Barbara énormément, la fait tourner dans « Je suis né à Venise ». Dans ce film, qui ne sera diffusé qu’à la télévision, Barbara tient deux rôles : celui d'une chanteuse (elle interprète trois titres : L’Amour magicien, L’Homme en habit rouge et La Mort) et celui de La Dame de la nuit. Sa carrière musicale demeure active dans les années 1970 : à la télévision, en 1972, elle interprète un duo avec Johnny Hallyday, « Toi mon ombre, toi ma lumière ». Elle tourne au Japon, au Canada, en Belgique, en Israël, aux Pays-Bas et en Suisse. Barbara réalisera ses plus grands passages de sa carrière à la télévision pendant ses années ORTF, entre 1958 et 1974. En 1973, Barbara s'installe à Précy-sur-Marne, à trente kilomètres à l'est de Paris, dans une ancienne ferme villageoise au 2, rue de Verdun. Pour ses répétitions avant chaque spectacle, elle fait transformer la grange en théâtre, lui donnant le nom de « Grange au loup ». Dans le jardin enserré par les bâtiments de la ferme, elle découvre le plaisir de jardiner. Au petit matin du 5 juin 1974, les pompiers de Meaux découvrent son corps inanimé. Dans le coma, elle est conduite en urgence à l'hôpital. Plus tard, dans plusieurs entretiens, elle relate l'événement en expliquant que, n'arrivant pas à trouver le sommeil, elle a absorbé les cachets qu'elle avait sous la main. Lors d'un concert à Avignon, elle déclare : "Je n'ai pas voulu mourir, j'ai voulu dormir". Par décision, elle interrompt ses apparitions audiovisuelles en 1974. À partir de cette période, ses textes et ses choix musicaux évoluent en profondeur, et ses concerts de 1974, 1975 et 1978 accueillent de nouveaux titres importants. La chanson de 1974, « L’homme en habit rouge », évoque le souvenir de sa liaison avec son parolier de l’album La Louve, François Wertheimer, auquel Barbara avait offert le parfum Habit rouge de Guerlain. Pour cet album de 1973, Barbara demande à William Sheller de faire les orchestrations. De cette collaboration naît une amitié entre William et la Duchesse, comme celui-ci la surnomme affectueusement. C'est elle qui pousse alors William à devenir chanteur. Entre 1975 et 1976, elle a une aventure avec le comédien Pierre Arditi, de quatorze ans son cadet. Celui-ci se souvient d'avoir été comme "un adolescent énamouré" dans une liaison qu'il décrit comme "pas très longue mais marquante". Après leur séparation, ils sont restés très bons amis. En 1978, elle fait un retour remarqué à l'Olympia. Son album Seule est l’une des meilleures ventes de 1981. Son plus grand succès sur scène est celui qu’elle présente à l'automne de la même année à l’hippodrome de Pantin. Plus que de simples concerts, ses représentations sont, selon Jérôme Garcin, de véritables messes dont les rappels ininterrompus se prolongent jusque tard dans la nuit. Elle y interprète notamment « Regarde », chanson militante qu'elle a composée et chantée pour la campagne présidentielle de François Mitterrand, pour qui elle appela à voter, à partir du 8 avril 1981. C’est lors de ce spectacle que la voix de la chanteuse, pour la première fois, et irrémédiablement, se brise. Si au départ elle s'en affole, par la suite elle ne cherchera pas à le cacher mais saura au contraire se servir de cette voix, désormais "au crépuscule", pour renforcer l’aspect dramatique et authentique de son interprétation. Se renouvelant sans cesse, la chanteuse continue d’attirer un public très jeune. L’année suivante, elle reçoit le Grand prix national de la chanson en reconnaissance de sa contribution à la culture française. Par ailleurs, elle développe une relation de travail et d’amitié avec la vedette cinématographique montante Gérard Depardieu et son épouse Élisabeth. En 1985, elle coécrit avec Luc Plamondon la musique et le texte de la pièce Lily Passion, où elle joue et chante avec Gérard Depardieu. Sorte d’autobiographie romancée, c’est l’histoire d’une chanteuse qui voue toute sa vie à son public. La première représentation a lieu au Zénith de Paris, le 21 janvier 1986. L’été venu, elle est invitée sur la scène du Metropolitan Opera de New York pour un Gala Performance, donné le 8 juillet. Elle accompagne au piano son ami le danseur étoile Mikhaïl Barychnikov qui danse sur deux de ses chansons « Pierre » et « Le Mal de vivre ». À cette période, elle s'investit dans la collecte de fonds pour le traitement du Sida. Elle rend visite aux malades dans les hôpitaux et dans les prisons. Lors de ses concerts, elle met des corbeilles de préservatifs à la disposition des personnes venues l’écouter ; engagement dont témoigne artistiquement le titre « Sid’Amour à mort ». En 1987, elle monte pour la première fois sur la scène du théâtre du Châtelet, à Paris, pour une série de récitals pendant les mois de septembre et octobre, suivis d'une tournée en France, en Suisse, en Belgique, au Japon, au Canada et en Israël qui se termine en 1988. En 1988, elle est promue chevalier de la Légion d'honneur par le Président de la République François Mitterrand. L'année suivante, elle chante au théâtre Mogador à Paris de février à avril. Suivra une tournée en France et au Japon jusqu'en 1991. En 1991, elle enregistre « Lettres à un jeune poète » de Rainer Maria Rilke pour les Éditions Claudine Ducaté. Elle dédicacera cet enregistrement dans une librairie parisienne, la même année. En novembre et décembre 1993, Barbara est à nouveau sur la scène parisienne du théâtre du Châtelet, mais des problèmes de santé la contraignent à interrompre les représentations. Après quelques jours de repos, elle retrouve son public, le temps d’enregistrer le spectacle, puis renonce à poursuivre et annule les dernières représentations. En 1994, elle obtient la Victoire de l'artiste interprète féminine de l'année aux Victoires de la musique (une récompense qu'elle obtiendra une seconde fois en 1997). Son ultime tournée débute à Dijon, le 1er février. Sa dernière apparition sur scène a lieu le soir du samedi 26 mars 1994 au Centre de Congrès Vinci de la ville de Tours. Après seize années passées loin des studios, elle enregistre douze nouvelles chansons durant l'été 1996. Pour ce disque, Jean-Louis Aubert signe le texte « Vivant poème » et Guillaume Depardieu celui de « À force de ». Sorti le 6 novembre, cet album sobrement intitulé « Barbara » est son chant du cygne. Epuisée par les stimulants, les médicaments pris en dose massive pour soigner son angoisse ou les corticoïdes pour ses cordes vocales, affaiblie par une alimentation hasardeuse, elle consacre son temps à la rédaction de ses mémoires. Le 24 novembre 1997, elle est hospitalisée pour une pneumonie que les rumeurs transforment en mystère. Elle meurt à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine à l’âge de 67 ans, victime d’une infection respiratoire foudroyante. Elle disparaît juste après la sortie de « Femme Piano », regroupant ses plus belles chansons. Elle est enterrée trois jours plus tard au cimetière de Bagneux, entourée d’une foule d’amis et de fans. Allant totalement à l’encontre des modes de son temps, tant musicales que physiques, Barbara a pourtant su se faire sa place et s’imposer sur la scène de la chanson française. Toute son œuvre fut intimement liée à sa vie personnelle. Les mémoires posthumes de Barbara, « Il était un piano noir », révélèrent une déchirure d’enfance, un lourd secret à porter. Même si cela transpire tout au long de son œuvre, l’artiste ne pourra jamais l’aborder franchement sinon par des allusions très voilées, qui permettront à ses proches de sentir cette fêlure ineffaçable.
Barbara, née Monique Andrée Serf le 9 juin 1930 près du square des Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris et décédée le 24 novembre 1997 à Neuilly-sur-Seine. Elle est le deuxième enfant d’une famille qui en compte quatre. Elle a marqué la chanson française de sa musique poétique et passionnelle. Nombre de ses chansons sont devenues des classiques, notamment : « Dis, quand reviendras-tu ? », « Nantes », « Au bois de Saint-Amand », « Göttingen », « La solitude », « Une petite cantate », « La Dame brune », « L'Aigle noir », « Marienbad », « Ma plus belle histoire d’amour », « Pierre », « Le mal de vivre », « Vienne », « Drouot » ou encore « Si la photo est bonne ». Elle a joué dans trois films pour le cinéma « Aussi loin que l’amour » en 1971, « Franz » en 1972, « L’oiseau rare » en 1973 et dans deux pièces musicales sur scène : « Madame » en 1970, et « Lily passion » avec Gérard Depardieu en 1985. Depuis 2010, le « prix Barbara » récompense chaque année une jeune chanteuse francophone. Elle est la fille de Jacques Serf, un Juif alsacien, représentant de commerce en peaux et fourrures et d’Esther Brodsky, Juive née à Tiraspol (Moldavie), fonctionnaire à la préfecture de Paris. Monique Serf passe les premières années de sa vie dans ce coin des Batignolles, avec ses parents, sa grand-mère maternelle Hava Poustilnikov, née à Zlatopil (en Ukraine), et son frère aîné Jean, né en 1928. Sa jeunesse est marquée par des déménagements successifs, notamment en 1937, à Marseille, première étape d’un itinéraire sinueux, 1938, au 26, rue Mulsant à Roanne (Loire), où naît sa sœur Régine en août de la même année, en 1939, la famille quitte Roanne pour Le Vésinet dans la banlieue ouest de la capitale, où réside Jeanne Spire, la tante de Monsieur Serf. En septembre 1939 la guerre éclate et son père rejoint le front. Jeanne Spire, Jean et Monique rejoignent Poitiers, où un médecin les héberge. En 1940, sa mère travaille à la préfecture de Blois. Les deux aînés et leur grand-tante l’y rejoignent. Un bombardement de la ville s’annonce. Les deux enfants partent en train avec Jeanne Spire. Une attaque de l’aviation allemande vise le convoi en rase campagne. Les voyageurs resteront bloqués dans le train durant plusieurs jours. L’école communale de Préaux (Indre) accueille les réfugiés du train. Jeanne Spire loue deux chambres au-dessus du café Lanchais sur la place du village. Les deux enfants et Jeanne Spire resteront plus d’un an à Préaux. Ils s’intègrent à la vie du village, Monique et Jean vont à l’école communale. Fin 1941, par l’intermédiaire de la mairie de Préaux, leur grand-tante apprend que les parents résident à Tarbes, où Monsieur Serf est démobilisé. La famille se recompose immédiatement à Tarbes (Hautes-Pyrénées), au 3 bis, rue des Carmes. La tante Jeanne reste quelques mois avec eux. Claude, le jeune frère de Monique naît en mars 1942. Monique fréquente l’école communale. Mais la famille doit quitter rapidement Tarbes : un dénonciateur a informé la police qu’une famille juive vit rue des Carmes. Une menace de rafle dont les parents ont été informés. C'est la tante Jeanne qui avait été prévenue la veille du départ. Les déménagements redoublent sous l’Occupation pour fuir la traque nazie faite aux juifs. S’y ajoutent les séparations pour déjouer les dénonciations. De 1943 à octobre 1945, la famille se cache près de Chasseneuil-sur-Bonnieure en Charente, puis à Grenoble et à Saint-Marcellin en Isère. À la Libération, les membres de la famille quittent Saint-Marcellin pour Paris, d’abord au 131, rue Marcadet, puis dans un appartement rue Notre-Dame-de-Nazareth, puis dans un autre hôtel rue de Vaugirard, où ils se retrouvent tous. Barbara subira le comportement incestueux de son père pendant son enfance. Après Blois, Préaux, la voilà donc fin 1941 à Tarbes. Qui rêve spectacles, déguise ses voisins de la cour « et la petite fille de la propriétaire qui était rudement jolie et qui intéressait diablement mon frère Jean », se souvient-elle. Mais c'est un quotidien de cauchemar que vit la petite fille juive dans « une assez grande maison, 3 bis, rue des Carmes ». Son frère est premier en tout au lycée Théophile-Gautier. Elle est « très indisciplinée », « frondeuse », « désobéissante », disent ses livrets scolaires de la communale. Son père ne manque jamais une occasion de l'humilier. Sauf quand ils sont seuls tous les deux. Elle n'écrira jamais le mot. Mais « le soir, lorsque j'entends claquer le grand portail vert et les pas de mon père résonner dans la cour, je me prends à trembler ». Et les larmes lui viennent, confie-t-elle en révélant sans le dire l'inceste. Rappelant simplement « les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire ». C’est à Tarbes, alors qu'elle a à peine onze ans et demi, que son père abuse d'elle pour la première fois. "Un soir, à Tarbes, mon univers bascule dans l'horreur", écrit-elle. Personne ne dénonce l'inceste dans sa famille. Elle tente bien de s'adresser à une gendarmerie, au soir d'une fugue en Bretagne. On l'écoute mais sa plainte n'est pas enregistrée. Son père revient la chercher et laisse entendre qu'elle affabule. En 1949, alors qu'elle n'a que dix-neuf ans, le départ définitif du foyer familial de son père marque l'interruption de leurs rapports, mais elle n'en fait le récit que très tard, dans ses mémoires interrompus par sa mort en 1997, sans toutefois se décider à dire les mots de « viol » et d'« inceste ». « Tarbes a toujours été un souvenir très dur pour Barbara », confiera à la Dépêche du Midi, Marie Chaix, la secrétaire et biographe de la chanteuse Barbara. « Je ne chanterai pas à Tarbes », disait-elle. Plus tard, elle donnera un concert, finalement, mais à Ibos, au Parvis. C’est donc à Tarbes qu’elle vécut les pires moments de sa vie qui lui inspirèrent plus tard, la chanson « L’Aigle noir ». Beaucoup de personnes se sont interrogées sur le sens réel des paroles de « L'Aigle noir ». De son vivant, Barbara se dérobait à chaque fois, prétextant que cela ne concernait qu'elle : "Ce ne sont pas les paroles qui sont importantes...", disait-elle. Selon le chanteur Patrick Bruel, qui a repris le titre en 2015, ces paroles seraient une référence à l'emblème du Troisième Reich et à la vie d'errance et de danger durant l'enfance de la chanteuse. Le journaliste Pierre Adrian commente : "Après l'interprétation psychanalytique, voici l'interprétation historique". En 1946, la famille Self s’installe au Vésinet (Yvelines) à la pension des Trois Marroniers au 31 bis, rue Ernest-André, où la future Barbara prend ses premiers cours de chant chez Madame Madeleine Thomas-Dusséqué. À son contact, elle apprend le chant, le solfège et le piano, avant d'emménager au 50, rue de Vitruve dans le 20e arrondissement de Paris. Madame Dusséqué quitte le Vésinet pour Paris. Elle donne des cours salle Pleyel. Le 30 décembre 1946, sa grand-mère maternelle Hava Poustilnikov décède à Paris à son domicile 131, rue Marcadet, à l’âge de 66 ans. Cette femme comptait beaucoup pour Monique. Peu attirée par les études, elle ambitionne depuis longtemps de devenir pianiste mais son rêve est brisé depuis 1944, un kyste à la main droite ayant obligé les médecins de Grenoble à intervenir à sept reprises et sectionner les tendons. Ses parents promettent de lui offrir des cours de chant. Elle s’inscrit à ceux de Mme Dusséqué. Sa vie en est changée. Au bout de quelques leçons, sa professeure la présente à maître Paulet, enseignant au Conservatoire de Paris, qui la prend comme élève en 1947. Dans le nouvel appartement, un piano loué par son père est installé ; Monique en joue d’instinct, sans prendre de leçons. La jeune fille entre au Conservatoire comme auditrice, mais au répertoire de chant classique, qui l'ennuie, elle préfère celui de la chanson populaire, ayant rencontré à l'ABC l'univers de Piaf. Elle arrête les cours en 1948. La même année, après avoir passé une audition au théâtre Mogador, elle est engagée comme mannequin-choriste dans l’opérette « Violettes impériales ». Un jour de 1949, son père abandonne soudainement le foyer, pour ne plus revenir. Bientôt, la même année, la location du piano ne peut plus être honorée. Contrainte de s’en séparer, elle vit un déchirement. Voulant à tout prix concrétiser son rêve, devenir "pianiste chantante", elle quitte Paris en février 1950. Grâce à l’argent prêté par une amie, elle s’exile à Bruxelles chez un cousin, Sacha Piroutsky, qu’elle quitte au bout de deux mois car il devenait violent. Sans ressources ni connaissances, la vie est difficile. Au hasard d’une rencontre, elle rejoint une communauté d’artistes à Charleroi, qui se réunissent dans un local appelé La Mansarde. Là, elle trouve de l’aide et commence à chanter dans des cabarets sous le nom de Barbara Brodi (en l'honneur d'une de ses aïeules ukrainiennes appelée Varvara, ou de sa grand-mère Hava Brodsky). Son répertoire est constitué de chansons d’Édith Piaf, Marianne Oswald, Germaine Montero, Juliette Gréco. Chaque fois, le public la siffle copieusement. En 1950, elle rencontre Jacques Brel qui, comme elle, tente de percer en se produisant dans divers cabarets. Elle ajoute à son répertoire les premières chansons de cet auteur-compositeur en herbe avec qui elle va se lier d'une très grande amitié discrète mais indéfectible, pleine de complicité et d'admiration mutuelle. Plus tard, tandis que Barbara ne chante encore que des chansons écrites par d'autres, Brel l'encourage à écrire elle-même ses propres chansons ; il sera donc le premier à qui elle fera découvrir ses premiers textes, dont ses premiers succès. Brel dira « Barbara, c'est une fille bien. Elle a un grain, mais un beau grain. On est un peu amoureux, comme ça, depuis longtemps ». En 1971, il lui offrira un premier rôle dans son film Franz. À partir de 1981, soit trois ans après la mort de Brel, La Valse de Franz, composée par Brel, sera jouée dans tous les spectacles de Barbara, En 1990, elle créera au théâtre Mogador la chanson Gauguin (Lettre à Jacques Brel). Fin 1951, elle retourne vivre chez son oncle au 131, rue Marcadet à Paris pour des auditions sans lendemain, dont une au cabaret La Fontaine des Quatre-Saisons dont la programmation est déjà faite et où on lui propose une place de plongeuse pour un an. Elle peut toutefois y rencontrer et observer, sans jamais chanter, Boris Vian avec Henri Crolla et Louis Bessières ou encore Mouloudji. Elle revient à Bruxelles où un ami du groupe de Charleroi lui donne l’occasion de chanter. Elle est mise en relation avec Ethery Rouchadze, pianiste géorgienne qui accepte de l’accompagner et auprès de qui elle se perfectionnera au piano. Cette dernière lui présente Claude Sluys, jeune avocat. Habitué des lieux de spectacles, il se pique d’écrire quelques chansons. Fin 1952, il déniche le « théâtre du Cheval blanc » et use de ses relations pour y ouvrir un cabaret afin qu’elle s’y produise sous le nom de Barbara. Elle monte pour la première fois sur scène accompagnée de son piano, vêtue d’un châle noir et maquillée de khôl. Ainsi commence à se construire le personnage de la « dame en noir ». Le bouche à oreille aidant, le succès ne se fait pas attendre. Le 31 octobre 1953, Barbara épouse Claude Sluys. Au début de l’année 1955, elle enregistre deux chansons chez Decca : « Mon pote le gitan » et « L'œillet blanc » (parfois noté « L'œillet rouge »), diffusées en 78 tours et 45 tours. En 1955, les époux se séparent. À la fin de l'année, Barbara retourne à Paris où elle chante dans de petits cabarets : La Rose rouge en 1956, Chez Moineau en 1957, puis en 1958 à L’Écluse, où elle a déjà chanté pour de courts engagements. En 1958, elle réussit à s’imposer, sous le surnom de La Chanteuse de minuit, si bien que sa notoriété grandit et lui attire un public de fidèles, en particulier parmi les étudiants du Quartier latin. C’est sous le nom de « Barbara » qu’elle effectue son premier passage à la télévision, le 12 juillet 1958, sur l’unique chaîne de la RTF, dans l’émission Cabaret du Soir, où la présentatrice la compare à Yvette Guilbert et lui assure "qu’elle deviendra certainement une grande vedette". À cette époque, poussée par son ami Brel, elle commence à écrire. Remarquée et engagée par Pathé-Marconi, elle enregistre, sous le label « La Voix de son Maître », son premier Super 45 tours, « La Chanteuse de minuit », avec deux de ses propres chansons : « J’ai troqué » et « J’ai tué l’amour », et au printemps 1959 son premier 33 tours « Barbara à L’Écluse ». En décembre 1959, apprenant que son père, qui avait fui sur les routes pour noyer son crime dans le vagabondage et la déchéance, est mourant et la réclame auprès de lui à Nantes (Loire-Atlantique), elle s'y précipite, mais arrive trop tard. À la vue de son corps, à la morgue, ses sentiments oscillent entre fascination, panique, mépris, haine, d'une part, et un immense désespoir d'autre part. Au lendemain de l’enterrement, elle commence l’écriture de la chanson « Nantes », qu’elle achève quatre ans plus tard, quelques heures avant son passage au théâtre des Capucines, le 5 novembre 1963 ; ce sera l'une de ses plus grandes chansons. En 1960, elle change de maison de disque pour signer chez Odéon. Elle enregistre « Barbara chante Brassens » puis « Barbara chante Jacques Brel » : le premier de ces albums est couronné par l’Académie Charles-Cros dans la catégorie « Meilleure interprète ». En 1961, elle décroche un tour de chant du 9 au 20 février, en première partie de Félix Marten à Bobino. Sa performance est peu appréciée, sa présentation jugée austère, à l’évidence pas encore prête pour les grandes scènes. Loin de se décourager, elle reprend ses récitals à L’Écluse. La même année, elle se rend à Abidjan, où elle retrouve son amant, le diplomate Hubert Ballay ; elle lui écrira « Dis, quand reviendras-tu ? », avant de le quitter. Deux années plus tard, les mardis de novembre et décembre 1963, au théâtre des Capucines, elle retient et capte l’attention avec un répertoire nouveau comprenant deux de ses chansons : « Nantes » et « Dis, quand reviendras-tu ? ». Le succès est tel que la maison Philips va donner un véritable élan à sa carrière en lui signant un contrat. Séduit, Georges Brassens lui propose la première partie de son prochain spectacle à Bobino. En attendant, le 4 juillet 1964, elle se rend sans enthousiasme en Allemagne de l'Ouest, en réponse à l’invitation de Hans-Gunther Klein, directeur du Junges Theater de la ville universitaire de Göttingen. Agréablement surprise et touchée par l’accueil chaleureux qu’elle reçoit, elle prolonge son séjour d’une semaine. L'avant-veille de son départ, elle offre au public la chanson « Göttingen », qu’elle a écrite d’un trait dans les jardins du théâtre. En mai 1967, elle sera à Hambourg pour l’enregistrer, avec neuf autres titres, traduits en allemand, pour le 33 tours « Barbara singt Barbara », et retournera chanter à Göttingen le 4 octobre. Dans les années 1980, les hommes politiques se saisiront de la chanson pour promouvoir l'amitié franco-allemande. En 1988, Barbara recevra la Médaille d’honneur de Göttingen et l'ordre du Mérite fédéral. En 1992, à la veille d'un référendum, François Mitterrand choisira ce titre pour terminer un entretien télévisé. En 2002, Xavier Darcos, alors ministre délégué à l’enseignement scolaire, inscrira cette chanson aux programmes officiels des classes de l'école primaire : la chanson sera reprise dans les écoles en 2003 à l'occasion de la commémoration du quarantième anniversaire du traité d'amitié franco-allemand, dit traité de l'Élysée. Comme convenu, elle chante à Bobino avec Georges Brassens en « vedette » du 21 octobre au 9 novembre 1964. Le public est conquis et les critiques sont unanimes pour saluer sa prestation. Paris-presse, L’Intransigeant écrit qu’elle "fait presque oublier Brassens", L'Humanité : "Un faux pas de Brassens, une prouesse de Barbara." Le 14 mars 1965, sort son premier album Philips, « Barbara chante Barbara ». Il obtient le prix de l’Académie Charles-Cros et un réel succès commercial. Lors de la cérémonie, au palais d’Orsay, Barbara déchire son prix en quatre pour le distribuer aux techniciens, en témoignage de sa gratitude. La même année, elle obtient un grand succès à Bobino. Le 15 septembre, jour de la première, France Inter organise une journée Barbara sur ses ondes. La chanteuse est si profondément marquée par cette première qu’elle l'immortalise peu après dans l’une de ses plus grandes chansons : Ma plus belle histoire d’amour. « Ce fut, un soir, en septembre / Vous étiez venus m’attendre / Ici même, vous en souvenez-vous ? … ». En décembre 1966, Barbara se produit à nouveau à Bobino, où elle interprète notamment « Au cœur de la nuit » (titre que jamais plus elle n'inscrira à son tour de chant). Trois ans avant « L'Aigle noir », elle y évoque "un bruissement d'ailes qui effleure son visage", évoque la mort de son père et le pardon "pour qu'enfin tu puisses dormir, pour qu'enfin ton cœur repose, que tu finisses de mourir sous tes paupières déjà closes" (voir les albums Ma plus belle histoire d'amour, Bobino 1967). En 1967, elle écrit avec Georges Moustaki, « La Dame brune », chanson d'amour qu'ils interprètent en duo. Elle dira à son sujet : "Moustaki, c'est ma tendresse". Le 6 novembre 1967, alors en tournée en Italie, elle apprend la mort de sa mère. Elle a vécu au 14, rue de Rémusat de 1961 à 1967, date à laquelle elle quitte l'immeuble à la suite du décès de sa mère, ce qui lui inspire quelques années plus tard, en 1972, la chanson Rémusat, où elle évoque ce double départ. En février 1969, Barbara est à l’Olympia. À la fin de la dernière représentation, à la stupeur générale, elle annonce qu’elle arrête le tour de chant. Mais elle respecte ses engagements passés jusqu’en 1971. Toutefois, cet arrêt ne sera pas définitif. Elle a d'ailleurs déclaré qu'elle n'avait jamais fait d'adieux, mais qu'elle avait pris ses distances. La chanteuse reviendra sur les scènes du music-hall après trois ans d'absence. Début 1970, elle est au théâtre de la Renaissance dans « Madame », une pièce musicale, écrite par Rémo Forlani, dont elle signe la musique. Le rocking-chair du décor la suivra désormais dans tous ses tours de chant. Elle interprète une "tenancière de lupanar en Afrique". « Madame » est un échec, mais Barbara remet rapidement le pied à l’étrier grâce au succès de l’album studio L'Aigle noir, dont la chanson homonyme est l’un des plus gros succès discographiques de l’année. Barbara a dit de cette chanson qu'elle l'avait rêvée, "un rêve plus beau que la chanson elle-même". À la suite de la publication de ses mémoires en 1998, une interprétation bien plus sombre de « L'Aigle noir » fut supposée. En février 1972, Barbara est avec son ami Jacques Brel à l'affiche de « Franz ». Elle joue Léonie, femme laide, incapable de vivre l’amour dont elle rêve. Ce premier film réalisé par le chanteur obtient peu de succès. Deux ans plus tard, elle joue la diva délaissée du film « L'Oiseau rare », réalisé par Jean-Claude Brialy. Le danseur et chorégraphe Maurice Béjart, qui appréciait Barbara énormément, la fait tourner dans « Je suis né à Venise ». Dans ce film, qui ne sera diffusé qu’à la télévision, Barbara tient deux rôles : celui d'une chanteuse (elle interprète trois titres : L’Amour magicien, L’Homme en habit rouge et La Mort) et celui de La Dame de la nuit. Sa carrière musicale demeure active dans les années 1970 : à la télévision, en 1972, elle interprète un duo avec Johnny Hallyday, « Toi mon ombre, toi ma lumière ». Elle tourne au Japon, au Canada, en Belgique, en Israël, aux Pays-Bas et en Suisse. Barbara réalisera ses plus grands passages de sa carrière à la télévision pendant ses années ORTF, entre 1958 et 1974. En 1973, Barbara s'installe à Précy-sur-Marne, à trente kilomètres à l'est de Paris, dans une ancienne ferme villageoise au 2, rue de Verdun. Pour ses répétitions avant chaque spectacle, elle fait transformer la grange en théâtre, lui donnant le nom de « Grange au loup ». Dans le jardin enserré par les bâtiments de la ferme, elle découvre le plaisir de jardiner. Au petit matin du 5 juin 1974, les pompiers de Meaux découvrent son corps inanimé. Dans le coma, elle est conduite en urgence à l'hôpital. Plus tard, dans plusieurs entretiens, elle relate l'événement en expliquant que, n'arrivant pas à trouver le sommeil, elle a absorbé les cachets qu'elle avait sous la main. Lors d'un concert à Avignon, elle déclare : "Je n'ai pas voulu mourir, j'ai voulu dormir". Par décision, elle interrompt ses apparitions audiovisuelles en 1974. À partir de cette période, ses textes et ses choix musicaux évoluent en profondeur, et ses concerts de 1974, 1975 et 1978 accueillent de nouveaux titres importants. La chanson de 1974, « L’homme en habit rouge », évoque le souvenir de sa liaison avec son parolier de l’album La Louve, François Wertheimer, auquel Barbara avait offert le parfum Habit rouge de Guerlain. Pour cet album de 1973, Barbara demande à William Sheller de faire les orchestrations. De cette collaboration naît une amitié entre William et la Duchesse, comme celui-ci la surnomme affectueusement. C'est elle qui pousse alors William à devenir chanteur. Entre 1975 et 1976, elle a une aventure avec le comédien Pierre Arditi, de quatorze ans son cadet. Celui-ci se souvient d'avoir été comme "un adolescent énamouré" dans une liaison qu'il décrit comme "pas très longue mais marquante". Après leur séparation, ils sont restés très bons amis. En 1978, elle fait un retour remarqué à l'Olympia. Son album Seule est l’une des meilleures ventes de 1981. Son plus grand succès sur scène est celui qu’elle présente à l'automne de la même année à l’hippodrome de Pantin. Plus que de simples concerts, ses représentations sont, selon Jérôme Garcin, de véritables messes dont les rappels ininterrompus se prolongent jusque tard dans la nuit. Elle y interprète notamment « Regarde », chanson militante qu'elle a composée et chantée pour la campagne présidentielle de François Mitterrand, pour qui elle appela à voter, à partir du 8 avril 1981. C’est lors de ce spectacle que la voix de la chanteuse, pour la première fois, et irrémédiablement, se brise. Si au départ elle s'en affole, par la suite elle ne cherchera pas à le cacher mais saura au contraire se servir de cette voix, désormais "au crépuscule", pour renforcer l’aspect dramatique et authentique de son interprétation. Se renouvelant sans cesse, la chanteuse continue d’attirer un public très jeune. L’année suivante, elle reçoit le Grand prix national de la chanson en reconnaissance de sa contribution à la culture française. Par ailleurs, elle développe une relation de travail et d’amitié avec la vedette cinématographique montante Gérard Depardieu et son épouse Élisabeth. En 1985, elle coécrit avec Luc Plamondon la musique et le texte de la pièce Lily Passion, où elle joue et chante avec Gérard Depardieu. Sorte d’autobiographie romancée, c’est l’histoire d’une chanteuse qui voue toute sa vie à son public. La première représentation a lieu au Zénith de Paris, le 21 janvier 1986. L’été venu, elle est invitée sur la scène du Metropolitan Opera de New York pour un Gala Performance, donné le 8 juillet. Elle accompagne au piano son ami le danseur étoile Mikhaïl Barychnikov qui danse sur deux de ses chansons « Pierre » et « Le Mal de vivre ». À cette période, elle s'investit dans la collecte de fonds pour le traitement du Sida. Elle rend visite aux malades dans les hôpitaux et dans les prisons. Lors de ses concerts, elle met des corbeilles de préservatifs à la disposition des personnes venues l’écouter ; engagement dont témoigne artistiquement le titre « Sid’Amour à mort ». En 1987, elle monte pour la première fois sur la scène du théâtre du Châtelet, à Paris, pour une série de récitals pendant les mois de septembre et octobre, suivis d'une tournée en France, en Suisse, en Belgique, au Japon, au Canada et en Israël qui se termine en 1988. En 1988, elle est promue chevalier de la Légion d'honneur par le Président de la République François Mitterrand. L'année suivante, elle chante au théâtre Mogador à Paris de février à avril. Suivra une tournée en France et au Japon jusqu'en 1991. En 1991, elle enregistre « Lettres à un jeune poète » de Rainer Maria Rilke pour les Éditions Claudine Ducaté. Elle dédicacera cet enregistrement dans une librairie parisienne, la même année. En novembre et décembre 1993, Barbara est à nouveau sur la scène parisienne du théâtre du Châtelet, mais des problèmes de santé la contraignent à interrompre les représentations. Après quelques jours de repos, elle retrouve son public, le temps d’enregistrer le spectacle, puis renonce à poursuivre et annule les dernières représentations. En 1994, elle obtient la Victoire de l'artiste interprète féminine de l'année aux Victoires de la musique (une récompense qu'elle obtiendra une seconde fois en 1997). Son ultime tournée débute à Dijon, le 1er février. Sa dernière apparition sur scène a lieu le soir du samedi 26 mars 1994 au Centre de Congrès Vinci de la ville de Tours. Après seize années passées loin des studios, elle enregistre douze nouvelles chansons durant l'été 1996. Pour ce disque, Jean-Louis Aubert signe le texte « Vivant poème » et Guillaume Depardieu celui de « À force de ». Sorti le 6 novembre, cet album sobrement intitulé « Barbara » est son chant du cygne. Epuisée par les stimulants, les médicaments pris en dose massive pour soigner son angoisse ou les corticoïdes pour ses cordes vocales, affaiblie par une alimentation hasardeuse, elle consacre son temps à la rédaction de ses mémoires. Le 24 novembre 1997, elle est hospitalisée pour une pneumonie que les rumeurs transforment en mystère. Elle meurt à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine à l’âge de 67 ans, victime d’une infection respiratoire foudroyante. Elle disparaît juste après la sortie de « Femme Piano », regroupant ses plus belles chansons. Elle est enterrée trois jours plus tard au cimetière de Bagneux, entourée d’une foule d’amis et de fans. Allant totalement à l’encontre des modes de son temps, tant musicales que physiques, Barbara a pourtant su se faire sa place et s’imposer sur la scène de la chanson française. Toute son œuvre fut intimement liée à sa vie personnelle. Les mémoires posthumes de Barbara, « Il était un piano noir », révélèrent une déchirure d’enfance, un lourd secret à porter. Même si cela transpire tout au long de son œuvre, l’artiste ne pourra jamais l’aborder franchement sinon par des allusions très voilées, qui permettront à ses proches de sentir cette fêlure ineffaçable.BARÈRE Bertrand (1755-1841)
Avocat et homme politique de la Révolution française
 Bertrand BARÈRE, dit Bertrand Barère de Vieuzac, né le 10 septembre 1755 à Tarbes et mort le 13 janvier 1841, à l’âge de 85 ans. Il était le fils d’un procureur du roi qui avait été maire de Tarbes et président du Tiers État aux assemblées de Bigorre. Il fera son droit en 1770-1771 à l’université de Toulouse et le 8 juillet 1775 il prêtera son serment d’avocat. Par la suite, il deviendra mainteneur des Jeux floraux et rentrera à la loge maçonnique L’Encyclopédique de Toulouse. Avocat de profession, député du Tiers État aux États généraux en 1789, il deviendra un des hommes politiques les plus importants pendant la Convention nationale en 1793-1794. En 1775, il deviendra avocat au Parlement de Toulouse, puis conseiller de la sénéchaussée de Bigorre. En 1782, il ajoutera à son nom de famille le nom de Vieuzac, une très petite seigneurie (de Vieuzac-Argelès) lui appartenant. En avril 1789, il sera élu député aux États généraux. Il siègera alors parmi les députés appelés constitutionnels qui veulent une monarchie constitutionnelle et deux assemblées se partageant le pouvoir législatif (le bicaméralisme). Il créera Le Point du Jour, un journal qui rend compte des débats et des décrets de l’Assemblée constituante. Il fréquentera le club politique modéré des Feuillants et les milieux liés à la coterie du duc d’Orléans, cousin du roi. Il sera favorable à l’égalité des droits entre les blancs et les hommes libres de couleur à Haïti (colonie française). Pendant l’été 1792, il sera élu député des Hautes-Pyrénées à la Convention. Député du centre, il se rapprochera des députés montagnards. En décembre 1792, comme président de la Convention, il présidera le début du procès de Louis XVI. Son attitude convaincra les députés du centre (la Plaine) de soutenir les Montagnards. Il votera la mort du roi, sans appel ni sursis. En avril 1793, il sera le député le mieux élu au Comité de Salut public. Il sera réélu en juillet 1793. Il s’occupera des relations diplomatiques et de l’instruction. Grand travailleur, esprit clair, brillant orateur, il sera chargé des rapports quotidiens que le comité fait à la Convention. Il fera décréter que la « Terreur est à l’ordre du jour ». Il sera un adversaire des Hébertistes ou Exagérés. Cependant il traînera derrière lui son passé de modéré. Pour éviter les ennuis il doit se montrer ferme partisan des mesures extrêmes. En thermidor an II (juillet 1794), il ne soutiendra pas Robespierre quand celui-ci est accusé de dictature. Pendant la réaction thermidorienne, il sera exclu dès septembre 1794 du Comité de Salut public. Il sera arrêté en mars 1795. Pendant son procès il défendra l’œuvre collective accomplie par le gouvernement révolutionnaire afin de sauver la République. Il échappera de peu à la guillotine et sera condamné à la déportation à Cayenne en mars 1795, mais parviendra à rester en France. S’évadant de la prison de Saintes, il se cachera pendant cinq ans à Bordeaux. En 1797, il sera élu au Conseil des Cinq-Cents, mais son élection sera invalidée. Il sera amnistié après le coup d’État du 18 brumaire de Napoléon Bonaparte. Il sera alors subventionné pour rédiger des écrits favorables à Bonaparte comme des rapports périodiques sur l’état de l’opinion publique et il sera mis à contribution pour la rédaction d’un journal intitulé "Mémorial anti-britannique", qui paraissait tous les deux jours. Pendant les Cent-Jours, Napoléon Ier le nommera membre de la Chambre des représentants. Comme régicide lors de la seconde Restauration, il devra s’exiler en Belgique en 1816, et ne reviendra en France qu’après la Révolution de 1830. Pratiquement dépourvu de revenus, il vivra alors très modestement et s’en retournera en 1832 dans le département des Hautes-Pyrénées, qu’il avait contribué à créer. En 1833, il sera élu au Conseil général de Tarbes Sud où il s’occupera de questions d’éclairage public et de canalisations urbaines. De nouveau élu député des Hautes-Pyrénées en 1834, son élection sera une nouvelle fois annulée. Il démissionnera en 1840 du Conseil général des Hautes-Pyrénées et mourra un an après. À Tarbes il fit un rapport sur l’économie locale et, visionnaire, un autre sur l’urbanisme de la ville pour l’an 2000. Lors de la création des départements, il se battit pour que la Bigorre, de trop petite taille et menacée par les exigences du Béarn et de l’Armagnac, devienne le département des Hautes-Pyrénées, en prenant le complément de superficie aux alentours et pour que Tarbes en soit le chef-lieu. Tarbes lui dédia quand même une avenue face à la gare. L’« Anacréon de la guillotine », tel fut l’un des nombreux surnoms de Barère de Vieuzac. En 1994, la Société Académique remplaça la plaque posée sur sa maison natale en ne retenant pour l’histoire que « promoteur du département » et non l’« Anacréon de la guillotine ».
Bertrand BARÈRE, dit Bertrand Barère de Vieuzac, né le 10 septembre 1755 à Tarbes et mort le 13 janvier 1841, à l’âge de 85 ans. Il était le fils d’un procureur du roi qui avait été maire de Tarbes et président du Tiers État aux assemblées de Bigorre. Il fera son droit en 1770-1771 à l’université de Toulouse et le 8 juillet 1775 il prêtera son serment d’avocat. Par la suite, il deviendra mainteneur des Jeux floraux et rentrera à la loge maçonnique L’Encyclopédique de Toulouse. Avocat de profession, député du Tiers État aux États généraux en 1789, il deviendra un des hommes politiques les plus importants pendant la Convention nationale en 1793-1794. En 1775, il deviendra avocat au Parlement de Toulouse, puis conseiller de la sénéchaussée de Bigorre. En 1782, il ajoutera à son nom de famille le nom de Vieuzac, une très petite seigneurie (de Vieuzac-Argelès) lui appartenant. En avril 1789, il sera élu député aux États généraux. Il siègera alors parmi les députés appelés constitutionnels qui veulent une monarchie constitutionnelle et deux assemblées se partageant le pouvoir législatif (le bicaméralisme). Il créera Le Point du Jour, un journal qui rend compte des débats et des décrets de l’Assemblée constituante. Il fréquentera le club politique modéré des Feuillants et les milieux liés à la coterie du duc d’Orléans, cousin du roi. Il sera favorable à l’égalité des droits entre les blancs et les hommes libres de couleur à Haïti (colonie française). Pendant l’été 1792, il sera élu député des Hautes-Pyrénées à la Convention. Député du centre, il se rapprochera des députés montagnards. En décembre 1792, comme président de la Convention, il présidera le début du procès de Louis XVI. Son attitude convaincra les députés du centre (la Plaine) de soutenir les Montagnards. Il votera la mort du roi, sans appel ni sursis. En avril 1793, il sera le député le mieux élu au Comité de Salut public. Il sera réélu en juillet 1793. Il s’occupera des relations diplomatiques et de l’instruction. Grand travailleur, esprit clair, brillant orateur, il sera chargé des rapports quotidiens que le comité fait à la Convention. Il fera décréter que la « Terreur est à l’ordre du jour ». Il sera un adversaire des Hébertistes ou Exagérés. Cependant il traînera derrière lui son passé de modéré. Pour éviter les ennuis il doit se montrer ferme partisan des mesures extrêmes. En thermidor an II (juillet 1794), il ne soutiendra pas Robespierre quand celui-ci est accusé de dictature. Pendant la réaction thermidorienne, il sera exclu dès septembre 1794 du Comité de Salut public. Il sera arrêté en mars 1795. Pendant son procès il défendra l’œuvre collective accomplie par le gouvernement révolutionnaire afin de sauver la République. Il échappera de peu à la guillotine et sera condamné à la déportation à Cayenne en mars 1795, mais parviendra à rester en France. S’évadant de la prison de Saintes, il se cachera pendant cinq ans à Bordeaux. En 1797, il sera élu au Conseil des Cinq-Cents, mais son élection sera invalidée. Il sera amnistié après le coup d’État du 18 brumaire de Napoléon Bonaparte. Il sera alors subventionné pour rédiger des écrits favorables à Bonaparte comme des rapports périodiques sur l’état de l’opinion publique et il sera mis à contribution pour la rédaction d’un journal intitulé "Mémorial anti-britannique", qui paraissait tous les deux jours. Pendant les Cent-Jours, Napoléon Ier le nommera membre de la Chambre des représentants. Comme régicide lors de la seconde Restauration, il devra s’exiler en Belgique en 1816, et ne reviendra en France qu’après la Révolution de 1830. Pratiquement dépourvu de revenus, il vivra alors très modestement et s’en retournera en 1832 dans le département des Hautes-Pyrénées, qu’il avait contribué à créer. En 1833, il sera élu au Conseil général de Tarbes Sud où il s’occupera de questions d’éclairage public et de canalisations urbaines. De nouveau élu député des Hautes-Pyrénées en 1834, son élection sera une nouvelle fois annulée. Il démissionnera en 1840 du Conseil général des Hautes-Pyrénées et mourra un an après. À Tarbes il fit un rapport sur l’économie locale et, visionnaire, un autre sur l’urbanisme de la ville pour l’an 2000. Lors de la création des départements, il se battit pour que la Bigorre, de trop petite taille et menacée par les exigences du Béarn et de l’Armagnac, devienne le département des Hautes-Pyrénées, en prenant le complément de superficie aux alentours et pour que Tarbes en soit le chef-lieu. Tarbes lui dédia quand même une avenue face à la gare. L’« Anacréon de la guillotine », tel fut l’un des nombreux surnoms de Barère de Vieuzac. En 1994, la Société Académique remplaça la plaque posée sur sa maison natale en ne retenant pour l’histoire que « promoteur du département » et non l’« Anacréon de la guillotine ».
 Bertrand BARÈRE, dit Bertrand Barère de Vieuzac, né le 10 septembre 1755 à Tarbes et mort le 13 janvier 1841, à l’âge de 85 ans. Il était le fils d’un procureur du roi qui avait été maire de Tarbes et président du Tiers État aux assemblées de Bigorre. Il fera son droit en 1770-1771 à l’université de Toulouse et le 8 juillet 1775 il prêtera son serment d’avocat. Par la suite, il deviendra mainteneur des Jeux floraux et rentrera à la loge maçonnique L’Encyclopédique de Toulouse. Avocat de profession, député du Tiers État aux États généraux en 1789, il deviendra un des hommes politiques les plus importants pendant la Convention nationale en 1793-1794. En 1775, il deviendra avocat au Parlement de Toulouse, puis conseiller de la sénéchaussée de Bigorre. En 1782, il ajoutera à son nom de famille le nom de Vieuzac, une très petite seigneurie (de Vieuzac-Argelès) lui appartenant. En avril 1789, il sera élu député aux États généraux. Il siègera alors parmi les députés appelés constitutionnels qui veulent une monarchie constitutionnelle et deux assemblées se partageant le pouvoir législatif (le bicaméralisme). Il créera Le Point du Jour, un journal qui rend compte des débats et des décrets de l’Assemblée constituante. Il fréquentera le club politique modéré des Feuillants et les milieux liés à la coterie du duc d’Orléans, cousin du roi. Il sera favorable à l’égalité des droits entre les blancs et les hommes libres de couleur à Haïti (colonie française). Pendant l’été 1792, il sera élu député des Hautes-Pyrénées à la Convention. Député du centre, il se rapprochera des députés montagnards. En décembre 1792, comme président de la Convention, il présidera le début du procès de Louis XVI. Son attitude convaincra les députés du centre (la Plaine) de soutenir les Montagnards. Il votera la mort du roi, sans appel ni sursis. En avril 1793, il sera le député le mieux élu au Comité de Salut public. Il sera réélu en juillet 1793. Il s’occupera des relations diplomatiques et de l’instruction. Grand travailleur, esprit clair, brillant orateur, il sera chargé des rapports quotidiens que le comité fait à la Convention. Il fera décréter que la « Terreur est à l’ordre du jour ». Il sera un adversaire des Hébertistes ou Exagérés. Cependant il traînera derrière lui son passé de modéré. Pour éviter les ennuis il doit se montrer ferme partisan des mesures extrêmes. En thermidor an II (juillet 1794), il ne soutiendra pas Robespierre quand celui-ci est accusé de dictature. Pendant la réaction thermidorienne, il sera exclu dès septembre 1794 du Comité de Salut public. Il sera arrêté en mars 1795. Pendant son procès il défendra l’œuvre collective accomplie par le gouvernement révolutionnaire afin de sauver la République. Il échappera de peu à la guillotine et sera condamné à la déportation à Cayenne en mars 1795, mais parviendra à rester en France. S’évadant de la prison de Saintes, il se cachera pendant cinq ans à Bordeaux. En 1797, il sera élu au Conseil des Cinq-Cents, mais son élection sera invalidée. Il sera amnistié après le coup d’État du 18 brumaire de Napoléon Bonaparte. Il sera alors subventionné pour rédiger des écrits favorables à Bonaparte comme des rapports périodiques sur l’état de l’opinion publique et il sera mis à contribution pour la rédaction d’un journal intitulé "Mémorial anti-britannique", qui paraissait tous les deux jours. Pendant les Cent-Jours, Napoléon Ier le nommera membre de la Chambre des représentants. Comme régicide lors de la seconde Restauration, il devra s’exiler en Belgique en 1816, et ne reviendra en France qu’après la Révolution de 1830. Pratiquement dépourvu de revenus, il vivra alors très modestement et s’en retournera en 1832 dans le département des Hautes-Pyrénées, qu’il avait contribué à créer. En 1833, il sera élu au Conseil général de Tarbes Sud où il s’occupera de questions d’éclairage public et de canalisations urbaines. De nouveau élu député des Hautes-Pyrénées en 1834, son élection sera une nouvelle fois annulée. Il démissionnera en 1840 du Conseil général des Hautes-Pyrénées et mourra un an après. À Tarbes il fit un rapport sur l’économie locale et, visionnaire, un autre sur l’urbanisme de la ville pour l’an 2000. Lors de la création des départements, il se battit pour que la Bigorre, de trop petite taille et menacée par les exigences du Béarn et de l’Armagnac, devienne le département des Hautes-Pyrénées, en prenant le complément de superficie aux alentours et pour que Tarbes en soit le chef-lieu. Tarbes lui dédia quand même une avenue face à la gare. L’« Anacréon de la guillotine », tel fut l’un des nombreux surnoms de Barère de Vieuzac. En 1994, la Société Académique remplaça la plaque posée sur sa maison natale en ne retenant pour l’histoire que « promoteur du département » et non l’« Anacréon de la guillotine ».
Bertrand BARÈRE, dit Bertrand Barère de Vieuzac, né le 10 septembre 1755 à Tarbes et mort le 13 janvier 1841, à l’âge de 85 ans. Il était le fils d’un procureur du roi qui avait été maire de Tarbes et président du Tiers État aux assemblées de Bigorre. Il fera son droit en 1770-1771 à l’université de Toulouse et le 8 juillet 1775 il prêtera son serment d’avocat. Par la suite, il deviendra mainteneur des Jeux floraux et rentrera à la loge maçonnique L’Encyclopédique de Toulouse. Avocat de profession, député du Tiers État aux États généraux en 1789, il deviendra un des hommes politiques les plus importants pendant la Convention nationale en 1793-1794. En 1775, il deviendra avocat au Parlement de Toulouse, puis conseiller de la sénéchaussée de Bigorre. En 1782, il ajoutera à son nom de famille le nom de Vieuzac, une très petite seigneurie (de Vieuzac-Argelès) lui appartenant. En avril 1789, il sera élu député aux États généraux. Il siègera alors parmi les députés appelés constitutionnels qui veulent une monarchie constitutionnelle et deux assemblées se partageant le pouvoir législatif (le bicaméralisme). Il créera Le Point du Jour, un journal qui rend compte des débats et des décrets de l’Assemblée constituante. Il fréquentera le club politique modéré des Feuillants et les milieux liés à la coterie du duc d’Orléans, cousin du roi. Il sera favorable à l’égalité des droits entre les blancs et les hommes libres de couleur à Haïti (colonie française). Pendant l’été 1792, il sera élu député des Hautes-Pyrénées à la Convention. Député du centre, il se rapprochera des députés montagnards. En décembre 1792, comme président de la Convention, il présidera le début du procès de Louis XVI. Son attitude convaincra les députés du centre (la Plaine) de soutenir les Montagnards. Il votera la mort du roi, sans appel ni sursis. En avril 1793, il sera le député le mieux élu au Comité de Salut public. Il sera réélu en juillet 1793. Il s’occupera des relations diplomatiques et de l’instruction. Grand travailleur, esprit clair, brillant orateur, il sera chargé des rapports quotidiens que le comité fait à la Convention. Il fera décréter que la « Terreur est à l’ordre du jour ». Il sera un adversaire des Hébertistes ou Exagérés. Cependant il traînera derrière lui son passé de modéré. Pour éviter les ennuis il doit se montrer ferme partisan des mesures extrêmes. En thermidor an II (juillet 1794), il ne soutiendra pas Robespierre quand celui-ci est accusé de dictature. Pendant la réaction thermidorienne, il sera exclu dès septembre 1794 du Comité de Salut public. Il sera arrêté en mars 1795. Pendant son procès il défendra l’œuvre collective accomplie par le gouvernement révolutionnaire afin de sauver la République. Il échappera de peu à la guillotine et sera condamné à la déportation à Cayenne en mars 1795, mais parviendra à rester en France. S’évadant de la prison de Saintes, il se cachera pendant cinq ans à Bordeaux. En 1797, il sera élu au Conseil des Cinq-Cents, mais son élection sera invalidée. Il sera amnistié après le coup d’État du 18 brumaire de Napoléon Bonaparte. Il sera alors subventionné pour rédiger des écrits favorables à Bonaparte comme des rapports périodiques sur l’état de l’opinion publique et il sera mis à contribution pour la rédaction d’un journal intitulé "Mémorial anti-britannique", qui paraissait tous les deux jours. Pendant les Cent-Jours, Napoléon Ier le nommera membre de la Chambre des représentants. Comme régicide lors de la seconde Restauration, il devra s’exiler en Belgique en 1816, et ne reviendra en France qu’après la Révolution de 1830. Pratiquement dépourvu de revenus, il vivra alors très modestement et s’en retournera en 1832 dans le département des Hautes-Pyrénées, qu’il avait contribué à créer. En 1833, il sera élu au Conseil général de Tarbes Sud où il s’occupera de questions d’éclairage public et de canalisations urbaines. De nouveau élu député des Hautes-Pyrénées en 1834, son élection sera une nouvelle fois annulée. Il démissionnera en 1840 du Conseil général des Hautes-Pyrénées et mourra un an après. À Tarbes il fit un rapport sur l’économie locale et, visionnaire, un autre sur l’urbanisme de la ville pour l’an 2000. Lors de la création des départements, il se battit pour que la Bigorre, de trop petite taille et menacée par les exigences du Béarn et de l’Armagnac, devienne le département des Hautes-Pyrénées, en prenant le complément de superficie aux alentours et pour que Tarbes en soit le chef-lieu. Tarbes lui dédia quand même une avenue face à la gare. L’« Anacréon de la guillotine », tel fut l’un des nombreux surnoms de Barère de Vieuzac. En 1994, la Société Académique remplaça la plaque posée sur sa maison natale en ne retenant pour l’histoire que « promoteur du département » et non l’« Anacréon de la guillotine ».BARTHE Jean (1932-2017)
Capitaine du XV de France puis du XIII de France
 Jean BARTHE, surnommé « Jeanjean », né le 22 juillet 1932 à Lourdes et mort le 2 décembre 2017 à Villemoustaussou, à l’âge de 85 ans. Il était un athlète (1,90 m, 90kg) comme jamais le XV de France n’en avait connu avant lui. Initié au rugby dans la cour de récréation de l’école primaire, il devint rapidement le premier choix des sélectionneurs à l’aile de la troisième-ligne sous l’ère Jean Prat (1954-1955), puis aux côtés de Lucien Mias (1958-1959), avant d’être nommé capitaine à son tour et de porter le brassard en 1959, face à l’Angleterre à Twickenham, pour un partage des points (3-3). Mais il n’était pas fait pour commander : servir les autres lui convenait parfaitement. 22 fois sélectionné dans l’équipe de France à XIII, avec laquelle il disputa la Coupe du monde en 1960, il reste aujourd’hui encore le seul joueur à avoir été capitaine de la sélection nationale dans les deux codes. Nous sommes dans les années cinquante. Celles du grand Lourdes de Jean Prat, avec lequel il fut champion de France en 1956, 1957 et 1958, enlevant trois Brennus avec les quinzistes lourdais. Rapide, inépuisable, solide à l’impact, à la fois rude défenseur et parfait soutien offensif à l’intérieur de ses trois-quarts, il fut le parfait pendant de « Monsieur Rugby ». En 1959, à 27 ans, en pleine gloire et après seulement 26 sélections en équipe de France, il signera des contrats lucratifs chez les treizistes (Roanne, Saint-Gaudens, Carcassonne), histoire de faire fructifier son renom. Il sera champion de France avec Roanne en 1960, puis avec l’AS Carcassonne en 1966 et 1967. Il remporta aussi la coupe de France : une fois avec Roanne (1962) et deux fois avec l’AS Carcassonne (1967, 1968). Il est considéré, avec Max Rousié, Puig-Aubert et Jean Galia, comme l’un des grands transfuges français du XV au XIII. Sa force herculéenne et sa gueule d’archange, qu’il avait plaisir à se faire cabosser irradiaient tous les terrains. Altruiste, toujours au service du collectif, infatigable quelle que soit la tâche à accomplir, il ne rechignait pas aussi à monter en deuxième-ligne, « dans la cage », pour dépanner et souffrir en silence. A XIII, il passera même pilier. Plus le match était rugueux plus il élevait son niveau de jeu. Ainsi fut-il brave entre tous à Pretoria, en 1958, contre le Northern Transvaal, lors de la tournée du XV de France en Afrique du Sud. « Dans un enfer de violence », reconnaîtra-t-il. Lors de cette tournée historique en Afrique du Sud, un fait d’armes est resté à la postérité. Alors que le XV de France a décroché un match nul méritoire face aux Springboks au Cap (3-3) et qu’il mène (5-9) à quelques minutes de la fin du second match, l’ailier sud-africain John Prinsloo fonce, décalé, vers l’en-but français. Au bout de sa course l’essai promis. Il va sceller la défaite tricolore. Mais surgissant de nulle part, Jeanjean plaque Prinsloo et le sort en touche. L’action est immortalisée par un tableau, dans la salle de réception de l’Ellis Park de Johannesbourg, théâtre de l’exploit français : remporter pour la première fois de son histoire une série de tests en Afrique du Sud ! Sur la fin de sa carrière, c’est à Carcassonne que Jean Barthe et son épouse décideront de s’établir. Il avait longtemps tenu, avec son épouse Denise, le bar « Le Rugby », boulevard de Varsovie à Carcassonne. Son palmarès : champion de France en 1949 ; champion de France senior deuxième série avec Biscarosse, où il débuta ; finaliste du championnat de France en 1955 ; triple champion de France avec Lourdes en 1956, 1957 et 1958 et détenteur du Challenge Yves du Manoir en 1956 ; vingt-six fois international sous le maillot bleu, il est considéré entre 1953 et 1968 comme l’un des meilleurs 3e ligne au monde. Il fut capitaine du XIII de France pendant la Coupe du monde disputée en Angleterre en 1960, soldée par trois échecs : Grande-Bretagne (33-7), Nouvelle-Zélande (9-0), Australie (13-12). Une vie bien remplie pour ce champion, qui restera une figure légendaire à XV et à XIII. Il a fini sa carrière à Saint-Jacques XIII, équipe avec laquelle il remporta en 1972, un ultime titre de champion de France de Nationale 2. Le stade de Villemoustaussou (Aude) porte son nom depuis 2009.
Jean BARTHE, surnommé « Jeanjean », né le 22 juillet 1932 à Lourdes et mort le 2 décembre 2017 à Villemoustaussou, à l’âge de 85 ans. Il était un athlète (1,90 m, 90kg) comme jamais le XV de France n’en avait connu avant lui. Initié au rugby dans la cour de récréation de l’école primaire, il devint rapidement le premier choix des sélectionneurs à l’aile de la troisième-ligne sous l’ère Jean Prat (1954-1955), puis aux côtés de Lucien Mias (1958-1959), avant d’être nommé capitaine à son tour et de porter le brassard en 1959, face à l’Angleterre à Twickenham, pour un partage des points (3-3). Mais il n’était pas fait pour commander : servir les autres lui convenait parfaitement. 22 fois sélectionné dans l’équipe de France à XIII, avec laquelle il disputa la Coupe du monde en 1960, il reste aujourd’hui encore le seul joueur à avoir été capitaine de la sélection nationale dans les deux codes. Nous sommes dans les années cinquante. Celles du grand Lourdes de Jean Prat, avec lequel il fut champion de France en 1956, 1957 et 1958, enlevant trois Brennus avec les quinzistes lourdais. Rapide, inépuisable, solide à l’impact, à la fois rude défenseur et parfait soutien offensif à l’intérieur de ses trois-quarts, il fut le parfait pendant de « Monsieur Rugby ». En 1959, à 27 ans, en pleine gloire et après seulement 26 sélections en équipe de France, il signera des contrats lucratifs chez les treizistes (Roanne, Saint-Gaudens, Carcassonne), histoire de faire fructifier son renom. Il sera champion de France avec Roanne en 1960, puis avec l’AS Carcassonne en 1966 et 1967. Il remporta aussi la coupe de France : une fois avec Roanne (1962) et deux fois avec l’AS Carcassonne (1967, 1968). Il est considéré, avec Max Rousié, Puig-Aubert et Jean Galia, comme l’un des grands transfuges français du XV au XIII. Sa force herculéenne et sa gueule d’archange, qu’il avait plaisir à se faire cabosser irradiaient tous les terrains. Altruiste, toujours au service du collectif, infatigable quelle que soit la tâche à accomplir, il ne rechignait pas aussi à monter en deuxième-ligne, « dans la cage », pour dépanner et souffrir en silence. A XIII, il passera même pilier. Plus le match était rugueux plus il élevait son niveau de jeu. Ainsi fut-il brave entre tous à Pretoria, en 1958, contre le Northern Transvaal, lors de la tournée du XV de France en Afrique du Sud. « Dans un enfer de violence », reconnaîtra-t-il. Lors de cette tournée historique en Afrique du Sud, un fait d’armes est resté à la postérité. Alors que le XV de France a décroché un match nul méritoire face aux Springboks au Cap (3-3) et qu’il mène (5-9) à quelques minutes de la fin du second match, l’ailier sud-africain John Prinsloo fonce, décalé, vers l’en-but français. Au bout de sa course l’essai promis. Il va sceller la défaite tricolore. Mais surgissant de nulle part, Jeanjean plaque Prinsloo et le sort en touche. L’action est immortalisée par un tableau, dans la salle de réception de l’Ellis Park de Johannesbourg, théâtre de l’exploit français : remporter pour la première fois de son histoire une série de tests en Afrique du Sud ! Sur la fin de sa carrière, c’est à Carcassonne que Jean Barthe et son épouse décideront de s’établir. Il avait longtemps tenu, avec son épouse Denise, le bar « Le Rugby », boulevard de Varsovie à Carcassonne. Son palmarès : champion de France en 1949 ; champion de France senior deuxième série avec Biscarosse, où il débuta ; finaliste du championnat de France en 1955 ; triple champion de France avec Lourdes en 1956, 1957 et 1958 et détenteur du Challenge Yves du Manoir en 1956 ; vingt-six fois international sous le maillot bleu, il est considéré entre 1953 et 1968 comme l’un des meilleurs 3e ligne au monde. Il fut capitaine du XIII de France pendant la Coupe du monde disputée en Angleterre en 1960, soldée par trois échecs : Grande-Bretagne (33-7), Nouvelle-Zélande (9-0), Australie (13-12). Une vie bien remplie pour ce champion, qui restera une figure légendaire à XV et à XIII. Il a fini sa carrière à Saint-Jacques XIII, équipe avec laquelle il remporta en 1972, un ultime titre de champion de France de Nationale 2. Le stade de Villemoustaussou (Aude) porte son nom depuis 2009.
 Jean BARTHE, surnommé « Jeanjean », né le 22 juillet 1932 à Lourdes et mort le 2 décembre 2017 à Villemoustaussou, à l’âge de 85 ans. Il était un athlète (1,90 m, 90kg) comme jamais le XV de France n’en avait connu avant lui. Initié au rugby dans la cour de récréation de l’école primaire, il devint rapidement le premier choix des sélectionneurs à l’aile de la troisième-ligne sous l’ère Jean Prat (1954-1955), puis aux côtés de Lucien Mias (1958-1959), avant d’être nommé capitaine à son tour et de porter le brassard en 1959, face à l’Angleterre à Twickenham, pour un partage des points (3-3). Mais il n’était pas fait pour commander : servir les autres lui convenait parfaitement. 22 fois sélectionné dans l’équipe de France à XIII, avec laquelle il disputa la Coupe du monde en 1960, il reste aujourd’hui encore le seul joueur à avoir été capitaine de la sélection nationale dans les deux codes. Nous sommes dans les années cinquante. Celles du grand Lourdes de Jean Prat, avec lequel il fut champion de France en 1956, 1957 et 1958, enlevant trois Brennus avec les quinzistes lourdais. Rapide, inépuisable, solide à l’impact, à la fois rude défenseur et parfait soutien offensif à l’intérieur de ses trois-quarts, il fut le parfait pendant de « Monsieur Rugby ». En 1959, à 27 ans, en pleine gloire et après seulement 26 sélections en équipe de France, il signera des contrats lucratifs chez les treizistes (Roanne, Saint-Gaudens, Carcassonne), histoire de faire fructifier son renom. Il sera champion de France avec Roanne en 1960, puis avec l’AS Carcassonne en 1966 et 1967. Il remporta aussi la coupe de France : une fois avec Roanne (1962) et deux fois avec l’AS Carcassonne (1967, 1968). Il est considéré, avec Max Rousié, Puig-Aubert et Jean Galia, comme l’un des grands transfuges français du XV au XIII. Sa force herculéenne et sa gueule d’archange, qu’il avait plaisir à se faire cabosser irradiaient tous les terrains. Altruiste, toujours au service du collectif, infatigable quelle que soit la tâche à accomplir, il ne rechignait pas aussi à monter en deuxième-ligne, « dans la cage », pour dépanner et souffrir en silence. A XIII, il passera même pilier. Plus le match était rugueux plus il élevait son niveau de jeu. Ainsi fut-il brave entre tous à Pretoria, en 1958, contre le Northern Transvaal, lors de la tournée du XV de France en Afrique du Sud. « Dans un enfer de violence », reconnaîtra-t-il. Lors de cette tournée historique en Afrique du Sud, un fait d’armes est resté à la postérité. Alors que le XV de France a décroché un match nul méritoire face aux Springboks au Cap (3-3) et qu’il mène (5-9) à quelques minutes de la fin du second match, l’ailier sud-africain John Prinsloo fonce, décalé, vers l’en-but français. Au bout de sa course l’essai promis. Il va sceller la défaite tricolore. Mais surgissant de nulle part, Jeanjean plaque Prinsloo et le sort en touche. L’action est immortalisée par un tableau, dans la salle de réception de l’Ellis Park de Johannesbourg, théâtre de l’exploit français : remporter pour la première fois de son histoire une série de tests en Afrique du Sud ! Sur la fin de sa carrière, c’est à Carcassonne que Jean Barthe et son épouse décideront de s’établir. Il avait longtemps tenu, avec son épouse Denise, le bar « Le Rugby », boulevard de Varsovie à Carcassonne. Son palmarès : champion de France en 1949 ; champion de France senior deuxième série avec Biscarosse, où il débuta ; finaliste du championnat de France en 1955 ; triple champion de France avec Lourdes en 1956, 1957 et 1958 et détenteur du Challenge Yves du Manoir en 1956 ; vingt-six fois international sous le maillot bleu, il est considéré entre 1953 et 1968 comme l’un des meilleurs 3e ligne au monde. Il fut capitaine du XIII de France pendant la Coupe du monde disputée en Angleterre en 1960, soldée par trois échecs : Grande-Bretagne (33-7), Nouvelle-Zélande (9-0), Australie (13-12). Une vie bien remplie pour ce champion, qui restera une figure légendaire à XV et à XIII. Il a fini sa carrière à Saint-Jacques XIII, équipe avec laquelle il remporta en 1972, un ultime titre de champion de France de Nationale 2. Le stade de Villemoustaussou (Aude) porte son nom depuis 2009.
Jean BARTHE, surnommé « Jeanjean », né le 22 juillet 1932 à Lourdes et mort le 2 décembre 2017 à Villemoustaussou, à l’âge de 85 ans. Il était un athlète (1,90 m, 90kg) comme jamais le XV de France n’en avait connu avant lui. Initié au rugby dans la cour de récréation de l’école primaire, il devint rapidement le premier choix des sélectionneurs à l’aile de la troisième-ligne sous l’ère Jean Prat (1954-1955), puis aux côtés de Lucien Mias (1958-1959), avant d’être nommé capitaine à son tour et de porter le brassard en 1959, face à l’Angleterre à Twickenham, pour un partage des points (3-3). Mais il n’était pas fait pour commander : servir les autres lui convenait parfaitement. 22 fois sélectionné dans l’équipe de France à XIII, avec laquelle il disputa la Coupe du monde en 1960, il reste aujourd’hui encore le seul joueur à avoir été capitaine de la sélection nationale dans les deux codes. Nous sommes dans les années cinquante. Celles du grand Lourdes de Jean Prat, avec lequel il fut champion de France en 1956, 1957 et 1958, enlevant trois Brennus avec les quinzistes lourdais. Rapide, inépuisable, solide à l’impact, à la fois rude défenseur et parfait soutien offensif à l’intérieur de ses trois-quarts, il fut le parfait pendant de « Monsieur Rugby ». En 1959, à 27 ans, en pleine gloire et après seulement 26 sélections en équipe de France, il signera des contrats lucratifs chez les treizistes (Roanne, Saint-Gaudens, Carcassonne), histoire de faire fructifier son renom. Il sera champion de France avec Roanne en 1960, puis avec l’AS Carcassonne en 1966 et 1967. Il remporta aussi la coupe de France : une fois avec Roanne (1962) et deux fois avec l’AS Carcassonne (1967, 1968). Il est considéré, avec Max Rousié, Puig-Aubert et Jean Galia, comme l’un des grands transfuges français du XV au XIII. Sa force herculéenne et sa gueule d’archange, qu’il avait plaisir à se faire cabosser irradiaient tous les terrains. Altruiste, toujours au service du collectif, infatigable quelle que soit la tâche à accomplir, il ne rechignait pas aussi à monter en deuxième-ligne, « dans la cage », pour dépanner et souffrir en silence. A XIII, il passera même pilier. Plus le match était rugueux plus il élevait son niveau de jeu. Ainsi fut-il brave entre tous à Pretoria, en 1958, contre le Northern Transvaal, lors de la tournée du XV de France en Afrique du Sud. « Dans un enfer de violence », reconnaîtra-t-il. Lors de cette tournée historique en Afrique du Sud, un fait d’armes est resté à la postérité. Alors que le XV de France a décroché un match nul méritoire face aux Springboks au Cap (3-3) et qu’il mène (5-9) à quelques minutes de la fin du second match, l’ailier sud-africain John Prinsloo fonce, décalé, vers l’en-but français. Au bout de sa course l’essai promis. Il va sceller la défaite tricolore. Mais surgissant de nulle part, Jeanjean plaque Prinsloo et le sort en touche. L’action est immortalisée par un tableau, dans la salle de réception de l’Ellis Park de Johannesbourg, théâtre de l’exploit français : remporter pour la première fois de son histoire une série de tests en Afrique du Sud ! Sur la fin de sa carrière, c’est à Carcassonne que Jean Barthe et son épouse décideront de s’établir. Il avait longtemps tenu, avec son épouse Denise, le bar « Le Rugby », boulevard de Varsovie à Carcassonne. Son palmarès : champion de France en 1949 ; champion de France senior deuxième série avec Biscarosse, où il débuta ; finaliste du championnat de France en 1955 ; triple champion de France avec Lourdes en 1956, 1957 et 1958 et détenteur du Challenge Yves du Manoir en 1956 ; vingt-six fois international sous le maillot bleu, il est considéré entre 1953 et 1968 comme l’un des meilleurs 3e ligne au monde. Il fut capitaine du XIII de France pendant la Coupe du monde disputée en Angleterre en 1960, soldée par trois échecs : Grande-Bretagne (33-7), Nouvelle-Zélande (9-0), Australie (13-12). Une vie bien remplie pour ce champion, qui restera une figure légendaire à XV et à XIII. Il a fini sa carrière à Saint-Jacques XIII, équipe avec laquelle il remporta en 1972, un ultime titre de champion de France de Nationale 2. Le stade de Villemoustaussou (Aude) porte son nom depuis 2009.BILLERES René (1910-2004)
Homme politique - sénateur et député - ministre de l'Éducation nationale
 René BILLERES, né le 29 août 1910 à Ger et décédé le 2 octobre 2004 à Lourdes, à l’âge de 94 ans. Il est le fils de Charles Billères, commis-greffier et de Jeanne Davant, institutrice. Il s’est marié en 1937 avec Marie-Laure Saintourens et eurent une fille, qu'ils appelèrent Françoise. Orphelin de père à l’âge de 12 ans, il ira à l’école primaire à Ger, puis poursuit ses études au lycée de Tarbes, où il est boursier et interne. En 1927, il obtient le deuxième prix de version grecque au Concours général. Il fait une hypokhâgne au lycée de Toulouse en 1929-1930, puis une khâgne au lycée Lakanal à Sceaux, et en 1931, il entre à l’École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Condisciple de Georges Pompidou et de Jacques Soustelle à l’École normale supérieure, il est agrégé de lettres classiques en 1934, puis en 1935, il entame à Mont-de-Marsan et poursuit à Tarbes, une carrière de professeur de lettres que la Libération va interrompre pour le lancer dans l’arène politique sous les couleurs valoisiennes. En 1936, il est candidat aux élections législatives. En 1939, il est mobilisé, blessé et fait prisonnier. Il reste cinq ans dans un camp, à Lübben en Allemagne jusqu’en avril 1945. Député radical-socialiste de la première circonscription des Hautes-Pyrénées à la deuxième Assemblée nationale constituante, puis à l'Assemblée nationale de 1946 à 1973, il préside la Commission de l'Éducation nationale de 1948 à 1954. Il devient ensuite ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports dans plusieurs gouvernements successifs. La suppression des devoirs à domicile fut décidée pendant cette période ainsi que la prolongation de la scolarité obligatoire et la réforme de l'enseignement public qui comporte la revalorisation de l'enseignement technique. Pendant ces années, les moyens de l'Éducation nationale ont augmenté de 50 %. Billères vote l'investiture du général de Gaulle en 1958. En qualité de président du Parti radical-socialiste de 1965 à 1969, il contribue à l'Union de la gauche (première candidature de François Mitterrand à la présidence en 1965, puis fondation de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste). Dans le contre-gouvernement fictif élaboré en 1966 par François Mitterrand, René Billères est présenté comme pouvant être ministre de l'Éducation nationale d'un gouvernement de gauche. Radical de gauche, il est élu au Sénat en 1974 et y siégea jusqu'en 1983 dans le groupe de la Gauche démocratique. Il sera membre de la commission des affaires culturelles et membre de la Formation des sénateurs radicaux de Gauche rattachée administrativement au groupe de la Gauche démocratique. Il est à l’origine de la création en 1956 d’un lycée mixte de plein air à vocation climatique (accueil de jeunes souffrant de problèmes respiratoires ou d’affections asthmatiques) à Argelès-Gazost, sous-préfecture des Hautes-Pyrénées, où il posséda une résidence. En 2006, le lycée climatique fut rebaptisé en son honneur lycée climatique René-Billères (date du cinquantenaire). Ses fonctions gouvernementales seront successivement : secrétaire d'État à la Présidence du Conseil, chargé des relations avec les Assemblées et de la Fonction publique du gouvernement Pierre Mendès France (du 12 novembre 1954 au 23 février 1955) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Guy Mollet (du 1er février au 22 juin 1956) ; ministre d'État de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Guy Mollet (du 22 juin 1956 au 13 juin 1957) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Maurice Bourgès-Maunoury (du 13 juin au 6 novembre 1957) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Félix Gaillard (du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958). Ses mandats locaux seront successivement : député des Hautes-Pyrénées - Radical et radical-socialiste (1946, 1946-1951, 1951-1955, 1956-1958) ; député de la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées (1958-1962, 1962-1967, 1967-1968, 1968-1973) ; sénateur des Hautes-Pyrénées (1974-1983). René Billères était commandeur des Palmes académiques, des Arts et lettres et du Mérite sportif, Croix de guerre 1939-1945, et chevalier de la Légion d'honneur. Il fut un catholique pratiquant et, en politique, un laïque fervent, avec une morale rigoureuse, une intelligence claire et une extrême sensibilité. Ses partenaires de la Fédération de la Gauche vantent sa loyauté, sa lucidité et son courage. Parmi les autres mesures novatrices à son actif dans l’enseignement, on notera celle de la suppression de l’examen d’entrée en 6ème et la création d’un examen spécial d’entrée en Faculté pour les non-bacheliers, qui sont toujours en vigueur. Il aura semé des idées qui ont germé, lancé des formules qui ont été reprises et mises en œuvre par ses successeurs comme Alain Peyrefitte, ministre de l'Éducation nationale (1967-1968). Il sera candidat malheureux en 1961 à la présidence du Parti radical contre Maurice Faure. Quarante ans de vie militante, plus de vingt ans de mandat parlementaire et de responsabilités. Cependant il ne sera jamais un notable local, ni maire, ni conseiller général. En 1959, il échoue à conquérir la mairie de Tarbes, et en 1967, à récupérer le siège de conseiller général de Lannemezan, après la mort du docteur Baratgin. Le 14 mai 1983, il annonce son retrait définitif de la politique, et abandonne en septembre suivant son siège de sénateur à François Abadie. A compter de sa retraite, il ne livre que de rares témoignages sur sa longue carrière politique, et s'éteint le 2 octobre 2004. Il a été inhumé dans le cimetière de son village natal de Ger.
René BILLERES, né le 29 août 1910 à Ger et décédé le 2 octobre 2004 à Lourdes, à l’âge de 94 ans. Il est le fils de Charles Billères, commis-greffier et de Jeanne Davant, institutrice. Il s’est marié en 1937 avec Marie-Laure Saintourens et eurent une fille, qu'ils appelèrent Françoise. Orphelin de père à l’âge de 12 ans, il ira à l’école primaire à Ger, puis poursuit ses études au lycée de Tarbes, où il est boursier et interne. En 1927, il obtient le deuxième prix de version grecque au Concours général. Il fait une hypokhâgne au lycée de Toulouse en 1929-1930, puis une khâgne au lycée Lakanal à Sceaux, et en 1931, il entre à l’École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Condisciple de Georges Pompidou et de Jacques Soustelle à l’École normale supérieure, il est agrégé de lettres classiques en 1934, puis en 1935, il entame à Mont-de-Marsan et poursuit à Tarbes, une carrière de professeur de lettres que la Libération va interrompre pour le lancer dans l’arène politique sous les couleurs valoisiennes. En 1936, il est candidat aux élections législatives. En 1939, il est mobilisé, blessé et fait prisonnier. Il reste cinq ans dans un camp, à Lübben en Allemagne jusqu’en avril 1945. Député radical-socialiste de la première circonscription des Hautes-Pyrénées à la deuxième Assemblée nationale constituante, puis à l'Assemblée nationale de 1946 à 1973, il préside la Commission de l'Éducation nationale de 1948 à 1954. Il devient ensuite ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports dans plusieurs gouvernements successifs. La suppression des devoirs à domicile fut décidée pendant cette période ainsi que la prolongation de la scolarité obligatoire et la réforme de l'enseignement public qui comporte la revalorisation de l'enseignement technique. Pendant ces années, les moyens de l'Éducation nationale ont augmenté de 50 %. Billères vote l'investiture du général de Gaulle en 1958. En qualité de président du Parti radical-socialiste de 1965 à 1969, il contribue à l'Union de la gauche (première candidature de François Mitterrand à la présidence en 1965, puis fondation de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste). Dans le contre-gouvernement fictif élaboré en 1966 par François Mitterrand, René Billères est présenté comme pouvant être ministre de l'Éducation nationale d'un gouvernement de gauche. Radical de gauche, il est élu au Sénat en 1974 et y siégea jusqu'en 1983 dans le groupe de la Gauche démocratique. Il sera membre de la commission des affaires culturelles et membre de la Formation des sénateurs radicaux de Gauche rattachée administrativement au groupe de la Gauche démocratique. Il est à l’origine de la création en 1956 d’un lycée mixte de plein air à vocation climatique (accueil de jeunes souffrant de problèmes respiratoires ou d’affections asthmatiques) à Argelès-Gazost, sous-préfecture des Hautes-Pyrénées, où il posséda une résidence. En 2006, le lycée climatique fut rebaptisé en son honneur lycée climatique René-Billères (date du cinquantenaire). Ses fonctions gouvernementales seront successivement : secrétaire d'État à la Présidence du Conseil, chargé des relations avec les Assemblées et de la Fonction publique du gouvernement Pierre Mendès France (du 12 novembre 1954 au 23 février 1955) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Guy Mollet (du 1er février au 22 juin 1956) ; ministre d'État de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Guy Mollet (du 22 juin 1956 au 13 juin 1957) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Maurice Bourgès-Maunoury (du 13 juin au 6 novembre 1957) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Félix Gaillard (du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958). Ses mandats locaux seront successivement : député des Hautes-Pyrénées - Radical et radical-socialiste (1946, 1946-1951, 1951-1955, 1956-1958) ; député de la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées (1958-1962, 1962-1967, 1967-1968, 1968-1973) ; sénateur des Hautes-Pyrénées (1974-1983). René Billères était commandeur des Palmes académiques, des Arts et lettres et du Mérite sportif, Croix de guerre 1939-1945, et chevalier de la Légion d'honneur. Il fut un catholique pratiquant et, en politique, un laïque fervent, avec une morale rigoureuse, une intelligence claire et une extrême sensibilité. Ses partenaires de la Fédération de la Gauche vantent sa loyauté, sa lucidité et son courage. Parmi les autres mesures novatrices à son actif dans l’enseignement, on notera celle de la suppression de l’examen d’entrée en 6ème et la création d’un examen spécial d’entrée en Faculté pour les non-bacheliers, qui sont toujours en vigueur. Il aura semé des idées qui ont germé, lancé des formules qui ont été reprises et mises en œuvre par ses successeurs comme Alain Peyrefitte, ministre de l'Éducation nationale (1967-1968). Il sera candidat malheureux en 1961 à la présidence du Parti radical contre Maurice Faure. Quarante ans de vie militante, plus de vingt ans de mandat parlementaire et de responsabilités. Cependant il ne sera jamais un notable local, ni maire, ni conseiller général. En 1959, il échoue à conquérir la mairie de Tarbes, et en 1967, à récupérer le siège de conseiller général de Lannemezan, après la mort du docteur Baratgin. Le 14 mai 1983, il annonce son retrait définitif de la politique, et abandonne en septembre suivant son siège de sénateur à François Abadie. A compter de sa retraite, il ne livre que de rares témoignages sur sa longue carrière politique, et s'éteint le 2 octobre 2004. Il a été inhumé dans le cimetière de son village natal de Ger.
 René BILLERES, né le 29 août 1910 à Ger et décédé le 2 octobre 2004 à Lourdes, à l’âge de 94 ans. Il est le fils de Charles Billères, commis-greffier et de Jeanne Davant, institutrice. Il s’est marié en 1937 avec Marie-Laure Saintourens et eurent une fille, qu'ils appelèrent Françoise. Orphelin de père à l’âge de 12 ans, il ira à l’école primaire à Ger, puis poursuit ses études au lycée de Tarbes, où il est boursier et interne. En 1927, il obtient le deuxième prix de version grecque au Concours général. Il fait une hypokhâgne au lycée de Toulouse en 1929-1930, puis une khâgne au lycée Lakanal à Sceaux, et en 1931, il entre à l’École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Condisciple de Georges Pompidou et de Jacques Soustelle à l’École normale supérieure, il est agrégé de lettres classiques en 1934, puis en 1935, il entame à Mont-de-Marsan et poursuit à Tarbes, une carrière de professeur de lettres que la Libération va interrompre pour le lancer dans l’arène politique sous les couleurs valoisiennes. En 1936, il est candidat aux élections législatives. En 1939, il est mobilisé, blessé et fait prisonnier. Il reste cinq ans dans un camp, à Lübben en Allemagne jusqu’en avril 1945. Député radical-socialiste de la première circonscription des Hautes-Pyrénées à la deuxième Assemblée nationale constituante, puis à l'Assemblée nationale de 1946 à 1973, il préside la Commission de l'Éducation nationale de 1948 à 1954. Il devient ensuite ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports dans plusieurs gouvernements successifs. La suppression des devoirs à domicile fut décidée pendant cette période ainsi que la prolongation de la scolarité obligatoire et la réforme de l'enseignement public qui comporte la revalorisation de l'enseignement technique. Pendant ces années, les moyens de l'Éducation nationale ont augmenté de 50 %. Billères vote l'investiture du général de Gaulle en 1958. En qualité de président du Parti radical-socialiste de 1965 à 1969, il contribue à l'Union de la gauche (première candidature de François Mitterrand à la présidence en 1965, puis fondation de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste). Dans le contre-gouvernement fictif élaboré en 1966 par François Mitterrand, René Billères est présenté comme pouvant être ministre de l'Éducation nationale d'un gouvernement de gauche. Radical de gauche, il est élu au Sénat en 1974 et y siégea jusqu'en 1983 dans le groupe de la Gauche démocratique. Il sera membre de la commission des affaires culturelles et membre de la Formation des sénateurs radicaux de Gauche rattachée administrativement au groupe de la Gauche démocratique. Il est à l’origine de la création en 1956 d’un lycée mixte de plein air à vocation climatique (accueil de jeunes souffrant de problèmes respiratoires ou d’affections asthmatiques) à Argelès-Gazost, sous-préfecture des Hautes-Pyrénées, où il posséda une résidence. En 2006, le lycée climatique fut rebaptisé en son honneur lycée climatique René-Billères (date du cinquantenaire). Ses fonctions gouvernementales seront successivement : secrétaire d'État à la Présidence du Conseil, chargé des relations avec les Assemblées et de la Fonction publique du gouvernement Pierre Mendès France (du 12 novembre 1954 au 23 février 1955) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Guy Mollet (du 1er février au 22 juin 1956) ; ministre d'État de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Guy Mollet (du 22 juin 1956 au 13 juin 1957) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Maurice Bourgès-Maunoury (du 13 juin au 6 novembre 1957) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Félix Gaillard (du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958). Ses mandats locaux seront successivement : député des Hautes-Pyrénées - Radical et radical-socialiste (1946, 1946-1951, 1951-1955, 1956-1958) ; député de la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées (1958-1962, 1962-1967, 1967-1968, 1968-1973) ; sénateur des Hautes-Pyrénées (1974-1983). René Billères était commandeur des Palmes académiques, des Arts et lettres et du Mérite sportif, Croix de guerre 1939-1945, et chevalier de la Légion d'honneur. Il fut un catholique pratiquant et, en politique, un laïque fervent, avec une morale rigoureuse, une intelligence claire et une extrême sensibilité. Ses partenaires de la Fédération de la Gauche vantent sa loyauté, sa lucidité et son courage. Parmi les autres mesures novatrices à son actif dans l’enseignement, on notera celle de la suppression de l’examen d’entrée en 6ème et la création d’un examen spécial d’entrée en Faculté pour les non-bacheliers, qui sont toujours en vigueur. Il aura semé des idées qui ont germé, lancé des formules qui ont été reprises et mises en œuvre par ses successeurs comme Alain Peyrefitte, ministre de l'Éducation nationale (1967-1968). Il sera candidat malheureux en 1961 à la présidence du Parti radical contre Maurice Faure. Quarante ans de vie militante, plus de vingt ans de mandat parlementaire et de responsabilités. Cependant il ne sera jamais un notable local, ni maire, ni conseiller général. En 1959, il échoue à conquérir la mairie de Tarbes, et en 1967, à récupérer le siège de conseiller général de Lannemezan, après la mort du docteur Baratgin. Le 14 mai 1983, il annonce son retrait définitif de la politique, et abandonne en septembre suivant son siège de sénateur à François Abadie. A compter de sa retraite, il ne livre que de rares témoignages sur sa longue carrière politique, et s'éteint le 2 octobre 2004. Il a été inhumé dans le cimetière de son village natal de Ger.
René BILLERES, né le 29 août 1910 à Ger et décédé le 2 octobre 2004 à Lourdes, à l’âge de 94 ans. Il est le fils de Charles Billères, commis-greffier et de Jeanne Davant, institutrice. Il s’est marié en 1937 avec Marie-Laure Saintourens et eurent une fille, qu'ils appelèrent Françoise. Orphelin de père à l’âge de 12 ans, il ira à l’école primaire à Ger, puis poursuit ses études au lycée de Tarbes, où il est boursier et interne. En 1927, il obtient le deuxième prix de version grecque au Concours général. Il fait une hypokhâgne au lycée de Toulouse en 1929-1930, puis une khâgne au lycée Lakanal à Sceaux, et en 1931, il entre à l’École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Condisciple de Georges Pompidou et de Jacques Soustelle à l’École normale supérieure, il est agrégé de lettres classiques en 1934, puis en 1935, il entame à Mont-de-Marsan et poursuit à Tarbes, une carrière de professeur de lettres que la Libération va interrompre pour le lancer dans l’arène politique sous les couleurs valoisiennes. En 1936, il est candidat aux élections législatives. En 1939, il est mobilisé, blessé et fait prisonnier. Il reste cinq ans dans un camp, à Lübben en Allemagne jusqu’en avril 1945. Député radical-socialiste de la première circonscription des Hautes-Pyrénées à la deuxième Assemblée nationale constituante, puis à l'Assemblée nationale de 1946 à 1973, il préside la Commission de l'Éducation nationale de 1948 à 1954. Il devient ensuite ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports dans plusieurs gouvernements successifs. La suppression des devoirs à domicile fut décidée pendant cette période ainsi que la prolongation de la scolarité obligatoire et la réforme de l'enseignement public qui comporte la revalorisation de l'enseignement technique. Pendant ces années, les moyens de l'Éducation nationale ont augmenté de 50 %. Billères vote l'investiture du général de Gaulle en 1958. En qualité de président du Parti radical-socialiste de 1965 à 1969, il contribue à l'Union de la gauche (première candidature de François Mitterrand à la présidence en 1965, puis fondation de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste). Dans le contre-gouvernement fictif élaboré en 1966 par François Mitterrand, René Billères est présenté comme pouvant être ministre de l'Éducation nationale d'un gouvernement de gauche. Radical de gauche, il est élu au Sénat en 1974 et y siégea jusqu'en 1983 dans le groupe de la Gauche démocratique. Il sera membre de la commission des affaires culturelles et membre de la Formation des sénateurs radicaux de Gauche rattachée administrativement au groupe de la Gauche démocratique. Il est à l’origine de la création en 1956 d’un lycée mixte de plein air à vocation climatique (accueil de jeunes souffrant de problèmes respiratoires ou d’affections asthmatiques) à Argelès-Gazost, sous-préfecture des Hautes-Pyrénées, où il posséda une résidence. En 2006, le lycée climatique fut rebaptisé en son honneur lycée climatique René-Billères (date du cinquantenaire). Ses fonctions gouvernementales seront successivement : secrétaire d'État à la Présidence du Conseil, chargé des relations avec les Assemblées et de la Fonction publique du gouvernement Pierre Mendès France (du 12 novembre 1954 au 23 février 1955) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Guy Mollet (du 1er février au 22 juin 1956) ; ministre d'État de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Guy Mollet (du 22 juin 1956 au 13 juin 1957) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Maurice Bourgès-Maunoury (du 13 juin au 6 novembre 1957) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Félix Gaillard (du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958). Ses mandats locaux seront successivement : député des Hautes-Pyrénées - Radical et radical-socialiste (1946, 1946-1951, 1951-1955, 1956-1958) ; député de la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées (1958-1962, 1962-1967, 1967-1968, 1968-1973) ; sénateur des Hautes-Pyrénées (1974-1983). René Billères était commandeur des Palmes académiques, des Arts et lettres et du Mérite sportif, Croix de guerre 1939-1945, et chevalier de la Légion d'honneur. Il fut un catholique pratiquant et, en politique, un laïque fervent, avec une morale rigoureuse, une intelligence claire et une extrême sensibilité. Ses partenaires de la Fédération de la Gauche vantent sa loyauté, sa lucidité et son courage. Parmi les autres mesures novatrices à son actif dans l’enseignement, on notera celle de la suppression de l’examen d’entrée en 6ème et la création d’un examen spécial d’entrée en Faculté pour les non-bacheliers, qui sont toujours en vigueur. Il aura semé des idées qui ont germé, lancé des formules qui ont été reprises et mises en œuvre par ses successeurs comme Alain Peyrefitte, ministre de l'Éducation nationale (1967-1968). Il sera candidat malheureux en 1961 à la présidence du Parti radical contre Maurice Faure. Quarante ans de vie militante, plus de vingt ans de mandat parlementaire et de responsabilités. Cependant il ne sera jamais un notable local, ni maire, ni conseiller général. En 1959, il échoue à conquérir la mairie de Tarbes, et en 1967, à récupérer le siège de conseiller général de Lannemezan, après la mort du docteur Baratgin. Le 14 mai 1983, il annonce son retrait définitif de la politique, et abandonne en septembre suivant son siège de sénateur à François Abadie. A compter de sa retraite, il ne livre que de rares témoignages sur sa longue carrière politique, et s'éteint le 2 octobre 2004. Il a été inhumé dans le cimetière de son village natal de Ger.BLANC Christian (1942-XXXX)
Homme politique, chef d’entreprise, préfet des Hautes-Pyrénées
 Christian BLANC, né le 17 mai 1942 à Talence en Gironde, est un haut fonctionnaire, chef d'entreprise et homme politique français. Il effectue ses études à Bordeaux, au lycée Montesquieu, puis intègre l'Institut d'études politiques (IAE) de Bordeaux. Il est préfet des Hautes-Pyrénées en 1983 et préfet de Seine-et-Marne en 1985, puis il est l’artisan en 1988 de la mission du dialogue en Nouvelle-Calédonie, qui se conclut par les accords de Matignon. Il a travaillé dans le monde de l'entreprise, dirigeant la RATP de 1989 à 1992, Air France de 1993 à 1997, qu'il sauve de la faillite et la banque Merrill Lynch France de 2000 à 2002. Il fut également administrateur de Middle East Airlines (1998-1999), de Carrefour, de Capgemini (2004), de la Chancellerie des Universités de Paris (1998-2001), d'Action contre la faim (ACF) et président du Comité de sélection pour le recrutement d'inspecteurs des finances au tour extérieur (2000). Proche de Michel Rocard, et d'Edgard Pisani, il fonda en 2001 le think tank "l’Ami public " et en 2002, le mouvement politique Énergies démocrates (2002-2007). En 2002, il est élu député apparenté UDF de la 3e circonscription des Yvelines. Il rejoint le groupe parlementaire Nouveau Centre de 2002 à 2008. Réélu député en 2007, celui que l'on a surnommé « l'homme des missions impossibles » entre au gouvernement le 18 mars 2008 comme secrétaire d’État chargé du Développement de la région capitale, et travaille sur le Grand Paris. À la demande de Nicolas Sarkozy et François Fillon, il annonce sa démission du gouvernement le 4 juillet 2010. Après deux mandats de député, il ne se représente pas une troisième fois. En septembre 2014, la compagnie aérienne tunisienne Syphax Airlines recrute Christian Blanc au poste de PDG, dont il démissionne deux mois plus tard. En 2015, il publie aux Éditions Odile Jacob "Paris Ville monde", un livre dans lequel il explique sa stratégie pour permettre à la France de retrouver sa place dans l'économie mondiale. Présent au World Trade Center de New York le 11 septembre 2001, il échappa aux attentats, car il était sorti fumer un cigare hors du bâtiment.
Christian BLANC, né le 17 mai 1942 à Talence en Gironde, est un haut fonctionnaire, chef d'entreprise et homme politique français. Il effectue ses études à Bordeaux, au lycée Montesquieu, puis intègre l'Institut d'études politiques (IAE) de Bordeaux. Il est préfet des Hautes-Pyrénées en 1983 et préfet de Seine-et-Marne en 1985, puis il est l’artisan en 1988 de la mission du dialogue en Nouvelle-Calédonie, qui se conclut par les accords de Matignon. Il a travaillé dans le monde de l'entreprise, dirigeant la RATP de 1989 à 1992, Air France de 1993 à 1997, qu'il sauve de la faillite et la banque Merrill Lynch France de 2000 à 2002. Il fut également administrateur de Middle East Airlines (1998-1999), de Carrefour, de Capgemini (2004), de la Chancellerie des Universités de Paris (1998-2001), d'Action contre la faim (ACF) et président du Comité de sélection pour le recrutement d'inspecteurs des finances au tour extérieur (2000). Proche de Michel Rocard, et d'Edgard Pisani, il fonda en 2001 le think tank "l’Ami public " et en 2002, le mouvement politique Énergies démocrates (2002-2007). En 2002, il est élu député apparenté UDF de la 3e circonscription des Yvelines. Il rejoint le groupe parlementaire Nouveau Centre de 2002 à 2008. Réélu député en 2007, celui que l'on a surnommé « l'homme des missions impossibles » entre au gouvernement le 18 mars 2008 comme secrétaire d’État chargé du Développement de la région capitale, et travaille sur le Grand Paris. À la demande de Nicolas Sarkozy et François Fillon, il annonce sa démission du gouvernement le 4 juillet 2010. Après deux mandats de député, il ne se représente pas une troisième fois. En septembre 2014, la compagnie aérienne tunisienne Syphax Airlines recrute Christian Blanc au poste de PDG, dont il démissionne deux mois plus tard. En 2015, il publie aux Éditions Odile Jacob "Paris Ville monde", un livre dans lequel il explique sa stratégie pour permettre à la France de retrouver sa place dans l'économie mondiale. Présent au World Trade Center de New York le 11 septembre 2001, il échappa aux attentats, car il était sorti fumer un cigare hors du bâtiment.
 Christian BLANC, né le 17 mai 1942 à Talence en Gironde, est un haut fonctionnaire, chef d'entreprise et homme politique français. Il effectue ses études à Bordeaux, au lycée Montesquieu, puis intègre l'Institut d'études politiques (IAE) de Bordeaux. Il est préfet des Hautes-Pyrénées en 1983 et préfet de Seine-et-Marne en 1985, puis il est l’artisan en 1988 de la mission du dialogue en Nouvelle-Calédonie, qui se conclut par les accords de Matignon. Il a travaillé dans le monde de l'entreprise, dirigeant la RATP de 1989 à 1992, Air France de 1993 à 1997, qu'il sauve de la faillite et la banque Merrill Lynch France de 2000 à 2002. Il fut également administrateur de Middle East Airlines (1998-1999), de Carrefour, de Capgemini (2004), de la Chancellerie des Universités de Paris (1998-2001), d'Action contre la faim (ACF) et président du Comité de sélection pour le recrutement d'inspecteurs des finances au tour extérieur (2000). Proche de Michel Rocard, et d'Edgard Pisani, il fonda en 2001 le think tank "l’Ami public " et en 2002, le mouvement politique Énergies démocrates (2002-2007). En 2002, il est élu député apparenté UDF de la 3e circonscription des Yvelines. Il rejoint le groupe parlementaire Nouveau Centre de 2002 à 2008. Réélu député en 2007, celui que l'on a surnommé « l'homme des missions impossibles » entre au gouvernement le 18 mars 2008 comme secrétaire d’État chargé du Développement de la région capitale, et travaille sur le Grand Paris. À la demande de Nicolas Sarkozy et François Fillon, il annonce sa démission du gouvernement le 4 juillet 2010. Après deux mandats de député, il ne se représente pas une troisième fois. En septembre 2014, la compagnie aérienne tunisienne Syphax Airlines recrute Christian Blanc au poste de PDG, dont il démissionne deux mois plus tard. En 2015, il publie aux Éditions Odile Jacob "Paris Ville monde", un livre dans lequel il explique sa stratégie pour permettre à la France de retrouver sa place dans l'économie mondiale. Présent au World Trade Center de New York le 11 septembre 2001, il échappa aux attentats, car il était sorti fumer un cigare hors du bâtiment.
Christian BLANC, né le 17 mai 1942 à Talence en Gironde, est un haut fonctionnaire, chef d'entreprise et homme politique français. Il effectue ses études à Bordeaux, au lycée Montesquieu, puis intègre l'Institut d'études politiques (IAE) de Bordeaux. Il est préfet des Hautes-Pyrénées en 1983 et préfet de Seine-et-Marne en 1985, puis il est l’artisan en 1988 de la mission du dialogue en Nouvelle-Calédonie, qui se conclut par les accords de Matignon. Il a travaillé dans le monde de l'entreprise, dirigeant la RATP de 1989 à 1992, Air France de 1993 à 1997, qu'il sauve de la faillite et la banque Merrill Lynch France de 2000 à 2002. Il fut également administrateur de Middle East Airlines (1998-1999), de Carrefour, de Capgemini (2004), de la Chancellerie des Universités de Paris (1998-2001), d'Action contre la faim (ACF) et président du Comité de sélection pour le recrutement d'inspecteurs des finances au tour extérieur (2000). Proche de Michel Rocard, et d'Edgard Pisani, il fonda en 2001 le think tank "l’Ami public " et en 2002, le mouvement politique Énergies démocrates (2002-2007). En 2002, il est élu député apparenté UDF de la 3e circonscription des Yvelines. Il rejoint le groupe parlementaire Nouveau Centre de 2002 à 2008. Réélu député en 2007, celui que l'on a surnommé « l'homme des missions impossibles » entre au gouvernement le 18 mars 2008 comme secrétaire d’État chargé du Développement de la région capitale, et travaille sur le Grand Paris. À la demande de Nicolas Sarkozy et François Fillon, il annonce sa démission du gouvernement le 4 juillet 2010. Après deux mandats de député, il ne se représente pas une troisième fois. En septembre 2014, la compagnie aérienne tunisienne Syphax Airlines recrute Christian Blanc au poste de PDG, dont il démissionne deux mois plus tard. En 2015, il publie aux Éditions Odile Jacob "Paris Ville monde", un livre dans lequel il explique sa stratégie pour permettre à la France de retrouver sa place dans l'économie mondiale. Présent au World Trade Center de New York le 11 septembre 2001, il échappa aux attentats, car il était sorti fumer un cigare hors du bâtiment.BLÉRIOT Louis (1872-1936)
Ingénieur, inventeur, constructeur d’avions et avant tout premier aviateur à avoir traversé la Manche en aéroplane le 25 juillet 1909 à bord du Blériot XI, Bigourdan par alliance
 Louis Charles Joseph BLÉRIOT, né le 1er juillet 1872 à Cambrai et mort subitement le 1er août 1936 à Paris, à l’âge de 64 ans, est un constructeur de lanternes d’automobiles, d’avions, de motocyclettes et de chars à voile, et un pilote précurseur et pionnier de l’aviation française. À ses débuts, comme ingénieur diplômé de l’École Centrale des Arts et Manufactures (promotion 1895), il entre chez Baguès, une société d’ingénierie électrique à Paris, puis effectue son service militaire dans l’artillerie à Tarbes au 24e régiment d’artillerie comme sous-lieutenant puis lieutenant de réserve au 36e régiment d’artillerie. Les Établissements Louis Blériot, qu’il a créés en 1903, connaissent un succès certain dans la fabrication de phares à acétylène pour l’industrie automobile alors en pleine expansion. On lui doit l’appellation « phare » pour les éclairages de voitures. Et après avoir fait fortune dans les phares pour automobiles, entre 1905 et 1909, il se lance dans la grande aventure aéronautique et produit une série de 11 prototypes : le Blériot I, le Blériot II, le Blériot III … jusqu’au Blériot XI, qui est celui de la traversée de la Manche. Après plusieurs années de recherches et pas mal de casse, il est parvenu à réaliser un aéroplane léger, solide et fiable. Le Blériot XI est un appareil monoplan à fuselage partiellement entoilé, long de 8 mètres, avec une envergure de 7,20 mètres et qui pèse 310 kilogrammes. Son hélice Chauvière bipale est entraînée par un moteur Anzani à trois cylindres en étoile développant 25ch. Répondant au défi lancé en 1908 par le Daily Mail (journal britannique), Blériot se lance dans l’aventure de la première traversée de la Manche, Et voilà comment, le 25 juillet 1909, Louis Blériot et Hubert Latham, deux pionniers français de l’aviation, se retrouvent au petit matin, prêts à partir de Calais pour une course aérienne France-Angleterre. Et c’est Latham qui paraît avoir les meilleures chances de remporter le pactole de 1000 livres du Daily Mail. Mais, Hubert Latham, son concurrent direct, est victime d’une panne, et c’est Blériot qui gagne (suite à des problèmes techniques, Latham ne réussira à décoller que le 27 juillet avant d’échouer à 500 mètres du but). C’est à Pau que Louis Blériot s’est préparé à ce grand exploit et après un dernier vol d’essai de 11 minutes effectué à 4h15 du matin au-dessus des Baraques, le 25 juillet 1909, le temps semble idéal, Le vent est tombé durant la nuit, et à 4h41 du matin, Louis Blériot s’envole pour l’Angleterre. Très vite, à 4h48, il dépasse le contre-torpilleur accompagnateur Escopette, où son épouse se trouve à bord, guettant son mari dans les airs avec ses jumelles, et 37 minutes après et 35 kilomètres de vol, la Manche est traversée. Ce qui donne une vitesse moyenne d’environ 57 km/h à une altitude de vol de 100 mètres. Ainsi, ce 25 juillet 1909, Louis Blériot est le premier à traverser la Manche par les airs, en décollant au lever du soleil, condition exigée par le Daily Mail, qui est à l’origine du défi et qui lui remettra la somme de 25.000 Francs-or mise en jeu. Malgré une blessure au pied, et ne sachant pas nager, il effectue la traversée, ralliant le lieu-dit Les Baraques près de Calais à Douvres en Angleterre, aux commandes du Blériot XI qu’il a conçu en collaboration avec Raymond Saulnier. La visibilité étant moyenne au départ, il s’oriente sans boussole en s’aidant de la trajectoire des bateaux reliant la France et la Grande-Bretagne, avant de pouvoir distinguer les falaises près de Douvres. La puissance de son moteur lui permet à peine de monter plus haut que ces dernières. Après un virage vers l’est, il revient à l’ouest pour finalement trouver le champ et atterrir sur les côtes anglaises, où l’attend le journaliste français Charles Fontaine muni d’un grand drapeau tricolore qu’il agite, et son photographe Marcel Marmier. À 5h12, après un virage, c’est chose faite : Blériot coupe le moteur sur le sol anglais. En une trentaine de minutes, la traversée a été réalisée mais fidèle à son habitude, Louis Blériot endommage le train de son appareil à l’atterrissage et une pale de l’hélice a été brisée, mais Blériot est sorti indemne. Désormais l’Angleterre n’est plus une île ! La Manche venait d’être vaincue par un plus lourd que l’air. La capitale britannique salue l’exploit de Louis Blériot, devenu mondialement célèbre, avant son retour en France. Un vol qui fera sa gloire, abondamment relayé par la presse de l’époque. Les jours qui suivent ne seront qu’honneurs, réceptions et fêtes. L’événement a un retentissement mondial. Pour Blériot, c’était la consécration mais aussi le soulagement car depuis quelques années, il avait dépensé la quasi-totalité de sa fortune pour concevoir et construire une dizaine de prototypes aux destins plus ou moins heureux. Cette réussite va le propulser et lui éviter la faillite. Du jour au lendemain, les commandes de son Blériot XI affluent du monde entier et l’armée commence sérieusement à s’intéresser à ce nouveau mode de déplacement. La traversée de la Manche réussie, le fidèle Alfred Leblanc lui avance les fonds pour lancer rapidement la fabrication en série du modèle de cette traversée. L’ingénieur va se lancer dans la production, s’installant sur le terrain de Buc, en région parisienne, non loin de Toussus-le-Noble. Après son exploit, le 24 novembre 1909, Blériot crée une école de pilotage à Pau (dont le plus prestigieux élève fut Guynemer) qui fonctionnera jusqu’en novembre 1913. Ville choisie à cause de sa situation tout à fait exceptionnelle et parce qu’il y règne une température idéale, et qu’il a connue lors de son service militaire à Tarbes, et où il s’est marié non loin à Bagnères. Le terrain qu’il choisit est situé sur les landes de Pont-Long à 10 km au nord de Pau, à Lescar. C’est un terrain vague à peu près rectangulaire, long de 1800 mètres et large de 500 mètres environ, couvert d’ajoncs, d’où les eaux s’écoulaient vers le nord-ouest. Il y avait jalonné une ligne médiane via deux pylônes espacés de 1250 mètres, et dégagé, entre cette médiane et les limites du terrain, une piste large de 100 mètres devant les hangars, réduite à 25 mètres vers les extrémités et se refermant sur elle-même en contournant les pylônes. Après l’exploit qui le rendit célèbre dans le monde entier, Blériot participe à la Grande Semaine d’Aviation de la Champagne fin août 1909. Le 28 août 1909, il bat le record du monde de vitesse au Meeting de Champagne à Reims, sur Blériot XI. Le 7 octobre 1909, le gouvernement décide de décerner à 16 pionniers de l’aviation un brevet de pilote. La délivrance de ces brevets est effectuée par ordre alphabétique et Louis Blériot bénéficie ainsi au brevet n°1. L’instauration du brevet de pilote intervient le 1er janvier 1910. Le 10 octobre 1909, Louis Blériot fonde la Compagnie Générale Transaérienne (CGT). Le 30 octobre 1909, le Français Louis Blériot effectue le premier vol en avion à Bucarest en Roumanie. L’appareil avec lequel il avait accompli son exploit, et qui portait désormais le nom de Calais-Douvres, fut cédé au journal Le Matin pour la somme de 10.000 Francs représentant son prix de construction. Le 13 octobre 1909, le journal Le Matin offre cet aéroplane au Conservatoire des arts et métiers qu’il n’a depuis jamais quitté. La carrière de Blériot en tant que pilote se termina, en décembre 1909, d’une façon assez tragique. Au cours d’une démonstration sur le Blériot XII, exécutée à Constantinople, il se trouva pris dans de violentes rafales de vent, qui le plaquèrent au sol. Le pionnier français victime de son 32e accident (accidents qui lui ont valu le surnom de « roi de la casse » ou « l’homme qui tombe toujours » par la presse), s’en tira avec quelques côtes enfoncées et de nombreuses contusions. Sa décision était prise. Désormais, il ne volera plus que sporadiquement pour se concentrer sur le développement et l’industrialisation de ses machines. En août 1914, Louis Blériot et d’autres industriels reprennent les actifs de la Société de Production des Avions Déperdussin (SPAD), tombée en faillite, pour en faire la Société Pour l’Aviation et ses Dérivés (SPAD). L’ingénieur en charge du bureau d’études, Louis Béchereau, développera plusieurs avions de chasse dont les fameux SPAD S.VII et SPAD S.XIII qui équiperont un grand nombre d’escadrilles françaises. En 1917, les Établissements Blériot aéronautique et SPAD assurent 10% de la production d’avions en France. Blériot achète des sites industriels hors de Paris comme à Suresnes. Pendant la guerre, ce sont des milliers d’avions qui sortiront des ateliers Blériot de Suresnes et, en particulier, plus de 11.000 chasseurs SPAD, essentiellement dotés de moteurs Gnome et Rhône. Blériot devient le banquier de ses sociétés et fait des placements considérables dans l’industrie des loisirs, en particulier à Monte-Carlo. Louis Blériot devient donc un important industriel dans le domaine aéronautique, avec ses usines à Suresnes. Après la guerre, il se lance dans la fabrication de motos, avec un succès très mitigé. Il continue de fabriquer des avions, les avions SPAD, mais comptant sur les commandes de l’État, lequel révisa le contrat à la baisse, Blériot dû bientôt fermer ses usines. En 1936, le gouvernement nationalise les usines Blériot. La Société Blériot aéronautique est absorbée par la Société Nationale des Constructions Aéronautiques du Sud-Ouest (SNCASO). Louis Blériot ne supporta pas cette décision et cinq jours après la date effective, terrassé par le chagrin, il meurt précocement le 1er août 1936, à son domicile au 288, boulevard Saint-Germain, emporté par une crise cardiaque. La France rendra hommage à l’homme de la traversée de la Manche par des funérailles nationales le 5 août 1936, en l’église Saint-Louis des Invalides. Les honneurs militaires lui seront rendus par un détachement du 34e régiment d’Aviation du Bourget. L’éloge funèbre étant prononcé par le ministre de l’Air, Pierre Cot. Il sera inhumé au cimetière des Gonards à Versailles, dans le caveau de famille. Parmi ces nombreux « fous volants » de l’époque, qui éblouissaient le public, en particulier en France, Blériot se distingue comme le « père de l’aéronautique ». Ayant fait fortune en inventant les phares pour permettre aux automobiles de rouler la nuit, il aura réinvesti tous ses bénéfices dans des prototypes qu’il améliore avec le « manche à balai ». Blériot est à l’origine de la « cloche », ancêtre du manche à balai centralisant les commandes et permettant de contrôler l’altitude et le cap de l’avion. Il a aussi eu l’idée d’un « Salon de la Locomotion Aérienne ». Il sera le premier à fabriquer en série des avions, qui serviront à l’aéropostale, au transport aérien, puis... à la Première Guerre mondiale. Et ensuite seulement viendront les lignes commerciales et les applications civiles... Louis Blériot aura fait notablement progresser la construction et l’expérimentation des aéroplanes. En 1911, l’Aéro-club français fera installer une stèle commémorant l’événement du 25 juillet 1909, au lieu-dit « Les Baraques-Plage », pas très loin de la zone de l’envol. Depuis le décès le 1er août 1936 de Louis Blériot, « Les Baraques-Plage » se nomme « Blériot-Plage ». Le monument se trouve actuellement à l’angle de la rue Guynemer, prolongée par la rue Sémaphore, et du CD 940 reliant Calais à Sangatte. La médaille Louis Blériot est délivrée en l’honneur d’un événement en rapport avec l’aviation décernée par la Fédération aéronautique internationale (FAI) depuis 1936 en l’honneur de Louis Blériot. L’avion qui a été utilisé dans la traversée de la Manche est aujourd’hui conservé au Musée des Arts et Métiers à Paris. En mai 1927, Blériot, le pionnier de la Manche, est la première personne que Charles Lindbergh demandera à voir à l’issue de sa traversée de l’Atlantique Nord à bord de son avion Spirit of Saint Louis. Louis Blériot était très attaché aux Hautes-Pyrénées puisqu’il s’éprit de Jeanne Alicia Védère, née en 1883, fille de colonel à la retraite, originaire de Gerde, qu’il épousa le 21 février 1901 à Bagnères-de-Bigorre, alors âgés respectivement de 18 et 29 ans et dont il avait fait la connaissance à Tarbes, lors de son service militaire. Installés boulevard Maillot à Neuilly-sur-Seine, ils vont avoir six enfants, trois garçons, Louis, Marcel, Jean et trois filles, Simone, Ginette et Nelly. Louis est taciturne et renfermé, Alicia, son épouse est bavarde, enthousiaste et pleine d’entrain : un couple complémentaire. Il fut tout de suite adopté en Bigorre, où il effectua de nombreuses visites dans le secteur de Bagnères et de Cauterets. Les aviateurs de son école de pilotage de Pau l’accompagnaient souvent. Les pilotes des avions Blériot survoleront régulièrement le département des Hautes-Pyrénées en 1910 et 1911. Le 3 février 1911, Blériot fait un atterrissage remarqué entre les villages de Gerde et Asté, tout à côté de Bagnères. De quoi donner de nouvelles idées à notre ingénieur Pierre-Georges Latécoère, centralien comme lui, né à Bagnères-de-Bigorre en 1883 ! Malgré des conditions météo épouvantables en ce mois de février, Blériot réussit son atterrissage. Son épouse, les aviateurs Leblanc et Aubrun l’attendaient. C’est ensuite Leblanc qui, dix minutes après, montait sur l’oiseau mécanique et regagnait Pau par la voie des airs. Blériot et sa femme sont rentrés à Bagnères-de-Bigorre en automobile, longuement ovationnés sur leur parcours. En 1913, Louis Blériot et son épouse se sont essayés à la luge et au bobsleigh à Cauterets. Sur une maison de la rue Saint-Blaise à Bagnères-de-Bigorre, est accrochée cette plaque : « L’aviateur Louis Blériot (1872-1936) a habité cette maison avec sa famille Bagnéraise. » Madame Louis Blériot décèdera le 13 mars 1963. Madame Louis Blériot fut de toutes les manifestations et inaugurations aux côtés de son héroïque mari, l’accompagnant ainsi jusqu’en 1936 et le représentant très dignement après sa mort. C’était une jolie femme, toujours vêtue très élégamment et coiffée d’un large chapeau à la mode de l’époque. À cela s’ajoutait son immuable sourire qui la rendait agréable à regarder. Elle se disait la mascotte de son ingénieur, inventeur et pilote aviateur. Il la faisait frémir de peur à chacun de ses essais en vol, par ses nombreuses chutes parfois très sérieuses qui le faisaient appeler "l’homme qui tombe toujours". Madame Louis Blériot s’était rendue à Blériot-Plage le 25 juillet 1959 à l’occasion du cinquantenaire de la traversée de la Manche. Ce sera là sa dernière visite sur les terres qui ont vu le décollage de son illustre mari. Le 13 mars 1963, elle décédait à l’âge de quatre-vingt ans, en son domicile parisien, entourée de l’affection de ses enfants et petits-enfants. Le père Grignon qui avait abrité le Blériot XI de la traversée avait eu ces mots : "Madame Blériot fut, pendant les jours qui ont précédé le départ, une aide précieuse pour son mari avec lequel elle venait chaque jour aux Baraques, se montrant aussi convaincue que lui de sa réussite, croyant en lui et en ses rêves. "
Louis Charles Joseph BLÉRIOT, né le 1er juillet 1872 à Cambrai et mort subitement le 1er août 1936 à Paris, à l’âge de 64 ans, est un constructeur de lanternes d’automobiles, d’avions, de motocyclettes et de chars à voile, et un pilote précurseur et pionnier de l’aviation française. À ses débuts, comme ingénieur diplômé de l’École Centrale des Arts et Manufactures (promotion 1895), il entre chez Baguès, une société d’ingénierie électrique à Paris, puis effectue son service militaire dans l’artillerie à Tarbes au 24e régiment d’artillerie comme sous-lieutenant puis lieutenant de réserve au 36e régiment d’artillerie. Les Établissements Louis Blériot, qu’il a créés en 1903, connaissent un succès certain dans la fabrication de phares à acétylène pour l’industrie automobile alors en pleine expansion. On lui doit l’appellation « phare » pour les éclairages de voitures. Et après avoir fait fortune dans les phares pour automobiles, entre 1905 et 1909, il se lance dans la grande aventure aéronautique et produit une série de 11 prototypes : le Blériot I, le Blériot II, le Blériot III … jusqu’au Blériot XI, qui est celui de la traversée de la Manche. Après plusieurs années de recherches et pas mal de casse, il est parvenu à réaliser un aéroplane léger, solide et fiable. Le Blériot XI est un appareil monoplan à fuselage partiellement entoilé, long de 8 mètres, avec une envergure de 7,20 mètres et qui pèse 310 kilogrammes. Son hélice Chauvière bipale est entraînée par un moteur Anzani à trois cylindres en étoile développant 25ch. Répondant au défi lancé en 1908 par le Daily Mail (journal britannique), Blériot se lance dans l’aventure de la première traversée de la Manche, Et voilà comment, le 25 juillet 1909, Louis Blériot et Hubert Latham, deux pionniers français de l’aviation, se retrouvent au petit matin, prêts à partir de Calais pour une course aérienne France-Angleterre. Et c’est Latham qui paraît avoir les meilleures chances de remporter le pactole de 1000 livres du Daily Mail. Mais, Hubert Latham, son concurrent direct, est victime d’une panne, et c’est Blériot qui gagne (suite à des problèmes techniques, Latham ne réussira à décoller que le 27 juillet avant d’échouer à 500 mètres du but). C’est à Pau que Louis Blériot s’est préparé à ce grand exploit et après un dernier vol d’essai de 11 minutes effectué à 4h15 du matin au-dessus des Baraques, le 25 juillet 1909, le temps semble idéal, Le vent est tombé durant la nuit, et à 4h41 du matin, Louis Blériot s’envole pour l’Angleterre. Très vite, à 4h48, il dépasse le contre-torpilleur accompagnateur Escopette, où son épouse se trouve à bord, guettant son mari dans les airs avec ses jumelles, et 37 minutes après et 35 kilomètres de vol, la Manche est traversée. Ce qui donne une vitesse moyenne d’environ 57 km/h à une altitude de vol de 100 mètres. Ainsi, ce 25 juillet 1909, Louis Blériot est le premier à traverser la Manche par les airs, en décollant au lever du soleil, condition exigée par le Daily Mail, qui est à l’origine du défi et qui lui remettra la somme de 25.000 Francs-or mise en jeu. Malgré une blessure au pied, et ne sachant pas nager, il effectue la traversée, ralliant le lieu-dit Les Baraques près de Calais à Douvres en Angleterre, aux commandes du Blériot XI qu’il a conçu en collaboration avec Raymond Saulnier. La visibilité étant moyenne au départ, il s’oriente sans boussole en s’aidant de la trajectoire des bateaux reliant la France et la Grande-Bretagne, avant de pouvoir distinguer les falaises près de Douvres. La puissance de son moteur lui permet à peine de monter plus haut que ces dernières. Après un virage vers l’est, il revient à l’ouest pour finalement trouver le champ et atterrir sur les côtes anglaises, où l’attend le journaliste français Charles Fontaine muni d’un grand drapeau tricolore qu’il agite, et son photographe Marcel Marmier. À 5h12, après un virage, c’est chose faite : Blériot coupe le moteur sur le sol anglais. En une trentaine de minutes, la traversée a été réalisée mais fidèle à son habitude, Louis Blériot endommage le train de son appareil à l’atterrissage et une pale de l’hélice a été brisée, mais Blériot est sorti indemne. Désormais l’Angleterre n’est plus une île ! La Manche venait d’être vaincue par un plus lourd que l’air. La capitale britannique salue l’exploit de Louis Blériot, devenu mondialement célèbre, avant son retour en France. Un vol qui fera sa gloire, abondamment relayé par la presse de l’époque. Les jours qui suivent ne seront qu’honneurs, réceptions et fêtes. L’événement a un retentissement mondial. Pour Blériot, c’était la consécration mais aussi le soulagement car depuis quelques années, il avait dépensé la quasi-totalité de sa fortune pour concevoir et construire une dizaine de prototypes aux destins plus ou moins heureux. Cette réussite va le propulser et lui éviter la faillite. Du jour au lendemain, les commandes de son Blériot XI affluent du monde entier et l’armée commence sérieusement à s’intéresser à ce nouveau mode de déplacement. La traversée de la Manche réussie, le fidèle Alfred Leblanc lui avance les fonds pour lancer rapidement la fabrication en série du modèle de cette traversée. L’ingénieur va se lancer dans la production, s’installant sur le terrain de Buc, en région parisienne, non loin de Toussus-le-Noble. Après son exploit, le 24 novembre 1909, Blériot crée une école de pilotage à Pau (dont le plus prestigieux élève fut Guynemer) qui fonctionnera jusqu’en novembre 1913. Ville choisie à cause de sa situation tout à fait exceptionnelle et parce qu’il y règne une température idéale, et qu’il a connue lors de son service militaire à Tarbes, et où il s’est marié non loin à Bagnères. Le terrain qu’il choisit est situé sur les landes de Pont-Long à 10 km au nord de Pau, à Lescar. C’est un terrain vague à peu près rectangulaire, long de 1800 mètres et large de 500 mètres environ, couvert d’ajoncs, d’où les eaux s’écoulaient vers le nord-ouest. Il y avait jalonné une ligne médiane via deux pylônes espacés de 1250 mètres, et dégagé, entre cette médiane et les limites du terrain, une piste large de 100 mètres devant les hangars, réduite à 25 mètres vers les extrémités et se refermant sur elle-même en contournant les pylônes. Après l’exploit qui le rendit célèbre dans le monde entier, Blériot participe à la Grande Semaine d’Aviation de la Champagne fin août 1909. Le 28 août 1909, il bat le record du monde de vitesse au Meeting de Champagne à Reims, sur Blériot XI. Le 7 octobre 1909, le gouvernement décide de décerner à 16 pionniers de l’aviation un brevet de pilote. La délivrance de ces brevets est effectuée par ordre alphabétique et Louis Blériot bénéficie ainsi au brevet n°1. L’instauration du brevet de pilote intervient le 1er janvier 1910. Le 10 octobre 1909, Louis Blériot fonde la Compagnie Générale Transaérienne (CGT). Le 30 octobre 1909, le Français Louis Blériot effectue le premier vol en avion à Bucarest en Roumanie. L’appareil avec lequel il avait accompli son exploit, et qui portait désormais le nom de Calais-Douvres, fut cédé au journal Le Matin pour la somme de 10.000 Francs représentant son prix de construction. Le 13 octobre 1909, le journal Le Matin offre cet aéroplane au Conservatoire des arts et métiers qu’il n’a depuis jamais quitté. La carrière de Blériot en tant que pilote se termina, en décembre 1909, d’une façon assez tragique. Au cours d’une démonstration sur le Blériot XII, exécutée à Constantinople, il se trouva pris dans de violentes rafales de vent, qui le plaquèrent au sol. Le pionnier français victime de son 32e accident (accidents qui lui ont valu le surnom de « roi de la casse » ou « l’homme qui tombe toujours » par la presse), s’en tira avec quelques côtes enfoncées et de nombreuses contusions. Sa décision était prise. Désormais, il ne volera plus que sporadiquement pour se concentrer sur le développement et l’industrialisation de ses machines. En août 1914, Louis Blériot et d’autres industriels reprennent les actifs de la Société de Production des Avions Déperdussin (SPAD), tombée en faillite, pour en faire la Société Pour l’Aviation et ses Dérivés (SPAD). L’ingénieur en charge du bureau d’études, Louis Béchereau, développera plusieurs avions de chasse dont les fameux SPAD S.VII et SPAD S.XIII qui équiperont un grand nombre d’escadrilles françaises. En 1917, les Établissements Blériot aéronautique et SPAD assurent 10% de la production d’avions en France. Blériot achète des sites industriels hors de Paris comme à Suresnes. Pendant la guerre, ce sont des milliers d’avions qui sortiront des ateliers Blériot de Suresnes et, en particulier, plus de 11.000 chasseurs SPAD, essentiellement dotés de moteurs Gnome et Rhône. Blériot devient le banquier de ses sociétés et fait des placements considérables dans l’industrie des loisirs, en particulier à Monte-Carlo. Louis Blériot devient donc un important industriel dans le domaine aéronautique, avec ses usines à Suresnes. Après la guerre, il se lance dans la fabrication de motos, avec un succès très mitigé. Il continue de fabriquer des avions, les avions SPAD, mais comptant sur les commandes de l’État, lequel révisa le contrat à la baisse, Blériot dû bientôt fermer ses usines. En 1936, le gouvernement nationalise les usines Blériot. La Société Blériot aéronautique est absorbée par la Société Nationale des Constructions Aéronautiques du Sud-Ouest (SNCASO). Louis Blériot ne supporta pas cette décision et cinq jours après la date effective, terrassé par le chagrin, il meurt précocement le 1er août 1936, à son domicile au 288, boulevard Saint-Germain, emporté par une crise cardiaque. La France rendra hommage à l’homme de la traversée de la Manche par des funérailles nationales le 5 août 1936, en l’église Saint-Louis des Invalides. Les honneurs militaires lui seront rendus par un détachement du 34e régiment d’Aviation du Bourget. L’éloge funèbre étant prononcé par le ministre de l’Air, Pierre Cot. Il sera inhumé au cimetière des Gonards à Versailles, dans le caveau de famille. Parmi ces nombreux « fous volants » de l’époque, qui éblouissaient le public, en particulier en France, Blériot se distingue comme le « père de l’aéronautique ». Ayant fait fortune en inventant les phares pour permettre aux automobiles de rouler la nuit, il aura réinvesti tous ses bénéfices dans des prototypes qu’il améliore avec le « manche à balai ». Blériot est à l’origine de la « cloche », ancêtre du manche à balai centralisant les commandes et permettant de contrôler l’altitude et le cap de l’avion. Il a aussi eu l’idée d’un « Salon de la Locomotion Aérienne ». Il sera le premier à fabriquer en série des avions, qui serviront à l’aéropostale, au transport aérien, puis... à la Première Guerre mondiale. Et ensuite seulement viendront les lignes commerciales et les applications civiles... Louis Blériot aura fait notablement progresser la construction et l’expérimentation des aéroplanes. En 1911, l’Aéro-club français fera installer une stèle commémorant l’événement du 25 juillet 1909, au lieu-dit « Les Baraques-Plage », pas très loin de la zone de l’envol. Depuis le décès le 1er août 1936 de Louis Blériot, « Les Baraques-Plage » se nomme « Blériot-Plage ». Le monument se trouve actuellement à l’angle de la rue Guynemer, prolongée par la rue Sémaphore, et du CD 940 reliant Calais à Sangatte. La médaille Louis Blériot est délivrée en l’honneur d’un événement en rapport avec l’aviation décernée par la Fédération aéronautique internationale (FAI) depuis 1936 en l’honneur de Louis Blériot. L’avion qui a été utilisé dans la traversée de la Manche est aujourd’hui conservé au Musée des Arts et Métiers à Paris. En mai 1927, Blériot, le pionnier de la Manche, est la première personne que Charles Lindbergh demandera à voir à l’issue de sa traversée de l’Atlantique Nord à bord de son avion Spirit of Saint Louis. Louis Blériot était très attaché aux Hautes-Pyrénées puisqu’il s’éprit de Jeanne Alicia Védère, née en 1883, fille de colonel à la retraite, originaire de Gerde, qu’il épousa le 21 février 1901 à Bagnères-de-Bigorre, alors âgés respectivement de 18 et 29 ans et dont il avait fait la connaissance à Tarbes, lors de son service militaire. Installés boulevard Maillot à Neuilly-sur-Seine, ils vont avoir six enfants, trois garçons, Louis, Marcel, Jean et trois filles, Simone, Ginette et Nelly. Louis est taciturne et renfermé, Alicia, son épouse est bavarde, enthousiaste et pleine d’entrain : un couple complémentaire. Il fut tout de suite adopté en Bigorre, où il effectua de nombreuses visites dans le secteur de Bagnères et de Cauterets. Les aviateurs de son école de pilotage de Pau l’accompagnaient souvent. Les pilotes des avions Blériot survoleront régulièrement le département des Hautes-Pyrénées en 1910 et 1911. Le 3 février 1911, Blériot fait un atterrissage remarqué entre les villages de Gerde et Asté, tout à côté de Bagnères. De quoi donner de nouvelles idées à notre ingénieur Pierre-Georges Latécoère, centralien comme lui, né à Bagnères-de-Bigorre en 1883 ! Malgré des conditions météo épouvantables en ce mois de février, Blériot réussit son atterrissage. Son épouse, les aviateurs Leblanc et Aubrun l’attendaient. C’est ensuite Leblanc qui, dix minutes après, montait sur l’oiseau mécanique et regagnait Pau par la voie des airs. Blériot et sa femme sont rentrés à Bagnères-de-Bigorre en automobile, longuement ovationnés sur leur parcours. En 1913, Louis Blériot et son épouse se sont essayés à la luge et au bobsleigh à Cauterets. Sur une maison de la rue Saint-Blaise à Bagnères-de-Bigorre, est accrochée cette plaque : « L’aviateur Louis Blériot (1872-1936) a habité cette maison avec sa famille Bagnéraise. » Madame Louis Blériot décèdera le 13 mars 1963. Madame Louis Blériot fut de toutes les manifestations et inaugurations aux côtés de son héroïque mari, l’accompagnant ainsi jusqu’en 1936 et le représentant très dignement après sa mort. C’était une jolie femme, toujours vêtue très élégamment et coiffée d’un large chapeau à la mode de l’époque. À cela s’ajoutait son immuable sourire qui la rendait agréable à regarder. Elle se disait la mascotte de son ingénieur, inventeur et pilote aviateur. Il la faisait frémir de peur à chacun de ses essais en vol, par ses nombreuses chutes parfois très sérieuses qui le faisaient appeler "l’homme qui tombe toujours". Madame Louis Blériot s’était rendue à Blériot-Plage le 25 juillet 1959 à l’occasion du cinquantenaire de la traversée de la Manche. Ce sera là sa dernière visite sur les terres qui ont vu le décollage de son illustre mari. Le 13 mars 1963, elle décédait à l’âge de quatre-vingt ans, en son domicile parisien, entourée de l’affection de ses enfants et petits-enfants. Le père Grignon qui avait abrité le Blériot XI de la traversée avait eu ces mots : "Madame Blériot fut, pendant les jours qui ont précédé le départ, une aide précieuse pour son mari avec lequel elle venait chaque jour aux Baraques, se montrant aussi convaincue que lui de sa réussite, croyant en lui et en ses rêves. "
 Louis Charles Joseph BLÉRIOT, né le 1er juillet 1872 à Cambrai et mort subitement le 1er août 1936 à Paris, à l’âge de 64 ans, est un constructeur de lanternes d’automobiles, d’avions, de motocyclettes et de chars à voile, et un pilote précurseur et pionnier de l’aviation française. À ses débuts, comme ingénieur diplômé de l’École Centrale des Arts et Manufactures (promotion 1895), il entre chez Baguès, une société d’ingénierie électrique à Paris, puis effectue son service militaire dans l’artillerie à Tarbes au 24e régiment d’artillerie comme sous-lieutenant puis lieutenant de réserve au 36e régiment d’artillerie. Les Établissements Louis Blériot, qu’il a créés en 1903, connaissent un succès certain dans la fabrication de phares à acétylène pour l’industrie automobile alors en pleine expansion. On lui doit l’appellation « phare » pour les éclairages de voitures. Et après avoir fait fortune dans les phares pour automobiles, entre 1905 et 1909, il se lance dans la grande aventure aéronautique et produit une série de 11 prototypes : le Blériot I, le Blériot II, le Blériot III … jusqu’au Blériot XI, qui est celui de la traversée de la Manche. Après plusieurs années de recherches et pas mal de casse, il est parvenu à réaliser un aéroplane léger, solide et fiable. Le Blériot XI est un appareil monoplan à fuselage partiellement entoilé, long de 8 mètres, avec une envergure de 7,20 mètres et qui pèse 310 kilogrammes. Son hélice Chauvière bipale est entraînée par un moteur Anzani à trois cylindres en étoile développant 25ch. Répondant au défi lancé en 1908 par le Daily Mail (journal britannique), Blériot se lance dans l’aventure de la première traversée de la Manche, Et voilà comment, le 25 juillet 1909, Louis Blériot et Hubert Latham, deux pionniers français de l’aviation, se retrouvent au petit matin, prêts à partir de Calais pour une course aérienne France-Angleterre. Et c’est Latham qui paraît avoir les meilleures chances de remporter le pactole de 1000 livres du Daily Mail. Mais, Hubert Latham, son concurrent direct, est victime d’une panne, et c’est Blériot qui gagne (suite à des problèmes techniques, Latham ne réussira à décoller que le 27 juillet avant d’échouer à 500 mètres du but). C’est à Pau que Louis Blériot s’est préparé à ce grand exploit et après un dernier vol d’essai de 11 minutes effectué à 4h15 du matin au-dessus des Baraques, le 25 juillet 1909, le temps semble idéal, Le vent est tombé durant la nuit, et à 4h41 du matin, Louis Blériot s’envole pour l’Angleterre. Très vite, à 4h48, il dépasse le contre-torpilleur accompagnateur Escopette, où son épouse se trouve à bord, guettant son mari dans les airs avec ses jumelles, et 37 minutes après et 35 kilomètres de vol, la Manche est traversée. Ce qui donne une vitesse moyenne d’environ 57 km/h à une altitude de vol de 100 mètres. Ainsi, ce 25 juillet 1909, Louis Blériot est le premier à traverser la Manche par les airs, en décollant au lever du soleil, condition exigée par le Daily Mail, qui est à l’origine du défi et qui lui remettra la somme de 25.000 Francs-or mise en jeu. Malgré une blessure au pied, et ne sachant pas nager, il effectue la traversée, ralliant le lieu-dit Les Baraques près de Calais à Douvres en Angleterre, aux commandes du Blériot XI qu’il a conçu en collaboration avec Raymond Saulnier. La visibilité étant moyenne au départ, il s’oriente sans boussole en s’aidant de la trajectoire des bateaux reliant la France et la Grande-Bretagne, avant de pouvoir distinguer les falaises près de Douvres. La puissance de son moteur lui permet à peine de monter plus haut que ces dernières. Après un virage vers l’est, il revient à l’ouest pour finalement trouver le champ et atterrir sur les côtes anglaises, où l’attend le journaliste français Charles Fontaine muni d’un grand drapeau tricolore qu’il agite, et son photographe Marcel Marmier. À 5h12, après un virage, c’est chose faite : Blériot coupe le moteur sur le sol anglais. En une trentaine de minutes, la traversée a été réalisée mais fidèle à son habitude, Louis Blériot endommage le train de son appareil à l’atterrissage et une pale de l’hélice a été brisée, mais Blériot est sorti indemne. Désormais l’Angleterre n’est plus une île ! La Manche venait d’être vaincue par un plus lourd que l’air. La capitale britannique salue l’exploit de Louis Blériot, devenu mondialement célèbre, avant son retour en France. Un vol qui fera sa gloire, abondamment relayé par la presse de l’époque. Les jours qui suivent ne seront qu’honneurs, réceptions et fêtes. L’événement a un retentissement mondial. Pour Blériot, c’était la consécration mais aussi le soulagement car depuis quelques années, il avait dépensé la quasi-totalité de sa fortune pour concevoir et construire une dizaine de prototypes aux destins plus ou moins heureux. Cette réussite va le propulser et lui éviter la faillite. Du jour au lendemain, les commandes de son Blériot XI affluent du monde entier et l’armée commence sérieusement à s’intéresser à ce nouveau mode de déplacement. La traversée de la Manche réussie, le fidèle Alfred Leblanc lui avance les fonds pour lancer rapidement la fabrication en série du modèle de cette traversée. L’ingénieur va se lancer dans la production, s’installant sur le terrain de Buc, en région parisienne, non loin de Toussus-le-Noble. Après son exploit, le 24 novembre 1909, Blériot crée une école de pilotage à Pau (dont le plus prestigieux élève fut Guynemer) qui fonctionnera jusqu’en novembre 1913. Ville choisie à cause de sa situation tout à fait exceptionnelle et parce qu’il y règne une température idéale, et qu’il a connue lors de son service militaire à Tarbes, et où il s’est marié non loin à Bagnères. Le terrain qu’il choisit est situé sur les landes de Pont-Long à 10 km au nord de Pau, à Lescar. C’est un terrain vague à peu près rectangulaire, long de 1800 mètres et large de 500 mètres environ, couvert d’ajoncs, d’où les eaux s’écoulaient vers le nord-ouest. Il y avait jalonné une ligne médiane via deux pylônes espacés de 1250 mètres, et dégagé, entre cette médiane et les limites du terrain, une piste large de 100 mètres devant les hangars, réduite à 25 mètres vers les extrémités et se refermant sur elle-même en contournant les pylônes. Après l’exploit qui le rendit célèbre dans le monde entier, Blériot participe à la Grande Semaine d’Aviation de la Champagne fin août 1909. Le 28 août 1909, il bat le record du monde de vitesse au Meeting de Champagne à Reims, sur Blériot XI. Le 7 octobre 1909, le gouvernement décide de décerner à 16 pionniers de l’aviation un brevet de pilote. La délivrance de ces brevets est effectuée par ordre alphabétique et Louis Blériot bénéficie ainsi au brevet n°1. L’instauration du brevet de pilote intervient le 1er janvier 1910. Le 10 octobre 1909, Louis Blériot fonde la Compagnie Générale Transaérienne (CGT). Le 30 octobre 1909, le Français Louis Blériot effectue le premier vol en avion à Bucarest en Roumanie. L’appareil avec lequel il avait accompli son exploit, et qui portait désormais le nom de Calais-Douvres, fut cédé au journal Le Matin pour la somme de 10.000 Francs représentant son prix de construction. Le 13 octobre 1909, le journal Le Matin offre cet aéroplane au Conservatoire des arts et métiers qu’il n’a depuis jamais quitté. La carrière de Blériot en tant que pilote se termina, en décembre 1909, d’une façon assez tragique. Au cours d’une démonstration sur le Blériot XII, exécutée à Constantinople, il se trouva pris dans de violentes rafales de vent, qui le plaquèrent au sol. Le pionnier français victime de son 32e accident (accidents qui lui ont valu le surnom de « roi de la casse » ou « l’homme qui tombe toujours » par la presse), s’en tira avec quelques côtes enfoncées et de nombreuses contusions. Sa décision était prise. Désormais, il ne volera plus que sporadiquement pour se concentrer sur le développement et l’industrialisation de ses machines. En août 1914, Louis Blériot et d’autres industriels reprennent les actifs de la Société de Production des Avions Déperdussin (SPAD), tombée en faillite, pour en faire la Société Pour l’Aviation et ses Dérivés (SPAD). L’ingénieur en charge du bureau d’études, Louis Béchereau, développera plusieurs avions de chasse dont les fameux SPAD S.VII et SPAD S.XIII qui équiperont un grand nombre d’escadrilles françaises. En 1917, les Établissements Blériot aéronautique et SPAD assurent 10% de la production d’avions en France. Blériot achète des sites industriels hors de Paris comme à Suresnes. Pendant la guerre, ce sont des milliers d’avions qui sortiront des ateliers Blériot de Suresnes et, en particulier, plus de 11.000 chasseurs SPAD, essentiellement dotés de moteurs Gnome et Rhône. Blériot devient le banquier de ses sociétés et fait des placements considérables dans l’industrie des loisirs, en particulier à Monte-Carlo. Louis Blériot devient donc un important industriel dans le domaine aéronautique, avec ses usines à Suresnes. Après la guerre, il se lance dans la fabrication de motos, avec un succès très mitigé. Il continue de fabriquer des avions, les avions SPAD, mais comptant sur les commandes de l’État, lequel révisa le contrat à la baisse, Blériot dû bientôt fermer ses usines. En 1936, le gouvernement nationalise les usines Blériot. La Société Blériot aéronautique est absorbée par la Société Nationale des Constructions Aéronautiques du Sud-Ouest (SNCASO). Louis Blériot ne supporta pas cette décision et cinq jours après la date effective, terrassé par le chagrin, il meurt précocement le 1er août 1936, à son domicile au 288, boulevard Saint-Germain, emporté par une crise cardiaque. La France rendra hommage à l’homme de la traversée de la Manche par des funérailles nationales le 5 août 1936, en l’église Saint-Louis des Invalides. Les honneurs militaires lui seront rendus par un détachement du 34e régiment d’Aviation du Bourget. L’éloge funèbre étant prononcé par le ministre de l’Air, Pierre Cot. Il sera inhumé au cimetière des Gonards à Versailles, dans le caveau de famille. Parmi ces nombreux « fous volants » de l’époque, qui éblouissaient le public, en particulier en France, Blériot se distingue comme le « père de l’aéronautique ». Ayant fait fortune en inventant les phares pour permettre aux automobiles de rouler la nuit, il aura réinvesti tous ses bénéfices dans des prototypes qu’il améliore avec le « manche à balai ». Blériot est à l’origine de la « cloche », ancêtre du manche à balai centralisant les commandes et permettant de contrôler l’altitude et le cap de l’avion. Il a aussi eu l’idée d’un « Salon de la Locomotion Aérienne ». Il sera le premier à fabriquer en série des avions, qui serviront à l’aéropostale, au transport aérien, puis... à la Première Guerre mondiale. Et ensuite seulement viendront les lignes commerciales et les applications civiles... Louis Blériot aura fait notablement progresser la construction et l’expérimentation des aéroplanes. En 1911, l’Aéro-club français fera installer une stèle commémorant l’événement du 25 juillet 1909, au lieu-dit « Les Baraques-Plage », pas très loin de la zone de l’envol. Depuis le décès le 1er août 1936 de Louis Blériot, « Les Baraques-Plage » se nomme « Blériot-Plage ». Le monument se trouve actuellement à l’angle de la rue Guynemer, prolongée par la rue Sémaphore, et du CD 940 reliant Calais à Sangatte. La médaille Louis Blériot est délivrée en l’honneur d’un événement en rapport avec l’aviation décernée par la Fédération aéronautique internationale (FAI) depuis 1936 en l’honneur de Louis Blériot. L’avion qui a été utilisé dans la traversée de la Manche est aujourd’hui conservé au Musée des Arts et Métiers à Paris. En mai 1927, Blériot, le pionnier de la Manche, est la première personne que Charles Lindbergh demandera à voir à l’issue de sa traversée de l’Atlantique Nord à bord de son avion Spirit of Saint Louis. Louis Blériot était très attaché aux Hautes-Pyrénées puisqu’il s’éprit de Jeanne Alicia Védère, née en 1883, fille de colonel à la retraite, originaire de Gerde, qu’il épousa le 21 février 1901 à Bagnères-de-Bigorre, alors âgés respectivement de 18 et 29 ans et dont il avait fait la connaissance à Tarbes, lors de son service militaire. Installés boulevard Maillot à Neuilly-sur-Seine, ils vont avoir six enfants, trois garçons, Louis, Marcel, Jean et trois filles, Simone, Ginette et Nelly. Louis est taciturne et renfermé, Alicia, son épouse est bavarde, enthousiaste et pleine d’entrain : un couple complémentaire. Il fut tout de suite adopté en Bigorre, où il effectua de nombreuses visites dans le secteur de Bagnères et de Cauterets. Les aviateurs de son école de pilotage de Pau l’accompagnaient souvent. Les pilotes des avions Blériot survoleront régulièrement le département des Hautes-Pyrénées en 1910 et 1911. Le 3 février 1911, Blériot fait un atterrissage remarqué entre les villages de Gerde et Asté, tout à côté de Bagnères. De quoi donner de nouvelles idées à notre ingénieur Pierre-Georges Latécoère, centralien comme lui, né à Bagnères-de-Bigorre en 1883 ! Malgré des conditions météo épouvantables en ce mois de février, Blériot réussit son atterrissage. Son épouse, les aviateurs Leblanc et Aubrun l’attendaient. C’est ensuite Leblanc qui, dix minutes après, montait sur l’oiseau mécanique et regagnait Pau par la voie des airs. Blériot et sa femme sont rentrés à Bagnères-de-Bigorre en automobile, longuement ovationnés sur leur parcours. En 1913, Louis Blériot et son épouse se sont essayés à la luge et au bobsleigh à Cauterets. Sur une maison de la rue Saint-Blaise à Bagnères-de-Bigorre, est accrochée cette plaque : « L’aviateur Louis Blériot (1872-1936) a habité cette maison avec sa famille Bagnéraise. » Madame Louis Blériot décèdera le 13 mars 1963. Madame Louis Blériot fut de toutes les manifestations et inaugurations aux côtés de son héroïque mari, l’accompagnant ainsi jusqu’en 1936 et le représentant très dignement après sa mort. C’était une jolie femme, toujours vêtue très élégamment et coiffée d’un large chapeau à la mode de l’époque. À cela s’ajoutait son immuable sourire qui la rendait agréable à regarder. Elle se disait la mascotte de son ingénieur, inventeur et pilote aviateur. Il la faisait frémir de peur à chacun de ses essais en vol, par ses nombreuses chutes parfois très sérieuses qui le faisaient appeler "l’homme qui tombe toujours". Madame Louis Blériot s’était rendue à Blériot-Plage le 25 juillet 1959 à l’occasion du cinquantenaire de la traversée de la Manche. Ce sera là sa dernière visite sur les terres qui ont vu le décollage de son illustre mari. Le 13 mars 1963, elle décédait à l’âge de quatre-vingt ans, en son domicile parisien, entourée de l’affection de ses enfants et petits-enfants. Le père Grignon qui avait abrité le Blériot XI de la traversée avait eu ces mots : "Madame Blériot fut, pendant les jours qui ont précédé le départ, une aide précieuse pour son mari avec lequel elle venait chaque jour aux Baraques, se montrant aussi convaincue que lui de sa réussite, croyant en lui et en ses rêves. "
Louis Charles Joseph BLÉRIOT, né le 1er juillet 1872 à Cambrai et mort subitement le 1er août 1936 à Paris, à l’âge de 64 ans, est un constructeur de lanternes d’automobiles, d’avions, de motocyclettes et de chars à voile, et un pilote précurseur et pionnier de l’aviation française. À ses débuts, comme ingénieur diplômé de l’École Centrale des Arts et Manufactures (promotion 1895), il entre chez Baguès, une société d’ingénierie électrique à Paris, puis effectue son service militaire dans l’artillerie à Tarbes au 24e régiment d’artillerie comme sous-lieutenant puis lieutenant de réserve au 36e régiment d’artillerie. Les Établissements Louis Blériot, qu’il a créés en 1903, connaissent un succès certain dans la fabrication de phares à acétylène pour l’industrie automobile alors en pleine expansion. On lui doit l’appellation « phare » pour les éclairages de voitures. Et après avoir fait fortune dans les phares pour automobiles, entre 1905 et 1909, il se lance dans la grande aventure aéronautique et produit une série de 11 prototypes : le Blériot I, le Blériot II, le Blériot III … jusqu’au Blériot XI, qui est celui de la traversée de la Manche. Après plusieurs années de recherches et pas mal de casse, il est parvenu à réaliser un aéroplane léger, solide et fiable. Le Blériot XI est un appareil monoplan à fuselage partiellement entoilé, long de 8 mètres, avec une envergure de 7,20 mètres et qui pèse 310 kilogrammes. Son hélice Chauvière bipale est entraînée par un moteur Anzani à trois cylindres en étoile développant 25ch. Répondant au défi lancé en 1908 par le Daily Mail (journal britannique), Blériot se lance dans l’aventure de la première traversée de la Manche, Et voilà comment, le 25 juillet 1909, Louis Blériot et Hubert Latham, deux pionniers français de l’aviation, se retrouvent au petit matin, prêts à partir de Calais pour une course aérienne France-Angleterre. Et c’est Latham qui paraît avoir les meilleures chances de remporter le pactole de 1000 livres du Daily Mail. Mais, Hubert Latham, son concurrent direct, est victime d’une panne, et c’est Blériot qui gagne (suite à des problèmes techniques, Latham ne réussira à décoller que le 27 juillet avant d’échouer à 500 mètres du but). C’est à Pau que Louis Blériot s’est préparé à ce grand exploit et après un dernier vol d’essai de 11 minutes effectué à 4h15 du matin au-dessus des Baraques, le 25 juillet 1909, le temps semble idéal, Le vent est tombé durant la nuit, et à 4h41 du matin, Louis Blériot s’envole pour l’Angleterre. Très vite, à 4h48, il dépasse le contre-torpilleur accompagnateur Escopette, où son épouse se trouve à bord, guettant son mari dans les airs avec ses jumelles, et 37 minutes après et 35 kilomètres de vol, la Manche est traversée. Ce qui donne une vitesse moyenne d’environ 57 km/h à une altitude de vol de 100 mètres. Ainsi, ce 25 juillet 1909, Louis Blériot est le premier à traverser la Manche par les airs, en décollant au lever du soleil, condition exigée par le Daily Mail, qui est à l’origine du défi et qui lui remettra la somme de 25.000 Francs-or mise en jeu. Malgré une blessure au pied, et ne sachant pas nager, il effectue la traversée, ralliant le lieu-dit Les Baraques près de Calais à Douvres en Angleterre, aux commandes du Blériot XI qu’il a conçu en collaboration avec Raymond Saulnier. La visibilité étant moyenne au départ, il s’oriente sans boussole en s’aidant de la trajectoire des bateaux reliant la France et la Grande-Bretagne, avant de pouvoir distinguer les falaises près de Douvres. La puissance de son moteur lui permet à peine de monter plus haut que ces dernières. Après un virage vers l’est, il revient à l’ouest pour finalement trouver le champ et atterrir sur les côtes anglaises, où l’attend le journaliste français Charles Fontaine muni d’un grand drapeau tricolore qu’il agite, et son photographe Marcel Marmier. À 5h12, après un virage, c’est chose faite : Blériot coupe le moteur sur le sol anglais. En une trentaine de minutes, la traversée a été réalisée mais fidèle à son habitude, Louis Blériot endommage le train de son appareil à l’atterrissage et une pale de l’hélice a été brisée, mais Blériot est sorti indemne. Désormais l’Angleterre n’est plus une île ! La Manche venait d’être vaincue par un plus lourd que l’air. La capitale britannique salue l’exploit de Louis Blériot, devenu mondialement célèbre, avant son retour en France. Un vol qui fera sa gloire, abondamment relayé par la presse de l’époque. Les jours qui suivent ne seront qu’honneurs, réceptions et fêtes. L’événement a un retentissement mondial. Pour Blériot, c’était la consécration mais aussi le soulagement car depuis quelques années, il avait dépensé la quasi-totalité de sa fortune pour concevoir et construire une dizaine de prototypes aux destins plus ou moins heureux. Cette réussite va le propulser et lui éviter la faillite. Du jour au lendemain, les commandes de son Blériot XI affluent du monde entier et l’armée commence sérieusement à s’intéresser à ce nouveau mode de déplacement. La traversée de la Manche réussie, le fidèle Alfred Leblanc lui avance les fonds pour lancer rapidement la fabrication en série du modèle de cette traversée. L’ingénieur va se lancer dans la production, s’installant sur le terrain de Buc, en région parisienne, non loin de Toussus-le-Noble. Après son exploit, le 24 novembre 1909, Blériot crée une école de pilotage à Pau (dont le plus prestigieux élève fut Guynemer) qui fonctionnera jusqu’en novembre 1913. Ville choisie à cause de sa situation tout à fait exceptionnelle et parce qu’il y règne une température idéale, et qu’il a connue lors de son service militaire à Tarbes, et où il s’est marié non loin à Bagnères. Le terrain qu’il choisit est situé sur les landes de Pont-Long à 10 km au nord de Pau, à Lescar. C’est un terrain vague à peu près rectangulaire, long de 1800 mètres et large de 500 mètres environ, couvert d’ajoncs, d’où les eaux s’écoulaient vers le nord-ouest. Il y avait jalonné une ligne médiane via deux pylônes espacés de 1250 mètres, et dégagé, entre cette médiane et les limites du terrain, une piste large de 100 mètres devant les hangars, réduite à 25 mètres vers les extrémités et se refermant sur elle-même en contournant les pylônes. Après l’exploit qui le rendit célèbre dans le monde entier, Blériot participe à la Grande Semaine d’Aviation de la Champagne fin août 1909. Le 28 août 1909, il bat le record du monde de vitesse au Meeting de Champagne à Reims, sur Blériot XI. Le 7 octobre 1909, le gouvernement décide de décerner à 16 pionniers de l’aviation un brevet de pilote. La délivrance de ces brevets est effectuée par ordre alphabétique et Louis Blériot bénéficie ainsi au brevet n°1. L’instauration du brevet de pilote intervient le 1er janvier 1910. Le 10 octobre 1909, Louis Blériot fonde la Compagnie Générale Transaérienne (CGT). Le 30 octobre 1909, le Français Louis Blériot effectue le premier vol en avion à Bucarest en Roumanie. L’appareil avec lequel il avait accompli son exploit, et qui portait désormais le nom de Calais-Douvres, fut cédé au journal Le Matin pour la somme de 10.000 Francs représentant son prix de construction. Le 13 octobre 1909, le journal Le Matin offre cet aéroplane au Conservatoire des arts et métiers qu’il n’a depuis jamais quitté. La carrière de Blériot en tant que pilote se termina, en décembre 1909, d’une façon assez tragique. Au cours d’une démonstration sur le Blériot XII, exécutée à Constantinople, il se trouva pris dans de violentes rafales de vent, qui le plaquèrent au sol. Le pionnier français victime de son 32e accident (accidents qui lui ont valu le surnom de « roi de la casse » ou « l’homme qui tombe toujours » par la presse), s’en tira avec quelques côtes enfoncées et de nombreuses contusions. Sa décision était prise. Désormais, il ne volera plus que sporadiquement pour se concentrer sur le développement et l’industrialisation de ses machines. En août 1914, Louis Blériot et d’autres industriels reprennent les actifs de la Société de Production des Avions Déperdussin (SPAD), tombée en faillite, pour en faire la Société Pour l’Aviation et ses Dérivés (SPAD). L’ingénieur en charge du bureau d’études, Louis Béchereau, développera plusieurs avions de chasse dont les fameux SPAD S.VII et SPAD S.XIII qui équiperont un grand nombre d’escadrilles françaises. En 1917, les Établissements Blériot aéronautique et SPAD assurent 10% de la production d’avions en France. Blériot achète des sites industriels hors de Paris comme à Suresnes. Pendant la guerre, ce sont des milliers d’avions qui sortiront des ateliers Blériot de Suresnes et, en particulier, plus de 11.000 chasseurs SPAD, essentiellement dotés de moteurs Gnome et Rhône. Blériot devient le banquier de ses sociétés et fait des placements considérables dans l’industrie des loisirs, en particulier à Monte-Carlo. Louis Blériot devient donc un important industriel dans le domaine aéronautique, avec ses usines à Suresnes. Après la guerre, il se lance dans la fabrication de motos, avec un succès très mitigé. Il continue de fabriquer des avions, les avions SPAD, mais comptant sur les commandes de l’État, lequel révisa le contrat à la baisse, Blériot dû bientôt fermer ses usines. En 1936, le gouvernement nationalise les usines Blériot. La Société Blériot aéronautique est absorbée par la Société Nationale des Constructions Aéronautiques du Sud-Ouest (SNCASO). Louis Blériot ne supporta pas cette décision et cinq jours après la date effective, terrassé par le chagrin, il meurt précocement le 1er août 1936, à son domicile au 288, boulevard Saint-Germain, emporté par une crise cardiaque. La France rendra hommage à l’homme de la traversée de la Manche par des funérailles nationales le 5 août 1936, en l’église Saint-Louis des Invalides. Les honneurs militaires lui seront rendus par un détachement du 34e régiment d’Aviation du Bourget. L’éloge funèbre étant prononcé par le ministre de l’Air, Pierre Cot. Il sera inhumé au cimetière des Gonards à Versailles, dans le caveau de famille. Parmi ces nombreux « fous volants » de l’époque, qui éblouissaient le public, en particulier en France, Blériot se distingue comme le « père de l’aéronautique ». Ayant fait fortune en inventant les phares pour permettre aux automobiles de rouler la nuit, il aura réinvesti tous ses bénéfices dans des prototypes qu’il améliore avec le « manche à balai ». Blériot est à l’origine de la « cloche », ancêtre du manche à balai centralisant les commandes et permettant de contrôler l’altitude et le cap de l’avion. Il a aussi eu l’idée d’un « Salon de la Locomotion Aérienne ». Il sera le premier à fabriquer en série des avions, qui serviront à l’aéropostale, au transport aérien, puis... à la Première Guerre mondiale. Et ensuite seulement viendront les lignes commerciales et les applications civiles... Louis Blériot aura fait notablement progresser la construction et l’expérimentation des aéroplanes. En 1911, l’Aéro-club français fera installer une stèle commémorant l’événement du 25 juillet 1909, au lieu-dit « Les Baraques-Plage », pas très loin de la zone de l’envol. Depuis le décès le 1er août 1936 de Louis Blériot, « Les Baraques-Plage » se nomme « Blériot-Plage ». Le monument se trouve actuellement à l’angle de la rue Guynemer, prolongée par la rue Sémaphore, et du CD 940 reliant Calais à Sangatte. La médaille Louis Blériot est délivrée en l’honneur d’un événement en rapport avec l’aviation décernée par la Fédération aéronautique internationale (FAI) depuis 1936 en l’honneur de Louis Blériot. L’avion qui a été utilisé dans la traversée de la Manche est aujourd’hui conservé au Musée des Arts et Métiers à Paris. En mai 1927, Blériot, le pionnier de la Manche, est la première personne que Charles Lindbergh demandera à voir à l’issue de sa traversée de l’Atlantique Nord à bord de son avion Spirit of Saint Louis. Louis Blériot était très attaché aux Hautes-Pyrénées puisqu’il s’éprit de Jeanne Alicia Védère, née en 1883, fille de colonel à la retraite, originaire de Gerde, qu’il épousa le 21 février 1901 à Bagnères-de-Bigorre, alors âgés respectivement de 18 et 29 ans et dont il avait fait la connaissance à Tarbes, lors de son service militaire. Installés boulevard Maillot à Neuilly-sur-Seine, ils vont avoir six enfants, trois garçons, Louis, Marcel, Jean et trois filles, Simone, Ginette et Nelly. Louis est taciturne et renfermé, Alicia, son épouse est bavarde, enthousiaste et pleine d’entrain : un couple complémentaire. Il fut tout de suite adopté en Bigorre, où il effectua de nombreuses visites dans le secteur de Bagnères et de Cauterets. Les aviateurs de son école de pilotage de Pau l’accompagnaient souvent. Les pilotes des avions Blériot survoleront régulièrement le département des Hautes-Pyrénées en 1910 et 1911. Le 3 février 1911, Blériot fait un atterrissage remarqué entre les villages de Gerde et Asté, tout à côté de Bagnères. De quoi donner de nouvelles idées à notre ingénieur Pierre-Georges Latécoère, centralien comme lui, né à Bagnères-de-Bigorre en 1883 ! Malgré des conditions météo épouvantables en ce mois de février, Blériot réussit son atterrissage. Son épouse, les aviateurs Leblanc et Aubrun l’attendaient. C’est ensuite Leblanc qui, dix minutes après, montait sur l’oiseau mécanique et regagnait Pau par la voie des airs. Blériot et sa femme sont rentrés à Bagnères-de-Bigorre en automobile, longuement ovationnés sur leur parcours. En 1913, Louis Blériot et son épouse se sont essayés à la luge et au bobsleigh à Cauterets. Sur une maison de la rue Saint-Blaise à Bagnères-de-Bigorre, est accrochée cette plaque : « L’aviateur Louis Blériot (1872-1936) a habité cette maison avec sa famille Bagnéraise. » Madame Louis Blériot décèdera le 13 mars 1963. Madame Louis Blériot fut de toutes les manifestations et inaugurations aux côtés de son héroïque mari, l’accompagnant ainsi jusqu’en 1936 et le représentant très dignement après sa mort. C’était une jolie femme, toujours vêtue très élégamment et coiffée d’un large chapeau à la mode de l’époque. À cela s’ajoutait son immuable sourire qui la rendait agréable à regarder. Elle se disait la mascotte de son ingénieur, inventeur et pilote aviateur. Il la faisait frémir de peur à chacun de ses essais en vol, par ses nombreuses chutes parfois très sérieuses qui le faisaient appeler "l’homme qui tombe toujours". Madame Louis Blériot s’était rendue à Blériot-Plage le 25 juillet 1959 à l’occasion du cinquantenaire de la traversée de la Manche. Ce sera là sa dernière visite sur les terres qui ont vu le décollage de son illustre mari. Le 13 mars 1963, elle décédait à l’âge de quatre-vingt ans, en son domicile parisien, entourée de l’affection de ses enfants et petits-enfants. Le père Grignon qui avait abrité le Blériot XI de la traversée avait eu ces mots : "Madame Blériot fut, pendant les jours qui ont précédé le départ, une aide précieuse pour son mari avec lequel elle venait chaque jour aux Baraques, se montrant aussi convaincue que lui de sa réussite, croyant en lui et en ses rêves. "BORDE Henri (1888-1958)
Peintre et sculpteur
 Henri BORDE, né le 4 septembre 1888 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 10 avril 1958 à Tarbes, à l’âge de 70 ans. Après des études secondaires au Lycée de Mont-de-Marsan, se destinant à la magistrature à l’instar de son père, il abandonne les études de droit pour se consacrer à la sculpture puis à la peinture, qu’il va étudier à Paris. Il commença à peindre en 1910, mais il fut d’abord sculpteur et c’est sous le parrainage du sculpteur originaire de Mont-de-Marsan, Charles Despiau, qu’il exposa au Salon d’Automne. Ce salon qui sera dominé après la Première Guerre mondiale par les œuvres des peintres de Montparnasse : Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Georges Braque et Georges Gimel. En 1909, préférant sa région aux fastes et excentricités de la capitale, il s’installa définitivement à Tarbes « au pays », où il fut professeur à l’École des Arts de la ville (aussi nommée l’École des beaux-arts). Il forma de nombreux élèves, dont Michel Zeller galeriste à Tarbes. Il aménagea son atelier rue Soult et réalisera des commandes publiques : il peindra les voûtes de la cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède avec l’ensemble de ses Anges musiciens et les scènes de la vie religieuse. Il réalisera deux fontaines sur les allées de Tarbes et les monuments aux morts de Juillan, Sarrancolin et Sarriac-Bigorre ainsi que la décoration d’une partie de la grande salle de réunion de la Chambre de commerce de la ville et celle du pavillon des trois B à l’Exposition universelle en 1937. Ses nombreux dessins trahissent la recherche de formes propre au sculpteur. Sa vie se partagera entre Tarbes, sa maison de campagne d’Ibos et le Pays basque, où il fera de fréquents séjours. Sa peinture personnelle, marquée par le classicisme, trouve des accents modernes pour représenter les aspects variés de la Bigorre, tant dans les paysages que dans les scènes de genre qui atteignent souvent une simplicité monumentale. Par-dessus tout, il aimait peindre des paysages, des scènes typiques de sa Bigorre, les gens de son entourage ou d’ailleurs, qu’ils soient de la montagne ou de la campagne, sans oublier ceux de la bourgeoisie tarbaise. Il n’aimait pas qu’on l’encense. Il se plaisait à dire : "La peinture, on n’en parle pas, on la regarde". Plusieurs de ses peintures et de ses œuvres se trouvent réparties dans les musées de Bagnères-de-Bigorre, Bayonne, Pau et Tarbes. Cet artiste complet de la fin de l’épisode romantique, qualifié de moderne, honore la Bigorre. Une place de Tarbes porte son nom (à l’entrée du jardin Massey), un livre lui a été consacré et des hommages publics à son talent lui ont été rendus.
Henri BORDE, né le 4 septembre 1888 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 10 avril 1958 à Tarbes, à l’âge de 70 ans. Après des études secondaires au Lycée de Mont-de-Marsan, se destinant à la magistrature à l’instar de son père, il abandonne les études de droit pour se consacrer à la sculpture puis à la peinture, qu’il va étudier à Paris. Il commença à peindre en 1910, mais il fut d’abord sculpteur et c’est sous le parrainage du sculpteur originaire de Mont-de-Marsan, Charles Despiau, qu’il exposa au Salon d’Automne. Ce salon qui sera dominé après la Première Guerre mondiale par les œuvres des peintres de Montparnasse : Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Georges Braque et Georges Gimel. En 1909, préférant sa région aux fastes et excentricités de la capitale, il s’installa définitivement à Tarbes « au pays », où il fut professeur à l’École des Arts de la ville (aussi nommée l’École des beaux-arts). Il forma de nombreux élèves, dont Michel Zeller galeriste à Tarbes. Il aménagea son atelier rue Soult et réalisera des commandes publiques : il peindra les voûtes de la cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède avec l’ensemble de ses Anges musiciens et les scènes de la vie religieuse. Il réalisera deux fontaines sur les allées de Tarbes et les monuments aux morts de Juillan, Sarrancolin et Sarriac-Bigorre ainsi que la décoration d’une partie de la grande salle de réunion de la Chambre de commerce de la ville et celle du pavillon des trois B à l’Exposition universelle en 1937. Ses nombreux dessins trahissent la recherche de formes propre au sculpteur. Sa vie se partagera entre Tarbes, sa maison de campagne d’Ibos et le Pays basque, où il fera de fréquents séjours. Sa peinture personnelle, marquée par le classicisme, trouve des accents modernes pour représenter les aspects variés de la Bigorre, tant dans les paysages que dans les scènes de genre qui atteignent souvent une simplicité monumentale. Par-dessus tout, il aimait peindre des paysages, des scènes typiques de sa Bigorre, les gens de son entourage ou d’ailleurs, qu’ils soient de la montagne ou de la campagne, sans oublier ceux de la bourgeoisie tarbaise. Il n’aimait pas qu’on l’encense. Il se plaisait à dire : "La peinture, on n’en parle pas, on la regarde". Plusieurs de ses peintures et de ses œuvres se trouvent réparties dans les musées de Bagnères-de-Bigorre, Bayonne, Pau et Tarbes. Cet artiste complet de la fin de l’épisode romantique, qualifié de moderne, honore la Bigorre. Une place de Tarbes porte son nom (à l’entrée du jardin Massey), un livre lui a été consacré et des hommages publics à son talent lui ont été rendus.
 Henri BORDE, né le 4 septembre 1888 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 10 avril 1958 à Tarbes, à l’âge de 70 ans. Après des études secondaires au Lycée de Mont-de-Marsan, se destinant à la magistrature à l’instar de son père, il abandonne les études de droit pour se consacrer à la sculpture puis à la peinture, qu’il va étudier à Paris. Il commença à peindre en 1910, mais il fut d’abord sculpteur et c’est sous le parrainage du sculpteur originaire de Mont-de-Marsan, Charles Despiau, qu’il exposa au Salon d’Automne. Ce salon qui sera dominé après la Première Guerre mondiale par les œuvres des peintres de Montparnasse : Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Georges Braque et Georges Gimel. En 1909, préférant sa région aux fastes et excentricités de la capitale, il s’installa définitivement à Tarbes « au pays », où il fut professeur à l’École des Arts de la ville (aussi nommée l’École des beaux-arts). Il forma de nombreux élèves, dont Michel Zeller galeriste à Tarbes. Il aménagea son atelier rue Soult et réalisera des commandes publiques : il peindra les voûtes de la cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède avec l’ensemble de ses Anges musiciens et les scènes de la vie religieuse. Il réalisera deux fontaines sur les allées de Tarbes et les monuments aux morts de Juillan, Sarrancolin et Sarriac-Bigorre ainsi que la décoration d’une partie de la grande salle de réunion de la Chambre de commerce de la ville et celle du pavillon des trois B à l’Exposition universelle en 1937. Ses nombreux dessins trahissent la recherche de formes propre au sculpteur. Sa vie se partagera entre Tarbes, sa maison de campagne d’Ibos et le Pays basque, où il fera de fréquents séjours. Sa peinture personnelle, marquée par le classicisme, trouve des accents modernes pour représenter les aspects variés de la Bigorre, tant dans les paysages que dans les scènes de genre qui atteignent souvent une simplicité monumentale. Par-dessus tout, il aimait peindre des paysages, des scènes typiques de sa Bigorre, les gens de son entourage ou d’ailleurs, qu’ils soient de la montagne ou de la campagne, sans oublier ceux de la bourgeoisie tarbaise. Il n’aimait pas qu’on l’encense. Il se plaisait à dire : "La peinture, on n’en parle pas, on la regarde". Plusieurs de ses peintures et de ses œuvres se trouvent réparties dans les musées de Bagnères-de-Bigorre, Bayonne, Pau et Tarbes. Cet artiste complet de la fin de l’épisode romantique, qualifié de moderne, honore la Bigorre. Une place de Tarbes porte son nom (à l’entrée du jardin Massey), un livre lui a été consacré et des hommages publics à son talent lui ont été rendus.
Henri BORDE, né le 4 septembre 1888 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 10 avril 1958 à Tarbes, à l’âge de 70 ans. Après des études secondaires au Lycée de Mont-de-Marsan, se destinant à la magistrature à l’instar de son père, il abandonne les études de droit pour se consacrer à la sculpture puis à la peinture, qu’il va étudier à Paris. Il commença à peindre en 1910, mais il fut d’abord sculpteur et c’est sous le parrainage du sculpteur originaire de Mont-de-Marsan, Charles Despiau, qu’il exposa au Salon d’Automne. Ce salon qui sera dominé après la Première Guerre mondiale par les œuvres des peintres de Montparnasse : Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Georges Braque et Georges Gimel. En 1909, préférant sa région aux fastes et excentricités de la capitale, il s’installa définitivement à Tarbes « au pays », où il fut professeur à l’École des Arts de la ville (aussi nommée l’École des beaux-arts). Il forma de nombreux élèves, dont Michel Zeller galeriste à Tarbes. Il aménagea son atelier rue Soult et réalisera des commandes publiques : il peindra les voûtes de la cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède avec l’ensemble de ses Anges musiciens et les scènes de la vie religieuse. Il réalisera deux fontaines sur les allées de Tarbes et les monuments aux morts de Juillan, Sarrancolin et Sarriac-Bigorre ainsi que la décoration d’une partie de la grande salle de réunion de la Chambre de commerce de la ville et celle du pavillon des trois B à l’Exposition universelle en 1937. Ses nombreux dessins trahissent la recherche de formes propre au sculpteur. Sa vie se partagera entre Tarbes, sa maison de campagne d’Ibos et le Pays basque, où il fera de fréquents séjours. Sa peinture personnelle, marquée par le classicisme, trouve des accents modernes pour représenter les aspects variés de la Bigorre, tant dans les paysages que dans les scènes de genre qui atteignent souvent une simplicité monumentale. Par-dessus tout, il aimait peindre des paysages, des scènes typiques de sa Bigorre, les gens de son entourage ou d’ailleurs, qu’ils soient de la montagne ou de la campagne, sans oublier ceux de la bourgeoisie tarbaise. Il n’aimait pas qu’on l’encense. Il se plaisait à dire : "La peinture, on n’en parle pas, on la regarde". Plusieurs de ses peintures et de ses œuvres se trouvent réparties dans les musées de Bagnères-de-Bigorre, Bayonne, Pau et Tarbes. Cet artiste complet de la fin de l’épisode romantique, qualifié de moderne, honore la Bigorre. Une place de Tarbes porte son nom (à l’entrée du jardin Massey), un livre lui a été consacré et des hommages publics à son talent lui ont été rendus.BOURDETTE Jean (1818-1911)
Historien régionaliste, enseignant et naturaliste
 Jean BOURDETTE, né le 12 février 1818 à Argelès-Gazost et mort à Toulouse le 29 septembre 1911, à l’âge de 93 ans. Ingénieur agronome, diplômé de l’Institution royale agronomique de Grignon, il passa son enfance à Argelès-Gazost. Auteur connu pour ses travaux d’historien régionaliste consacrés au Lavedan, dont il commença la publication après l’âge de 70 ans, il est surtout réputé pour ses "Notices et Annales du Lavedan". Après une carrière professionnelle à Paris comme enseignant en sciences naturelles, collaborateur scientifique de l’astronome et mathématicien Le Verrier, directeur de la Mission Égyptienne, en 1878 il se retirera à Toulouse devenant membre de la Société botanique de France. Mais il semble que sa reconversion comme botaniste n’ait pas été très active, n’ayant publié que six articles dans ce domaine. Sa passion première étant surtout de faire connaître l’histoire du Lavedan, son pays d’enfance. Ainsi tous ses ouvrages seront consacrés à l’histoire du Lavedan et à quelques autres sites ou entités géographiques de Bigorre. Son œuvre a fait l’objet, en 1992, de plusieurs articles d’auteurs différents rassemblés sur le thème "Autour de Jean Bourdette" et publiés par la "Société d’Études des Sept Vallées". Il s’intéressa aussi à la lexicologie du gascon parlé en Lavedan, en relation avec Miquèu de Camelat, le poète et dramaturge d’Arrens-Marsous. Un manuscrit de quelque 1404 pages en 4 volumes est conservé dans Le musée Pyrénéen de Lourdes, qui s’intitule : Essai de vocabulaire du Gascon en Lavedan. Trois autres ouvrages témoignent aussi de recherches historiques sur d’autres territoires que le Lavedan : Le château et la ville de Lourdes, Notice des Barons des Angles et Notice du Nébouzan. Il est souvent cité comme l’historien du Lavedan. Sa tombe se trouve au cimetière d’Argelès-Gazost. Une rue et une école primaire portent son nom à Argelès-Gazost ainsi qu’une rue à Lourdes.
Jean BOURDETTE, né le 12 février 1818 à Argelès-Gazost et mort à Toulouse le 29 septembre 1911, à l’âge de 93 ans. Ingénieur agronome, diplômé de l’Institution royale agronomique de Grignon, il passa son enfance à Argelès-Gazost. Auteur connu pour ses travaux d’historien régionaliste consacrés au Lavedan, dont il commença la publication après l’âge de 70 ans, il est surtout réputé pour ses "Notices et Annales du Lavedan". Après une carrière professionnelle à Paris comme enseignant en sciences naturelles, collaborateur scientifique de l’astronome et mathématicien Le Verrier, directeur de la Mission Égyptienne, en 1878 il se retirera à Toulouse devenant membre de la Société botanique de France. Mais il semble que sa reconversion comme botaniste n’ait pas été très active, n’ayant publié que six articles dans ce domaine. Sa passion première étant surtout de faire connaître l’histoire du Lavedan, son pays d’enfance. Ainsi tous ses ouvrages seront consacrés à l’histoire du Lavedan et à quelques autres sites ou entités géographiques de Bigorre. Son œuvre a fait l’objet, en 1992, de plusieurs articles d’auteurs différents rassemblés sur le thème "Autour de Jean Bourdette" et publiés par la "Société d’Études des Sept Vallées". Il s’intéressa aussi à la lexicologie du gascon parlé en Lavedan, en relation avec Miquèu de Camelat, le poète et dramaturge d’Arrens-Marsous. Un manuscrit de quelque 1404 pages en 4 volumes est conservé dans Le musée Pyrénéen de Lourdes, qui s’intitule : Essai de vocabulaire du Gascon en Lavedan. Trois autres ouvrages témoignent aussi de recherches historiques sur d’autres territoires que le Lavedan : Le château et la ville de Lourdes, Notice des Barons des Angles et Notice du Nébouzan. Il est souvent cité comme l’historien du Lavedan. Sa tombe se trouve au cimetière d’Argelès-Gazost. Une rue et une école primaire portent son nom à Argelès-Gazost ainsi qu’une rue à Lourdes.
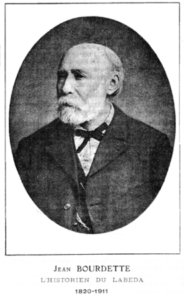 Jean BOURDETTE, né le 12 février 1818 à Argelès-Gazost et mort à Toulouse le 29 septembre 1911, à l’âge de 93 ans. Ingénieur agronome, diplômé de l’Institution royale agronomique de Grignon, il passa son enfance à Argelès-Gazost. Auteur connu pour ses travaux d’historien régionaliste consacrés au Lavedan, dont il commença la publication après l’âge de 70 ans, il est surtout réputé pour ses "Notices et Annales du Lavedan". Après une carrière professionnelle à Paris comme enseignant en sciences naturelles, collaborateur scientifique de l’astronome et mathématicien Le Verrier, directeur de la Mission Égyptienne, en 1878 il se retirera à Toulouse devenant membre de la Société botanique de France. Mais il semble que sa reconversion comme botaniste n’ait pas été très active, n’ayant publié que six articles dans ce domaine. Sa passion première étant surtout de faire connaître l’histoire du Lavedan, son pays d’enfance. Ainsi tous ses ouvrages seront consacrés à l’histoire du Lavedan et à quelques autres sites ou entités géographiques de Bigorre. Son œuvre a fait l’objet, en 1992, de plusieurs articles d’auteurs différents rassemblés sur le thème "Autour de Jean Bourdette" et publiés par la "Société d’Études des Sept Vallées". Il s’intéressa aussi à la lexicologie du gascon parlé en Lavedan, en relation avec Miquèu de Camelat, le poète et dramaturge d’Arrens-Marsous. Un manuscrit de quelque 1404 pages en 4 volumes est conservé dans Le musée Pyrénéen de Lourdes, qui s’intitule : Essai de vocabulaire du Gascon en Lavedan. Trois autres ouvrages témoignent aussi de recherches historiques sur d’autres territoires que le Lavedan : Le château et la ville de Lourdes, Notice des Barons des Angles et Notice du Nébouzan. Il est souvent cité comme l’historien du Lavedan. Sa tombe se trouve au cimetière d’Argelès-Gazost. Une rue et une école primaire portent son nom à Argelès-Gazost ainsi qu’une rue à Lourdes.
Jean BOURDETTE, né le 12 février 1818 à Argelès-Gazost et mort à Toulouse le 29 septembre 1911, à l’âge de 93 ans. Ingénieur agronome, diplômé de l’Institution royale agronomique de Grignon, il passa son enfance à Argelès-Gazost. Auteur connu pour ses travaux d’historien régionaliste consacrés au Lavedan, dont il commença la publication après l’âge de 70 ans, il est surtout réputé pour ses "Notices et Annales du Lavedan". Après une carrière professionnelle à Paris comme enseignant en sciences naturelles, collaborateur scientifique de l’astronome et mathématicien Le Verrier, directeur de la Mission Égyptienne, en 1878 il se retirera à Toulouse devenant membre de la Société botanique de France. Mais il semble que sa reconversion comme botaniste n’ait pas été très active, n’ayant publié que six articles dans ce domaine. Sa passion première étant surtout de faire connaître l’histoire du Lavedan, son pays d’enfance. Ainsi tous ses ouvrages seront consacrés à l’histoire du Lavedan et à quelques autres sites ou entités géographiques de Bigorre. Son œuvre a fait l’objet, en 1992, de plusieurs articles d’auteurs différents rassemblés sur le thème "Autour de Jean Bourdette" et publiés par la "Société d’Études des Sept Vallées". Il s’intéressa aussi à la lexicologie du gascon parlé en Lavedan, en relation avec Miquèu de Camelat, le poète et dramaturge d’Arrens-Marsous. Un manuscrit de quelque 1404 pages en 4 volumes est conservé dans Le musée Pyrénéen de Lourdes, qui s’intitule : Essai de vocabulaire du Gascon en Lavedan. Trois autres ouvrages témoignent aussi de recherches historiques sur d’autres territoires que le Lavedan : Le château et la ville de Lourdes, Notice des Barons des Angles et Notice du Nébouzan. Il est souvent cité comme l’historien du Lavedan. Sa tombe se trouve au cimetière d’Argelès-Gazost. Une rue et une école primaire portent son nom à Argelès-Gazost ainsi qu’une rue à Lourdes.BOUSSEMART Jean-Jacques (1963-XXXX)
Sprinteur spécialiste du 200 mètres, finaliste olympique
 Jean-Jacques BOUSSEMART, né le 11 avril 1963 à Lourdes, est un athlète spécialiste des épreuves de sprint. Licencié au Bordeaux EC, il remporte le 200 m des Championnats de France 1983 dans le temps de 20''60. Il participe aux Championnats du monde d'athlétisme 1983 à Helsinki et se classe huitième de l'épreuve du relais 4 x 100 mètres. En juin 1984, il remporte son deuxième titre national en 20''46, et établit le 1er juillet 1984 à Villeneuve-d'Ascq la meilleure performance de sa carrière sur 200 m avec le temps de 20''41. Sélectionné pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, il se classe sixième de la finale du 200 mètres (20''55) remportée par Carl Lewis et sixième du relais 4 x 100 m. Son palmarès : 22 sélections en équipe de France dont les titres de champion de France scolaire 1979, 1980, 1981 et 1982, champion de France cadet du 200 m en 1980, champion de France junior du 100 m en 1981, du 200 m en 1982, champion de France du 200 m en 1983 et 1984. Ses records personnels : 100 m : 10''33 ; 200 m : 20''41 ; 400 m : 45''73 ; 400 m haies : 50''97 ; 60 m : 6''67. Recordman de France du relais 4 x 200 m. Il exerce actuellement comme professeur d'éducation physique et sportive (EPS) au lycée Gustave Eiffel de Bordeaux. Il aura été 17 fois champion de France, toutes catégories confondues, aura participé à de nombreux championnats du monde et d’Europe et passé douze ans en équipe de France. Sa carrière sera mise sous l’éteignoir en raison d’une fracture de fatigue contractée en 1985. À 22 ans, il devra stopper le sprint et se lancera sur le 400 m, une distance qu’il n’affectionnera pas. Ses parents originaires du nord de la France avaient été instituteurs à Marsous et à Bun puis à Argelès-Gazost. Et leur fils Jean-Jacques restera l’un des rares français à avoir disputé une finale olympique. C’était en 1984 aux JO de Los Angeles.
Jean-Jacques BOUSSEMART, né le 11 avril 1963 à Lourdes, est un athlète spécialiste des épreuves de sprint. Licencié au Bordeaux EC, il remporte le 200 m des Championnats de France 1983 dans le temps de 20''60. Il participe aux Championnats du monde d'athlétisme 1983 à Helsinki et se classe huitième de l'épreuve du relais 4 x 100 mètres. En juin 1984, il remporte son deuxième titre national en 20''46, et établit le 1er juillet 1984 à Villeneuve-d'Ascq la meilleure performance de sa carrière sur 200 m avec le temps de 20''41. Sélectionné pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, il se classe sixième de la finale du 200 mètres (20''55) remportée par Carl Lewis et sixième du relais 4 x 100 m. Son palmarès : 22 sélections en équipe de France dont les titres de champion de France scolaire 1979, 1980, 1981 et 1982, champion de France cadet du 200 m en 1980, champion de France junior du 100 m en 1981, du 200 m en 1982, champion de France du 200 m en 1983 et 1984. Ses records personnels : 100 m : 10''33 ; 200 m : 20''41 ; 400 m : 45''73 ; 400 m haies : 50''97 ; 60 m : 6''67. Recordman de France du relais 4 x 200 m. Il exerce actuellement comme professeur d'éducation physique et sportive (EPS) au lycée Gustave Eiffel de Bordeaux. Il aura été 17 fois champion de France, toutes catégories confondues, aura participé à de nombreux championnats du monde et d’Europe et passé douze ans en équipe de France. Sa carrière sera mise sous l’éteignoir en raison d’une fracture de fatigue contractée en 1985. À 22 ans, il devra stopper le sprint et se lancera sur le 400 m, une distance qu’il n’affectionnera pas. Ses parents originaires du nord de la France avaient été instituteurs à Marsous et à Bun puis à Argelès-Gazost. Et leur fils Jean-Jacques restera l’un des rares français à avoir disputé une finale olympique. C’était en 1984 aux JO de Los Angeles.
 Jean-Jacques BOUSSEMART, né le 11 avril 1963 à Lourdes, est un athlète spécialiste des épreuves de sprint. Licencié au Bordeaux EC, il remporte le 200 m des Championnats de France 1983 dans le temps de 20''60. Il participe aux Championnats du monde d'athlétisme 1983 à Helsinki et se classe huitième de l'épreuve du relais 4 x 100 mètres. En juin 1984, il remporte son deuxième titre national en 20''46, et établit le 1er juillet 1984 à Villeneuve-d'Ascq la meilleure performance de sa carrière sur 200 m avec le temps de 20''41. Sélectionné pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, il se classe sixième de la finale du 200 mètres (20''55) remportée par Carl Lewis et sixième du relais 4 x 100 m. Son palmarès : 22 sélections en équipe de France dont les titres de champion de France scolaire 1979, 1980, 1981 et 1982, champion de France cadet du 200 m en 1980, champion de France junior du 100 m en 1981, du 200 m en 1982, champion de France du 200 m en 1983 et 1984. Ses records personnels : 100 m : 10''33 ; 200 m : 20''41 ; 400 m : 45''73 ; 400 m haies : 50''97 ; 60 m : 6''67. Recordman de France du relais 4 x 200 m. Il exerce actuellement comme professeur d'éducation physique et sportive (EPS) au lycée Gustave Eiffel de Bordeaux. Il aura été 17 fois champion de France, toutes catégories confondues, aura participé à de nombreux championnats du monde et d’Europe et passé douze ans en équipe de France. Sa carrière sera mise sous l’éteignoir en raison d’une fracture de fatigue contractée en 1985. À 22 ans, il devra stopper le sprint et se lancera sur le 400 m, une distance qu’il n’affectionnera pas. Ses parents originaires du nord de la France avaient été instituteurs à Marsous et à Bun puis à Argelès-Gazost. Et leur fils Jean-Jacques restera l’un des rares français à avoir disputé une finale olympique. C’était en 1984 aux JO de Los Angeles.
Jean-Jacques BOUSSEMART, né le 11 avril 1963 à Lourdes, est un athlète spécialiste des épreuves de sprint. Licencié au Bordeaux EC, il remporte le 200 m des Championnats de France 1983 dans le temps de 20''60. Il participe aux Championnats du monde d'athlétisme 1983 à Helsinki et se classe huitième de l'épreuve du relais 4 x 100 mètres. En juin 1984, il remporte son deuxième titre national en 20''46, et établit le 1er juillet 1984 à Villeneuve-d'Ascq la meilleure performance de sa carrière sur 200 m avec le temps de 20''41. Sélectionné pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, il se classe sixième de la finale du 200 mètres (20''55) remportée par Carl Lewis et sixième du relais 4 x 100 m. Son palmarès : 22 sélections en équipe de France dont les titres de champion de France scolaire 1979, 1980, 1981 et 1982, champion de France cadet du 200 m en 1980, champion de France junior du 100 m en 1981, du 200 m en 1982, champion de France du 200 m en 1983 et 1984. Ses records personnels : 100 m : 10''33 ; 200 m : 20''41 ; 400 m : 45''73 ; 400 m haies : 50''97 ; 60 m : 6''67. Recordman de France du relais 4 x 200 m. Il exerce actuellement comme professeur d'éducation physique et sportive (EPS) au lycée Gustave Eiffel de Bordeaux. Il aura été 17 fois champion de France, toutes catégories confondues, aura participé à de nombreux championnats du monde et d’Europe et passé douze ans en équipe de France. Sa carrière sera mise sous l’éteignoir en raison d’une fracture de fatigue contractée en 1985. À 22 ans, il devra stopper le sprint et se lancera sur le 400 m, une distance qu’il n’affectionnera pas. Ses parents originaires du nord de la France avaient été instituteurs à Marsous et à Bun puis à Argelès-Gazost. Et leur fils Jean-Jacques restera l’un des rares français à avoir disputé une finale olympique. C’était en 1984 aux JO de Los Angeles.BRAU Joseph (1891-1975)
Médecin radiologue, colonel honoraire de l’Armée française et résistant, déporté à Buchenwald.
 Joseph BRAU, né le 26 avril 1891 à Trébons et mort le 11 mai 1975 à Seignosse dans les Landes, à l’âge de 84 ans. Il est le cadet d'une famille de quatre enfants : Frédéric, Zéphire, Jean et Joseph. Joseph Brau intègre l'école publique avec deux ans de retard : il ne parle que le patois. Il obtient son certificat d'études secondaires du 1er degré en juillet 1906 à Toulouse, puis son baccalauréat en mars 1910 et son certificat d'études physiques, chimiques et naturelles en juillet de la même année, toujours à Toulouse. Reçu au concours d'entrée à l'École du service de santé des armées, il intègre ce qui deviendra plus tard l'École Santé navale de Lyon. Il obtient son diplôme en juillet 1914 puis soutient une thèse de doctorat en médecine en mars 1917, pendant la Première Guerre mondiale, et se spécialise en électroradiologie. Mobilisé comme médecin chef d’un hôpital auxiliaire dans le Jura le 19 septembre 1939, il y fait son devoir, comme il l’a déjà fait d’août 1914 à octobre 1919, sur divers fronts. Il est démobilisé en août 1940, rentre à son domicile de la région parisienne et s’engage, en 1941, avec son ami et associé à la clinique de la rue des Moulins à Coulommiers, le Dr Pierre Berson, dans le réseau de résistance « Hector » sous les ordres du capitaine Rouard, commandant les compagnies des vallées de la Marne, sous le pseudonyme de « Bertrand ». Combattant volontaire de la Résistance, membre des Forces françaises combattantes, grâce à sa carte professionnelle, il peut circuler dans des zones « interdites » et fournir ainsi aux alliés de précieuses informations comme les positions exactes des emplacements des matériels de lutte antiaérienne. Après le démantèlement du réseau en 1943, suite à une dénonciation, il décide de fuir la France par l’Espagne pour rejoindre Londres, mais il est arrêté à Bedous dans les Basses-Pyrénées, en juillet 1943, avant de pouvoir passer la frontière. Il redoute de ne pouvoir résister à la torture. Il est porteur de trop d'informations concernant la Résistance. Il tente donc de se suicider avec des médicaments et tombe dans un état comateux. Les Allemands le font soigner et le transfèrent au siège de la Gestapo, à Oloron-Sainte-Marie, pour y subir un interrogatoire et face à son refus de signer toute déposition rédigée en allemand, langue qu'il ne connaît pas, il sera emprisonné en août au Fort du Hâ à Bordeaux. En septembre, il est transféré à Compiègne, au Frontstalag 122, avant d’être déporté à Buchenwald dans le convoi I.145, parti le 28 octobre. Il arrive à Buchenwald le 31 octobre 1943, avec le matricule 31299. Après la quarantaine, il a la chance d’être nommé au Revier (baraquement destiné aux prisonniers malades des camps – ce mot était prononcé par les déportés français « revir »), dont il devient le premier médecin français. Le Dr Joseph Brau sait se faire accepter et reconnaître par sa compétence et son dévouement. Avant sa nomination, pour être admis au Revier, il fallait avoir une température élevée. Joseph Brau obtient l’admission de malades sans fièvre, sur la seule autorité de son diagnostic. Pour les déportés qui y sont admis, c’est une chance car, même si le lieu est dépourvu de moyens, les malades y trouvent la possibilité de ne pas participer à l’appel, d’échapper au travail et d’avoir quelques jours de repos qui peuvent leur sauver la vie. L’appareil de radio de Joseph Brau fonctionne au maximum, passant de trois clichés par jour à son arrivée à une cinquantaine à la libération du camp. Le docteur Joseph Brau sait toujours « interpréter » ses radios de façon à sauver le plus grand nombre de déportés du sort qui les attend. Au Revier, durant toute sa période d’emprisonnement, il s’attachera à améliorer l’existence des malades du camp, les conditions de vie des prisonniers et d'en sauver d'autres le plus possible. Dans le cadre du Comité des intérêts français (CIF), il est nommé président du Comité du corps médical français. Au Revier, des conférences médicales dans chaque langue sont organisées tous les samedis pour améliorer l’efficacité des diagnostics et des soins. Joseph Brau a la charge d’organiser les conférences en français. Le 12 avril 1945, le camp de Buchenwald est libéré. Le lieutenant-colonel Joseph Brau, le plus élevé en grade parmi les médecins détenus, est nommé médecin chef chargé de l’administration du Revier et du service de santé du camp par le colonel des Rangers de la troisième armée américaine. Fin avril, il est rapatrié avec les derniers déportés français hospitalisés au Revier, et il rapporte avec lui toutes les archives du Revier concernant les Français, qu’il remet aux autorités gouvernementales de son pays. A son retour, le Docteur Joseph Brau témoigne de la moralité de ses camarades d’infortune chaque fois que cela lui est demandé, en particulier au colonel Frédéric-Henri Manhès et à Marcel Paul, dont les actions dans le cadre du CIF sont, à plusieurs reprises, très sévèrement contestées après la Libération, et établit des certificats médicaux pour les anciens détenus qui le demandent. Revenu dans la vie civile, et en parallèle de son activité de médecin, il poursuit donc activement son militantisme contre le fascisme et celui pour le devoir de mémoire des camps. Il entretient des relations suivies avec nombre de ses anciens camarades d'infortune dont Ernst Busse (futur vice-ministre-président, ministre de l'Intérieur et secrétaire d’État aux Eaux et Forêts du Land de Thuringe), Marcel Paul (ministre de la Production industrielle de novembre 1945 à décembre 1946, dans les gouvernements de Charles de Gaulle, Félix Gouin et Georges Bidault), le colonel Frédéric-Henri Manhès, Albert Forcinal, le Dr Jean Rousset, le Dr Jean Lansac, Nicolas Simon dit « Gandhi », Aloïs Grimm. Il est membre du comité national de la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes (FNDIRP), membre de l'amicale de Buchenwald-Dora et Kommandos, qui deviendra l'Association française Buchenwald-Dora et Kommandos. Il prend sa retraite de médecin radiologue civil en 1956. En 1963, il reçoit à Berlin-Est la Médaille für Kämpfer gegen den Faschismus (médaille de la Lutte contre le fascisme) du Conseil des ministres de la RDA. Ses souvenirs détaillés de résistant et de déporté à Buchenwald sont consignés dans un livre, « Ici, chacun son dû (à tort ou à raison) », écrit en 1973 par Lucien Cariat, instituteur membre du groupe de résistance Vengeance, et dont Marcel Paul a rédigé l’introduction. Après la guerre, en 1955, il est élu conseiller général du canton de La Ferté-sous-Jouarre, dans le département de Seine-et-Marne, et réélu en 1961. Le 31 mars 1973, dans la cour de l'hôtel des Invalides à Paris, le président Georges Pompidou lui remet la Croix de Grand Officier de la Légion d’Honneur. Pendant les trente dernières années de sa vie Joseph Brau a l’habitude de passer tous ses moments de liberté en famille dans les Landes, à Hossegor puis à Seignosse, où il se retire définitivement en 1971, et où il meurt le 11 mai 1975. Durant sa vie, il se verra attribuer de nombreux titres et décorations : la croix de guerre avec palme (1917), une citation à l’ordre de la IVe armée, une citation à l’ordre de la 46e division d’occupation de Haute-Silésie (1921), la croix de guerre des TOE avec étoile d’argent (1922), la médaille commémorative de Haute-Silésie, la médaille coloniale agrafe Maroc (1924), promu chevalier de la Légion d’honneur (1925), la médaille d’argent de l’Académie de médecine, la médaille commémorative d’Orient (1926), le grade de médecin lieutenant-colonel (1940), la médaille commémorative d’Orient avec inscription « Orient », la croix de guerre 1939-1945, promu officier de la Légion d’honneur, une citation à l’ordre du corps d'armée (1947), la croix de guerre avec étoile de vermeil, la médaille d'honneur des épidémies (1948), élevé au rang de médecin colonel (1949), admission à l'honorariat du grade de colonel (1953), titre de Combattant volontaire de la Résistance (1953), attestation d’appartenance aux Forces françaises combattantes du réseau Hector (1956), promu commandeur de la Légion d’honneur en qualité de mutilé de guerre (1961), la croix de Guerre 1939-1945 avec palme, la médaille Kämpfer gegen den Faschismus 1933-1945 du Conseil des ministres de la RDA (1963), la médaille de la Reconnaissance de la FNDIRP (1967), la croix du combattant volontaire 1939-1945 (1968), élevé à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur (1973). La commune de La Ferté-sous-Jouarre a baptisé dans les années 1980 une de ses écoles maternelles du nom du Docteur Brau. Une plaque commémorative rappelant Joseph Brau a été apposée le 18 novembre 1995 sur le mur de l'école. Le samedi 11 avril 2015, à Trébons, en mémoire du Dr Joseph Brau (1891-1975), une plaque commémorative scellée sur la façade de sa maison natale a été dévoilée par Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, préfète des Hautes-Pyrénées, et Yves Pujo, maire de la commune. Le 7 juin 2016, le maire de Seignosse, et les élus de son équipe, ont inauguré une rue d’un nouveau quartier résidentiel de Seignosse, baptisée du patronyme de la famille de cet illustre résistant seignossais, le docteur Joseph Brau.
Joseph BRAU, né le 26 avril 1891 à Trébons et mort le 11 mai 1975 à Seignosse dans les Landes, à l’âge de 84 ans. Il est le cadet d'une famille de quatre enfants : Frédéric, Zéphire, Jean et Joseph. Joseph Brau intègre l'école publique avec deux ans de retard : il ne parle que le patois. Il obtient son certificat d'études secondaires du 1er degré en juillet 1906 à Toulouse, puis son baccalauréat en mars 1910 et son certificat d'études physiques, chimiques et naturelles en juillet de la même année, toujours à Toulouse. Reçu au concours d'entrée à l'École du service de santé des armées, il intègre ce qui deviendra plus tard l'École Santé navale de Lyon. Il obtient son diplôme en juillet 1914 puis soutient une thèse de doctorat en médecine en mars 1917, pendant la Première Guerre mondiale, et se spécialise en électroradiologie. Mobilisé comme médecin chef d’un hôpital auxiliaire dans le Jura le 19 septembre 1939, il y fait son devoir, comme il l’a déjà fait d’août 1914 à octobre 1919, sur divers fronts. Il est démobilisé en août 1940, rentre à son domicile de la région parisienne et s’engage, en 1941, avec son ami et associé à la clinique de la rue des Moulins à Coulommiers, le Dr Pierre Berson, dans le réseau de résistance « Hector » sous les ordres du capitaine Rouard, commandant les compagnies des vallées de la Marne, sous le pseudonyme de « Bertrand ». Combattant volontaire de la Résistance, membre des Forces françaises combattantes, grâce à sa carte professionnelle, il peut circuler dans des zones « interdites » et fournir ainsi aux alliés de précieuses informations comme les positions exactes des emplacements des matériels de lutte antiaérienne. Après le démantèlement du réseau en 1943, suite à une dénonciation, il décide de fuir la France par l’Espagne pour rejoindre Londres, mais il est arrêté à Bedous dans les Basses-Pyrénées, en juillet 1943, avant de pouvoir passer la frontière. Il redoute de ne pouvoir résister à la torture. Il est porteur de trop d'informations concernant la Résistance. Il tente donc de se suicider avec des médicaments et tombe dans un état comateux. Les Allemands le font soigner et le transfèrent au siège de la Gestapo, à Oloron-Sainte-Marie, pour y subir un interrogatoire et face à son refus de signer toute déposition rédigée en allemand, langue qu'il ne connaît pas, il sera emprisonné en août au Fort du Hâ à Bordeaux. En septembre, il est transféré à Compiègne, au Frontstalag 122, avant d’être déporté à Buchenwald dans le convoi I.145, parti le 28 octobre. Il arrive à Buchenwald le 31 octobre 1943, avec le matricule 31299. Après la quarantaine, il a la chance d’être nommé au Revier (baraquement destiné aux prisonniers malades des camps – ce mot était prononcé par les déportés français « revir »), dont il devient le premier médecin français. Le Dr Joseph Brau sait se faire accepter et reconnaître par sa compétence et son dévouement. Avant sa nomination, pour être admis au Revier, il fallait avoir une température élevée. Joseph Brau obtient l’admission de malades sans fièvre, sur la seule autorité de son diagnostic. Pour les déportés qui y sont admis, c’est une chance car, même si le lieu est dépourvu de moyens, les malades y trouvent la possibilité de ne pas participer à l’appel, d’échapper au travail et d’avoir quelques jours de repos qui peuvent leur sauver la vie. L’appareil de radio de Joseph Brau fonctionne au maximum, passant de trois clichés par jour à son arrivée à une cinquantaine à la libération du camp. Le docteur Joseph Brau sait toujours « interpréter » ses radios de façon à sauver le plus grand nombre de déportés du sort qui les attend. Au Revier, durant toute sa période d’emprisonnement, il s’attachera à améliorer l’existence des malades du camp, les conditions de vie des prisonniers et d'en sauver d'autres le plus possible. Dans le cadre du Comité des intérêts français (CIF), il est nommé président du Comité du corps médical français. Au Revier, des conférences médicales dans chaque langue sont organisées tous les samedis pour améliorer l’efficacité des diagnostics et des soins. Joseph Brau a la charge d’organiser les conférences en français. Le 12 avril 1945, le camp de Buchenwald est libéré. Le lieutenant-colonel Joseph Brau, le plus élevé en grade parmi les médecins détenus, est nommé médecin chef chargé de l’administration du Revier et du service de santé du camp par le colonel des Rangers de la troisième armée américaine. Fin avril, il est rapatrié avec les derniers déportés français hospitalisés au Revier, et il rapporte avec lui toutes les archives du Revier concernant les Français, qu’il remet aux autorités gouvernementales de son pays. A son retour, le Docteur Joseph Brau témoigne de la moralité de ses camarades d’infortune chaque fois que cela lui est demandé, en particulier au colonel Frédéric-Henri Manhès et à Marcel Paul, dont les actions dans le cadre du CIF sont, à plusieurs reprises, très sévèrement contestées après la Libération, et établit des certificats médicaux pour les anciens détenus qui le demandent. Revenu dans la vie civile, et en parallèle de son activité de médecin, il poursuit donc activement son militantisme contre le fascisme et celui pour le devoir de mémoire des camps. Il entretient des relations suivies avec nombre de ses anciens camarades d'infortune dont Ernst Busse (futur vice-ministre-président, ministre de l'Intérieur et secrétaire d’État aux Eaux et Forêts du Land de Thuringe), Marcel Paul (ministre de la Production industrielle de novembre 1945 à décembre 1946, dans les gouvernements de Charles de Gaulle, Félix Gouin et Georges Bidault), le colonel Frédéric-Henri Manhès, Albert Forcinal, le Dr Jean Rousset, le Dr Jean Lansac, Nicolas Simon dit « Gandhi », Aloïs Grimm. Il est membre du comité national de la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes (FNDIRP), membre de l'amicale de Buchenwald-Dora et Kommandos, qui deviendra l'Association française Buchenwald-Dora et Kommandos. Il prend sa retraite de médecin radiologue civil en 1956. En 1963, il reçoit à Berlin-Est la Médaille für Kämpfer gegen den Faschismus (médaille de la Lutte contre le fascisme) du Conseil des ministres de la RDA. Ses souvenirs détaillés de résistant et de déporté à Buchenwald sont consignés dans un livre, « Ici, chacun son dû (à tort ou à raison) », écrit en 1973 par Lucien Cariat, instituteur membre du groupe de résistance Vengeance, et dont Marcel Paul a rédigé l’introduction. Après la guerre, en 1955, il est élu conseiller général du canton de La Ferté-sous-Jouarre, dans le département de Seine-et-Marne, et réélu en 1961. Le 31 mars 1973, dans la cour de l'hôtel des Invalides à Paris, le président Georges Pompidou lui remet la Croix de Grand Officier de la Légion d’Honneur. Pendant les trente dernières années de sa vie Joseph Brau a l’habitude de passer tous ses moments de liberté en famille dans les Landes, à Hossegor puis à Seignosse, où il se retire définitivement en 1971, et où il meurt le 11 mai 1975. Durant sa vie, il se verra attribuer de nombreux titres et décorations : la croix de guerre avec palme (1917), une citation à l’ordre de la IVe armée, une citation à l’ordre de la 46e division d’occupation de Haute-Silésie (1921), la croix de guerre des TOE avec étoile d’argent (1922), la médaille commémorative de Haute-Silésie, la médaille coloniale agrafe Maroc (1924), promu chevalier de la Légion d’honneur (1925), la médaille d’argent de l’Académie de médecine, la médaille commémorative d’Orient (1926), le grade de médecin lieutenant-colonel (1940), la médaille commémorative d’Orient avec inscription « Orient », la croix de guerre 1939-1945, promu officier de la Légion d’honneur, une citation à l’ordre du corps d'armée (1947), la croix de guerre avec étoile de vermeil, la médaille d'honneur des épidémies (1948), élevé au rang de médecin colonel (1949), admission à l'honorariat du grade de colonel (1953), titre de Combattant volontaire de la Résistance (1953), attestation d’appartenance aux Forces françaises combattantes du réseau Hector (1956), promu commandeur de la Légion d’honneur en qualité de mutilé de guerre (1961), la croix de Guerre 1939-1945 avec palme, la médaille Kämpfer gegen den Faschismus 1933-1945 du Conseil des ministres de la RDA (1963), la médaille de la Reconnaissance de la FNDIRP (1967), la croix du combattant volontaire 1939-1945 (1968), élevé à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur (1973). La commune de La Ferté-sous-Jouarre a baptisé dans les années 1980 une de ses écoles maternelles du nom du Docteur Brau. Une plaque commémorative rappelant Joseph Brau a été apposée le 18 novembre 1995 sur le mur de l'école. Le samedi 11 avril 2015, à Trébons, en mémoire du Dr Joseph Brau (1891-1975), une plaque commémorative scellée sur la façade de sa maison natale a été dévoilée par Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, préfète des Hautes-Pyrénées, et Yves Pujo, maire de la commune. Le 7 juin 2016, le maire de Seignosse, et les élus de son équipe, ont inauguré une rue d’un nouveau quartier résidentiel de Seignosse, baptisée du patronyme de la famille de cet illustre résistant seignossais, le docteur Joseph Brau.
 Joseph BRAU, né le 26 avril 1891 à Trébons et mort le 11 mai 1975 à Seignosse dans les Landes, à l’âge de 84 ans. Il est le cadet d'une famille de quatre enfants : Frédéric, Zéphire, Jean et Joseph. Joseph Brau intègre l'école publique avec deux ans de retard : il ne parle que le patois. Il obtient son certificat d'études secondaires du 1er degré en juillet 1906 à Toulouse, puis son baccalauréat en mars 1910 et son certificat d'études physiques, chimiques et naturelles en juillet de la même année, toujours à Toulouse. Reçu au concours d'entrée à l'École du service de santé des armées, il intègre ce qui deviendra plus tard l'École Santé navale de Lyon. Il obtient son diplôme en juillet 1914 puis soutient une thèse de doctorat en médecine en mars 1917, pendant la Première Guerre mondiale, et se spécialise en électroradiologie. Mobilisé comme médecin chef d’un hôpital auxiliaire dans le Jura le 19 septembre 1939, il y fait son devoir, comme il l’a déjà fait d’août 1914 à octobre 1919, sur divers fronts. Il est démobilisé en août 1940, rentre à son domicile de la région parisienne et s’engage, en 1941, avec son ami et associé à la clinique de la rue des Moulins à Coulommiers, le Dr Pierre Berson, dans le réseau de résistance « Hector » sous les ordres du capitaine Rouard, commandant les compagnies des vallées de la Marne, sous le pseudonyme de « Bertrand ». Combattant volontaire de la Résistance, membre des Forces françaises combattantes, grâce à sa carte professionnelle, il peut circuler dans des zones « interdites » et fournir ainsi aux alliés de précieuses informations comme les positions exactes des emplacements des matériels de lutte antiaérienne. Après le démantèlement du réseau en 1943, suite à une dénonciation, il décide de fuir la France par l’Espagne pour rejoindre Londres, mais il est arrêté à Bedous dans les Basses-Pyrénées, en juillet 1943, avant de pouvoir passer la frontière. Il redoute de ne pouvoir résister à la torture. Il est porteur de trop d'informations concernant la Résistance. Il tente donc de se suicider avec des médicaments et tombe dans un état comateux. Les Allemands le font soigner et le transfèrent au siège de la Gestapo, à Oloron-Sainte-Marie, pour y subir un interrogatoire et face à son refus de signer toute déposition rédigée en allemand, langue qu'il ne connaît pas, il sera emprisonné en août au Fort du Hâ à Bordeaux. En septembre, il est transféré à Compiègne, au Frontstalag 122, avant d’être déporté à Buchenwald dans le convoi I.145, parti le 28 octobre. Il arrive à Buchenwald le 31 octobre 1943, avec le matricule 31299. Après la quarantaine, il a la chance d’être nommé au Revier (baraquement destiné aux prisonniers malades des camps – ce mot était prononcé par les déportés français « revir »), dont il devient le premier médecin français. Le Dr Joseph Brau sait se faire accepter et reconnaître par sa compétence et son dévouement. Avant sa nomination, pour être admis au Revier, il fallait avoir une température élevée. Joseph Brau obtient l’admission de malades sans fièvre, sur la seule autorité de son diagnostic. Pour les déportés qui y sont admis, c’est une chance car, même si le lieu est dépourvu de moyens, les malades y trouvent la possibilité de ne pas participer à l’appel, d’échapper au travail et d’avoir quelques jours de repos qui peuvent leur sauver la vie. L’appareil de radio de Joseph Brau fonctionne au maximum, passant de trois clichés par jour à son arrivée à une cinquantaine à la libération du camp. Le docteur Joseph Brau sait toujours « interpréter » ses radios de façon à sauver le plus grand nombre de déportés du sort qui les attend. Au Revier, durant toute sa période d’emprisonnement, il s’attachera à améliorer l’existence des malades du camp, les conditions de vie des prisonniers et d'en sauver d'autres le plus possible. Dans le cadre du Comité des intérêts français (CIF), il est nommé président du Comité du corps médical français. Au Revier, des conférences médicales dans chaque langue sont organisées tous les samedis pour améliorer l’efficacité des diagnostics et des soins. Joseph Brau a la charge d’organiser les conférences en français. Le 12 avril 1945, le camp de Buchenwald est libéré. Le lieutenant-colonel Joseph Brau, le plus élevé en grade parmi les médecins détenus, est nommé médecin chef chargé de l’administration du Revier et du service de santé du camp par le colonel des Rangers de la troisième armée américaine. Fin avril, il est rapatrié avec les derniers déportés français hospitalisés au Revier, et il rapporte avec lui toutes les archives du Revier concernant les Français, qu’il remet aux autorités gouvernementales de son pays. A son retour, le Docteur Joseph Brau témoigne de la moralité de ses camarades d’infortune chaque fois que cela lui est demandé, en particulier au colonel Frédéric-Henri Manhès et à Marcel Paul, dont les actions dans le cadre du CIF sont, à plusieurs reprises, très sévèrement contestées après la Libération, et établit des certificats médicaux pour les anciens détenus qui le demandent. Revenu dans la vie civile, et en parallèle de son activité de médecin, il poursuit donc activement son militantisme contre le fascisme et celui pour le devoir de mémoire des camps. Il entretient des relations suivies avec nombre de ses anciens camarades d'infortune dont Ernst Busse (futur vice-ministre-président, ministre de l'Intérieur et secrétaire d’État aux Eaux et Forêts du Land de Thuringe), Marcel Paul (ministre de la Production industrielle de novembre 1945 à décembre 1946, dans les gouvernements de Charles de Gaulle, Félix Gouin et Georges Bidault), le colonel Frédéric-Henri Manhès, Albert Forcinal, le Dr Jean Rousset, le Dr Jean Lansac, Nicolas Simon dit « Gandhi », Aloïs Grimm. Il est membre du comité national de la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes (FNDIRP), membre de l'amicale de Buchenwald-Dora et Kommandos, qui deviendra l'Association française Buchenwald-Dora et Kommandos. Il prend sa retraite de médecin radiologue civil en 1956. En 1963, il reçoit à Berlin-Est la Médaille für Kämpfer gegen den Faschismus (médaille de la Lutte contre le fascisme) du Conseil des ministres de la RDA. Ses souvenirs détaillés de résistant et de déporté à Buchenwald sont consignés dans un livre, « Ici, chacun son dû (à tort ou à raison) », écrit en 1973 par Lucien Cariat, instituteur membre du groupe de résistance Vengeance, et dont Marcel Paul a rédigé l’introduction. Après la guerre, en 1955, il est élu conseiller général du canton de La Ferté-sous-Jouarre, dans le département de Seine-et-Marne, et réélu en 1961. Le 31 mars 1973, dans la cour de l'hôtel des Invalides à Paris, le président Georges Pompidou lui remet la Croix de Grand Officier de la Légion d’Honneur. Pendant les trente dernières années de sa vie Joseph Brau a l’habitude de passer tous ses moments de liberté en famille dans les Landes, à Hossegor puis à Seignosse, où il se retire définitivement en 1971, et où il meurt le 11 mai 1975. Durant sa vie, il se verra attribuer de nombreux titres et décorations : la croix de guerre avec palme (1917), une citation à l’ordre de la IVe armée, une citation à l’ordre de la 46e division d’occupation de Haute-Silésie (1921), la croix de guerre des TOE avec étoile d’argent (1922), la médaille commémorative de Haute-Silésie, la médaille coloniale agrafe Maroc (1924), promu chevalier de la Légion d’honneur (1925), la médaille d’argent de l’Académie de médecine, la médaille commémorative d’Orient (1926), le grade de médecin lieutenant-colonel (1940), la médaille commémorative d’Orient avec inscription « Orient », la croix de guerre 1939-1945, promu officier de la Légion d’honneur, une citation à l’ordre du corps d'armée (1947), la croix de guerre avec étoile de vermeil, la médaille d'honneur des épidémies (1948), élevé au rang de médecin colonel (1949), admission à l'honorariat du grade de colonel (1953), titre de Combattant volontaire de la Résistance (1953), attestation d’appartenance aux Forces françaises combattantes du réseau Hector (1956), promu commandeur de la Légion d’honneur en qualité de mutilé de guerre (1961), la croix de Guerre 1939-1945 avec palme, la médaille Kämpfer gegen den Faschismus 1933-1945 du Conseil des ministres de la RDA (1963), la médaille de la Reconnaissance de la FNDIRP (1967), la croix du combattant volontaire 1939-1945 (1968), élevé à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur (1973). La commune de La Ferté-sous-Jouarre a baptisé dans les années 1980 une de ses écoles maternelles du nom du Docteur Brau. Une plaque commémorative rappelant Joseph Brau a été apposée le 18 novembre 1995 sur le mur de l'école. Le samedi 11 avril 2015, à Trébons, en mémoire du Dr Joseph Brau (1891-1975), une plaque commémorative scellée sur la façade de sa maison natale a été dévoilée par Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, préfète des Hautes-Pyrénées, et Yves Pujo, maire de la commune. Le 7 juin 2016, le maire de Seignosse, et les élus de son équipe, ont inauguré une rue d’un nouveau quartier résidentiel de Seignosse, baptisée du patronyme de la famille de cet illustre résistant seignossais, le docteur Joseph Brau.
Joseph BRAU, né le 26 avril 1891 à Trébons et mort le 11 mai 1975 à Seignosse dans les Landes, à l’âge de 84 ans. Il est le cadet d'une famille de quatre enfants : Frédéric, Zéphire, Jean et Joseph. Joseph Brau intègre l'école publique avec deux ans de retard : il ne parle que le patois. Il obtient son certificat d'études secondaires du 1er degré en juillet 1906 à Toulouse, puis son baccalauréat en mars 1910 et son certificat d'études physiques, chimiques et naturelles en juillet de la même année, toujours à Toulouse. Reçu au concours d'entrée à l'École du service de santé des armées, il intègre ce qui deviendra plus tard l'École Santé navale de Lyon. Il obtient son diplôme en juillet 1914 puis soutient une thèse de doctorat en médecine en mars 1917, pendant la Première Guerre mondiale, et se spécialise en électroradiologie. Mobilisé comme médecin chef d’un hôpital auxiliaire dans le Jura le 19 septembre 1939, il y fait son devoir, comme il l’a déjà fait d’août 1914 à octobre 1919, sur divers fronts. Il est démobilisé en août 1940, rentre à son domicile de la région parisienne et s’engage, en 1941, avec son ami et associé à la clinique de la rue des Moulins à Coulommiers, le Dr Pierre Berson, dans le réseau de résistance « Hector » sous les ordres du capitaine Rouard, commandant les compagnies des vallées de la Marne, sous le pseudonyme de « Bertrand ». Combattant volontaire de la Résistance, membre des Forces françaises combattantes, grâce à sa carte professionnelle, il peut circuler dans des zones « interdites » et fournir ainsi aux alliés de précieuses informations comme les positions exactes des emplacements des matériels de lutte antiaérienne. Après le démantèlement du réseau en 1943, suite à une dénonciation, il décide de fuir la France par l’Espagne pour rejoindre Londres, mais il est arrêté à Bedous dans les Basses-Pyrénées, en juillet 1943, avant de pouvoir passer la frontière. Il redoute de ne pouvoir résister à la torture. Il est porteur de trop d'informations concernant la Résistance. Il tente donc de se suicider avec des médicaments et tombe dans un état comateux. Les Allemands le font soigner et le transfèrent au siège de la Gestapo, à Oloron-Sainte-Marie, pour y subir un interrogatoire et face à son refus de signer toute déposition rédigée en allemand, langue qu'il ne connaît pas, il sera emprisonné en août au Fort du Hâ à Bordeaux. En septembre, il est transféré à Compiègne, au Frontstalag 122, avant d’être déporté à Buchenwald dans le convoi I.145, parti le 28 octobre. Il arrive à Buchenwald le 31 octobre 1943, avec le matricule 31299. Après la quarantaine, il a la chance d’être nommé au Revier (baraquement destiné aux prisonniers malades des camps – ce mot était prononcé par les déportés français « revir »), dont il devient le premier médecin français. Le Dr Joseph Brau sait se faire accepter et reconnaître par sa compétence et son dévouement. Avant sa nomination, pour être admis au Revier, il fallait avoir une température élevée. Joseph Brau obtient l’admission de malades sans fièvre, sur la seule autorité de son diagnostic. Pour les déportés qui y sont admis, c’est une chance car, même si le lieu est dépourvu de moyens, les malades y trouvent la possibilité de ne pas participer à l’appel, d’échapper au travail et d’avoir quelques jours de repos qui peuvent leur sauver la vie. L’appareil de radio de Joseph Brau fonctionne au maximum, passant de trois clichés par jour à son arrivée à une cinquantaine à la libération du camp. Le docteur Joseph Brau sait toujours « interpréter » ses radios de façon à sauver le plus grand nombre de déportés du sort qui les attend. Au Revier, durant toute sa période d’emprisonnement, il s’attachera à améliorer l’existence des malades du camp, les conditions de vie des prisonniers et d'en sauver d'autres le plus possible. Dans le cadre du Comité des intérêts français (CIF), il est nommé président du Comité du corps médical français. Au Revier, des conférences médicales dans chaque langue sont organisées tous les samedis pour améliorer l’efficacité des diagnostics et des soins. Joseph Brau a la charge d’organiser les conférences en français. Le 12 avril 1945, le camp de Buchenwald est libéré. Le lieutenant-colonel Joseph Brau, le plus élevé en grade parmi les médecins détenus, est nommé médecin chef chargé de l’administration du Revier et du service de santé du camp par le colonel des Rangers de la troisième armée américaine. Fin avril, il est rapatrié avec les derniers déportés français hospitalisés au Revier, et il rapporte avec lui toutes les archives du Revier concernant les Français, qu’il remet aux autorités gouvernementales de son pays. A son retour, le Docteur Joseph Brau témoigne de la moralité de ses camarades d’infortune chaque fois que cela lui est demandé, en particulier au colonel Frédéric-Henri Manhès et à Marcel Paul, dont les actions dans le cadre du CIF sont, à plusieurs reprises, très sévèrement contestées après la Libération, et établit des certificats médicaux pour les anciens détenus qui le demandent. Revenu dans la vie civile, et en parallèle de son activité de médecin, il poursuit donc activement son militantisme contre le fascisme et celui pour le devoir de mémoire des camps. Il entretient des relations suivies avec nombre de ses anciens camarades d'infortune dont Ernst Busse (futur vice-ministre-président, ministre de l'Intérieur et secrétaire d’État aux Eaux et Forêts du Land de Thuringe), Marcel Paul (ministre de la Production industrielle de novembre 1945 à décembre 1946, dans les gouvernements de Charles de Gaulle, Félix Gouin et Georges Bidault), le colonel Frédéric-Henri Manhès, Albert Forcinal, le Dr Jean Rousset, le Dr Jean Lansac, Nicolas Simon dit « Gandhi », Aloïs Grimm. Il est membre du comité national de la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes (FNDIRP), membre de l'amicale de Buchenwald-Dora et Kommandos, qui deviendra l'Association française Buchenwald-Dora et Kommandos. Il prend sa retraite de médecin radiologue civil en 1956. En 1963, il reçoit à Berlin-Est la Médaille für Kämpfer gegen den Faschismus (médaille de la Lutte contre le fascisme) du Conseil des ministres de la RDA. Ses souvenirs détaillés de résistant et de déporté à Buchenwald sont consignés dans un livre, « Ici, chacun son dû (à tort ou à raison) », écrit en 1973 par Lucien Cariat, instituteur membre du groupe de résistance Vengeance, et dont Marcel Paul a rédigé l’introduction. Après la guerre, en 1955, il est élu conseiller général du canton de La Ferté-sous-Jouarre, dans le département de Seine-et-Marne, et réélu en 1961. Le 31 mars 1973, dans la cour de l'hôtel des Invalides à Paris, le président Georges Pompidou lui remet la Croix de Grand Officier de la Légion d’Honneur. Pendant les trente dernières années de sa vie Joseph Brau a l’habitude de passer tous ses moments de liberté en famille dans les Landes, à Hossegor puis à Seignosse, où il se retire définitivement en 1971, et où il meurt le 11 mai 1975. Durant sa vie, il se verra attribuer de nombreux titres et décorations : la croix de guerre avec palme (1917), une citation à l’ordre de la IVe armée, une citation à l’ordre de la 46e division d’occupation de Haute-Silésie (1921), la croix de guerre des TOE avec étoile d’argent (1922), la médaille commémorative de Haute-Silésie, la médaille coloniale agrafe Maroc (1924), promu chevalier de la Légion d’honneur (1925), la médaille d’argent de l’Académie de médecine, la médaille commémorative d’Orient (1926), le grade de médecin lieutenant-colonel (1940), la médaille commémorative d’Orient avec inscription « Orient », la croix de guerre 1939-1945, promu officier de la Légion d’honneur, une citation à l’ordre du corps d'armée (1947), la croix de guerre avec étoile de vermeil, la médaille d'honneur des épidémies (1948), élevé au rang de médecin colonel (1949), admission à l'honorariat du grade de colonel (1953), titre de Combattant volontaire de la Résistance (1953), attestation d’appartenance aux Forces françaises combattantes du réseau Hector (1956), promu commandeur de la Légion d’honneur en qualité de mutilé de guerre (1961), la croix de Guerre 1939-1945 avec palme, la médaille Kämpfer gegen den Faschismus 1933-1945 du Conseil des ministres de la RDA (1963), la médaille de la Reconnaissance de la FNDIRP (1967), la croix du combattant volontaire 1939-1945 (1968), élevé à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur (1973). La commune de La Ferté-sous-Jouarre a baptisé dans les années 1980 une de ses écoles maternelles du nom du Docteur Brau. Une plaque commémorative rappelant Joseph Brau a été apposée le 18 novembre 1995 sur le mur de l'école. Le samedi 11 avril 2015, à Trébons, en mémoire du Dr Joseph Brau (1891-1975), une plaque commémorative scellée sur la façade de sa maison natale a été dévoilée par Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, préfète des Hautes-Pyrénées, et Yves Pujo, maire de la commune. Le 7 juin 2016, le maire de Seignosse, et les élus de son équipe, ont inauguré une rue d’un nouveau quartier résidentiel de Seignosse, baptisée du patronyme de la famille de cet illustre résistant seignossais, le docteur Joseph Brau.BROOKE Alan Francis (1883-1963)
Field Marshal, 1er vicomte Alanbrooke et baron Alanbrooke
 Alan Francis BROOKE, né le 23 juillet 1883 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 17 juin 1963 dans son village d’Hartley Wintney dans le Hampshire, à l’âge de 79 ans. Militaire britannique, il fut promu au grade de Field-Marshal en 1944 et fait baron Alanbrooke de Brookenborough, comté de Fermanagh en 1945, puis vicomte en 1946. De parents d’Irlande du Nord, il passa la majeure partie de son enfance en France, où il fut éduqué. Conformément à la tradition familiale, il étudiera à l’académie royale militaire de Woolwich, en Angleterre, où il obtiendra son diplôme d’officier d’artillerie. Pendant la Première Guerre mondiale, il servira en France avec l’Artillerie royale, terminant le conflit en tant que lieutenant-colonel. Dans l’entre-deux-guerres, il enseigna au Camberley Staff College et à l’Imperial Defence College. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il commanda le deuxième Corps de la Force expéditionnaire britannique sur le continent, qui ne réussit pas à arrêter l’invasion allemande, mais qui assura un important soutien d’artillerie pour les troupes belges, françaises et britanniques, lors de l’évacuation de Dunkerque, en 1940. En juillet 1940, il fut nommé Commandant de l’United Kingdom Home Forces et en décembre 1941, promu au rang de Chief of the Imperial General Staff (CIGS) et président du Comité des chefs d’Etat-Major, un poste qu’il occupera jusqu’en 1946. Il fut également un membre essentiel dans la planification du débarquement en Normandie de juin 1944. Ses désaccords publics avec certaines politiques de Winston Churchill rendirent ses nominations surprenantes, mais elles démontrent le respect de Churchill pour sa capacité de leadership. Il servit de premier conseiller militaire au Premier ministre Winston Churchill, au Cabinet de guerre et aux alliés du Royaume-Uni. Comme CIGS, il fut la tête fonctionnelle de l’armée, et à la tête du Comité des chefs d’Etat-Major, il fut responsable de la direction stratégique globale de l’effort de guerre. Il se vit offrir le commandement des forces britanniques au Moyen-Orient, poste qu’il refusa, pensant qu’il devait rester au Royaume-Uni pour empêcher Churchill de mener le pays dans toutes les aventures militaires hasardeuses. En 1942, il rejoignit le commandement exécutif des alliés occidentaux, le Chief of the Imperial General Staff américano-britannique à Washington. Comme Bernard Montgomery, il sera plus tard amer et déçu de ne pas avoir été choisi pour diriger le débarquement allié en Europe de l’Ouest, poste qui reviendra au général Eisenhower. Décision basée sur le pourcentage d’hommes et de matériels que les États-Unis avaient fourni à l’alliance. Après la guerre, en novembre 1945, en tant que président des chefs d’Etat-Major de la Grande-Bretagne, il rendit visite à Douglas MacArthur au Japon. En 1946, pour ses services militaires, il sera fait vicomte Alanbrooke. En 1949, il sera chancelier de l’Université Queen’s de Belfast, jusqu’à sa mort en 1963. En 2001, la publication de ses mémoires de guerre, War Diaries, non censurées, apporta ses visions jour après jour de l’effort de guerre britannique et, parfois, des critiques directes à propos des décisions de guerre de Winston Churchill ou de la capacité du général Dwight David Eisenhower en tant que Commandant militaire et de la stratégie américaine en général.
Alan Francis BROOKE, né le 23 juillet 1883 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 17 juin 1963 dans son village d’Hartley Wintney dans le Hampshire, à l’âge de 79 ans. Militaire britannique, il fut promu au grade de Field-Marshal en 1944 et fait baron Alanbrooke de Brookenborough, comté de Fermanagh en 1945, puis vicomte en 1946. De parents d’Irlande du Nord, il passa la majeure partie de son enfance en France, où il fut éduqué. Conformément à la tradition familiale, il étudiera à l’académie royale militaire de Woolwich, en Angleterre, où il obtiendra son diplôme d’officier d’artillerie. Pendant la Première Guerre mondiale, il servira en France avec l’Artillerie royale, terminant le conflit en tant que lieutenant-colonel. Dans l’entre-deux-guerres, il enseigna au Camberley Staff College et à l’Imperial Defence College. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il commanda le deuxième Corps de la Force expéditionnaire britannique sur le continent, qui ne réussit pas à arrêter l’invasion allemande, mais qui assura un important soutien d’artillerie pour les troupes belges, françaises et britanniques, lors de l’évacuation de Dunkerque, en 1940. En juillet 1940, il fut nommé Commandant de l’United Kingdom Home Forces et en décembre 1941, promu au rang de Chief of the Imperial General Staff (CIGS) et président du Comité des chefs d’Etat-Major, un poste qu’il occupera jusqu’en 1946. Il fut également un membre essentiel dans la planification du débarquement en Normandie de juin 1944. Ses désaccords publics avec certaines politiques de Winston Churchill rendirent ses nominations surprenantes, mais elles démontrent le respect de Churchill pour sa capacité de leadership. Il servit de premier conseiller militaire au Premier ministre Winston Churchill, au Cabinet de guerre et aux alliés du Royaume-Uni. Comme CIGS, il fut la tête fonctionnelle de l’armée, et à la tête du Comité des chefs d’Etat-Major, il fut responsable de la direction stratégique globale de l’effort de guerre. Il se vit offrir le commandement des forces britanniques au Moyen-Orient, poste qu’il refusa, pensant qu’il devait rester au Royaume-Uni pour empêcher Churchill de mener le pays dans toutes les aventures militaires hasardeuses. En 1942, il rejoignit le commandement exécutif des alliés occidentaux, le Chief of the Imperial General Staff américano-britannique à Washington. Comme Bernard Montgomery, il sera plus tard amer et déçu de ne pas avoir été choisi pour diriger le débarquement allié en Europe de l’Ouest, poste qui reviendra au général Eisenhower. Décision basée sur le pourcentage d’hommes et de matériels que les États-Unis avaient fourni à l’alliance. Après la guerre, en novembre 1945, en tant que président des chefs d’Etat-Major de la Grande-Bretagne, il rendit visite à Douglas MacArthur au Japon. En 1946, pour ses services militaires, il sera fait vicomte Alanbrooke. En 1949, il sera chancelier de l’Université Queen’s de Belfast, jusqu’à sa mort en 1963. En 2001, la publication de ses mémoires de guerre, War Diaries, non censurées, apporta ses visions jour après jour de l’effort de guerre britannique et, parfois, des critiques directes à propos des décisions de guerre de Winston Churchill ou de la capacité du général Dwight David Eisenhower en tant que Commandant militaire et de la stratégie américaine en général.
 Alan Francis BROOKE, né le 23 juillet 1883 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 17 juin 1963 dans son village d’Hartley Wintney dans le Hampshire, à l’âge de 79 ans. Militaire britannique, il fut promu au grade de Field-Marshal en 1944 et fait baron Alanbrooke de Brookenborough, comté de Fermanagh en 1945, puis vicomte en 1946. De parents d’Irlande du Nord, il passa la majeure partie de son enfance en France, où il fut éduqué. Conformément à la tradition familiale, il étudiera à l’académie royale militaire de Woolwich, en Angleterre, où il obtiendra son diplôme d’officier d’artillerie. Pendant la Première Guerre mondiale, il servira en France avec l’Artillerie royale, terminant le conflit en tant que lieutenant-colonel. Dans l’entre-deux-guerres, il enseigna au Camberley Staff College et à l’Imperial Defence College. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il commanda le deuxième Corps de la Force expéditionnaire britannique sur le continent, qui ne réussit pas à arrêter l’invasion allemande, mais qui assura un important soutien d’artillerie pour les troupes belges, françaises et britanniques, lors de l’évacuation de Dunkerque, en 1940. En juillet 1940, il fut nommé Commandant de l’United Kingdom Home Forces et en décembre 1941, promu au rang de Chief of the Imperial General Staff (CIGS) et président du Comité des chefs d’Etat-Major, un poste qu’il occupera jusqu’en 1946. Il fut également un membre essentiel dans la planification du débarquement en Normandie de juin 1944. Ses désaccords publics avec certaines politiques de Winston Churchill rendirent ses nominations surprenantes, mais elles démontrent le respect de Churchill pour sa capacité de leadership. Il servit de premier conseiller militaire au Premier ministre Winston Churchill, au Cabinet de guerre et aux alliés du Royaume-Uni. Comme CIGS, il fut la tête fonctionnelle de l’armée, et à la tête du Comité des chefs d’Etat-Major, il fut responsable de la direction stratégique globale de l’effort de guerre. Il se vit offrir le commandement des forces britanniques au Moyen-Orient, poste qu’il refusa, pensant qu’il devait rester au Royaume-Uni pour empêcher Churchill de mener le pays dans toutes les aventures militaires hasardeuses. En 1942, il rejoignit le commandement exécutif des alliés occidentaux, le Chief of the Imperial General Staff américano-britannique à Washington. Comme Bernard Montgomery, il sera plus tard amer et déçu de ne pas avoir été choisi pour diriger le débarquement allié en Europe de l’Ouest, poste qui reviendra au général Eisenhower. Décision basée sur le pourcentage d’hommes et de matériels que les États-Unis avaient fourni à l’alliance. Après la guerre, en novembre 1945, en tant que président des chefs d’Etat-Major de la Grande-Bretagne, il rendit visite à Douglas MacArthur au Japon. En 1946, pour ses services militaires, il sera fait vicomte Alanbrooke. En 1949, il sera chancelier de l’Université Queen’s de Belfast, jusqu’à sa mort en 1963. En 2001, la publication de ses mémoires de guerre, War Diaries, non censurées, apporta ses visions jour après jour de l’effort de guerre britannique et, parfois, des critiques directes à propos des décisions de guerre de Winston Churchill ou de la capacité du général Dwight David Eisenhower en tant que Commandant militaire et de la stratégie américaine en général.
Alan Francis BROOKE, né le 23 juillet 1883 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 17 juin 1963 dans son village d’Hartley Wintney dans le Hampshire, à l’âge de 79 ans. Militaire britannique, il fut promu au grade de Field-Marshal en 1944 et fait baron Alanbrooke de Brookenborough, comté de Fermanagh en 1945, puis vicomte en 1946. De parents d’Irlande du Nord, il passa la majeure partie de son enfance en France, où il fut éduqué. Conformément à la tradition familiale, il étudiera à l’académie royale militaire de Woolwich, en Angleterre, où il obtiendra son diplôme d’officier d’artillerie. Pendant la Première Guerre mondiale, il servira en France avec l’Artillerie royale, terminant le conflit en tant que lieutenant-colonel. Dans l’entre-deux-guerres, il enseigna au Camberley Staff College et à l’Imperial Defence College. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il commanda le deuxième Corps de la Force expéditionnaire britannique sur le continent, qui ne réussit pas à arrêter l’invasion allemande, mais qui assura un important soutien d’artillerie pour les troupes belges, françaises et britanniques, lors de l’évacuation de Dunkerque, en 1940. En juillet 1940, il fut nommé Commandant de l’United Kingdom Home Forces et en décembre 1941, promu au rang de Chief of the Imperial General Staff (CIGS) et président du Comité des chefs d’Etat-Major, un poste qu’il occupera jusqu’en 1946. Il fut également un membre essentiel dans la planification du débarquement en Normandie de juin 1944. Ses désaccords publics avec certaines politiques de Winston Churchill rendirent ses nominations surprenantes, mais elles démontrent le respect de Churchill pour sa capacité de leadership. Il servit de premier conseiller militaire au Premier ministre Winston Churchill, au Cabinet de guerre et aux alliés du Royaume-Uni. Comme CIGS, il fut la tête fonctionnelle de l’armée, et à la tête du Comité des chefs d’Etat-Major, il fut responsable de la direction stratégique globale de l’effort de guerre. Il se vit offrir le commandement des forces britanniques au Moyen-Orient, poste qu’il refusa, pensant qu’il devait rester au Royaume-Uni pour empêcher Churchill de mener le pays dans toutes les aventures militaires hasardeuses. En 1942, il rejoignit le commandement exécutif des alliés occidentaux, le Chief of the Imperial General Staff américano-britannique à Washington. Comme Bernard Montgomery, il sera plus tard amer et déçu de ne pas avoir été choisi pour diriger le débarquement allié en Europe de l’Ouest, poste qui reviendra au général Eisenhower. Décision basée sur le pourcentage d’hommes et de matériels que les États-Unis avaient fourni à l’alliance. Après la guerre, en novembre 1945, en tant que président des chefs d’Etat-Major de la Grande-Bretagne, il rendit visite à Douglas MacArthur au Japon. En 1946, pour ses services militaires, il sera fait vicomte Alanbrooke. En 1949, il sera chancelier de l’Université Queen’s de Belfast, jusqu’à sa mort en 1963. En 2001, la publication de ses mémoires de guerre, War Diaries, non censurées, apporta ses visions jour après jour de l’effort de guerre britannique et, parfois, des critiques directes à propos des décisions de guerre de Winston Churchill ou de la capacité du général Dwight David Eisenhower en tant que Commandant militaire et de la stratégie américaine en général.CAILLAVET Henri (1914-2013)
Avocat et homme politique
 Henri CAILLAVET, né le 13 février 1914 à Agen et mort le 27 février 2013 à Bourisp en vallée d'Aure, à l’âge de 99 ans. Avocat de formation, il eut une longue carrière politique et parlementaire (38 années de mandats électoraux - 29 ans député ou sénateur du Lot-et-Garonne). Il est issu d'une famille de négociants. Son père Jean Caillavet est drapier, propriétaire de plusieurs magasins à Agen et sa mère Marie-Louise Caubet, est d'origine provençale. Son père est franc-maçon et occupe au Grand Orient de France durant l’entre-deux-guerres, la charge de Vénérable de la Loge à Agen. Le jeune Henri suit un parcours scolaire classique à Agen, à l'école élémentaire Joseph-Bara puis au lycée Bernard-Palissy. Après un brillant cursus universitaire à Toulouse, il est docteur en droit et sciences économiques, et licencié ès lettres (philosophie). À partir de 1938, il exerce la profession d’avocat à la Cour d'appel de Paris. À 21 ans, il est initié en mai 1935 par la Loge des « Vrais Amis Réunis et Indépendance Française » (VARIF) du Grand Orient de France à l’Orient de Toulouse. Il sera une sommité dans le Grand Orient de France. En 1937-1938, proche des milieux libertaires et anarchistes, il fait passer des armes démontées pour les Brigades internationales qui se battent au côté des Républicains espagnols. Il est mobilisé en 1939. Dès 1940, il s’oppose à la politique du maréchal Pétain. Son appartenance au Grand Orient de France n’y est pas étrangère. Ses actions contre le régime de Vichy provoquent son arrestation, il est interné le 28 octobre 1940, durant 24 heures, au camp de Noé qui « le relâche faute de preuves ». En tant que franc-maçon, il est empêché de passer son agrégation de droit. « Faute de mieux », il plaide au barreau de Bagnères-de-Bigorre. Il entre en Résistance contre l'occupation allemande en 1940 et fonde avec André Hauriou le mouvement Combat. Il est arrêté par les Allemands et livré à la Gestapo en mai 1942. Du fait d'un alibi, justifiant sa présence sur la frontière espagnole, il est libéré au bout de neuf semaines. Deux ans après la Libération, il est élu à 32 ans, député le 2 juin 1946 à la seconde Assemblée nationale Constituante. En tant que parlementaire, il est membre de la Haute Cour de Justice chargée de juger les anciens responsables de Vichy. Il préserve son mandat de député jusqu’en 1958. Très actif en matière de proposition de loi, il en fait sept jusqu'en 1951, puis vingt-quatre jusqu'en 1956. En janvier 1953, on lui confie le poste de secrétaire d'État à la France d’Outre-mer dans le gouvernement René Mayer, puis en 1954 dans le gouvernement Pierre Mendès France, ceux de secrétaire d'État, successivement aux Affaires économiques et au Plan (1954), à la Marine nationale (1954-55), et enfin à l'Intérieur (1955). En 1958, il s’oppose au général de Gaulle en votant contre son investiture et la nouvelle Constitution. Il perd les élections législatives balayé par la vague gaulliste qui ouvre la Ve République. Par ailleurs, il est élu conseiller général radical-socialiste du canton d’Astaffort en Lot-et-Garonne de 1951 à 1963. Il quitte ensuite le Lot-et-Garonne pour les Hautes-Pyrénées, où il est élu maire de Bourisp de 1959 à 1983. Il se présente aux élections sénatoriales en Lot-et-Garonne et est élu en juin 1967. Sénateur de 1967 à 1983, il cumule ce mandat avec celui de député européen de 1979 à 1984. Infatigable législateur, il s'illustre notamment par l'élaboration de projets de loi concernant le divorce par consentement mutuel (1971), la publicité clandestine à la télévision (1972), l'interruption volontaire de grossesse (IVG) (1974), les greffes d'organes en 1976, le vote blanc (1980), le tribunal de l'informatique, l'euthanasie et l'acharnement thérapeutique (1978), l’insémination artificielle, l’internement psychiatrique. Il fait aussi des propositions législatives concernant l'homosexualité et le transsexualisme (1978-1981). Il a justifié l'avortement thérapeutique et l'euthanasie par des arguments qualifiés par certains d'eugénistes, affirmant que dès lors qu'un enfant peut poursuivre ses ascendants en justice pour réclamer le droit à ne pas naître handicapé (arrêt Perruche). Il perd son mandat de sénateur en 1983 contre Jean François-Poncet. Mais il contribue à lancer de nombreuses initiatives, comme la création de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL) et le think tank Réseau Voltaire. C'est ainsi qu'il a présidé la commission pour la transparence et la pluralité de la presse (juin 1985). Plusieurs fois président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), il en démissionne le 23 juin 2007. Il se présente comme athée et rationaliste et a été intégré au Comité consultatif national d'éthique depuis 1981. Il préside le Comité Laïcité République jusqu'en 2009. Grande figure du radicalisme, avocat né à Agen, résistant (membre du réseau de résistance Combat), ministre militant de Pierre Mendès France, franc-maçon déclaré, longtemps député puis sénateur du Lot-et-Garonne, Henri Caillavet restera un infatigable défenseur des droits des femmes et de leur émancipation, mais aussi un militant du "droit de mourir dans la dignité" et promoteur de la greffe d'organes. Il restera à jamais dans l'histoire française de la pénalisation de l'homophobie et de la transphobie. Il n'a jamais cessé de se battre. Auteur, entre autres de « À cœur ouvert », "Petite Traversée du siècle" (Éditions Bruno Leprince), en 2012, à l’âge de 98 ans, il a publié un premier roman « Manon ou les amours inachevées » aux Éditions Bruno Leprince. Une romance poétique et sentimentale, une manière de nous parler de lui, de la vie, de la mort, de l’amour surtout. Henri Caillavet avait quitté le MRG (devenu depuis PRG) en 1975, avant de le réintégrer en 1981. Il fut le vice-président de cette formation de 1973 à 1975. En 1979, il avait été élu député européen sur la liste UDF, conduite par Simone Veil. En 1981, il s'était rallié à François Mitterrand. Celui qui était surnommé « le recordman de la législation » en raison de son activisme législatif est décédé le 27 février 2013 dans son village de Bourisp à l'âge de 99 ans et incinéré au crématorium d'Azereix. Dans l'hommage qui lui fut rendu, le président de la République française François Hollande a salué un défenseur « des valeurs humanistes et, avant tout, de la liberté ». Le président du Sénat Jean-Pierre Bel a fait part de sa « très grande peine » à la suite du décès de cette « figure éminente du radicalisme ». Son épouse, née Françoise Rousseau, décèdera en 2011, à l'âge de 99 ans. Le couple avait eu quatre garçons : Jean-Pierre, Guy, François et Hugues.
Henri CAILLAVET, né le 13 février 1914 à Agen et mort le 27 février 2013 à Bourisp en vallée d'Aure, à l’âge de 99 ans. Avocat de formation, il eut une longue carrière politique et parlementaire (38 années de mandats électoraux - 29 ans député ou sénateur du Lot-et-Garonne). Il est issu d'une famille de négociants. Son père Jean Caillavet est drapier, propriétaire de plusieurs magasins à Agen et sa mère Marie-Louise Caubet, est d'origine provençale. Son père est franc-maçon et occupe au Grand Orient de France durant l’entre-deux-guerres, la charge de Vénérable de la Loge à Agen. Le jeune Henri suit un parcours scolaire classique à Agen, à l'école élémentaire Joseph-Bara puis au lycée Bernard-Palissy. Après un brillant cursus universitaire à Toulouse, il est docteur en droit et sciences économiques, et licencié ès lettres (philosophie). À partir de 1938, il exerce la profession d’avocat à la Cour d'appel de Paris. À 21 ans, il est initié en mai 1935 par la Loge des « Vrais Amis Réunis et Indépendance Française » (VARIF) du Grand Orient de France à l’Orient de Toulouse. Il sera une sommité dans le Grand Orient de France. En 1937-1938, proche des milieux libertaires et anarchistes, il fait passer des armes démontées pour les Brigades internationales qui se battent au côté des Républicains espagnols. Il est mobilisé en 1939. Dès 1940, il s’oppose à la politique du maréchal Pétain. Son appartenance au Grand Orient de France n’y est pas étrangère. Ses actions contre le régime de Vichy provoquent son arrestation, il est interné le 28 octobre 1940, durant 24 heures, au camp de Noé qui « le relâche faute de preuves ». En tant que franc-maçon, il est empêché de passer son agrégation de droit. « Faute de mieux », il plaide au barreau de Bagnères-de-Bigorre. Il entre en Résistance contre l'occupation allemande en 1940 et fonde avec André Hauriou le mouvement Combat. Il est arrêté par les Allemands et livré à la Gestapo en mai 1942. Du fait d'un alibi, justifiant sa présence sur la frontière espagnole, il est libéré au bout de neuf semaines. Deux ans après la Libération, il est élu à 32 ans, député le 2 juin 1946 à la seconde Assemblée nationale Constituante. En tant que parlementaire, il est membre de la Haute Cour de Justice chargée de juger les anciens responsables de Vichy. Il préserve son mandat de député jusqu’en 1958. Très actif en matière de proposition de loi, il en fait sept jusqu'en 1951, puis vingt-quatre jusqu'en 1956. En janvier 1953, on lui confie le poste de secrétaire d'État à la France d’Outre-mer dans le gouvernement René Mayer, puis en 1954 dans le gouvernement Pierre Mendès France, ceux de secrétaire d'État, successivement aux Affaires économiques et au Plan (1954), à la Marine nationale (1954-55), et enfin à l'Intérieur (1955). En 1958, il s’oppose au général de Gaulle en votant contre son investiture et la nouvelle Constitution. Il perd les élections législatives balayé par la vague gaulliste qui ouvre la Ve République. Par ailleurs, il est élu conseiller général radical-socialiste du canton d’Astaffort en Lot-et-Garonne de 1951 à 1963. Il quitte ensuite le Lot-et-Garonne pour les Hautes-Pyrénées, où il est élu maire de Bourisp de 1959 à 1983. Il se présente aux élections sénatoriales en Lot-et-Garonne et est élu en juin 1967. Sénateur de 1967 à 1983, il cumule ce mandat avec celui de député européen de 1979 à 1984. Infatigable législateur, il s'illustre notamment par l'élaboration de projets de loi concernant le divorce par consentement mutuel (1971), la publicité clandestine à la télévision (1972), l'interruption volontaire de grossesse (IVG) (1974), les greffes d'organes en 1976, le vote blanc (1980), le tribunal de l'informatique, l'euthanasie et l'acharnement thérapeutique (1978), l’insémination artificielle, l’internement psychiatrique. Il fait aussi des propositions législatives concernant l'homosexualité et le transsexualisme (1978-1981). Il a justifié l'avortement thérapeutique et l'euthanasie par des arguments qualifiés par certains d'eugénistes, affirmant que dès lors qu'un enfant peut poursuivre ses ascendants en justice pour réclamer le droit à ne pas naître handicapé (arrêt Perruche). Il perd son mandat de sénateur en 1983 contre Jean François-Poncet. Mais il contribue à lancer de nombreuses initiatives, comme la création de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL) et le think tank Réseau Voltaire. C'est ainsi qu'il a présidé la commission pour la transparence et la pluralité de la presse (juin 1985). Plusieurs fois président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), il en démissionne le 23 juin 2007. Il se présente comme athée et rationaliste et a été intégré au Comité consultatif national d'éthique depuis 1981. Il préside le Comité Laïcité République jusqu'en 2009. Grande figure du radicalisme, avocat né à Agen, résistant (membre du réseau de résistance Combat), ministre militant de Pierre Mendès France, franc-maçon déclaré, longtemps député puis sénateur du Lot-et-Garonne, Henri Caillavet restera un infatigable défenseur des droits des femmes et de leur émancipation, mais aussi un militant du "droit de mourir dans la dignité" et promoteur de la greffe d'organes. Il restera à jamais dans l'histoire française de la pénalisation de l'homophobie et de la transphobie. Il n'a jamais cessé de se battre. Auteur, entre autres de « À cœur ouvert », "Petite Traversée du siècle" (Éditions Bruno Leprince), en 2012, à l’âge de 98 ans, il a publié un premier roman « Manon ou les amours inachevées » aux Éditions Bruno Leprince. Une romance poétique et sentimentale, une manière de nous parler de lui, de la vie, de la mort, de l’amour surtout. Henri Caillavet avait quitté le MRG (devenu depuis PRG) en 1975, avant de le réintégrer en 1981. Il fut le vice-président de cette formation de 1973 à 1975. En 1979, il avait été élu député européen sur la liste UDF, conduite par Simone Veil. En 1981, il s'était rallié à François Mitterrand. Celui qui était surnommé « le recordman de la législation » en raison de son activisme législatif est décédé le 27 février 2013 dans son village de Bourisp à l'âge de 99 ans et incinéré au crématorium d'Azereix. Dans l'hommage qui lui fut rendu, le président de la République française François Hollande a salué un défenseur « des valeurs humanistes et, avant tout, de la liberté ». Le président du Sénat Jean-Pierre Bel a fait part de sa « très grande peine » à la suite du décès de cette « figure éminente du radicalisme ». Son épouse, née Françoise Rousseau, décèdera en 2011, à l'âge de 99 ans. Le couple avait eu quatre garçons : Jean-Pierre, Guy, François et Hugues.
 Henri CAILLAVET, né le 13 février 1914 à Agen et mort le 27 février 2013 à Bourisp en vallée d'Aure, à l’âge de 99 ans. Avocat de formation, il eut une longue carrière politique et parlementaire (38 années de mandats électoraux - 29 ans député ou sénateur du Lot-et-Garonne). Il est issu d'une famille de négociants. Son père Jean Caillavet est drapier, propriétaire de plusieurs magasins à Agen et sa mère Marie-Louise Caubet, est d'origine provençale. Son père est franc-maçon et occupe au Grand Orient de France durant l’entre-deux-guerres, la charge de Vénérable de la Loge à Agen. Le jeune Henri suit un parcours scolaire classique à Agen, à l'école élémentaire Joseph-Bara puis au lycée Bernard-Palissy. Après un brillant cursus universitaire à Toulouse, il est docteur en droit et sciences économiques, et licencié ès lettres (philosophie). À partir de 1938, il exerce la profession d’avocat à la Cour d'appel de Paris. À 21 ans, il est initié en mai 1935 par la Loge des « Vrais Amis Réunis et Indépendance Française » (VARIF) du Grand Orient de France à l’Orient de Toulouse. Il sera une sommité dans le Grand Orient de France. En 1937-1938, proche des milieux libertaires et anarchistes, il fait passer des armes démontées pour les Brigades internationales qui se battent au côté des Républicains espagnols. Il est mobilisé en 1939. Dès 1940, il s’oppose à la politique du maréchal Pétain. Son appartenance au Grand Orient de France n’y est pas étrangère. Ses actions contre le régime de Vichy provoquent son arrestation, il est interné le 28 octobre 1940, durant 24 heures, au camp de Noé qui « le relâche faute de preuves ». En tant que franc-maçon, il est empêché de passer son agrégation de droit. « Faute de mieux », il plaide au barreau de Bagnères-de-Bigorre. Il entre en Résistance contre l'occupation allemande en 1940 et fonde avec André Hauriou le mouvement Combat. Il est arrêté par les Allemands et livré à la Gestapo en mai 1942. Du fait d'un alibi, justifiant sa présence sur la frontière espagnole, il est libéré au bout de neuf semaines. Deux ans après la Libération, il est élu à 32 ans, député le 2 juin 1946 à la seconde Assemblée nationale Constituante. En tant que parlementaire, il est membre de la Haute Cour de Justice chargée de juger les anciens responsables de Vichy. Il préserve son mandat de député jusqu’en 1958. Très actif en matière de proposition de loi, il en fait sept jusqu'en 1951, puis vingt-quatre jusqu'en 1956. En janvier 1953, on lui confie le poste de secrétaire d'État à la France d’Outre-mer dans le gouvernement René Mayer, puis en 1954 dans le gouvernement Pierre Mendès France, ceux de secrétaire d'État, successivement aux Affaires économiques et au Plan (1954), à la Marine nationale (1954-55), et enfin à l'Intérieur (1955). En 1958, il s’oppose au général de Gaulle en votant contre son investiture et la nouvelle Constitution. Il perd les élections législatives balayé par la vague gaulliste qui ouvre la Ve République. Par ailleurs, il est élu conseiller général radical-socialiste du canton d’Astaffort en Lot-et-Garonne de 1951 à 1963. Il quitte ensuite le Lot-et-Garonne pour les Hautes-Pyrénées, où il est élu maire de Bourisp de 1959 à 1983. Il se présente aux élections sénatoriales en Lot-et-Garonne et est élu en juin 1967. Sénateur de 1967 à 1983, il cumule ce mandat avec celui de député européen de 1979 à 1984. Infatigable législateur, il s'illustre notamment par l'élaboration de projets de loi concernant le divorce par consentement mutuel (1971), la publicité clandestine à la télévision (1972), l'interruption volontaire de grossesse (IVG) (1974), les greffes d'organes en 1976, le vote blanc (1980), le tribunal de l'informatique, l'euthanasie et l'acharnement thérapeutique (1978), l’insémination artificielle, l’internement psychiatrique. Il fait aussi des propositions législatives concernant l'homosexualité et le transsexualisme (1978-1981). Il a justifié l'avortement thérapeutique et l'euthanasie par des arguments qualifiés par certains d'eugénistes, affirmant que dès lors qu'un enfant peut poursuivre ses ascendants en justice pour réclamer le droit à ne pas naître handicapé (arrêt Perruche). Il perd son mandat de sénateur en 1983 contre Jean François-Poncet. Mais il contribue à lancer de nombreuses initiatives, comme la création de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL) et le think tank Réseau Voltaire. C'est ainsi qu'il a présidé la commission pour la transparence et la pluralité de la presse (juin 1985). Plusieurs fois président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), il en démissionne le 23 juin 2007. Il se présente comme athée et rationaliste et a été intégré au Comité consultatif national d'éthique depuis 1981. Il préside le Comité Laïcité République jusqu'en 2009. Grande figure du radicalisme, avocat né à Agen, résistant (membre du réseau de résistance Combat), ministre militant de Pierre Mendès France, franc-maçon déclaré, longtemps député puis sénateur du Lot-et-Garonne, Henri Caillavet restera un infatigable défenseur des droits des femmes et de leur émancipation, mais aussi un militant du "droit de mourir dans la dignité" et promoteur de la greffe d'organes. Il restera à jamais dans l'histoire française de la pénalisation de l'homophobie et de la transphobie. Il n'a jamais cessé de se battre. Auteur, entre autres de « À cœur ouvert », "Petite Traversée du siècle" (Éditions Bruno Leprince), en 2012, à l’âge de 98 ans, il a publié un premier roman « Manon ou les amours inachevées » aux Éditions Bruno Leprince. Une romance poétique et sentimentale, une manière de nous parler de lui, de la vie, de la mort, de l’amour surtout. Henri Caillavet avait quitté le MRG (devenu depuis PRG) en 1975, avant de le réintégrer en 1981. Il fut le vice-président de cette formation de 1973 à 1975. En 1979, il avait été élu député européen sur la liste UDF, conduite par Simone Veil. En 1981, il s'était rallié à François Mitterrand. Celui qui était surnommé « le recordman de la législation » en raison de son activisme législatif est décédé le 27 février 2013 dans son village de Bourisp à l'âge de 99 ans et incinéré au crématorium d'Azereix. Dans l'hommage qui lui fut rendu, le président de la République française François Hollande a salué un défenseur « des valeurs humanistes et, avant tout, de la liberté ». Le président du Sénat Jean-Pierre Bel a fait part de sa « très grande peine » à la suite du décès de cette « figure éminente du radicalisme ». Son épouse, née Françoise Rousseau, décèdera en 2011, à l'âge de 99 ans. Le couple avait eu quatre garçons : Jean-Pierre, Guy, François et Hugues.
Henri CAILLAVET, né le 13 février 1914 à Agen et mort le 27 février 2013 à Bourisp en vallée d'Aure, à l’âge de 99 ans. Avocat de formation, il eut une longue carrière politique et parlementaire (38 années de mandats électoraux - 29 ans député ou sénateur du Lot-et-Garonne). Il est issu d'une famille de négociants. Son père Jean Caillavet est drapier, propriétaire de plusieurs magasins à Agen et sa mère Marie-Louise Caubet, est d'origine provençale. Son père est franc-maçon et occupe au Grand Orient de France durant l’entre-deux-guerres, la charge de Vénérable de la Loge à Agen. Le jeune Henri suit un parcours scolaire classique à Agen, à l'école élémentaire Joseph-Bara puis au lycée Bernard-Palissy. Après un brillant cursus universitaire à Toulouse, il est docteur en droit et sciences économiques, et licencié ès lettres (philosophie). À partir de 1938, il exerce la profession d’avocat à la Cour d'appel de Paris. À 21 ans, il est initié en mai 1935 par la Loge des « Vrais Amis Réunis et Indépendance Française » (VARIF) du Grand Orient de France à l’Orient de Toulouse. Il sera une sommité dans le Grand Orient de France. En 1937-1938, proche des milieux libertaires et anarchistes, il fait passer des armes démontées pour les Brigades internationales qui se battent au côté des Républicains espagnols. Il est mobilisé en 1939. Dès 1940, il s’oppose à la politique du maréchal Pétain. Son appartenance au Grand Orient de France n’y est pas étrangère. Ses actions contre le régime de Vichy provoquent son arrestation, il est interné le 28 octobre 1940, durant 24 heures, au camp de Noé qui « le relâche faute de preuves ». En tant que franc-maçon, il est empêché de passer son agrégation de droit. « Faute de mieux », il plaide au barreau de Bagnères-de-Bigorre. Il entre en Résistance contre l'occupation allemande en 1940 et fonde avec André Hauriou le mouvement Combat. Il est arrêté par les Allemands et livré à la Gestapo en mai 1942. Du fait d'un alibi, justifiant sa présence sur la frontière espagnole, il est libéré au bout de neuf semaines. Deux ans après la Libération, il est élu à 32 ans, député le 2 juin 1946 à la seconde Assemblée nationale Constituante. En tant que parlementaire, il est membre de la Haute Cour de Justice chargée de juger les anciens responsables de Vichy. Il préserve son mandat de député jusqu’en 1958. Très actif en matière de proposition de loi, il en fait sept jusqu'en 1951, puis vingt-quatre jusqu'en 1956. En janvier 1953, on lui confie le poste de secrétaire d'État à la France d’Outre-mer dans le gouvernement René Mayer, puis en 1954 dans le gouvernement Pierre Mendès France, ceux de secrétaire d'État, successivement aux Affaires économiques et au Plan (1954), à la Marine nationale (1954-55), et enfin à l'Intérieur (1955). En 1958, il s’oppose au général de Gaulle en votant contre son investiture et la nouvelle Constitution. Il perd les élections législatives balayé par la vague gaulliste qui ouvre la Ve République. Par ailleurs, il est élu conseiller général radical-socialiste du canton d’Astaffort en Lot-et-Garonne de 1951 à 1963. Il quitte ensuite le Lot-et-Garonne pour les Hautes-Pyrénées, où il est élu maire de Bourisp de 1959 à 1983. Il se présente aux élections sénatoriales en Lot-et-Garonne et est élu en juin 1967. Sénateur de 1967 à 1983, il cumule ce mandat avec celui de député européen de 1979 à 1984. Infatigable législateur, il s'illustre notamment par l'élaboration de projets de loi concernant le divorce par consentement mutuel (1971), la publicité clandestine à la télévision (1972), l'interruption volontaire de grossesse (IVG) (1974), les greffes d'organes en 1976, le vote blanc (1980), le tribunal de l'informatique, l'euthanasie et l'acharnement thérapeutique (1978), l’insémination artificielle, l’internement psychiatrique. Il fait aussi des propositions législatives concernant l'homosexualité et le transsexualisme (1978-1981). Il a justifié l'avortement thérapeutique et l'euthanasie par des arguments qualifiés par certains d'eugénistes, affirmant que dès lors qu'un enfant peut poursuivre ses ascendants en justice pour réclamer le droit à ne pas naître handicapé (arrêt Perruche). Il perd son mandat de sénateur en 1983 contre Jean François-Poncet. Mais il contribue à lancer de nombreuses initiatives, comme la création de la Commission nationale informatique et liberté (CNIL) et le think tank Réseau Voltaire. C'est ainsi qu'il a présidé la commission pour la transparence et la pluralité de la presse (juin 1985). Plusieurs fois président de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), il en démissionne le 23 juin 2007. Il se présente comme athée et rationaliste et a été intégré au Comité consultatif national d'éthique depuis 1981. Il préside le Comité Laïcité République jusqu'en 2009. Grande figure du radicalisme, avocat né à Agen, résistant (membre du réseau de résistance Combat), ministre militant de Pierre Mendès France, franc-maçon déclaré, longtemps député puis sénateur du Lot-et-Garonne, Henri Caillavet restera un infatigable défenseur des droits des femmes et de leur émancipation, mais aussi un militant du "droit de mourir dans la dignité" et promoteur de la greffe d'organes. Il restera à jamais dans l'histoire française de la pénalisation de l'homophobie et de la transphobie. Il n'a jamais cessé de se battre. Auteur, entre autres de « À cœur ouvert », "Petite Traversée du siècle" (Éditions Bruno Leprince), en 2012, à l’âge de 98 ans, il a publié un premier roman « Manon ou les amours inachevées » aux Éditions Bruno Leprince. Une romance poétique et sentimentale, une manière de nous parler de lui, de la vie, de la mort, de l’amour surtout. Henri Caillavet avait quitté le MRG (devenu depuis PRG) en 1975, avant de le réintégrer en 1981. Il fut le vice-président de cette formation de 1973 à 1975. En 1979, il avait été élu député européen sur la liste UDF, conduite par Simone Veil. En 1981, il s'était rallié à François Mitterrand. Celui qui était surnommé « le recordman de la législation » en raison de son activisme législatif est décédé le 27 février 2013 dans son village de Bourisp à l'âge de 99 ans et incinéré au crématorium d'Azereix. Dans l'hommage qui lui fut rendu, le président de la République française François Hollande a salué un défenseur « des valeurs humanistes et, avant tout, de la liberté ». Le président du Sénat Jean-Pierre Bel a fait part de sa « très grande peine » à la suite du décès de cette « figure éminente du radicalisme ». Son épouse, née Françoise Rousseau, décèdera en 2011, à l'âge de 99 ans. Le couple avait eu quatre garçons : Jean-Pierre, Guy, François et Hugues.CALOT François (1861-1944)
Chirurgien orthopédiste de renommée internationale
 François CALOT, né le 17 mai 1861 à Arrens-Marsous et mort le 1er mars 1944 à Adast, à l’âge de 82 ans. Cinquième enfant d’une fratrie de huit d’une famille de cultivateurs, reçu au baccalauréat en 1880 à Saint-Pé-de-Bigorre, il monte faire médecine à Paris en 1881. Et pour payer ses études, il deviendra répétiteur à l’école Fénelon tenue par des jésuites. Élève brillant de la faculté de médecine, il est prosecteur et étudie l’anatomie et la dissection sous la direction d’un chef des travaux pratiques novateur, Louis-Hubert Farabeuf (1841-1910). Il sera reçu 9e sur 52 au concours d’internat en 1887. Après quelques années aux hôpitaux Saint-Louis et Bichat, il sera nommé en tant qu’interne à l’Hôpital maritime de Berck-sur-Mer. Il y assurera l’intérim du poste de chirurgien-chef, en raison de la maladie du docteur Henri Cazin, qui décèdera en 1891. En novembre 1891, il obtiendra la direction de l’hôpital Nathaniel-de-Rothschild, ainsi que celle du dispensaire Henri-de-Rothschild, inauguré le 6 juin 1892 pour les enfants pauvres de la région. Il devient célèbre en présentant, le 22 décembre 1896, devant l’Académie de médecine, 37 observations de réduction de gibbosité pottique par une méthode très simple : "Endormi au chloroforme, le malade est retourné sur le ventre et, pendant que deux ou quatre aides, suivant l’âge et la taille de l’enfant, exercent à la tête et aux pieds des tractions vigoureuses, l’opérateur pèse de tout son poids et de toute sa vigueur sur la bosse jusqu’à ce que la partie déviée de la colonne vertébrale soit rentrée dans l’alignement. Cela dure deux minutes au maximum. Après quoi un plâtre est confectionné pour assurer une immobilisation prolongée. Dans les 37 cas il n’y a eu que des succès". Sa renommée internationale, relayée par les caricaturistes, attire à Berck les patients les plus illustres, venus du monde entier. Il allait être connu comme celui qui savait redresser les bossus. Il contribua à la renommée mondiale de Berck où il fonda plusieurs établissements hospitaliers. Grâce à la baronne de Rothschild, il fera construire en 1900-1902 un établissement hospitalier de luxe pour les enfants de familles aisées, l’institut orthopédique de Berck, devenu institut Saint-François-de-Sales. D’une capacité initiale de cent lits, l’hôpital atteint les six cents lits en 1939. C’est là qu’il passe la majeure partie de sa vie professionnelle, tout en dirigeant deux autres centres ouverts avenue Montaigne à Paris et à Argelès-Gazost dans ses Pyrénées natales. De 1906 à 1933, il donnera à Berck un cours d’orthopédie d’une semaine, destiné aux médecins et étudiants et attirant des centaines de médecins du monde entier. Il participera en outre aux congrès internationaux de médecine et de chirurgie de Moscou (1897), Madrid (1903) et Lisbonne (1906), et présidera le jury de la classe de médecine et de chirurgie à l’exposition internationale de Bruxelles de 1910. Il est l’auteur de nombreux ouvrages spécialisés sur les scolioses, les pathologies de la hanche chez l’enfant, l’orthopédie en général et dont l’œuvre majeure dans le domaine de l’édition restera « L’orthopédie indispensable aux praticiens », édité en 1909 chez Masson, puis réédité de nombreuses fois chez Maloine, traduit et publié à l’étranger. Il sera fait chevalier de la Légion d’honneur le 20 octobre 1911 et promu officier par décret du 14 février 1921 pour services rendus aux blessés et malades militaires pendant la Grande Guerre. Durant la guerre de 14-18, il fut désigné comme médecin-chef de trois des hôpitaux militaires de Berck. Lui, le chirurgien des enfants et de la tuberculose va devenir un expert en traumatologie de guerre. Dès 1916, il publie l’ouvrage « Orthopédie et chirurgie de guerre » qui sera réédité à trois reprises et traduit en plusieurs langues. Pour lui l’immobilisation des fractures doit être réalisée de façon rigoureuse le plus rapidement possible. Il propose de réaliser dans les ambulances mêmes du front des appareils plâtrés fenêtrés en lieu et place des extensions ou des gouttières métalliques, source de déplacement lors des transports vers les hôpitaux de l’arrière. Et il se fait surtout le chantre de la méthode conservatrice « jamais d’amputation hors de la gangrène déclarée, jamais d’ablation primitive d’esquilles ». Marié le 18 octobre 1894 à Marie Bacqueville, ils auront quatre filles. Au décès de son épouse en 1934, il vendra l’Institut Saint-François de Sales à une société anonyme, dite société Calot, mais continuera à diriger l’établissement jusqu’à sa retraite en 1941. Dès lors, il s’installera définitivement au château de Miramont à Adast, qu’il avait acheté en 1906 et où il décèdera en 1944. Il sera inhumé dans la chapelle du château, aux côtés de son épouse. En 1970, la propriété ayant été vendue par ses filles à Jacques Chancel, leurs cendres furent transférées dans le cimetière d’Arrens. Son nom reste surtout présent aujourd’hui grâce à l’Institut Calot de Berck-sur-Mer, qu’il a créé et qui est resté un établissement hautement spécialisé dans la prise en charge des pathologies orthopédiques et des affections neurologiques tant sur le plan médical que chirurgical. Son frère, l’abbé Paul François Calot, fut lui directeur du Château-observatoire d’Abbadia (1923-1944) près d’Hendaye, qui poursuivant l’œuvre de son prédécesseur Aloys Verschaffel, publia de nombreux catalogues d’étoiles.
François CALOT, né le 17 mai 1861 à Arrens-Marsous et mort le 1er mars 1944 à Adast, à l’âge de 82 ans. Cinquième enfant d’une fratrie de huit d’une famille de cultivateurs, reçu au baccalauréat en 1880 à Saint-Pé-de-Bigorre, il monte faire médecine à Paris en 1881. Et pour payer ses études, il deviendra répétiteur à l’école Fénelon tenue par des jésuites. Élève brillant de la faculté de médecine, il est prosecteur et étudie l’anatomie et la dissection sous la direction d’un chef des travaux pratiques novateur, Louis-Hubert Farabeuf (1841-1910). Il sera reçu 9e sur 52 au concours d’internat en 1887. Après quelques années aux hôpitaux Saint-Louis et Bichat, il sera nommé en tant qu’interne à l’Hôpital maritime de Berck-sur-Mer. Il y assurera l’intérim du poste de chirurgien-chef, en raison de la maladie du docteur Henri Cazin, qui décèdera en 1891. En novembre 1891, il obtiendra la direction de l’hôpital Nathaniel-de-Rothschild, ainsi que celle du dispensaire Henri-de-Rothschild, inauguré le 6 juin 1892 pour les enfants pauvres de la région. Il devient célèbre en présentant, le 22 décembre 1896, devant l’Académie de médecine, 37 observations de réduction de gibbosité pottique par une méthode très simple : "Endormi au chloroforme, le malade est retourné sur le ventre et, pendant que deux ou quatre aides, suivant l’âge et la taille de l’enfant, exercent à la tête et aux pieds des tractions vigoureuses, l’opérateur pèse de tout son poids et de toute sa vigueur sur la bosse jusqu’à ce que la partie déviée de la colonne vertébrale soit rentrée dans l’alignement. Cela dure deux minutes au maximum. Après quoi un plâtre est confectionné pour assurer une immobilisation prolongée. Dans les 37 cas il n’y a eu que des succès". Sa renommée internationale, relayée par les caricaturistes, attire à Berck les patients les plus illustres, venus du monde entier. Il allait être connu comme celui qui savait redresser les bossus. Il contribua à la renommée mondiale de Berck où il fonda plusieurs établissements hospitaliers. Grâce à la baronne de Rothschild, il fera construire en 1900-1902 un établissement hospitalier de luxe pour les enfants de familles aisées, l’institut orthopédique de Berck, devenu institut Saint-François-de-Sales. D’une capacité initiale de cent lits, l’hôpital atteint les six cents lits en 1939. C’est là qu’il passe la majeure partie de sa vie professionnelle, tout en dirigeant deux autres centres ouverts avenue Montaigne à Paris et à Argelès-Gazost dans ses Pyrénées natales. De 1906 à 1933, il donnera à Berck un cours d’orthopédie d’une semaine, destiné aux médecins et étudiants et attirant des centaines de médecins du monde entier. Il participera en outre aux congrès internationaux de médecine et de chirurgie de Moscou (1897), Madrid (1903) et Lisbonne (1906), et présidera le jury de la classe de médecine et de chirurgie à l’exposition internationale de Bruxelles de 1910. Il est l’auteur de nombreux ouvrages spécialisés sur les scolioses, les pathologies de la hanche chez l’enfant, l’orthopédie en général et dont l’œuvre majeure dans le domaine de l’édition restera « L’orthopédie indispensable aux praticiens », édité en 1909 chez Masson, puis réédité de nombreuses fois chez Maloine, traduit et publié à l’étranger. Il sera fait chevalier de la Légion d’honneur le 20 octobre 1911 et promu officier par décret du 14 février 1921 pour services rendus aux blessés et malades militaires pendant la Grande Guerre. Durant la guerre de 14-18, il fut désigné comme médecin-chef de trois des hôpitaux militaires de Berck. Lui, le chirurgien des enfants et de la tuberculose va devenir un expert en traumatologie de guerre. Dès 1916, il publie l’ouvrage « Orthopédie et chirurgie de guerre » qui sera réédité à trois reprises et traduit en plusieurs langues. Pour lui l’immobilisation des fractures doit être réalisée de façon rigoureuse le plus rapidement possible. Il propose de réaliser dans les ambulances mêmes du front des appareils plâtrés fenêtrés en lieu et place des extensions ou des gouttières métalliques, source de déplacement lors des transports vers les hôpitaux de l’arrière. Et il se fait surtout le chantre de la méthode conservatrice « jamais d’amputation hors de la gangrène déclarée, jamais d’ablation primitive d’esquilles ». Marié le 18 octobre 1894 à Marie Bacqueville, ils auront quatre filles. Au décès de son épouse en 1934, il vendra l’Institut Saint-François de Sales à une société anonyme, dite société Calot, mais continuera à diriger l’établissement jusqu’à sa retraite en 1941. Dès lors, il s’installera définitivement au château de Miramont à Adast, qu’il avait acheté en 1906 et où il décèdera en 1944. Il sera inhumé dans la chapelle du château, aux côtés de son épouse. En 1970, la propriété ayant été vendue par ses filles à Jacques Chancel, leurs cendres furent transférées dans le cimetière d’Arrens. Son nom reste surtout présent aujourd’hui grâce à l’Institut Calot de Berck-sur-Mer, qu’il a créé et qui est resté un établissement hautement spécialisé dans la prise en charge des pathologies orthopédiques et des affections neurologiques tant sur le plan médical que chirurgical. Son frère, l’abbé Paul François Calot, fut lui directeur du Château-observatoire d’Abbadia (1923-1944) près d’Hendaye, qui poursuivant l’œuvre de son prédécesseur Aloys Verschaffel, publia de nombreux catalogues d’étoiles.
 François CALOT, né le 17 mai 1861 à Arrens-Marsous et mort le 1er mars 1944 à Adast, à l’âge de 82 ans. Cinquième enfant d’une fratrie de huit d’une famille de cultivateurs, reçu au baccalauréat en 1880 à Saint-Pé-de-Bigorre, il monte faire médecine à Paris en 1881. Et pour payer ses études, il deviendra répétiteur à l’école Fénelon tenue par des jésuites. Élève brillant de la faculté de médecine, il est prosecteur et étudie l’anatomie et la dissection sous la direction d’un chef des travaux pratiques novateur, Louis-Hubert Farabeuf (1841-1910). Il sera reçu 9e sur 52 au concours d’internat en 1887. Après quelques années aux hôpitaux Saint-Louis et Bichat, il sera nommé en tant qu’interne à l’Hôpital maritime de Berck-sur-Mer. Il y assurera l’intérim du poste de chirurgien-chef, en raison de la maladie du docteur Henri Cazin, qui décèdera en 1891. En novembre 1891, il obtiendra la direction de l’hôpital Nathaniel-de-Rothschild, ainsi que celle du dispensaire Henri-de-Rothschild, inauguré le 6 juin 1892 pour les enfants pauvres de la région. Il devient célèbre en présentant, le 22 décembre 1896, devant l’Académie de médecine, 37 observations de réduction de gibbosité pottique par une méthode très simple : "Endormi au chloroforme, le malade est retourné sur le ventre et, pendant que deux ou quatre aides, suivant l’âge et la taille de l’enfant, exercent à la tête et aux pieds des tractions vigoureuses, l’opérateur pèse de tout son poids et de toute sa vigueur sur la bosse jusqu’à ce que la partie déviée de la colonne vertébrale soit rentrée dans l’alignement. Cela dure deux minutes au maximum. Après quoi un plâtre est confectionné pour assurer une immobilisation prolongée. Dans les 37 cas il n’y a eu que des succès". Sa renommée internationale, relayée par les caricaturistes, attire à Berck les patients les plus illustres, venus du monde entier. Il allait être connu comme celui qui savait redresser les bossus. Il contribua à la renommée mondiale de Berck où il fonda plusieurs établissements hospitaliers. Grâce à la baronne de Rothschild, il fera construire en 1900-1902 un établissement hospitalier de luxe pour les enfants de familles aisées, l’institut orthopédique de Berck, devenu institut Saint-François-de-Sales. D’une capacité initiale de cent lits, l’hôpital atteint les six cents lits en 1939. C’est là qu’il passe la majeure partie de sa vie professionnelle, tout en dirigeant deux autres centres ouverts avenue Montaigne à Paris et à Argelès-Gazost dans ses Pyrénées natales. De 1906 à 1933, il donnera à Berck un cours d’orthopédie d’une semaine, destiné aux médecins et étudiants et attirant des centaines de médecins du monde entier. Il participera en outre aux congrès internationaux de médecine et de chirurgie de Moscou (1897), Madrid (1903) et Lisbonne (1906), et présidera le jury de la classe de médecine et de chirurgie à l’exposition internationale de Bruxelles de 1910. Il est l’auteur de nombreux ouvrages spécialisés sur les scolioses, les pathologies de la hanche chez l’enfant, l’orthopédie en général et dont l’œuvre majeure dans le domaine de l’édition restera « L’orthopédie indispensable aux praticiens », édité en 1909 chez Masson, puis réédité de nombreuses fois chez Maloine, traduit et publié à l’étranger. Il sera fait chevalier de la Légion d’honneur le 20 octobre 1911 et promu officier par décret du 14 février 1921 pour services rendus aux blessés et malades militaires pendant la Grande Guerre. Durant la guerre de 14-18, il fut désigné comme médecin-chef de trois des hôpitaux militaires de Berck. Lui, le chirurgien des enfants et de la tuberculose va devenir un expert en traumatologie de guerre. Dès 1916, il publie l’ouvrage « Orthopédie et chirurgie de guerre » qui sera réédité à trois reprises et traduit en plusieurs langues. Pour lui l’immobilisation des fractures doit être réalisée de façon rigoureuse le plus rapidement possible. Il propose de réaliser dans les ambulances mêmes du front des appareils plâtrés fenêtrés en lieu et place des extensions ou des gouttières métalliques, source de déplacement lors des transports vers les hôpitaux de l’arrière. Et il se fait surtout le chantre de la méthode conservatrice « jamais d’amputation hors de la gangrène déclarée, jamais d’ablation primitive d’esquilles ». Marié le 18 octobre 1894 à Marie Bacqueville, ils auront quatre filles. Au décès de son épouse en 1934, il vendra l’Institut Saint-François de Sales à une société anonyme, dite société Calot, mais continuera à diriger l’établissement jusqu’à sa retraite en 1941. Dès lors, il s’installera définitivement au château de Miramont à Adast, qu’il avait acheté en 1906 et où il décèdera en 1944. Il sera inhumé dans la chapelle du château, aux côtés de son épouse. En 1970, la propriété ayant été vendue par ses filles à Jacques Chancel, leurs cendres furent transférées dans le cimetière d’Arrens. Son nom reste surtout présent aujourd’hui grâce à l’Institut Calot de Berck-sur-Mer, qu’il a créé et qui est resté un établissement hautement spécialisé dans la prise en charge des pathologies orthopédiques et des affections neurologiques tant sur le plan médical que chirurgical. Son frère, l’abbé Paul François Calot, fut lui directeur du Château-observatoire d’Abbadia (1923-1944) près d’Hendaye, qui poursuivant l’œuvre de son prédécesseur Aloys Verschaffel, publia de nombreux catalogues d’étoiles.
François CALOT, né le 17 mai 1861 à Arrens-Marsous et mort le 1er mars 1944 à Adast, à l’âge de 82 ans. Cinquième enfant d’une fratrie de huit d’une famille de cultivateurs, reçu au baccalauréat en 1880 à Saint-Pé-de-Bigorre, il monte faire médecine à Paris en 1881. Et pour payer ses études, il deviendra répétiteur à l’école Fénelon tenue par des jésuites. Élève brillant de la faculté de médecine, il est prosecteur et étudie l’anatomie et la dissection sous la direction d’un chef des travaux pratiques novateur, Louis-Hubert Farabeuf (1841-1910). Il sera reçu 9e sur 52 au concours d’internat en 1887. Après quelques années aux hôpitaux Saint-Louis et Bichat, il sera nommé en tant qu’interne à l’Hôpital maritime de Berck-sur-Mer. Il y assurera l’intérim du poste de chirurgien-chef, en raison de la maladie du docteur Henri Cazin, qui décèdera en 1891. En novembre 1891, il obtiendra la direction de l’hôpital Nathaniel-de-Rothschild, ainsi que celle du dispensaire Henri-de-Rothschild, inauguré le 6 juin 1892 pour les enfants pauvres de la région. Il devient célèbre en présentant, le 22 décembre 1896, devant l’Académie de médecine, 37 observations de réduction de gibbosité pottique par une méthode très simple : "Endormi au chloroforme, le malade est retourné sur le ventre et, pendant que deux ou quatre aides, suivant l’âge et la taille de l’enfant, exercent à la tête et aux pieds des tractions vigoureuses, l’opérateur pèse de tout son poids et de toute sa vigueur sur la bosse jusqu’à ce que la partie déviée de la colonne vertébrale soit rentrée dans l’alignement. Cela dure deux minutes au maximum. Après quoi un plâtre est confectionné pour assurer une immobilisation prolongée. Dans les 37 cas il n’y a eu que des succès". Sa renommée internationale, relayée par les caricaturistes, attire à Berck les patients les plus illustres, venus du monde entier. Il allait être connu comme celui qui savait redresser les bossus. Il contribua à la renommée mondiale de Berck où il fonda plusieurs établissements hospitaliers. Grâce à la baronne de Rothschild, il fera construire en 1900-1902 un établissement hospitalier de luxe pour les enfants de familles aisées, l’institut orthopédique de Berck, devenu institut Saint-François-de-Sales. D’une capacité initiale de cent lits, l’hôpital atteint les six cents lits en 1939. C’est là qu’il passe la majeure partie de sa vie professionnelle, tout en dirigeant deux autres centres ouverts avenue Montaigne à Paris et à Argelès-Gazost dans ses Pyrénées natales. De 1906 à 1933, il donnera à Berck un cours d’orthopédie d’une semaine, destiné aux médecins et étudiants et attirant des centaines de médecins du monde entier. Il participera en outre aux congrès internationaux de médecine et de chirurgie de Moscou (1897), Madrid (1903) et Lisbonne (1906), et présidera le jury de la classe de médecine et de chirurgie à l’exposition internationale de Bruxelles de 1910. Il est l’auteur de nombreux ouvrages spécialisés sur les scolioses, les pathologies de la hanche chez l’enfant, l’orthopédie en général et dont l’œuvre majeure dans le domaine de l’édition restera « L’orthopédie indispensable aux praticiens », édité en 1909 chez Masson, puis réédité de nombreuses fois chez Maloine, traduit et publié à l’étranger. Il sera fait chevalier de la Légion d’honneur le 20 octobre 1911 et promu officier par décret du 14 février 1921 pour services rendus aux blessés et malades militaires pendant la Grande Guerre. Durant la guerre de 14-18, il fut désigné comme médecin-chef de trois des hôpitaux militaires de Berck. Lui, le chirurgien des enfants et de la tuberculose va devenir un expert en traumatologie de guerre. Dès 1916, il publie l’ouvrage « Orthopédie et chirurgie de guerre » qui sera réédité à trois reprises et traduit en plusieurs langues. Pour lui l’immobilisation des fractures doit être réalisée de façon rigoureuse le plus rapidement possible. Il propose de réaliser dans les ambulances mêmes du front des appareils plâtrés fenêtrés en lieu et place des extensions ou des gouttières métalliques, source de déplacement lors des transports vers les hôpitaux de l’arrière. Et il se fait surtout le chantre de la méthode conservatrice « jamais d’amputation hors de la gangrène déclarée, jamais d’ablation primitive d’esquilles ». Marié le 18 octobre 1894 à Marie Bacqueville, ils auront quatre filles. Au décès de son épouse en 1934, il vendra l’Institut Saint-François de Sales à une société anonyme, dite société Calot, mais continuera à diriger l’établissement jusqu’à sa retraite en 1941. Dès lors, il s’installera définitivement au château de Miramont à Adast, qu’il avait acheté en 1906 et où il décèdera en 1944. Il sera inhumé dans la chapelle du château, aux côtés de son épouse. En 1970, la propriété ayant été vendue par ses filles à Jacques Chancel, leurs cendres furent transférées dans le cimetière d’Arrens. Son nom reste surtout présent aujourd’hui grâce à l’Institut Calot de Berck-sur-Mer, qu’il a créé et qui est resté un établissement hautement spécialisé dans la prise en charge des pathologies orthopédiques et des affections neurologiques tant sur le plan médical que chirurgical. Son frère, l’abbé Paul François Calot, fut lui directeur du Château-observatoire d’Abbadia (1923-1944) près d’Hendaye, qui poursuivant l’œuvre de son prédécesseur Aloys Verschaffel, publia de nombreux catalogues d’étoiles.CAMELAT Michel (1871-1962)
Commerçant, dramaturge, poète et écrivain occitan, nouvelliste et éditeur
 Michel CAMELAT, né le 26 janvier 1871 à Arrens et mort le 19 novembre 1962 à Tarbes, à l’âge de 90 ans, est le grand écrivain moderne de la Gascogne, dont l’aventure littéraire vient en contrepoint d’une existence modeste d’épicier de village. Il est le fils unique de Jean-Pierre Camélat, cordonnier et de Marianne Four-Pome, son épouse. De 1882 à 1886, il fait ses études secondaires au petit séminaire de Saint-Pé-de-Bigorre, où il est un élève remuant et souvent malade. À l’âge de 17 ans, refusant de s’engager sur la voie de la prêtrise suivant les vœux de ses parents, ceux-ci le retirent du collège. De retour dans sa famille, il multiplie les lectures et, avec l’aide des prêtres du sanctuaire voisin de Pouey-Laün, acquiert une culture classique et se consacre désormais à l’étude du gascon et de sa littérature. Premiers poèmes et premières chansons. Il commence un lexique, recueille des proverbes et élabore les statuts d’une société des amis du gascon. Il découvre le poète chansonnier Cyprien Despourrins et les Papillotos de Jasmin. Il entre en relation avec l’érudit bigourdan, Jean Bourdette, qui lui conseille en 1889 de faire œuvre « en lavedanais ».
Michel CAMELAT, né le 26 janvier 1871 à Arrens et mort le 19 novembre 1962 à Tarbes, à l’âge de 90 ans, est le grand écrivain moderne de la Gascogne, dont l’aventure littéraire vient en contrepoint d’une existence modeste d’épicier de village. Il est le fils unique de Jean-Pierre Camélat, cordonnier et de Marianne Four-Pome, son épouse. De 1882 à 1886, il fait ses études secondaires au petit séminaire de Saint-Pé-de-Bigorre, où il est un élève remuant et souvent malade. À l’âge de 17 ans, refusant de s’engager sur la voie de la prêtrise suivant les vœux de ses parents, ceux-ci le retirent du collège. De retour dans sa famille, il multiplie les lectures et, avec l’aide des prêtres du sanctuaire voisin de Pouey-Laün, acquiert une culture classique et se consacre désormais à l’étude du gascon et de sa littérature. Premiers poèmes et premières chansons. Il commence un lexique, recueille des proverbes et élabore les statuts d’une société des amis du gascon. Il découvre le poète chansonnier Cyprien Despourrins et les Papillotos de Jasmin. Il entre en relation avec l’érudit bigourdan, Jean Bourdette, qui lui conseille en 1889 de faire œuvre « en lavedanais ».
1888 - il découvre l’œuvre des Félibres – les écrivains en langue d’Oc – grâce à l’anthologie des Poètes provençaux contemporains, puis Mirèio qui est une révélation. Pendant longtemps, il relira tous les ans le chef-d’œuvre de Frédéric Mistral.
1890 - lors d’une « félibrée » à Tarbes, où il obtient un premier prix de poésie, il fait la connaissance du jeune Simin Palay (né en 1874, écrivain et futur lexicographe du gascon) ainsi que du chartiste Jean Passy (auteur de l’Origine des Ossalois), avec lesquels il se lie d’amitié et collaborera toute sa vie.
1891 - il publie « Le patois d’Arrens », étude sur le gascon pyrénéen du Lavedan. C’est dans cette variété de langue, qu’il compose ses premiers essais poétiques. Quatre ans plus tard, il abandonnera définitivement les formes de langue autochtones (gascon lavedanais), du moins à l’écrit, pour n’écrire désormais que dans le gascon du Béarn, senti comme plus classique et lui permettant d’être lu dans toute la Gascogne – Pau constituant par ailleurs un foyer de production relativement actif.
1893 - soucieux de s’adresser en langue d’Oc au public le plus large possible, il publie avec Simin Palay un premier almanach - l’Armanac patouès de la Bigorro - qui devient dès l’année suivante l’Armanac gascou (Bigorre, Béarn, Armagnac, Landes).
1895 - publication d’un recueil de chansons « Et piu-piu dera me laguta » (Cansoûs gascounas, Tarbes, Lescamela). L’introduction est un vibrant manifeste en faveur de la langue.
1896 - le 2 janvier, à l’instigation de Camelat principalement, fondation à Pau avec Simin Palay et Daniel Lafore de l’Escole Gastou Febus. Il ne s’agit pas d’une structure scolaire, mais d’une antenne du Félibrige qui entend organiser et fédérer l’action en faveur de la langue d’Oc sur l’ensemble de la Gascogne.
1897 - fondation de Reclams de Bearn e Gascounhe, revue de l’Escole à caractère littéraire et militant.
Le 22 février, mariage avec Catherine Augé. Le ménage vivra à Arrens, village que Miquèu n’a jamais voulu quitter malgré le souhait de son épouse d’une installation à Argelès-Gazost ou à Lourdes. Le couple aura quatre enfants, dont deux mourront en bas âge. Catherine ne considérait pas sans méfiance les travaux littéraires de son mari, d’autant que celui-ci tenait sans enthousiasme particulier, quoiqu’avec sérieux, le commerce qui assurait la subsistance du ménage. Toutefois, malgré des difficultés financières épisodiques, le couple resta uni.
1898 - le 26 juin, naissance à Arrens d’Isabelle-Jeanne-Marie (Beline). Il commence vraisemblablement Mourte e Bibe dont l’écriture s’étalera sur 15 ans.
1899 - première édition de Beline (Tarbes, Lescamela), qui lui vaut immédiatement une lettre bienveillante de Mistral et la consécration au sein du Félibrige.
1900 - naissance le 14 avril de Jean-Pierre-Jacques Camélat, qui décédera le 11 juillet de la même année. Le 21 mai, Miquèu est élu maire d’Arrens. Il le restera jusqu’au mois de mars 1904.
1901- l’organisation le 21 mai à Pau et le succès de la « Santa Estela », rassemblement annuel du Félibrige, en présence de Mistral son fondateur, consacrent l’action des félibres gascons et la détermination de Miquèu, à tel point que la date du 21 mai 1901 servira de sous-titre à Mourte e Bibe.
Le premier août, jour de la Saint-Pierre aux liens, (le jour dont sera datée Mourte e Bibe), naissance de Pierre-Michel Camélat.
Le ménage s’installe au centre d’Arrens, dans la maison que Camelat ne quittera qu’à la fin de sa vie.
1905 - le 19 août, décès de sa fille Beline, âgée de 7 ans.
1906 - le 6 juin, naissance de Beline-Marie, deuxième fille de Camelat à porter ce nom.
1910 - Beline, 2e édition, Tarbes, Dusséqué.
Le 15 janvier, parution du premier numéro du journal La Bouts de la Terre. Miquèu, en rupture avec la ligne trop « francimande » suivie par Reclams, fonde un bimensuel de 4 pages, bon marché, qui s’adresse au peuple. La Bouts de la Terre, rédigé intégralement en langue d’Oc et dans une écriture unifiée, paraîtra sans interruption jusqu’à la Première Guerre mondiale. Après la guerre, Miquèu ne parviendra pas à relancer cette publication et prendra en charge la rédaction de Reclams.
1911 - voyage en Catalogne. Griset nouste, divertissement en un acte, Pau, Marrimpouey, sur le modèle d’une comédie découverte à Barcelone, ouvre une série d’œuvres écrites pour le théâtre.
1912 - Roubi lou sounadou, pastourale en cinq estanques e en prose, La Bouts de la Terre (Pau, Marrimpouey). A l’aygue douce nou-b hidét ! [Méfiez-vous de l’eau qui dort], comédie proverbe, Pau, Marrimpouey.
1914 - Gastou-Febus, pièce en cinq actes et en vers, Pau, La Bouts de la Terre, premier drame historique.
Mobilisation de Miquèu, qui sera profondément affecté par la guerre et son cortège de deuils, en particulier celui du jeune poète Jean-Baptiste Bégarie, fils spirituel et ami, tué sur le front en 1915.
1916 - Lou darrè Calhabari [Le dernier Charivari], divertissement en un acte, Pau, Marrimpouey.
1920 - Mourte e Bibe, Pau, Marrimpouey. Le poème épique était achevé en 1913, mais sa parution fut retardée par la guerre.
1924 - Lola « drame lyrique », deuxième drame historique, Samatan, Editouriau Occitan.
1926 - Beline, (3e édition), Pau, Marrimpouey. Décès de la mère de l’écrivain.
1928 - mort de son père. Garbe de pouesies (1520-1920), anthologie à usage scolaire, Pau Marrimpouey.
1931 - début d’une relation épistolaire avec le jeune poète Andrèu Pic.
1933 - Garbe de proses (1775-1930), anthologie, Pau, Marrimpouey. Nouvelle édition de A l’aygue douce nou-b hidét ! Lourdes, Lacrampe.
1934 - L’espigue aus dits, recueil de poèmes, Pau, Marrimpouey.
1936 - Nouvelle édition de Gastou-Febus, Pau, Marrimpouey.
1937 - Bite-bitante, recueil de nouvelles, Pau, Marrimpouey.
1938 - Lous Memòris d’u Capbourrut, [autobiographie de ses premières années jusqu’à la publication de Beline], Pau, Marrimpouey.
1939 - nouvelle édition de Lole, drame en trois actes et en vers, Pau, Marrimpouey.
1942 - Lou Piu-piu de la mie flahute, reprise en gascon béarnais de l’ouvrage de 1895, Pau, Marrimpouey.
1943 - mort de son fils Pierre, le 27 juillet. Médecin, celui-ci contracta le choléra auprès des malades qu’il soignait dans les Landes, à Luxey.
1946 - tros causits de pouesie e de prose à l’usance de las escoles primàris, Pau, Marrimpouey.
1950 - la literature gascoune de las hounts prumères a oey lou die, Pau, Marrimpouey.
1951 - Mourte e Bibe, nouvelle édition remaniée, Pau, Marrimpouey.
1957 - Garbe de pouesies (1567-1957), 2e édition, remaniée, Pau, Marrimpouey.
1958 - mort d’André Pic à qui Miquèu comptait confier la rédaction de Reclams, assurée par Marcel Saint-Bézard à partir de cette année-là.
1962 - âgé et quasiment aveugle, Miquèu s’éteint le 19 novembre à Tarbes où sa fille Beline (Mme Vammale) l’a recueilli. Édition définitive de Belina en graphie classique, préface de Robert Lafont, traduction française et notes critiques de Pierre Bec et Robert Lafont, Tolosa, Institut d’Estudis Occitans.
Dans son petit village d’Arrens, où il ne parla et n’écrivit jamais qu’en langue d’Oc, vêtu sans jamais varier à la mode bigourdane, avec le petit béret, le court veston, la large ceinture, il a écrit des poésies qui portent la marque de son existence et qui attirèrent immédiatement sur lui l’attention du Félibrige. Son poème en trois chants, Beline, le classa parmi les meilleurs poètes méridionaux ; il lui fit accorder une fleur par l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse et l’introduisit dans le Consistoire des Majoraux, en remplacement de Léonce Couture, ancien doyen de la Faculté libre des Lettres de Toulouse. Cet épicier-poète à l’origine avec quelques amis de l’Escole Gastoû Febus et de la revue Reclams de Biarn e Gascougne, compte parmi les plus grands écrivains gascons. Avec Simin Palay, le plus grand poète en béarnais, il est une figure marquante du renouveau culturel et littéraire du début du XXe siècle. Son buste, inauguré à Arrens le 20 octobre 1963, se dresse dans le petit jardin en face de l’école.
 Michel CAMELAT, né le 26 janvier 1871 à Arrens et mort le 19 novembre 1962 à Tarbes, à l’âge de 90 ans, est le grand écrivain moderne de la Gascogne, dont l’aventure littéraire vient en contrepoint d’une existence modeste d’épicier de village. Il est le fils unique de Jean-Pierre Camélat, cordonnier et de Marianne Four-Pome, son épouse. De 1882 à 1886, il fait ses études secondaires au petit séminaire de Saint-Pé-de-Bigorre, où il est un élève remuant et souvent malade. À l’âge de 17 ans, refusant de s’engager sur la voie de la prêtrise suivant les vœux de ses parents, ceux-ci le retirent du collège. De retour dans sa famille, il multiplie les lectures et, avec l’aide des prêtres du sanctuaire voisin de Pouey-Laün, acquiert une culture classique et se consacre désormais à l’étude du gascon et de sa littérature. Premiers poèmes et premières chansons. Il commence un lexique, recueille des proverbes et élabore les statuts d’une société des amis du gascon. Il découvre le poète chansonnier Cyprien Despourrins et les Papillotos de Jasmin. Il entre en relation avec l’érudit bigourdan, Jean Bourdette, qui lui conseille en 1889 de faire œuvre « en lavedanais ».
Michel CAMELAT, né le 26 janvier 1871 à Arrens et mort le 19 novembre 1962 à Tarbes, à l’âge de 90 ans, est le grand écrivain moderne de la Gascogne, dont l’aventure littéraire vient en contrepoint d’une existence modeste d’épicier de village. Il est le fils unique de Jean-Pierre Camélat, cordonnier et de Marianne Four-Pome, son épouse. De 1882 à 1886, il fait ses études secondaires au petit séminaire de Saint-Pé-de-Bigorre, où il est un élève remuant et souvent malade. À l’âge de 17 ans, refusant de s’engager sur la voie de la prêtrise suivant les vœux de ses parents, ceux-ci le retirent du collège. De retour dans sa famille, il multiplie les lectures et, avec l’aide des prêtres du sanctuaire voisin de Pouey-Laün, acquiert une culture classique et se consacre désormais à l’étude du gascon et de sa littérature. Premiers poèmes et premières chansons. Il commence un lexique, recueille des proverbes et élabore les statuts d’une société des amis du gascon. Il découvre le poète chansonnier Cyprien Despourrins et les Papillotos de Jasmin. Il entre en relation avec l’érudit bigourdan, Jean Bourdette, qui lui conseille en 1889 de faire œuvre « en lavedanais ».1888 - il découvre l’œuvre des Félibres – les écrivains en langue d’Oc – grâce à l’anthologie des Poètes provençaux contemporains, puis Mirèio qui est une révélation. Pendant longtemps, il relira tous les ans le chef-d’œuvre de Frédéric Mistral.
1890 - lors d’une « félibrée » à Tarbes, où il obtient un premier prix de poésie, il fait la connaissance du jeune Simin Palay (né en 1874, écrivain et futur lexicographe du gascon) ainsi que du chartiste Jean Passy (auteur de l’Origine des Ossalois), avec lesquels il se lie d’amitié et collaborera toute sa vie.
1891 - il publie « Le patois d’Arrens », étude sur le gascon pyrénéen du Lavedan. C’est dans cette variété de langue, qu’il compose ses premiers essais poétiques. Quatre ans plus tard, il abandonnera définitivement les formes de langue autochtones (gascon lavedanais), du moins à l’écrit, pour n’écrire désormais que dans le gascon du Béarn, senti comme plus classique et lui permettant d’être lu dans toute la Gascogne – Pau constituant par ailleurs un foyer de production relativement actif.
1893 - soucieux de s’adresser en langue d’Oc au public le plus large possible, il publie avec Simin Palay un premier almanach - l’Armanac patouès de la Bigorro - qui devient dès l’année suivante l’Armanac gascou (Bigorre, Béarn, Armagnac, Landes).
1895 - publication d’un recueil de chansons « Et piu-piu dera me laguta » (Cansoûs gascounas, Tarbes, Lescamela). L’introduction est un vibrant manifeste en faveur de la langue.
1896 - le 2 janvier, à l’instigation de Camelat principalement, fondation à Pau avec Simin Palay et Daniel Lafore de l’Escole Gastou Febus. Il ne s’agit pas d’une structure scolaire, mais d’une antenne du Félibrige qui entend organiser et fédérer l’action en faveur de la langue d’Oc sur l’ensemble de la Gascogne.
1897 - fondation de Reclams de Bearn e Gascounhe, revue de l’Escole à caractère littéraire et militant.
Le 22 février, mariage avec Catherine Augé. Le ménage vivra à Arrens, village que Miquèu n’a jamais voulu quitter malgré le souhait de son épouse d’une installation à Argelès-Gazost ou à Lourdes. Le couple aura quatre enfants, dont deux mourront en bas âge. Catherine ne considérait pas sans méfiance les travaux littéraires de son mari, d’autant que celui-ci tenait sans enthousiasme particulier, quoiqu’avec sérieux, le commerce qui assurait la subsistance du ménage. Toutefois, malgré des difficultés financières épisodiques, le couple resta uni.
1898 - le 26 juin, naissance à Arrens d’Isabelle-Jeanne-Marie (Beline). Il commence vraisemblablement Mourte e Bibe dont l’écriture s’étalera sur 15 ans.
1899 - première édition de Beline (Tarbes, Lescamela), qui lui vaut immédiatement une lettre bienveillante de Mistral et la consécration au sein du Félibrige.
1900 - naissance le 14 avril de Jean-Pierre-Jacques Camélat, qui décédera le 11 juillet de la même année. Le 21 mai, Miquèu est élu maire d’Arrens. Il le restera jusqu’au mois de mars 1904.
1901- l’organisation le 21 mai à Pau et le succès de la « Santa Estela », rassemblement annuel du Félibrige, en présence de Mistral son fondateur, consacrent l’action des félibres gascons et la détermination de Miquèu, à tel point que la date du 21 mai 1901 servira de sous-titre à Mourte e Bibe.
Le premier août, jour de la Saint-Pierre aux liens, (le jour dont sera datée Mourte e Bibe), naissance de Pierre-Michel Camélat.
Le ménage s’installe au centre d’Arrens, dans la maison que Camelat ne quittera qu’à la fin de sa vie.
1905 - le 19 août, décès de sa fille Beline, âgée de 7 ans.
1906 - le 6 juin, naissance de Beline-Marie, deuxième fille de Camelat à porter ce nom.
1910 - Beline, 2e édition, Tarbes, Dusséqué.
Le 15 janvier, parution du premier numéro du journal La Bouts de la Terre. Miquèu, en rupture avec la ligne trop « francimande » suivie par Reclams, fonde un bimensuel de 4 pages, bon marché, qui s’adresse au peuple. La Bouts de la Terre, rédigé intégralement en langue d’Oc et dans une écriture unifiée, paraîtra sans interruption jusqu’à la Première Guerre mondiale. Après la guerre, Miquèu ne parviendra pas à relancer cette publication et prendra en charge la rédaction de Reclams.
1911 - voyage en Catalogne. Griset nouste, divertissement en un acte, Pau, Marrimpouey, sur le modèle d’une comédie découverte à Barcelone, ouvre une série d’œuvres écrites pour le théâtre.
1912 - Roubi lou sounadou, pastourale en cinq estanques e en prose, La Bouts de la Terre (Pau, Marrimpouey). A l’aygue douce nou-b hidét ! [Méfiez-vous de l’eau qui dort], comédie proverbe, Pau, Marrimpouey.
1914 - Gastou-Febus, pièce en cinq actes et en vers, Pau, La Bouts de la Terre, premier drame historique.
Mobilisation de Miquèu, qui sera profondément affecté par la guerre et son cortège de deuils, en particulier celui du jeune poète Jean-Baptiste Bégarie, fils spirituel et ami, tué sur le front en 1915.
1916 - Lou darrè Calhabari [Le dernier Charivari], divertissement en un acte, Pau, Marrimpouey.
1920 - Mourte e Bibe, Pau, Marrimpouey. Le poème épique était achevé en 1913, mais sa parution fut retardée par la guerre.
1924 - Lola « drame lyrique », deuxième drame historique, Samatan, Editouriau Occitan.
1926 - Beline, (3e édition), Pau, Marrimpouey. Décès de la mère de l’écrivain.
1928 - mort de son père. Garbe de pouesies (1520-1920), anthologie à usage scolaire, Pau Marrimpouey.
1931 - début d’une relation épistolaire avec le jeune poète Andrèu Pic.
1933 - Garbe de proses (1775-1930), anthologie, Pau, Marrimpouey. Nouvelle édition de A l’aygue douce nou-b hidét ! Lourdes, Lacrampe.
1934 - L’espigue aus dits, recueil de poèmes, Pau, Marrimpouey.
1936 - Nouvelle édition de Gastou-Febus, Pau, Marrimpouey.
1937 - Bite-bitante, recueil de nouvelles, Pau, Marrimpouey.
1938 - Lous Memòris d’u Capbourrut, [autobiographie de ses premières années jusqu’à la publication de Beline], Pau, Marrimpouey.
1939 - nouvelle édition de Lole, drame en trois actes et en vers, Pau, Marrimpouey.
1942 - Lou Piu-piu de la mie flahute, reprise en gascon béarnais de l’ouvrage de 1895, Pau, Marrimpouey.
1943 - mort de son fils Pierre, le 27 juillet. Médecin, celui-ci contracta le choléra auprès des malades qu’il soignait dans les Landes, à Luxey.
1946 - tros causits de pouesie e de prose à l’usance de las escoles primàris, Pau, Marrimpouey.
1950 - la literature gascoune de las hounts prumères a oey lou die, Pau, Marrimpouey.
1951 - Mourte e Bibe, nouvelle édition remaniée, Pau, Marrimpouey.
1957 - Garbe de pouesies (1567-1957), 2e édition, remaniée, Pau, Marrimpouey.
1958 - mort d’André Pic à qui Miquèu comptait confier la rédaction de Reclams, assurée par Marcel Saint-Bézard à partir de cette année-là.
1962 - âgé et quasiment aveugle, Miquèu s’éteint le 19 novembre à Tarbes où sa fille Beline (Mme Vammale) l’a recueilli. Édition définitive de Belina en graphie classique, préface de Robert Lafont, traduction française et notes critiques de Pierre Bec et Robert Lafont, Tolosa, Institut d’Estudis Occitans.
Dans son petit village d’Arrens, où il ne parla et n’écrivit jamais qu’en langue d’Oc, vêtu sans jamais varier à la mode bigourdane, avec le petit béret, le court veston, la large ceinture, il a écrit des poésies qui portent la marque de son existence et qui attirèrent immédiatement sur lui l’attention du Félibrige. Son poème en trois chants, Beline, le classa parmi les meilleurs poètes méridionaux ; il lui fit accorder une fleur par l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse et l’introduisit dans le Consistoire des Majoraux, en remplacement de Léonce Couture, ancien doyen de la Faculté libre des Lettres de Toulouse. Cet épicier-poète à l’origine avec quelques amis de l’Escole Gastoû Febus et de la revue Reclams de Biarn e Gascougne, compte parmi les plus grands écrivains gascons. Avec Simin Palay, le plus grand poète en béarnais, il est une figure marquante du renouveau culturel et littéraire du début du XXe siècle. Son buste, inauguré à Arrens le 20 octobre 1963, se dresse dans le petit jardin en face de l’école.
CASTEX Jean (1965-XXXX)
Premier ministre, ancien élève du lycée Notre-Dame de Garaison à Monléon-Magnoac
 Jean CASTEX, né le 25 juin 1965 à Vic-Fezensac dans le Gers, est un haut fonctionnaire et homme d'État français. Il est Premier ministre depuis le 3 juillet 2020. Il est le fils de Claude Castex, instituteur, et de Nicole Fontanier, également institutrice, décédée le 16 janvier 2020. Il a été interne, à sa demande, scolarisé de la classe de seconde à celle de terminale (1979-1982), au lycée privé de Garaison à Monléon-Magnoac dans les Hautes-Pyrénées, institution de l'enseignement catholique, où il obtient en 1982 son baccalauréat C (filière scientifique) avec mention. L’établissement scolaire était alors dirigé par le père Yves Laguilhony († 2017). Après sa scolarité en Magnoac, Jean Castex a continué à entretenir des liens suivis avec son ancien directeur. C’est ainsi qu’en 1988, le père Yves Laguilhony alla célébrer son mariage, dans les Pyrénées-Orientales. C’est aussi ainsi que Jean Castex vint à Garaison, pour entourer le père Yves Laguilhony lors de la fête organisée le 2 décembre 2017 à l’occasion du quatre-vingt-dixième anniversaire du père, à la tête de l’établissement scolaire de 1962 à 1987. Autre marque de son attachement à Garaison, il y fut le vice-président de l’Ogec (Organisme de gestion des établissements catholiques). Jean Castex a laissé le souvenir d’un élève brillant, doté d’une forte mémoire et très jovial avec ses camarades. Et le voilà aujourd’hui Premier ministre d’Emmanuel Macron, qui lui-même ne fait pas mystère de ses liens familiaux bigourdans, avec des grands-parents bagnérais.
Jean CASTEX, né le 25 juin 1965 à Vic-Fezensac dans le Gers, est un haut fonctionnaire et homme d'État français. Il est Premier ministre depuis le 3 juillet 2020. Il est le fils de Claude Castex, instituteur, et de Nicole Fontanier, également institutrice, décédée le 16 janvier 2020. Il a été interne, à sa demande, scolarisé de la classe de seconde à celle de terminale (1979-1982), au lycée privé de Garaison à Monléon-Magnoac dans les Hautes-Pyrénées, institution de l'enseignement catholique, où il obtient en 1982 son baccalauréat C (filière scientifique) avec mention. L’établissement scolaire était alors dirigé par le père Yves Laguilhony († 2017). Après sa scolarité en Magnoac, Jean Castex a continué à entretenir des liens suivis avec son ancien directeur. C’est ainsi qu’en 1988, le père Yves Laguilhony alla célébrer son mariage, dans les Pyrénées-Orientales. C’est aussi ainsi que Jean Castex vint à Garaison, pour entourer le père Yves Laguilhony lors de la fête organisée le 2 décembre 2017 à l’occasion du quatre-vingt-dixième anniversaire du père, à la tête de l’établissement scolaire de 1962 à 1987. Autre marque de son attachement à Garaison, il y fut le vice-président de l’Ogec (Organisme de gestion des établissements catholiques). Jean Castex a laissé le souvenir d’un élève brillant, doté d’une forte mémoire et très jovial avec ses camarades. Et le voilà aujourd’hui Premier ministre d’Emmanuel Macron, qui lui-même ne fait pas mystère de ses liens familiaux bigourdans, avec des grands-parents bagnérais.
 Jean CASTEX, né le 25 juin 1965 à Vic-Fezensac dans le Gers, est un haut fonctionnaire et homme d'État français. Il est Premier ministre depuis le 3 juillet 2020. Il est le fils de Claude Castex, instituteur, et de Nicole Fontanier, également institutrice, décédée le 16 janvier 2020. Il a été interne, à sa demande, scolarisé de la classe de seconde à celle de terminale (1979-1982), au lycée privé de Garaison à Monléon-Magnoac dans les Hautes-Pyrénées, institution de l'enseignement catholique, où il obtient en 1982 son baccalauréat C (filière scientifique) avec mention. L’établissement scolaire était alors dirigé par le père Yves Laguilhony († 2017). Après sa scolarité en Magnoac, Jean Castex a continué à entretenir des liens suivis avec son ancien directeur. C’est ainsi qu’en 1988, le père Yves Laguilhony alla célébrer son mariage, dans les Pyrénées-Orientales. C’est aussi ainsi que Jean Castex vint à Garaison, pour entourer le père Yves Laguilhony lors de la fête organisée le 2 décembre 2017 à l’occasion du quatre-vingt-dixième anniversaire du père, à la tête de l’établissement scolaire de 1962 à 1987. Autre marque de son attachement à Garaison, il y fut le vice-président de l’Ogec (Organisme de gestion des établissements catholiques). Jean Castex a laissé le souvenir d’un élève brillant, doté d’une forte mémoire et très jovial avec ses camarades. Et le voilà aujourd’hui Premier ministre d’Emmanuel Macron, qui lui-même ne fait pas mystère de ses liens familiaux bigourdans, avec des grands-parents bagnérais.
Jean CASTEX, né le 25 juin 1965 à Vic-Fezensac dans le Gers, est un haut fonctionnaire et homme d'État français. Il est Premier ministre depuis le 3 juillet 2020. Il est le fils de Claude Castex, instituteur, et de Nicole Fontanier, également institutrice, décédée le 16 janvier 2020. Il a été interne, à sa demande, scolarisé de la classe de seconde à celle de terminale (1979-1982), au lycée privé de Garaison à Monléon-Magnoac dans les Hautes-Pyrénées, institution de l'enseignement catholique, où il obtient en 1982 son baccalauréat C (filière scientifique) avec mention. L’établissement scolaire était alors dirigé par le père Yves Laguilhony († 2017). Après sa scolarité en Magnoac, Jean Castex a continué à entretenir des liens suivis avec son ancien directeur. C’est ainsi qu’en 1988, le père Yves Laguilhony alla célébrer son mariage, dans les Pyrénées-Orientales. C’est aussi ainsi que Jean Castex vint à Garaison, pour entourer le père Yves Laguilhony lors de la fête organisée le 2 décembre 2017 à l’occasion du quatre-vingt-dixième anniversaire du père, à la tête de l’établissement scolaire de 1962 à 1987. Autre marque de son attachement à Garaison, il y fut le vice-président de l’Ogec (Organisme de gestion des établissements catholiques). Jean Castex a laissé le souvenir d’un élève brillant, doté d’une forte mémoire et très jovial avec ses camarades. Et le voilà aujourd’hui Premier ministre d’Emmanuel Macron, qui lui-même ne fait pas mystère de ses liens familiaux bigourdans, avec des grands-parents bagnérais.CAZABAT Jean-Michel (1959-XXXX)
Créateur de chaussures de luxe basé aux États-Unis
 Jean-Michel CAZABAT, né en 1959 à Bordères-sur-l’Echez et installé aujourd’hui à New York, il chausse les célébrités comme Sharon Stone, Lenny Kravitz, Penélope Cruz, Madonna, Brooke Shields, Sarah Jessica Parker, Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Scarlette Johanssen, Kate Hudson, Mary-Kate Olsen, Oprah Winfrey, Michelle Obama et Lady Gaga. Rien ne le prédisposait à devenir le chausseur des stars. Adolescent, il rêvait d’être un grand photographe de mode et de charme et il choisit d’intégrer une école à Orthez pour rester dans son Sud-Ouest natal. À 17 ans, il couvre les matchs de rugby ou les concerts comme correspondant pour La Dépêche du Midi et La Nouvelle République des Pyrénées. Mais les piges ne paient pas le loyer. Un jour, un ami chausseur à Tarbes, Raymond Lacabanne, le présente à Roland Jourdan, un des designers très à la mode et patron des chaussures Charles Jourdan. Grâce à cet homme, il espérait rencontrer des photographes célèbres, qui travaillaient pour lui. En fait, il lui offre une place de vendeur à mi-temps dans une de ses boutiques de chaussures à Paris. En 1980, il accepta le poste et très vite, il devint un des meilleurs vendeurs de la société. Il lui confia alors la direction d’une première boutique, puis il le propulsa directeur adjoint de la plus prestigieuse boutique de la chaîne, celle des Champs-Élysées. La concurrence entendit parler de lui. Et en 1985, le chausseur Stephane Kélian, un autre artiste français de la bottine et du talon haut, le débauche pour qu’il prenne la direction de ses trois plus grandes enseignes parisiennes et lui confie en même temps la vente en gros aux acheteurs étrangers. Et la chance voulut que les résultats soient au rendez-vous. Du coup, Stephane Kélian lui demanda de venir avec lui à New York, où sa marque avait du mal à gagner des parts de marché. Il voulait qu’il lui donne son avis sur ce qu’il faudrait faire pour que les ventes décollent. Et il le propulsa responsable du marché américain où il développe un réseau de quinze magasins et de vente en gros de la côte Est à la côte Ouest. C’est ainsi qu’il s’installa dans la Grosse Pomme. Et en dix ans ils finirent par s’imposer comme les rois de la chaussure. Ils travaillaient alors pour les plus grands noms de la mode et de très nombreuses vedettes. Et désormais il prenait part à la création des collections. Tout de suite, il a montré un sens artistique certain. C’est vrai que faire de belles chaussures originales l’avait immédiatement séduit. Mais, en 1995, Kélian décida de vendre et de se retirer des affaires pour profiter de son argent. Jean-Michel ne souhaita pas rester, et voyant qu’il pouvait se libérer, la maison Charles Jourdan le relança. Il retourna dans la maison Jourdan avec le titre de directeur de la création, toujours depuis la Grosse Pomme. De 1995 à 1998, chez Jourdan, il participa à toute l’élaboration des collections et c’est lui qui créait ses modèles. Puis, à l’aube de ses 40 ans, lassé de devoir prendre en compte les points de vue des uns et des autres, il décide de travailler pour lui. Il monte sa propre affaire et se lance sous son propre nom. Ayant un peu d’argent de côté, il prend un magasin dans West Village, à l’angle de Bleecker Street et de la 10e Rue, dans le très chic quartier de SoHo sur Manhattan et depuis le 8 septembre 2011, son nom trône sur les vitrines d’une boutique de 170 mètres carrés. Il avait déjà une certaine renommée dans le milieu et les affaires prennent vite. Il crée des collections fabriquées à Milan en Italie, car les Américains ne sont pas très bons dans ce domaine. Il met en vente ses modèles dans des boutiques de mode new-yorkaises. Et ça marche ! Son truc, c’est de proposer de la qualité, de l’originalité et du confort. Sa ligne s’adresse à « une femme active, sexy, moderne qui a envie de se séduire et de séduire » expliquera-t-il. Il lance donc sa propre ligne féminine, ultra-féminine, colorée avec une gamme de chaussures vraiment exubérantes. Quelques années plus tard, pour les hommes il s’inspire de son propre style, avec connotation sixties, plutôt rock’n’roll, comme ses « bottines Beatles » en python métallisé. Ses sources d’inspiration étant le rock’n’roll et le monde de la nuit. Ses modèles représentant sa créativité et proposant un style avant-gardiste de la mode internationale, rapidement des journalistes s’intéressent à lui et des stars accourent dans ses magasins. Aujourd’hui, il chausse Sharon Stone, Lenny Kravitz, les actrices Kristen Stewart, Denise Richards, les chanteuses Miley et Cyrus Norah Jones, la famille Kardashian, mais aussi Mickey Rourke. Les comédiennes Penélope Cruz et Sarah Jessica Parker sont des clientes fidèles. Tous lui disent être « fous » de ses créations. Les plus grandes vedettes se baladent avec ses chaussures et les retombées sont exceptionnelles. Il vend entre 10 000 et 20 000 paires par an. Et celles réalisées pour les stars peuvent atteindre des prix vertigineux, surtout si on y incruste des diamants. Sinon, il vend aussi des modèles à 80 euros. Pour ses collections, il fait aussi confiance à son amie de toujours, Josy Bize, une New-Yorkaise adoptée, originaire de Lourdes, passée par les mêmes grandes maisons que lui, avant qu’ils ne décident de collaborer ensemble. Maintenant, comme il l’a fait pour Kélian, il cherche à ouvrir d’autres magasins dans le triangle d'or des boutiques de luxe et des marques de Paris et de Londres après Madison Avenue à New York qui concentre une clientèle fortunée, et un espace de vente à Hangzhou en Chine. Les chaussures de luxe Jean-Michel Cazabat sont disponibles dans les magasins de luxe du monde entier, y compris Barneys, Saks Fifth Avenue, Shopbop, Maxfield L.A. et certains magasins comme Neiman Marcus. On raconte que ses amis, Madonna ou Lionel Ritchie adorent son accent des Pyrénées.
Jean-Michel CAZABAT, né en 1959 à Bordères-sur-l’Echez et installé aujourd’hui à New York, il chausse les célébrités comme Sharon Stone, Lenny Kravitz, Penélope Cruz, Madonna, Brooke Shields, Sarah Jessica Parker, Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Scarlette Johanssen, Kate Hudson, Mary-Kate Olsen, Oprah Winfrey, Michelle Obama et Lady Gaga. Rien ne le prédisposait à devenir le chausseur des stars. Adolescent, il rêvait d’être un grand photographe de mode et de charme et il choisit d’intégrer une école à Orthez pour rester dans son Sud-Ouest natal. À 17 ans, il couvre les matchs de rugby ou les concerts comme correspondant pour La Dépêche du Midi et La Nouvelle République des Pyrénées. Mais les piges ne paient pas le loyer. Un jour, un ami chausseur à Tarbes, Raymond Lacabanne, le présente à Roland Jourdan, un des designers très à la mode et patron des chaussures Charles Jourdan. Grâce à cet homme, il espérait rencontrer des photographes célèbres, qui travaillaient pour lui. En fait, il lui offre une place de vendeur à mi-temps dans une de ses boutiques de chaussures à Paris. En 1980, il accepta le poste et très vite, il devint un des meilleurs vendeurs de la société. Il lui confia alors la direction d’une première boutique, puis il le propulsa directeur adjoint de la plus prestigieuse boutique de la chaîne, celle des Champs-Élysées. La concurrence entendit parler de lui. Et en 1985, le chausseur Stephane Kélian, un autre artiste français de la bottine et du talon haut, le débauche pour qu’il prenne la direction de ses trois plus grandes enseignes parisiennes et lui confie en même temps la vente en gros aux acheteurs étrangers. Et la chance voulut que les résultats soient au rendez-vous. Du coup, Stephane Kélian lui demanda de venir avec lui à New York, où sa marque avait du mal à gagner des parts de marché. Il voulait qu’il lui donne son avis sur ce qu’il faudrait faire pour que les ventes décollent. Et il le propulsa responsable du marché américain où il développe un réseau de quinze magasins et de vente en gros de la côte Est à la côte Ouest. C’est ainsi qu’il s’installa dans la Grosse Pomme. Et en dix ans ils finirent par s’imposer comme les rois de la chaussure. Ils travaillaient alors pour les plus grands noms de la mode et de très nombreuses vedettes. Et désormais il prenait part à la création des collections. Tout de suite, il a montré un sens artistique certain. C’est vrai que faire de belles chaussures originales l’avait immédiatement séduit. Mais, en 1995, Kélian décida de vendre et de se retirer des affaires pour profiter de son argent. Jean-Michel ne souhaita pas rester, et voyant qu’il pouvait se libérer, la maison Charles Jourdan le relança. Il retourna dans la maison Jourdan avec le titre de directeur de la création, toujours depuis la Grosse Pomme. De 1995 à 1998, chez Jourdan, il participa à toute l’élaboration des collections et c’est lui qui créait ses modèles. Puis, à l’aube de ses 40 ans, lassé de devoir prendre en compte les points de vue des uns et des autres, il décide de travailler pour lui. Il monte sa propre affaire et se lance sous son propre nom. Ayant un peu d’argent de côté, il prend un magasin dans West Village, à l’angle de Bleecker Street et de la 10e Rue, dans le très chic quartier de SoHo sur Manhattan et depuis le 8 septembre 2011, son nom trône sur les vitrines d’une boutique de 170 mètres carrés. Il avait déjà une certaine renommée dans le milieu et les affaires prennent vite. Il crée des collections fabriquées à Milan en Italie, car les Américains ne sont pas très bons dans ce domaine. Il met en vente ses modèles dans des boutiques de mode new-yorkaises. Et ça marche ! Son truc, c’est de proposer de la qualité, de l’originalité et du confort. Sa ligne s’adresse à « une femme active, sexy, moderne qui a envie de se séduire et de séduire » expliquera-t-il. Il lance donc sa propre ligne féminine, ultra-féminine, colorée avec une gamme de chaussures vraiment exubérantes. Quelques années plus tard, pour les hommes il s’inspire de son propre style, avec connotation sixties, plutôt rock’n’roll, comme ses « bottines Beatles » en python métallisé. Ses sources d’inspiration étant le rock’n’roll et le monde de la nuit. Ses modèles représentant sa créativité et proposant un style avant-gardiste de la mode internationale, rapidement des journalistes s’intéressent à lui et des stars accourent dans ses magasins. Aujourd’hui, il chausse Sharon Stone, Lenny Kravitz, les actrices Kristen Stewart, Denise Richards, les chanteuses Miley et Cyrus Norah Jones, la famille Kardashian, mais aussi Mickey Rourke. Les comédiennes Penélope Cruz et Sarah Jessica Parker sont des clientes fidèles. Tous lui disent être « fous » de ses créations. Les plus grandes vedettes se baladent avec ses chaussures et les retombées sont exceptionnelles. Il vend entre 10 000 et 20 000 paires par an. Et celles réalisées pour les stars peuvent atteindre des prix vertigineux, surtout si on y incruste des diamants. Sinon, il vend aussi des modèles à 80 euros. Pour ses collections, il fait aussi confiance à son amie de toujours, Josy Bize, une New-Yorkaise adoptée, originaire de Lourdes, passée par les mêmes grandes maisons que lui, avant qu’ils ne décident de collaborer ensemble. Maintenant, comme il l’a fait pour Kélian, il cherche à ouvrir d’autres magasins dans le triangle d'or des boutiques de luxe et des marques de Paris et de Londres après Madison Avenue à New York qui concentre une clientèle fortunée, et un espace de vente à Hangzhou en Chine. Les chaussures de luxe Jean-Michel Cazabat sont disponibles dans les magasins de luxe du monde entier, y compris Barneys, Saks Fifth Avenue, Shopbop, Maxfield L.A. et certains magasins comme Neiman Marcus. On raconte que ses amis, Madonna ou Lionel Ritchie adorent son accent des Pyrénées.
 Jean-Michel CAZABAT, né en 1959 à Bordères-sur-l’Echez et installé aujourd’hui à New York, il chausse les célébrités comme Sharon Stone, Lenny Kravitz, Penélope Cruz, Madonna, Brooke Shields, Sarah Jessica Parker, Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Scarlette Johanssen, Kate Hudson, Mary-Kate Olsen, Oprah Winfrey, Michelle Obama et Lady Gaga. Rien ne le prédisposait à devenir le chausseur des stars. Adolescent, il rêvait d’être un grand photographe de mode et de charme et il choisit d’intégrer une école à Orthez pour rester dans son Sud-Ouest natal. À 17 ans, il couvre les matchs de rugby ou les concerts comme correspondant pour La Dépêche du Midi et La Nouvelle République des Pyrénées. Mais les piges ne paient pas le loyer. Un jour, un ami chausseur à Tarbes, Raymond Lacabanne, le présente à Roland Jourdan, un des designers très à la mode et patron des chaussures Charles Jourdan. Grâce à cet homme, il espérait rencontrer des photographes célèbres, qui travaillaient pour lui. En fait, il lui offre une place de vendeur à mi-temps dans une de ses boutiques de chaussures à Paris. En 1980, il accepta le poste et très vite, il devint un des meilleurs vendeurs de la société. Il lui confia alors la direction d’une première boutique, puis il le propulsa directeur adjoint de la plus prestigieuse boutique de la chaîne, celle des Champs-Élysées. La concurrence entendit parler de lui. Et en 1985, le chausseur Stephane Kélian, un autre artiste français de la bottine et du talon haut, le débauche pour qu’il prenne la direction de ses trois plus grandes enseignes parisiennes et lui confie en même temps la vente en gros aux acheteurs étrangers. Et la chance voulut que les résultats soient au rendez-vous. Du coup, Stephane Kélian lui demanda de venir avec lui à New York, où sa marque avait du mal à gagner des parts de marché. Il voulait qu’il lui donne son avis sur ce qu’il faudrait faire pour que les ventes décollent. Et il le propulsa responsable du marché américain où il développe un réseau de quinze magasins et de vente en gros de la côte Est à la côte Ouest. C’est ainsi qu’il s’installa dans la Grosse Pomme. Et en dix ans ils finirent par s’imposer comme les rois de la chaussure. Ils travaillaient alors pour les plus grands noms de la mode et de très nombreuses vedettes. Et désormais il prenait part à la création des collections. Tout de suite, il a montré un sens artistique certain. C’est vrai que faire de belles chaussures originales l’avait immédiatement séduit. Mais, en 1995, Kélian décida de vendre et de se retirer des affaires pour profiter de son argent. Jean-Michel ne souhaita pas rester, et voyant qu’il pouvait se libérer, la maison Charles Jourdan le relança. Il retourna dans la maison Jourdan avec le titre de directeur de la création, toujours depuis la Grosse Pomme. De 1995 à 1998, chez Jourdan, il participa à toute l’élaboration des collections et c’est lui qui créait ses modèles. Puis, à l’aube de ses 40 ans, lassé de devoir prendre en compte les points de vue des uns et des autres, il décide de travailler pour lui. Il monte sa propre affaire et se lance sous son propre nom. Ayant un peu d’argent de côté, il prend un magasin dans West Village, à l’angle de Bleecker Street et de la 10e Rue, dans le très chic quartier de SoHo sur Manhattan et depuis le 8 septembre 2011, son nom trône sur les vitrines d’une boutique de 170 mètres carrés. Il avait déjà une certaine renommée dans le milieu et les affaires prennent vite. Il crée des collections fabriquées à Milan en Italie, car les Américains ne sont pas très bons dans ce domaine. Il met en vente ses modèles dans des boutiques de mode new-yorkaises. Et ça marche ! Son truc, c’est de proposer de la qualité, de l’originalité et du confort. Sa ligne s’adresse à « une femme active, sexy, moderne qui a envie de se séduire et de séduire » expliquera-t-il. Il lance donc sa propre ligne féminine, ultra-féminine, colorée avec une gamme de chaussures vraiment exubérantes. Quelques années plus tard, pour les hommes il s’inspire de son propre style, avec connotation sixties, plutôt rock’n’roll, comme ses « bottines Beatles » en python métallisé. Ses sources d’inspiration étant le rock’n’roll et le monde de la nuit. Ses modèles représentant sa créativité et proposant un style avant-gardiste de la mode internationale, rapidement des journalistes s’intéressent à lui et des stars accourent dans ses magasins. Aujourd’hui, il chausse Sharon Stone, Lenny Kravitz, les actrices Kristen Stewart, Denise Richards, les chanteuses Miley et Cyrus Norah Jones, la famille Kardashian, mais aussi Mickey Rourke. Les comédiennes Penélope Cruz et Sarah Jessica Parker sont des clientes fidèles. Tous lui disent être « fous » de ses créations. Les plus grandes vedettes se baladent avec ses chaussures et les retombées sont exceptionnelles. Il vend entre 10 000 et 20 000 paires par an. Et celles réalisées pour les stars peuvent atteindre des prix vertigineux, surtout si on y incruste des diamants. Sinon, il vend aussi des modèles à 80 euros. Pour ses collections, il fait aussi confiance à son amie de toujours, Josy Bize, une New-Yorkaise adoptée, originaire de Lourdes, passée par les mêmes grandes maisons que lui, avant qu’ils ne décident de collaborer ensemble. Maintenant, comme il l’a fait pour Kélian, il cherche à ouvrir d’autres magasins dans le triangle d'or des boutiques de luxe et des marques de Paris et de Londres après Madison Avenue à New York qui concentre une clientèle fortunée, et un espace de vente à Hangzhou en Chine. Les chaussures de luxe Jean-Michel Cazabat sont disponibles dans les magasins de luxe du monde entier, y compris Barneys, Saks Fifth Avenue, Shopbop, Maxfield L.A. et certains magasins comme Neiman Marcus. On raconte que ses amis, Madonna ou Lionel Ritchie adorent son accent des Pyrénées.
Jean-Michel CAZABAT, né en 1959 à Bordères-sur-l’Echez et installé aujourd’hui à New York, il chausse les célébrités comme Sharon Stone, Lenny Kravitz, Penélope Cruz, Madonna, Brooke Shields, Sarah Jessica Parker, Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Scarlette Johanssen, Kate Hudson, Mary-Kate Olsen, Oprah Winfrey, Michelle Obama et Lady Gaga. Rien ne le prédisposait à devenir le chausseur des stars. Adolescent, il rêvait d’être un grand photographe de mode et de charme et il choisit d’intégrer une école à Orthez pour rester dans son Sud-Ouest natal. À 17 ans, il couvre les matchs de rugby ou les concerts comme correspondant pour La Dépêche du Midi et La Nouvelle République des Pyrénées. Mais les piges ne paient pas le loyer. Un jour, un ami chausseur à Tarbes, Raymond Lacabanne, le présente à Roland Jourdan, un des designers très à la mode et patron des chaussures Charles Jourdan. Grâce à cet homme, il espérait rencontrer des photographes célèbres, qui travaillaient pour lui. En fait, il lui offre une place de vendeur à mi-temps dans une de ses boutiques de chaussures à Paris. En 1980, il accepta le poste et très vite, il devint un des meilleurs vendeurs de la société. Il lui confia alors la direction d’une première boutique, puis il le propulsa directeur adjoint de la plus prestigieuse boutique de la chaîne, celle des Champs-Élysées. La concurrence entendit parler de lui. Et en 1985, le chausseur Stephane Kélian, un autre artiste français de la bottine et du talon haut, le débauche pour qu’il prenne la direction de ses trois plus grandes enseignes parisiennes et lui confie en même temps la vente en gros aux acheteurs étrangers. Et la chance voulut que les résultats soient au rendez-vous. Du coup, Stephane Kélian lui demanda de venir avec lui à New York, où sa marque avait du mal à gagner des parts de marché. Il voulait qu’il lui donne son avis sur ce qu’il faudrait faire pour que les ventes décollent. Et il le propulsa responsable du marché américain où il développe un réseau de quinze magasins et de vente en gros de la côte Est à la côte Ouest. C’est ainsi qu’il s’installa dans la Grosse Pomme. Et en dix ans ils finirent par s’imposer comme les rois de la chaussure. Ils travaillaient alors pour les plus grands noms de la mode et de très nombreuses vedettes. Et désormais il prenait part à la création des collections. Tout de suite, il a montré un sens artistique certain. C’est vrai que faire de belles chaussures originales l’avait immédiatement séduit. Mais, en 1995, Kélian décida de vendre et de se retirer des affaires pour profiter de son argent. Jean-Michel ne souhaita pas rester, et voyant qu’il pouvait se libérer, la maison Charles Jourdan le relança. Il retourna dans la maison Jourdan avec le titre de directeur de la création, toujours depuis la Grosse Pomme. De 1995 à 1998, chez Jourdan, il participa à toute l’élaboration des collections et c’est lui qui créait ses modèles. Puis, à l’aube de ses 40 ans, lassé de devoir prendre en compte les points de vue des uns et des autres, il décide de travailler pour lui. Il monte sa propre affaire et se lance sous son propre nom. Ayant un peu d’argent de côté, il prend un magasin dans West Village, à l’angle de Bleecker Street et de la 10e Rue, dans le très chic quartier de SoHo sur Manhattan et depuis le 8 septembre 2011, son nom trône sur les vitrines d’une boutique de 170 mètres carrés. Il avait déjà une certaine renommée dans le milieu et les affaires prennent vite. Il crée des collections fabriquées à Milan en Italie, car les Américains ne sont pas très bons dans ce domaine. Il met en vente ses modèles dans des boutiques de mode new-yorkaises. Et ça marche ! Son truc, c’est de proposer de la qualité, de l’originalité et du confort. Sa ligne s’adresse à « une femme active, sexy, moderne qui a envie de se séduire et de séduire » expliquera-t-il. Il lance donc sa propre ligne féminine, ultra-féminine, colorée avec une gamme de chaussures vraiment exubérantes. Quelques années plus tard, pour les hommes il s’inspire de son propre style, avec connotation sixties, plutôt rock’n’roll, comme ses « bottines Beatles » en python métallisé. Ses sources d’inspiration étant le rock’n’roll et le monde de la nuit. Ses modèles représentant sa créativité et proposant un style avant-gardiste de la mode internationale, rapidement des journalistes s’intéressent à lui et des stars accourent dans ses magasins. Aujourd’hui, il chausse Sharon Stone, Lenny Kravitz, les actrices Kristen Stewart, Denise Richards, les chanteuses Miley et Cyrus Norah Jones, la famille Kardashian, mais aussi Mickey Rourke. Les comédiennes Penélope Cruz et Sarah Jessica Parker sont des clientes fidèles. Tous lui disent être « fous » de ses créations. Les plus grandes vedettes se baladent avec ses chaussures et les retombées sont exceptionnelles. Il vend entre 10 000 et 20 000 paires par an. Et celles réalisées pour les stars peuvent atteindre des prix vertigineux, surtout si on y incruste des diamants. Sinon, il vend aussi des modèles à 80 euros. Pour ses collections, il fait aussi confiance à son amie de toujours, Josy Bize, une New-Yorkaise adoptée, originaire de Lourdes, passée par les mêmes grandes maisons que lui, avant qu’ils ne décident de collaborer ensemble. Maintenant, comme il l’a fait pour Kélian, il cherche à ouvrir d’autres magasins dans le triangle d'or des boutiques de luxe et des marques de Paris et de Londres après Madison Avenue à New York qui concentre une clientèle fortunée, et un espace de vente à Hangzhou en Chine. Les chaussures de luxe Jean-Michel Cazabat sont disponibles dans les magasins de luxe du monde entier, y compris Barneys, Saks Fifth Avenue, Shopbop, Maxfield L.A. et certains magasins comme Neiman Marcus. On raconte que ses amis, Madonna ou Lionel Ritchie adorent son accent des Pyrénées.CAZAUSSUS Élie (1958-2019)
Pâtissier, glacié, chocolatier le plus titré au monde
 Élie CAZAUSSUS, né le 14 septembre 1958 à Tarbes et décédé le 17 mai 2019. Pâtissier fort réputé, Meilleur Ouvrier de France Glacier (MOF) 2004, détenteur de trois Coupes du monde, président national de la Confédération des Glaciers de France, il s’affiche comme l’une des références incontournables de la planète gourmande. Titulaire d’un CAP de pâtisserie, à l’âge de 20 ans il ouvre sa première pâtisserie à Bordères-sur-L’échez. Passionné par son métier et assoiffé de connaissances, il se plonge dans les livres de recettes pour tenter d’atteindre l’excellence. Puis il enchaîne les stages à l’école nationale de pâtisserie d’Yssingeaux (Haute-Loire) et chez le célèbre pâtissier chocolatier Gaston Lenôtre à Paris. Il donnera des cours dans les chambres des métiers des Hautes-Pyrénées et du Gers. Dans les années 1990 il décide de se lancer dans les concours. En l’an 2000, après plus de deux ans de préparation, il tente le titre de MOF en catégorie sucre, chocolat et glace. Ayant préparé une sculpture sur le thème de la mythologie grecque, il échouera. Loin d’être découragé il se remet au travail pour préparer le concours de 2004 (le concours n’ayant lieu que tous les 4 ans). Et en attendant ce grand rendez-vous, il rejoint l’équipe de France de pâtisserie et brigue en 2003 la Coupe du monde de pâtisserie avec Angelo Musa et Youri Neyers. Leur coach est Philippe Conticini. Face à 21 nations, le trio l’emporte. L’année suivante, en 2004, il poursuit sur sa lancée et décroche enfin le titre de MOF Glacier, tant attendu. Ce qui sera pour lui la plus belle des récompenses. Dès lors il n’a plus le droit de disputer de concours, sauf en qualité d’entraîneur. Et en 2009, en qualité de coach de l’équipe nationale il décroche sa deuxième Coupe du monde de pâtisserie avec Jérôme de Olivera, pâtissier au plazza Athénée à Paris, Jérôme Langillier et Marc Rivière, employé du célèbre traiteur parisien Potel et Chabot. Son premier titre mondial il l’a obtenu en 2003 en tant que participant à cette compétition qui réunissait les meilleurs pâteux de la planète. Il est d’ailleurs le seul Français de toute l’histoire de la pâtisserie à détenir ce doublé, qui fait désormais référence dans le monde entier. En 2014, il coache l’équipe qui remporte la Coupe du monde de la glace à Rimini en Italie. Son équipe étant composée de Jean-Christophe Vitte, Christophe Bouret, Benoît Lagache et Yazid Ichemrahen. Virtuose de la pâtisserie, il aimait transmettre son savoir et ses expériences à ceux qui rêvaient de devenir MOF ou champions du monde et se préparer aux concours, comme à ceux nombreux qui se passionnent pour cet art. Il a monté à Tarbes des ateliers gourmands de 3 heures composés de groupes de 3 personnes, des amateurs qui choisissent leur thème et repartent avec leur production. Son commerce cédé en 2018 sur la place du Marché-Brauhauban était un haut lieu de la gastronomie tarbaise. Spécialiste du chocolat, également sculpteur sur glace, il proposait des pâtisseries originales et poétiques à déguster sur place ou à emporter. Comme créations originales on notera : un chocolat à l’oignon de Trébons à base de chocolat noir avec des noisettes grillées, un chocolat au piment d’Espelette avec le piment enrobé de Guanaja, « Jo le Haricot » un personnage en forme de haricot et le touron au haricot tarbais. Dans ses centres de formation, il accueillait aussi des stagiaires envoyés par des écoles du monde entier et notamment du Japon. Le 25 avril 2017, il avait été élu président de la Confédération nationale des Glaciers de France. En 2018, il coachait l’équipe de France composée de Rémi Montagne, Christophe Domange, Jean-Thomas Schneider et Benoît Charvet, qui face à 11 autres équipes et 60 participants, concourait à Rimini pour le titre de champion du monde de la glace. Ainsi son talent l’avait inscrit à côté des plus grands noms : Yves Thuriès, Ladurée, Christophe Michalak et Pierre Hermé, celui-là même qui a fait son apprentissage chez le prestigieux Gaston Lenôtre. Cet artiste de la douceur, pâtissier tarbais fort réputé, excellait dans son art au niveau mondial. Ce grand nom de la gastronomie française, le pâtissier glacier le plus titré au monde, s'est éteint le vendredi 17 mai 2019, emporté par la maladie. Il a été inhumé au cimetière de Luquet, son village natal des Hautes-Pyrénées. Il avait 60 ans.
Élie CAZAUSSUS, né le 14 septembre 1958 à Tarbes et décédé le 17 mai 2019. Pâtissier fort réputé, Meilleur Ouvrier de France Glacier (MOF) 2004, détenteur de trois Coupes du monde, président national de la Confédération des Glaciers de France, il s’affiche comme l’une des références incontournables de la planète gourmande. Titulaire d’un CAP de pâtisserie, à l’âge de 20 ans il ouvre sa première pâtisserie à Bordères-sur-L’échez. Passionné par son métier et assoiffé de connaissances, il se plonge dans les livres de recettes pour tenter d’atteindre l’excellence. Puis il enchaîne les stages à l’école nationale de pâtisserie d’Yssingeaux (Haute-Loire) et chez le célèbre pâtissier chocolatier Gaston Lenôtre à Paris. Il donnera des cours dans les chambres des métiers des Hautes-Pyrénées et du Gers. Dans les années 1990 il décide de se lancer dans les concours. En l’an 2000, après plus de deux ans de préparation, il tente le titre de MOF en catégorie sucre, chocolat et glace. Ayant préparé une sculpture sur le thème de la mythologie grecque, il échouera. Loin d’être découragé il se remet au travail pour préparer le concours de 2004 (le concours n’ayant lieu que tous les 4 ans). Et en attendant ce grand rendez-vous, il rejoint l’équipe de France de pâtisserie et brigue en 2003 la Coupe du monde de pâtisserie avec Angelo Musa et Youri Neyers. Leur coach est Philippe Conticini. Face à 21 nations, le trio l’emporte. L’année suivante, en 2004, il poursuit sur sa lancée et décroche enfin le titre de MOF Glacier, tant attendu. Ce qui sera pour lui la plus belle des récompenses. Dès lors il n’a plus le droit de disputer de concours, sauf en qualité d’entraîneur. Et en 2009, en qualité de coach de l’équipe nationale il décroche sa deuxième Coupe du monde de pâtisserie avec Jérôme de Olivera, pâtissier au plazza Athénée à Paris, Jérôme Langillier et Marc Rivière, employé du célèbre traiteur parisien Potel et Chabot. Son premier titre mondial il l’a obtenu en 2003 en tant que participant à cette compétition qui réunissait les meilleurs pâteux de la planète. Il est d’ailleurs le seul Français de toute l’histoire de la pâtisserie à détenir ce doublé, qui fait désormais référence dans le monde entier. En 2014, il coache l’équipe qui remporte la Coupe du monde de la glace à Rimini en Italie. Son équipe étant composée de Jean-Christophe Vitte, Christophe Bouret, Benoît Lagache et Yazid Ichemrahen. Virtuose de la pâtisserie, il aimait transmettre son savoir et ses expériences à ceux qui rêvaient de devenir MOF ou champions du monde et se préparer aux concours, comme à ceux nombreux qui se passionnent pour cet art. Il a monté à Tarbes des ateliers gourmands de 3 heures composés de groupes de 3 personnes, des amateurs qui choisissent leur thème et repartent avec leur production. Son commerce cédé en 2018 sur la place du Marché-Brauhauban était un haut lieu de la gastronomie tarbaise. Spécialiste du chocolat, également sculpteur sur glace, il proposait des pâtisseries originales et poétiques à déguster sur place ou à emporter. Comme créations originales on notera : un chocolat à l’oignon de Trébons à base de chocolat noir avec des noisettes grillées, un chocolat au piment d’Espelette avec le piment enrobé de Guanaja, « Jo le Haricot » un personnage en forme de haricot et le touron au haricot tarbais. Dans ses centres de formation, il accueillait aussi des stagiaires envoyés par des écoles du monde entier et notamment du Japon. Le 25 avril 2017, il avait été élu président de la Confédération nationale des Glaciers de France. En 2018, il coachait l’équipe de France composée de Rémi Montagne, Christophe Domange, Jean-Thomas Schneider et Benoît Charvet, qui face à 11 autres équipes et 60 participants, concourait à Rimini pour le titre de champion du monde de la glace. Ainsi son talent l’avait inscrit à côté des plus grands noms : Yves Thuriès, Ladurée, Christophe Michalak et Pierre Hermé, celui-là même qui a fait son apprentissage chez le prestigieux Gaston Lenôtre. Cet artiste de la douceur, pâtissier tarbais fort réputé, excellait dans son art au niveau mondial. Ce grand nom de la gastronomie française, le pâtissier glacier le plus titré au monde, s'est éteint le vendredi 17 mai 2019, emporté par la maladie. Il a été inhumé au cimetière de Luquet, son village natal des Hautes-Pyrénées. Il avait 60 ans.
 Élie CAZAUSSUS, né le 14 septembre 1958 à Tarbes et décédé le 17 mai 2019. Pâtissier fort réputé, Meilleur Ouvrier de France Glacier (MOF) 2004, détenteur de trois Coupes du monde, président national de la Confédération des Glaciers de France, il s’affiche comme l’une des références incontournables de la planète gourmande. Titulaire d’un CAP de pâtisserie, à l’âge de 20 ans il ouvre sa première pâtisserie à Bordères-sur-L’échez. Passionné par son métier et assoiffé de connaissances, il se plonge dans les livres de recettes pour tenter d’atteindre l’excellence. Puis il enchaîne les stages à l’école nationale de pâtisserie d’Yssingeaux (Haute-Loire) et chez le célèbre pâtissier chocolatier Gaston Lenôtre à Paris. Il donnera des cours dans les chambres des métiers des Hautes-Pyrénées et du Gers. Dans les années 1990 il décide de se lancer dans les concours. En l’an 2000, après plus de deux ans de préparation, il tente le titre de MOF en catégorie sucre, chocolat et glace. Ayant préparé une sculpture sur le thème de la mythologie grecque, il échouera. Loin d’être découragé il se remet au travail pour préparer le concours de 2004 (le concours n’ayant lieu que tous les 4 ans). Et en attendant ce grand rendez-vous, il rejoint l’équipe de France de pâtisserie et brigue en 2003 la Coupe du monde de pâtisserie avec Angelo Musa et Youri Neyers. Leur coach est Philippe Conticini. Face à 21 nations, le trio l’emporte. L’année suivante, en 2004, il poursuit sur sa lancée et décroche enfin le titre de MOF Glacier, tant attendu. Ce qui sera pour lui la plus belle des récompenses. Dès lors il n’a plus le droit de disputer de concours, sauf en qualité d’entraîneur. Et en 2009, en qualité de coach de l’équipe nationale il décroche sa deuxième Coupe du monde de pâtisserie avec Jérôme de Olivera, pâtissier au plazza Athénée à Paris, Jérôme Langillier et Marc Rivière, employé du célèbre traiteur parisien Potel et Chabot. Son premier titre mondial il l’a obtenu en 2003 en tant que participant à cette compétition qui réunissait les meilleurs pâteux de la planète. Il est d’ailleurs le seul Français de toute l’histoire de la pâtisserie à détenir ce doublé, qui fait désormais référence dans le monde entier. En 2014, il coache l’équipe qui remporte la Coupe du monde de la glace à Rimini en Italie. Son équipe étant composée de Jean-Christophe Vitte, Christophe Bouret, Benoît Lagache et Yazid Ichemrahen. Virtuose de la pâtisserie, il aimait transmettre son savoir et ses expériences à ceux qui rêvaient de devenir MOF ou champions du monde et se préparer aux concours, comme à ceux nombreux qui se passionnent pour cet art. Il a monté à Tarbes des ateliers gourmands de 3 heures composés de groupes de 3 personnes, des amateurs qui choisissent leur thème et repartent avec leur production. Son commerce cédé en 2018 sur la place du Marché-Brauhauban était un haut lieu de la gastronomie tarbaise. Spécialiste du chocolat, également sculpteur sur glace, il proposait des pâtisseries originales et poétiques à déguster sur place ou à emporter. Comme créations originales on notera : un chocolat à l’oignon de Trébons à base de chocolat noir avec des noisettes grillées, un chocolat au piment d’Espelette avec le piment enrobé de Guanaja, « Jo le Haricot » un personnage en forme de haricot et le touron au haricot tarbais. Dans ses centres de formation, il accueillait aussi des stagiaires envoyés par des écoles du monde entier et notamment du Japon. Le 25 avril 2017, il avait été élu président de la Confédération nationale des Glaciers de France. En 2018, il coachait l’équipe de France composée de Rémi Montagne, Christophe Domange, Jean-Thomas Schneider et Benoît Charvet, qui face à 11 autres équipes et 60 participants, concourait à Rimini pour le titre de champion du monde de la glace. Ainsi son talent l’avait inscrit à côté des plus grands noms : Yves Thuriès, Ladurée, Christophe Michalak et Pierre Hermé, celui-là même qui a fait son apprentissage chez le prestigieux Gaston Lenôtre. Cet artiste de la douceur, pâtissier tarbais fort réputé, excellait dans son art au niveau mondial. Ce grand nom de la gastronomie française, le pâtissier glacier le plus titré au monde, s'est éteint le vendredi 17 mai 2019, emporté par la maladie. Il a été inhumé au cimetière de Luquet, son village natal des Hautes-Pyrénées. Il avait 60 ans.
Élie CAZAUSSUS, né le 14 septembre 1958 à Tarbes et décédé le 17 mai 2019. Pâtissier fort réputé, Meilleur Ouvrier de France Glacier (MOF) 2004, détenteur de trois Coupes du monde, président national de la Confédération des Glaciers de France, il s’affiche comme l’une des références incontournables de la planète gourmande. Titulaire d’un CAP de pâtisserie, à l’âge de 20 ans il ouvre sa première pâtisserie à Bordères-sur-L’échez. Passionné par son métier et assoiffé de connaissances, il se plonge dans les livres de recettes pour tenter d’atteindre l’excellence. Puis il enchaîne les stages à l’école nationale de pâtisserie d’Yssingeaux (Haute-Loire) et chez le célèbre pâtissier chocolatier Gaston Lenôtre à Paris. Il donnera des cours dans les chambres des métiers des Hautes-Pyrénées et du Gers. Dans les années 1990 il décide de se lancer dans les concours. En l’an 2000, après plus de deux ans de préparation, il tente le titre de MOF en catégorie sucre, chocolat et glace. Ayant préparé une sculpture sur le thème de la mythologie grecque, il échouera. Loin d’être découragé il se remet au travail pour préparer le concours de 2004 (le concours n’ayant lieu que tous les 4 ans). Et en attendant ce grand rendez-vous, il rejoint l’équipe de France de pâtisserie et brigue en 2003 la Coupe du monde de pâtisserie avec Angelo Musa et Youri Neyers. Leur coach est Philippe Conticini. Face à 21 nations, le trio l’emporte. L’année suivante, en 2004, il poursuit sur sa lancée et décroche enfin le titre de MOF Glacier, tant attendu. Ce qui sera pour lui la plus belle des récompenses. Dès lors il n’a plus le droit de disputer de concours, sauf en qualité d’entraîneur. Et en 2009, en qualité de coach de l’équipe nationale il décroche sa deuxième Coupe du monde de pâtisserie avec Jérôme de Olivera, pâtissier au plazza Athénée à Paris, Jérôme Langillier et Marc Rivière, employé du célèbre traiteur parisien Potel et Chabot. Son premier titre mondial il l’a obtenu en 2003 en tant que participant à cette compétition qui réunissait les meilleurs pâteux de la planète. Il est d’ailleurs le seul Français de toute l’histoire de la pâtisserie à détenir ce doublé, qui fait désormais référence dans le monde entier. En 2014, il coache l’équipe qui remporte la Coupe du monde de la glace à Rimini en Italie. Son équipe étant composée de Jean-Christophe Vitte, Christophe Bouret, Benoît Lagache et Yazid Ichemrahen. Virtuose de la pâtisserie, il aimait transmettre son savoir et ses expériences à ceux qui rêvaient de devenir MOF ou champions du monde et se préparer aux concours, comme à ceux nombreux qui se passionnent pour cet art. Il a monté à Tarbes des ateliers gourmands de 3 heures composés de groupes de 3 personnes, des amateurs qui choisissent leur thème et repartent avec leur production. Son commerce cédé en 2018 sur la place du Marché-Brauhauban était un haut lieu de la gastronomie tarbaise. Spécialiste du chocolat, également sculpteur sur glace, il proposait des pâtisseries originales et poétiques à déguster sur place ou à emporter. Comme créations originales on notera : un chocolat à l’oignon de Trébons à base de chocolat noir avec des noisettes grillées, un chocolat au piment d’Espelette avec le piment enrobé de Guanaja, « Jo le Haricot » un personnage en forme de haricot et le touron au haricot tarbais. Dans ses centres de formation, il accueillait aussi des stagiaires envoyés par des écoles du monde entier et notamment du Japon. Le 25 avril 2017, il avait été élu président de la Confédération nationale des Glaciers de France. En 2018, il coachait l’équipe de France composée de Rémi Montagne, Christophe Domange, Jean-Thomas Schneider et Benoît Charvet, qui face à 11 autres équipes et 60 participants, concourait à Rimini pour le titre de champion du monde de la glace. Ainsi son talent l’avait inscrit à côté des plus grands noms : Yves Thuriès, Ladurée, Christophe Michalak et Pierre Hermé, celui-là même qui a fait son apprentissage chez le prestigieux Gaston Lenôtre. Cet artiste de la douceur, pâtissier tarbais fort réputé, excellait dans son art au niveau mondial. Ce grand nom de la gastronomie française, le pâtissier glacier le plus titré au monde, s'est éteint le vendredi 17 mai 2019, emporté par la maladie. Il a été inhumé au cimetière de Luquet, son village natal des Hautes-Pyrénées. Il avait 60 ans.CHANCEL Jacques (1928-2014)
Journaliste, écrivain, homme de radio et de télévision
 Jacques CHANCEL, né le 2 juillet 1928 à Ayzac-Ost, où son père fabriquait des escaliers, de son vrai nom Joseph Crampes, et mort à Paris le 23 décembre 2014, à l’âge de 86 ans, est une grande figure de l’audiovisuel. Comme Pivot, Bellemare, Zitrone, Desgraupes, Poivre d’Arvor, Drucker, Bouvard, il appartient à la légende du petit écran. Études au collège de Saint-Pé-de-Bigorre, à l’institution Jeanne-d’Arc à Tarbes puis au lycée Victor-Duruy à Bagnères-de-Bigorre. Aventurier, il souhaite rejoindre l’Indochine afin de couvrir le conflit. Mais n’ayant pas l’âge requis, il demande à l’instituteur de son village, officier de l’état-civil, de le vieillir afin de pouvoir partir. En trichant sur son âge, il fait l’école militaire de transmissions de Montargis et après direct l’Indochine. C’est ainsi qu’il se retrouve là-bas correspondant de guerre pour France-Asie à 17 ans puis travaille pour Radio France et Paris Match. À la demande des services de sécurité il change aussi de nom et choisit Chancel, parce qu’il y avait ce nom dans sa famille. Il parcourt le Sud-Est asiatique de 1950 à 1958 et achève ses études de droit entre Saïgon et Pékin. En 1952, la jeep dans laquelle il se trouve avec des officiers saute sur une mine pendant la traversée d’un pont. Il est le seul survivant mais il se retrouve aveugle à l’hôpital de Saigon. Par chance, au bout d’un an il recouvre la vue. Après son retour en France en 1958, il travaille pour plusieurs journaux comme Paris-Jour, Télé Magazine et très attiré par la radio, il rejoint France Inter. Durant vingt-deux ans, il anime la mythique émission quotidienne d’une heure "Radioscopie" sur France Inter (6826 émissions de 1968 à 1982 puis de 1988 à 1990), où il questionne avec insolence les âmes les plus fortes de l’époque. À la télévision, en 1971, il lance "Grand Amphi" qui devient un an plus tard "Le Grand Echiquier". Et durant dix-sept ans, il anime l’émission "Le Grand Échiquier" qu’il présente sur une durée d’environ trois heures, à partir de 1972 sur la deuxième chaîne de l’ORTF puis sur Antenne 2. Ses émissions à la radio et à la télévision, ont marqué des générations de Français. Passionné de musique classique et de littérature autant que du Tour de France, il a interrogé pendant plus de vingt ans les plus grands noms de la culture, du spectacle et de la politique mais aussi des anonymes. Ses entretiens, il les conduit sans agressivité, en s’interdisant de s’immiscer dans la vie privée de ses interlocuteurs. Mais il parvient à les amener tout doucement sur le terrain des grandes questions, telles que la vie, la mort ou l’amour. La question qu’il posa le 8 février 1978 au secrétaire général du Parti communiste français, Georges Marchais, « Et Dieu dans tout ça ? » devait devenir culte. Un de ses plus grands regrets est de ne pas avoir reçu Picasso. Il fut aussi passionné de vélo et plus particulièrement par le Tour de France, qu’il suivra 35 fois. Tout au long de sa carrière, il a également occupé des postes de direction. Il a par exemple été conseiller de Marcel Jullian pour Antenne 2 de 1975 à 1977, directeur de la rédaction de Jours de France en 1986, directeur des programmes puis de l’antenne de France 3 de 1989 à 1992, délégué général auprès du PDG de France 2 et France 3 de 1992 à 1994, administrateur du groupe Canal+ de 2003 à 2010 et enfin conseiller pour iTélé et membre du Haut Conseil de la francophonie. Homme de Lettres, il a été directeur de la collection Idée Fixe aux éditions Julliard. Il a écrit plusieurs livres, dont notamment son Journal (en plusieurs tomes). "Pourquoi partir ?", dernier volume sur la période de janvier 2011 à juin 2014, qui a été publié fin 2014 chez Flammarion. Dans ce livre, il aborde avec beaucoup de discrétion ses soucis de santé. Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages, dont "Radioscopie" (6 volumes), "Le temps d’un regard" (1978) qui recevra le prix de l’Académie française, "Tant qu’il y aura des îles" (1980) le prix des maisons de la Presse, le "Dictionnaire amoureux de la Télévision" (2011) et "La Nuit attendra" (2013). Il est officier de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite, commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres et il a reçu le prix Ondas de la radiodiffusion espagnole (1971), le Grand prix arts, sciences et lettres de l’ORTF (1974), un 7 d’or de la Meilleure émission musicale (1987), pour le Grand échiquier (1974), le prix Louis Lumière de l’Académie du disque français (1981), le prix Balzac (1983), le prix Georges Dupau de l’Académie française pour son œuvre "Le guetteur de rives" (1985), le prix Roland-Dorgelès (2004). Il fut un homme curieux, qui savait écouter les autres et qui préférait les mots "conversation", "rencontre" ou "entretien" à celui d’"interview". « Si j’ai un talent, un seul talent, c’est de savoir écouter, je sais écouter », disait-il de lui-même. « Les gens ne s’écoutent plus, ils n’écoutent qu’eux-mêmes ». « Je suis un écouteur. Interroger, c’est écouter l’autre ». Ce qu’il fera toute sa vie. Dans les années 1960, il avait acheté le château de Miramont, à Adast (65). Belvédère donnant sur le Pibeste et le Hautacam, à côté de Saint-Savin. Très attaché à la Bigorre, au pays des Gaves, à ses Pyrénées, sa terre de repos disait-il, il était une figure de ce territoire auquel il est resté fidèle jusqu’à la fin de sa vie. On gardera de lui le souvenir d’un grand homme de médias avec cette voix de velours, amoureux de sa Bigorre natale, fidèle en amitié, et surtout celui pour qui la famille était vitale. Et il obéit toujours à ce conseil de son père, menuisier à Ost : « N’oublie pas de vivre ! ». Marié avec Martine Labrosse et père de deux enfants, il s’est éteint le 23 décembre 2014 à l’âge de 86 ans et a été inhumé le 8 janvier 2015 dans la crypte de la chapelle du château d’Adast. Le Grand Échiquier, célèbre émission culturelle animée dans les années 1970 par Jacques Chancel, est de retour depuis 2019, présenté en direct par Anne-Sophie Lapix, qui propose sur France 2 des rencontres artistiques inédites entre chanteurs, musiciens, chorégraphes, danseurs, humoristes ou encore chefs d'orchestre dans des lieux différents comme le palais des Beaux-Arts de Lille, la Halle Tony Garnier de Lyon, etc.
Jacques CHANCEL, né le 2 juillet 1928 à Ayzac-Ost, où son père fabriquait des escaliers, de son vrai nom Joseph Crampes, et mort à Paris le 23 décembre 2014, à l’âge de 86 ans, est une grande figure de l’audiovisuel. Comme Pivot, Bellemare, Zitrone, Desgraupes, Poivre d’Arvor, Drucker, Bouvard, il appartient à la légende du petit écran. Études au collège de Saint-Pé-de-Bigorre, à l’institution Jeanne-d’Arc à Tarbes puis au lycée Victor-Duruy à Bagnères-de-Bigorre. Aventurier, il souhaite rejoindre l’Indochine afin de couvrir le conflit. Mais n’ayant pas l’âge requis, il demande à l’instituteur de son village, officier de l’état-civil, de le vieillir afin de pouvoir partir. En trichant sur son âge, il fait l’école militaire de transmissions de Montargis et après direct l’Indochine. C’est ainsi qu’il se retrouve là-bas correspondant de guerre pour France-Asie à 17 ans puis travaille pour Radio France et Paris Match. À la demande des services de sécurité il change aussi de nom et choisit Chancel, parce qu’il y avait ce nom dans sa famille. Il parcourt le Sud-Est asiatique de 1950 à 1958 et achève ses études de droit entre Saïgon et Pékin. En 1952, la jeep dans laquelle il se trouve avec des officiers saute sur une mine pendant la traversée d’un pont. Il est le seul survivant mais il se retrouve aveugle à l’hôpital de Saigon. Par chance, au bout d’un an il recouvre la vue. Après son retour en France en 1958, il travaille pour plusieurs journaux comme Paris-Jour, Télé Magazine et très attiré par la radio, il rejoint France Inter. Durant vingt-deux ans, il anime la mythique émission quotidienne d’une heure "Radioscopie" sur France Inter (6826 émissions de 1968 à 1982 puis de 1988 à 1990), où il questionne avec insolence les âmes les plus fortes de l’époque. À la télévision, en 1971, il lance "Grand Amphi" qui devient un an plus tard "Le Grand Echiquier". Et durant dix-sept ans, il anime l’émission "Le Grand Échiquier" qu’il présente sur une durée d’environ trois heures, à partir de 1972 sur la deuxième chaîne de l’ORTF puis sur Antenne 2. Ses émissions à la radio et à la télévision, ont marqué des générations de Français. Passionné de musique classique et de littérature autant que du Tour de France, il a interrogé pendant plus de vingt ans les plus grands noms de la culture, du spectacle et de la politique mais aussi des anonymes. Ses entretiens, il les conduit sans agressivité, en s’interdisant de s’immiscer dans la vie privée de ses interlocuteurs. Mais il parvient à les amener tout doucement sur le terrain des grandes questions, telles que la vie, la mort ou l’amour. La question qu’il posa le 8 février 1978 au secrétaire général du Parti communiste français, Georges Marchais, « Et Dieu dans tout ça ? » devait devenir culte. Un de ses plus grands regrets est de ne pas avoir reçu Picasso. Il fut aussi passionné de vélo et plus particulièrement par le Tour de France, qu’il suivra 35 fois. Tout au long de sa carrière, il a également occupé des postes de direction. Il a par exemple été conseiller de Marcel Jullian pour Antenne 2 de 1975 à 1977, directeur de la rédaction de Jours de France en 1986, directeur des programmes puis de l’antenne de France 3 de 1989 à 1992, délégué général auprès du PDG de France 2 et France 3 de 1992 à 1994, administrateur du groupe Canal+ de 2003 à 2010 et enfin conseiller pour iTélé et membre du Haut Conseil de la francophonie. Homme de Lettres, il a été directeur de la collection Idée Fixe aux éditions Julliard. Il a écrit plusieurs livres, dont notamment son Journal (en plusieurs tomes). "Pourquoi partir ?", dernier volume sur la période de janvier 2011 à juin 2014, qui a été publié fin 2014 chez Flammarion. Dans ce livre, il aborde avec beaucoup de discrétion ses soucis de santé. Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages, dont "Radioscopie" (6 volumes), "Le temps d’un regard" (1978) qui recevra le prix de l’Académie française, "Tant qu’il y aura des îles" (1980) le prix des maisons de la Presse, le "Dictionnaire amoureux de la Télévision" (2011) et "La Nuit attendra" (2013). Il est officier de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite, commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres et il a reçu le prix Ondas de la radiodiffusion espagnole (1971), le Grand prix arts, sciences et lettres de l’ORTF (1974), un 7 d’or de la Meilleure émission musicale (1987), pour le Grand échiquier (1974), le prix Louis Lumière de l’Académie du disque français (1981), le prix Balzac (1983), le prix Georges Dupau de l’Académie française pour son œuvre "Le guetteur de rives" (1985), le prix Roland-Dorgelès (2004). Il fut un homme curieux, qui savait écouter les autres et qui préférait les mots "conversation", "rencontre" ou "entretien" à celui d’"interview". « Si j’ai un talent, un seul talent, c’est de savoir écouter, je sais écouter », disait-il de lui-même. « Les gens ne s’écoutent plus, ils n’écoutent qu’eux-mêmes ». « Je suis un écouteur. Interroger, c’est écouter l’autre ». Ce qu’il fera toute sa vie. Dans les années 1960, il avait acheté le château de Miramont, à Adast (65). Belvédère donnant sur le Pibeste et le Hautacam, à côté de Saint-Savin. Très attaché à la Bigorre, au pays des Gaves, à ses Pyrénées, sa terre de repos disait-il, il était une figure de ce territoire auquel il est resté fidèle jusqu’à la fin de sa vie. On gardera de lui le souvenir d’un grand homme de médias avec cette voix de velours, amoureux de sa Bigorre natale, fidèle en amitié, et surtout celui pour qui la famille était vitale. Et il obéit toujours à ce conseil de son père, menuisier à Ost : « N’oublie pas de vivre ! ». Marié avec Martine Labrosse et père de deux enfants, il s’est éteint le 23 décembre 2014 à l’âge de 86 ans et a été inhumé le 8 janvier 2015 dans la crypte de la chapelle du château d’Adast. Le Grand Échiquier, célèbre émission culturelle animée dans les années 1970 par Jacques Chancel, est de retour depuis 2019, présenté en direct par Anne-Sophie Lapix, qui propose sur France 2 des rencontres artistiques inédites entre chanteurs, musiciens, chorégraphes, danseurs, humoristes ou encore chefs d'orchestre dans des lieux différents comme le palais des Beaux-Arts de Lille, la Halle Tony Garnier de Lyon, etc.
 Jacques CHANCEL, né le 2 juillet 1928 à Ayzac-Ost, où son père fabriquait des escaliers, de son vrai nom Joseph Crampes, et mort à Paris le 23 décembre 2014, à l’âge de 86 ans, est une grande figure de l’audiovisuel. Comme Pivot, Bellemare, Zitrone, Desgraupes, Poivre d’Arvor, Drucker, Bouvard, il appartient à la légende du petit écran. Études au collège de Saint-Pé-de-Bigorre, à l’institution Jeanne-d’Arc à Tarbes puis au lycée Victor-Duruy à Bagnères-de-Bigorre. Aventurier, il souhaite rejoindre l’Indochine afin de couvrir le conflit. Mais n’ayant pas l’âge requis, il demande à l’instituteur de son village, officier de l’état-civil, de le vieillir afin de pouvoir partir. En trichant sur son âge, il fait l’école militaire de transmissions de Montargis et après direct l’Indochine. C’est ainsi qu’il se retrouve là-bas correspondant de guerre pour France-Asie à 17 ans puis travaille pour Radio France et Paris Match. À la demande des services de sécurité il change aussi de nom et choisit Chancel, parce qu’il y avait ce nom dans sa famille. Il parcourt le Sud-Est asiatique de 1950 à 1958 et achève ses études de droit entre Saïgon et Pékin. En 1952, la jeep dans laquelle il se trouve avec des officiers saute sur une mine pendant la traversée d’un pont. Il est le seul survivant mais il se retrouve aveugle à l’hôpital de Saigon. Par chance, au bout d’un an il recouvre la vue. Après son retour en France en 1958, il travaille pour plusieurs journaux comme Paris-Jour, Télé Magazine et très attiré par la radio, il rejoint France Inter. Durant vingt-deux ans, il anime la mythique émission quotidienne d’une heure "Radioscopie" sur France Inter (6826 émissions de 1968 à 1982 puis de 1988 à 1990), où il questionne avec insolence les âmes les plus fortes de l’époque. À la télévision, en 1971, il lance "Grand Amphi" qui devient un an plus tard "Le Grand Echiquier". Et durant dix-sept ans, il anime l’émission "Le Grand Échiquier" qu’il présente sur une durée d’environ trois heures, à partir de 1972 sur la deuxième chaîne de l’ORTF puis sur Antenne 2. Ses émissions à la radio et à la télévision, ont marqué des générations de Français. Passionné de musique classique et de littérature autant que du Tour de France, il a interrogé pendant plus de vingt ans les plus grands noms de la culture, du spectacle et de la politique mais aussi des anonymes. Ses entretiens, il les conduit sans agressivité, en s’interdisant de s’immiscer dans la vie privée de ses interlocuteurs. Mais il parvient à les amener tout doucement sur le terrain des grandes questions, telles que la vie, la mort ou l’amour. La question qu’il posa le 8 février 1978 au secrétaire général du Parti communiste français, Georges Marchais, « Et Dieu dans tout ça ? » devait devenir culte. Un de ses plus grands regrets est de ne pas avoir reçu Picasso. Il fut aussi passionné de vélo et plus particulièrement par le Tour de France, qu’il suivra 35 fois. Tout au long de sa carrière, il a également occupé des postes de direction. Il a par exemple été conseiller de Marcel Jullian pour Antenne 2 de 1975 à 1977, directeur de la rédaction de Jours de France en 1986, directeur des programmes puis de l’antenne de France 3 de 1989 à 1992, délégué général auprès du PDG de France 2 et France 3 de 1992 à 1994, administrateur du groupe Canal+ de 2003 à 2010 et enfin conseiller pour iTélé et membre du Haut Conseil de la francophonie. Homme de Lettres, il a été directeur de la collection Idée Fixe aux éditions Julliard. Il a écrit plusieurs livres, dont notamment son Journal (en plusieurs tomes). "Pourquoi partir ?", dernier volume sur la période de janvier 2011 à juin 2014, qui a été publié fin 2014 chez Flammarion. Dans ce livre, il aborde avec beaucoup de discrétion ses soucis de santé. Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages, dont "Radioscopie" (6 volumes), "Le temps d’un regard" (1978) qui recevra le prix de l’Académie française, "Tant qu’il y aura des îles" (1980) le prix des maisons de la Presse, le "Dictionnaire amoureux de la Télévision" (2011) et "La Nuit attendra" (2013). Il est officier de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite, commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres et il a reçu le prix Ondas de la radiodiffusion espagnole (1971), le Grand prix arts, sciences et lettres de l’ORTF (1974), un 7 d’or de la Meilleure émission musicale (1987), pour le Grand échiquier (1974), le prix Louis Lumière de l’Académie du disque français (1981), le prix Balzac (1983), le prix Georges Dupau de l’Académie française pour son œuvre "Le guetteur de rives" (1985), le prix Roland-Dorgelès (2004). Il fut un homme curieux, qui savait écouter les autres et qui préférait les mots "conversation", "rencontre" ou "entretien" à celui d’"interview". « Si j’ai un talent, un seul talent, c’est de savoir écouter, je sais écouter », disait-il de lui-même. « Les gens ne s’écoutent plus, ils n’écoutent qu’eux-mêmes ». « Je suis un écouteur. Interroger, c’est écouter l’autre ». Ce qu’il fera toute sa vie. Dans les années 1960, il avait acheté le château de Miramont, à Adast (65). Belvédère donnant sur le Pibeste et le Hautacam, à côté de Saint-Savin. Très attaché à la Bigorre, au pays des Gaves, à ses Pyrénées, sa terre de repos disait-il, il était une figure de ce territoire auquel il est resté fidèle jusqu’à la fin de sa vie. On gardera de lui le souvenir d’un grand homme de médias avec cette voix de velours, amoureux de sa Bigorre natale, fidèle en amitié, et surtout celui pour qui la famille était vitale. Et il obéit toujours à ce conseil de son père, menuisier à Ost : « N’oublie pas de vivre ! ». Marié avec Martine Labrosse et père de deux enfants, il s’est éteint le 23 décembre 2014 à l’âge de 86 ans et a été inhumé le 8 janvier 2015 dans la crypte de la chapelle du château d’Adast. Le Grand Échiquier, célèbre émission culturelle animée dans les années 1970 par Jacques Chancel, est de retour depuis 2019, présenté en direct par Anne-Sophie Lapix, qui propose sur France 2 des rencontres artistiques inédites entre chanteurs, musiciens, chorégraphes, danseurs, humoristes ou encore chefs d'orchestre dans des lieux différents comme le palais des Beaux-Arts de Lille, la Halle Tony Garnier de Lyon, etc.
Jacques CHANCEL, né le 2 juillet 1928 à Ayzac-Ost, où son père fabriquait des escaliers, de son vrai nom Joseph Crampes, et mort à Paris le 23 décembre 2014, à l’âge de 86 ans, est une grande figure de l’audiovisuel. Comme Pivot, Bellemare, Zitrone, Desgraupes, Poivre d’Arvor, Drucker, Bouvard, il appartient à la légende du petit écran. Études au collège de Saint-Pé-de-Bigorre, à l’institution Jeanne-d’Arc à Tarbes puis au lycée Victor-Duruy à Bagnères-de-Bigorre. Aventurier, il souhaite rejoindre l’Indochine afin de couvrir le conflit. Mais n’ayant pas l’âge requis, il demande à l’instituteur de son village, officier de l’état-civil, de le vieillir afin de pouvoir partir. En trichant sur son âge, il fait l’école militaire de transmissions de Montargis et après direct l’Indochine. C’est ainsi qu’il se retrouve là-bas correspondant de guerre pour France-Asie à 17 ans puis travaille pour Radio France et Paris Match. À la demande des services de sécurité il change aussi de nom et choisit Chancel, parce qu’il y avait ce nom dans sa famille. Il parcourt le Sud-Est asiatique de 1950 à 1958 et achève ses études de droit entre Saïgon et Pékin. En 1952, la jeep dans laquelle il se trouve avec des officiers saute sur une mine pendant la traversée d’un pont. Il est le seul survivant mais il se retrouve aveugle à l’hôpital de Saigon. Par chance, au bout d’un an il recouvre la vue. Après son retour en France en 1958, il travaille pour plusieurs journaux comme Paris-Jour, Télé Magazine et très attiré par la radio, il rejoint France Inter. Durant vingt-deux ans, il anime la mythique émission quotidienne d’une heure "Radioscopie" sur France Inter (6826 émissions de 1968 à 1982 puis de 1988 à 1990), où il questionne avec insolence les âmes les plus fortes de l’époque. À la télévision, en 1971, il lance "Grand Amphi" qui devient un an plus tard "Le Grand Echiquier". Et durant dix-sept ans, il anime l’émission "Le Grand Échiquier" qu’il présente sur une durée d’environ trois heures, à partir de 1972 sur la deuxième chaîne de l’ORTF puis sur Antenne 2. Ses émissions à la radio et à la télévision, ont marqué des générations de Français. Passionné de musique classique et de littérature autant que du Tour de France, il a interrogé pendant plus de vingt ans les plus grands noms de la culture, du spectacle et de la politique mais aussi des anonymes. Ses entretiens, il les conduit sans agressivité, en s’interdisant de s’immiscer dans la vie privée de ses interlocuteurs. Mais il parvient à les amener tout doucement sur le terrain des grandes questions, telles que la vie, la mort ou l’amour. La question qu’il posa le 8 février 1978 au secrétaire général du Parti communiste français, Georges Marchais, « Et Dieu dans tout ça ? » devait devenir culte. Un de ses plus grands regrets est de ne pas avoir reçu Picasso. Il fut aussi passionné de vélo et plus particulièrement par le Tour de France, qu’il suivra 35 fois. Tout au long de sa carrière, il a également occupé des postes de direction. Il a par exemple été conseiller de Marcel Jullian pour Antenne 2 de 1975 à 1977, directeur de la rédaction de Jours de France en 1986, directeur des programmes puis de l’antenne de France 3 de 1989 à 1992, délégué général auprès du PDG de France 2 et France 3 de 1992 à 1994, administrateur du groupe Canal+ de 2003 à 2010 et enfin conseiller pour iTélé et membre du Haut Conseil de la francophonie. Homme de Lettres, il a été directeur de la collection Idée Fixe aux éditions Julliard. Il a écrit plusieurs livres, dont notamment son Journal (en plusieurs tomes). "Pourquoi partir ?", dernier volume sur la période de janvier 2011 à juin 2014, qui a été publié fin 2014 chez Flammarion. Dans ce livre, il aborde avec beaucoup de discrétion ses soucis de santé. Il est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages, dont "Radioscopie" (6 volumes), "Le temps d’un regard" (1978) qui recevra le prix de l’Académie française, "Tant qu’il y aura des îles" (1980) le prix des maisons de la Presse, le "Dictionnaire amoureux de la Télévision" (2011) et "La Nuit attendra" (2013). Il est officier de la Légion d’honneur et de l’Ordre national du Mérite, commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres et il a reçu le prix Ondas de la radiodiffusion espagnole (1971), le Grand prix arts, sciences et lettres de l’ORTF (1974), un 7 d’or de la Meilleure émission musicale (1987), pour le Grand échiquier (1974), le prix Louis Lumière de l’Académie du disque français (1981), le prix Balzac (1983), le prix Georges Dupau de l’Académie française pour son œuvre "Le guetteur de rives" (1985), le prix Roland-Dorgelès (2004). Il fut un homme curieux, qui savait écouter les autres et qui préférait les mots "conversation", "rencontre" ou "entretien" à celui d’"interview". « Si j’ai un talent, un seul talent, c’est de savoir écouter, je sais écouter », disait-il de lui-même. « Les gens ne s’écoutent plus, ils n’écoutent qu’eux-mêmes ». « Je suis un écouteur. Interroger, c’est écouter l’autre ». Ce qu’il fera toute sa vie. Dans les années 1960, il avait acheté le château de Miramont, à Adast (65). Belvédère donnant sur le Pibeste et le Hautacam, à côté de Saint-Savin. Très attaché à la Bigorre, au pays des Gaves, à ses Pyrénées, sa terre de repos disait-il, il était une figure de ce territoire auquel il est resté fidèle jusqu’à la fin de sa vie. On gardera de lui le souvenir d’un grand homme de médias avec cette voix de velours, amoureux de sa Bigorre natale, fidèle en amitié, et surtout celui pour qui la famille était vitale. Et il obéit toujours à ce conseil de son père, menuisier à Ost : « N’oublie pas de vivre ! ». Marié avec Martine Labrosse et père de deux enfants, il s’est éteint le 23 décembre 2014 à l’âge de 86 ans et a été inhumé le 8 janvier 2015 dans la crypte de la chapelle du château d’Adast. Le Grand Échiquier, célèbre émission culturelle animée dans les années 1970 par Jacques Chancel, est de retour depuis 2019, présenté en direct par Anne-Sophie Lapix, qui propose sur France 2 des rencontres artistiques inédites entre chanteurs, musiciens, chorégraphes, danseurs, humoristes ou encore chefs d'orchestre dans des lieux différents comme le palais des Beaux-Arts de Lille, la Halle Tony Garnier de Lyon, etc.CHAUVET Guy (1933-2007)
Grand ténor mondialement connu
 Guy CHAUVET, né le 2 octobre 1933 à Montluçon et mort le 26 mars 2007 à Espoey, à l’âge de 73 ans. Arrivé à l’âge de 3 mois dans les Hautes-Pyrénées il va faire toute sa scolarité et son service militaire (parachutiste au 1er Régiment de Hussards) à Tarbes, avant de partir à l’âge de 24 ans pour l’Opéra de Paris. Chanteur lyrique, c’est là qu’il va devenir le grand ténor international. Il découvrit le chant grâce à la chorale et sa voix au Conservatoire Henri-Duparc, mais aussi par le biais de la radio et du cinéma : il admirait le ténor d’opérette André Dassary et le ténor d’opéra José Luccioni, spécialiste de ces grands rôles, dont il se fera lui-même une spécialité. Chanteur amateur, il sera d’abord baryton, mais se métamorphosera en ténor. Il participa à plusieurs concours, Pau et Tarbes en 1952. En mars 1954, c’est le concours des Ténors organisé à Cannes par Mario Podesta qui le fait connaître dans toute la France. Le premier prix sera partagé entre quatre vainqueurs ex-aequo, Alain Vanzo, Tony Poncet, Gustave Botiaux et Roger Gardes; Guy, le plus jeune des finalistes (il n’a que 20 ans) impressionne dans le récit du Graal de Lohengrin et se voit attribuer, sur insistance du directeur du casino, un prix spécial doté de la somme de 150 000 francs. Lauréat du concours de Toulouse en 1955, il remportera en 1958 deux Voix d’or, celle qui récompense l’épreuve d’opéra et celle de la catégorie mélodie. Ce qui lui vaudra d’être immédiatement engagé par Georges Hirsch, alors directeur de l’Opéra de Paris. En 1959, il débuta au Palais Garnier dans un homme d’arme de « La Flûte enchantée », il sera Adario dans l’une des innombrables reprises des « Indes galantes » montées par Maurice Lehmann (il y sera Don Carlos en 1962). Il assurera quelques troisièmes rôles dans Aïda ou dans Samson et Dalila aux côtés de Mario del Monaco avant de devenir le plus jeune premier ténor de l’Opéra en tenant le rôle de Faust de Berlioz de la Damnation, le 20 septembre 1959. Lors des deux saisons suivantes, il sera imposé par Régine Crespin en Enée, chantera Arturo avec Joan Sutherland en Lucia et triomphera en Florestan tout en assurant une création mondiale à Monte-Carlo. Cette ascension fulgurante lui vaudra quelques jalousies et il trouvera un beau jour dans le parking des artistes les pneus de sa nouvelle voiture en piteux état. Avec une carrière sur les plus grandes scènes du monde mais aussi dans nos provinces, il aura travaillé avec les artistes les plus éminents de son époque, mais aura surtout été marqué par Régine Crespin et Fiorenza Cossotto, par Gabriel Bacquier et Jon Vickers. Il considérait Andréa Guiot comme une sœur et réciproquement. Bref, une immense voix lyrique qui aura côtoyé les plus grandes : Renata Tebaldi, Régine Crespin, Placido Domingo, etc. Après s’être retiré des scènes en 1984, il deviendra l’un des professeurs les plus emblématiques du Conservatoire de Tarbes. En septembre 2001, le maire de Tarbes le fera Citoyen d’honneur de la ville. Par ailleurs il avait déjà été décoré de la Légion d’honneur et fait chevalier de l’Ordre national du Mérite et de l’Ordre des Arts et des Lettres. Il aimait surtout sa femme Josette et ses deux enfants (dont un qu’il avait eu le malheur de perdre jeune) et son Sud-Ouest natal.
Guy CHAUVET, né le 2 octobre 1933 à Montluçon et mort le 26 mars 2007 à Espoey, à l’âge de 73 ans. Arrivé à l’âge de 3 mois dans les Hautes-Pyrénées il va faire toute sa scolarité et son service militaire (parachutiste au 1er Régiment de Hussards) à Tarbes, avant de partir à l’âge de 24 ans pour l’Opéra de Paris. Chanteur lyrique, c’est là qu’il va devenir le grand ténor international. Il découvrit le chant grâce à la chorale et sa voix au Conservatoire Henri-Duparc, mais aussi par le biais de la radio et du cinéma : il admirait le ténor d’opérette André Dassary et le ténor d’opéra José Luccioni, spécialiste de ces grands rôles, dont il se fera lui-même une spécialité. Chanteur amateur, il sera d’abord baryton, mais se métamorphosera en ténor. Il participa à plusieurs concours, Pau et Tarbes en 1952. En mars 1954, c’est le concours des Ténors organisé à Cannes par Mario Podesta qui le fait connaître dans toute la France. Le premier prix sera partagé entre quatre vainqueurs ex-aequo, Alain Vanzo, Tony Poncet, Gustave Botiaux et Roger Gardes; Guy, le plus jeune des finalistes (il n’a que 20 ans) impressionne dans le récit du Graal de Lohengrin et se voit attribuer, sur insistance du directeur du casino, un prix spécial doté de la somme de 150 000 francs. Lauréat du concours de Toulouse en 1955, il remportera en 1958 deux Voix d’or, celle qui récompense l’épreuve d’opéra et celle de la catégorie mélodie. Ce qui lui vaudra d’être immédiatement engagé par Georges Hirsch, alors directeur de l’Opéra de Paris. En 1959, il débuta au Palais Garnier dans un homme d’arme de « La Flûte enchantée », il sera Adario dans l’une des innombrables reprises des « Indes galantes » montées par Maurice Lehmann (il y sera Don Carlos en 1962). Il assurera quelques troisièmes rôles dans Aïda ou dans Samson et Dalila aux côtés de Mario del Monaco avant de devenir le plus jeune premier ténor de l’Opéra en tenant le rôle de Faust de Berlioz de la Damnation, le 20 septembre 1959. Lors des deux saisons suivantes, il sera imposé par Régine Crespin en Enée, chantera Arturo avec Joan Sutherland en Lucia et triomphera en Florestan tout en assurant une création mondiale à Monte-Carlo. Cette ascension fulgurante lui vaudra quelques jalousies et il trouvera un beau jour dans le parking des artistes les pneus de sa nouvelle voiture en piteux état. Avec une carrière sur les plus grandes scènes du monde mais aussi dans nos provinces, il aura travaillé avec les artistes les plus éminents de son époque, mais aura surtout été marqué par Régine Crespin et Fiorenza Cossotto, par Gabriel Bacquier et Jon Vickers. Il considérait Andréa Guiot comme une sœur et réciproquement. Bref, une immense voix lyrique qui aura côtoyé les plus grandes : Renata Tebaldi, Régine Crespin, Placido Domingo, etc. Après s’être retiré des scènes en 1984, il deviendra l’un des professeurs les plus emblématiques du Conservatoire de Tarbes. En septembre 2001, le maire de Tarbes le fera Citoyen d’honneur de la ville. Par ailleurs il avait déjà été décoré de la Légion d’honneur et fait chevalier de l’Ordre national du Mérite et de l’Ordre des Arts et des Lettres. Il aimait surtout sa femme Josette et ses deux enfants (dont un qu’il avait eu le malheur de perdre jeune) et son Sud-Ouest natal.
 Guy CHAUVET, né le 2 octobre 1933 à Montluçon et mort le 26 mars 2007 à Espoey, à l’âge de 73 ans. Arrivé à l’âge de 3 mois dans les Hautes-Pyrénées il va faire toute sa scolarité et son service militaire (parachutiste au 1er Régiment de Hussards) à Tarbes, avant de partir à l’âge de 24 ans pour l’Opéra de Paris. Chanteur lyrique, c’est là qu’il va devenir le grand ténor international. Il découvrit le chant grâce à la chorale et sa voix au Conservatoire Henri-Duparc, mais aussi par le biais de la radio et du cinéma : il admirait le ténor d’opérette André Dassary et le ténor d’opéra José Luccioni, spécialiste de ces grands rôles, dont il se fera lui-même une spécialité. Chanteur amateur, il sera d’abord baryton, mais se métamorphosera en ténor. Il participa à plusieurs concours, Pau et Tarbes en 1952. En mars 1954, c’est le concours des Ténors organisé à Cannes par Mario Podesta qui le fait connaître dans toute la France. Le premier prix sera partagé entre quatre vainqueurs ex-aequo, Alain Vanzo, Tony Poncet, Gustave Botiaux et Roger Gardes; Guy, le plus jeune des finalistes (il n’a que 20 ans) impressionne dans le récit du Graal de Lohengrin et se voit attribuer, sur insistance du directeur du casino, un prix spécial doté de la somme de 150 000 francs. Lauréat du concours de Toulouse en 1955, il remportera en 1958 deux Voix d’or, celle qui récompense l’épreuve d’opéra et celle de la catégorie mélodie. Ce qui lui vaudra d’être immédiatement engagé par Georges Hirsch, alors directeur de l’Opéra de Paris. En 1959, il débuta au Palais Garnier dans un homme d’arme de « La Flûte enchantée », il sera Adario dans l’une des innombrables reprises des « Indes galantes » montées par Maurice Lehmann (il y sera Don Carlos en 1962). Il assurera quelques troisièmes rôles dans Aïda ou dans Samson et Dalila aux côtés de Mario del Monaco avant de devenir le plus jeune premier ténor de l’Opéra en tenant le rôle de Faust de Berlioz de la Damnation, le 20 septembre 1959. Lors des deux saisons suivantes, il sera imposé par Régine Crespin en Enée, chantera Arturo avec Joan Sutherland en Lucia et triomphera en Florestan tout en assurant une création mondiale à Monte-Carlo. Cette ascension fulgurante lui vaudra quelques jalousies et il trouvera un beau jour dans le parking des artistes les pneus de sa nouvelle voiture en piteux état. Avec une carrière sur les plus grandes scènes du monde mais aussi dans nos provinces, il aura travaillé avec les artistes les plus éminents de son époque, mais aura surtout été marqué par Régine Crespin et Fiorenza Cossotto, par Gabriel Bacquier et Jon Vickers. Il considérait Andréa Guiot comme une sœur et réciproquement. Bref, une immense voix lyrique qui aura côtoyé les plus grandes : Renata Tebaldi, Régine Crespin, Placido Domingo, etc. Après s’être retiré des scènes en 1984, il deviendra l’un des professeurs les plus emblématiques du Conservatoire de Tarbes. En septembre 2001, le maire de Tarbes le fera Citoyen d’honneur de la ville. Par ailleurs il avait déjà été décoré de la Légion d’honneur et fait chevalier de l’Ordre national du Mérite et de l’Ordre des Arts et des Lettres. Il aimait surtout sa femme Josette et ses deux enfants (dont un qu’il avait eu le malheur de perdre jeune) et son Sud-Ouest natal.
Guy CHAUVET, né le 2 octobre 1933 à Montluçon et mort le 26 mars 2007 à Espoey, à l’âge de 73 ans. Arrivé à l’âge de 3 mois dans les Hautes-Pyrénées il va faire toute sa scolarité et son service militaire (parachutiste au 1er Régiment de Hussards) à Tarbes, avant de partir à l’âge de 24 ans pour l’Opéra de Paris. Chanteur lyrique, c’est là qu’il va devenir le grand ténor international. Il découvrit le chant grâce à la chorale et sa voix au Conservatoire Henri-Duparc, mais aussi par le biais de la radio et du cinéma : il admirait le ténor d’opérette André Dassary et le ténor d’opéra José Luccioni, spécialiste de ces grands rôles, dont il se fera lui-même une spécialité. Chanteur amateur, il sera d’abord baryton, mais se métamorphosera en ténor. Il participa à plusieurs concours, Pau et Tarbes en 1952. En mars 1954, c’est le concours des Ténors organisé à Cannes par Mario Podesta qui le fait connaître dans toute la France. Le premier prix sera partagé entre quatre vainqueurs ex-aequo, Alain Vanzo, Tony Poncet, Gustave Botiaux et Roger Gardes; Guy, le plus jeune des finalistes (il n’a que 20 ans) impressionne dans le récit du Graal de Lohengrin et se voit attribuer, sur insistance du directeur du casino, un prix spécial doté de la somme de 150 000 francs. Lauréat du concours de Toulouse en 1955, il remportera en 1958 deux Voix d’or, celle qui récompense l’épreuve d’opéra et celle de la catégorie mélodie. Ce qui lui vaudra d’être immédiatement engagé par Georges Hirsch, alors directeur de l’Opéra de Paris. En 1959, il débuta au Palais Garnier dans un homme d’arme de « La Flûte enchantée », il sera Adario dans l’une des innombrables reprises des « Indes galantes » montées par Maurice Lehmann (il y sera Don Carlos en 1962). Il assurera quelques troisièmes rôles dans Aïda ou dans Samson et Dalila aux côtés de Mario del Monaco avant de devenir le plus jeune premier ténor de l’Opéra en tenant le rôle de Faust de Berlioz de la Damnation, le 20 septembre 1959. Lors des deux saisons suivantes, il sera imposé par Régine Crespin en Enée, chantera Arturo avec Joan Sutherland en Lucia et triomphera en Florestan tout en assurant une création mondiale à Monte-Carlo. Cette ascension fulgurante lui vaudra quelques jalousies et il trouvera un beau jour dans le parking des artistes les pneus de sa nouvelle voiture en piteux état. Avec une carrière sur les plus grandes scènes du monde mais aussi dans nos provinces, il aura travaillé avec les artistes les plus éminents de son époque, mais aura surtout été marqué par Régine Crespin et Fiorenza Cossotto, par Gabriel Bacquier et Jon Vickers. Il considérait Andréa Guiot comme une sœur et réciproquement. Bref, une immense voix lyrique qui aura côtoyé les plus grandes : Renata Tebaldi, Régine Crespin, Placido Domingo, etc. Après s’être retiré des scènes en 1984, il deviendra l’un des professeurs les plus emblématiques du Conservatoire de Tarbes. En septembre 2001, le maire de Tarbes le fera Citoyen d’honneur de la ville. Par ailleurs il avait déjà été décoré de la Légion d’honneur et fait chevalier de l’Ordre national du Mérite et de l’Ordre des Arts et des Lettres. Il aimait surtout sa femme Josette et ses deux enfants (dont un qu’il avait eu le malheur de perdre jeune) et son Sud-Ouest natal.COELHO Paulo (1947-XXXX)
Romancier, interprète et écrivain brésilien, Bigourdan d'adoption
 Paulo COELHO, né le 24 août 1947 à Rio de Janeiro dans une famille de classe moyenne est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands de la littérature contemporaine et l’un des écrivains les plus lus dans le monde. Son père, Pedro Queima Coelho de Souza, est ingénieur et sa mère une femme au foyer très catholique. Écrivain brésilien, il est l’auteur de romans, parmi lesquels le plus célèbre est sans conteste L’Alchimiste, un véritable chef-d’œuvre. Mais il est aussi l’auteur de livres de sagesse comme le Manuel du Guerrier de la Lumière, manuel dans lequel il développe une série de préceptes exprimant sa conception spirituelle de la vie et de l’existence. Dans son enfance il reçut une éducation rigoureuse dans l’école jésuite de San Ignacio à Rio qui l’éloigna pendant longtemps de l’Église catholique. C’est à partir de ce moment qu’il montre son intérêt pour la littérature en découvrant les œuvres de Henry Miller, Jorge Luis Borges, Marx, Hegel ou Engels. Ses parents le veulent ingénieur, tentant de le dissuader de s’engager sur la voie littéraire, mais Paulo aime le théâtre. Il entre alors en conflit avec eux. Entre 17 et 20 ans, ses parents désemparés par cet adolescent difficile et croyant reconnaître dans son attitude rebelle des signes de folie, le font interner trois fois en hôpital psychiatrique, où il subit des électrochocs. Il s’en échappa trois fois avant d’être relâché à l’âge de 20 ans. Bien des années plus tard, il puisera dans cette expérience pénible le matériau de son roman «Veronika décide de mourir». Pour faire plaisir à ses parents, il décide de suivre des études de droit et met de côté son rêve de devenir écrivain. Mais un an plus tard, il abandonna tout et s’engagea dans le mouvement hippie. Les années 1960 voient l’explosion internationale du mouvement hippie. Paulo y souscrit, ainsi qu’à tous ses excès. À l’âge de 23 ans, il abandonne sa ville natale pour voyager à travers le Mexique, le Pérou, la Bolivie et le Chili, ainsi qu’à travers l’Europe et l’Afrique du Nord, s’immergeant dans la culture hippie qui régnait à cette époque. Deux ans plus tard, en 1972, il revient au Brésil et commence à composer des paroles de chansons populaires. Il va écrire des chansons pour des chanteurs brésiliens très célèbres tels que Elis Regina ou Rita Lee et travailler avec le compositeur et interprète Raul Seixas. Leur association qui dure jusqu’en 1976 est un succès et contribue à changer le visage de la scène rock brésilienne. En 1974, ses prises de position libertaires en tant que journaliste, musicien et écrivain à l’égard de la dictature militaire brésilienne lui valurent d’être emprisonné et soumis à la torture physique. Par une ironie du sort, c’est son dossier psychiatrique qui lui permit d’échapper au pire, en le faisant passer pour fou. Aspirant dès lors à une vie ordinaire, il entra à 26 ans chez Polygram, où il va connaître sa future épouse. Cet épisode de « normalité « ne dure que quelques années. En 1977, il déménage à Londres, achète une machine à écrire, et se consacre à plein temps à la littérature, sans beaucoup de résultats. En 1978, il repart au Brésil et travaille pour la Compagnie discographique CBS. Trois mois plus tard, il quitte son emploi et son épouse. En 1979, il retrouve l’artiste-peintre Christina Oiticica, une ancienne amie avec qui il va se marier en secondes noces, en 1980. Ensemble ils intègrent l’ordre religieux RAM (Rigueur, Amour et Miséricorde), dont le siège central se trouve en Hollande. C’est pendant la visite du camp de concentration de Dachau, là, dans l’émotion du recueillement que sa vocation d’écrivain prend un tournant majeur : il a une vision et il va y rencontrer la personne qui le réconcilie avec le catholicisme et bouleverse son engagement d’écrivain. C’est donc à partir de ce moment que commença véritablement à se révéler à lui sa vocation d’écrivain et qu’il décidera plus tard de se lancer sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, où il trouve l’inspiration de son premier livre à succès et où il comprend que son destin était d’écrire. C’est en 1982, qu’il publie un premier roman «Archives de l’enfer», un livre qui ne connaîtra pas le succès. En 1987, il publie «Le Pèlerin de Compostelle», livre qui connaît un succès mitigé, où il relate le voyage initiatique entrepris avec Christina Oiticica. Mais le livre qui révéla véritablement Paulo Coelho fut L’Alchimiste, un best-seller mondial, publié en 1988 et traduit en français en 1994. Un conte philosophique et initiatique dans lequel l’auteur, à travers le personnage principal du roman, développe les thèmes qui lui ont permis de trouver sa «légende personnelle». Dans ce livre, il raconte l’histoire d’un jeune berger andalou nommé Santiago qui part à la recherche d’un trésor enfoui au pied des pyramides. Et Santiago rencontre un alchimiste dans le désert qui devient un guide pour lui. Ce roman, avec lequel il acquiert une renommée internationale, s’est vendu en vingt ans à plus de 65 millions d’exemplaires dans le monde. Aujourd’hui, Paulo est une figure internationale de la scène littéraire puisqu’il a vendu à ce jour plus de 175 millions d’exemplaires de ses œuvres, publiées dans 81 langues différentes à travers le monde avec 400 millions de lecteurs. Il est le deuxième auteur le plus vendu au monde. Il a gagné de nombreux prix littéraires dans divers pays, y compris une mention du prestigieux Prix littéraire de Dublin pour Veronika décide de mourir. Il est chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur et officier des Arts et des Lettres en France et il a reçu de nombreuses décorations et des prix internationaux prestigieux. En 2002, il a été admis à l’Académie brésilienne des Lettres (l’équivalent de notre Académie française) et en 2007 il a été nommé Messager de la Paix des Nations Unies. Avec plus de 30 millions de fans, il est l’auteur qui compte le plus grand nombre d’adeptes sur les réseaux sociaux. Homme de cœur, il a créé une fondation « l’Instituto Paulo Coelho », chargé d'aider des Brésiliens démunis et discriminés, à laquelle il consacre une partie de ses revenus pour venir en aide aux enfants défavorisés et aux personnes âgées au Brésil. Il s’investit aussi dans de nombreux programmes humanitaires dans le monde, notamment pour l’Unesco. Il publie au rythme d’un roman par an environ. Il y développe ses thèmes de prédilection, à savoir l’amour, le destin et le hasard, la spiritualité. En dehors des périodes où il voyage pour promouvoir ses œuvres, il habite entre Rio de Janeiro, Genève et le village de Saint-Martin dans les Hautes-Pyrénées. Une ville tient pourtant une place particulière dans son cœur : Tarbes. « J’y étais passé rapidement lors de mon premier pèlerinage à Lourdes en 1992. J’ai réellement découvert cette ville dix ans plus tard », explique-t-il. En 2001, l’écrivain et sa femme Christina Oiticica cherchent un endroit où se poser pendant quelques mois, histoire de souffler après vingt ans d’itinérance. Ils décident de retourner à Lourdes pour méditer. La ville sainte occupe une place importante dans la vie de Coelho. Paulo y fête chaque année le réveillon devant la grotte de Massabielle et il ne se déplace nulle part sans un petit flacon d’eau bénite provenant du sanctuaire. « J’en prends trois gouttes chaque matin, cela me tient en forme », confiera-t-il. Arrivés de Paris, l’écrivain brésilien et sa femme passent la nuit à l’hôtel Henri IV à Tarbes. « Nous avons atterri dans la chambre 8, se souvient le romancier, pourtant habitué aux plus grands palaces du monde. Nous nous y sommes sentis si bien que nous avons décidé d’y rester une deuxième nuit puis une autre, puis encore une autre. » Christina et Paulo ne vont plus quitter Tarbes pendant plus de six mois, en vivant avec le minimum dans cet hôtel sans restaurant. Tout semble «exotique» au Sud-Américain. La halle Marcadieu et la fontaine des Quatre-Vallées, ou encore la cathédrale Notre-Dame de la Sède. Mais aussi, bien sûr, le jardin Massey. Et dès qu’il le peut, l’écrivain enfile ses chaussures de randonnée et emprunte les chemins de traverse, arpentant inlassablement les sentiers de la Bigorre. « Un sentier différent tous les jours. Jamais le même. Pour le plaisir de la découverte. Ici, c’est le paradis des marcheurs. » Sa femme, qui faute de place ne peut entreposer les toiles qu’elle peint chaque jour dans la chambre d’hôtel, décide d’enfouir ses œuvres au gré de ses balades. « Nous enterrions les tableaux au pied d’un arbre, dans le lit d’une rivière ou en plein champ et relevions l’emplacement grâce à un GPS en nous disant que nous viendrions les chercher un an plus tard, jour pour jour. » Ces œuvres, curieusement travaillées par l’humidité et les insectes, sont aujourd’hui exposées à travers le monde. Ses bonnes adresses gastronomiques sont nombreuses : il dîne tous les soirs dehors. Parmi ses tables favorites, l’écrivain cite Le Fil à la patte, L’Aragon mais aussi Le Viscos à Saint-Savin. On le rencontre aussi, parfois, au Petit Gourmand. Bon vivant, il a noué rapidement des liens d’amitié avec des habitants des Hautes-Pyrénées, dont le docteur Yves Louit, de Saint-Martin. En 2003, Paulo Coelho a finalement décidé d’acquérir une propriété près de Tarbes. « Nous avons acheté un moulin à Saint-Martin que nous rénovons nous-mêmes. Nous y passons désormais trois mois par an. » Le reste de l’année, l’écrivain est sur les routes. « Mais je sais que Tarbes est devenue mon port d’attache », assure-t-il. « C’est le meilleur ambassadeur de notre ville » dira de lui le maire Gérard Trémège. Et pas étonnant que la municipalité de Tarbes en ait fait son Citoyen d’honneur en 2001 ! Par ailleurs, Paulo Coelho est très attaché au délicieux village de Saint-Savin et il y fait référence dans son livre « Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j’ai pleuré », avec une scène près de la fontaine et aussi au village de Viscos (Bescos dans Le Démon et mademoiselle Prym).
Paulo COELHO, né le 24 août 1947 à Rio de Janeiro dans une famille de classe moyenne est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands de la littérature contemporaine et l’un des écrivains les plus lus dans le monde. Son père, Pedro Queima Coelho de Souza, est ingénieur et sa mère une femme au foyer très catholique. Écrivain brésilien, il est l’auteur de romans, parmi lesquels le plus célèbre est sans conteste L’Alchimiste, un véritable chef-d’œuvre. Mais il est aussi l’auteur de livres de sagesse comme le Manuel du Guerrier de la Lumière, manuel dans lequel il développe une série de préceptes exprimant sa conception spirituelle de la vie et de l’existence. Dans son enfance il reçut une éducation rigoureuse dans l’école jésuite de San Ignacio à Rio qui l’éloigna pendant longtemps de l’Église catholique. C’est à partir de ce moment qu’il montre son intérêt pour la littérature en découvrant les œuvres de Henry Miller, Jorge Luis Borges, Marx, Hegel ou Engels. Ses parents le veulent ingénieur, tentant de le dissuader de s’engager sur la voie littéraire, mais Paulo aime le théâtre. Il entre alors en conflit avec eux. Entre 17 et 20 ans, ses parents désemparés par cet adolescent difficile et croyant reconnaître dans son attitude rebelle des signes de folie, le font interner trois fois en hôpital psychiatrique, où il subit des électrochocs. Il s’en échappa trois fois avant d’être relâché à l’âge de 20 ans. Bien des années plus tard, il puisera dans cette expérience pénible le matériau de son roman «Veronika décide de mourir». Pour faire plaisir à ses parents, il décide de suivre des études de droit et met de côté son rêve de devenir écrivain. Mais un an plus tard, il abandonna tout et s’engagea dans le mouvement hippie. Les années 1960 voient l’explosion internationale du mouvement hippie. Paulo y souscrit, ainsi qu’à tous ses excès. À l’âge de 23 ans, il abandonne sa ville natale pour voyager à travers le Mexique, le Pérou, la Bolivie et le Chili, ainsi qu’à travers l’Europe et l’Afrique du Nord, s’immergeant dans la culture hippie qui régnait à cette époque. Deux ans plus tard, en 1972, il revient au Brésil et commence à composer des paroles de chansons populaires. Il va écrire des chansons pour des chanteurs brésiliens très célèbres tels que Elis Regina ou Rita Lee et travailler avec le compositeur et interprète Raul Seixas. Leur association qui dure jusqu’en 1976 est un succès et contribue à changer le visage de la scène rock brésilienne. En 1974, ses prises de position libertaires en tant que journaliste, musicien et écrivain à l’égard de la dictature militaire brésilienne lui valurent d’être emprisonné et soumis à la torture physique. Par une ironie du sort, c’est son dossier psychiatrique qui lui permit d’échapper au pire, en le faisant passer pour fou. Aspirant dès lors à une vie ordinaire, il entra à 26 ans chez Polygram, où il va connaître sa future épouse. Cet épisode de « normalité « ne dure que quelques années. En 1977, il déménage à Londres, achète une machine à écrire, et se consacre à plein temps à la littérature, sans beaucoup de résultats. En 1978, il repart au Brésil et travaille pour la Compagnie discographique CBS. Trois mois plus tard, il quitte son emploi et son épouse. En 1979, il retrouve l’artiste-peintre Christina Oiticica, une ancienne amie avec qui il va se marier en secondes noces, en 1980. Ensemble ils intègrent l’ordre religieux RAM (Rigueur, Amour et Miséricorde), dont le siège central se trouve en Hollande. C’est pendant la visite du camp de concentration de Dachau, là, dans l’émotion du recueillement que sa vocation d’écrivain prend un tournant majeur : il a une vision et il va y rencontrer la personne qui le réconcilie avec le catholicisme et bouleverse son engagement d’écrivain. C’est donc à partir de ce moment que commença véritablement à se révéler à lui sa vocation d’écrivain et qu’il décidera plus tard de se lancer sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, où il trouve l’inspiration de son premier livre à succès et où il comprend que son destin était d’écrire. C’est en 1982, qu’il publie un premier roman «Archives de l’enfer», un livre qui ne connaîtra pas le succès. En 1987, il publie «Le Pèlerin de Compostelle», livre qui connaît un succès mitigé, où il relate le voyage initiatique entrepris avec Christina Oiticica. Mais le livre qui révéla véritablement Paulo Coelho fut L’Alchimiste, un best-seller mondial, publié en 1988 et traduit en français en 1994. Un conte philosophique et initiatique dans lequel l’auteur, à travers le personnage principal du roman, développe les thèmes qui lui ont permis de trouver sa «légende personnelle». Dans ce livre, il raconte l’histoire d’un jeune berger andalou nommé Santiago qui part à la recherche d’un trésor enfoui au pied des pyramides. Et Santiago rencontre un alchimiste dans le désert qui devient un guide pour lui. Ce roman, avec lequel il acquiert une renommée internationale, s’est vendu en vingt ans à plus de 65 millions d’exemplaires dans le monde. Aujourd’hui, Paulo est une figure internationale de la scène littéraire puisqu’il a vendu à ce jour plus de 175 millions d’exemplaires de ses œuvres, publiées dans 81 langues différentes à travers le monde avec 400 millions de lecteurs. Il est le deuxième auteur le plus vendu au monde. Il a gagné de nombreux prix littéraires dans divers pays, y compris une mention du prestigieux Prix littéraire de Dublin pour Veronika décide de mourir. Il est chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur et officier des Arts et des Lettres en France et il a reçu de nombreuses décorations et des prix internationaux prestigieux. En 2002, il a été admis à l’Académie brésilienne des Lettres (l’équivalent de notre Académie française) et en 2007 il a été nommé Messager de la Paix des Nations Unies. Avec plus de 30 millions de fans, il est l’auteur qui compte le plus grand nombre d’adeptes sur les réseaux sociaux. Homme de cœur, il a créé une fondation « l’Instituto Paulo Coelho », chargé d'aider des Brésiliens démunis et discriminés, à laquelle il consacre une partie de ses revenus pour venir en aide aux enfants défavorisés et aux personnes âgées au Brésil. Il s’investit aussi dans de nombreux programmes humanitaires dans le monde, notamment pour l’Unesco. Il publie au rythme d’un roman par an environ. Il y développe ses thèmes de prédilection, à savoir l’amour, le destin et le hasard, la spiritualité. En dehors des périodes où il voyage pour promouvoir ses œuvres, il habite entre Rio de Janeiro, Genève et le village de Saint-Martin dans les Hautes-Pyrénées. Une ville tient pourtant une place particulière dans son cœur : Tarbes. « J’y étais passé rapidement lors de mon premier pèlerinage à Lourdes en 1992. J’ai réellement découvert cette ville dix ans plus tard », explique-t-il. En 2001, l’écrivain et sa femme Christina Oiticica cherchent un endroit où se poser pendant quelques mois, histoire de souffler après vingt ans d’itinérance. Ils décident de retourner à Lourdes pour méditer. La ville sainte occupe une place importante dans la vie de Coelho. Paulo y fête chaque année le réveillon devant la grotte de Massabielle et il ne se déplace nulle part sans un petit flacon d’eau bénite provenant du sanctuaire. « J’en prends trois gouttes chaque matin, cela me tient en forme », confiera-t-il. Arrivés de Paris, l’écrivain brésilien et sa femme passent la nuit à l’hôtel Henri IV à Tarbes. « Nous avons atterri dans la chambre 8, se souvient le romancier, pourtant habitué aux plus grands palaces du monde. Nous nous y sommes sentis si bien que nous avons décidé d’y rester une deuxième nuit puis une autre, puis encore une autre. » Christina et Paulo ne vont plus quitter Tarbes pendant plus de six mois, en vivant avec le minimum dans cet hôtel sans restaurant. Tout semble «exotique» au Sud-Américain. La halle Marcadieu et la fontaine des Quatre-Vallées, ou encore la cathédrale Notre-Dame de la Sède. Mais aussi, bien sûr, le jardin Massey. Et dès qu’il le peut, l’écrivain enfile ses chaussures de randonnée et emprunte les chemins de traverse, arpentant inlassablement les sentiers de la Bigorre. « Un sentier différent tous les jours. Jamais le même. Pour le plaisir de la découverte. Ici, c’est le paradis des marcheurs. » Sa femme, qui faute de place ne peut entreposer les toiles qu’elle peint chaque jour dans la chambre d’hôtel, décide d’enfouir ses œuvres au gré de ses balades. « Nous enterrions les tableaux au pied d’un arbre, dans le lit d’une rivière ou en plein champ et relevions l’emplacement grâce à un GPS en nous disant que nous viendrions les chercher un an plus tard, jour pour jour. » Ces œuvres, curieusement travaillées par l’humidité et les insectes, sont aujourd’hui exposées à travers le monde. Ses bonnes adresses gastronomiques sont nombreuses : il dîne tous les soirs dehors. Parmi ses tables favorites, l’écrivain cite Le Fil à la patte, L’Aragon mais aussi Le Viscos à Saint-Savin. On le rencontre aussi, parfois, au Petit Gourmand. Bon vivant, il a noué rapidement des liens d’amitié avec des habitants des Hautes-Pyrénées, dont le docteur Yves Louit, de Saint-Martin. En 2003, Paulo Coelho a finalement décidé d’acquérir une propriété près de Tarbes. « Nous avons acheté un moulin à Saint-Martin que nous rénovons nous-mêmes. Nous y passons désormais trois mois par an. » Le reste de l’année, l’écrivain est sur les routes. « Mais je sais que Tarbes est devenue mon port d’attache », assure-t-il. « C’est le meilleur ambassadeur de notre ville » dira de lui le maire Gérard Trémège. Et pas étonnant que la municipalité de Tarbes en ait fait son Citoyen d’honneur en 2001 ! Par ailleurs, Paulo Coelho est très attaché au délicieux village de Saint-Savin et il y fait référence dans son livre « Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j’ai pleuré », avec une scène près de la fontaine et aussi au village de Viscos (Bescos dans Le Démon et mademoiselle Prym).
Voici quelques-uns de ses ouvrages qui ont rencontré un vif succès : Le Pèlerin de Compostelle (1997), L’Alchimiste (1988), Les Walkyries (1992), Maktub (1994), Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j’ai pleuré (1995), La Cinquième Montagne (1996), Manuel du guerrier de la lumière (1997), Veronika décide de mourir (1998), Conversations avec Paulo Coelho (1999), Le Démon et mademoiselle Prym (2000), Onze Minutes (2003), Le Zahir (2005), La Sorcière de Portobello (2007), La Solitude du Vainqueur (2008), Comme le fleuve qui coule (2008), Brida (2010), Aleph (2011), Le Manuscrit retrouvé (2013), Et le septième jour-Trilogie (2014), Contes de Noël (2014), Adultère (2015), L’Espionne (2016), Hippie (2018), La voie de l'archer (2019). Chaque nouvelle sortie de livre fait l’événement mais sans atteindre le succès qu’il a connu auparavant avec «L’Alchimiste» ou «Le Pèlerin de Compostelle». Depuis 2016 Paulo Coelho travaillait avec Kobe Bryant, légende du basket, sur l’écriture d’un livre pour enfants. Mais suite au décès survenu le dimanche 26 janvier 2020 de l’ancien joueur de NBA, âgé de 41 ans, dans un crash d’hélicoptère en Californie, Paulo Coelho a décidé d’abandonner son écriture considérant que cela ”n’avait pas beaucoup de sens de le publier sans lui” et que cela ne “serait pas pertinent pour lui ou sa famille”.
 Paulo COELHO, né le 24 août 1947 à Rio de Janeiro dans une famille de classe moyenne est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands de la littérature contemporaine et l’un des écrivains les plus lus dans le monde. Son père, Pedro Queima Coelho de Souza, est ingénieur et sa mère une femme au foyer très catholique. Écrivain brésilien, il est l’auteur de romans, parmi lesquels le plus célèbre est sans conteste L’Alchimiste, un véritable chef-d’œuvre. Mais il est aussi l’auteur de livres de sagesse comme le Manuel du Guerrier de la Lumière, manuel dans lequel il développe une série de préceptes exprimant sa conception spirituelle de la vie et de l’existence. Dans son enfance il reçut une éducation rigoureuse dans l’école jésuite de San Ignacio à Rio qui l’éloigna pendant longtemps de l’Église catholique. C’est à partir de ce moment qu’il montre son intérêt pour la littérature en découvrant les œuvres de Henry Miller, Jorge Luis Borges, Marx, Hegel ou Engels. Ses parents le veulent ingénieur, tentant de le dissuader de s’engager sur la voie littéraire, mais Paulo aime le théâtre. Il entre alors en conflit avec eux. Entre 17 et 20 ans, ses parents désemparés par cet adolescent difficile et croyant reconnaître dans son attitude rebelle des signes de folie, le font interner trois fois en hôpital psychiatrique, où il subit des électrochocs. Il s’en échappa trois fois avant d’être relâché à l’âge de 20 ans. Bien des années plus tard, il puisera dans cette expérience pénible le matériau de son roman «Veronika décide de mourir». Pour faire plaisir à ses parents, il décide de suivre des études de droit et met de côté son rêve de devenir écrivain. Mais un an plus tard, il abandonna tout et s’engagea dans le mouvement hippie. Les années 1960 voient l’explosion internationale du mouvement hippie. Paulo y souscrit, ainsi qu’à tous ses excès. À l’âge de 23 ans, il abandonne sa ville natale pour voyager à travers le Mexique, le Pérou, la Bolivie et le Chili, ainsi qu’à travers l’Europe et l’Afrique du Nord, s’immergeant dans la culture hippie qui régnait à cette époque. Deux ans plus tard, en 1972, il revient au Brésil et commence à composer des paroles de chansons populaires. Il va écrire des chansons pour des chanteurs brésiliens très célèbres tels que Elis Regina ou Rita Lee et travailler avec le compositeur et interprète Raul Seixas. Leur association qui dure jusqu’en 1976 est un succès et contribue à changer le visage de la scène rock brésilienne. En 1974, ses prises de position libertaires en tant que journaliste, musicien et écrivain à l’égard de la dictature militaire brésilienne lui valurent d’être emprisonné et soumis à la torture physique. Par une ironie du sort, c’est son dossier psychiatrique qui lui permit d’échapper au pire, en le faisant passer pour fou. Aspirant dès lors à une vie ordinaire, il entra à 26 ans chez Polygram, où il va connaître sa future épouse. Cet épisode de « normalité « ne dure que quelques années. En 1977, il déménage à Londres, achète une machine à écrire, et se consacre à plein temps à la littérature, sans beaucoup de résultats. En 1978, il repart au Brésil et travaille pour la Compagnie discographique CBS. Trois mois plus tard, il quitte son emploi et son épouse. En 1979, il retrouve l’artiste-peintre Christina Oiticica, une ancienne amie avec qui il va se marier en secondes noces, en 1980. Ensemble ils intègrent l’ordre religieux RAM (Rigueur, Amour et Miséricorde), dont le siège central se trouve en Hollande. C’est pendant la visite du camp de concentration de Dachau, là, dans l’émotion du recueillement que sa vocation d’écrivain prend un tournant majeur : il a une vision et il va y rencontrer la personne qui le réconcilie avec le catholicisme et bouleverse son engagement d’écrivain. C’est donc à partir de ce moment que commença véritablement à se révéler à lui sa vocation d’écrivain et qu’il décidera plus tard de se lancer sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, où il trouve l’inspiration de son premier livre à succès et où il comprend que son destin était d’écrire. C’est en 1982, qu’il publie un premier roman «Archives de l’enfer», un livre qui ne connaîtra pas le succès. En 1987, il publie «Le Pèlerin de Compostelle», livre qui connaît un succès mitigé, où il relate le voyage initiatique entrepris avec Christina Oiticica. Mais le livre qui révéla véritablement Paulo Coelho fut L’Alchimiste, un best-seller mondial, publié en 1988 et traduit en français en 1994. Un conte philosophique et initiatique dans lequel l’auteur, à travers le personnage principal du roman, développe les thèmes qui lui ont permis de trouver sa «légende personnelle». Dans ce livre, il raconte l’histoire d’un jeune berger andalou nommé Santiago qui part à la recherche d’un trésor enfoui au pied des pyramides. Et Santiago rencontre un alchimiste dans le désert qui devient un guide pour lui. Ce roman, avec lequel il acquiert une renommée internationale, s’est vendu en vingt ans à plus de 65 millions d’exemplaires dans le monde. Aujourd’hui, Paulo est une figure internationale de la scène littéraire puisqu’il a vendu à ce jour plus de 175 millions d’exemplaires de ses œuvres, publiées dans 81 langues différentes à travers le monde avec 400 millions de lecteurs. Il est le deuxième auteur le plus vendu au monde. Il a gagné de nombreux prix littéraires dans divers pays, y compris une mention du prestigieux Prix littéraire de Dublin pour Veronika décide de mourir. Il est chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur et officier des Arts et des Lettres en France et il a reçu de nombreuses décorations et des prix internationaux prestigieux. En 2002, il a été admis à l’Académie brésilienne des Lettres (l’équivalent de notre Académie française) et en 2007 il a été nommé Messager de la Paix des Nations Unies. Avec plus de 30 millions de fans, il est l’auteur qui compte le plus grand nombre d’adeptes sur les réseaux sociaux. Homme de cœur, il a créé une fondation « l’Instituto Paulo Coelho », chargé d'aider des Brésiliens démunis et discriminés, à laquelle il consacre une partie de ses revenus pour venir en aide aux enfants défavorisés et aux personnes âgées au Brésil. Il s’investit aussi dans de nombreux programmes humanitaires dans le monde, notamment pour l’Unesco. Il publie au rythme d’un roman par an environ. Il y développe ses thèmes de prédilection, à savoir l’amour, le destin et le hasard, la spiritualité. En dehors des périodes où il voyage pour promouvoir ses œuvres, il habite entre Rio de Janeiro, Genève et le village de Saint-Martin dans les Hautes-Pyrénées. Une ville tient pourtant une place particulière dans son cœur : Tarbes. « J’y étais passé rapidement lors de mon premier pèlerinage à Lourdes en 1992. J’ai réellement découvert cette ville dix ans plus tard », explique-t-il. En 2001, l’écrivain et sa femme Christina Oiticica cherchent un endroit où se poser pendant quelques mois, histoire de souffler après vingt ans d’itinérance. Ils décident de retourner à Lourdes pour méditer. La ville sainte occupe une place importante dans la vie de Coelho. Paulo y fête chaque année le réveillon devant la grotte de Massabielle et il ne se déplace nulle part sans un petit flacon d’eau bénite provenant du sanctuaire. « J’en prends trois gouttes chaque matin, cela me tient en forme », confiera-t-il. Arrivés de Paris, l’écrivain brésilien et sa femme passent la nuit à l’hôtel Henri IV à Tarbes. « Nous avons atterri dans la chambre 8, se souvient le romancier, pourtant habitué aux plus grands palaces du monde. Nous nous y sommes sentis si bien que nous avons décidé d’y rester une deuxième nuit puis une autre, puis encore une autre. » Christina et Paulo ne vont plus quitter Tarbes pendant plus de six mois, en vivant avec le minimum dans cet hôtel sans restaurant. Tout semble «exotique» au Sud-Américain. La halle Marcadieu et la fontaine des Quatre-Vallées, ou encore la cathédrale Notre-Dame de la Sède. Mais aussi, bien sûr, le jardin Massey. Et dès qu’il le peut, l’écrivain enfile ses chaussures de randonnée et emprunte les chemins de traverse, arpentant inlassablement les sentiers de la Bigorre. « Un sentier différent tous les jours. Jamais le même. Pour le plaisir de la découverte. Ici, c’est le paradis des marcheurs. » Sa femme, qui faute de place ne peut entreposer les toiles qu’elle peint chaque jour dans la chambre d’hôtel, décide d’enfouir ses œuvres au gré de ses balades. « Nous enterrions les tableaux au pied d’un arbre, dans le lit d’une rivière ou en plein champ et relevions l’emplacement grâce à un GPS en nous disant que nous viendrions les chercher un an plus tard, jour pour jour. » Ces œuvres, curieusement travaillées par l’humidité et les insectes, sont aujourd’hui exposées à travers le monde. Ses bonnes adresses gastronomiques sont nombreuses : il dîne tous les soirs dehors. Parmi ses tables favorites, l’écrivain cite Le Fil à la patte, L’Aragon mais aussi Le Viscos à Saint-Savin. On le rencontre aussi, parfois, au Petit Gourmand. Bon vivant, il a noué rapidement des liens d’amitié avec des habitants des Hautes-Pyrénées, dont le docteur Yves Louit, de Saint-Martin. En 2003, Paulo Coelho a finalement décidé d’acquérir une propriété près de Tarbes. « Nous avons acheté un moulin à Saint-Martin que nous rénovons nous-mêmes. Nous y passons désormais trois mois par an. » Le reste de l’année, l’écrivain est sur les routes. « Mais je sais que Tarbes est devenue mon port d’attache », assure-t-il. « C’est le meilleur ambassadeur de notre ville » dira de lui le maire Gérard Trémège. Et pas étonnant que la municipalité de Tarbes en ait fait son Citoyen d’honneur en 2001 ! Par ailleurs, Paulo Coelho est très attaché au délicieux village de Saint-Savin et il y fait référence dans son livre « Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j’ai pleuré », avec une scène près de la fontaine et aussi au village de Viscos (Bescos dans Le Démon et mademoiselle Prym).
Paulo COELHO, né le 24 août 1947 à Rio de Janeiro dans une famille de classe moyenne est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands de la littérature contemporaine et l’un des écrivains les plus lus dans le monde. Son père, Pedro Queima Coelho de Souza, est ingénieur et sa mère une femme au foyer très catholique. Écrivain brésilien, il est l’auteur de romans, parmi lesquels le plus célèbre est sans conteste L’Alchimiste, un véritable chef-d’œuvre. Mais il est aussi l’auteur de livres de sagesse comme le Manuel du Guerrier de la Lumière, manuel dans lequel il développe une série de préceptes exprimant sa conception spirituelle de la vie et de l’existence. Dans son enfance il reçut une éducation rigoureuse dans l’école jésuite de San Ignacio à Rio qui l’éloigna pendant longtemps de l’Église catholique. C’est à partir de ce moment qu’il montre son intérêt pour la littérature en découvrant les œuvres de Henry Miller, Jorge Luis Borges, Marx, Hegel ou Engels. Ses parents le veulent ingénieur, tentant de le dissuader de s’engager sur la voie littéraire, mais Paulo aime le théâtre. Il entre alors en conflit avec eux. Entre 17 et 20 ans, ses parents désemparés par cet adolescent difficile et croyant reconnaître dans son attitude rebelle des signes de folie, le font interner trois fois en hôpital psychiatrique, où il subit des électrochocs. Il s’en échappa trois fois avant d’être relâché à l’âge de 20 ans. Bien des années plus tard, il puisera dans cette expérience pénible le matériau de son roman «Veronika décide de mourir». Pour faire plaisir à ses parents, il décide de suivre des études de droit et met de côté son rêve de devenir écrivain. Mais un an plus tard, il abandonna tout et s’engagea dans le mouvement hippie. Les années 1960 voient l’explosion internationale du mouvement hippie. Paulo y souscrit, ainsi qu’à tous ses excès. À l’âge de 23 ans, il abandonne sa ville natale pour voyager à travers le Mexique, le Pérou, la Bolivie et le Chili, ainsi qu’à travers l’Europe et l’Afrique du Nord, s’immergeant dans la culture hippie qui régnait à cette époque. Deux ans plus tard, en 1972, il revient au Brésil et commence à composer des paroles de chansons populaires. Il va écrire des chansons pour des chanteurs brésiliens très célèbres tels que Elis Regina ou Rita Lee et travailler avec le compositeur et interprète Raul Seixas. Leur association qui dure jusqu’en 1976 est un succès et contribue à changer le visage de la scène rock brésilienne. En 1974, ses prises de position libertaires en tant que journaliste, musicien et écrivain à l’égard de la dictature militaire brésilienne lui valurent d’être emprisonné et soumis à la torture physique. Par une ironie du sort, c’est son dossier psychiatrique qui lui permit d’échapper au pire, en le faisant passer pour fou. Aspirant dès lors à une vie ordinaire, il entra à 26 ans chez Polygram, où il va connaître sa future épouse. Cet épisode de « normalité « ne dure que quelques années. En 1977, il déménage à Londres, achète une machine à écrire, et se consacre à plein temps à la littérature, sans beaucoup de résultats. En 1978, il repart au Brésil et travaille pour la Compagnie discographique CBS. Trois mois plus tard, il quitte son emploi et son épouse. En 1979, il retrouve l’artiste-peintre Christina Oiticica, une ancienne amie avec qui il va se marier en secondes noces, en 1980. Ensemble ils intègrent l’ordre religieux RAM (Rigueur, Amour et Miséricorde), dont le siège central se trouve en Hollande. C’est pendant la visite du camp de concentration de Dachau, là, dans l’émotion du recueillement que sa vocation d’écrivain prend un tournant majeur : il a une vision et il va y rencontrer la personne qui le réconcilie avec le catholicisme et bouleverse son engagement d’écrivain. C’est donc à partir de ce moment que commença véritablement à se révéler à lui sa vocation d’écrivain et qu’il décidera plus tard de se lancer sur le Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, où il trouve l’inspiration de son premier livre à succès et où il comprend que son destin était d’écrire. C’est en 1982, qu’il publie un premier roman «Archives de l’enfer», un livre qui ne connaîtra pas le succès. En 1987, il publie «Le Pèlerin de Compostelle», livre qui connaît un succès mitigé, où il relate le voyage initiatique entrepris avec Christina Oiticica. Mais le livre qui révéla véritablement Paulo Coelho fut L’Alchimiste, un best-seller mondial, publié en 1988 et traduit en français en 1994. Un conte philosophique et initiatique dans lequel l’auteur, à travers le personnage principal du roman, développe les thèmes qui lui ont permis de trouver sa «légende personnelle». Dans ce livre, il raconte l’histoire d’un jeune berger andalou nommé Santiago qui part à la recherche d’un trésor enfoui au pied des pyramides. Et Santiago rencontre un alchimiste dans le désert qui devient un guide pour lui. Ce roman, avec lequel il acquiert une renommée internationale, s’est vendu en vingt ans à plus de 65 millions d’exemplaires dans le monde. Aujourd’hui, Paulo est une figure internationale de la scène littéraire puisqu’il a vendu à ce jour plus de 175 millions d’exemplaires de ses œuvres, publiées dans 81 langues différentes à travers le monde avec 400 millions de lecteurs. Il est le deuxième auteur le plus vendu au monde. Il a gagné de nombreux prix littéraires dans divers pays, y compris une mention du prestigieux Prix littéraire de Dublin pour Veronika décide de mourir. Il est chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur et officier des Arts et des Lettres en France et il a reçu de nombreuses décorations et des prix internationaux prestigieux. En 2002, il a été admis à l’Académie brésilienne des Lettres (l’équivalent de notre Académie française) et en 2007 il a été nommé Messager de la Paix des Nations Unies. Avec plus de 30 millions de fans, il est l’auteur qui compte le plus grand nombre d’adeptes sur les réseaux sociaux. Homme de cœur, il a créé une fondation « l’Instituto Paulo Coelho », chargé d'aider des Brésiliens démunis et discriminés, à laquelle il consacre une partie de ses revenus pour venir en aide aux enfants défavorisés et aux personnes âgées au Brésil. Il s’investit aussi dans de nombreux programmes humanitaires dans le monde, notamment pour l’Unesco. Il publie au rythme d’un roman par an environ. Il y développe ses thèmes de prédilection, à savoir l’amour, le destin et le hasard, la spiritualité. En dehors des périodes où il voyage pour promouvoir ses œuvres, il habite entre Rio de Janeiro, Genève et le village de Saint-Martin dans les Hautes-Pyrénées. Une ville tient pourtant une place particulière dans son cœur : Tarbes. « J’y étais passé rapidement lors de mon premier pèlerinage à Lourdes en 1992. J’ai réellement découvert cette ville dix ans plus tard », explique-t-il. En 2001, l’écrivain et sa femme Christina Oiticica cherchent un endroit où se poser pendant quelques mois, histoire de souffler après vingt ans d’itinérance. Ils décident de retourner à Lourdes pour méditer. La ville sainte occupe une place importante dans la vie de Coelho. Paulo y fête chaque année le réveillon devant la grotte de Massabielle et il ne se déplace nulle part sans un petit flacon d’eau bénite provenant du sanctuaire. « J’en prends trois gouttes chaque matin, cela me tient en forme », confiera-t-il. Arrivés de Paris, l’écrivain brésilien et sa femme passent la nuit à l’hôtel Henri IV à Tarbes. « Nous avons atterri dans la chambre 8, se souvient le romancier, pourtant habitué aux plus grands palaces du monde. Nous nous y sommes sentis si bien que nous avons décidé d’y rester une deuxième nuit puis une autre, puis encore une autre. » Christina et Paulo ne vont plus quitter Tarbes pendant plus de six mois, en vivant avec le minimum dans cet hôtel sans restaurant. Tout semble «exotique» au Sud-Américain. La halle Marcadieu et la fontaine des Quatre-Vallées, ou encore la cathédrale Notre-Dame de la Sède. Mais aussi, bien sûr, le jardin Massey. Et dès qu’il le peut, l’écrivain enfile ses chaussures de randonnée et emprunte les chemins de traverse, arpentant inlassablement les sentiers de la Bigorre. « Un sentier différent tous les jours. Jamais le même. Pour le plaisir de la découverte. Ici, c’est le paradis des marcheurs. » Sa femme, qui faute de place ne peut entreposer les toiles qu’elle peint chaque jour dans la chambre d’hôtel, décide d’enfouir ses œuvres au gré de ses balades. « Nous enterrions les tableaux au pied d’un arbre, dans le lit d’une rivière ou en plein champ et relevions l’emplacement grâce à un GPS en nous disant que nous viendrions les chercher un an plus tard, jour pour jour. » Ces œuvres, curieusement travaillées par l’humidité et les insectes, sont aujourd’hui exposées à travers le monde. Ses bonnes adresses gastronomiques sont nombreuses : il dîne tous les soirs dehors. Parmi ses tables favorites, l’écrivain cite Le Fil à la patte, L’Aragon mais aussi Le Viscos à Saint-Savin. On le rencontre aussi, parfois, au Petit Gourmand. Bon vivant, il a noué rapidement des liens d’amitié avec des habitants des Hautes-Pyrénées, dont le docteur Yves Louit, de Saint-Martin. En 2003, Paulo Coelho a finalement décidé d’acquérir une propriété près de Tarbes. « Nous avons acheté un moulin à Saint-Martin que nous rénovons nous-mêmes. Nous y passons désormais trois mois par an. » Le reste de l’année, l’écrivain est sur les routes. « Mais je sais que Tarbes est devenue mon port d’attache », assure-t-il. « C’est le meilleur ambassadeur de notre ville » dira de lui le maire Gérard Trémège. Et pas étonnant que la municipalité de Tarbes en ait fait son Citoyen d’honneur en 2001 ! Par ailleurs, Paulo Coelho est très attaché au délicieux village de Saint-Savin et il y fait référence dans son livre « Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j’ai pleuré », avec une scène près de la fontaine et aussi au village de Viscos (Bescos dans Le Démon et mademoiselle Prym).Voici quelques-uns de ses ouvrages qui ont rencontré un vif succès : Le Pèlerin de Compostelle (1997), L’Alchimiste (1988), Les Walkyries (1992), Maktub (1994), Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j’ai pleuré (1995), La Cinquième Montagne (1996), Manuel du guerrier de la lumière (1997), Veronika décide de mourir (1998), Conversations avec Paulo Coelho (1999), Le Démon et mademoiselle Prym (2000), Onze Minutes (2003), Le Zahir (2005), La Sorcière de Portobello (2007), La Solitude du Vainqueur (2008), Comme le fleuve qui coule (2008), Brida (2010), Aleph (2011), Le Manuscrit retrouvé (2013), Et le septième jour-Trilogie (2014), Contes de Noël (2014), Adultère (2015), L’Espionne (2016), Hippie (2018), La voie de l'archer (2019). Chaque nouvelle sortie de livre fait l’événement mais sans atteindre le succès qu’il a connu auparavant avec «L’Alchimiste» ou «Le Pèlerin de Compostelle». Depuis 2016 Paulo Coelho travaillait avec Kobe Bryant, légende du basket, sur l’écriture d’un livre pour enfants. Mais suite au décès survenu le dimanche 26 janvier 2020 de l’ancien joueur de NBA, âgé de 41 ans, dans un crash d’hélicoptère en Californie, Paulo Coelho a décidé d’abandonner son écriture considérant que cela ”n’avait pas beaucoup de sens de le publier sans lui” et que cela ne “serait pas pertinent pour lui ou sa famille”.
CRAUSTE Michel (1934-2019)
Joueur international de rugby à XV, solide troisième ligne aile et capitaine du XV de France, une légende du rugby lourdais, national et international
 Michel CRAUSTE, alias « Attila » ou « Le Mongol » né le 6 juillet 1934 à Saint-Laurent-de-Gosse dans les Landes et mort le 2 mai 2019 à Pau, à l'âge de 84 ans. Il vit d'abord à Saint-Sever (1938-1947) ; sa famille rejoint ensuite la maison de sa mère à Saint-Laurent-de-Gosse, un village où il vécut une partie de son enfance, jusqu’à son départ au collège d’Aire-sur-Adour, pour passer un CAP et un BEI dans la spécialité d’ajusteur-mécanicien et le CAP de dessinateur industriel. Michel Crauste a un frère aîné Claude, né en 1933 et un autre plus jeune, Jean-Louis, né en 1938. Il pratique d'abord le football, le basket-ball et l'athlétisme. Il commence le rugby à XV au collège d'Aire-sur-l'Adour dans les Landes, où il est pensionnaire dès l'âge de 13 ans. Il joue talonneur puis trois-quarts centre avant de se fixer comme troisième ligne aile. À 16 ans le jeune adolescent part étudier en Seine-et-Marne à l'École Nationale des Métiers de l'Électricité de France de Gurcy-le-Châtel. Il y retrouve quelques bons copains du collège et fait la connaissance de deux Béarnais, François Moncla originaire de Louvie-Juzon et Arnaud Marquezusaa de Saint-Palais, arrivé six mois après lui au centre de formation d'Électricité de France. Tous deux devinrent ses meilleurs amis. Crauste et Marquezusaa se retrouveront plus tard sous le maillot du FC Lourdais XV. Moncla qui a deux ans de plus que Michel est moniteur pour les travaux sur les réseaux électriques, et il entraîne l'équipe de rugby de l’école. Il joue en senior au Racing club de France, club de 1re division, et il commence à s'y faire un nom. Il y entraîne les juniors. En 1951, François Moncla qui porte les couleurs du Racing Club de France parvient à convaincre Michel de rejoindre les juniors ciel et blanc. À l'école, en cadet, Michel Crauste dispute le championnat régional ; avec ses coéquipiers, il est champion d'académie de Paris. Michel avait coutume de dire : « S'il existe un homme dans le rugby à qui je dois beaucoup, c'est bien François Moncla. François a été mon premier instructeur en rugby. Il m'a pris sous son aile en tant qu’entraîneur de l'équipe de France. C'est lui qui m'a amené au Racing. C'est lui qui a fait le joueur que je suis devenu. C'est un grand frère, dans toute ma carrière sportive et aujourd'hui encore. » En 1954, avec les juniors du Racing, Michel Crauste remportera la finale du championnat de France à Toulouse, face au Stadoceste Tarbais, par 19 à 0 et gagne sa place de titulaire en équipe seniors du Racing. Il joue en troisième ligne dans une équipe où l’on retrouve plusieurs internationaux dont Zézé Dufau, le demi de mêlée, Michel Vannier “Brin d’osier” à l’arrière. En 1955, il est incorporé à la caserne Pérignon, à Toulouse, puis il fait son service militaire au bataillon de Joinville avec Arnaud Marquesuzaa, avec une parenthèse au DAT de Versailles ; il décide alors de se consacrer entièrement au rugby. En 1956, la 3ème ligne du Racing CF composée de François Moncla, Michel Crauste et Brun est l’une des meilleures de France avec celle de Lourdes (Jean Prat, Jean Barthe, Henri Domec). En 1957, François Moncla partit jouer en équipe de France. Michel Crauste l'y rejoignit quelques mois plus tard. À 22 ans, il est sélectionné pour son premier match sous les couleurs de l’équipe de France, où il rencontra le 19 mai 1957 les roumains de Bucarest. L’équipe de France l’emporta sur un score de 18 points à 15. Et quelques jours plus tard, c’est avec les couleurs du Racing qu’il affronta l’équipe de Lourdes (FC Lourdais), sur la pelouse de Gerland, à Lyon. Pour lui, ce fut un grand moment, car il avait tant d’admiration pour cette équipe de Lourdes ! Le Racing fut battu, sur le score de 16 à 13. Avec le club parisien, il prendra sa revanche deux ans plus tard avant d’arriver à Lourdes en 1960. Au cours de sa carrière de joueur, Michel Crauste a remporté un titre de champion de France (1959) avec le Racing, après avoir battu le Stade Montois à Bordeaux et Lourdes en demi-finale à Bayonne, puis deux titres (1960, 1968) avec Lourdes, où il a évolué de 1959 à 1972. Suite à cet échec cuisant lors de la demi-finale du championnat de France face au Racing à Bayonne, Jean Prat, entraîneur de Lourdes, reprit l’équipe d’une main de maître, et en reconstruisit une qui, après un début de saison des plus catastrophiques, remporta le titre de champion de France en 1960 et un 7e bouclier de Brennus. Cet ailier, dit « Le Mongol » de 1m81 et 87 kg, qui avait hérité son surnom de son visage vaguement asiatique et de sa moustache drue, a également à son palmarès deux Challenge Yves du Manoir (1966 et 1967) remportés par le FC Lourdes. Retenu pour la première fois en équipe de France en 1957, Michel Crauste compte 62 sélections en équipe de France entre 1957 et 1966, nouveau record. Il a remporté quatre Tournois des Cinq nations (1959, 1960, 1961, 1962) et porté 22 fois le brassard de capitaine des Bleus, notamment en 1964 quand l’équipe de France, dirigée par Jean Prat, avait battu l'Afrique du Sud (8-6) avec son pack d'avants surnommé le pack des bestiaux. "J'avais à mes côtés de sacrés guerriers comme Benoît Dauga ou Walther Spanghero et des joueurs de grande qualité comme Jean Gachassin. Cela faisait un moment que l'on jouait ensemble, on se connaissait bien. Nous avions fait une grande partie", s'était souvenu dans un entretien Michel Crauste qui, au nom de l'équipe, avait reçu seul la Légion d'Honneur des mains du général de Gaulle, à son retour de la tournée victorieuse en Afrique du Sud. Mais 1962 demeurera sa grande année : il fut nommé capitaine de l’équipe de France et lors d’un match face aux anglais, le 24 février 1962, il inscrivit trois essais ! Un exploit qui n’a jamais encore été égalé. Il joua le tournoi 1965 (France-Galles 1965 restera un grand match mythique), et le tournoi 1966. En 1970, le club de Lourdes proposa à Michel Crauste le poste d’entraîneur, qui lui apporta beaucoup sur le plan personnel. Il entraîna l’équipe senior durant la saison 1970-1971. En 1972, il mit un terme à sa carrière, qui fit suite à une grave blessure lors d’un match. Cependant, Michel Crauste ne s’éloigna jamais trop loin du rugby… Il profita un temps des activités qu’il aimait pratiquer, telles que la pêche et la chasse. Durant dix ans, il entraîna le club de Morlaàs, et ensuite, durant deux ans, le club de Bagnères-de-Bigorre. Puis il fut appelé au comité directeur de la FFR, et sera adjoint au maire de Lons en charge des sports. En 1995, il fut le manager de l’équipe de France, en préparation de la Coupe du monde, et accompagna l’équipe à Denver aux USA pour une tournée de trois semaines. Par la suite, Michel Crauste s’était un peu désinvesti du rugby. En 1997, il revint à Lourdes et, avec quelques amis, essaya de remettre le FC Lourdais à flots. En 1998, il prit les fonctions de président du club, avec pour but de lui faire passer le palier qui l’amènerait en Pro D2 et de redresser la situation financière du club. Il fut élu président du FC Lourdes XV en 1998 jusqu’en 2013. En 2013, il se retira à l'âge de 79 ans. Néanmoins il restera président honoraire du club. Il fut aussi conseiller municipal de Lourdes, de 2001 à 2014, avec le maire Jean-Pierre Artiganave. Durant plusieurs années, il présida le Rassemblement International des Sportifs avec son fidèle bras droit Robert Vignes. Puis à l’orée de ses 80 printemps, il se retira de tout. Michel Crauste s’est éteint le jeudi 2 mai 2019 à Pau des suites d’une longue maladie. Ses obsèques ont eu lieu le mardi 7 mai 2019 en l'église Saint-Julien de Lons (64), en présence de nombreux joueurs de rugby, toutes générations confondues, venus honorer la mémoire de Michel Crauste, ancien capitaine du XV de France, et considéré comme un géant de ce jeu. « Il s’était attiré le respect sur tous les terrains du monde », comme le souligna, François Moncla, son fidèle ami de 65 ans, dans son éloge rempli d’émotion. « Je vais conserver le souvenir extraordinaire de Michel. C'était un frère d'armes du point de vue de la vie scolaire et du point de vue du rugby », a dit François Moncla. « C'était un très grand joueur et notre amitié est indéfectible. C'en est un de plus qui s'en va. Je ne peux pas dire un mot de plus », a-t-il ajouté. Michel Crauste a été ensuite inhumé dans son village natal de Saint-Laurent-de-Gosse. Joueur mythique des années 60, au palmarès impressionnant, élu meilleur joueur français du championnat en 1961, il compte 62 sélections en équipe de France, au cours desquelles il marque 30 points, 10 essais et détenant alors le record du plus grand nombre de capes. Il participe notamment à neuf Tournois des Cinq Nations de 1958 à 1966. Il dispute même 44 matchs consécutifs avec l'équipe de France, un record pour l'époque. Il est capitaine de l'équipe de France à 22 reprises avec un résultat de 15 victoires, de 5 matchs nuls et de 2 défaites. Il a soulevé le bouclier de Brennus à trois reprises sur une carrière s’étalant de 1954 à 1972. De quoi laisser une trace indélébile sur le rugby tricolore et nul doute que son souvenir restera longtemps gravé dans les mémoires. En 2010, il sera élevé au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. À côté du rugby, il a fait carrière à l'Électricité de France, tout comme ses amis François Moncla et Arnaud Marquesuzaa. Une mutation administrative lui donna un poste à Pau en 1959. Et, il y resta jusqu'à sa retraite professionnelle. Il a écrit le livre « Au feu du rugby », paru aux éditions Solar en 1973. Et en mai 2015, le philosophe Christophe Schaeffer écrit avec lui son testament rugbystique sur les valeurs de ce jeu pour les générations futures : « Le Testament du Mongol », paru aux éditions Les 5 éditeurs et préfacé par Denis Lalanne et Thierry Dusautoir. Il fut un homme profondément attaché à sa ville d’adoption, qui aura porté au plus haut les couleurs de Lourdes, et qui fait encore aujourd’hui la plus grande fierté des Lourdaises et des Lourdais. Ne manquant ni de qualités, ni de titres, ardent défenseur des valeurs altruistes de ce jeu, il peut désormais figurer en bonne place et en toute légitimité dans le gotha des grands champions du rugby international.
Michel CRAUSTE, alias « Attila » ou « Le Mongol » né le 6 juillet 1934 à Saint-Laurent-de-Gosse dans les Landes et mort le 2 mai 2019 à Pau, à l'âge de 84 ans. Il vit d'abord à Saint-Sever (1938-1947) ; sa famille rejoint ensuite la maison de sa mère à Saint-Laurent-de-Gosse, un village où il vécut une partie de son enfance, jusqu’à son départ au collège d’Aire-sur-Adour, pour passer un CAP et un BEI dans la spécialité d’ajusteur-mécanicien et le CAP de dessinateur industriel. Michel Crauste a un frère aîné Claude, né en 1933 et un autre plus jeune, Jean-Louis, né en 1938. Il pratique d'abord le football, le basket-ball et l'athlétisme. Il commence le rugby à XV au collège d'Aire-sur-l'Adour dans les Landes, où il est pensionnaire dès l'âge de 13 ans. Il joue talonneur puis trois-quarts centre avant de se fixer comme troisième ligne aile. À 16 ans le jeune adolescent part étudier en Seine-et-Marne à l'École Nationale des Métiers de l'Électricité de France de Gurcy-le-Châtel. Il y retrouve quelques bons copains du collège et fait la connaissance de deux Béarnais, François Moncla originaire de Louvie-Juzon et Arnaud Marquezusaa de Saint-Palais, arrivé six mois après lui au centre de formation d'Électricité de France. Tous deux devinrent ses meilleurs amis. Crauste et Marquezusaa se retrouveront plus tard sous le maillot du FC Lourdais XV. Moncla qui a deux ans de plus que Michel est moniteur pour les travaux sur les réseaux électriques, et il entraîne l'équipe de rugby de l’école. Il joue en senior au Racing club de France, club de 1re division, et il commence à s'y faire un nom. Il y entraîne les juniors. En 1951, François Moncla qui porte les couleurs du Racing Club de France parvient à convaincre Michel de rejoindre les juniors ciel et blanc. À l'école, en cadet, Michel Crauste dispute le championnat régional ; avec ses coéquipiers, il est champion d'académie de Paris. Michel avait coutume de dire : « S'il existe un homme dans le rugby à qui je dois beaucoup, c'est bien François Moncla. François a été mon premier instructeur en rugby. Il m'a pris sous son aile en tant qu’entraîneur de l'équipe de France. C'est lui qui m'a amené au Racing. C'est lui qui a fait le joueur que je suis devenu. C'est un grand frère, dans toute ma carrière sportive et aujourd'hui encore. » En 1954, avec les juniors du Racing, Michel Crauste remportera la finale du championnat de France à Toulouse, face au Stadoceste Tarbais, par 19 à 0 et gagne sa place de titulaire en équipe seniors du Racing. Il joue en troisième ligne dans une équipe où l’on retrouve plusieurs internationaux dont Zézé Dufau, le demi de mêlée, Michel Vannier “Brin d’osier” à l’arrière. En 1955, il est incorporé à la caserne Pérignon, à Toulouse, puis il fait son service militaire au bataillon de Joinville avec Arnaud Marquesuzaa, avec une parenthèse au DAT de Versailles ; il décide alors de se consacrer entièrement au rugby. En 1956, la 3ème ligne du Racing CF composée de François Moncla, Michel Crauste et Brun est l’une des meilleures de France avec celle de Lourdes (Jean Prat, Jean Barthe, Henri Domec). En 1957, François Moncla partit jouer en équipe de France. Michel Crauste l'y rejoignit quelques mois plus tard. À 22 ans, il est sélectionné pour son premier match sous les couleurs de l’équipe de France, où il rencontra le 19 mai 1957 les roumains de Bucarest. L’équipe de France l’emporta sur un score de 18 points à 15. Et quelques jours plus tard, c’est avec les couleurs du Racing qu’il affronta l’équipe de Lourdes (FC Lourdais), sur la pelouse de Gerland, à Lyon. Pour lui, ce fut un grand moment, car il avait tant d’admiration pour cette équipe de Lourdes ! Le Racing fut battu, sur le score de 16 à 13. Avec le club parisien, il prendra sa revanche deux ans plus tard avant d’arriver à Lourdes en 1960. Au cours de sa carrière de joueur, Michel Crauste a remporté un titre de champion de France (1959) avec le Racing, après avoir battu le Stade Montois à Bordeaux et Lourdes en demi-finale à Bayonne, puis deux titres (1960, 1968) avec Lourdes, où il a évolué de 1959 à 1972. Suite à cet échec cuisant lors de la demi-finale du championnat de France face au Racing à Bayonne, Jean Prat, entraîneur de Lourdes, reprit l’équipe d’une main de maître, et en reconstruisit une qui, après un début de saison des plus catastrophiques, remporta le titre de champion de France en 1960 et un 7e bouclier de Brennus. Cet ailier, dit « Le Mongol » de 1m81 et 87 kg, qui avait hérité son surnom de son visage vaguement asiatique et de sa moustache drue, a également à son palmarès deux Challenge Yves du Manoir (1966 et 1967) remportés par le FC Lourdes. Retenu pour la première fois en équipe de France en 1957, Michel Crauste compte 62 sélections en équipe de France entre 1957 et 1966, nouveau record. Il a remporté quatre Tournois des Cinq nations (1959, 1960, 1961, 1962) et porté 22 fois le brassard de capitaine des Bleus, notamment en 1964 quand l’équipe de France, dirigée par Jean Prat, avait battu l'Afrique du Sud (8-6) avec son pack d'avants surnommé le pack des bestiaux. "J'avais à mes côtés de sacrés guerriers comme Benoît Dauga ou Walther Spanghero et des joueurs de grande qualité comme Jean Gachassin. Cela faisait un moment que l'on jouait ensemble, on se connaissait bien. Nous avions fait une grande partie", s'était souvenu dans un entretien Michel Crauste qui, au nom de l'équipe, avait reçu seul la Légion d'Honneur des mains du général de Gaulle, à son retour de la tournée victorieuse en Afrique du Sud. Mais 1962 demeurera sa grande année : il fut nommé capitaine de l’équipe de France et lors d’un match face aux anglais, le 24 février 1962, il inscrivit trois essais ! Un exploit qui n’a jamais encore été égalé. Il joua le tournoi 1965 (France-Galles 1965 restera un grand match mythique), et le tournoi 1966. En 1970, le club de Lourdes proposa à Michel Crauste le poste d’entraîneur, qui lui apporta beaucoup sur le plan personnel. Il entraîna l’équipe senior durant la saison 1970-1971. En 1972, il mit un terme à sa carrière, qui fit suite à une grave blessure lors d’un match. Cependant, Michel Crauste ne s’éloigna jamais trop loin du rugby… Il profita un temps des activités qu’il aimait pratiquer, telles que la pêche et la chasse. Durant dix ans, il entraîna le club de Morlaàs, et ensuite, durant deux ans, le club de Bagnères-de-Bigorre. Puis il fut appelé au comité directeur de la FFR, et sera adjoint au maire de Lons en charge des sports. En 1995, il fut le manager de l’équipe de France, en préparation de la Coupe du monde, et accompagna l’équipe à Denver aux USA pour une tournée de trois semaines. Par la suite, Michel Crauste s’était un peu désinvesti du rugby. En 1997, il revint à Lourdes et, avec quelques amis, essaya de remettre le FC Lourdais à flots. En 1998, il prit les fonctions de président du club, avec pour but de lui faire passer le palier qui l’amènerait en Pro D2 et de redresser la situation financière du club. Il fut élu président du FC Lourdes XV en 1998 jusqu’en 2013. En 2013, il se retira à l'âge de 79 ans. Néanmoins il restera président honoraire du club. Il fut aussi conseiller municipal de Lourdes, de 2001 à 2014, avec le maire Jean-Pierre Artiganave. Durant plusieurs années, il présida le Rassemblement International des Sportifs avec son fidèle bras droit Robert Vignes. Puis à l’orée de ses 80 printemps, il se retira de tout. Michel Crauste s’est éteint le jeudi 2 mai 2019 à Pau des suites d’une longue maladie. Ses obsèques ont eu lieu le mardi 7 mai 2019 en l'église Saint-Julien de Lons (64), en présence de nombreux joueurs de rugby, toutes générations confondues, venus honorer la mémoire de Michel Crauste, ancien capitaine du XV de France, et considéré comme un géant de ce jeu. « Il s’était attiré le respect sur tous les terrains du monde », comme le souligna, François Moncla, son fidèle ami de 65 ans, dans son éloge rempli d’émotion. « Je vais conserver le souvenir extraordinaire de Michel. C'était un frère d'armes du point de vue de la vie scolaire et du point de vue du rugby », a dit François Moncla. « C'était un très grand joueur et notre amitié est indéfectible. C'en est un de plus qui s'en va. Je ne peux pas dire un mot de plus », a-t-il ajouté. Michel Crauste a été ensuite inhumé dans son village natal de Saint-Laurent-de-Gosse. Joueur mythique des années 60, au palmarès impressionnant, élu meilleur joueur français du championnat en 1961, il compte 62 sélections en équipe de France, au cours desquelles il marque 30 points, 10 essais et détenant alors le record du plus grand nombre de capes. Il participe notamment à neuf Tournois des Cinq Nations de 1958 à 1966. Il dispute même 44 matchs consécutifs avec l'équipe de France, un record pour l'époque. Il est capitaine de l'équipe de France à 22 reprises avec un résultat de 15 victoires, de 5 matchs nuls et de 2 défaites. Il a soulevé le bouclier de Brennus à trois reprises sur une carrière s’étalant de 1954 à 1972. De quoi laisser une trace indélébile sur le rugby tricolore et nul doute que son souvenir restera longtemps gravé dans les mémoires. En 2010, il sera élevé au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. À côté du rugby, il a fait carrière à l'Électricité de France, tout comme ses amis François Moncla et Arnaud Marquesuzaa. Une mutation administrative lui donna un poste à Pau en 1959. Et, il y resta jusqu'à sa retraite professionnelle. Il a écrit le livre « Au feu du rugby », paru aux éditions Solar en 1973. Et en mai 2015, le philosophe Christophe Schaeffer écrit avec lui son testament rugbystique sur les valeurs de ce jeu pour les générations futures : « Le Testament du Mongol », paru aux éditions Les 5 éditeurs et préfacé par Denis Lalanne et Thierry Dusautoir. Il fut un homme profondément attaché à sa ville d’adoption, qui aura porté au plus haut les couleurs de Lourdes, et qui fait encore aujourd’hui la plus grande fierté des Lourdaises et des Lourdais. Ne manquant ni de qualités, ni de titres, ardent défenseur des valeurs altruistes de ce jeu, il peut désormais figurer en bonne place et en toute légitimité dans le gotha des grands champions du rugby international.
 Michel CRAUSTE, alias « Attila » ou « Le Mongol » né le 6 juillet 1934 à Saint-Laurent-de-Gosse dans les Landes et mort le 2 mai 2019 à Pau, à l'âge de 84 ans. Il vit d'abord à Saint-Sever (1938-1947) ; sa famille rejoint ensuite la maison de sa mère à Saint-Laurent-de-Gosse, un village où il vécut une partie de son enfance, jusqu’à son départ au collège d’Aire-sur-Adour, pour passer un CAP et un BEI dans la spécialité d’ajusteur-mécanicien et le CAP de dessinateur industriel. Michel Crauste a un frère aîné Claude, né en 1933 et un autre plus jeune, Jean-Louis, né en 1938. Il pratique d'abord le football, le basket-ball et l'athlétisme. Il commence le rugby à XV au collège d'Aire-sur-l'Adour dans les Landes, où il est pensionnaire dès l'âge de 13 ans. Il joue talonneur puis trois-quarts centre avant de se fixer comme troisième ligne aile. À 16 ans le jeune adolescent part étudier en Seine-et-Marne à l'École Nationale des Métiers de l'Électricité de France de Gurcy-le-Châtel. Il y retrouve quelques bons copains du collège et fait la connaissance de deux Béarnais, François Moncla originaire de Louvie-Juzon et Arnaud Marquezusaa de Saint-Palais, arrivé six mois après lui au centre de formation d'Électricité de France. Tous deux devinrent ses meilleurs amis. Crauste et Marquezusaa se retrouveront plus tard sous le maillot du FC Lourdais XV. Moncla qui a deux ans de plus que Michel est moniteur pour les travaux sur les réseaux électriques, et il entraîne l'équipe de rugby de l’école. Il joue en senior au Racing club de France, club de 1re division, et il commence à s'y faire un nom. Il y entraîne les juniors. En 1951, François Moncla qui porte les couleurs du Racing Club de France parvient à convaincre Michel de rejoindre les juniors ciel et blanc. À l'école, en cadet, Michel Crauste dispute le championnat régional ; avec ses coéquipiers, il est champion d'académie de Paris. Michel avait coutume de dire : « S'il existe un homme dans le rugby à qui je dois beaucoup, c'est bien François Moncla. François a été mon premier instructeur en rugby. Il m'a pris sous son aile en tant qu’entraîneur de l'équipe de France. C'est lui qui m'a amené au Racing. C'est lui qui a fait le joueur que je suis devenu. C'est un grand frère, dans toute ma carrière sportive et aujourd'hui encore. » En 1954, avec les juniors du Racing, Michel Crauste remportera la finale du championnat de France à Toulouse, face au Stadoceste Tarbais, par 19 à 0 et gagne sa place de titulaire en équipe seniors du Racing. Il joue en troisième ligne dans une équipe où l’on retrouve plusieurs internationaux dont Zézé Dufau, le demi de mêlée, Michel Vannier “Brin d’osier” à l’arrière. En 1955, il est incorporé à la caserne Pérignon, à Toulouse, puis il fait son service militaire au bataillon de Joinville avec Arnaud Marquesuzaa, avec une parenthèse au DAT de Versailles ; il décide alors de se consacrer entièrement au rugby. En 1956, la 3ème ligne du Racing CF composée de François Moncla, Michel Crauste et Brun est l’une des meilleures de France avec celle de Lourdes (Jean Prat, Jean Barthe, Henri Domec). En 1957, François Moncla partit jouer en équipe de France. Michel Crauste l'y rejoignit quelques mois plus tard. À 22 ans, il est sélectionné pour son premier match sous les couleurs de l’équipe de France, où il rencontra le 19 mai 1957 les roumains de Bucarest. L’équipe de France l’emporta sur un score de 18 points à 15. Et quelques jours plus tard, c’est avec les couleurs du Racing qu’il affronta l’équipe de Lourdes (FC Lourdais), sur la pelouse de Gerland, à Lyon. Pour lui, ce fut un grand moment, car il avait tant d’admiration pour cette équipe de Lourdes ! Le Racing fut battu, sur le score de 16 à 13. Avec le club parisien, il prendra sa revanche deux ans plus tard avant d’arriver à Lourdes en 1960. Au cours de sa carrière de joueur, Michel Crauste a remporté un titre de champion de France (1959) avec le Racing, après avoir battu le Stade Montois à Bordeaux et Lourdes en demi-finale à Bayonne, puis deux titres (1960, 1968) avec Lourdes, où il a évolué de 1959 à 1972. Suite à cet échec cuisant lors de la demi-finale du championnat de France face au Racing à Bayonne, Jean Prat, entraîneur de Lourdes, reprit l’équipe d’une main de maître, et en reconstruisit une qui, après un début de saison des plus catastrophiques, remporta le titre de champion de France en 1960 et un 7e bouclier de Brennus. Cet ailier, dit « Le Mongol » de 1m81 et 87 kg, qui avait hérité son surnom de son visage vaguement asiatique et de sa moustache drue, a également à son palmarès deux Challenge Yves du Manoir (1966 et 1967) remportés par le FC Lourdes. Retenu pour la première fois en équipe de France en 1957, Michel Crauste compte 62 sélections en équipe de France entre 1957 et 1966, nouveau record. Il a remporté quatre Tournois des Cinq nations (1959, 1960, 1961, 1962) et porté 22 fois le brassard de capitaine des Bleus, notamment en 1964 quand l’équipe de France, dirigée par Jean Prat, avait battu l'Afrique du Sud (8-6) avec son pack d'avants surnommé le pack des bestiaux. "J'avais à mes côtés de sacrés guerriers comme Benoît Dauga ou Walther Spanghero et des joueurs de grande qualité comme Jean Gachassin. Cela faisait un moment que l'on jouait ensemble, on se connaissait bien. Nous avions fait une grande partie", s'était souvenu dans un entretien Michel Crauste qui, au nom de l'équipe, avait reçu seul la Légion d'Honneur des mains du général de Gaulle, à son retour de la tournée victorieuse en Afrique du Sud. Mais 1962 demeurera sa grande année : il fut nommé capitaine de l’équipe de France et lors d’un match face aux anglais, le 24 février 1962, il inscrivit trois essais ! Un exploit qui n’a jamais encore été égalé. Il joua le tournoi 1965 (France-Galles 1965 restera un grand match mythique), et le tournoi 1966. En 1970, le club de Lourdes proposa à Michel Crauste le poste d’entraîneur, qui lui apporta beaucoup sur le plan personnel. Il entraîna l’équipe senior durant la saison 1970-1971. En 1972, il mit un terme à sa carrière, qui fit suite à une grave blessure lors d’un match. Cependant, Michel Crauste ne s’éloigna jamais trop loin du rugby… Il profita un temps des activités qu’il aimait pratiquer, telles que la pêche et la chasse. Durant dix ans, il entraîna le club de Morlaàs, et ensuite, durant deux ans, le club de Bagnères-de-Bigorre. Puis il fut appelé au comité directeur de la FFR, et sera adjoint au maire de Lons en charge des sports. En 1995, il fut le manager de l’équipe de France, en préparation de la Coupe du monde, et accompagna l’équipe à Denver aux USA pour une tournée de trois semaines. Par la suite, Michel Crauste s’était un peu désinvesti du rugby. En 1997, il revint à Lourdes et, avec quelques amis, essaya de remettre le FC Lourdais à flots. En 1998, il prit les fonctions de président du club, avec pour but de lui faire passer le palier qui l’amènerait en Pro D2 et de redresser la situation financière du club. Il fut élu président du FC Lourdes XV en 1998 jusqu’en 2013. En 2013, il se retira à l'âge de 79 ans. Néanmoins il restera président honoraire du club. Il fut aussi conseiller municipal de Lourdes, de 2001 à 2014, avec le maire Jean-Pierre Artiganave. Durant plusieurs années, il présida le Rassemblement International des Sportifs avec son fidèle bras droit Robert Vignes. Puis à l’orée de ses 80 printemps, il se retira de tout. Michel Crauste s’est éteint le jeudi 2 mai 2019 à Pau des suites d’une longue maladie. Ses obsèques ont eu lieu le mardi 7 mai 2019 en l'église Saint-Julien de Lons (64), en présence de nombreux joueurs de rugby, toutes générations confondues, venus honorer la mémoire de Michel Crauste, ancien capitaine du XV de France, et considéré comme un géant de ce jeu. « Il s’était attiré le respect sur tous les terrains du monde », comme le souligna, François Moncla, son fidèle ami de 65 ans, dans son éloge rempli d’émotion. « Je vais conserver le souvenir extraordinaire de Michel. C'était un frère d'armes du point de vue de la vie scolaire et du point de vue du rugby », a dit François Moncla. « C'était un très grand joueur et notre amitié est indéfectible. C'en est un de plus qui s'en va. Je ne peux pas dire un mot de plus », a-t-il ajouté. Michel Crauste a été ensuite inhumé dans son village natal de Saint-Laurent-de-Gosse. Joueur mythique des années 60, au palmarès impressionnant, élu meilleur joueur français du championnat en 1961, il compte 62 sélections en équipe de France, au cours desquelles il marque 30 points, 10 essais et détenant alors le record du plus grand nombre de capes. Il participe notamment à neuf Tournois des Cinq Nations de 1958 à 1966. Il dispute même 44 matchs consécutifs avec l'équipe de France, un record pour l'époque. Il est capitaine de l'équipe de France à 22 reprises avec un résultat de 15 victoires, de 5 matchs nuls et de 2 défaites. Il a soulevé le bouclier de Brennus à trois reprises sur une carrière s’étalant de 1954 à 1972. De quoi laisser une trace indélébile sur le rugby tricolore et nul doute que son souvenir restera longtemps gravé dans les mémoires. En 2010, il sera élevé au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. À côté du rugby, il a fait carrière à l'Électricité de France, tout comme ses amis François Moncla et Arnaud Marquesuzaa. Une mutation administrative lui donna un poste à Pau en 1959. Et, il y resta jusqu'à sa retraite professionnelle. Il a écrit le livre « Au feu du rugby », paru aux éditions Solar en 1973. Et en mai 2015, le philosophe Christophe Schaeffer écrit avec lui son testament rugbystique sur les valeurs de ce jeu pour les générations futures : « Le Testament du Mongol », paru aux éditions Les 5 éditeurs et préfacé par Denis Lalanne et Thierry Dusautoir. Il fut un homme profondément attaché à sa ville d’adoption, qui aura porté au plus haut les couleurs de Lourdes, et qui fait encore aujourd’hui la plus grande fierté des Lourdaises et des Lourdais. Ne manquant ni de qualités, ni de titres, ardent défenseur des valeurs altruistes de ce jeu, il peut désormais figurer en bonne place et en toute légitimité dans le gotha des grands champions du rugby international.
Michel CRAUSTE, alias « Attila » ou « Le Mongol » né le 6 juillet 1934 à Saint-Laurent-de-Gosse dans les Landes et mort le 2 mai 2019 à Pau, à l'âge de 84 ans. Il vit d'abord à Saint-Sever (1938-1947) ; sa famille rejoint ensuite la maison de sa mère à Saint-Laurent-de-Gosse, un village où il vécut une partie de son enfance, jusqu’à son départ au collège d’Aire-sur-Adour, pour passer un CAP et un BEI dans la spécialité d’ajusteur-mécanicien et le CAP de dessinateur industriel. Michel Crauste a un frère aîné Claude, né en 1933 et un autre plus jeune, Jean-Louis, né en 1938. Il pratique d'abord le football, le basket-ball et l'athlétisme. Il commence le rugby à XV au collège d'Aire-sur-l'Adour dans les Landes, où il est pensionnaire dès l'âge de 13 ans. Il joue talonneur puis trois-quarts centre avant de se fixer comme troisième ligne aile. À 16 ans le jeune adolescent part étudier en Seine-et-Marne à l'École Nationale des Métiers de l'Électricité de France de Gurcy-le-Châtel. Il y retrouve quelques bons copains du collège et fait la connaissance de deux Béarnais, François Moncla originaire de Louvie-Juzon et Arnaud Marquezusaa de Saint-Palais, arrivé six mois après lui au centre de formation d'Électricité de France. Tous deux devinrent ses meilleurs amis. Crauste et Marquezusaa se retrouveront plus tard sous le maillot du FC Lourdais XV. Moncla qui a deux ans de plus que Michel est moniteur pour les travaux sur les réseaux électriques, et il entraîne l'équipe de rugby de l’école. Il joue en senior au Racing club de France, club de 1re division, et il commence à s'y faire un nom. Il y entraîne les juniors. En 1951, François Moncla qui porte les couleurs du Racing Club de France parvient à convaincre Michel de rejoindre les juniors ciel et blanc. À l'école, en cadet, Michel Crauste dispute le championnat régional ; avec ses coéquipiers, il est champion d'académie de Paris. Michel avait coutume de dire : « S'il existe un homme dans le rugby à qui je dois beaucoup, c'est bien François Moncla. François a été mon premier instructeur en rugby. Il m'a pris sous son aile en tant qu’entraîneur de l'équipe de France. C'est lui qui m'a amené au Racing. C'est lui qui a fait le joueur que je suis devenu. C'est un grand frère, dans toute ma carrière sportive et aujourd'hui encore. » En 1954, avec les juniors du Racing, Michel Crauste remportera la finale du championnat de France à Toulouse, face au Stadoceste Tarbais, par 19 à 0 et gagne sa place de titulaire en équipe seniors du Racing. Il joue en troisième ligne dans une équipe où l’on retrouve plusieurs internationaux dont Zézé Dufau, le demi de mêlée, Michel Vannier “Brin d’osier” à l’arrière. En 1955, il est incorporé à la caserne Pérignon, à Toulouse, puis il fait son service militaire au bataillon de Joinville avec Arnaud Marquesuzaa, avec une parenthèse au DAT de Versailles ; il décide alors de se consacrer entièrement au rugby. En 1956, la 3ème ligne du Racing CF composée de François Moncla, Michel Crauste et Brun est l’une des meilleures de France avec celle de Lourdes (Jean Prat, Jean Barthe, Henri Domec). En 1957, François Moncla partit jouer en équipe de France. Michel Crauste l'y rejoignit quelques mois plus tard. À 22 ans, il est sélectionné pour son premier match sous les couleurs de l’équipe de France, où il rencontra le 19 mai 1957 les roumains de Bucarest. L’équipe de France l’emporta sur un score de 18 points à 15. Et quelques jours plus tard, c’est avec les couleurs du Racing qu’il affronta l’équipe de Lourdes (FC Lourdais), sur la pelouse de Gerland, à Lyon. Pour lui, ce fut un grand moment, car il avait tant d’admiration pour cette équipe de Lourdes ! Le Racing fut battu, sur le score de 16 à 13. Avec le club parisien, il prendra sa revanche deux ans plus tard avant d’arriver à Lourdes en 1960. Au cours de sa carrière de joueur, Michel Crauste a remporté un titre de champion de France (1959) avec le Racing, après avoir battu le Stade Montois à Bordeaux et Lourdes en demi-finale à Bayonne, puis deux titres (1960, 1968) avec Lourdes, où il a évolué de 1959 à 1972. Suite à cet échec cuisant lors de la demi-finale du championnat de France face au Racing à Bayonne, Jean Prat, entraîneur de Lourdes, reprit l’équipe d’une main de maître, et en reconstruisit une qui, après un début de saison des plus catastrophiques, remporta le titre de champion de France en 1960 et un 7e bouclier de Brennus. Cet ailier, dit « Le Mongol » de 1m81 et 87 kg, qui avait hérité son surnom de son visage vaguement asiatique et de sa moustache drue, a également à son palmarès deux Challenge Yves du Manoir (1966 et 1967) remportés par le FC Lourdes. Retenu pour la première fois en équipe de France en 1957, Michel Crauste compte 62 sélections en équipe de France entre 1957 et 1966, nouveau record. Il a remporté quatre Tournois des Cinq nations (1959, 1960, 1961, 1962) et porté 22 fois le brassard de capitaine des Bleus, notamment en 1964 quand l’équipe de France, dirigée par Jean Prat, avait battu l'Afrique du Sud (8-6) avec son pack d'avants surnommé le pack des bestiaux. "J'avais à mes côtés de sacrés guerriers comme Benoît Dauga ou Walther Spanghero et des joueurs de grande qualité comme Jean Gachassin. Cela faisait un moment que l'on jouait ensemble, on se connaissait bien. Nous avions fait une grande partie", s'était souvenu dans un entretien Michel Crauste qui, au nom de l'équipe, avait reçu seul la Légion d'Honneur des mains du général de Gaulle, à son retour de la tournée victorieuse en Afrique du Sud. Mais 1962 demeurera sa grande année : il fut nommé capitaine de l’équipe de France et lors d’un match face aux anglais, le 24 février 1962, il inscrivit trois essais ! Un exploit qui n’a jamais encore été égalé. Il joua le tournoi 1965 (France-Galles 1965 restera un grand match mythique), et le tournoi 1966. En 1970, le club de Lourdes proposa à Michel Crauste le poste d’entraîneur, qui lui apporta beaucoup sur le plan personnel. Il entraîna l’équipe senior durant la saison 1970-1971. En 1972, il mit un terme à sa carrière, qui fit suite à une grave blessure lors d’un match. Cependant, Michel Crauste ne s’éloigna jamais trop loin du rugby… Il profita un temps des activités qu’il aimait pratiquer, telles que la pêche et la chasse. Durant dix ans, il entraîna le club de Morlaàs, et ensuite, durant deux ans, le club de Bagnères-de-Bigorre. Puis il fut appelé au comité directeur de la FFR, et sera adjoint au maire de Lons en charge des sports. En 1995, il fut le manager de l’équipe de France, en préparation de la Coupe du monde, et accompagna l’équipe à Denver aux USA pour une tournée de trois semaines. Par la suite, Michel Crauste s’était un peu désinvesti du rugby. En 1997, il revint à Lourdes et, avec quelques amis, essaya de remettre le FC Lourdais à flots. En 1998, il prit les fonctions de président du club, avec pour but de lui faire passer le palier qui l’amènerait en Pro D2 et de redresser la situation financière du club. Il fut élu président du FC Lourdes XV en 1998 jusqu’en 2013. En 2013, il se retira à l'âge de 79 ans. Néanmoins il restera président honoraire du club. Il fut aussi conseiller municipal de Lourdes, de 2001 à 2014, avec le maire Jean-Pierre Artiganave. Durant plusieurs années, il présida le Rassemblement International des Sportifs avec son fidèle bras droit Robert Vignes. Puis à l’orée de ses 80 printemps, il se retira de tout. Michel Crauste s’est éteint le jeudi 2 mai 2019 à Pau des suites d’une longue maladie. Ses obsèques ont eu lieu le mardi 7 mai 2019 en l'église Saint-Julien de Lons (64), en présence de nombreux joueurs de rugby, toutes générations confondues, venus honorer la mémoire de Michel Crauste, ancien capitaine du XV de France, et considéré comme un géant de ce jeu. « Il s’était attiré le respect sur tous les terrains du monde », comme le souligna, François Moncla, son fidèle ami de 65 ans, dans son éloge rempli d’émotion. « Je vais conserver le souvenir extraordinaire de Michel. C'était un frère d'armes du point de vue de la vie scolaire et du point de vue du rugby », a dit François Moncla. « C'était un très grand joueur et notre amitié est indéfectible. C'en est un de plus qui s'en va. Je ne peux pas dire un mot de plus », a-t-il ajouté. Michel Crauste a été ensuite inhumé dans son village natal de Saint-Laurent-de-Gosse. Joueur mythique des années 60, au palmarès impressionnant, élu meilleur joueur français du championnat en 1961, il compte 62 sélections en équipe de France, au cours desquelles il marque 30 points, 10 essais et détenant alors le record du plus grand nombre de capes. Il participe notamment à neuf Tournois des Cinq Nations de 1958 à 1966. Il dispute même 44 matchs consécutifs avec l'équipe de France, un record pour l'époque. Il est capitaine de l'équipe de France à 22 reprises avec un résultat de 15 victoires, de 5 matchs nuls et de 2 défaites. Il a soulevé le bouclier de Brennus à trois reprises sur une carrière s’étalant de 1954 à 1972. De quoi laisser une trace indélébile sur le rugby tricolore et nul doute que son souvenir restera longtemps gravé dans les mémoires. En 2010, il sera élevé au grade d'officier dans l'ordre national de la Légion d'honneur. À côté du rugby, il a fait carrière à l'Électricité de France, tout comme ses amis François Moncla et Arnaud Marquesuzaa. Une mutation administrative lui donna un poste à Pau en 1959. Et, il y resta jusqu'à sa retraite professionnelle. Il a écrit le livre « Au feu du rugby », paru aux éditions Solar en 1973. Et en mai 2015, le philosophe Christophe Schaeffer écrit avec lui son testament rugbystique sur les valeurs de ce jeu pour les générations futures : « Le Testament du Mongol », paru aux éditions Les 5 éditeurs et préfacé par Denis Lalanne et Thierry Dusautoir. Il fut un homme profondément attaché à sa ville d’adoption, qui aura porté au plus haut les couleurs de Lourdes, et qui fait encore aujourd’hui la plus grande fierté des Lourdaises et des Lourdais. Ne manquant ni de qualités, ni de titres, ardent défenseur des valeurs altruistes de ce jeu, il peut désormais figurer en bonne place et en toute légitimité dans le gotha des grands champions du rugby international.CREPEL Mathieu (1984-XXXX)
Snowboarder professionnel double champion du monde de snowboard
 Mathieu CREPEL, né le 26 octobre 1984 à Tarbes, est un snowboarder professionnel, multiple champion du monde, au talent indéniable. Précoce, à l’âge de 6 ans, il se découvre une passion pour les sports de glisse et notamment le snowboard. Son père, moniteur de ski, l’emmenait directement en hors-piste sur les pentes de La Mongie. Montrant des dispositions hors du commun, on lui avait donné le surnom de « petit singe » en raison de son étonnante agilité sur sa planche. En 1999, il quitte ses Pyrénées pour intégrer le lycée sport études de Villard-de-Lans. En 2002, il descend pour la première fois le Pic du Midi en snowboard, un domaine de haute montagne non balisé, qui n’était pas encore ouvert au public. Il fut le plus jeune rider professionnel français. À l’âge de 10 ans, ses aînés pro-riders l’emmenait en trip snowboard au Groenland. À 15 ans, il prend part aux Championnats du monde « jeunes » et termine second. En 2001, aux Championnats du monde junior en pipe, il termine encore à la deuxième place, et de là, il va enchaîner les belles performances en contest. Vainqueur de la Quik Cup (compétition mêlant snow et surf) en 2001 et 2002, puis 2ème au Quiksilver Slopestyle Pro en 2003. En 2003, il gagne son premier titre et devient champion de France de Big Air et de Half Pipe, le tout à seulement 18 ans. Sa carrière est lancée. En 2005, il devient le premier champion du monde de pipe français en remportant le gros Globe de Cristal FIS (Fédération internationale de Ski). Il est sélectionné pour les JO de Turin en 2006, et atteint la finale mais revient non médaillé. Cette même saison, il est double champion du monde de pipe, à la fois en FIS et sur le circuit TTR (Ticket To Ride). Exploit encore inégalé à ce jour chez les hommes. En 2007, il est double champion du monde (médaillé d’or) en Half Pipe et Big Air à Arosa, en Suisse. En février 2008, il organise son premier grand événement, le Mathieu Crépel Invitational, épreuve inscrite au calendrier TTR, chez lui dans les Pyrénées. Il réalise là quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur, et l’événement est un vrai succès. En 2009, il est 3e (médaillé de bronze) en Half Pipe au Championnat du monde à Gangwon. Enfin en 2010, il obtient une prestigieuse médaille d’argent aux X-Games européens, organisés à Tignes. Cette même année, il est 10e en Half Pipe aux Jeux olympiques d'hiver de Vancouver. En 2011, il est 7e en Half Pipe et 5e en Big Air au Championnat du monde de La Molina, en Espagne. En 2016, il remporte haut la main le légendaire Banked Slalom à Mont Baker, au nord-ouest des États-Unis. À 31 ans, il gagne l’épreuve avec un temps record devant des gros noms du snowboard comme Jake Blauvelt, Terje Hakonsen ou encore Bryan Fox. Passé consultant en snowboard sur les plateaux de télé, on l’a vu notamment commenter les Jeux olympiques d’hiver de Sotchi 2014 sur France Télévision. Il est le parrain de la « Surfrider Association », luttant pour la protection des océans, mais aussi du « Flocon à la Vague », association qui retrace le parcours de l’eau depuis les montagnes jusqu’aux océans. Aujourd’hui, il porte les films documentaires Odisea avec son ami surfeur Damien Castera. Après l’Alaska, ils ont tourné au Chili le deuxième volet d’Odisea, qui consiste à suivre le cycle de l’eau, de la montagne à l’océan. Depuis 2007, il est l’un des ambassadeurs des produits "eco-friendly" de Quiksilver, et a créé sa propre ligne de produits techniques en polyester 100% recyclé. Accro au surf, ces dernières années, notre snowboarder de La Mongie s’attaque en 2018 à la montagne d’eau haiwaïenne Jaws, la vague la plus puissante du monde, filmée et racontée par son ami d’enfance Morgan Le Faucheur. Un défi fou et incroyable de surfer, la mythique vague de Jaws à Hawaii. Il en fait le film à succès « Shaka », disponible sur les plateformes de VOD iTunes, Amazon et Vimeo. Récemment il a présenté sa nouvelle vidéo « Chione » dans laquelle il dévoile ses sessions incroyables dans la poudreuse et les vagues du Canada, de la Norvège et du Japon. Des images captivantes qui le mettent en scène en surf et snowboard. «One Board, Two Worlds» est un nouveau projet pensé par le célèbre snowboarder. Ce dernier nous emmène entre les vagues du Pays Basque et les montagnes des Pyrénées, pour une rencontre inédite de ces deux éléments, si chers à Mathieu. Un projet né d'un rêve fou : celui de rider la montagne et l'océan avec la même planche. Une aventure filmée par le vidéaste-photographe Guillaume Arrieta, et qui sera disponible courant 2020.
Mathieu CREPEL, né le 26 octobre 1984 à Tarbes, est un snowboarder professionnel, multiple champion du monde, au talent indéniable. Précoce, à l’âge de 6 ans, il se découvre une passion pour les sports de glisse et notamment le snowboard. Son père, moniteur de ski, l’emmenait directement en hors-piste sur les pentes de La Mongie. Montrant des dispositions hors du commun, on lui avait donné le surnom de « petit singe » en raison de son étonnante agilité sur sa planche. En 1999, il quitte ses Pyrénées pour intégrer le lycée sport études de Villard-de-Lans. En 2002, il descend pour la première fois le Pic du Midi en snowboard, un domaine de haute montagne non balisé, qui n’était pas encore ouvert au public. Il fut le plus jeune rider professionnel français. À l’âge de 10 ans, ses aînés pro-riders l’emmenait en trip snowboard au Groenland. À 15 ans, il prend part aux Championnats du monde « jeunes » et termine second. En 2001, aux Championnats du monde junior en pipe, il termine encore à la deuxième place, et de là, il va enchaîner les belles performances en contest. Vainqueur de la Quik Cup (compétition mêlant snow et surf) en 2001 et 2002, puis 2ème au Quiksilver Slopestyle Pro en 2003. En 2003, il gagne son premier titre et devient champion de France de Big Air et de Half Pipe, le tout à seulement 18 ans. Sa carrière est lancée. En 2005, il devient le premier champion du monde de pipe français en remportant le gros Globe de Cristal FIS (Fédération internationale de Ski). Il est sélectionné pour les JO de Turin en 2006, et atteint la finale mais revient non médaillé. Cette même saison, il est double champion du monde de pipe, à la fois en FIS et sur le circuit TTR (Ticket To Ride). Exploit encore inégalé à ce jour chez les hommes. En 2007, il est double champion du monde (médaillé d’or) en Half Pipe et Big Air à Arosa, en Suisse. En février 2008, il organise son premier grand événement, le Mathieu Crépel Invitational, épreuve inscrite au calendrier TTR, chez lui dans les Pyrénées. Il réalise là quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur, et l’événement est un vrai succès. En 2009, il est 3e (médaillé de bronze) en Half Pipe au Championnat du monde à Gangwon. Enfin en 2010, il obtient une prestigieuse médaille d’argent aux X-Games européens, organisés à Tignes. Cette même année, il est 10e en Half Pipe aux Jeux olympiques d'hiver de Vancouver. En 2011, il est 7e en Half Pipe et 5e en Big Air au Championnat du monde de La Molina, en Espagne. En 2016, il remporte haut la main le légendaire Banked Slalom à Mont Baker, au nord-ouest des États-Unis. À 31 ans, il gagne l’épreuve avec un temps record devant des gros noms du snowboard comme Jake Blauvelt, Terje Hakonsen ou encore Bryan Fox. Passé consultant en snowboard sur les plateaux de télé, on l’a vu notamment commenter les Jeux olympiques d’hiver de Sotchi 2014 sur France Télévision. Il est le parrain de la « Surfrider Association », luttant pour la protection des océans, mais aussi du « Flocon à la Vague », association qui retrace le parcours de l’eau depuis les montagnes jusqu’aux océans. Aujourd’hui, il porte les films documentaires Odisea avec son ami surfeur Damien Castera. Après l’Alaska, ils ont tourné au Chili le deuxième volet d’Odisea, qui consiste à suivre le cycle de l’eau, de la montagne à l’océan. Depuis 2007, il est l’un des ambassadeurs des produits "eco-friendly" de Quiksilver, et a créé sa propre ligne de produits techniques en polyester 100% recyclé. Accro au surf, ces dernières années, notre snowboarder de La Mongie s’attaque en 2018 à la montagne d’eau haiwaïenne Jaws, la vague la plus puissante du monde, filmée et racontée par son ami d’enfance Morgan Le Faucheur. Un défi fou et incroyable de surfer, la mythique vague de Jaws à Hawaii. Il en fait le film à succès « Shaka », disponible sur les plateformes de VOD iTunes, Amazon et Vimeo. Récemment il a présenté sa nouvelle vidéo « Chione » dans laquelle il dévoile ses sessions incroyables dans la poudreuse et les vagues du Canada, de la Norvège et du Japon. Des images captivantes qui le mettent en scène en surf et snowboard. «One Board, Two Worlds» est un nouveau projet pensé par le célèbre snowboarder. Ce dernier nous emmène entre les vagues du Pays Basque et les montagnes des Pyrénées, pour une rencontre inédite de ces deux éléments, si chers à Mathieu. Un projet né d'un rêve fou : celui de rider la montagne et l'océan avec la même planche. Une aventure filmée par le vidéaste-photographe Guillaume Arrieta, et qui sera disponible courant 2020.
 Mathieu CREPEL, né le 26 octobre 1984 à Tarbes, est un snowboarder professionnel, multiple champion du monde, au talent indéniable. Précoce, à l’âge de 6 ans, il se découvre une passion pour les sports de glisse et notamment le snowboard. Son père, moniteur de ski, l’emmenait directement en hors-piste sur les pentes de La Mongie. Montrant des dispositions hors du commun, on lui avait donné le surnom de « petit singe » en raison de son étonnante agilité sur sa planche. En 1999, il quitte ses Pyrénées pour intégrer le lycée sport études de Villard-de-Lans. En 2002, il descend pour la première fois le Pic du Midi en snowboard, un domaine de haute montagne non balisé, qui n’était pas encore ouvert au public. Il fut le plus jeune rider professionnel français. À l’âge de 10 ans, ses aînés pro-riders l’emmenait en trip snowboard au Groenland. À 15 ans, il prend part aux Championnats du monde « jeunes » et termine second. En 2001, aux Championnats du monde junior en pipe, il termine encore à la deuxième place, et de là, il va enchaîner les belles performances en contest. Vainqueur de la Quik Cup (compétition mêlant snow et surf) en 2001 et 2002, puis 2ème au Quiksilver Slopestyle Pro en 2003. En 2003, il gagne son premier titre et devient champion de France de Big Air et de Half Pipe, le tout à seulement 18 ans. Sa carrière est lancée. En 2005, il devient le premier champion du monde de pipe français en remportant le gros Globe de Cristal FIS (Fédération internationale de Ski). Il est sélectionné pour les JO de Turin en 2006, et atteint la finale mais revient non médaillé. Cette même saison, il est double champion du monde de pipe, à la fois en FIS et sur le circuit TTR (Ticket To Ride). Exploit encore inégalé à ce jour chez les hommes. En 2007, il est double champion du monde (médaillé d’or) en Half Pipe et Big Air à Arosa, en Suisse. En février 2008, il organise son premier grand événement, le Mathieu Crépel Invitational, épreuve inscrite au calendrier TTR, chez lui dans les Pyrénées. Il réalise là quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur, et l’événement est un vrai succès. En 2009, il est 3e (médaillé de bronze) en Half Pipe au Championnat du monde à Gangwon. Enfin en 2010, il obtient une prestigieuse médaille d’argent aux X-Games européens, organisés à Tignes. Cette même année, il est 10e en Half Pipe aux Jeux olympiques d'hiver de Vancouver. En 2011, il est 7e en Half Pipe et 5e en Big Air au Championnat du monde de La Molina, en Espagne. En 2016, il remporte haut la main le légendaire Banked Slalom à Mont Baker, au nord-ouest des États-Unis. À 31 ans, il gagne l’épreuve avec un temps record devant des gros noms du snowboard comme Jake Blauvelt, Terje Hakonsen ou encore Bryan Fox. Passé consultant en snowboard sur les plateaux de télé, on l’a vu notamment commenter les Jeux olympiques d’hiver de Sotchi 2014 sur France Télévision. Il est le parrain de la « Surfrider Association », luttant pour la protection des océans, mais aussi du « Flocon à la Vague », association qui retrace le parcours de l’eau depuis les montagnes jusqu’aux océans. Aujourd’hui, il porte les films documentaires Odisea avec son ami surfeur Damien Castera. Après l’Alaska, ils ont tourné au Chili le deuxième volet d’Odisea, qui consiste à suivre le cycle de l’eau, de la montagne à l’océan. Depuis 2007, il est l’un des ambassadeurs des produits "eco-friendly" de Quiksilver, et a créé sa propre ligne de produits techniques en polyester 100% recyclé. Accro au surf, ces dernières années, notre snowboarder de La Mongie s’attaque en 2018 à la montagne d’eau haiwaïenne Jaws, la vague la plus puissante du monde, filmée et racontée par son ami d’enfance Morgan Le Faucheur. Un défi fou et incroyable de surfer, la mythique vague de Jaws à Hawaii. Il en fait le film à succès « Shaka », disponible sur les plateformes de VOD iTunes, Amazon et Vimeo. Récemment il a présenté sa nouvelle vidéo « Chione » dans laquelle il dévoile ses sessions incroyables dans la poudreuse et les vagues du Canada, de la Norvège et du Japon. Des images captivantes qui le mettent en scène en surf et snowboard. «One Board, Two Worlds» est un nouveau projet pensé par le célèbre snowboarder. Ce dernier nous emmène entre les vagues du Pays Basque et les montagnes des Pyrénées, pour une rencontre inédite de ces deux éléments, si chers à Mathieu. Un projet né d'un rêve fou : celui de rider la montagne et l'océan avec la même planche. Une aventure filmée par le vidéaste-photographe Guillaume Arrieta, et qui sera disponible courant 2020.
Mathieu CREPEL, né le 26 octobre 1984 à Tarbes, est un snowboarder professionnel, multiple champion du monde, au talent indéniable. Précoce, à l’âge de 6 ans, il se découvre une passion pour les sports de glisse et notamment le snowboard. Son père, moniteur de ski, l’emmenait directement en hors-piste sur les pentes de La Mongie. Montrant des dispositions hors du commun, on lui avait donné le surnom de « petit singe » en raison de son étonnante agilité sur sa planche. En 1999, il quitte ses Pyrénées pour intégrer le lycée sport études de Villard-de-Lans. En 2002, il descend pour la première fois le Pic du Midi en snowboard, un domaine de haute montagne non balisé, qui n’était pas encore ouvert au public. Il fut le plus jeune rider professionnel français. À l’âge de 10 ans, ses aînés pro-riders l’emmenait en trip snowboard au Groenland. À 15 ans, il prend part aux Championnats du monde « jeunes » et termine second. En 2001, aux Championnats du monde junior en pipe, il termine encore à la deuxième place, et de là, il va enchaîner les belles performances en contest. Vainqueur de la Quik Cup (compétition mêlant snow et surf) en 2001 et 2002, puis 2ème au Quiksilver Slopestyle Pro en 2003. En 2003, il gagne son premier titre et devient champion de France de Big Air et de Half Pipe, le tout à seulement 18 ans. Sa carrière est lancée. En 2005, il devient le premier champion du monde de pipe français en remportant le gros Globe de Cristal FIS (Fédération internationale de Ski). Il est sélectionné pour les JO de Turin en 2006, et atteint la finale mais revient non médaillé. Cette même saison, il est double champion du monde de pipe, à la fois en FIS et sur le circuit TTR (Ticket To Ride). Exploit encore inégalé à ce jour chez les hommes. En 2007, il est double champion du monde (médaillé d’or) en Half Pipe et Big Air à Arosa, en Suisse. En février 2008, il organise son premier grand événement, le Mathieu Crépel Invitational, épreuve inscrite au calendrier TTR, chez lui dans les Pyrénées. Il réalise là quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur, et l’événement est un vrai succès. En 2009, il est 3e (médaillé de bronze) en Half Pipe au Championnat du monde à Gangwon. Enfin en 2010, il obtient une prestigieuse médaille d’argent aux X-Games européens, organisés à Tignes. Cette même année, il est 10e en Half Pipe aux Jeux olympiques d'hiver de Vancouver. En 2011, il est 7e en Half Pipe et 5e en Big Air au Championnat du monde de La Molina, en Espagne. En 2016, il remporte haut la main le légendaire Banked Slalom à Mont Baker, au nord-ouest des États-Unis. À 31 ans, il gagne l’épreuve avec un temps record devant des gros noms du snowboard comme Jake Blauvelt, Terje Hakonsen ou encore Bryan Fox. Passé consultant en snowboard sur les plateaux de télé, on l’a vu notamment commenter les Jeux olympiques d’hiver de Sotchi 2014 sur France Télévision. Il est le parrain de la « Surfrider Association », luttant pour la protection des océans, mais aussi du « Flocon à la Vague », association qui retrace le parcours de l’eau depuis les montagnes jusqu’aux océans. Aujourd’hui, il porte les films documentaires Odisea avec son ami surfeur Damien Castera. Après l’Alaska, ils ont tourné au Chili le deuxième volet d’Odisea, qui consiste à suivre le cycle de l’eau, de la montagne à l’océan. Depuis 2007, il est l’un des ambassadeurs des produits "eco-friendly" de Quiksilver, et a créé sa propre ligne de produits techniques en polyester 100% recyclé. Accro au surf, ces dernières années, notre snowboarder de La Mongie s’attaque en 2018 à la montagne d’eau haiwaïenne Jaws, la vague la plus puissante du monde, filmée et racontée par son ami d’enfance Morgan Le Faucheur. Un défi fou et incroyable de surfer, la mythique vague de Jaws à Hawaii. Il en fait le film à succès « Shaka », disponible sur les plateformes de VOD iTunes, Amazon et Vimeo. Récemment il a présenté sa nouvelle vidéo « Chione » dans laquelle il dévoile ses sessions incroyables dans la poudreuse et les vagues du Canada, de la Norvège et du Japon. Des images captivantes qui le mettent en scène en surf et snowboard. «One Board, Two Worlds» est un nouveau projet pensé par le célèbre snowboarder. Ce dernier nous emmène entre les vagues du Pays Basque et les montagnes des Pyrénées, pour une rencontre inédite de ces deux éléments, si chers à Mathieu. Un projet né d'un rêve fou : celui de rider la montagne et l'océan avec la même planche. Une aventure filmée par le vidéaste-photographe Guillaume Arrieta, et qui sera disponible courant 2020.DANTZIG Charles (1961-XXXX)
Écrivain, romancier, poète et éditeur
 Charles DANTZIG, de son vrai nom Patrick Lefebvre, né à Tarbes le 7 octobre 1961, est l'auteur d'une vingtaine de livres, alternant romans, essais et recueils de poésies. Parmi ses grandes admirations figurent Fitzgerald, Joyce et Wilde, dont il s'est fait l'enthousiaste traducteur. Il est issu d'une famille de professeurs de médecine. Après le bac, il suit des études de droit à Toulouse. Il obtient son doctorat de droit avec une thèse soutenue sur le sujet :« les libertés de l'air », une étude sur les droits de trafic que les États accordent aux compagnies aériennes. Une fois diplômé, il décide de monter à Paris où il entame des carrières parallèles d'auteur - en 1990, il publie son essai sur Remy de Gourmont (Le Rocher) - et d'éditeur (Les Belles Lettres, puis Grasset). Il est l'auteur de plusieurs romans, dont « Nos vies hâtives » (Grasset, 2001, prix Jean Freustié et prix Roger Nimier) et « Un film d'amour » (Grasset, 2003), et d'essais comme « La guerre du cliché » (Les Belles Lettres, 1998). À seulement vingt-huit ans, il fait donc paraître un essai « Remy de Gourmont, Cher Vieux Daim ! » (Le Rocher, 1990), suivi de son premier recueil de poésies, « Le chauffeur est toujours seul » (La Différence). Il devient éditeur aux Belles Lettres, où il a créé et dirigé trois collections : « Brique » pour la littérature contemporaine, « Eux & nous » où des écrivains français parlent d'auteurs de l'antiquité classique et « Trésors de la nouvelle » au titre assez évocateur. Il a publié les œuvres quasi complètes de Marcel Schwob (Œuvres, Les Belles Lettres) et plusieurs anthologies de poésie, comme l'Anthologie de la poésie symboliste, l'Anthologie de la poésie grecque classique, une anthologie des poésies de Voltaire. Ses premiers essais paraissent aux Belles Lettres, entre autres « Il n'y a pas d'Indochine » en 1995 et « La Guerre du cliché » en 1998 ; ainsi que ses recueils de poésies : « Que le siècle commence » en 1996 (récompensé par le prix Paul Verlaine), « Ce qui se passe vraiment dans les toiles de Jouy » en 1999, « À quoi servent les avions ? » en 2001, où, avant les attentats du 11 septembre, il imagine la destruction des tours jumelles. Une première anthologie de ses poèmes paraîtra en 2003 sous le titre de « En souvenir des long-courriers ». Son premier roman, « Confitures de crimes » (en référence à un vers de H.J.-M. Levet : Le soleil se couche en des confitures de crimes), paraît aux Belles Lettres en 1993. Il est ensuite éditeur chez Grasset où il dirige la collection des « Cahiers rouges », dont il renouvelle le catalogue en y faisant entrer des livres "culte" comme « L'Horizon chimérique » de Jean de La Ville de Mirmont ou le « J'adore » de Jean Desbordes, ainsi que de grands mémorialistes et diaristes du XXe siècle, comme Harold Nicolson, George Moore et Robert de Saint Jean. Il est l'éditeur d'Adrien Goetz et de sa fameuse série des Intrigues (Intrigue à l'anglaise, Intrigue à Versailles). Ayant convaincu Dany Laferrière de recommencer à écrire, il publie son roman « L'énigme du retour », qui reçoit le prix Médicis 2009. En 2005, il publie son « Dictionnaire égoïste de la littérature française », son plus grand succès. De mars 2006 à mars 2008, il a signé l'épilogue de chaque dossier du Magazine Littéraire. En janvier 2009, il publie chez Grasset une nouvelle somme, son « Encyclopédie capricieuse du tout et du rien ». En 2011, il publie « Pourquoi lire ? » aux éditions Grasset. Il est l'auteur de poèmes comme « Les nageurs » et de romans comme « Histoire de l’amour et de la haine ». Partisan des liens entre la littérature et la création contemporaine, il a été commissaire associé de l'exposition d'ouverture du Centre Pompidou-Metz, "Chef-d'œuvre ?". Écrivain et éditeur chez Grasset, il dirigea les deux collections « Les Cahiers rouges » et « Le Courage », avec la revue internationale du même nom. En 2017, après un « Dictionnaire égoïste de la littérature française » aux éditions Grasset, une « Encyclopédie capricieuse du tout et du rien » et « Histoire de l’amour et de la haine », il publie dans sa maison, dans la collection Bleue de Grasset, son nouvel essai : « Traité des gestes ». Qu’est-ce qu’un geste ? De quoi est-il le prolongement ? Que disent ces gestes que tout le monde fait et que personne ne semble vraiment remarquer ? Et tout le monde a envie de comprendre ce que ces gestes veulent dire. Il interroge leur origine et leur signification et dresse l'inventaire des gestes plus ou moins quotidiens, plus ou moins habituels et plus ou moins célèbres, à partir d'observations quotidiennes et de souvenirs, mais encore de la littérature, des arts et de l'histoire. Les gestes nous échappent, et nous révèlent. Un battement de paupières. Un regard qui se détourne. Un haussement d’épaules, geste avec la langue, geste avec les mains, gestes d’adieu, fausseté du geste, gestes nationaux, gestes oubliés. Observateur attentif de ses contemporains, il décrypte leurs tics et manies, les rapprochant de leurs illustres aînés, puisés dans l'histoire, la musique, le cinéma et, bien sûr, la littérature. À l’occasion de la publication du « Traité des gestes », il a reçu le grand prix de littérature Paul Morand. Ses romans ont reçu de nombreux prix, dont le prix Décembre et le prix Duménil à l’unanimité, le Grand prix de l'Essai de l’Académie française, et le Grand prix Jean-Giono pour l'ensemble de son œuvre. Son livre : « Histoire de l'amour et de la haine » a reçu le prix Transfuge du meilleur roman français 2015. Son fameux « Dictionnaire égoïste de la littérature française », immense succès immédiat critique et public paru en 2005, a obtenu cinq prix, dont le Prix Décembre, a été salué par la presse de tous les pays. Depuis 2017, il produit et anime l'émission "Personnages en personne". En janvier 2019, il publie son 26e livre « Chambord-des-Songes » chez Flammarion et ce même mois, s’étant porté candidat en 2018 à l’Académie française au fauteuil de Michel Déon, il échoue à cette 3e élection. Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité, l’élection est blanche et reportée.
Charles DANTZIG, de son vrai nom Patrick Lefebvre, né à Tarbes le 7 octobre 1961, est l'auteur d'une vingtaine de livres, alternant romans, essais et recueils de poésies. Parmi ses grandes admirations figurent Fitzgerald, Joyce et Wilde, dont il s'est fait l'enthousiaste traducteur. Il est issu d'une famille de professeurs de médecine. Après le bac, il suit des études de droit à Toulouse. Il obtient son doctorat de droit avec une thèse soutenue sur le sujet :« les libertés de l'air », une étude sur les droits de trafic que les États accordent aux compagnies aériennes. Une fois diplômé, il décide de monter à Paris où il entame des carrières parallèles d'auteur - en 1990, il publie son essai sur Remy de Gourmont (Le Rocher) - et d'éditeur (Les Belles Lettres, puis Grasset). Il est l'auteur de plusieurs romans, dont « Nos vies hâtives » (Grasset, 2001, prix Jean Freustié et prix Roger Nimier) et « Un film d'amour » (Grasset, 2003), et d'essais comme « La guerre du cliché » (Les Belles Lettres, 1998). À seulement vingt-huit ans, il fait donc paraître un essai « Remy de Gourmont, Cher Vieux Daim ! » (Le Rocher, 1990), suivi de son premier recueil de poésies, « Le chauffeur est toujours seul » (La Différence). Il devient éditeur aux Belles Lettres, où il a créé et dirigé trois collections : « Brique » pour la littérature contemporaine, « Eux & nous » où des écrivains français parlent d'auteurs de l'antiquité classique et « Trésors de la nouvelle » au titre assez évocateur. Il a publié les œuvres quasi complètes de Marcel Schwob (Œuvres, Les Belles Lettres) et plusieurs anthologies de poésie, comme l'Anthologie de la poésie symboliste, l'Anthologie de la poésie grecque classique, une anthologie des poésies de Voltaire. Ses premiers essais paraissent aux Belles Lettres, entre autres « Il n'y a pas d'Indochine » en 1995 et « La Guerre du cliché » en 1998 ; ainsi que ses recueils de poésies : « Que le siècle commence » en 1996 (récompensé par le prix Paul Verlaine), « Ce qui se passe vraiment dans les toiles de Jouy » en 1999, « À quoi servent les avions ? » en 2001, où, avant les attentats du 11 septembre, il imagine la destruction des tours jumelles. Une première anthologie de ses poèmes paraîtra en 2003 sous le titre de « En souvenir des long-courriers ». Son premier roman, « Confitures de crimes » (en référence à un vers de H.J.-M. Levet : Le soleil se couche en des confitures de crimes), paraît aux Belles Lettres en 1993. Il est ensuite éditeur chez Grasset où il dirige la collection des « Cahiers rouges », dont il renouvelle le catalogue en y faisant entrer des livres "culte" comme « L'Horizon chimérique » de Jean de La Ville de Mirmont ou le « J'adore » de Jean Desbordes, ainsi que de grands mémorialistes et diaristes du XXe siècle, comme Harold Nicolson, George Moore et Robert de Saint Jean. Il est l'éditeur d'Adrien Goetz et de sa fameuse série des Intrigues (Intrigue à l'anglaise, Intrigue à Versailles). Ayant convaincu Dany Laferrière de recommencer à écrire, il publie son roman « L'énigme du retour », qui reçoit le prix Médicis 2009. En 2005, il publie son « Dictionnaire égoïste de la littérature française », son plus grand succès. De mars 2006 à mars 2008, il a signé l'épilogue de chaque dossier du Magazine Littéraire. En janvier 2009, il publie chez Grasset une nouvelle somme, son « Encyclopédie capricieuse du tout et du rien ». En 2011, il publie « Pourquoi lire ? » aux éditions Grasset. Il est l'auteur de poèmes comme « Les nageurs » et de romans comme « Histoire de l’amour et de la haine ». Partisan des liens entre la littérature et la création contemporaine, il a été commissaire associé de l'exposition d'ouverture du Centre Pompidou-Metz, "Chef-d'œuvre ?". Écrivain et éditeur chez Grasset, il dirigea les deux collections « Les Cahiers rouges » et « Le Courage », avec la revue internationale du même nom. En 2017, après un « Dictionnaire égoïste de la littérature française » aux éditions Grasset, une « Encyclopédie capricieuse du tout et du rien » et « Histoire de l’amour et de la haine », il publie dans sa maison, dans la collection Bleue de Grasset, son nouvel essai : « Traité des gestes ». Qu’est-ce qu’un geste ? De quoi est-il le prolongement ? Que disent ces gestes que tout le monde fait et que personne ne semble vraiment remarquer ? Et tout le monde a envie de comprendre ce que ces gestes veulent dire. Il interroge leur origine et leur signification et dresse l'inventaire des gestes plus ou moins quotidiens, plus ou moins habituels et plus ou moins célèbres, à partir d'observations quotidiennes et de souvenirs, mais encore de la littérature, des arts et de l'histoire. Les gestes nous échappent, et nous révèlent. Un battement de paupières. Un regard qui se détourne. Un haussement d’épaules, geste avec la langue, geste avec les mains, gestes d’adieu, fausseté du geste, gestes nationaux, gestes oubliés. Observateur attentif de ses contemporains, il décrypte leurs tics et manies, les rapprochant de leurs illustres aînés, puisés dans l'histoire, la musique, le cinéma et, bien sûr, la littérature. À l’occasion de la publication du « Traité des gestes », il a reçu le grand prix de littérature Paul Morand. Ses romans ont reçu de nombreux prix, dont le prix Décembre et le prix Duménil à l’unanimité, le Grand prix de l'Essai de l’Académie française, et le Grand prix Jean-Giono pour l'ensemble de son œuvre. Son livre : « Histoire de l'amour et de la haine » a reçu le prix Transfuge du meilleur roman français 2015. Son fameux « Dictionnaire égoïste de la littérature française », immense succès immédiat critique et public paru en 2005, a obtenu cinq prix, dont le Prix Décembre, a été salué par la presse de tous les pays. Depuis 2017, il produit et anime l'émission "Personnages en personne". En janvier 2019, il publie son 26e livre « Chambord-des-Songes » chez Flammarion et ce même mois, s’étant porté candidat en 2018 à l’Académie française au fauteuil de Michel Déon, il échoue à cette 3e élection. Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité, l’élection est blanche et reportée.
 Charles DANTZIG, de son vrai nom Patrick Lefebvre, né à Tarbes le 7 octobre 1961, est l'auteur d'une vingtaine de livres, alternant romans, essais et recueils de poésies. Parmi ses grandes admirations figurent Fitzgerald, Joyce et Wilde, dont il s'est fait l'enthousiaste traducteur. Il est issu d'une famille de professeurs de médecine. Après le bac, il suit des études de droit à Toulouse. Il obtient son doctorat de droit avec une thèse soutenue sur le sujet :« les libertés de l'air », une étude sur les droits de trafic que les États accordent aux compagnies aériennes. Une fois diplômé, il décide de monter à Paris où il entame des carrières parallèles d'auteur - en 1990, il publie son essai sur Remy de Gourmont (Le Rocher) - et d'éditeur (Les Belles Lettres, puis Grasset). Il est l'auteur de plusieurs romans, dont « Nos vies hâtives » (Grasset, 2001, prix Jean Freustié et prix Roger Nimier) et « Un film d'amour » (Grasset, 2003), et d'essais comme « La guerre du cliché » (Les Belles Lettres, 1998). À seulement vingt-huit ans, il fait donc paraître un essai « Remy de Gourmont, Cher Vieux Daim ! » (Le Rocher, 1990), suivi de son premier recueil de poésies, « Le chauffeur est toujours seul » (La Différence). Il devient éditeur aux Belles Lettres, où il a créé et dirigé trois collections : « Brique » pour la littérature contemporaine, « Eux & nous » où des écrivains français parlent d'auteurs de l'antiquité classique et « Trésors de la nouvelle » au titre assez évocateur. Il a publié les œuvres quasi complètes de Marcel Schwob (Œuvres, Les Belles Lettres) et plusieurs anthologies de poésie, comme l'Anthologie de la poésie symboliste, l'Anthologie de la poésie grecque classique, une anthologie des poésies de Voltaire. Ses premiers essais paraissent aux Belles Lettres, entre autres « Il n'y a pas d'Indochine » en 1995 et « La Guerre du cliché » en 1998 ; ainsi que ses recueils de poésies : « Que le siècle commence » en 1996 (récompensé par le prix Paul Verlaine), « Ce qui se passe vraiment dans les toiles de Jouy » en 1999, « À quoi servent les avions ? » en 2001, où, avant les attentats du 11 septembre, il imagine la destruction des tours jumelles. Une première anthologie de ses poèmes paraîtra en 2003 sous le titre de « En souvenir des long-courriers ». Son premier roman, « Confitures de crimes » (en référence à un vers de H.J.-M. Levet : Le soleil se couche en des confitures de crimes), paraît aux Belles Lettres en 1993. Il est ensuite éditeur chez Grasset où il dirige la collection des « Cahiers rouges », dont il renouvelle le catalogue en y faisant entrer des livres "culte" comme « L'Horizon chimérique » de Jean de La Ville de Mirmont ou le « J'adore » de Jean Desbordes, ainsi que de grands mémorialistes et diaristes du XXe siècle, comme Harold Nicolson, George Moore et Robert de Saint Jean. Il est l'éditeur d'Adrien Goetz et de sa fameuse série des Intrigues (Intrigue à l'anglaise, Intrigue à Versailles). Ayant convaincu Dany Laferrière de recommencer à écrire, il publie son roman « L'énigme du retour », qui reçoit le prix Médicis 2009. En 2005, il publie son « Dictionnaire égoïste de la littérature française », son plus grand succès. De mars 2006 à mars 2008, il a signé l'épilogue de chaque dossier du Magazine Littéraire. En janvier 2009, il publie chez Grasset une nouvelle somme, son « Encyclopédie capricieuse du tout et du rien ». En 2011, il publie « Pourquoi lire ? » aux éditions Grasset. Il est l'auteur de poèmes comme « Les nageurs » et de romans comme « Histoire de l’amour et de la haine ». Partisan des liens entre la littérature et la création contemporaine, il a été commissaire associé de l'exposition d'ouverture du Centre Pompidou-Metz, "Chef-d'œuvre ?". Écrivain et éditeur chez Grasset, il dirigea les deux collections « Les Cahiers rouges » et « Le Courage », avec la revue internationale du même nom. En 2017, après un « Dictionnaire égoïste de la littérature française » aux éditions Grasset, une « Encyclopédie capricieuse du tout et du rien » et « Histoire de l’amour et de la haine », il publie dans sa maison, dans la collection Bleue de Grasset, son nouvel essai : « Traité des gestes ». Qu’est-ce qu’un geste ? De quoi est-il le prolongement ? Que disent ces gestes que tout le monde fait et que personne ne semble vraiment remarquer ? Et tout le monde a envie de comprendre ce que ces gestes veulent dire. Il interroge leur origine et leur signification et dresse l'inventaire des gestes plus ou moins quotidiens, plus ou moins habituels et plus ou moins célèbres, à partir d'observations quotidiennes et de souvenirs, mais encore de la littérature, des arts et de l'histoire. Les gestes nous échappent, et nous révèlent. Un battement de paupières. Un regard qui se détourne. Un haussement d’épaules, geste avec la langue, geste avec les mains, gestes d’adieu, fausseté du geste, gestes nationaux, gestes oubliés. Observateur attentif de ses contemporains, il décrypte leurs tics et manies, les rapprochant de leurs illustres aînés, puisés dans l'histoire, la musique, le cinéma et, bien sûr, la littérature. À l’occasion de la publication du « Traité des gestes », il a reçu le grand prix de littérature Paul Morand. Ses romans ont reçu de nombreux prix, dont le prix Décembre et le prix Duménil à l’unanimité, le Grand prix de l'Essai de l’Académie française, et le Grand prix Jean-Giono pour l'ensemble de son œuvre. Son livre : « Histoire de l'amour et de la haine » a reçu le prix Transfuge du meilleur roman français 2015. Son fameux « Dictionnaire égoïste de la littérature française », immense succès immédiat critique et public paru en 2005, a obtenu cinq prix, dont le Prix Décembre, a été salué par la presse de tous les pays. Depuis 2017, il produit et anime l'émission "Personnages en personne". En janvier 2019, il publie son 26e livre « Chambord-des-Songes » chez Flammarion et ce même mois, s’étant porté candidat en 2018 à l’Académie française au fauteuil de Michel Déon, il échoue à cette 3e élection. Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité, l’élection est blanche et reportée.
Charles DANTZIG, de son vrai nom Patrick Lefebvre, né à Tarbes le 7 octobre 1961, est l'auteur d'une vingtaine de livres, alternant romans, essais et recueils de poésies. Parmi ses grandes admirations figurent Fitzgerald, Joyce et Wilde, dont il s'est fait l'enthousiaste traducteur. Il est issu d'une famille de professeurs de médecine. Après le bac, il suit des études de droit à Toulouse. Il obtient son doctorat de droit avec une thèse soutenue sur le sujet :« les libertés de l'air », une étude sur les droits de trafic que les États accordent aux compagnies aériennes. Une fois diplômé, il décide de monter à Paris où il entame des carrières parallèles d'auteur - en 1990, il publie son essai sur Remy de Gourmont (Le Rocher) - et d'éditeur (Les Belles Lettres, puis Grasset). Il est l'auteur de plusieurs romans, dont « Nos vies hâtives » (Grasset, 2001, prix Jean Freustié et prix Roger Nimier) et « Un film d'amour » (Grasset, 2003), et d'essais comme « La guerre du cliché » (Les Belles Lettres, 1998). À seulement vingt-huit ans, il fait donc paraître un essai « Remy de Gourmont, Cher Vieux Daim ! » (Le Rocher, 1990), suivi de son premier recueil de poésies, « Le chauffeur est toujours seul » (La Différence). Il devient éditeur aux Belles Lettres, où il a créé et dirigé trois collections : « Brique » pour la littérature contemporaine, « Eux & nous » où des écrivains français parlent d'auteurs de l'antiquité classique et « Trésors de la nouvelle » au titre assez évocateur. Il a publié les œuvres quasi complètes de Marcel Schwob (Œuvres, Les Belles Lettres) et plusieurs anthologies de poésie, comme l'Anthologie de la poésie symboliste, l'Anthologie de la poésie grecque classique, une anthologie des poésies de Voltaire. Ses premiers essais paraissent aux Belles Lettres, entre autres « Il n'y a pas d'Indochine » en 1995 et « La Guerre du cliché » en 1998 ; ainsi que ses recueils de poésies : « Que le siècle commence » en 1996 (récompensé par le prix Paul Verlaine), « Ce qui se passe vraiment dans les toiles de Jouy » en 1999, « À quoi servent les avions ? » en 2001, où, avant les attentats du 11 septembre, il imagine la destruction des tours jumelles. Une première anthologie de ses poèmes paraîtra en 2003 sous le titre de « En souvenir des long-courriers ». Son premier roman, « Confitures de crimes » (en référence à un vers de H.J.-M. Levet : Le soleil se couche en des confitures de crimes), paraît aux Belles Lettres en 1993. Il est ensuite éditeur chez Grasset où il dirige la collection des « Cahiers rouges », dont il renouvelle le catalogue en y faisant entrer des livres "culte" comme « L'Horizon chimérique » de Jean de La Ville de Mirmont ou le « J'adore » de Jean Desbordes, ainsi que de grands mémorialistes et diaristes du XXe siècle, comme Harold Nicolson, George Moore et Robert de Saint Jean. Il est l'éditeur d'Adrien Goetz et de sa fameuse série des Intrigues (Intrigue à l'anglaise, Intrigue à Versailles). Ayant convaincu Dany Laferrière de recommencer à écrire, il publie son roman « L'énigme du retour », qui reçoit le prix Médicis 2009. En 2005, il publie son « Dictionnaire égoïste de la littérature française », son plus grand succès. De mars 2006 à mars 2008, il a signé l'épilogue de chaque dossier du Magazine Littéraire. En janvier 2009, il publie chez Grasset une nouvelle somme, son « Encyclopédie capricieuse du tout et du rien ». En 2011, il publie « Pourquoi lire ? » aux éditions Grasset. Il est l'auteur de poèmes comme « Les nageurs » et de romans comme « Histoire de l’amour et de la haine ». Partisan des liens entre la littérature et la création contemporaine, il a été commissaire associé de l'exposition d'ouverture du Centre Pompidou-Metz, "Chef-d'œuvre ?". Écrivain et éditeur chez Grasset, il dirigea les deux collections « Les Cahiers rouges » et « Le Courage », avec la revue internationale du même nom. En 2017, après un « Dictionnaire égoïste de la littérature française » aux éditions Grasset, une « Encyclopédie capricieuse du tout et du rien » et « Histoire de l’amour et de la haine », il publie dans sa maison, dans la collection Bleue de Grasset, son nouvel essai : « Traité des gestes ». Qu’est-ce qu’un geste ? De quoi est-il le prolongement ? Que disent ces gestes que tout le monde fait et que personne ne semble vraiment remarquer ? Et tout le monde a envie de comprendre ce que ces gestes veulent dire. Il interroge leur origine et leur signification et dresse l'inventaire des gestes plus ou moins quotidiens, plus ou moins habituels et plus ou moins célèbres, à partir d'observations quotidiennes et de souvenirs, mais encore de la littérature, des arts et de l'histoire. Les gestes nous échappent, et nous révèlent. Un battement de paupières. Un regard qui se détourne. Un haussement d’épaules, geste avec la langue, geste avec les mains, gestes d’adieu, fausseté du geste, gestes nationaux, gestes oubliés. Observateur attentif de ses contemporains, il décrypte leurs tics et manies, les rapprochant de leurs illustres aînés, puisés dans l'histoire, la musique, le cinéma et, bien sûr, la littérature. À l’occasion de la publication du « Traité des gestes », il a reçu le grand prix de littérature Paul Morand. Ses romans ont reçu de nombreux prix, dont le prix Décembre et le prix Duménil à l’unanimité, le Grand prix de l'Essai de l’Académie française, et le Grand prix Jean-Giono pour l'ensemble de son œuvre. Son livre : « Histoire de l'amour et de la haine » a reçu le prix Transfuge du meilleur roman français 2015. Son fameux « Dictionnaire égoïste de la littérature française », immense succès immédiat critique et public paru en 2005, a obtenu cinq prix, dont le Prix Décembre, a été salué par la presse de tous les pays. Depuis 2017, il produit et anime l'émission "Personnages en personne". En janvier 2019, il publie son 26e livre « Chambord-des-Songes » chez Flammarion et ce même mois, s’étant porté candidat en 2018 à l’Académie française au fauteuil de Michel Déon, il échoue à cette 3e élection. Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité, l’élection est blanche et reportée.DAVANT Jean-Pierre (1945-2024)
Président de la Fédération nationale de la Mutualité Française
 Jean-Pierre DAVANT, né le 12 avril 1945, de parents bigourdans, il est le fils d’un directeur d’école primaire et d’une infirmière. Diplômé de l’École nationale des impôts, il a exercé comme inspecteur principal des impôts. De 1978 à 1986, il a occupé les fonctions de président de la Mutuelle nationale des agents de la Direction générale des impôts. Au sein de son administration, il contribua à la réunification qui conduira à la création de la Mutuelle des Agents des Impôts (MAI), qu’il présidera jusqu’en 1990. Président dès 1986 de la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l’État (FNMFAE), qui s’appellera deux ans plus tard Mutualité de la Fonction Publique (MFP), il aura en charge le Centre Médico-Chirurgical (CMC) de la Porte de Choisy. Il présidera la MFP de 1986 à 1992. En 1987, il créera, à partir du service d’Étude et de Recherche Appliquée du CMC, la Fondation de l’Avenir pour la Recherche Médicale Appliquée, reconnue d’utilité publique, qu’il présidera jusqu’en 2001. En 1991, il organisera le rapprochement de l’Hôpital International de l’Université de Paris avec le Centre de la Porte de Choisy, pour édifier en 1998, l’Institut Mutualiste Montsouris, dont il est à l’origine. En 1986, il fut élu vice-président et membre du comité directeur de la FNMF, dont il intégra le conseil d’administration en 1979. En juin 1992, il succèdera à René Teulade, nommé ministre des Affaires sociales et de l’intégration, à la présidence de la FNMF. La Mutualité française protège vingt-cinq millions de personnes en France et représente le premier mouvement social du pays. Il sera réélu à la tête de la FNMF en 1998, puis en juin 2004 jusqu’en 2010. En juin 2011, après avoir quitté en décembre 2010 la FNMF, qu’il avait présidée durant dix-huit ans, il prendra la présidence de la Mutuelle des sportifs (MDS). Il avait accepté ce poste au nom de son engagement dans le monde sportif. En 2011, amateur de sport, ex-joueur de rugby, il prit la présidence du Tarbes Pyrénées Rugby (TPR), apportant de par ses relations, de gros sponsors nationaux comme la Matmut, Essilor, la Mutualité Française et dont il démissionnera en 2016, ayant en 2013 passé la main à Antoine Nunès. En février 2013, il démissionnera de la présidence de la Mutuelle des sportifs (MDS). Il fut également P-DG de l’IMAPS, une société anonyme créée en octobre 2010 par la FNMF, à l’issue de son congrès de 2009, pour valoriser l’apport de l’activité physique pour la santé, dans le cadre notamment des maladies chroniques. Cette création lui permettant de réunir ses deux « passions » à travers la promotion de la santé par l’activité physique et sportive. Membre du premier Conseil national du sida, il préside depuis 2010 le conseil de surveillance de la Fondation Gustave Roussy de recherche sur le cancer, succédant à Simone Veil. En 2001, il présida le Comité National de liaison des activités mutualistes, coopératives et associatives (CNLAMCA), devenu en octobre 2001, le CEGES (Conseil des Entreprises et des Groupements de l’Économie Sociale). Il fut également membre du Comité directeur de l’Association Internationale de la Mutualité (AIM), membre du bureau du Conseil économique et social et de la commission des comptes de la santé. Il fut également vice-président de la Matmut. En 1994, lors de son congrès national à Bayonne, la Mutualité Française élabora une « charte pour la protection sociale en l’an 2000 ». Les congrès de Lille (1997) et Paris (2000) confirmèrent un mouvement en marche pour affronter ses réformes internes et celles qui s’imposaient à la société française tout entière pour préserver un système de santé performant, accessible à tous. Ses réformes internes avaient été initiées par l’application des directives européennes à la Mutualité Française. En 2001, elles avaient conduit à une réécriture du Code de la Mutualité. FNMF et FMF (Fédération des mutuelles de France), sœurs ennemies depuis 1976, y avaient collaboré étroitement. Les deux fédérations ensemble avaient réussi à surmonter cette difficulté et se trouvèrent à nouveau réunies. En juin 2003, lors du XXXVIIème congrès de la Mutualité à Toulouse, en présence de Philippe Douste-Blazy, il proposa aux congressistes le texte d’une résolution présentant vingt-cinq mesures concrètes destinées à « sauver la Sécurité sociale » et à réduire les inégalités de santé. Elle fut votée à l’unanimité. Depuis, campagnes de presse et mobilisations nationales diverses se succédèrent pour peser sur le gouvernement. Il positionna la Mutualité en acteur incontournable de l’un des plus grands débats nationaux de ce début du XXIème siècle. Par ailleurs, il est l’auteur de trois ouvrages : Santé, le moment de vérité (1996), Notre santé n’est pas un commerce (2000) et La Révolution médicale, écrit avec les professeurs Thomas Tursz et Guy Vallancien (2003). Jean-Pierre Davant est décédé le 30 septembre 2024, à l’âge de 79 ans. Les funérailles ont été célébrées au cimetière de Trébons (65200), le samedi 05 octobre 2024.
Jean-Pierre DAVANT, né le 12 avril 1945, de parents bigourdans, il est le fils d’un directeur d’école primaire et d’une infirmière. Diplômé de l’École nationale des impôts, il a exercé comme inspecteur principal des impôts. De 1978 à 1986, il a occupé les fonctions de président de la Mutuelle nationale des agents de la Direction générale des impôts. Au sein de son administration, il contribua à la réunification qui conduira à la création de la Mutuelle des Agents des Impôts (MAI), qu’il présidera jusqu’en 1990. Président dès 1986 de la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l’État (FNMFAE), qui s’appellera deux ans plus tard Mutualité de la Fonction Publique (MFP), il aura en charge le Centre Médico-Chirurgical (CMC) de la Porte de Choisy. Il présidera la MFP de 1986 à 1992. En 1987, il créera, à partir du service d’Étude et de Recherche Appliquée du CMC, la Fondation de l’Avenir pour la Recherche Médicale Appliquée, reconnue d’utilité publique, qu’il présidera jusqu’en 2001. En 1991, il organisera le rapprochement de l’Hôpital International de l’Université de Paris avec le Centre de la Porte de Choisy, pour édifier en 1998, l’Institut Mutualiste Montsouris, dont il est à l’origine. En 1986, il fut élu vice-président et membre du comité directeur de la FNMF, dont il intégra le conseil d’administration en 1979. En juin 1992, il succèdera à René Teulade, nommé ministre des Affaires sociales et de l’intégration, à la présidence de la FNMF. La Mutualité française protège vingt-cinq millions de personnes en France et représente le premier mouvement social du pays. Il sera réélu à la tête de la FNMF en 1998, puis en juin 2004 jusqu’en 2010. En juin 2011, après avoir quitté en décembre 2010 la FNMF, qu’il avait présidée durant dix-huit ans, il prendra la présidence de la Mutuelle des sportifs (MDS). Il avait accepté ce poste au nom de son engagement dans le monde sportif. En 2011, amateur de sport, ex-joueur de rugby, il prit la présidence du Tarbes Pyrénées Rugby (TPR), apportant de par ses relations, de gros sponsors nationaux comme la Matmut, Essilor, la Mutualité Française et dont il démissionnera en 2016, ayant en 2013 passé la main à Antoine Nunès. En février 2013, il démissionnera de la présidence de la Mutuelle des sportifs (MDS). Il fut également P-DG de l’IMAPS, une société anonyme créée en octobre 2010 par la FNMF, à l’issue de son congrès de 2009, pour valoriser l’apport de l’activité physique pour la santé, dans le cadre notamment des maladies chroniques. Cette création lui permettant de réunir ses deux « passions » à travers la promotion de la santé par l’activité physique et sportive. Membre du premier Conseil national du sida, il préside depuis 2010 le conseil de surveillance de la Fondation Gustave Roussy de recherche sur le cancer, succédant à Simone Veil. En 2001, il présida le Comité National de liaison des activités mutualistes, coopératives et associatives (CNLAMCA), devenu en octobre 2001, le CEGES (Conseil des Entreprises et des Groupements de l’Économie Sociale). Il fut également membre du Comité directeur de l’Association Internationale de la Mutualité (AIM), membre du bureau du Conseil économique et social et de la commission des comptes de la santé. Il fut également vice-président de la Matmut. En 1994, lors de son congrès national à Bayonne, la Mutualité Française élabora une « charte pour la protection sociale en l’an 2000 ». Les congrès de Lille (1997) et Paris (2000) confirmèrent un mouvement en marche pour affronter ses réformes internes et celles qui s’imposaient à la société française tout entière pour préserver un système de santé performant, accessible à tous. Ses réformes internes avaient été initiées par l’application des directives européennes à la Mutualité Française. En 2001, elles avaient conduit à une réécriture du Code de la Mutualité. FNMF et FMF (Fédération des mutuelles de France), sœurs ennemies depuis 1976, y avaient collaboré étroitement. Les deux fédérations ensemble avaient réussi à surmonter cette difficulté et se trouvèrent à nouveau réunies. En juin 2003, lors du XXXVIIème congrès de la Mutualité à Toulouse, en présence de Philippe Douste-Blazy, il proposa aux congressistes le texte d’une résolution présentant vingt-cinq mesures concrètes destinées à « sauver la Sécurité sociale » et à réduire les inégalités de santé. Elle fut votée à l’unanimité. Depuis, campagnes de presse et mobilisations nationales diverses se succédèrent pour peser sur le gouvernement. Il positionna la Mutualité en acteur incontournable de l’un des plus grands débats nationaux de ce début du XXIème siècle. Par ailleurs, il est l’auteur de trois ouvrages : Santé, le moment de vérité (1996), Notre santé n’est pas un commerce (2000) et La Révolution médicale, écrit avec les professeurs Thomas Tursz et Guy Vallancien (2003). Jean-Pierre Davant est décédé le 30 septembre 2024, à l’âge de 79 ans. Les funérailles ont été célébrées au cimetière de Trébons (65200), le samedi 05 octobre 2024.
 Jean-Pierre DAVANT, né le 12 avril 1945, de parents bigourdans, il est le fils d’un directeur d’école primaire et d’une infirmière. Diplômé de l’École nationale des impôts, il a exercé comme inspecteur principal des impôts. De 1978 à 1986, il a occupé les fonctions de président de la Mutuelle nationale des agents de la Direction générale des impôts. Au sein de son administration, il contribua à la réunification qui conduira à la création de la Mutuelle des Agents des Impôts (MAI), qu’il présidera jusqu’en 1990. Président dès 1986 de la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l’État (FNMFAE), qui s’appellera deux ans plus tard Mutualité de la Fonction Publique (MFP), il aura en charge le Centre Médico-Chirurgical (CMC) de la Porte de Choisy. Il présidera la MFP de 1986 à 1992. En 1987, il créera, à partir du service d’Étude et de Recherche Appliquée du CMC, la Fondation de l’Avenir pour la Recherche Médicale Appliquée, reconnue d’utilité publique, qu’il présidera jusqu’en 2001. En 1991, il organisera le rapprochement de l’Hôpital International de l’Université de Paris avec le Centre de la Porte de Choisy, pour édifier en 1998, l’Institut Mutualiste Montsouris, dont il est à l’origine. En 1986, il fut élu vice-président et membre du comité directeur de la FNMF, dont il intégra le conseil d’administration en 1979. En juin 1992, il succèdera à René Teulade, nommé ministre des Affaires sociales et de l’intégration, à la présidence de la FNMF. La Mutualité française protège vingt-cinq millions de personnes en France et représente le premier mouvement social du pays. Il sera réélu à la tête de la FNMF en 1998, puis en juin 2004 jusqu’en 2010. En juin 2011, après avoir quitté en décembre 2010 la FNMF, qu’il avait présidée durant dix-huit ans, il prendra la présidence de la Mutuelle des sportifs (MDS). Il avait accepté ce poste au nom de son engagement dans le monde sportif. En 2011, amateur de sport, ex-joueur de rugby, il prit la présidence du Tarbes Pyrénées Rugby (TPR), apportant de par ses relations, de gros sponsors nationaux comme la Matmut, Essilor, la Mutualité Française et dont il démissionnera en 2016, ayant en 2013 passé la main à Antoine Nunès. En février 2013, il démissionnera de la présidence de la Mutuelle des sportifs (MDS). Il fut également P-DG de l’IMAPS, une société anonyme créée en octobre 2010 par la FNMF, à l’issue de son congrès de 2009, pour valoriser l’apport de l’activité physique pour la santé, dans le cadre notamment des maladies chroniques. Cette création lui permettant de réunir ses deux « passions » à travers la promotion de la santé par l’activité physique et sportive. Membre du premier Conseil national du sida, il préside depuis 2010 le conseil de surveillance de la Fondation Gustave Roussy de recherche sur le cancer, succédant à Simone Veil. En 2001, il présida le Comité National de liaison des activités mutualistes, coopératives et associatives (CNLAMCA), devenu en octobre 2001, le CEGES (Conseil des Entreprises et des Groupements de l’Économie Sociale). Il fut également membre du Comité directeur de l’Association Internationale de la Mutualité (AIM), membre du bureau du Conseil économique et social et de la commission des comptes de la santé. Il fut également vice-président de la Matmut. En 1994, lors de son congrès national à Bayonne, la Mutualité Française élabora une « charte pour la protection sociale en l’an 2000 ». Les congrès de Lille (1997) et Paris (2000) confirmèrent un mouvement en marche pour affronter ses réformes internes et celles qui s’imposaient à la société française tout entière pour préserver un système de santé performant, accessible à tous. Ses réformes internes avaient été initiées par l’application des directives européennes à la Mutualité Française. En 2001, elles avaient conduit à une réécriture du Code de la Mutualité. FNMF et FMF (Fédération des mutuelles de France), sœurs ennemies depuis 1976, y avaient collaboré étroitement. Les deux fédérations ensemble avaient réussi à surmonter cette difficulté et se trouvèrent à nouveau réunies. En juin 2003, lors du XXXVIIème congrès de la Mutualité à Toulouse, en présence de Philippe Douste-Blazy, il proposa aux congressistes le texte d’une résolution présentant vingt-cinq mesures concrètes destinées à « sauver la Sécurité sociale » et à réduire les inégalités de santé. Elle fut votée à l’unanimité. Depuis, campagnes de presse et mobilisations nationales diverses se succédèrent pour peser sur le gouvernement. Il positionna la Mutualité en acteur incontournable de l’un des plus grands débats nationaux de ce début du XXIème siècle. Par ailleurs, il est l’auteur de trois ouvrages : Santé, le moment de vérité (1996), Notre santé n’est pas un commerce (2000) et La Révolution médicale, écrit avec les professeurs Thomas Tursz et Guy Vallancien (2003). Jean-Pierre Davant est décédé le 30 septembre 2024, à l’âge de 79 ans. Les funérailles ont été célébrées au cimetière de Trébons (65200), le samedi 05 octobre 2024.
Jean-Pierre DAVANT, né le 12 avril 1945, de parents bigourdans, il est le fils d’un directeur d’école primaire et d’une infirmière. Diplômé de l’École nationale des impôts, il a exercé comme inspecteur principal des impôts. De 1978 à 1986, il a occupé les fonctions de président de la Mutuelle nationale des agents de la Direction générale des impôts. Au sein de son administration, il contribua à la réunification qui conduira à la création de la Mutuelle des Agents des Impôts (MAI), qu’il présidera jusqu’en 1990. Président dès 1986 de la Fédération nationale des mutuelles de fonctionnaires et agents de l’État (FNMFAE), qui s’appellera deux ans plus tard Mutualité de la Fonction Publique (MFP), il aura en charge le Centre Médico-Chirurgical (CMC) de la Porte de Choisy. Il présidera la MFP de 1986 à 1992. En 1987, il créera, à partir du service d’Étude et de Recherche Appliquée du CMC, la Fondation de l’Avenir pour la Recherche Médicale Appliquée, reconnue d’utilité publique, qu’il présidera jusqu’en 2001. En 1991, il organisera le rapprochement de l’Hôpital International de l’Université de Paris avec le Centre de la Porte de Choisy, pour édifier en 1998, l’Institut Mutualiste Montsouris, dont il est à l’origine. En 1986, il fut élu vice-président et membre du comité directeur de la FNMF, dont il intégra le conseil d’administration en 1979. En juin 1992, il succèdera à René Teulade, nommé ministre des Affaires sociales et de l’intégration, à la présidence de la FNMF. La Mutualité française protège vingt-cinq millions de personnes en France et représente le premier mouvement social du pays. Il sera réélu à la tête de la FNMF en 1998, puis en juin 2004 jusqu’en 2010. En juin 2011, après avoir quitté en décembre 2010 la FNMF, qu’il avait présidée durant dix-huit ans, il prendra la présidence de la Mutuelle des sportifs (MDS). Il avait accepté ce poste au nom de son engagement dans le monde sportif. En 2011, amateur de sport, ex-joueur de rugby, il prit la présidence du Tarbes Pyrénées Rugby (TPR), apportant de par ses relations, de gros sponsors nationaux comme la Matmut, Essilor, la Mutualité Française et dont il démissionnera en 2016, ayant en 2013 passé la main à Antoine Nunès. En février 2013, il démissionnera de la présidence de la Mutuelle des sportifs (MDS). Il fut également P-DG de l’IMAPS, une société anonyme créée en octobre 2010 par la FNMF, à l’issue de son congrès de 2009, pour valoriser l’apport de l’activité physique pour la santé, dans le cadre notamment des maladies chroniques. Cette création lui permettant de réunir ses deux « passions » à travers la promotion de la santé par l’activité physique et sportive. Membre du premier Conseil national du sida, il préside depuis 2010 le conseil de surveillance de la Fondation Gustave Roussy de recherche sur le cancer, succédant à Simone Veil. En 2001, il présida le Comité National de liaison des activités mutualistes, coopératives et associatives (CNLAMCA), devenu en octobre 2001, le CEGES (Conseil des Entreprises et des Groupements de l’Économie Sociale). Il fut également membre du Comité directeur de l’Association Internationale de la Mutualité (AIM), membre du bureau du Conseil économique et social et de la commission des comptes de la santé. Il fut également vice-président de la Matmut. En 1994, lors de son congrès national à Bayonne, la Mutualité Française élabora une « charte pour la protection sociale en l’an 2000 ». Les congrès de Lille (1997) et Paris (2000) confirmèrent un mouvement en marche pour affronter ses réformes internes et celles qui s’imposaient à la société française tout entière pour préserver un système de santé performant, accessible à tous. Ses réformes internes avaient été initiées par l’application des directives européennes à la Mutualité Française. En 2001, elles avaient conduit à une réécriture du Code de la Mutualité. FNMF et FMF (Fédération des mutuelles de France), sœurs ennemies depuis 1976, y avaient collaboré étroitement. Les deux fédérations ensemble avaient réussi à surmonter cette difficulté et se trouvèrent à nouveau réunies. En juin 2003, lors du XXXVIIème congrès de la Mutualité à Toulouse, en présence de Philippe Douste-Blazy, il proposa aux congressistes le texte d’une résolution présentant vingt-cinq mesures concrètes destinées à « sauver la Sécurité sociale » et à réduire les inégalités de santé. Elle fut votée à l’unanimité. Depuis, campagnes de presse et mobilisations nationales diverses se succédèrent pour peser sur le gouvernement. Il positionna la Mutualité en acteur incontournable de l’un des plus grands débats nationaux de ce début du XXIème siècle. Par ailleurs, il est l’auteur de trois ouvrages : Santé, le moment de vérité (1996), Notre santé n’est pas un commerce (2000) et La Révolution médicale, écrit avec les professeurs Thomas Tursz et Guy Vallancien (2003). Jean-Pierre Davant est décédé le 30 septembre 2024, à l’âge de 79 ans. Les funérailles ont été célébrées au cimetière de Trébons (65200), le samedi 05 octobre 2024.DE GERMAY Olivier (1960-XXXX)
Archevêque de Lyon et ancien capitaine au 1er régiment de Hussards parachutistes de Tarbes
 Olivier DE GERMAY, né le 18 septembre 1960 à Tours, il présente l’originalité d'avoir été militaire comme son père pendant dix ans. Avant d’embrasser la prêtrise, il était officier au 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes et participe notamment à la première Guerre du Golfe, au Koweït. Il est le troisième d'une fratrie de cinq enfants. Fils de Christian de Germay, général de division, commandeur de la Légion d'honneur, et de Claude Bullier. Après des études en classes préparatoires au Prytanée national militaire de La Flèche, il intègre l’École spéciale militaire de Saint-Cyr à Coëtquidan (promotion Grande Armée, 1981-1983), d’où il en est sorti officier en 1983 avec un diplôme d'ingénieur militaire. À sa sortie de l’école spéciale militaire, il choisira l’arme blindée et cavalerie et servira comme officier au prestigieux 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes. Prenant vite du galon et devenu officier au sein du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes, il a notamment servi au Tchad, en Centrafrique, en Irak et au Koweït. Doté de facilités intellectuelles indéniables, n’ayant peur de rien, grand sportif il a le goût du risque, ce qui l’a entraîné à l’époque où il était à Tarbes, à escalader la face nord du Vignemale. Parachutiste, parapentiste et excellent jockey amateur, il faisait des courses d’obstacles et d’endurance à moto. C'est au cœur de l'Afrique qu'il perçoit en lui l'écho d'un appel. "J'ai vécu quelques jours dans le désert. J'y ai rencontré des gens qui vivaient avec trois fois rien et qui étaient plus heureux que moi. Des gens qui exhalaient une paix intérieure, alors que j'étais aux prises avec des sensations diffuses de mal-être", s'est-il souvenu en 2012 auprès de Corse Matin avant de poursuivre : "J'ai pris brutalement conscience qu'en menant une vie centrée sur moi-même, je m'éloignais de l'essentiel. À ce moment-là, je ne pensais pas devenir prêtre, j'avais seulement le désir irrépressible de changer de vie…" Ce séjour dans le désert ne suffit donc pas à en faire un religieux mais dès son retour en France à la Toussaint 1990, il accomplit une retraite entre les murs de l'abbaye bénédictine de Fontgombault. Il tranche, ou plutôt qu'on l'aide à trancher. "C'est là que le Seigneur m'attendait. Le troisième jour, le moine avec qui j'avais beaucoup parlé m'a dit que j'avais la vocation". Olivier de Germay est entré tard au séminaire. C’est à 30 ans qu’il découvre sa vocation et rejoint en 1991 le Séminaire de Paray-le-Monial, puis le Séminaire universitaire Pie XI et l'Institut catholique à Toulouse, et enfin le Séminaire français de Rome. Le 17 mai 1998, jour de son ordination sacerdotale, nombreux sont ses camarades capitaines présents dans l’église. Mais passé son ordination de prêtre ce 17 mai 1998 auprès de l'archidiocèse de Toulouse, il obtient une licence de théologie morale à l'Institut pontifical Jean-Paul II de Rome en 1999. Ensuite il a connu une trajectoire météorique exerçant divers ministères dans le diocèse de Toulouse : vicaire puis curé de Castanet-Tolosan entre 1999 et 2006, aumônier diocésain des Guides de France en parallèle entre 1999 et 2001, doyen de la zone "Banlieues-Sud" de Toulouse entre 2003 et 2006, il est ensuite prêtre de Beauzelle jusqu'en 2012 et vicaire épiscopal (2004-2012) dans le diocèse de Toulouse en charge des banlieues, professeur de théologie sacramentelle et de la famille à l’Institut catholique de Toulouse, doyen de Blagnac (2009-2012). Jusqu’ici vicaire épiscopal, le 24 juin 2012, il est nommé à 52 ans évêque d'Ajaccio par le pape Benoît XVI succédant comme évêque de ce diocèse à Monseigneur Jean-Luc Brunin, nommé évêque du Havre. Ainsi en 2012, celui qui a aussi été désigné doyen de Blagnac quitte la Haute-Garonne pour Ajaccio et sa première mitre. Il reçoit la consécration épiscopale le 14 avril 2012 des mains de Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille, au cours d'une cérémonie à Ajaccio qui réunit environ trois mille personnes. C'est la deuxième consécration d'un évêque en titre sur le sol corse depuis 1802. À l'échelon national, il intègre la commission pour la catéchèse et le catéchuménat (la préparation à la confirmation pour les adultes déjà baptisés) mais aussi le groupe de travail consacré aux réflexions bioéthiques. Pour mémoire, Mgr André Lacrampe, né à Agos-Vidalos dans les Hautes-Pyrénées, et qui figure sur ce site, fut également évêque d’Ajaccio de 1995 à 2003 avant d’être nommé le 13 juin 2003, archevêque de Besançon, par le pape Jean-Paul II. Le 22 octobre 2020, le pape François a nommé, Monseigneur Olivier de Germay, le discret évêque de Corse, à la tête de l’archidiocèse de Lyon, succédant ainsi au cardinal Barbarin. Le nouveau primat des Gaules prendra possession de son siège en la cathédrale Saint-Jean, appelée aussi Primatiale St Jean, le 20 décembre 2020, occupant désormais l’une des fonctions les plus importantes et convoitées de l’Église de France. Monseigneur Olivier de Germay a toujours été ferme sur les questions sociétales et avait participé notamment à la grande "manif pour tous" du 13 janvier 2013. Son frère Benoît de Germay est neurochirurgien à la clinique de l’Union à Saint-Jean (31).
Olivier DE GERMAY, né le 18 septembre 1960 à Tours, il présente l’originalité d'avoir été militaire comme son père pendant dix ans. Avant d’embrasser la prêtrise, il était officier au 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes et participe notamment à la première Guerre du Golfe, au Koweït. Il est le troisième d'une fratrie de cinq enfants. Fils de Christian de Germay, général de division, commandeur de la Légion d'honneur, et de Claude Bullier. Après des études en classes préparatoires au Prytanée national militaire de La Flèche, il intègre l’École spéciale militaire de Saint-Cyr à Coëtquidan (promotion Grande Armée, 1981-1983), d’où il en est sorti officier en 1983 avec un diplôme d'ingénieur militaire. À sa sortie de l’école spéciale militaire, il choisira l’arme blindée et cavalerie et servira comme officier au prestigieux 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes. Prenant vite du galon et devenu officier au sein du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes, il a notamment servi au Tchad, en Centrafrique, en Irak et au Koweït. Doté de facilités intellectuelles indéniables, n’ayant peur de rien, grand sportif il a le goût du risque, ce qui l’a entraîné à l’époque où il était à Tarbes, à escalader la face nord du Vignemale. Parachutiste, parapentiste et excellent jockey amateur, il faisait des courses d’obstacles et d’endurance à moto. C'est au cœur de l'Afrique qu'il perçoit en lui l'écho d'un appel. "J'ai vécu quelques jours dans le désert. J'y ai rencontré des gens qui vivaient avec trois fois rien et qui étaient plus heureux que moi. Des gens qui exhalaient une paix intérieure, alors que j'étais aux prises avec des sensations diffuses de mal-être", s'est-il souvenu en 2012 auprès de Corse Matin avant de poursuivre : "J'ai pris brutalement conscience qu'en menant une vie centrée sur moi-même, je m'éloignais de l'essentiel. À ce moment-là, je ne pensais pas devenir prêtre, j'avais seulement le désir irrépressible de changer de vie…" Ce séjour dans le désert ne suffit donc pas à en faire un religieux mais dès son retour en France à la Toussaint 1990, il accomplit une retraite entre les murs de l'abbaye bénédictine de Fontgombault. Il tranche, ou plutôt qu'on l'aide à trancher. "C'est là que le Seigneur m'attendait. Le troisième jour, le moine avec qui j'avais beaucoup parlé m'a dit que j'avais la vocation". Olivier de Germay est entré tard au séminaire. C’est à 30 ans qu’il découvre sa vocation et rejoint en 1991 le Séminaire de Paray-le-Monial, puis le Séminaire universitaire Pie XI et l'Institut catholique à Toulouse, et enfin le Séminaire français de Rome. Le 17 mai 1998, jour de son ordination sacerdotale, nombreux sont ses camarades capitaines présents dans l’église. Mais passé son ordination de prêtre ce 17 mai 1998 auprès de l'archidiocèse de Toulouse, il obtient une licence de théologie morale à l'Institut pontifical Jean-Paul II de Rome en 1999. Ensuite il a connu une trajectoire météorique exerçant divers ministères dans le diocèse de Toulouse : vicaire puis curé de Castanet-Tolosan entre 1999 et 2006, aumônier diocésain des Guides de France en parallèle entre 1999 et 2001, doyen de la zone "Banlieues-Sud" de Toulouse entre 2003 et 2006, il est ensuite prêtre de Beauzelle jusqu'en 2012 et vicaire épiscopal (2004-2012) dans le diocèse de Toulouse en charge des banlieues, professeur de théologie sacramentelle et de la famille à l’Institut catholique de Toulouse, doyen de Blagnac (2009-2012). Jusqu’ici vicaire épiscopal, le 24 juin 2012, il est nommé à 52 ans évêque d'Ajaccio par le pape Benoît XVI succédant comme évêque de ce diocèse à Monseigneur Jean-Luc Brunin, nommé évêque du Havre. Ainsi en 2012, celui qui a aussi été désigné doyen de Blagnac quitte la Haute-Garonne pour Ajaccio et sa première mitre. Il reçoit la consécration épiscopale le 14 avril 2012 des mains de Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille, au cours d'une cérémonie à Ajaccio qui réunit environ trois mille personnes. C'est la deuxième consécration d'un évêque en titre sur le sol corse depuis 1802. À l'échelon national, il intègre la commission pour la catéchèse et le catéchuménat (la préparation à la confirmation pour les adultes déjà baptisés) mais aussi le groupe de travail consacré aux réflexions bioéthiques. Pour mémoire, Mgr André Lacrampe, né à Agos-Vidalos dans les Hautes-Pyrénées, et qui figure sur ce site, fut également évêque d’Ajaccio de 1995 à 2003 avant d’être nommé le 13 juin 2003, archevêque de Besançon, par le pape Jean-Paul II. Le 22 octobre 2020, le pape François a nommé, Monseigneur Olivier de Germay, le discret évêque de Corse, à la tête de l’archidiocèse de Lyon, succédant ainsi au cardinal Barbarin. Le nouveau primat des Gaules prendra possession de son siège en la cathédrale Saint-Jean, appelée aussi Primatiale St Jean, le 20 décembre 2020, occupant désormais l’une des fonctions les plus importantes et convoitées de l’Église de France. Monseigneur Olivier de Germay a toujours été ferme sur les questions sociétales et avait participé notamment à la grande "manif pour tous" du 13 janvier 2013. Son frère Benoît de Germay est neurochirurgien à la clinique de l’Union à Saint-Jean (31).
 Olivier DE GERMAY, né le 18 septembre 1960 à Tours, il présente l’originalité d'avoir été militaire comme son père pendant dix ans. Avant d’embrasser la prêtrise, il était officier au 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes et participe notamment à la première Guerre du Golfe, au Koweït. Il est le troisième d'une fratrie de cinq enfants. Fils de Christian de Germay, général de division, commandeur de la Légion d'honneur, et de Claude Bullier. Après des études en classes préparatoires au Prytanée national militaire de La Flèche, il intègre l’École spéciale militaire de Saint-Cyr à Coëtquidan (promotion Grande Armée, 1981-1983), d’où il en est sorti officier en 1983 avec un diplôme d'ingénieur militaire. À sa sortie de l’école spéciale militaire, il choisira l’arme blindée et cavalerie et servira comme officier au prestigieux 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes. Prenant vite du galon et devenu officier au sein du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes, il a notamment servi au Tchad, en Centrafrique, en Irak et au Koweït. Doté de facilités intellectuelles indéniables, n’ayant peur de rien, grand sportif il a le goût du risque, ce qui l’a entraîné à l’époque où il était à Tarbes, à escalader la face nord du Vignemale. Parachutiste, parapentiste et excellent jockey amateur, il faisait des courses d’obstacles et d’endurance à moto. C'est au cœur de l'Afrique qu'il perçoit en lui l'écho d'un appel. "J'ai vécu quelques jours dans le désert. J'y ai rencontré des gens qui vivaient avec trois fois rien et qui étaient plus heureux que moi. Des gens qui exhalaient une paix intérieure, alors que j'étais aux prises avec des sensations diffuses de mal-être", s'est-il souvenu en 2012 auprès de Corse Matin avant de poursuivre : "J'ai pris brutalement conscience qu'en menant une vie centrée sur moi-même, je m'éloignais de l'essentiel. À ce moment-là, je ne pensais pas devenir prêtre, j'avais seulement le désir irrépressible de changer de vie…" Ce séjour dans le désert ne suffit donc pas à en faire un religieux mais dès son retour en France à la Toussaint 1990, il accomplit une retraite entre les murs de l'abbaye bénédictine de Fontgombault. Il tranche, ou plutôt qu'on l'aide à trancher. "C'est là que le Seigneur m'attendait. Le troisième jour, le moine avec qui j'avais beaucoup parlé m'a dit que j'avais la vocation". Olivier de Germay est entré tard au séminaire. C’est à 30 ans qu’il découvre sa vocation et rejoint en 1991 le Séminaire de Paray-le-Monial, puis le Séminaire universitaire Pie XI et l'Institut catholique à Toulouse, et enfin le Séminaire français de Rome. Le 17 mai 1998, jour de son ordination sacerdotale, nombreux sont ses camarades capitaines présents dans l’église. Mais passé son ordination de prêtre ce 17 mai 1998 auprès de l'archidiocèse de Toulouse, il obtient une licence de théologie morale à l'Institut pontifical Jean-Paul II de Rome en 1999. Ensuite il a connu une trajectoire météorique exerçant divers ministères dans le diocèse de Toulouse : vicaire puis curé de Castanet-Tolosan entre 1999 et 2006, aumônier diocésain des Guides de France en parallèle entre 1999 et 2001, doyen de la zone "Banlieues-Sud" de Toulouse entre 2003 et 2006, il est ensuite prêtre de Beauzelle jusqu'en 2012 et vicaire épiscopal (2004-2012) dans le diocèse de Toulouse en charge des banlieues, professeur de théologie sacramentelle et de la famille à l’Institut catholique de Toulouse, doyen de Blagnac (2009-2012). Jusqu’ici vicaire épiscopal, le 24 juin 2012, il est nommé à 52 ans évêque d'Ajaccio par le pape Benoît XVI succédant comme évêque de ce diocèse à Monseigneur Jean-Luc Brunin, nommé évêque du Havre. Ainsi en 2012, celui qui a aussi été désigné doyen de Blagnac quitte la Haute-Garonne pour Ajaccio et sa première mitre. Il reçoit la consécration épiscopale le 14 avril 2012 des mains de Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille, au cours d'une cérémonie à Ajaccio qui réunit environ trois mille personnes. C'est la deuxième consécration d'un évêque en titre sur le sol corse depuis 1802. À l'échelon national, il intègre la commission pour la catéchèse et le catéchuménat (la préparation à la confirmation pour les adultes déjà baptisés) mais aussi le groupe de travail consacré aux réflexions bioéthiques. Pour mémoire, Mgr André Lacrampe, né à Agos-Vidalos dans les Hautes-Pyrénées, et qui figure sur ce site, fut également évêque d’Ajaccio de 1995 à 2003 avant d’être nommé le 13 juin 2003, archevêque de Besançon, par le pape Jean-Paul II. Le 22 octobre 2020, le pape François a nommé, Monseigneur Olivier de Germay, le discret évêque de Corse, à la tête de l’archidiocèse de Lyon, succédant ainsi au cardinal Barbarin. Le nouveau primat des Gaules prendra possession de son siège en la cathédrale Saint-Jean, appelée aussi Primatiale St Jean, le 20 décembre 2020, occupant désormais l’une des fonctions les plus importantes et convoitées de l’Église de France. Monseigneur Olivier de Germay a toujours été ferme sur les questions sociétales et avait participé notamment à la grande "manif pour tous" du 13 janvier 2013. Son frère Benoît de Germay est neurochirurgien à la clinique de l’Union à Saint-Jean (31).
Olivier DE GERMAY, né le 18 septembre 1960 à Tours, il présente l’originalité d'avoir été militaire comme son père pendant dix ans. Avant d’embrasser la prêtrise, il était officier au 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes et participe notamment à la première Guerre du Golfe, au Koweït. Il est le troisième d'une fratrie de cinq enfants. Fils de Christian de Germay, général de division, commandeur de la Légion d'honneur, et de Claude Bullier. Après des études en classes préparatoires au Prytanée national militaire de La Flèche, il intègre l’École spéciale militaire de Saint-Cyr à Coëtquidan (promotion Grande Armée, 1981-1983), d’où il en est sorti officier en 1983 avec un diplôme d'ingénieur militaire. À sa sortie de l’école spéciale militaire, il choisira l’arme blindée et cavalerie et servira comme officier au prestigieux 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes. Prenant vite du galon et devenu officier au sein du 1er régiment de hussards parachutistes de Tarbes, il a notamment servi au Tchad, en Centrafrique, en Irak et au Koweït. Doté de facilités intellectuelles indéniables, n’ayant peur de rien, grand sportif il a le goût du risque, ce qui l’a entraîné à l’époque où il était à Tarbes, à escalader la face nord du Vignemale. Parachutiste, parapentiste et excellent jockey amateur, il faisait des courses d’obstacles et d’endurance à moto. C'est au cœur de l'Afrique qu'il perçoit en lui l'écho d'un appel. "J'ai vécu quelques jours dans le désert. J'y ai rencontré des gens qui vivaient avec trois fois rien et qui étaient plus heureux que moi. Des gens qui exhalaient une paix intérieure, alors que j'étais aux prises avec des sensations diffuses de mal-être", s'est-il souvenu en 2012 auprès de Corse Matin avant de poursuivre : "J'ai pris brutalement conscience qu'en menant une vie centrée sur moi-même, je m'éloignais de l'essentiel. À ce moment-là, je ne pensais pas devenir prêtre, j'avais seulement le désir irrépressible de changer de vie…" Ce séjour dans le désert ne suffit donc pas à en faire un religieux mais dès son retour en France à la Toussaint 1990, il accomplit une retraite entre les murs de l'abbaye bénédictine de Fontgombault. Il tranche, ou plutôt qu'on l'aide à trancher. "C'est là que le Seigneur m'attendait. Le troisième jour, le moine avec qui j'avais beaucoup parlé m'a dit que j'avais la vocation". Olivier de Germay est entré tard au séminaire. C’est à 30 ans qu’il découvre sa vocation et rejoint en 1991 le Séminaire de Paray-le-Monial, puis le Séminaire universitaire Pie XI et l'Institut catholique à Toulouse, et enfin le Séminaire français de Rome. Le 17 mai 1998, jour de son ordination sacerdotale, nombreux sont ses camarades capitaines présents dans l’église. Mais passé son ordination de prêtre ce 17 mai 1998 auprès de l'archidiocèse de Toulouse, il obtient une licence de théologie morale à l'Institut pontifical Jean-Paul II de Rome en 1999. Ensuite il a connu une trajectoire météorique exerçant divers ministères dans le diocèse de Toulouse : vicaire puis curé de Castanet-Tolosan entre 1999 et 2006, aumônier diocésain des Guides de France en parallèle entre 1999 et 2001, doyen de la zone "Banlieues-Sud" de Toulouse entre 2003 et 2006, il est ensuite prêtre de Beauzelle jusqu'en 2012 et vicaire épiscopal (2004-2012) dans le diocèse de Toulouse en charge des banlieues, professeur de théologie sacramentelle et de la famille à l’Institut catholique de Toulouse, doyen de Blagnac (2009-2012). Jusqu’ici vicaire épiscopal, le 24 juin 2012, il est nommé à 52 ans évêque d'Ajaccio par le pape Benoît XVI succédant comme évêque de ce diocèse à Monseigneur Jean-Luc Brunin, nommé évêque du Havre. Ainsi en 2012, celui qui a aussi été désigné doyen de Blagnac quitte la Haute-Garonne pour Ajaccio et sa première mitre. Il reçoit la consécration épiscopale le 14 avril 2012 des mains de Monseigneur Georges Pontier, archevêque de Marseille, au cours d'une cérémonie à Ajaccio qui réunit environ trois mille personnes. C'est la deuxième consécration d'un évêque en titre sur le sol corse depuis 1802. À l'échelon national, il intègre la commission pour la catéchèse et le catéchuménat (la préparation à la confirmation pour les adultes déjà baptisés) mais aussi le groupe de travail consacré aux réflexions bioéthiques. Pour mémoire, Mgr André Lacrampe, né à Agos-Vidalos dans les Hautes-Pyrénées, et qui figure sur ce site, fut également évêque d’Ajaccio de 1995 à 2003 avant d’être nommé le 13 juin 2003, archevêque de Besançon, par le pape Jean-Paul II. Le 22 octobre 2020, le pape François a nommé, Monseigneur Olivier de Germay, le discret évêque de Corse, à la tête de l’archidiocèse de Lyon, succédant ainsi au cardinal Barbarin. Le nouveau primat des Gaules prendra possession de son siège en la cathédrale Saint-Jean, appelée aussi Primatiale St Jean, le 20 décembre 2020, occupant désormais l’une des fonctions les plus importantes et convoitées de l’Église de France. Monseigneur Olivier de Germay a toujours été ferme sur les questions sociétales et avait participé notamment à la grande "manif pour tous" du 13 janvier 2013. Son frère Benoît de Germay est neurochirurgien à la clinique de l’Union à Saint-Jean (31).DE LE RUE Paul-Henri (1984-XXXX)
Snowboarder médaillé olympique
 Paul-Henri DE LE RUE, alias "Polo", né le 17 avril 1984 à Lannemezan, est un spécialiste du snowboardcross. Il a 8 ans lorsqu'il découvre le snowboard. En 2004, il devient champion du monde junior. Deux ans plus tard, en 2006, aux Jeux olympiques de Turin, il remporte la médaille de bronze dans cette discipline. Il est six fois sur le podium lors de différentes étapes de coupes du Monde, entre 2005 et 2011. En 2010, aux JO de Vancouver au Canada, il obtiendra la 25e place. Cette même année, il intègrera le dispositif Athlètes SNCF à Toulouse, en tant que chargé de communication. En contrat d'insertion professionnelle, il rejoint ainsi les 24 athlètes de haut niveau déjà en poste dans l'entreprise, dont son frère. Son palmarès : en 2004, médaille d'or Junior ; en 2006, à 21 ans, médaillé de bronze en snowboardcross aux JO de Turin en Italie ; en 2007, il est 5e au Championnat du monde à Arosa en Suisse. Il aura remporté 2 médailles d’argent et 4 médailles de bronze en coupe du Monde, 1 médaille de bronze en coupe d’Europe en 2004 à Moelltaler Gletscher en Autriche et il aura été trois fois médaillé d’argent (2006, 2012, 2013) en Championnat de France. En 2014, aux JO de Sotchi, un mois après un grave accident, il décrochera une 4e place héroïque en finale du snowboardcross. Une performance exceptionnelle, qui viendra compléter son histoire olympique débutée par une médaille à Turin. En 2014, alors qu'il participait à une manche de la coupe du Monde de snowboardcross à Vallnord en Andorre, il avait lourdement chuté et avait dû être placé en coma artificiel au CHU de Toulouse. Du coma aux Jeux, il y avait 34 jours, et soutenu par sa compagne, il releva le défi de disputer ces JO. En 2015, il mettra un terme à sa carrière de sportif de haut niveau. Il se lancera alors dans une carrière de conférencier dans le monde du sport et en entreprise inspirée par son propre parcours et son envie d'aider : « de l'émotion à la performance », intitulé des conférences qu’il anime, se servant de ses expériences sportives. En tant qu'athlète, il ne fut jamais le meilleur techniquement ou physiquement, mais avait très souvent su faire de ses émotions un levier de performance. La gestion du doute, du changement, de l'imprévu, du risque et de la motivation sont des thèmes qui jalonnent sa réflexion. Lors de ses conférences, il part de l'émotion pour arriver à une performance individuelle et collective. Et dans ses débats il explique que « dépasser ses peurs, c’est oser être soi-même ». Il n’en oublie pas ses premiers amours puisqu’il organise aussi des séjours " freeride " dans les Pyrénées. En 2017, il participa aux deux premières étapes du World Tour de free-ride, une discipline dans laquelle son frère Xavier avait été cinq fois champion du monde, sur les lieux même de son accident en Andorre. Chez les De Le Rue, à Saint-Lary, on ne compte plus les titres de champions de Xavier, François, Sabine, Henri et Victor, les enfants de Christiane et Thierry De Le Rue, commerçants d'articles de sports dans la station auroise. Victor l'un des meilleurs spécialistes mondiaux du snowboard backcountry, champion de France cadet en free-style, Xavier snowboardeur multiple champion du monde en snowboard cross et free-ride, Sabine elle aussi titrée en 1998 vice-championne du monde cadette et François l'aîné du clan vainqueur en 2001 du Grand Raid Chamonix de free-ride. Aujourd’hui, conférencier et coach, Paul-Henri De Le Rue propose des outils de développement personnel pour définir et atteindre ses objectifs, gagner en leadership. En un mot, devenir une meilleure personne. Voici le récit d’une histoire hors norme , celle de l’aventure olympique, gravée dans un livre écrit par Claire Benoit, intitulé « Paul-Henri De Le Rue - Aller au bout de ses rêves – de l’émotion à la performance », paru le 17 décembre 2019, chez Atlantica Editions.
Paul-Henri DE LE RUE, alias "Polo", né le 17 avril 1984 à Lannemezan, est un spécialiste du snowboardcross. Il a 8 ans lorsqu'il découvre le snowboard. En 2004, il devient champion du monde junior. Deux ans plus tard, en 2006, aux Jeux olympiques de Turin, il remporte la médaille de bronze dans cette discipline. Il est six fois sur le podium lors de différentes étapes de coupes du Monde, entre 2005 et 2011. En 2010, aux JO de Vancouver au Canada, il obtiendra la 25e place. Cette même année, il intègrera le dispositif Athlètes SNCF à Toulouse, en tant que chargé de communication. En contrat d'insertion professionnelle, il rejoint ainsi les 24 athlètes de haut niveau déjà en poste dans l'entreprise, dont son frère. Son palmarès : en 2004, médaille d'or Junior ; en 2006, à 21 ans, médaillé de bronze en snowboardcross aux JO de Turin en Italie ; en 2007, il est 5e au Championnat du monde à Arosa en Suisse. Il aura remporté 2 médailles d’argent et 4 médailles de bronze en coupe du Monde, 1 médaille de bronze en coupe d’Europe en 2004 à Moelltaler Gletscher en Autriche et il aura été trois fois médaillé d’argent (2006, 2012, 2013) en Championnat de France. En 2014, aux JO de Sotchi, un mois après un grave accident, il décrochera une 4e place héroïque en finale du snowboardcross. Une performance exceptionnelle, qui viendra compléter son histoire olympique débutée par une médaille à Turin. En 2014, alors qu'il participait à une manche de la coupe du Monde de snowboardcross à Vallnord en Andorre, il avait lourdement chuté et avait dû être placé en coma artificiel au CHU de Toulouse. Du coma aux Jeux, il y avait 34 jours, et soutenu par sa compagne, il releva le défi de disputer ces JO. En 2015, il mettra un terme à sa carrière de sportif de haut niveau. Il se lancera alors dans une carrière de conférencier dans le monde du sport et en entreprise inspirée par son propre parcours et son envie d'aider : « de l'émotion à la performance », intitulé des conférences qu’il anime, se servant de ses expériences sportives. En tant qu'athlète, il ne fut jamais le meilleur techniquement ou physiquement, mais avait très souvent su faire de ses émotions un levier de performance. La gestion du doute, du changement, de l'imprévu, du risque et de la motivation sont des thèmes qui jalonnent sa réflexion. Lors de ses conférences, il part de l'émotion pour arriver à une performance individuelle et collective. Et dans ses débats il explique que « dépasser ses peurs, c’est oser être soi-même ». Il n’en oublie pas ses premiers amours puisqu’il organise aussi des séjours " freeride " dans les Pyrénées. En 2017, il participa aux deux premières étapes du World Tour de free-ride, une discipline dans laquelle son frère Xavier avait été cinq fois champion du monde, sur les lieux même de son accident en Andorre. Chez les De Le Rue, à Saint-Lary, on ne compte plus les titres de champions de Xavier, François, Sabine, Henri et Victor, les enfants de Christiane et Thierry De Le Rue, commerçants d'articles de sports dans la station auroise. Victor l'un des meilleurs spécialistes mondiaux du snowboard backcountry, champion de France cadet en free-style, Xavier snowboardeur multiple champion du monde en snowboard cross et free-ride, Sabine elle aussi titrée en 1998 vice-championne du monde cadette et François l'aîné du clan vainqueur en 2001 du Grand Raid Chamonix de free-ride. Aujourd’hui, conférencier et coach, Paul-Henri De Le Rue propose des outils de développement personnel pour définir et atteindre ses objectifs, gagner en leadership. En un mot, devenir une meilleure personne. Voici le récit d’une histoire hors norme , celle de l’aventure olympique, gravée dans un livre écrit par Claire Benoit, intitulé « Paul-Henri De Le Rue - Aller au bout de ses rêves – de l’émotion à la performance », paru le 17 décembre 2019, chez Atlantica Editions.
 Paul-Henri DE LE RUE, alias "Polo", né le 17 avril 1984 à Lannemezan, est un spécialiste du snowboardcross. Il a 8 ans lorsqu'il découvre le snowboard. En 2004, il devient champion du monde junior. Deux ans plus tard, en 2006, aux Jeux olympiques de Turin, il remporte la médaille de bronze dans cette discipline. Il est six fois sur le podium lors de différentes étapes de coupes du Monde, entre 2005 et 2011. En 2010, aux JO de Vancouver au Canada, il obtiendra la 25e place. Cette même année, il intègrera le dispositif Athlètes SNCF à Toulouse, en tant que chargé de communication. En contrat d'insertion professionnelle, il rejoint ainsi les 24 athlètes de haut niveau déjà en poste dans l'entreprise, dont son frère. Son palmarès : en 2004, médaille d'or Junior ; en 2006, à 21 ans, médaillé de bronze en snowboardcross aux JO de Turin en Italie ; en 2007, il est 5e au Championnat du monde à Arosa en Suisse. Il aura remporté 2 médailles d’argent et 4 médailles de bronze en coupe du Monde, 1 médaille de bronze en coupe d’Europe en 2004 à Moelltaler Gletscher en Autriche et il aura été trois fois médaillé d’argent (2006, 2012, 2013) en Championnat de France. En 2014, aux JO de Sotchi, un mois après un grave accident, il décrochera une 4e place héroïque en finale du snowboardcross. Une performance exceptionnelle, qui viendra compléter son histoire olympique débutée par une médaille à Turin. En 2014, alors qu'il participait à une manche de la coupe du Monde de snowboardcross à Vallnord en Andorre, il avait lourdement chuté et avait dû être placé en coma artificiel au CHU de Toulouse. Du coma aux Jeux, il y avait 34 jours, et soutenu par sa compagne, il releva le défi de disputer ces JO. En 2015, il mettra un terme à sa carrière de sportif de haut niveau. Il se lancera alors dans une carrière de conférencier dans le monde du sport et en entreprise inspirée par son propre parcours et son envie d'aider : « de l'émotion à la performance », intitulé des conférences qu’il anime, se servant de ses expériences sportives. En tant qu'athlète, il ne fut jamais le meilleur techniquement ou physiquement, mais avait très souvent su faire de ses émotions un levier de performance. La gestion du doute, du changement, de l'imprévu, du risque et de la motivation sont des thèmes qui jalonnent sa réflexion. Lors de ses conférences, il part de l'émotion pour arriver à une performance individuelle et collective. Et dans ses débats il explique que « dépasser ses peurs, c’est oser être soi-même ». Il n’en oublie pas ses premiers amours puisqu’il organise aussi des séjours " freeride " dans les Pyrénées. En 2017, il participa aux deux premières étapes du World Tour de free-ride, une discipline dans laquelle son frère Xavier avait été cinq fois champion du monde, sur les lieux même de son accident en Andorre. Chez les De Le Rue, à Saint-Lary, on ne compte plus les titres de champions de Xavier, François, Sabine, Henri et Victor, les enfants de Christiane et Thierry De Le Rue, commerçants d'articles de sports dans la station auroise. Victor l'un des meilleurs spécialistes mondiaux du snowboard backcountry, champion de France cadet en free-style, Xavier snowboardeur multiple champion du monde en snowboard cross et free-ride, Sabine elle aussi titrée en 1998 vice-championne du monde cadette et François l'aîné du clan vainqueur en 2001 du Grand Raid Chamonix de free-ride. Aujourd’hui, conférencier et coach, Paul-Henri De Le Rue propose des outils de développement personnel pour définir et atteindre ses objectifs, gagner en leadership. En un mot, devenir une meilleure personne. Voici le récit d’une histoire hors norme , celle de l’aventure olympique, gravée dans un livre écrit par Claire Benoit, intitulé « Paul-Henri De Le Rue - Aller au bout de ses rêves – de l’émotion à la performance », paru le 17 décembre 2019, chez Atlantica Editions.
Paul-Henri DE LE RUE, alias "Polo", né le 17 avril 1984 à Lannemezan, est un spécialiste du snowboardcross. Il a 8 ans lorsqu'il découvre le snowboard. En 2004, il devient champion du monde junior. Deux ans plus tard, en 2006, aux Jeux olympiques de Turin, il remporte la médaille de bronze dans cette discipline. Il est six fois sur le podium lors de différentes étapes de coupes du Monde, entre 2005 et 2011. En 2010, aux JO de Vancouver au Canada, il obtiendra la 25e place. Cette même année, il intègrera le dispositif Athlètes SNCF à Toulouse, en tant que chargé de communication. En contrat d'insertion professionnelle, il rejoint ainsi les 24 athlètes de haut niveau déjà en poste dans l'entreprise, dont son frère. Son palmarès : en 2004, médaille d'or Junior ; en 2006, à 21 ans, médaillé de bronze en snowboardcross aux JO de Turin en Italie ; en 2007, il est 5e au Championnat du monde à Arosa en Suisse. Il aura remporté 2 médailles d’argent et 4 médailles de bronze en coupe du Monde, 1 médaille de bronze en coupe d’Europe en 2004 à Moelltaler Gletscher en Autriche et il aura été trois fois médaillé d’argent (2006, 2012, 2013) en Championnat de France. En 2014, aux JO de Sotchi, un mois après un grave accident, il décrochera une 4e place héroïque en finale du snowboardcross. Une performance exceptionnelle, qui viendra compléter son histoire olympique débutée par une médaille à Turin. En 2014, alors qu'il participait à une manche de la coupe du Monde de snowboardcross à Vallnord en Andorre, il avait lourdement chuté et avait dû être placé en coma artificiel au CHU de Toulouse. Du coma aux Jeux, il y avait 34 jours, et soutenu par sa compagne, il releva le défi de disputer ces JO. En 2015, il mettra un terme à sa carrière de sportif de haut niveau. Il se lancera alors dans une carrière de conférencier dans le monde du sport et en entreprise inspirée par son propre parcours et son envie d'aider : « de l'émotion à la performance », intitulé des conférences qu’il anime, se servant de ses expériences sportives. En tant qu'athlète, il ne fut jamais le meilleur techniquement ou physiquement, mais avait très souvent su faire de ses émotions un levier de performance. La gestion du doute, du changement, de l'imprévu, du risque et de la motivation sont des thèmes qui jalonnent sa réflexion. Lors de ses conférences, il part de l'émotion pour arriver à une performance individuelle et collective. Et dans ses débats il explique que « dépasser ses peurs, c’est oser être soi-même ». Il n’en oublie pas ses premiers amours puisqu’il organise aussi des séjours " freeride " dans les Pyrénées. En 2017, il participa aux deux premières étapes du World Tour de free-ride, une discipline dans laquelle son frère Xavier avait été cinq fois champion du monde, sur les lieux même de son accident en Andorre. Chez les De Le Rue, à Saint-Lary, on ne compte plus les titres de champions de Xavier, François, Sabine, Henri et Victor, les enfants de Christiane et Thierry De Le Rue, commerçants d'articles de sports dans la station auroise. Victor l'un des meilleurs spécialistes mondiaux du snowboard backcountry, champion de France cadet en free-style, Xavier snowboardeur multiple champion du monde en snowboard cross et free-ride, Sabine elle aussi titrée en 1998 vice-championne du monde cadette et François l'aîné du clan vainqueur en 2001 du Grand Raid Chamonix de free-ride. Aujourd’hui, conférencier et coach, Paul-Henri De Le Rue propose des outils de développement personnel pour définir et atteindre ses objectifs, gagner en leadership. En un mot, devenir une meilleure personne. Voici le récit d’une histoire hors norme , celle de l’aventure olympique, gravée dans un livre écrit par Claire Benoit, intitulé « Paul-Henri De Le Rue - Aller au bout de ses rêves – de l’émotion à la performance », paru le 17 décembre 2019, chez Atlantica Editions.DEGOIS Françoise (1964-XXXX)
Journaliste, conseillère politique, écrivain
 Françoise DEGOIS est née le 22 juin 1964 à Lourdes. En 1992, devenue journaliste, elle entre à France Inter, chargée de suivre l'actualité du PS, et elle avait d’ailleurs eu la primauté médiatique sur la séparation du couple Ségolène Royal – François Hollande en 2007. Après avoir pris fait et cause pour Laurent Fabius au moment du référendum sur la Constitution européenne, en 2005, Françoise découvre Ségolène Royal, candidate à la candidature socialiste pour l'élection présidentielle de 2007. Pendant la campagne présidentielle, Françoise Degois ne cache pas son enthousiasme à la fin des meetings, qu'elle couvre pratiquement tous. Et, depuis plus de deux ans, dans ses reportages comme dans le livre d'entretiens qu'elle a écrit avec l'ex-candidate, « Femme debout, éditions Denoël, 2009 », elle ne fait pas mystère de son admiration, ni de sa bienveillance pour la présidente de Poitou-Charentes. Après dix ans à France Inter, où elle assurait des fonctions de chroniqueuse politique et de grande reporter, en charge du PS, il n'est pas surprenant que le 16 novembre 2009 elle rejoigne le cabinet de Ségolène Royal, au titre de "conseillère spéciale au cabinet de la présidence". Elle sera notamment chargée de mettre en place les politiques de civilisations sur lesquelles l'Institut de Recherche Edgar Morin, implanté à Poitiers, a fait de nombreuses propositions. "Une intellectuelle très brillante et très cultivée", dira d’elle Ségolène Royal le 17 novembre 2019, sur Canal +. "Quelqu'un de bien", confirmera-t-elle à L'Express. Cette fonction de conseillère soulèvera bien des critiques dans la presse pointant du doigt la proximité de la journaliste avec certains politiques. Un ralliement susceptible de renforcer les doutes sur l'étanchéité entre médias et politiques. Sa carrière à France Inter lui avait déjà permis en effet de suivre la campagne de Ségolène Royal lors de l'élection présidentielle de 2007 et, par la suite, d'écrire un livre d'entretiens avec cette dernière, ex-candidate PS à la présidentielle. Au début du quinquennat de François Hollande, elle a été la conseillère politique de Guillaume Garot, un proche de Ségolène Royal, ministre délégué à l'Agroalimentaire dans le gouvernement Ayrault. Elle est une des participantes, particulièrement active, de l'émission « Les Grandes Gueules » sur RMC. Elle participe également à l'émission « Langue de bois s'abstenir » sur la chaîne TNT D8. En 2016, avec Romain Goguelin, elle réalise un documentaire sur Najat Vallaud-Belkacem, « La discrète ambitieuse », diffusé sur LCP. Le 31 août 2017, elle intègre l'émission « On refait le monde » sur RTL. Elle participe aussi à l'émission « Le débat » sur LCI. Elle est notamment l’auteure de « Quelle histoire ! Ségolène Royal et François Hollande » paru chez Plon, le 3 juillet 2014, et de « Il faut imaginer Sisyphe heureux - Les 100 derniers jours de François Hollande » paru aux Éditions de l'Observatoire, le 7 juin 2017.
Françoise DEGOIS est née le 22 juin 1964 à Lourdes. En 1992, devenue journaliste, elle entre à France Inter, chargée de suivre l'actualité du PS, et elle avait d’ailleurs eu la primauté médiatique sur la séparation du couple Ségolène Royal – François Hollande en 2007. Après avoir pris fait et cause pour Laurent Fabius au moment du référendum sur la Constitution européenne, en 2005, Françoise découvre Ségolène Royal, candidate à la candidature socialiste pour l'élection présidentielle de 2007. Pendant la campagne présidentielle, Françoise Degois ne cache pas son enthousiasme à la fin des meetings, qu'elle couvre pratiquement tous. Et, depuis plus de deux ans, dans ses reportages comme dans le livre d'entretiens qu'elle a écrit avec l'ex-candidate, « Femme debout, éditions Denoël, 2009 », elle ne fait pas mystère de son admiration, ni de sa bienveillance pour la présidente de Poitou-Charentes. Après dix ans à France Inter, où elle assurait des fonctions de chroniqueuse politique et de grande reporter, en charge du PS, il n'est pas surprenant que le 16 novembre 2009 elle rejoigne le cabinet de Ségolène Royal, au titre de "conseillère spéciale au cabinet de la présidence". Elle sera notamment chargée de mettre en place les politiques de civilisations sur lesquelles l'Institut de Recherche Edgar Morin, implanté à Poitiers, a fait de nombreuses propositions. "Une intellectuelle très brillante et très cultivée", dira d’elle Ségolène Royal le 17 novembre 2019, sur Canal +. "Quelqu'un de bien", confirmera-t-elle à L'Express. Cette fonction de conseillère soulèvera bien des critiques dans la presse pointant du doigt la proximité de la journaliste avec certains politiques. Un ralliement susceptible de renforcer les doutes sur l'étanchéité entre médias et politiques. Sa carrière à France Inter lui avait déjà permis en effet de suivre la campagne de Ségolène Royal lors de l'élection présidentielle de 2007 et, par la suite, d'écrire un livre d'entretiens avec cette dernière, ex-candidate PS à la présidentielle. Au début du quinquennat de François Hollande, elle a été la conseillère politique de Guillaume Garot, un proche de Ségolène Royal, ministre délégué à l'Agroalimentaire dans le gouvernement Ayrault. Elle est une des participantes, particulièrement active, de l'émission « Les Grandes Gueules » sur RMC. Elle participe également à l'émission « Langue de bois s'abstenir » sur la chaîne TNT D8. En 2016, avec Romain Goguelin, elle réalise un documentaire sur Najat Vallaud-Belkacem, « La discrète ambitieuse », diffusé sur LCP. Le 31 août 2017, elle intègre l'émission « On refait le monde » sur RTL. Elle participe aussi à l'émission « Le débat » sur LCI. Elle est notamment l’auteure de « Quelle histoire ! Ségolène Royal et François Hollande » paru chez Plon, le 3 juillet 2014, et de « Il faut imaginer Sisyphe heureux - Les 100 derniers jours de François Hollande » paru aux Éditions de l'Observatoire, le 7 juin 2017.
 Françoise DEGOIS est née le 22 juin 1964 à Lourdes. En 1992, devenue journaliste, elle entre à France Inter, chargée de suivre l'actualité du PS, et elle avait d’ailleurs eu la primauté médiatique sur la séparation du couple Ségolène Royal – François Hollande en 2007. Après avoir pris fait et cause pour Laurent Fabius au moment du référendum sur la Constitution européenne, en 2005, Françoise découvre Ségolène Royal, candidate à la candidature socialiste pour l'élection présidentielle de 2007. Pendant la campagne présidentielle, Françoise Degois ne cache pas son enthousiasme à la fin des meetings, qu'elle couvre pratiquement tous. Et, depuis plus de deux ans, dans ses reportages comme dans le livre d'entretiens qu'elle a écrit avec l'ex-candidate, « Femme debout, éditions Denoël, 2009 », elle ne fait pas mystère de son admiration, ni de sa bienveillance pour la présidente de Poitou-Charentes. Après dix ans à France Inter, où elle assurait des fonctions de chroniqueuse politique et de grande reporter, en charge du PS, il n'est pas surprenant que le 16 novembre 2009 elle rejoigne le cabinet de Ségolène Royal, au titre de "conseillère spéciale au cabinet de la présidence". Elle sera notamment chargée de mettre en place les politiques de civilisations sur lesquelles l'Institut de Recherche Edgar Morin, implanté à Poitiers, a fait de nombreuses propositions. "Une intellectuelle très brillante et très cultivée", dira d’elle Ségolène Royal le 17 novembre 2019, sur Canal +. "Quelqu'un de bien", confirmera-t-elle à L'Express. Cette fonction de conseillère soulèvera bien des critiques dans la presse pointant du doigt la proximité de la journaliste avec certains politiques. Un ralliement susceptible de renforcer les doutes sur l'étanchéité entre médias et politiques. Sa carrière à France Inter lui avait déjà permis en effet de suivre la campagne de Ségolène Royal lors de l'élection présidentielle de 2007 et, par la suite, d'écrire un livre d'entretiens avec cette dernière, ex-candidate PS à la présidentielle. Au début du quinquennat de François Hollande, elle a été la conseillère politique de Guillaume Garot, un proche de Ségolène Royal, ministre délégué à l'Agroalimentaire dans le gouvernement Ayrault. Elle est une des participantes, particulièrement active, de l'émission « Les Grandes Gueules » sur RMC. Elle participe également à l'émission « Langue de bois s'abstenir » sur la chaîne TNT D8. En 2016, avec Romain Goguelin, elle réalise un documentaire sur Najat Vallaud-Belkacem, « La discrète ambitieuse », diffusé sur LCP. Le 31 août 2017, elle intègre l'émission « On refait le monde » sur RTL. Elle participe aussi à l'émission « Le débat » sur LCI. Elle est notamment l’auteure de « Quelle histoire ! Ségolène Royal et François Hollande » paru chez Plon, le 3 juillet 2014, et de « Il faut imaginer Sisyphe heureux - Les 100 derniers jours de François Hollande » paru aux Éditions de l'Observatoire, le 7 juin 2017.
Françoise DEGOIS est née le 22 juin 1964 à Lourdes. En 1992, devenue journaliste, elle entre à France Inter, chargée de suivre l'actualité du PS, et elle avait d’ailleurs eu la primauté médiatique sur la séparation du couple Ségolène Royal – François Hollande en 2007. Après avoir pris fait et cause pour Laurent Fabius au moment du référendum sur la Constitution européenne, en 2005, Françoise découvre Ségolène Royal, candidate à la candidature socialiste pour l'élection présidentielle de 2007. Pendant la campagne présidentielle, Françoise Degois ne cache pas son enthousiasme à la fin des meetings, qu'elle couvre pratiquement tous. Et, depuis plus de deux ans, dans ses reportages comme dans le livre d'entretiens qu'elle a écrit avec l'ex-candidate, « Femme debout, éditions Denoël, 2009 », elle ne fait pas mystère de son admiration, ni de sa bienveillance pour la présidente de Poitou-Charentes. Après dix ans à France Inter, où elle assurait des fonctions de chroniqueuse politique et de grande reporter, en charge du PS, il n'est pas surprenant que le 16 novembre 2009 elle rejoigne le cabinet de Ségolène Royal, au titre de "conseillère spéciale au cabinet de la présidence". Elle sera notamment chargée de mettre en place les politiques de civilisations sur lesquelles l'Institut de Recherche Edgar Morin, implanté à Poitiers, a fait de nombreuses propositions. "Une intellectuelle très brillante et très cultivée", dira d’elle Ségolène Royal le 17 novembre 2019, sur Canal +. "Quelqu'un de bien", confirmera-t-elle à L'Express. Cette fonction de conseillère soulèvera bien des critiques dans la presse pointant du doigt la proximité de la journaliste avec certains politiques. Un ralliement susceptible de renforcer les doutes sur l'étanchéité entre médias et politiques. Sa carrière à France Inter lui avait déjà permis en effet de suivre la campagne de Ségolène Royal lors de l'élection présidentielle de 2007 et, par la suite, d'écrire un livre d'entretiens avec cette dernière, ex-candidate PS à la présidentielle. Au début du quinquennat de François Hollande, elle a été la conseillère politique de Guillaume Garot, un proche de Ségolène Royal, ministre délégué à l'Agroalimentaire dans le gouvernement Ayrault. Elle est une des participantes, particulièrement active, de l'émission « Les Grandes Gueules » sur RMC. Elle participe également à l'émission « Langue de bois s'abstenir » sur la chaîne TNT D8. En 2016, avec Romain Goguelin, elle réalise un documentaire sur Najat Vallaud-Belkacem, « La discrète ambitieuse », diffusé sur LCP. Le 31 août 2017, elle intègre l'émission « On refait le monde » sur RTL. Elle participe aussi à l'émission « Le débat » sur LCI. Elle est notamment l’auteure de « Quelle histoire ! Ségolène Royal et François Hollande » paru chez Plon, le 3 juillet 2014, et de « Il faut imaginer Sisyphe heureux - Les 100 derniers jours de François Hollande » paru aux Éditions de l'Observatoire, le 7 juin 2017.DELÈGUE Albert (1963-1995)
Mannequin de renommée internationale
 Albert DELÈGUE, né le 2 mai 1963 à Rambouillet et mort le 14 avril 1995, à l’âge de 31ans, à l'hôpital Purpan de Toulouse. Issu d'une famille de trois enfants, il passe son enfance à Mérilheu, un petit village situé à côté de Bagnères-de-Bigorre. Jeune, il était du genre timide et n’avait rien d’un play-boy. Plutôt petit et pas du tout musclé. Après avoir commencé un BTS d’informatique, il bifurque vers le monitorat de ski. Pour qui a toujours vécu à Mérilheu, dans les Pyrénées, les sports d’hiver n’ont rien d’exceptionnel. Passionné de sports de glisse, tels que le ski alpin, le ski nautique, le surf et le rafting, le jeune homme se destinait à une carrière de moniteur de ski. Mais en 1989, accompagnant à Paris un ami au casting organisé par la marque de cosmétiques Bourgeois, quelques tests photo suffiront à le lancer dans le mannequinat. Deux jours après la séance, il décroche son premier contrat publicitaire. À l'âge de 26 ans, il représente les parfums Bourgeois. En 1990, il pose en couverture du magazine "Perfect", le premier mensuel de mode à le mettre à l’honneur. S'ensuit une carrière internationale, durant laquelle il prête son image aux campagnes publicitaires de Calvin Klein, Gianni Versace, Sonia Rykiel, Daniel Hechter, Kenzo, Chevignon, Morgan, Blanc-Bleu, Valentino, Iceberg, René Lezard et Giorgio Armani, qui en fait le mannequin vedette de son eau de toilette homme. À partir de 1991 et jusqu'à sa mort, il sera l'égérie d'Armani. Il était avec Werner Schreyer, Marcus Schenkenberg, Cameron Alborzian, Greg Hansen ou encore Alain Gossuin, l'un des top models masculins les plus célèbres de l'agence Success dans les années 1990. Il avait travaillé pour l'agence Success et IPS Models. Deux livres lui sont consacrés : "Albert tel qu'en lui-même" de Maja et Jacques Delègue, et "Albert Delègue le Magnifique", une biographie de Jean-Pierre Alaux " qui décrit la trajectoire d'un gamin un peu trop beau qui a grandi un peu trop vite et qui est mort beaucoup trop tôt. Il n’était pas très grand 1m75, assez mince, et si vous l'aviez croisé et bien vous ne l'auriez sûrement pas reconnu. C’était aussi quelqu’un qui avait su faire rêver, tout en restant simple, agréable et joyeux. Quelqu’un de très gentil, de très humain, d’adorable. C'était avant tout une belle âme avant d'être un bel homme. Car, ce n'était pas que sa beauté extérieure qui rayonnait, mais bien celle qui jaillissait de lui. Il avait apporté du bien-être autour de lui. La gent féminine en était folle. C’était un beau mec et toutes bien sûr en étaient fan. Elles "bavaient" devant les posters d'Albert. Il fut l’un des plus beaux garçons et top models du monde. Il deviendra fatalement le volage fiancé de quelques copines top models et d’une actrice connue, demoiselles qui ont la réputation de ne pas avoir mauvais goût. Il se disait profondément polygame mais il n’aimait qu’une femme à la fois. Il avait eu le temps de chanter une unique chanson que l'on retrouvait en générique du premier film de Karl Zéro, en tant que metteur en scène, quelques temps avant sa mort ("la Femme-Tronc"). Il serait mort suite à un accident, alors qu'il faisait du jet-ski au Portugal, victime ensuite d'une rupture d'anévrisme ou d’un traumatisme crânien. Le 2 août 1994, jour de l’accident, il sera rapatrié et hospitalisé à Toulouse. Rééduqué par un kinésithérapeute, il recouvre l’usage de son bras et de sa jambe. En janvier 1995, apparaissent des troubles de la vision et de la mémoire. En mars, le voilà hospitalisé de nouveau afin de subir une batterie d’examens. Il décèdera le vendredi 14 avril 1995 d’une encéphalite. D’autres causes de sa mort ont paru en 1995 dans la presse, réfutées par la maman d’Albert. Le lendemain de son décès, ses cendres ont été dispersées dans la baie de São Martinho do Porto au Portugal. Albert aura marqué le mannequinat masculin et fait le bonheur de milliers d’adolescentes sur les posters de leurs chambres. Revenant souvent dans sa région d'origine des Hautes-Pyrénées, où il parrainait notamment des manifestations sportives, Albert Delègue dispose aujourd’hui encore d'un immense capital de sympathie et de notoriété.
Albert DELÈGUE, né le 2 mai 1963 à Rambouillet et mort le 14 avril 1995, à l’âge de 31ans, à l'hôpital Purpan de Toulouse. Issu d'une famille de trois enfants, il passe son enfance à Mérilheu, un petit village situé à côté de Bagnères-de-Bigorre. Jeune, il était du genre timide et n’avait rien d’un play-boy. Plutôt petit et pas du tout musclé. Après avoir commencé un BTS d’informatique, il bifurque vers le monitorat de ski. Pour qui a toujours vécu à Mérilheu, dans les Pyrénées, les sports d’hiver n’ont rien d’exceptionnel. Passionné de sports de glisse, tels que le ski alpin, le ski nautique, le surf et le rafting, le jeune homme se destinait à une carrière de moniteur de ski. Mais en 1989, accompagnant à Paris un ami au casting organisé par la marque de cosmétiques Bourgeois, quelques tests photo suffiront à le lancer dans le mannequinat. Deux jours après la séance, il décroche son premier contrat publicitaire. À l'âge de 26 ans, il représente les parfums Bourgeois. En 1990, il pose en couverture du magazine "Perfect", le premier mensuel de mode à le mettre à l’honneur. S'ensuit une carrière internationale, durant laquelle il prête son image aux campagnes publicitaires de Calvin Klein, Gianni Versace, Sonia Rykiel, Daniel Hechter, Kenzo, Chevignon, Morgan, Blanc-Bleu, Valentino, Iceberg, René Lezard et Giorgio Armani, qui en fait le mannequin vedette de son eau de toilette homme. À partir de 1991 et jusqu'à sa mort, il sera l'égérie d'Armani. Il était avec Werner Schreyer, Marcus Schenkenberg, Cameron Alborzian, Greg Hansen ou encore Alain Gossuin, l'un des top models masculins les plus célèbres de l'agence Success dans les années 1990. Il avait travaillé pour l'agence Success et IPS Models. Deux livres lui sont consacrés : "Albert tel qu'en lui-même" de Maja et Jacques Delègue, et "Albert Delègue le Magnifique", une biographie de Jean-Pierre Alaux " qui décrit la trajectoire d'un gamin un peu trop beau qui a grandi un peu trop vite et qui est mort beaucoup trop tôt. Il n’était pas très grand 1m75, assez mince, et si vous l'aviez croisé et bien vous ne l'auriez sûrement pas reconnu. C’était aussi quelqu’un qui avait su faire rêver, tout en restant simple, agréable et joyeux. Quelqu’un de très gentil, de très humain, d’adorable. C'était avant tout une belle âme avant d'être un bel homme. Car, ce n'était pas que sa beauté extérieure qui rayonnait, mais bien celle qui jaillissait de lui. Il avait apporté du bien-être autour de lui. La gent féminine en était folle. C’était un beau mec et toutes bien sûr en étaient fan. Elles "bavaient" devant les posters d'Albert. Il fut l’un des plus beaux garçons et top models du monde. Il deviendra fatalement le volage fiancé de quelques copines top models et d’une actrice connue, demoiselles qui ont la réputation de ne pas avoir mauvais goût. Il se disait profondément polygame mais il n’aimait qu’une femme à la fois. Il avait eu le temps de chanter une unique chanson que l'on retrouvait en générique du premier film de Karl Zéro, en tant que metteur en scène, quelques temps avant sa mort ("la Femme-Tronc"). Il serait mort suite à un accident, alors qu'il faisait du jet-ski au Portugal, victime ensuite d'une rupture d'anévrisme ou d’un traumatisme crânien. Le 2 août 1994, jour de l’accident, il sera rapatrié et hospitalisé à Toulouse. Rééduqué par un kinésithérapeute, il recouvre l’usage de son bras et de sa jambe. En janvier 1995, apparaissent des troubles de la vision et de la mémoire. En mars, le voilà hospitalisé de nouveau afin de subir une batterie d’examens. Il décèdera le vendredi 14 avril 1995 d’une encéphalite. D’autres causes de sa mort ont paru en 1995 dans la presse, réfutées par la maman d’Albert. Le lendemain de son décès, ses cendres ont été dispersées dans la baie de São Martinho do Porto au Portugal. Albert aura marqué le mannequinat masculin et fait le bonheur de milliers d’adolescentes sur les posters de leurs chambres. Revenant souvent dans sa région d'origine des Hautes-Pyrénées, où il parrainait notamment des manifestations sportives, Albert Delègue dispose aujourd’hui encore d'un immense capital de sympathie et de notoriété.
 Albert DELÈGUE, né le 2 mai 1963 à Rambouillet et mort le 14 avril 1995, à l’âge de 31ans, à l'hôpital Purpan de Toulouse. Issu d'une famille de trois enfants, il passe son enfance à Mérilheu, un petit village situé à côté de Bagnères-de-Bigorre. Jeune, il était du genre timide et n’avait rien d’un play-boy. Plutôt petit et pas du tout musclé. Après avoir commencé un BTS d’informatique, il bifurque vers le monitorat de ski. Pour qui a toujours vécu à Mérilheu, dans les Pyrénées, les sports d’hiver n’ont rien d’exceptionnel. Passionné de sports de glisse, tels que le ski alpin, le ski nautique, le surf et le rafting, le jeune homme se destinait à une carrière de moniteur de ski. Mais en 1989, accompagnant à Paris un ami au casting organisé par la marque de cosmétiques Bourgeois, quelques tests photo suffiront à le lancer dans le mannequinat. Deux jours après la séance, il décroche son premier contrat publicitaire. À l'âge de 26 ans, il représente les parfums Bourgeois. En 1990, il pose en couverture du magazine "Perfect", le premier mensuel de mode à le mettre à l’honneur. S'ensuit une carrière internationale, durant laquelle il prête son image aux campagnes publicitaires de Calvin Klein, Gianni Versace, Sonia Rykiel, Daniel Hechter, Kenzo, Chevignon, Morgan, Blanc-Bleu, Valentino, Iceberg, René Lezard et Giorgio Armani, qui en fait le mannequin vedette de son eau de toilette homme. À partir de 1991 et jusqu'à sa mort, il sera l'égérie d'Armani. Il était avec Werner Schreyer, Marcus Schenkenberg, Cameron Alborzian, Greg Hansen ou encore Alain Gossuin, l'un des top models masculins les plus célèbres de l'agence Success dans les années 1990. Il avait travaillé pour l'agence Success et IPS Models. Deux livres lui sont consacrés : "Albert tel qu'en lui-même" de Maja et Jacques Delègue, et "Albert Delègue le Magnifique", une biographie de Jean-Pierre Alaux " qui décrit la trajectoire d'un gamin un peu trop beau qui a grandi un peu trop vite et qui est mort beaucoup trop tôt. Il n’était pas très grand 1m75, assez mince, et si vous l'aviez croisé et bien vous ne l'auriez sûrement pas reconnu. C’était aussi quelqu’un qui avait su faire rêver, tout en restant simple, agréable et joyeux. Quelqu’un de très gentil, de très humain, d’adorable. C'était avant tout une belle âme avant d'être un bel homme. Car, ce n'était pas que sa beauté extérieure qui rayonnait, mais bien celle qui jaillissait de lui. Il avait apporté du bien-être autour de lui. La gent féminine en était folle. C’était un beau mec et toutes bien sûr en étaient fan. Elles "bavaient" devant les posters d'Albert. Il fut l’un des plus beaux garçons et top models du monde. Il deviendra fatalement le volage fiancé de quelques copines top models et d’une actrice connue, demoiselles qui ont la réputation de ne pas avoir mauvais goût. Il se disait profondément polygame mais il n’aimait qu’une femme à la fois. Il avait eu le temps de chanter une unique chanson que l'on retrouvait en générique du premier film de Karl Zéro, en tant que metteur en scène, quelques temps avant sa mort ("la Femme-Tronc"). Il serait mort suite à un accident, alors qu'il faisait du jet-ski au Portugal, victime ensuite d'une rupture d'anévrisme ou d’un traumatisme crânien. Le 2 août 1994, jour de l’accident, il sera rapatrié et hospitalisé à Toulouse. Rééduqué par un kinésithérapeute, il recouvre l’usage de son bras et de sa jambe. En janvier 1995, apparaissent des troubles de la vision et de la mémoire. En mars, le voilà hospitalisé de nouveau afin de subir une batterie d’examens. Il décèdera le vendredi 14 avril 1995 d’une encéphalite. D’autres causes de sa mort ont paru en 1995 dans la presse, réfutées par la maman d’Albert. Le lendemain de son décès, ses cendres ont été dispersées dans la baie de São Martinho do Porto au Portugal. Albert aura marqué le mannequinat masculin et fait le bonheur de milliers d’adolescentes sur les posters de leurs chambres. Revenant souvent dans sa région d'origine des Hautes-Pyrénées, où il parrainait notamment des manifestations sportives, Albert Delègue dispose aujourd’hui encore d'un immense capital de sympathie et de notoriété.
Albert DELÈGUE, né le 2 mai 1963 à Rambouillet et mort le 14 avril 1995, à l’âge de 31ans, à l'hôpital Purpan de Toulouse. Issu d'une famille de trois enfants, il passe son enfance à Mérilheu, un petit village situé à côté de Bagnères-de-Bigorre. Jeune, il était du genre timide et n’avait rien d’un play-boy. Plutôt petit et pas du tout musclé. Après avoir commencé un BTS d’informatique, il bifurque vers le monitorat de ski. Pour qui a toujours vécu à Mérilheu, dans les Pyrénées, les sports d’hiver n’ont rien d’exceptionnel. Passionné de sports de glisse, tels que le ski alpin, le ski nautique, le surf et le rafting, le jeune homme se destinait à une carrière de moniteur de ski. Mais en 1989, accompagnant à Paris un ami au casting organisé par la marque de cosmétiques Bourgeois, quelques tests photo suffiront à le lancer dans le mannequinat. Deux jours après la séance, il décroche son premier contrat publicitaire. À l'âge de 26 ans, il représente les parfums Bourgeois. En 1990, il pose en couverture du magazine "Perfect", le premier mensuel de mode à le mettre à l’honneur. S'ensuit une carrière internationale, durant laquelle il prête son image aux campagnes publicitaires de Calvin Klein, Gianni Versace, Sonia Rykiel, Daniel Hechter, Kenzo, Chevignon, Morgan, Blanc-Bleu, Valentino, Iceberg, René Lezard et Giorgio Armani, qui en fait le mannequin vedette de son eau de toilette homme. À partir de 1991 et jusqu'à sa mort, il sera l'égérie d'Armani. Il était avec Werner Schreyer, Marcus Schenkenberg, Cameron Alborzian, Greg Hansen ou encore Alain Gossuin, l'un des top models masculins les plus célèbres de l'agence Success dans les années 1990. Il avait travaillé pour l'agence Success et IPS Models. Deux livres lui sont consacrés : "Albert tel qu'en lui-même" de Maja et Jacques Delègue, et "Albert Delègue le Magnifique", une biographie de Jean-Pierre Alaux " qui décrit la trajectoire d'un gamin un peu trop beau qui a grandi un peu trop vite et qui est mort beaucoup trop tôt. Il n’était pas très grand 1m75, assez mince, et si vous l'aviez croisé et bien vous ne l'auriez sûrement pas reconnu. C’était aussi quelqu’un qui avait su faire rêver, tout en restant simple, agréable et joyeux. Quelqu’un de très gentil, de très humain, d’adorable. C'était avant tout une belle âme avant d'être un bel homme. Car, ce n'était pas que sa beauté extérieure qui rayonnait, mais bien celle qui jaillissait de lui. Il avait apporté du bien-être autour de lui. La gent féminine en était folle. C’était un beau mec et toutes bien sûr en étaient fan. Elles "bavaient" devant les posters d'Albert. Il fut l’un des plus beaux garçons et top models du monde. Il deviendra fatalement le volage fiancé de quelques copines top models et d’une actrice connue, demoiselles qui ont la réputation de ne pas avoir mauvais goût. Il se disait profondément polygame mais il n’aimait qu’une femme à la fois. Il avait eu le temps de chanter une unique chanson que l'on retrouvait en générique du premier film de Karl Zéro, en tant que metteur en scène, quelques temps avant sa mort ("la Femme-Tronc"). Il serait mort suite à un accident, alors qu'il faisait du jet-ski au Portugal, victime ensuite d'une rupture d'anévrisme ou d’un traumatisme crânien. Le 2 août 1994, jour de l’accident, il sera rapatrié et hospitalisé à Toulouse. Rééduqué par un kinésithérapeute, il recouvre l’usage de son bras et de sa jambe. En janvier 1995, apparaissent des troubles de la vision et de la mémoire. En mars, le voilà hospitalisé de nouveau afin de subir une batterie d’examens. Il décèdera le vendredi 14 avril 1995 d’une encéphalite. D’autres causes de sa mort ont paru en 1995 dans la presse, réfutées par la maman d’Albert. Le lendemain de son décès, ses cendres ont été dispersées dans la baie de São Martinho do Porto au Portugal. Albert aura marqué le mannequinat masculin et fait le bonheur de milliers d’adolescentes sur les posters de leurs chambres. Revenant souvent dans sa région d'origine des Hautes-Pyrénées, où il parrainait notamment des manifestations sportives, Albert Delègue dispose aujourd’hui encore d'un immense capital de sympathie et de notoriété.DEMBARRERE Jean (1747-1828)
 Général, sénateur et comte d’Empire originaire de Lourdes
Général, sénateur et comte d’Empire originaire de Lourdes
Comte Jean DEMBARRERE, général de division du génie, naquit le 3 juillet 1747 à Tarbes, d’une famille noble. Son père, Jean-François Dembarrère, appartenait à une famille originaire de Lourdes. Il était avocat au parlement et premier consul à Tarbes. En 1766, son fils Jean Dembarrère entre à l’École royale du génie de Mézières et entame sa carrière militaire. Il est ingénieur militaire deux ans après, en 1768. Nommé lieutenant en 1770, il est promu capitaine en 1777. En 1792, il est nommé commandant du génie à Brest. Appelé à l’armée du Nord lors des premières hostilités, il participa de mai à juillet 1793, avec le capitaine Lauriston, à la brillante défense de Valenciennes, qui ne se rendit qu’après quarante jours de bombardement. La conduite de Dembarrère durant ce siège lui valut le grade de général de brigade en 1793, et il suivit, en cette qualité, la garnison qui fut envoyée dans la Vendée. À la bataille de Doué, le 13 septembre 1793, il organisa les savantes dispositions du champ de bataille qui permirent au général Santerre de vaincre d’Autichamp et Talmont. Promu général de division le 16 février 1795, il sert dans l’armée de l’Ouest, où il commande une division. Puis il demanda et obtint de quitter l’armée de l’Ouest. En mars 1797, il fut nommé commandant à Luxembourg, puis commandant à Metz et en 1798, il servit dans l’armée d’Angleterre (armée de l’Ouest). Pendant un bref moment au cours de l’été 1799, il servit comme commandant en chef par intérim de l’armée d’Angleterre, puis en juillet il prit le commandement de la 11e division militaire de Bordeaux, où il réprima une émeute. En mars 1800, on l’envoya à l’armée d’Italie, où il eut le commandement en chef de l’armée du Génie. Quand cette armée éprouva à son tour des revers qui l’obligèrent à se concentrer en avril-mai 1800 sur les rives du Var pour arrêter l’ennemi prêt à envahir la Provence, Dembarrère fut chargé de diriger les fortifications sur toute la ligne, et notamment celles de la tête du pont du Var, qu’il défendit sous le feu le plus meurtrier. Il seconda puissamment les efforts du général en chef Rochambeau pour repousser les Autrichiens, particulièrement dans la journée du 20 mai 1800, où les Autrichiens, repoussés par deux fois, perdirent tout espoir d’effectuer leur passage. Il fut nommé membre et commandant de la Légion d’Honneur les 11 décembre 1803 et 14 juin 1804. Dembarrère continua à servir activement, soit à l’armée, soit comme inspecteur général jusqu’au 1er février 1805, époque de son élévation à la dignité de sénateur. C’était la récompense de près de quarante ans de travaux. L’Empereur le nomma comte de l’Empire par lettres du 15 juin 1808. En 1811, il présida le collège électoral des Hautes-Pyrénées. Il revient brièvement à la vie militaire en 1812, lorsqu’il organisa une partie de la garde nationale de la 11e division militaire. On lit dans un livre intitulé : Monsieur de Talleyrand, tome IV, page 251 : « Que ce sénateur était sous l’influence du prince de Bénévent, et que, dès 1813, il était dans une conspiration ourdie contre le chef de l’Empire. » Lors des événements de 1814, il prit part aux délibérations du Sénat, qui arrêta la formation d’un gouvernement provisoire, la déchéance de Napoléon (avril 1814) et le rappel des Bourbons. Aussi, avec le retour des Bourbons, fut-il nommé chevalier de Saint-Louis et pair de France par Louis XVIII, le 4 juin 1814. Le 23 août suivant, il fut nommé grand officier de la Légion d’Honneur. Napoléon, à son retour de l’Île d’Elbe, l’éloigna de la Chambre des pairs, mais Louis XVIII le réintégra à sa place à la Chambre haute à la seconde Restauration après les Cent-Jours. À son honneur, Dembarrère refusa de voter lors du jugement du maréchal Ney, son ancien supérieur, et siégea dans les rangs des pairs dévoués à la monarchie constitutionnelle. Louis XVIII le confirma dans son titre de comte attaché à la paierie par lettres-patentes du 20 décembre 1817. Il prit rarement la parole, et mourut à Lourdes le 3 mars 1828. Son nom est gravé sur l’un des piliers nord (1re colonne) de l’Arc de Triomphe, à Paris. Une rue de Tarbes porte son nom ainsi qu’une fontaine de Lourdes. Une caserne de Tarbes porta son nom (l’ancien couvent des Ursulines, sur le site de l’actuelle cité Rothschild). Son hôtel (aux portails ornés de la Légion d’honneur) rue des Pyrénées est occupé par l’Institut Médico-Éducatif Joseph-Forgues. Ses œuvres textuelles : « Coup d'œil sur les parties diverses de la science militaire (1783) » ; « Éloge historique du maréchal de Vauban (1784) » présenté à l'Académie de Dijon en 1784 ; « Observations sur un imprimé du lieutenant-général comte de Sainte-Suzanne (1819) » ; « Projet de changements à opérer dans le système des places fortes pour les rendre véritablement utiles à la défense de la France (1819) ». Son neveu Pierre Dauzat-Dembarrère fut député de l’arrondissement d’Argelès sous le second Empire. À cette époque, Monseigneur Laurence, évêque de Tarbes, était en instance auprès du Gouvernement pour obtenir l’autorisation de construire la Chapelle de la Grotte, mais il se heurtait à de nombreuses difficultés. Monsieur Dauzat-Dembarrère, qui était puissant, lui prêta son crédit et l’autorisation fut obtenue. Dauzat-Dembarrère publia, en 1872, un petit livre ayant pour titre « Histoire Politique de la Grotte de Lourdes ». Ce livre fut vendu au profit de l’Hospice de Lourdes. Le général Jean Dembarrère repose au cimetière de l’Égalité à Lourdes. Le domicile de la famille Dembarrère était situé au n° 62 de la rue du Bourg, à Lourdes. Jean-François Dembarrère, son père, avocat au parlement, et son épouse Anne, née Caubotte, qui avait apporté en dot à son mari le grand domaine de Vizens, ont vécu en cette demeure. Ils avaient également une résidence à Tarbes, mais Anne Dembarrère revenait souvent à Vizens avec ses enfants, dont le futur général Jean Dembarrère, qui y passa une partie de son enfance. Ce dernier est né à Tarbes le 3 juillet 1747. Jean-François Dembarrère et Anne de Caubotte étaient des cousins issus de germains. Quand sonne l’heure de la retraite, Jean Dembarrère quitte son hôtel particulier au 11 rue des Pyrénées à Tarbes, et se retire dans l’ancienne maison familiale de la rue du Bourg, à Lourdes, où il s’éteint le 4 mars 1828. Il vint à Lourdes, en 1785, où « son prestigieux uniforme de capitaine du corps royal du génie fit sensation à l’église paroissiale de Saint-Pierre. En mai de la même année, il assista comme parent et témoin au mariage de Bertrand Barère de Vieuzac à Vic-Bigorre. En tant que parenté, il y avait quelque rapport d’alliance entre les Caubotte et les Barère. Ses titres et distinctions : Légionnaire, le 11 décembre 1803 (l’appellation « Légionnaire » fut modifiée par l’ordonnance royale du 26 mars 1816 en « Chevalier de la Légion d’honneur ») ; Commandeur de la Légion d’honneur, le 14 juin 1804 ; Bonaparte le nomma Comte de l’Empire, le 15 juin 1808 ; Louis XVIII le fit Chevalier de Saint-Louis et Pair de France, le 4 juin 1814 ; Grand officier de la Légion d’Honneur, le 23 août 1814 ; Comte-pair héréditaire, le 31 août 1817. La famille Dembarrère, originaire de Lourdes, en Bigorre, appartenait avant la Révolution à la haute bourgeoisie de sa région. Pierre Dembarrère, marié le 30 mai 1655 à Marie de Soussens, devint peu de temps après notaire à Lourdes. Monsieur Maître Jean-François Dembarrère était sous Louis XV conseiller du Roi, lieutenant général criminel en la Sénéchaussée de Bigorre. Il avait épousé vers 1725 Anne de Caubotte, sœur de Philibert Caubotte, avocat et maire de Lourdes. Ce mariage, de par l’importance de sa dot (le grand domaine de Vizens), acheva de donner une large aisance au ménage. Il en eut une nombreuse postérité. Ils eurent neuf enfants dont trois sont restés célèbres : Jean, Jean-Jacques et Gratianne qui a épousé un cousin issu de germains : Bertrand Barère de Vieuzac. Le plus jeune et le plus célèbre de ses fils, Jean Dembarrère, né à Tarbes en 1747, décédé à Lourdes en 1828 sans avoir été marié et sans descendance, eut une brillante carrière militaire et politique. Général de division en 1793, directeur général des fortifications (1801), inspecteur général du Génie (1802), il fut nommé sénateur le 1er février 1805, fut créé comte de l’Empire par lettres du 15 juin 1808, président du collège électoral des Hautes-Pyrénées (1811), devint pair de France héréditaire sous la Restauration et fut confirmé, par lettres patentes du 20 décembre 1817, dans la possession du titre de comte attaché à sa patrie. Jean-Jacques Dembarrère, avocat, frère du comte Jean Dembarrère, épousa en 1774 Michelle de Mascaras, fille d’un ancien lieutenant principal au sénéchal de Bigorre. Il en eut trois filles, Gratianne, Mme Jeanne-Gratiane Dauzat et la baronne Anne-Marie Soult, et un fils, Jean-Jacques-Victoire Dembarrère (1780-1860). Celui-ci fut chef de bataillon dans l’artillerie, épousa sa cousine Claire-Jacquette Barère (Clarisse), fille de Bertrand Barère et laissa une fille unique Catherine Jeanne Philippe (dite Clarisse), qui épousa son cousin germain, Pierre Benoît Dauzat-Dembarrère, né à Lourdes le 17 avril 1809 et fils de Basile Dauzat et de Jeanne-Gratiane Dembarrère. Ces familles Dembarrère, Barère et Caubotte étaient prêtes à la consanguinité des alliances familiales pour renforcer leur pouvoir. Visens, le grand domaine des Caubotte, ils en étaient propriétaires depuis le XVIe siècle au moins. On avait d’ailleurs fini par identifier leur nom à celui de leur domaine. Celui-ci sera partagé et reconstitué au gré de ces alliances. À la mort de Jean-Jacques Dembarrère, le domaine de Visens fut partagé en trois lots, aux termes d’un acte passé devant Me Latapie, notaire à Lourdes, le 16 février 1811. Le domaine comportait six métairies : Pédoupas, Lalanne, Visens, Pouchou, Biscaye et Arrouach. Et chaque métairie avait une maison, une cour, une grange, un jardin et autres dépendances et des terres. Les maisons étaient des maisons bigourdanes classiques. Chaque héritier reçu deux métairies : premier lot, Biscaye et Arrouach ; deuxième lot, Visens et Pouchou ; troisième lot, Pédoupas et Lalanne. Ils furent attribués par tirage au sort. Le premier revint à la baronne Soult ; le deuxième à Mme Dauzat ; le troisième à Jean-Jacques-Victoire Dembarrère.
 Général, sénateur et comte d’Empire originaire de Lourdes
Général, sénateur et comte d’Empire originaire de LourdesComte Jean DEMBARRERE, général de division du génie, naquit le 3 juillet 1747 à Tarbes, d’une famille noble. Son père, Jean-François Dembarrère, appartenait à une famille originaire de Lourdes. Il était avocat au parlement et premier consul à Tarbes. En 1766, son fils Jean Dembarrère entre à l’École royale du génie de Mézières et entame sa carrière militaire. Il est ingénieur militaire deux ans après, en 1768. Nommé lieutenant en 1770, il est promu capitaine en 1777. En 1792, il est nommé commandant du génie à Brest. Appelé à l’armée du Nord lors des premières hostilités, il participa de mai à juillet 1793, avec le capitaine Lauriston, à la brillante défense de Valenciennes, qui ne se rendit qu’après quarante jours de bombardement. La conduite de Dembarrère durant ce siège lui valut le grade de général de brigade en 1793, et il suivit, en cette qualité, la garnison qui fut envoyée dans la Vendée. À la bataille de Doué, le 13 septembre 1793, il organisa les savantes dispositions du champ de bataille qui permirent au général Santerre de vaincre d’Autichamp et Talmont. Promu général de division le 16 février 1795, il sert dans l’armée de l’Ouest, où il commande une division. Puis il demanda et obtint de quitter l’armée de l’Ouest. En mars 1797, il fut nommé commandant à Luxembourg, puis commandant à Metz et en 1798, il servit dans l’armée d’Angleterre (armée de l’Ouest). Pendant un bref moment au cours de l’été 1799, il servit comme commandant en chef par intérim de l’armée d’Angleterre, puis en juillet il prit le commandement de la 11e division militaire de Bordeaux, où il réprima une émeute. En mars 1800, on l’envoya à l’armée d’Italie, où il eut le commandement en chef de l’armée du Génie. Quand cette armée éprouva à son tour des revers qui l’obligèrent à se concentrer en avril-mai 1800 sur les rives du Var pour arrêter l’ennemi prêt à envahir la Provence, Dembarrère fut chargé de diriger les fortifications sur toute la ligne, et notamment celles de la tête du pont du Var, qu’il défendit sous le feu le plus meurtrier. Il seconda puissamment les efforts du général en chef Rochambeau pour repousser les Autrichiens, particulièrement dans la journée du 20 mai 1800, où les Autrichiens, repoussés par deux fois, perdirent tout espoir d’effectuer leur passage. Il fut nommé membre et commandant de la Légion d’Honneur les 11 décembre 1803 et 14 juin 1804. Dembarrère continua à servir activement, soit à l’armée, soit comme inspecteur général jusqu’au 1er février 1805, époque de son élévation à la dignité de sénateur. C’était la récompense de près de quarante ans de travaux. L’Empereur le nomma comte de l’Empire par lettres du 15 juin 1808. En 1811, il présida le collège électoral des Hautes-Pyrénées. Il revient brièvement à la vie militaire en 1812, lorsqu’il organisa une partie de la garde nationale de la 11e division militaire. On lit dans un livre intitulé : Monsieur de Talleyrand, tome IV, page 251 : « Que ce sénateur était sous l’influence du prince de Bénévent, et que, dès 1813, il était dans une conspiration ourdie contre le chef de l’Empire. » Lors des événements de 1814, il prit part aux délibérations du Sénat, qui arrêta la formation d’un gouvernement provisoire, la déchéance de Napoléon (avril 1814) et le rappel des Bourbons. Aussi, avec le retour des Bourbons, fut-il nommé chevalier de Saint-Louis et pair de France par Louis XVIII, le 4 juin 1814. Le 23 août suivant, il fut nommé grand officier de la Légion d’Honneur. Napoléon, à son retour de l’Île d’Elbe, l’éloigna de la Chambre des pairs, mais Louis XVIII le réintégra à sa place à la Chambre haute à la seconde Restauration après les Cent-Jours. À son honneur, Dembarrère refusa de voter lors du jugement du maréchal Ney, son ancien supérieur, et siégea dans les rangs des pairs dévoués à la monarchie constitutionnelle. Louis XVIII le confirma dans son titre de comte attaché à la paierie par lettres-patentes du 20 décembre 1817. Il prit rarement la parole, et mourut à Lourdes le 3 mars 1828. Son nom est gravé sur l’un des piliers nord (1re colonne) de l’Arc de Triomphe, à Paris. Une rue de Tarbes porte son nom ainsi qu’une fontaine de Lourdes. Une caserne de Tarbes porta son nom (l’ancien couvent des Ursulines, sur le site de l’actuelle cité Rothschild). Son hôtel (aux portails ornés de la Légion d’honneur) rue des Pyrénées est occupé par l’Institut Médico-Éducatif Joseph-Forgues. Ses œuvres textuelles : « Coup d'œil sur les parties diverses de la science militaire (1783) » ; « Éloge historique du maréchal de Vauban (1784) » présenté à l'Académie de Dijon en 1784 ; « Observations sur un imprimé du lieutenant-général comte de Sainte-Suzanne (1819) » ; « Projet de changements à opérer dans le système des places fortes pour les rendre véritablement utiles à la défense de la France (1819) ». Son neveu Pierre Dauzat-Dembarrère fut député de l’arrondissement d’Argelès sous le second Empire. À cette époque, Monseigneur Laurence, évêque de Tarbes, était en instance auprès du Gouvernement pour obtenir l’autorisation de construire la Chapelle de la Grotte, mais il se heurtait à de nombreuses difficultés. Monsieur Dauzat-Dembarrère, qui était puissant, lui prêta son crédit et l’autorisation fut obtenue. Dauzat-Dembarrère publia, en 1872, un petit livre ayant pour titre « Histoire Politique de la Grotte de Lourdes ». Ce livre fut vendu au profit de l’Hospice de Lourdes. Le général Jean Dembarrère repose au cimetière de l’Égalité à Lourdes. Le domicile de la famille Dembarrère était situé au n° 62 de la rue du Bourg, à Lourdes. Jean-François Dembarrère, son père, avocat au parlement, et son épouse Anne, née Caubotte, qui avait apporté en dot à son mari le grand domaine de Vizens, ont vécu en cette demeure. Ils avaient également une résidence à Tarbes, mais Anne Dembarrère revenait souvent à Vizens avec ses enfants, dont le futur général Jean Dembarrère, qui y passa une partie de son enfance. Ce dernier est né à Tarbes le 3 juillet 1747. Jean-François Dembarrère et Anne de Caubotte étaient des cousins issus de germains. Quand sonne l’heure de la retraite, Jean Dembarrère quitte son hôtel particulier au 11 rue des Pyrénées à Tarbes, et se retire dans l’ancienne maison familiale de la rue du Bourg, à Lourdes, où il s’éteint le 4 mars 1828. Il vint à Lourdes, en 1785, où « son prestigieux uniforme de capitaine du corps royal du génie fit sensation à l’église paroissiale de Saint-Pierre. En mai de la même année, il assista comme parent et témoin au mariage de Bertrand Barère de Vieuzac à Vic-Bigorre. En tant que parenté, il y avait quelque rapport d’alliance entre les Caubotte et les Barère. Ses titres et distinctions : Légionnaire, le 11 décembre 1803 (l’appellation « Légionnaire » fut modifiée par l’ordonnance royale du 26 mars 1816 en « Chevalier de la Légion d’honneur ») ; Commandeur de la Légion d’honneur, le 14 juin 1804 ; Bonaparte le nomma Comte de l’Empire, le 15 juin 1808 ; Louis XVIII le fit Chevalier de Saint-Louis et Pair de France, le 4 juin 1814 ; Grand officier de la Légion d’Honneur, le 23 août 1814 ; Comte-pair héréditaire, le 31 août 1817. La famille Dembarrère, originaire de Lourdes, en Bigorre, appartenait avant la Révolution à la haute bourgeoisie de sa région. Pierre Dembarrère, marié le 30 mai 1655 à Marie de Soussens, devint peu de temps après notaire à Lourdes. Monsieur Maître Jean-François Dembarrère était sous Louis XV conseiller du Roi, lieutenant général criminel en la Sénéchaussée de Bigorre. Il avait épousé vers 1725 Anne de Caubotte, sœur de Philibert Caubotte, avocat et maire de Lourdes. Ce mariage, de par l’importance de sa dot (le grand domaine de Vizens), acheva de donner une large aisance au ménage. Il en eut une nombreuse postérité. Ils eurent neuf enfants dont trois sont restés célèbres : Jean, Jean-Jacques et Gratianne qui a épousé un cousin issu de germains : Bertrand Barère de Vieuzac. Le plus jeune et le plus célèbre de ses fils, Jean Dembarrère, né à Tarbes en 1747, décédé à Lourdes en 1828 sans avoir été marié et sans descendance, eut une brillante carrière militaire et politique. Général de division en 1793, directeur général des fortifications (1801), inspecteur général du Génie (1802), il fut nommé sénateur le 1er février 1805, fut créé comte de l’Empire par lettres du 15 juin 1808, président du collège électoral des Hautes-Pyrénées (1811), devint pair de France héréditaire sous la Restauration et fut confirmé, par lettres patentes du 20 décembre 1817, dans la possession du titre de comte attaché à sa patrie. Jean-Jacques Dembarrère, avocat, frère du comte Jean Dembarrère, épousa en 1774 Michelle de Mascaras, fille d’un ancien lieutenant principal au sénéchal de Bigorre. Il en eut trois filles, Gratianne, Mme Jeanne-Gratiane Dauzat et la baronne Anne-Marie Soult, et un fils, Jean-Jacques-Victoire Dembarrère (1780-1860). Celui-ci fut chef de bataillon dans l’artillerie, épousa sa cousine Claire-Jacquette Barère (Clarisse), fille de Bertrand Barère et laissa une fille unique Catherine Jeanne Philippe (dite Clarisse), qui épousa son cousin germain, Pierre Benoît Dauzat-Dembarrère, né à Lourdes le 17 avril 1809 et fils de Basile Dauzat et de Jeanne-Gratiane Dembarrère. Ces familles Dembarrère, Barère et Caubotte étaient prêtes à la consanguinité des alliances familiales pour renforcer leur pouvoir. Visens, le grand domaine des Caubotte, ils en étaient propriétaires depuis le XVIe siècle au moins. On avait d’ailleurs fini par identifier leur nom à celui de leur domaine. Celui-ci sera partagé et reconstitué au gré de ces alliances. À la mort de Jean-Jacques Dembarrère, le domaine de Visens fut partagé en trois lots, aux termes d’un acte passé devant Me Latapie, notaire à Lourdes, le 16 février 1811. Le domaine comportait six métairies : Pédoupas, Lalanne, Visens, Pouchou, Biscaye et Arrouach. Et chaque métairie avait une maison, une cour, une grange, un jardin et autres dépendances et des terres. Les maisons étaient des maisons bigourdanes classiques. Chaque héritier reçu deux métairies : premier lot, Biscaye et Arrouach ; deuxième lot, Visens et Pouchou ; troisième lot, Pédoupas et Lalanne. Ils furent attribués par tirage au sort. Le premier revint à la baronne Soult ; le deuxième à Mme Dauzat ; le troisième à Jean-Jacques-Victoire Dembarrère.
DINTRANS Philippe (1957-XXXX)
Talonneur international de rugby à XV
 Philippe DINTRANS, né le 29 janvier 1957 à Tarbes, est un ancien talonneur (1m82, 97kg) et capitaine à 12 reprises, entre 1984 et 1990, du XV tricolore avec un bilan de six victoires, quatre défaites et deux nuls. Il fut sélectionné 50 fois dans le XV tricolore, entre le 7 juillet 1979 à Christchurch contre la Nouvelle-Zélande et le 24 mai 1990 à Auch contre la Roumanie. En 1979, il fut le talonneur de l’équipe de France victorieuse pour la première fois de l’équipe de Nouvelle-Zélande à Auckland (24-19), sur la terre des « All Blacks ». En 1981, il remporta un Grand Chelem et en 1989, le Tournoi des Cinq Nations. En 1967, à l’âge de 10 ans, il entre à l’école de rugby du Stadoceste tarbais. En 1976, à 18 ans, premier match en équipe première au Stadoceste tarbais contre la section paloise. Ensuite, il ne lui faudra pas plus de trois saisons pour incorporer l’équipe de France. Lors de la tournée de 1979 en Nouvelle-Zélande, il sera appelé pour remplacer Alain Paco, considéré jusqu’alors comme le talonneur inamovible du XV de France. Il jouera talonneur à Tarbes jusqu’en 1991/92 pour 17 saisons, et son meilleur résultat étant celui de finaliste avec le Stadoceste tarbais à la saison 1987/88, match perdu face au SU Agen. Avec dix-sept saisons en Nationale, il fut surnommé "le Lorrain". De 1979 à 1990, il aura donc eu 50 sélections pour la France, marquant 3 essais, 12 points au total. Il aura participé à sept éditions du Tournoi des Cinq Nations en 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1989, en remportant le Grand Chelem en 1981 et en 1989. En 1984, 1er Capitanat en Nouvelle-Zélande : il succède à Jean-Pierre Rives comme capitaine de la sélection lors d’une nouvelle tournée en Nouvelle-Zélande. Malgré la défaite, ses hôtes lui décerneront le titre de joueur de l’année. En 1985, une hernie discale entraînant une paralysie de la jambe gauche le stoppera net. Remis de sa blessure, il fut également le capitaine malheureux de la première Coupe du monde de rugby de 1987, contre la Nouvelle-Zélande. L’équipe de France terminera deuxième. C’est depuis le banc de touche, qu’il assistera à la finale. Sa dernière sélection en 1990 fut un fiasco. À Auch, sur les terres de Jacques Fouroux, le sélectionneur national, il fut à la tête de l’équipe de France défaite par la Roumanie. Deux ans plus tard, en 1992, il mettra un terme à sa carrière avec Tarbes (club du Stadoceste avec lequel il avait atteint, en 1988, la finale du Championnat de France de rugby à XV de première division – c’était le huitième Bouclier de Brennus pour Agen). En 1982, Midi Olympique, lui décerna son Oscar de l’année. En 1993, il fut fait Citoyen d’honneur de la ville de Tarbes. En 2014, dans l’antre du Stade Maurice-Trélut à Tarbes, il fut promu chevalier de la Légion d’honneur. Professionnellement, il a été professeur d’éducation physique pendant sept ans et s’est également impliqué dans les affaires gastronomiques (vendeur de foie gras) et automobiles (treize années passées à la direction de Renault à Lourdes). En 2013, il retrouve Tarbes, en prenant le poste de directeur de la concession Renault du groupe EdenAuto. En 2020, à 63 ans, il quitte la direction de la concession Renault de Tarbes pour devenir ambassadeur du groupe Eden Auto et notamment autour du l’univers de l’ovalie.
Philippe DINTRANS, né le 29 janvier 1957 à Tarbes, est un ancien talonneur (1m82, 97kg) et capitaine à 12 reprises, entre 1984 et 1990, du XV tricolore avec un bilan de six victoires, quatre défaites et deux nuls. Il fut sélectionné 50 fois dans le XV tricolore, entre le 7 juillet 1979 à Christchurch contre la Nouvelle-Zélande et le 24 mai 1990 à Auch contre la Roumanie. En 1979, il fut le talonneur de l’équipe de France victorieuse pour la première fois de l’équipe de Nouvelle-Zélande à Auckland (24-19), sur la terre des « All Blacks ». En 1981, il remporta un Grand Chelem et en 1989, le Tournoi des Cinq Nations. En 1967, à l’âge de 10 ans, il entre à l’école de rugby du Stadoceste tarbais. En 1976, à 18 ans, premier match en équipe première au Stadoceste tarbais contre la section paloise. Ensuite, il ne lui faudra pas plus de trois saisons pour incorporer l’équipe de France. Lors de la tournée de 1979 en Nouvelle-Zélande, il sera appelé pour remplacer Alain Paco, considéré jusqu’alors comme le talonneur inamovible du XV de France. Il jouera talonneur à Tarbes jusqu’en 1991/92 pour 17 saisons, et son meilleur résultat étant celui de finaliste avec le Stadoceste tarbais à la saison 1987/88, match perdu face au SU Agen. Avec dix-sept saisons en Nationale, il fut surnommé "le Lorrain". De 1979 à 1990, il aura donc eu 50 sélections pour la France, marquant 3 essais, 12 points au total. Il aura participé à sept éditions du Tournoi des Cinq Nations en 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1989, en remportant le Grand Chelem en 1981 et en 1989. En 1984, 1er Capitanat en Nouvelle-Zélande : il succède à Jean-Pierre Rives comme capitaine de la sélection lors d’une nouvelle tournée en Nouvelle-Zélande. Malgré la défaite, ses hôtes lui décerneront le titre de joueur de l’année. En 1985, une hernie discale entraînant une paralysie de la jambe gauche le stoppera net. Remis de sa blessure, il fut également le capitaine malheureux de la première Coupe du monde de rugby de 1987, contre la Nouvelle-Zélande. L’équipe de France terminera deuxième. C’est depuis le banc de touche, qu’il assistera à la finale. Sa dernière sélection en 1990 fut un fiasco. À Auch, sur les terres de Jacques Fouroux, le sélectionneur national, il fut à la tête de l’équipe de France défaite par la Roumanie. Deux ans plus tard, en 1992, il mettra un terme à sa carrière avec Tarbes (club du Stadoceste avec lequel il avait atteint, en 1988, la finale du Championnat de France de rugby à XV de première division – c’était le huitième Bouclier de Brennus pour Agen). En 1982, Midi Olympique, lui décerna son Oscar de l’année. En 1993, il fut fait Citoyen d’honneur de la ville de Tarbes. En 2014, dans l’antre du Stade Maurice-Trélut à Tarbes, il fut promu chevalier de la Légion d’honneur. Professionnellement, il a été professeur d’éducation physique pendant sept ans et s’est également impliqué dans les affaires gastronomiques (vendeur de foie gras) et automobiles (treize années passées à la direction de Renault à Lourdes). En 2013, il retrouve Tarbes, en prenant le poste de directeur de la concession Renault du groupe EdenAuto. En 2020, à 63 ans, il quitte la direction de la concession Renault de Tarbes pour devenir ambassadeur du groupe Eden Auto et notamment autour du l’univers de l’ovalie.
 Philippe DINTRANS, né le 29 janvier 1957 à Tarbes, est un ancien talonneur (1m82, 97kg) et capitaine à 12 reprises, entre 1984 et 1990, du XV tricolore avec un bilan de six victoires, quatre défaites et deux nuls. Il fut sélectionné 50 fois dans le XV tricolore, entre le 7 juillet 1979 à Christchurch contre la Nouvelle-Zélande et le 24 mai 1990 à Auch contre la Roumanie. En 1979, il fut le talonneur de l’équipe de France victorieuse pour la première fois de l’équipe de Nouvelle-Zélande à Auckland (24-19), sur la terre des « All Blacks ». En 1981, il remporta un Grand Chelem et en 1989, le Tournoi des Cinq Nations. En 1967, à l’âge de 10 ans, il entre à l’école de rugby du Stadoceste tarbais. En 1976, à 18 ans, premier match en équipe première au Stadoceste tarbais contre la section paloise. Ensuite, il ne lui faudra pas plus de trois saisons pour incorporer l’équipe de France. Lors de la tournée de 1979 en Nouvelle-Zélande, il sera appelé pour remplacer Alain Paco, considéré jusqu’alors comme le talonneur inamovible du XV de France. Il jouera talonneur à Tarbes jusqu’en 1991/92 pour 17 saisons, et son meilleur résultat étant celui de finaliste avec le Stadoceste tarbais à la saison 1987/88, match perdu face au SU Agen. Avec dix-sept saisons en Nationale, il fut surnommé "le Lorrain". De 1979 à 1990, il aura donc eu 50 sélections pour la France, marquant 3 essais, 12 points au total. Il aura participé à sept éditions du Tournoi des Cinq Nations en 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1989, en remportant le Grand Chelem en 1981 et en 1989. En 1984, 1er Capitanat en Nouvelle-Zélande : il succède à Jean-Pierre Rives comme capitaine de la sélection lors d’une nouvelle tournée en Nouvelle-Zélande. Malgré la défaite, ses hôtes lui décerneront le titre de joueur de l’année. En 1985, une hernie discale entraînant une paralysie de la jambe gauche le stoppera net. Remis de sa blessure, il fut également le capitaine malheureux de la première Coupe du monde de rugby de 1987, contre la Nouvelle-Zélande. L’équipe de France terminera deuxième. C’est depuis le banc de touche, qu’il assistera à la finale. Sa dernière sélection en 1990 fut un fiasco. À Auch, sur les terres de Jacques Fouroux, le sélectionneur national, il fut à la tête de l’équipe de France défaite par la Roumanie. Deux ans plus tard, en 1992, il mettra un terme à sa carrière avec Tarbes (club du Stadoceste avec lequel il avait atteint, en 1988, la finale du Championnat de France de rugby à XV de première division – c’était le huitième Bouclier de Brennus pour Agen). En 1982, Midi Olympique, lui décerna son Oscar de l’année. En 1993, il fut fait Citoyen d’honneur de la ville de Tarbes. En 2014, dans l’antre du Stade Maurice-Trélut à Tarbes, il fut promu chevalier de la Légion d’honneur. Professionnellement, il a été professeur d’éducation physique pendant sept ans et s’est également impliqué dans les affaires gastronomiques (vendeur de foie gras) et automobiles (treize années passées à la direction de Renault à Lourdes). En 2013, il retrouve Tarbes, en prenant le poste de directeur de la concession Renault du groupe EdenAuto. En 2020, à 63 ans, il quitte la direction de la concession Renault de Tarbes pour devenir ambassadeur du groupe Eden Auto et notamment autour du l’univers de l’ovalie.
Philippe DINTRANS, né le 29 janvier 1957 à Tarbes, est un ancien talonneur (1m82, 97kg) et capitaine à 12 reprises, entre 1984 et 1990, du XV tricolore avec un bilan de six victoires, quatre défaites et deux nuls. Il fut sélectionné 50 fois dans le XV tricolore, entre le 7 juillet 1979 à Christchurch contre la Nouvelle-Zélande et le 24 mai 1990 à Auch contre la Roumanie. En 1979, il fut le talonneur de l’équipe de France victorieuse pour la première fois de l’équipe de Nouvelle-Zélande à Auckland (24-19), sur la terre des « All Blacks ». En 1981, il remporta un Grand Chelem et en 1989, le Tournoi des Cinq Nations. En 1967, à l’âge de 10 ans, il entre à l’école de rugby du Stadoceste tarbais. En 1976, à 18 ans, premier match en équipe première au Stadoceste tarbais contre la section paloise. Ensuite, il ne lui faudra pas plus de trois saisons pour incorporer l’équipe de France. Lors de la tournée de 1979 en Nouvelle-Zélande, il sera appelé pour remplacer Alain Paco, considéré jusqu’alors comme le talonneur inamovible du XV de France. Il jouera talonneur à Tarbes jusqu’en 1991/92 pour 17 saisons, et son meilleur résultat étant celui de finaliste avec le Stadoceste tarbais à la saison 1987/88, match perdu face au SU Agen. Avec dix-sept saisons en Nationale, il fut surnommé "le Lorrain". De 1979 à 1990, il aura donc eu 50 sélections pour la France, marquant 3 essais, 12 points au total. Il aura participé à sept éditions du Tournoi des Cinq Nations en 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 et 1989, en remportant le Grand Chelem en 1981 et en 1989. En 1984, 1er Capitanat en Nouvelle-Zélande : il succède à Jean-Pierre Rives comme capitaine de la sélection lors d’une nouvelle tournée en Nouvelle-Zélande. Malgré la défaite, ses hôtes lui décerneront le titre de joueur de l’année. En 1985, une hernie discale entraînant une paralysie de la jambe gauche le stoppera net. Remis de sa blessure, il fut également le capitaine malheureux de la première Coupe du monde de rugby de 1987, contre la Nouvelle-Zélande. L’équipe de France terminera deuxième. C’est depuis le banc de touche, qu’il assistera à la finale. Sa dernière sélection en 1990 fut un fiasco. À Auch, sur les terres de Jacques Fouroux, le sélectionneur national, il fut à la tête de l’équipe de France défaite par la Roumanie. Deux ans plus tard, en 1992, il mettra un terme à sa carrière avec Tarbes (club du Stadoceste avec lequel il avait atteint, en 1988, la finale du Championnat de France de rugby à XV de première division – c’était le huitième Bouclier de Brennus pour Agen). En 1982, Midi Olympique, lui décerna son Oscar de l’année. En 1993, il fut fait Citoyen d’honneur de la ville de Tarbes. En 2014, dans l’antre du Stade Maurice-Trélut à Tarbes, il fut promu chevalier de la Légion d’honneur. Professionnellement, il a été professeur d’éducation physique pendant sept ans et s’est également impliqué dans les affaires gastronomiques (vendeur de foie gras) et automobiles (treize années passées à la direction de Renault à Lourdes). En 2013, il retrouve Tarbes, en prenant le poste de directeur de la concession Renault du groupe EdenAuto. En 2020, à 63 ans, il quitte la direction de la concession Renault de Tarbes pour devenir ambassadeur du groupe Eden Auto et notamment autour du l’univers de l’ovalie.DOUSTE-BLAZY Philippe (1953-XXXX)
Cardiologue, professeur de médecine et homme politique
 Philippe DOUSTE-BLAZY, né le 1er janvier 1953 à Lourdes. Fils de Louis Douste-Blazy, professeur de médecine et petit-fils d’Antoine Béguère, maire et dirigeant du FC Lourdes, il étudie la médecine à Toulouse, effectue son internat en 1976 et est diplômé en 1982 de la faculté de médecine à Toulouse. Il poursuit d’abord une carrière de cardiologue à Lourdes et Toulouse, notamment à l’hôpital de Purpan à partir de 1986. Il rejoint alors la Société française de cardiologie. En 1988, il devient professeur de médecine à la faculté des sciences de Toulouse en épidémiologie, économie de la santé et prévention. Sa carrière politique débute seulement en mars 1989 avec son élection dans le fauteuil du maire de Lourdes. En juin de la même année, il est élu député européen, sur la liste « Le Centre pour l’Europe ». Cette année est aussi celle de son élection comme directeur national de l’Association de recherche contre les élévations du cholestérol (ARCOL). Il connaît ensuite une ascension rapide. Fin mars 1993, il est élu député dans la deuxième circonscription des Hautes-Pyrénées. Mandat qu’il abandonne en mai à la suite de sa nomination comme ministre délégué à la Santé dans le gouvernement d’Edouard Balladur, fonction qu’il cumule avec celle de porte-parole du gouvernement à partir du 19 janvier 1995. En mars 1994, il est élu au conseil général des Hautes-Pyrénées. Soutien de Jacques Chirac à l’élection présidentielle de 1995, il est nommé le 18 mai ministre de la Culture dans le gouvernement d’Alain Juppé, après la victoire de Jacques Chirac. Il est réélu maire de Lourdes, au premier tour des municipales en juin 1995 et il devient secrétaire général du CDS (Force démocrate) en décembre suivant. Il sera ensuite membre du bureau politique de l’UDF (1996-1999) et vice-président de l’UDF. Le 2 mai 1997, à Lourdes, alors qu’il faisait campagne pour les élections législatives, un Albanais de 37 ans le poignarde dans le dos dans un magasin de souvenirs rue de la Grotte. En juin 1997, la défaite de la droite aux élections législatives anticipées lui fait perdre son portefeuille de ministre de la Culture. Il retrouve donc son siège de député des Hautes-Pyrénées en 1997, devenant président du groupe UDF-Alliance à l’Assemblée nationale. En mars 2001, il laisse la circonscription de Lourdes pour se faire élire dans la première circonscription de la Haute-Garonne. Abandonnant ses mandats de conseiller général et de membre du conseil municipal de Lourdes, il remporte à la même date la mairie de Toulouse, succédant à Guy Hersant, maire par intérim en remplacement de Dominique Baudis, nommé président du CSA. Il préside la communauté d’agglomération du Grand Toulouse de 2001 à 2008. Réélu député de la Haute-Garonne le 16 juin 2002, et devenu secrétaire général de l’UMP le même mois lors du congrès du parti, il refuse d’entrer au gouvernement pour conserver la mairie de Toulouse. En 2004, il démissionnera cette fois de son poste de maire de la « Ville rose », se pliant à la règle du non-cumul des mandats, pour entrer le 31 mars 2004 au gouvernement comme ministre de la Santé et de la Protection sociale pendant un an. Le 29 novembre suivant, son titre s’élargit en ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille. Mais préférant le ministère des Affaires étrangères à un ministère des Affaires sociales ainsi élargi, il est nommé le 2 juin 2005, à la tête du Quai d’Orsay, dans le gouvernement de Dominique de Villepin. Comme ministre, il défend une diplomatie humanitaire, développant notamment le fonds Unitaid, un financement innovant d’achats de médicaments par une taxe prélevée sur les billets d’avion. Démissionnaire en mai 2007 à la suite de la victoire de Nicolas Sarkozy à la présidentielle, il annonce le jour de la passation des pouvoirs à Bernard Kouchner, renoncer à se présenter aux législatives dans la 1ère circonscription de Toulouse. Le 3 mars 2007, il avait été élu président du conseil d’administration d’Unitaid et en juin de la même année, il est nommé conseiller, chargé de mission auprès du Président de la République. En 2008, il devient professeur des universités – praticien hospitalier (PU-PH), enseignant à la faculté de médecine Paris-Diderot, et rattaché à l’hôpital Lariboisière. En février 2008, il devient conseiller spécial du Secrétaire général des Nations unies, chargé des sources novatrices de financement du développement, avec rang de Secrétaire général adjoint, qui n’est qu’un titre protocolaire et à titre bénévole, partageant cette fonction avec 80 autres personnes ayant le même titre. Poste qu’il occupe depuis 2008. Le 8 janvier 2012, il appelle à un soutien pour François Bayrou, candidat du MoDem pour l’élection présidentielle. En 2014, il propose sa candidature au conseil d’administration de l’ONG « Action contre la faim », mais ne sera pas élu. En 2016, il soutient Alain Juppé, candidat à la primaire présidentielle des Républicains. Depuis janvier 2016, il est professeur à la Medical School de Harvard. Il fut candidat à la présidence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dont le prochain président devait être désigné en 2017. Son argument de campagne : « Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où 2 milliards d’êtres humains n’ont pas accès aux médicaments et aux vaccins essentiels ». Mais, lors du conseil exécutif réuni le 25 janvier 2017, sa candidature ne sera pas retenue. Il soutient Emmanuel Macron pour l’élection présidentielle de 2017 et annonce son ralliement au candidat d’En Marche ! Retiré depuis plus de treize ans de la vie politique française au profit de lointaines fonctions internationales, en pleine pandémie de Covid-19 il s’est démultiplié dans les médias pour vanter les mérites du professeur Raoult, dont il est proche – il est d’ailleurs membre du conseil d’administration de l’IHU de Marseille, et de son traitement controversé à l’hydroxychloroquine. Ainsi (lui-même professeur en épidémiologie) est-il devenu en quelques semaines, un acteur incontournable de la crise sanitaire de coronavirus. Directeur de collection aux éditions Plon, il y a édité trois ouvrages : « Pour sauver nos retraites », « Le profit partagé », « La ville à bout de souffle ». Ses œuvres personnelles : « Des affaires pas si étrangères » chez Odile Jacob, 2007 et « La solidarité sauvera le monde » aux éditions Plon.
Philippe DOUSTE-BLAZY, né le 1er janvier 1953 à Lourdes. Fils de Louis Douste-Blazy, professeur de médecine et petit-fils d’Antoine Béguère, maire et dirigeant du FC Lourdes, il étudie la médecine à Toulouse, effectue son internat en 1976 et est diplômé en 1982 de la faculté de médecine à Toulouse. Il poursuit d’abord une carrière de cardiologue à Lourdes et Toulouse, notamment à l’hôpital de Purpan à partir de 1986. Il rejoint alors la Société française de cardiologie. En 1988, il devient professeur de médecine à la faculté des sciences de Toulouse en épidémiologie, économie de la santé et prévention. Sa carrière politique débute seulement en mars 1989 avec son élection dans le fauteuil du maire de Lourdes. En juin de la même année, il est élu député européen, sur la liste « Le Centre pour l’Europe ». Cette année est aussi celle de son élection comme directeur national de l’Association de recherche contre les élévations du cholestérol (ARCOL). Il connaît ensuite une ascension rapide. Fin mars 1993, il est élu député dans la deuxième circonscription des Hautes-Pyrénées. Mandat qu’il abandonne en mai à la suite de sa nomination comme ministre délégué à la Santé dans le gouvernement d’Edouard Balladur, fonction qu’il cumule avec celle de porte-parole du gouvernement à partir du 19 janvier 1995. En mars 1994, il est élu au conseil général des Hautes-Pyrénées. Soutien de Jacques Chirac à l’élection présidentielle de 1995, il est nommé le 18 mai ministre de la Culture dans le gouvernement d’Alain Juppé, après la victoire de Jacques Chirac. Il est réélu maire de Lourdes, au premier tour des municipales en juin 1995 et il devient secrétaire général du CDS (Force démocrate) en décembre suivant. Il sera ensuite membre du bureau politique de l’UDF (1996-1999) et vice-président de l’UDF. Le 2 mai 1997, à Lourdes, alors qu’il faisait campagne pour les élections législatives, un Albanais de 37 ans le poignarde dans le dos dans un magasin de souvenirs rue de la Grotte. En juin 1997, la défaite de la droite aux élections législatives anticipées lui fait perdre son portefeuille de ministre de la Culture. Il retrouve donc son siège de député des Hautes-Pyrénées en 1997, devenant président du groupe UDF-Alliance à l’Assemblée nationale. En mars 2001, il laisse la circonscription de Lourdes pour se faire élire dans la première circonscription de la Haute-Garonne. Abandonnant ses mandats de conseiller général et de membre du conseil municipal de Lourdes, il remporte à la même date la mairie de Toulouse, succédant à Guy Hersant, maire par intérim en remplacement de Dominique Baudis, nommé président du CSA. Il préside la communauté d’agglomération du Grand Toulouse de 2001 à 2008. Réélu député de la Haute-Garonne le 16 juin 2002, et devenu secrétaire général de l’UMP le même mois lors du congrès du parti, il refuse d’entrer au gouvernement pour conserver la mairie de Toulouse. En 2004, il démissionnera cette fois de son poste de maire de la « Ville rose », se pliant à la règle du non-cumul des mandats, pour entrer le 31 mars 2004 au gouvernement comme ministre de la Santé et de la Protection sociale pendant un an. Le 29 novembre suivant, son titre s’élargit en ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille. Mais préférant le ministère des Affaires étrangères à un ministère des Affaires sociales ainsi élargi, il est nommé le 2 juin 2005, à la tête du Quai d’Orsay, dans le gouvernement de Dominique de Villepin. Comme ministre, il défend une diplomatie humanitaire, développant notamment le fonds Unitaid, un financement innovant d’achats de médicaments par une taxe prélevée sur les billets d’avion. Démissionnaire en mai 2007 à la suite de la victoire de Nicolas Sarkozy à la présidentielle, il annonce le jour de la passation des pouvoirs à Bernard Kouchner, renoncer à se présenter aux législatives dans la 1ère circonscription de Toulouse. Le 3 mars 2007, il avait été élu président du conseil d’administration d’Unitaid et en juin de la même année, il est nommé conseiller, chargé de mission auprès du Président de la République. En 2008, il devient professeur des universités – praticien hospitalier (PU-PH), enseignant à la faculté de médecine Paris-Diderot, et rattaché à l’hôpital Lariboisière. En février 2008, il devient conseiller spécial du Secrétaire général des Nations unies, chargé des sources novatrices de financement du développement, avec rang de Secrétaire général adjoint, qui n’est qu’un titre protocolaire et à titre bénévole, partageant cette fonction avec 80 autres personnes ayant le même titre. Poste qu’il occupe depuis 2008. Le 8 janvier 2012, il appelle à un soutien pour François Bayrou, candidat du MoDem pour l’élection présidentielle. En 2014, il propose sa candidature au conseil d’administration de l’ONG « Action contre la faim », mais ne sera pas élu. En 2016, il soutient Alain Juppé, candidat à la primaire présidentielle des Républicains. Depuis janvier 2016, il est professeur à la Medical School de Harvard. Il fut candidat à la présidence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dont le prochain président devait être désigné en 2017. Son argument de campagne : « Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où 2 milliards d’êtres humains n’ont pas accès aux médicaments et aux vaccins essentiels ». Mais, lors du conseil exécutif réuni le 25 janvier 2017, sa candidature ne sera pas retenue. Il soutient Emmanuel Macron pour l’élection présidentielle de 2017 et annonce son ralliement au candidat d’En Marche ! Retiré depuis plus de treize ans de la vie politique française au profit de lointaines fonctions internationales, en pleine pandémie de Covid-19 il s’est démultiplié dans les médias pour vanter les mérites du professeur Raoult, dont il est proche – il est d’ailleurs membre du conseil d’administration de l’IHU de Marseille, et de son traitement controversé à l’hydroxychloroquine. Ainsi (lui-même professeur en épidémiologie) est-il devenu en quelques semaines, un acteur incontournable de la crise sanitaire de coronavirus. Directeur de collection aux éditions Plon, il y a édité trois ouvrages : « Pour sauver nos retraites », « Le profit partagé », « La ville à bout de souffle ». Ses œuvres personnelles : « Des affaires pas si étrangères » chez Odile Jacob, 2007 et « La solidarité sauvera le monde » aux éditions Plon.
 Philippe DOUSTE-BLAZY, né le 1er janvier 1953 à Lourdes. Fils de Louis Douste-Blazy, professeur de médecine et petit-fils d’Antoine Béguère, maire et dirigeant du FC Lourdes, il étudie la médecine à Toulouse, effectue son internat en 1976 et est diplômé en 1982 de la faculté de médecine à Toulouse. Il poursuit d’abord une carrière de cardiologue à Lourdes et Toulouse, notamment à l’hôpital de Purpan à partir de 1986. Il rejoint alors la Société française de cardiologie. En 1988, il devient professeur de médecine à la faculté des sciences de Toulouse en épidémiologie, économie de la santé et prévention. Sa carrière politique débute seulement en mars 1989 avec son élection dans le fauteuil du maire de Lourdes. En juin de la même année, il est élu député européen, sur la liste « Le Centre pour l’Europe ». Cette année est aussi celle de son élection comme directeur national de l’Association de recherche contre les élévations du cholestérol (ARCOL). Il connaît ensuite une ascension rapide. Fin mars 1993, il est élu député dans la deuxième circonscription des Hautes-Pyrénées. Mandat qu’il abandonne en mai à la suite de sa nomination comme ministre délégué à la Santé dans le gouvernement d’Edouard Balladur, fonction qu’il cumule avec celle de porte-parole du gouvernement à partir du 19 janvier 1995. En mars 1994, il est élu au conseil général des Hautes-Pyrénées. Soutien de Jacques Chirac à l’élection présidentielle de 1995, il est nommé le 18 mai ministre de la Culture dans le gouvernement d’Alain Juppé, après la victoire de Jacques Chirac. Il est réélu maire de Lourdes, au premier tour des municipales en juin 1995 et il devient secrétaire général du CDS (Force démocrate) en décembre suivant. Il sera ensuite membre du bureau politique de l’UDF (1996-1999) et vice-président de l’UDF. Le 2 mai 1997, à Lourdes, alors qu’il faisait campagne pour les élections législatives, un Albanais de 37 ans le poignarde dans le dos dans un magasin de souvenirs rue de la Grotte. En juin 1997, la défaite de la droite aux élections législatives anticipées lui fait perdre son portefeuille de ministre de la Culture. Il retrouve donc son siège de député des Hautes-Pyrénées en 1997, devenant président du groupe UDF-Alliance à l’Assemblée nationale. En mars 2001, il laisse la circonscription de Lourdes pour se faire élire dans la première circonscription de la Haute-Garonne. Abandonnant ses mandats de conseiller général et de membre du conseil municipal de Lourdes, il remporte à la même date la mairie de Toulouse, succédant à Guy Hersant, maire par intérim en remplacement de Dominique Baudis, nommé président du CSA. Il préside la communauté d’agglomération du Grand Toulouse de 2001 à 2008. Réélu député de la Haute-Garonne le 16 juin 2002, et devenu secrétaire général de l’UMP le même mois lors du congrès du parti, il refuse d’entrer au gouvernement pour conserver la mairie de Toulouse. En 2004, il démissionnera cette fois de son poste de maire de la « Ville rose », se pliant à la règle du non-cumul des mandats, pour entrer le 31 mars 2004 au gouvernement comme ministre de la Santé et de la Protection sociale pendant un an. Le 29 novembre suivant, son titre s’élargit en ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille. Mais préférant le ministère des Affaires étrangères à un ministère des Affaires sociales ainsi élargi, il est nommé le 2 juin 2005, à la tête du Quai d’Orsay, dans le gouvernement de Dominique de Villepin. Comme ministre, il défend une diplomatie humanitaire, développant notamment le fonds Unitaid, un financement innovant d’achats de médicaments par une taxe prélevée sur les billets d’avion. Démissionnaire en mai 2007 à la suite de la victoire de Nicolas Sarkozy à la présidentielle, il annonce le jour de la passation des pouvoirs à Bernard Kouchner, renoncer à se présenter aux législatives dans la 1ère circonscription de Toulouse. Le 3 mars 2007, il avait été élu président du conseil d’administration d’Unitaid et en juin de la même année, il est nommé conseiller, chargé de mission auprès du Président de la République. En 2008, il devient professeur des universités – praticien hospitalier (PU-PH), enseignant à la faculté de médecine Paris-Diderot, et rattaché à l’hôpital Lariboisière. En février 2008, il devient conseiller spécial du Secrétaire général des Nations unies, chargé des sources novatrices de financement du développement, avec rang de Secrétaire général adjoint, qui n’est qu’un titre protocolaire et à titre bénévole, partageant cette fonction avec 80 autres personnes ayant le même titre. Poste qu’il occupe depuis 2008. Le 8 janvier 2012, il appelle à un soutien pour François Bayrou, candidat du MoDem pour l’élection présidentielle. En 2014, il propose sa candidature au conseil d’administration de l’ONG « Action contre la faim », mais ne sera pas élu. En 2016, il soutient Alain Juppé, candidat à la primaire présidentielle des Républicains. Depuis janvier 2016, il est professeur à la Medical School de Harvard. Il fut candidat à la présidence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dont le prochain président devait être désigné en 2017. Son argument de campagne : « Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où 2 milliards d’êtres humains n’ont pas accès aux médicaments et aux vaccins essentiels ». Mais, lors du conseil exécutif réuni le 25 janvier 2017, sa candidature ne sera pas retenue. Il soutient Emmanuel Macron pour l’élection présidentielle de 2017 et annonce son ralliement au candidat d’En Marche ! Retiré depuis plus de treize ans de la vie politique française au profit de lointaines fonctions internationales, en pleine pandémie de Covid-19 il s’est démultiplié dans les médias pour vanter les mérites du professeur Raoult, dont il est proche – il est d’ailleurs membre du conseil d’administration de l’IHU de Marseille, et de son traitement controversé à l’hydroxychloroquine. Ainsi (lui-même professeur en épidémiologie) est-il devenu en quelques semaines, un acteur incontournable de la crise sanitaire de coronavirus. Directeur de collection aux éditions Plon, il y a édité trois ouvrages : « Pour sauver nos retraites », « Le profit partagé », « La ville à bout de souffle ». Ses œuvres personnelles : « Des affaires pas si étrangères » chez Odile Jacob, 2007 et « La solidarité sauvera le monde » aux éditions Plon.
Philippe DOUSTE-BLAZY, né le 1er janvier 1953 à Lourdes. Fils de Louis Douste-Blazy, professeur de médecine et petit-fils d’Antoine Béguère, maire et dirigeant du FC Lourdes, il étudie la médecine à Toulouse, effectue son internat en 1976 et est diplômé en 1982 de la faculté de médecine à Toulouse. Il poursuit d’abord une carrière de cardiologue à Lourdes et Toulouse, notamment à l’hôpital de Purpan à partir de 1986. Il rejoint alors la Société française de cardiologie. En 1988, il devient professeur de médecine à la faculté des sciences de Toulouse en épidémiologie, économie de la santé et prévention. Sa carrière politique débute seulement en mars 1989 avec son élection dans le fauteuil du maire de Lourdes. En juin de la même année, il est élu député européen, sur la liste « Le Centre pour l’Europe ». Cette année est aussi celle de son élection comme directeur national de l’Association de recherche contre les élévations du cholestérol (ARCOL). Il connaît ensuite une ascension rapide. Fin mars 1993, il est élu député dans la deuxième circonscription des Hautes-Pyrénées. Mandat qu’il abandonne en mai à la suite de sa nomination comme ministre délégué à la Santé dans le gouvernement d’Edouard Balladur, fonction qu’il cumule avec celle de porte-parole du gouvernement à partir du 19 janvier 1995. En mars 1994, il est élu au conseil général des Hautes-Pyrénées. Soutien de Jacques Chirac à l’élection présidentielle de 1995, il est nommé le 18 mai ministre de la Culture dans le gouvernement d’Alain Juppé, après la victoire de Jacques Chirac. Il est réélu maire de Lourdes, au premier tour des municipales en juin 1995 et il devient secrétaire général du CDS (Force démocrate) en décembre suivant. Il sera ensuite membre du bureau politique de l’UDF (1996-1999) et vice-président de l’UDF. Le 2 mai 1997, à Lourdes, alors qu’il faisait campagne pour les élections législatives, un Albanais de 37 ans le poignarde dans le dos dans un magasin de souvenirs rue de la Grotte. En juin 1997, la défaite de la droite aux élections législatives anticipées lui fait perdre son portefeuille de ministre de la Culture. Il retrouve donc son siège de député des Hautes-Pyrénées en 1997, devenant président du groupe UDF-Alliance à l’Assemblée nationale. En mars 2001, il laisse la circonscription de Lourdes pour se faire élire dans la première circonscription de la Haute-Garonne. Abandonnant ses mandats de conseiller général et de membre du conseil municipal de Lourdes, il remporte à la même date la mairie de Toulouse, succédant à Guy Hersant, maire par intérim en remplacement de Dominique Baudis, nommé président du CSA. Il préside la communauté d’agglomération du Grand Toulouse de 2001 à 2008. Réélu député de la Haute-Garonne le 16 juin 2002, et devenu secrétaire général de l’UMP le même mois lors du congrès du parti, il refuse d’entrer au gouvernement pour conserver la mairie de Toulouse. En 2004, il démissionnera cette fois de son poste de maire de la « Ville rose », se pliant à la règle du non-cumul des mandats, pour entrer le 31 mars 2004 au gouvernement comme ministre de la Santé et de la Protection sociale pendant un an. Le 29 novembre suivant, son titre s’élargit en ministre des Solidarités, de la Santé et de la Famille. Mais préférant le ministère des Affaires étrangères à un ministère des Affaires sociales ainsi élargi, il est nommé le 2 juin 2005, à la tête du Quai d’Orsay, dans le gouvernement de Dominique de Villepin. Comme ministre, il défend une diplomatie humanitaire, développant notamment le fonds Unitaid, un financement innovant d’achats de médicaments par une taxe prélevée sur les billets d’avion. Démissionnaire en mai 2007 à la suite de la victoire de Nicolas Sarkozy à la présidentielle, il annonce le jour de la passation des pouvoirs à Bernard Kouchner, renoncer à se présenter aux législatives dans la 1ère circonscription de Toulouse. Le 3 mars 2007, il avait été élu président du conseil d’administration d’Unitaid et en juin de la même année, il est nommé conseiller, chargé de mission auprès du Président de la République. En 2008, il devient professeur des universités – praticien hospitalier (PU-PH), enseignant à la faculté de médecine Paris-Diderot, et rattaché à l’hôpital Lariboisière. En février 2008, il devient conseiller spécial du Secrétaire général des Nations unies, chargé des sources novatrices de financement du développement, avec rang de Secrétaire général adjoint, qui n’est qu’un titre protocolaire et à titre bénévole, partageant cette fonction avec 80 autres personnes ayant le même titre. Poste qu’il occupe depuis 2008. Le 8 janvier 2012, il appelle à un soutien pour François Bayrou, candidat du MoDem pour l’élection présidentielle. En 2014, il propose sa candidature au conseil d’administration de l’ONG « Action contre la faim », mais ne sera pas élu. En 2016, il soutient Alain Juppé, candidat à la primaire présidentielle des Républicains. Depuis janvier 2016, il est professeur à la Medical School de Harvard. Il fut candidat à la présidence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), dont le prochain président devait être désigné en 2017. Son argument de campagne : « Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où 2 milliards d’êtres humains n’ont pas accès aux médicaments et aux vaccins essentiels ». Mais, lors du conseil exécutif réuni le 25 janvier 2017, sa candidature ne sera pas retenue. Il soutient Emmanuel Macron pour l’élection présidentielle de 2017 et annonce son ralliement au candidat d’En Marche ! Retiré depuis plus de treize ans de la vie politique française au profit de lointaines fonctions internationales, en pleine pandémie de Covid-19 il s’est démultiplié dans les médias pour vanter les mérites du professeur Raoult, dont il est proche – il est d’ailleurs membre du conseil d’administration de l’IHU de Marseille, et de son traitement controversé à l’hydroxychloroquine. Ainsi (lui-même professeur en épidémiologie) est-il devenu en quelques semaines, un acteur incontournable de la crise sanitaire de coronavirus. Directeur de collection aux éditions Plon, il y a édité trois ouvrages : « Pour sauver nos retraites », « Le profit partagé », « La ville à bout de souffle ». Ses œuvres personnelles : « Des affaires pas si étrangères » chez Odile Jacob, 2007 et « La solidarité sauvera le monde » aux éditions Plon.DRUON Maurice (1918-2009)
Homme politique, écrivain, Secrétaire perpétuel de l’Académie française, mobilisé dans la cavalerie au 2e régiment de hussards de Tarbes
 Maurice DRUON, né le 23 avril 1918 dans le 13e arrondissement de Paris et mort le 14 avril 2009 dans le 7e arrondissement de cette même ville, est un écrivain et homme politique français. Il est le neveu de l'écrivain Joseph Kessel, avec qui il écrira les paroles du Chant des Partisans, sur la musique d'une chanson russe d'Anna Marly, qui deviendra l'hymne aux mouvements de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. En 1966, à 48 ans, il est élu à l'Académie française, et en devient le secrétaire perpétuel de 1985 à 1999. Maurice Druon a été ministre des Affaires culturelles en 1973-1974, sous la présidence de Georges Pompidou. En 1921, le 10e Hussards de Tarbes devient le 2e Hussards et reprend les traditions de ce régiment dissous à Versailles. Ce régiment connaît un aspirant célèbre : Maurice Druon, officier de cavalerie. Celui-ci immortalisera le quartier Larrey dans la littérature puisque dans son roman « Les Grandes Familles », il décrit une prise d’armes qui se déroule dans ce quartier ! Maurice DRUON écrira : « j’ai gardé bon souvenir de Tarbes, ainsi que de l’appartement que j’avais loué, dans un vieux jardin. » Il passera ensuite de Tarbes à Nîmes, de hussard il deviendra chasseur, et recevra un commandement. Mais il trouva qu’à Nîmes la vie y était plus austère qu’à Tarbes. Démobilisé à Tarbes, il rejoindra dans le Midi son oncle Joseph Kessel, écrira une pièce de théâtre, puis s'engagera dans un réseau de Résistance, auquel appartient déjà un étudiant en médecine, Jean Bernard, qu'il retrouvera plus tard à l'Académie française. Rendu célèbre par la série historique des « Rois maudits », il reçut le prix Goncourt pour « Les Grandes Familles » en 1948 et le prix Pierre de Monaco pour l'ensemble de son œuvre.
Maurice DRUON, né le 23 avril 1918 dans le 13e arrondissement de Paris et mort le 14 avril 2009 dans le 7e arrondissement de cette même ville, est un écrivain et homme politique français. Il est le neveu de l'écrivain Joseph Kessel, avec qui il écrira les paroles du Chant des Partisans, sur la musique d'une chanson russe d'Anna Marly, qui deviendra l'hymne aux mouvements de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. En 1966, à 48 ans, il est élu à l'Académie française, et en devient le secrétaire perpétuel de 1985 à 1999. Maurice Druon a été ministre des Affaires culturelles en 1973-1974, sous la présidence de Georges Pompidou. En 1921, le 10e Hussards de Tarbes devient le 2e Hussards et reprend les traditions de ce régiment dissous à Versailles. Ce régiment connaît un aspirant célèbre : Maurice Druon, officier de cavalerie. Celui-ci immortalisera le quartier Larrey dans la littérature puisque dans son roman « Les Grandes Familles », il décrit une prise d’armes qui se déroule dans ce quartier ! Maurice DRUON écrira : « j’ai gardé bon souvenir de Tarbes, ainsi que de l’appartement que j’avais loué, dans un vieux jardin. » Il passera ensuite de Tarbes à Nîmes, de hussard il deviendra chasseur, et recevra un commandement. Mais il trouva qu’à Nîmes la vie y était plus austère qu’à Tarbes. Démobilisé à Tarbes, il rejoindra dans le Midi son oncle Joseph Kessel, écrira une pièce de théâtre, puis s'engagera dans un réseau de Résistance, auquel appartient déjà un étudiant en médecine, Jean Bernard, qu'il retrouvera plus tard à l'Académie française. Rendu célèbre par la série historique des « Rois maudits », il reçut le prix Goncourt pour « Les Grandes Familles » en 1948 et le prix Pierre de Monaco pour l'ensemble de son œuvre.
 Maurice DRUON, né le 23 avril 1918 dans le 13e arrondissement de Paris et mort le 14 avril 2009 dans le 7e arrondissement de cette même ville, est un écrivain et homme politique français. Il est le neveu de l'écrivain Joseph Kessel, avec qui il écrira les paroles du Chant des Partisans, sur la musique d'une chanson russe d'Anna Marly, qui deviendra l'hymne aux mouvements de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. En 1966, à 48 ans, il est élu à l'Académie française, et en devient le secrétaire perpétuel de 1985 à 1999. Maurice Druon a été ministre des Affaires culturelles en 1973-1974, sous la présidence de Georges Pompidou. En 1921, le 10e Hussards de Tarbes devient le 2e Hussards et reprend les traditions de ce régiment dissous à Versailles. Ce régiment connaît un aspirant célèbre : Maurice Druon, officier de cavalerie. Celui-ci immortalisera le quartier Larrey dans la littérature puisque dans son roman « Les Grandes Familles », il décrit une prise d’armes qui se déroule dans ce quartier ! Maurice DRUON écrira : « j’ai gardé bon souvenir de Tarbes, ainsi que de l’appartement que j’avais loué, dans un vieux jardin. » Il passera ensuite de Tarbes à Nîmes, de hussard il deviendra chasseur, et recevra un commandement. Mais il trouva qu’à Nîmes la vie y était plus austère qu’à Tarbes. Démobilisé à Tarbes, il rejoindra dans le Midi son oncle Joseph Kessel, écrira une pièce de théâtre, puis s'engagera dans un réseau de Résistance, auquel appartient déjà un étudiant en médecine, Jean Bernard, qu'il retrouvera plus tard à l'Académie française. Rendu célèbre par la série historique des « Rois maudits », il reçut le prix Goncourt pour « Les Grandes Familles » en 1948 et le prix Pierre de Monaco pour l'ensemble de son œuvre.
Maurice DRUON, né le 23 avril 1918 dans le 13e arrondissement de Paris et mort le 14 avril 2009 dans le 7e arrondissement de cette même ville, est un écrivain et homme politique français. Il est le neveu de l'écrivain Joseph Kessel, avec qui il écrira les paroles du Chant des Partisans, sur la musique d'une chanson russe d'Anna Marly, qui deviendra l'hymne aux mouvements de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale. En 1966, à 48 ans, il est élu à l'Académie française, et en devient le secrétaire perpétuel de 1985 à 1999. Maurice Druon a été ministre des Affaires culturelles en 1973-1974, sous la présidence de Georges Pompidou. En 1921, le 10e Hussards de Tarbes devient le 2e Hussards et reprend les traditions de ce régiment dissous à Versailles. Ce régiment connaît un aspirant célèbre : Maurice Druon, officier de cavalerie. Celui-ci immortalisera le quartier Larrey dans la littérature puisque dans son roman « Les Grandes Familles », il décrit une prise d’armes qui se déroule dans ce quartier ! Maurice DRUON écrira : « j’ai gardé bon souvenir de Tarbes, ainsi que de l’appartement que j’avais loué, dans un vieux jardin. » Il passera ensuite de Tarbes à Nîmes, de hussard il deviendra chasseur, et recevra un commandement. Mais il trouva qu’à Nîmes la vie y était plus austère qu’à Tarbes. Démobilisé à Tarbes, il rejoindra dans le Midi son oncle Joseph Kessel, écrira une pièce de théâtre, puis s'engagera dans un réseau de Résistance, auquel appartient déjà un étudiant en médecine, Jean Bernard, qu'il retrouvera plus tard à l'Académie française. Rendu célèbre par la série historique des « Rois maudits », il reçut le prix Goncourt pour « Les Grandes Familles » en 1948 et le prix Pierre de Monaco pour l'ensemble de son œuvre.DUCLOS Jacques (1896-1975)
Homme politique, dirigeant du Parti communiste français
 Jacques DUCLOS, né le 2 octobre 1896 à Louey et mort le 25 avril 1975 à Montreuil, à l’âge de 78 ans. Il fut l’un des principaux dirigeants du Parti communiste français durant près de cinquante ans, en compagnie de Maurice Thorez et de Benoît Frachon. Fils d’Antoine Duclos, charpentier qui tenait une auberge et d’une mère couturière, il fut apprenti-pâtissier dès l’âge de douze ans. En 1912, à l’âge de 16 ans, il quitta la Bigorre pour Paris pour aller exercer ses talents de pâtissier dans les hôtels parisiens. En 1915, il participa à la bataille de Verdun, où il sera blessé, puis fait prisonnier le 16 avril 1917 au Chemin des Dames, et envoyé en Allemagne pour travailler dans les champs. À la fin de la guerre, il s’investira dans l’Association républicaine des anciens combattants (ARAC), créée notamment par Henri Barbusse (Prix Goncourt 1916), Paul Vaillant-Couturier (futur député) et Boris Souvarine. Il y travaillera comme secrétaire de rédaction du journal. Ce fut le 31 décembre 1920 qu’il s’engagera directement à la SFIC, futur Parti communiste français (PCF). Il sera battu aux élections législatives du 11 mai 1924, mais le 28 mars 1926 devenu membre du comité central, il sera élu député de la Seine, à l’âge de 29 ans, en battant le futur président du Conseil, Paul Reynaud, à l’occasion d’une élection partielle. Il sera réélu le 29 avril 1928 dans le 20e arrondissement, en battant cette fois-ci, Léon Blum. Mais il sera ensuite battu le 8 mai 1932 par Marcel Déat, alors socialiste. Le 3 mai 1936, il sera réélu député à Montreuil, qui devint son fief électoral. Il sera plusieurs fois vice-président de la Chambre des députés. Ses écrits antimilitaristes furent réprimés à cette époque. Et il fut arrêté en 1927 pour propagande antimilitariste. Il vivra dans la clandestinité plutôt que dans l’Hémicycle entre 1927 et 1931, mais séjournera souvent à Moscou, assumant des responsabilités pour le compte de l’Internationale ou du Profintern, l’Internationale syndicale Rouge. En janvier 1931, bénéficiant d’un non-lieu, la Chambre vota l’amnistie pour lui, ce qui lui permit de reprendre son activité politique au grand jour. En 1931, il fera son entrée au bureau politique et au secrétariat du PCF et devint le bras droit de Maurice Thorez, jeune secrétaire général du PCF du 18 juillet 1930 au 17 mai 1964. Il avait 35 ans tandis que Thorez 31 ans. Homme du Komintern en France, il occupera un poste stratégique qui l’amènera à se rendre à Moscou pour prendre ses consignes. En relation directe avec le Kremlin, où il rencontrait Staline, il s’occupera aussi de l’organisation de plusieurs partis communistes européens. Après les émeutes du 6 février 1934 auxquelles les communistes participèrent, il fut l’un de ceux qui appelèrent à l’unité du futur Front populaire. Après son élection de mai 1936, il milita en faveur des Républicains espagnols, fut contre les Accords de Munich et proposa un "prélèvement sur les grosses fortunes". Il approuva aussi le Pacte germano-soviétique, signé le 23 août 1939 à Moscou, ce qui le conduisit à fuir la France en octobre 1939 vers la Belgique et à être déchu de son mandat de parlementaire le 20 février 1940. Le PCF fut dissous le 26 septembre 1939 par Édouard Daladier. En juin 1940, il retourna en France à vélo pour diriger l’activité clandestine des communistes jusqu’en 1944, aidé d’André Marty et de Benoît Frachon. Sous l’Occupation, sa tête fut mise à prix par les Allemands, car il était l’un des organisateurs de l’action clandestine du Parti communiste. Pendant toute cette période de juin 1940 à août 1944, où il fut responsable du PCF clandestin, toujours très prolixe, aussi bien en paroles qu’en écrits, il sera le principal rédacteur de la presse communiste clandestine. En août 1944, il réintègrera le siège du Comité central et en septembre 1944, il négociera avec le Général de Gaulle l’entrée de ministres communistes dans le gouvernement provisoire. Au retour à Paris de Thorez, le 27 novembre 1944, il redeviendra le numéro deux du PCF, sans que l’on ait connaissance de rivalités, qui auraient pu naître entre les deux hommes. De 1945 à 1947, il jouera un rôle politique et parlementaire de première importance. Il proposera à l’Assemblée la nationalisation d’une grande partie de l’économie française. De 1946 à 1958, pendant toute la IVe République, il sera élu député sans discontinuité et présidera à l’Assemblée le groupe parlementaire communiste. Le 10 octobre 1950, il fut victime d’une hémiplégie et jusqu’à sa mort en 1964, celui-ci effectuera de fréquents séjours en URSS pour y être soigné. Il fera alors fonction de secrétaire général par intérim. Le 28 mai 1952, lors des manifestations interdites organisées par la CGT et le PCF contre la venue à Paris du général américain Matthew Ridgway, qui venait d’être nommé commandant suprême des Forces alliées de l’OTAN et que la propagande communiste accusait de mener une guerre bactériologique en Corée du Nord, il fut victime d’une manœuvre policière. (On l’accusa d’avoir transporté des pigeons voyageurs tués au cours d’une partie de chasse, qui furent qualifiés de « pigeons voyageurs » pour porter des messages secrets à Moscou). Il sera arrêté malgré son mandat parlementaire (qui ne fut pas levé). Il restera à la prison de la Santé jusqu’en juillet 1952, ce qui le rendit encore plus populaire. Après s’être opposé au retour du Général de Gaulle et à l’instauration de la Ve République, en novembre 1958, il perd son siège de député, battu à Montreuil par un médecin gaulliste. Mais en avril 1959, il entrera au Sénat, y sera réélu en septembre 1968, où il présidera jusqu’à sa mort, le groupe communiste. En septembre 1965, avec Waldeck Rochet, il apportera son soutien à la candidature de François Mitterrand à l’élection présidentielle de décembre 1965. Dans les années qui suivirent la mort de Thorez en 1964, aucun successeur ne s’imposa au sein du Parti communiste et sa place restera importante. En 1968, année du Printemps de Prague, il approuvera l’invasion de la Tchécoslovaquie par les armées du Pacte de Varsovie. En 1969, favorable au "non" au référendum du 27 avril 1969 sur la régionalisation, soutenu par son ami Louis Talamoni, il sera investi comme candidat à l’élection présidentielle qui suivit le départ du Général de Gaulle. À 72 ans, grâce à sa verve et à son côté bonhomme, il fit une campagne très appréciée et atteignit le 1er juin 1969 la troisième place, recueillant 4,8 millions de voix, soit 21,3% des voix, écrasant les socialistes et frôlant de justesse sa qualification pour le second tour. Avant le second tour, il retint l’attention de l’opinion publique en déclarant, à propos des deux candidats restés en lice : Georges Pompidou et Alain Poher, « c’est blanc bonnet et bonnet blanc » et en appela à une abstention massive. De 1962 à 1975, il fut président de l’Association des amis de la Commune de Paris (1871). À l’occasion de son 70e anniversaire, il reçut en octobre 1971, l’ordre de Lénine « pour les grands services rendus au mouvement communiste et ouvrier international » et, dans le même temps, le Conseil d’État de la République démocratique d’Allemagne décida de lui décerner l’ordre de Karl Marx. Le 28 juin 1974, il votera pour la loi fixant à 18 ans l’âge de la majorité. Il fera de même pour la loi dite « Veil » relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Il fut l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, des essais politiques et des récits historiques ainsi que ses Mémoires. Il présenta, en 1973, le cinquième tome de ses Mémoires pour parler de la guerre d’Indochine et de Lautréamont. Au mois d’avril 1975, après une hospitalisation en janvier, il se rendit à Louey, où la télévision devait commencer le tournage d’un film sur sa vie, mais se sentant mal il fut hospitalisé à Paris, où il mourut d’une congestion pulmonaire à 78 ans, le 25 avril 1975. Il fut enterré au Père-Lachaise le 29 avril 1975, en présence de quelque 200 000 personnes, l’occasion d’un dernier hommage de l’élite du mouvement communiste international. Il était un homme de très petite taille, puisqu’il mesurait 1m49, sa voix rocailleuse et son accent devinrent familiers aux électeurs. Il laisse le souvenir d’un tribun redoutable et incontournable, d’un orateur très magistral, doté d’un grand sens de la repartie et d’une culture exceptionnelle qu’il s’était forgée en autodidacte, en lisant énormément, et qui faisait de nombreuses propositions et interpellations sur la politique. Ses principales publications sont : Écrits de prison (1952), la Commune de Paris à l’assaut du ciel (1961), la Première Internationale (1964), Octobre 17 vu de France (1967), Mémoires (7 volumes 1968-1973), Que sont devenus les communistes ? (1971), Bakounine et Marx (1974), Ce que je crois (1975).
Jacques DUCLOS, né le 2 octobre 1896 à Louey et mort le 25 avril 1975 à Montreuil, à l’âge de 78 ans. Il fut l’un des principaux dirigeants du Parti communiste français durant près de cinquante ans, en compagnie de Maurice Thorez et de Benoît Frachon. Fils d’Antoine Duclos, charpentier qui tenait une auberge et d’une mère couturière, il fut apprenti-pâtissier dès l’âge de douze ans. En 1912, à l’âge de 16 ans, il quitta la Bigorre pour Paris pour aller exercer ses talents de pâtissier dans les hôtels parisiens. En 1915, il participa à la bataille de Verdun, où il sera blessé, puis fait prisonnier le 16 avril 1917 au Chemin des Dames, et envoyé en Allemagne pour travailler dans les champs. À la fin de la guerre, il s’investira dans l’Association républicaine des anciens combattants (ARAC), créée notamment par Henri Barbusse (Prix Goncourt 1916), Paul Vaillant-Couturier (futur député) et Boris Souvarine. Il y travaillera comme secrétaire de rédaction du journal. Ce fut le 31 décembre 1920 qu’il s’engagera directement à la SFIC, futur Parti communiste français (PCF). Il sera battu aux élections législatives du 11 mai 1924, mais le 28 mars 1926 devenu membre du comité central, il sera élu député de la Seine, à l’âge de 29 ans, en battant le futur président du Conseil, Paul Reynaud, à l’occasion d’une élection partielle. Il sera réélu le 29 avril 1928 dans le 20e arrondissement, en battant cette fois-ci, Léon Blum. Mais il sera ensuite battu le 8 mai 1932 par Marcel Déat, alors socialiste. Le 3 mai 1936, il sera réélu député à Montreuil, qui devint son fief électoral. Il sera plusieurs fois vice-président de la Chambre des députés. Ses écrits antimilitaristes furent réprimés à cette époque. Et il fut arrêté en 1927 pour propagande antimilitariste. Il vivra dans la clandestinité plutôt que dans l’Hémicycle entre 1927 et 1931, mais séjournera souvent à Moscou, assumant des responsabilités pour le compte de l’Internationale ou du Profintern, l’Internationale syndicale Rouge. En janvier 1931, bénéficiant d’un non-lieu, la Chambre vota l’amnistie pour lui, ce qui lui permit de reprendre son activité politique au grand jour. En 1931, il fera son entrée au bureau politique et au secrétariat du PCF et devint le bras droit de Maurice Thorez, jeune secrétaire général du PCF du 18 juillet 1930 au 17 mai 1964. Il avait 35 ans tandis que Thorez 31 ans. Homme du Komintern en France, il occupera un poste stratégique qui l’amènera à se rendre à Moscou pour prendre ses consignes. En relation directe avec le Kremlin, où il rencontrait Staline, il s’occupera aussi de l’organisation de plusieurs partis communistes européens. Après les émeutes du 6 février 1934 auxquelles les communistes participèrent, il fut l’un de ceux qui appelèrent à l’unité du futur Front populaire. Après son élection de mai 1936, il milita en faveur des Républicains espagnols, fut contre les Accords de Munich et proposa un "prélèvement sur les grosses fortunes". Il approuva aussi le Pacte germano-soviétique, signé le 23 août 1939 à Moscou, ce qui le conduisit à fuir la France en octobre 1939 vers la Belgique et à être déchu de son mandat de parlementaire le 20 février 1940. Le PCF fut dissous le 26 septembre 1939 par Édouard Daladier. En juin 1940, il retourna en France à vélo pour diriger l’activité clandestine des communistes jusqu’en 1944, aidé d’André Marty et de Benoît Frachon. Sous l’Occupation, sa tête fut mise à prix par les Allemands, car il était l’un des organisateurs de l’action clandestine du Parti communiste. Pendant toute cette période de juin 1940 à août 1944, où il fut responsable du PCF clandestin, toujours très prolixe, aussi bien en paroles qu’en écrits, il sera le principal rédacteur de la presse communiste clandestine. En août 1944, il réintègrera le siège du Comité central et en septembre 1944, il négociera avec le Général de Gaulle l’entrée de ministres communistes dans le gouvernement provisoire. Au retour à Paris de Thorez, le 27 novembre 1944, il redeviendra le numéro deux du PCF, sans que l’on ait connaissance de rivalités, qui auraient pu naître entre les deux hommes. De 1945 à 1947, il jouera un rôle politique et parlementaire de première importance. Il proposera à l’Assemblée la nationalisation d’une grande partie de l’économie française. De 1946 à 1958, pendant toute la IVe République, il sera élu député sans discontinuité et présidera à l’Assemblée le groupe parlementaire communiste. Le 10 octobre 1950, il fut victime d’une hémiplégie et jusqu’à sa mort en 1964, celui-ci effectuera de fréquents séjours en URSS pour y être soigné. Il fera alors fonction de secrétaire général par intérim. Le 28 mai 1952, lors des manifestations interdites organisées par la CGT et le PCF contre la venue à Paris du général américain Matthew Ridgway, qui venait d’être nommé commandant suprême des Forces alliées de l’OTAN et que la propagande communiste accusait de mener une guerre bactériologique en Corée du Nord, il fut victime d’une manœuvre policière. (On l’accusa d’avoir transporté des pigeons voyageurs tués au cours d’une partie de chasse, qui furent qualifiés de « pigeons voyageurs » pour porter des messages secrets à Moscou). Il sera arrêté malgré son mandat parlementaire (qui ne fut pas levé). Il restera à la prison de la Santé jusqu’en juillet 1952, ce qui le rendit encore plus populaire. Après s’être opposé au retour du Général de Gaulle et à l’instauration de la Ve République, en novembre 1958, il perd son siège de député, battu à Montreuil par un médecin gaulliste. Mais en avril 1959, il entrera au Sénat, y sera réélu en septembre 1968, où il présidera jusqu’à sa mort, le groupe communiste. En septembre 1965, avec Waldeck Rochet, il apportera son soutien à la candidature de François Mitterrand à l’élection présidentielle de décembre 1965. Dans les années qui suivirent la mort de Thorez en 1964, aucun successeur ne s’imposa au sein du Parti communiste et sa place restera importante. En 1968, année du Printemps de Prague, il approuvera l’invasion de la Tchécoslovaquie par les armées du Pacte de Varsovie. En 1969, favorable au "non" au référendum du 27 avril 1969 sur la régionalisation, soutenu par son ami Louis Talamoni, il sera investi comme candidat à l’élection présidentielle qui suivit le départ du Général de Gaulle. À 72 ans, grâce à sa verve et à son côté bonhomme, il fit une campagne très appréciée et atteignit le 1er juin 1969 la troisième place, recueillant 4,8 millions de voix, soit 21,3% des voix, écrasant les socialistes et frôlant de justesse sa qualification pour le second tour. Avant le second tour, il retint l’attention de l’opinion publique en déclarant, à propos des deux candidats restés en lice : Georges Pompidou et Alain Poher, « c’est blanc bonnet et bonnet blanc » et en appela à une abstention massive. De 1962 à 1975, il fut président de l’Association des amis de la Commune de Paris (1871). À l’occasion de son 70e anniversaire, il reçut en octobre 1971, l’ordre de Lénine « pour les grands services rendus au mouvement communiste et ouvrier international » et, dans le même temps, le Conseil d’État de la République démocratique d’Allemagne décida de lui décerner l’ordre de Karl Marx. Le 28 juin 1974, il votera pour la loi fixant à 18 ans l’âge de la majorité. Il fera de même pour la loi dite « Veil » relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Il fut l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, des essais politiques et des récits historiques ainsi que ses Mémoires. Il présenta, en 1973, le cinquième tome de ses Mémoires pour parler de la guerre d’Indochine et de Lautréamont. Au mois d’avril 1975, après une hospitalisation en janvier, il se rendit à Louey, où la télévision devait commencer le tournage d’un film sur sa vie, mais se sentant mal il fut hospitalisé à Paris, où il mourut d’une congestion pulmonaire à 78 ans, le 25 avril 1975. Il fut enterré au Père-Lachaise le 29 avril 1975, en présence de quelque 200 000 personnes, l’occasion d’un dernier hommage de l’élite du mouvement communiste international. Il était un homme de très petite taille, puisqu’il mesurait 1m49, sa voix rocailleuse et son accent devinrent familiers aux électeurs. Il laisse le souvenir d’un tribun redoutable et incontournable, d’un orateur très magistral, doté d’un grand sens de la repartie et d’une culture exceptionnelle qu’il s’était forgée en autodidacte, en lisant énormément, et qui faisait de nombreuses propositions et interpellations sur la politique. Ses principales publications sont : Écrits de prison (1952), la Commune de Paris à l’assaut du ciel (1961), la Première Internationale (1964), Octobre 17 vu de France (1967), Mémoires (7 volumes 1968-1973), Que sont devenus les communistes ? (1971), Bakounine et Marx (1974), Ce que je crois (1975).
 Jacques DUCLOS, né le 2 octobre 1896 à Louey et mort le 25 avril 1975 à Montreuil, à l’âge de 78 ans. Il fut l’un des principaux dirigeants du Parti communiste français durant près de cinquante ans, en compagnie de Maurice Thorez et de Benoît Frachon. Fils d’Antoine Duclos, charpentier qui tenait une auberge et d’une mère couturière, il fut apprenti-pâtissier dès l’âge de douze ans. En 1912, à l’âge de 16 ans, il quitta la Bigorre pour Paris pour aller exercer ses talents de pâtissier dans les hôtels parisiens. En 1915, il participa à la bataille de Verdun, où il sera blessé, puis fait prisonnier le 16 avril 1917 au Chemin des Dames, et envoyé en Allemagne pour travailler dans les champs. À la fin de la guerre, il s’investira dans l’Association républicaine des anciens combattants (ARAC), créée notamment par Henri Barbusse (Prix Goncourt 1916), Paul Vaillant-Couturier (futur député) et Boris Souvarine. Il y travaillera comme secrétaire de rédaction du journal. Ce fut le 31 décembre 1920 qu’il s’engagera directement à la SFIC, futur Parti communiste français (PCF). Il sera battu aux élections législatives du 11 mai 1924, mais le 28 mars 1926 devenu membre du comité central, il sera élu député de la Seine, à l’âge de 29 ans, en battant le futur président du Conseil, Paul Reynaud, à l’occasion d’une élection partielle. Il sera réélu le 29 avril 1928 dans le 20e arrondissement, en battant cette fois-ci, Léon Blum. Mais il sera ensuite battu le 8 mai 1932 par Marcel Déat, alors socialiste. Le 3 mai 1936, il sera réélu député à Montreuil, qui devint son fief électoral. Il sera plusieurs fois vice-président de la Chambre des députés. Ses écrits antimilitaristes furent réprimés à cette époque. Et il fut arrêté en 1927 pour propagande antimilitariste. Il vivra dans la clandestinité plutôt que dans l’Hémicycle entre 1927 et 1931, mais séjournera souvent à Moscou, assumant des responsabilités pour le compte de l’Internationale ou du Profintern, l’Internationale syndicale Rouge. En janvier 1931, bénéficiant d’un non-lieu, la Chambre vota l’amnistie pour lui, ce qui lui permit de reprendre son activité politique au grand jour. En 1931, il fera son entrée au bureau politique et au secrétariat du PCF et devint le bras droit de Maurice Thorez, jeune secrétaire général du PCF du 18 juillet 1930 au 17 mai 1964. Il avait 35 ans tandis que Thorez 31 ans. Homme du Komintern en France, il occupera un poste stratégique qui l’amènera à se rendre à Moscou pour prendre ses consignes. En relation directe avec le Kremlin, où il rencontrait Staline, il s’occupera aussi de l’organisation de plusieurs partis communistes européens. Après les émeutes du 6 février 1934 auxquelles les communistes participèrent, il fut l’un de ceux qui appelèrent à l’unité du futur Front populaire. Après son élection de mai 1936, il milita en faveur des Républicains espagnols, fut contre les Accords de Munich et proposa un "prélèvement sur les grosses fortunes". Il approuva aussi le Pacte germano-soviétique, signé le 23 août 1939 à Moscou, ce qui le conduisit à fuir la France en octobre 1939 vers la Belgique et à être déchu de son mandat de parlementaire le 20 février 1940. Le PCF fut dissous le 26 septembre 1939 par Édouard Daladier. En juin 1940, il retourna en France à vélo pour diriger l’activité clandestine des communistes jusqu’en 1944, aidé d’André Marty et de Benoît Frachon. Sous l’Occupation, sa tête fut mise à prix par les Allemands, car il était l’un des organisateurs de l’action clandestine du Parti communiste. Pendant toute cette période de juin 1940 à août 1944, où il fut responsable du PCF clandestin, toujours très prolixe, aussi bien en paroles qu’en écrits, il sera le principal rédacteur de la presse communiste clandestine. En août 1944, il réintègrera le siège du Comité central et en septembre 1944, il négociera avec le Général de Gaulle l’entrée de ministres communistes dans le gouvernement provisoire. Au retour à Paris de Thorez, le 27 novembre 1944, il redeviendra le numéro deux du PCF, sans que l’on ait connaissance de rivalités, qui auraient pu naître entre les deux hommes. De 1945 à 1947, il jouera un rôle politique et parlementaire de première importance. Il proposera à l’Assemblée la nationalisation d’une grande partie de l’économie française. De 1946 à 1958, pendant toute la IVe République, il sera élu député sans discontinuité et présidera à l’Assemblée le groupe parlementaire communiste. Le 10 octobre 1950, il fut victime d’une hémiplégie et jusqu’à sa mort en 1964, celui-ci effectuera de fréquents séjours en URSS pour y être soigné. Il fera alors fonction de secrétaire général par intérim. Le 28 mai 1952, lors des manifestations interdites organisées par la CGT et le PCF contre la venue à Paris du général américain Matthew Ridgway, qui venait d’être nommé commandant suprême des Forces alliées de l’OTAN et que la propagande communiste accusait de mener une guerre bactériologique en Corée du Nord, il fut victime d’une manœuvre policière. (On l’accusa d’avoir transporté des pigeons voyageurs tués au cours d’une partie de chasse, qui furent qualifiés de « pigeons voyageurs » pour porter des messages secrets à Moscou). Il sera arrêté malgré son mandat parlementaire (qui ne fut pas levé). Il restera à la prison de la Santé jusqu’en juillet 1952, ce qui le rendit encore plus populaire. Après s’être opposé au retour du Général de Gaulle et à l’instauration de la Ve République, en novembre 1958, il perd son siège de député, battu à Montreuil par un médecin gaulliste. Mais en avril 1959, il entrera au Sénat, y sera réélu en septembre 1968, où il présidera jusqu’à sa mort, le groupe communiste. En septembre 1965, avec Waldeck Rochet, il apportera son soutien à la candidature de François Mitterrand à l’élection présidentielle de décembre 1965. Dans les années qui suivirent la mort de Thorez en 1964, aucun successeur ne s’imposa au sein du Parti communiste et sa place restera importante. En 1968, année du Printemps de Prague, il approuvera l’invasion de la Tchécoslovaquie par les armées du Pacte de Varsovie. En 1969, favorable au "non" au référendum du 27 avril 1969 sur la régionalisation, soutenu par son ami Louis Talamoni, il sera investi comme candidat à l’élection présidentielle qui suivit le départ du Général de Gaulle. À 72 ans, grâce à sa verve et à son côté bonhomme, il fit une campagne très appréciée et atteignit le 1er juin 1969 la troisième place, recueillant 4,8 millions de voix, soit 21,3% des voix, écrasant les socialistes et frôlant de justesse sa qualification pour le second tour. Avant le second tour, il retint l’attention de l’opinion publique en déclarant, à propos des deux candidats restés en lice : Georges Pompidou et Alain Poher, « c’est blanc bonnet et bonnet blanc » et en appela à une abstention massive. De 1962 à 1975, il fut président de l’Association des amis de la Commune de Paris (1871). À l’occasion de son 70e anniversaire, il reçut en octobre 1971, l’ordre de Lénine « pour les grands services rendus au mouvement communiste et ouvrier international » et, dans le même temps, le Conseil d’État de la République démocratique d’Allemagne décida de lui décerner l’ordre de Karl Marx. Le 28 juin 1974, il votera pour la loi fixant à 18 ans l’âge de la majorité. Il fera de même pour la loi dite « Veil » relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Il fut l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, des essais politiques et des récits historiques ainsi que ses Mémoires. Il présenta, en 1973, le cinquième tome de ses Mémoires pour parler de la guerre d’Indochine et de Lautréamont. Au mois d’avril 1975, après une hospitalisation en janvier, il se rendit à Louey, où la télévision devait commencer le tournage d’un film sur sa vie, mais se sentant mal il fut hospitalisé à Paris, où il mourut d’une congestion pulmonaire à 78 ans, le 25 avril 1975. Il fut enterré au Père-Lachaise le 29 avril 1975, en présence de quelque 200 000 personnes, l’occasion d’un dernier hommage de l’élite du mouvement communiste international. Il était un homme de très petite taille, puisqu’il mesurait 1m49, sa voix rocailleuse et son accent devinrent familiers aux électeurs. Il laisse le souvenir d’un tribun redoutable et incontournable, d’un orateur très magistral, doté d’un grand sens de la repartie et d’une culture exceptionnelle qu’il s’était forgée en autodidacte, en lisant énormément, et qui faisait de nombreuses propositions et interpellations sur la politique. Ses principales publications sont : Écrits de prison (1952), la Commune de Paris à l’assaut du ciel (1961), la Première Internationale (1964), Octobre 17 vu de France (1967), Mémoires (7 volumes 1968-1973), Que sont devenus les communistes ? (1971), Bakounine et Marx (1974), Ce que je crois (1975).
Jacques DUCLOS, né le 2 octobre 1896 à Louey et mort le 25 avril 1975 à Montreuil, à l’âge de 78 ans. Il fut l’un des principaux dirigeants du Parti communiste français durant près de cinquante ans, en compagnie de Maurice Thorez et de Benoît Frachon. Fils d’Antoine Duclos, charpentier qui tenait une auberge et d’une mère couturière, il fut apprenti-pâtissier dès l’âge de douze ans. En 1912, à l’âge de 16 ans, il quitta la Bigorre pour Paris pour aller exercer ses talents de pâtissier dans les hôtels parisiens. En 1915, il participa à la bataille de Verdun, où il sera blessé, puis fait prisonnier le 16 avril 1917 au Chemin des Dames, et envoyé en Allemagne pour travailler dans les champs. À la fin de la guerre, il s’investira dans l’Association républicaine des anciens combattants (ARAC), créée notamment par Henri Barbusse (Prix Goncourt 1916), Paul Vaillant-Couturier (futur député) et Boris Souvarine. Il y travaillera comme secrétaire de rédaction du journal. Ce fut le 31 décembre 1920 qu’il s’engagera directement à la SFIC, futur Parti communiste français (PCF). Il sera battu aux élections législatives du 11 mai 1924, mais le 28 mars 1926 devenu membre du comité central, il sera élu député de la Seine, à l’âge de 29 ans, en battant le futur président du Conseil, Paul Reynaud, à l’occasion d’une élection partielle. Il sera réélu le 29 avril 1928 dans le 20e arrondissement, en battant cette fois-ci, Léon Blum. Mais il sera ensuite battu le 8 mai 1932 par Marcel Déat, alors socialiste. Le 3 mai 1936, il sera réélu député à Montreuil, qui devint son fief électoral. Il sera plusieurs fois vice-président de la Chambre des députés. Ses écrits antimilitaristes furent réprimés à cette époque. Et il fut arrêté en 1927 pour propagande antimilitariste. Il vivra dans la clandestinité plutôt que dans l’Hémicycle entre 1927 et 1931, mais séjournera souvent à Moscou, assumant des responsabilités pour le compte de l’Internationale ou du Profintern, l’Internationale syndicale Rouge. En janvier 1931, bénéficiant d’un non-lieu, la Chambre vota l’amnistie pour lui, ce qui lui permit de reprendre son activité politique au grand jour. En 1931, il fera son entrée au bureau politique et au secrétariat du PCF et devint le bras droit de Maurice Thorez, jeune secrétaire général du PCF du 18 juillet 1930 au 17 mai 1964. Il avait 35 ans tandis que Thorez 31 ans. Homme du Komintern en France, il occupera un poste stratégique qui l’amènera à se rendre à Moscou pour prendre ses consignes. En relation directe avec le Kremlin, où il rencontrait Staline, il s’occupera aussi de l’organisation de plusieurs partis communistes européens. Après les émeutes du 6 février 1934 auxquelles les communistes participèrent, il fut l’un de ceux qui appelèrent à l’unité du futur Front populaire. Après son élection de mai 1936, il milita en faveur des Républicains espagnols, fut contre les Accords de Munich et proposa un "prélèvement sur les grosses fortunes". Il approuva aussi le Pacte germano-soviétique, signé le 23 août 1939 à Moscou, ce qui le conduisit à fuir la France en octobre 1939 vers la Belgique et à être déchu de son mandat de parlementaire le 20 février 1940. Le PCF fut dissous le 26 septembre 1939 par Édouard Daladier. En juin 1940, il retourna en France à vélo pour diriger l’activité clandestine des communistes jusqu’en 1944, aidé d’André Marty et de Benoît Frachon. Sous l’Occupation, sa tête fut mise à prix par les Allemands, car il était l’un des organisateurs de l’action clandestine du Parti communiste. Pendant toute cette période de juin 1940 à août 1944, où il fut responsable du PCF clandestin, toujours très prolixe, aussi bien en paroles qu’en écrits, il sera le principal rédacteur de la presse communiste clandestine. En août 1944, il réintègrera le siège du Comité central et en septembre 1944, il négociera avec le Général de Gaulle l’entrée de ministres communistes dans le gouvernement provisoire. Au retour à Paris de Thorez, le 27 novembre 1944, il redeviendra le numéro deux du PCF, sans que l’on ait connaissance de rivalités, qui auraient pu naître entre les deux hommes. De 1945 à 1947, il jouera un rôle politique et parlementaire de première importance. Il proposera à l’Assemblée la nationalisation d’une grande partie de l’économie française. De 1946 à 1958, pendant toute la IVe République, il sera élu député sans discontinuité et présidera à l’Assemblée le groupe parlementaire communiste. Le 10 octobre 1950, il fut victime d’une hémiplégie et jusqu’à sa mort en 1964, celui-ci effectuera de fréquents séjours en URSS pour y être soigné. Il fera alors fonction de secrétaire général par intérim. Le 28 mai 1952, lors des manifestations interdites organisées par la CGT et le PCF contre la venue à Paris du général américain Matthew Ridgway, qui venait d’être nommé commandant suprême des Forces alliées de l’OTAN et que la propagande communiste accusait de mener une guerre bactériologique en Corée du Nord, il fut victime d’une manœuvre policière. (On l’accusa d’avoir transporté des pigeons voyageurs tués au cours d’une partie de chasse, qui furent qualifiés de « pigeons voyageurs » pour porter des messages secrets à Moscou). Il sera arrêté malgré son mandat parlementaire (qui ne fut pas levé). Il restera à la prison de la Santé jusqu’en juillet 1952, ce qui le rendit encore plus populaire. Après s’être opposé au retour du Général de Gaulle et à l’instauration de la Ve République, en novembre 1958, il perd son siège de député, battu à Montreuil par un médecin gaulliste. Mais en avril 1959, il entrera au Sénat, y sera réélu en septembre 1968, où il présidera jusqu’à sa mort, le groupe communiste. En septembre 1965, avec Waldeck Rochet, il apportera son soutien à la candidature de François Mitterrand à l’élection présidentielle de décembre 1965. Dans les années qui suivirent la mort de Thorez en 1964, aucun successeur ne s’imposa au sein du Parti communiste et sa place restera importante. En 1968, année du Printemps de Prague, il approuvera l’invasion de la Tchécoslovaquie par les armées du Pacte de Varsovie. En 1969, favorable au "non" au référendum du 27 avril 1969 sur la régionalisation, soutenu par son ami Louis Talamoni, il sera investi comme candidat à l’élection présidentielle qui suivit le départ du Général de Gaulle. À 72 ans, grâce à sa verve et à son côté bonhomme, il fit une campagne très appréciée et atteignit le 1er juin 1969 la troisième place, recueillant 4,8 millions de voix, soit 21,3% des voix, écrasant les socialistes et frôlant de justesse sa qualification pour le second tour. Avant le second tour, il retint l’attention de l’opinion publique en déclarant, à propos des deux candidats restés en lice : Georges Pompidou et Alain Poher, « c’est blanc bonnet et bonnet blanc » et en appela à une abstention massive. De 1962 à 1975, il fut président de l’Association des amis de la Commune de Paris (1871). À l’occasion de son 70e anniversaire, il reçut en octobre 1971, l’ordre de Lénine « pour les grands services rendus au mouvement communiste et ouvrier international » et, dans le même temps, le Conseil d’État de la République démocratique d’Allemagne décida de lui décerner l’ordre de Karl Marx. Le 28 juin 1974, il votera pour la loi fixant à 18 ans l’âge de la majorité. Il fera de même pour la loi dite « Veil » relative à l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Il fut l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages, des essais politiques et des récits historiques ainsi que ses Mémoires. Il présenta, en 1973, le cinquième tome de ses Mémoires pour parler de la guerre d’Indochine et de Lautréamont. Au mois d’avril 1975, après une hospitalisation en janvier, il se rendit à Louey, où la télévision devait commencer le tournage d’un film sur sa vie, mais se sentant mal il fut hospitalisé à Paris, où il mourut d’une congestion pulmonaire à 78 ans, le 25 avril 1975. Il fut enterré au Père-Lachaise le 29 avril 1975, en présence de quelque 200 000 personnes, l’occasion d’un dernier hommage de l’élite du mouvement communiste international. Il était un homme de très petite taille, puisqu’il mesurait 1m49, sa voix rocailleuse et son accent devinrent familiers aux électeurs. Il laisse le souvenir d’un tribun redoutable et incontournable, d’un orateur très magistral, doté d’un grand sens de la repartie et d’une culture exceptionnelle qu’il s’était forgée en autodidacte, en lisant énormément, et qui faisait de nombreuses propositions et interpellations sur la politique. Ses principales publications sont : Écrits de prison (1952), la Commune de Paris à l’assaut du ciel (1961), la Première Internationale (1964), Octobre 17 vu de France (1967), Mémoires (7 volumes 1968-1973), Que sont devenus les communistes ? (1971), Bakounine et Marx (1974), Ce que je crois (1975).DUCLOS Marcellin (1879-1969)
Baryton de l’Opéra
 Marcellin DUCLOS, né le 20 avril 1879 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 6 février 1969 à Bagnères-de-Bigorre. Fils de Pierre Duclos, tailleur de pierres et de Marie Ferrer, originaire de Bielsa en Espagne, ménagère, mariés à Bagnères-de-Bigorre le 8 septembre 1875. D’abord menuisier, il entre au Conservatoire de Paris en 1905 et devient premier baryton à l'Opéra de Paris pendant trois ans. En 1907, il remporte au Conservatoire de Paris les premiers prix de chant et d’opéra et le second prix d’opéra-comique. Il débuta la même année au Palais Garnier, où il chanta notamment le rôle-titre de Rigoletto, qu'il joua plus de 300 fois. Il fit ses adieux à la scène de l'Opéra le 4 avril 1935 dans l'Or du Rhin (Alberich). Il fut fait chevalier de la Légion d'honneur en 1932. En 1961, sa ville natale de Bagnères-de-Bigorre donna son nom à une rue. Il débuta à l'Opéra de Paris le 6 septembre 1907 dans le rôle de Valentin de Faust. Il y créa le 2 mai 1909 Bacchus (Silène) de Jules Massenet ; le 28 avril 1925 Esther, princesse d’Israël (Aman) d’Antoine Mariotte ; le 6 décembre 1927 les Matines d’amour (Joffroy) de Jules Mazellier. Il y participa à la première le 23 octobre 1908 du Crépuscule des dieux (Alberich) de Richard Wagner [version française d’Alfred Ernst] ; le 17 novembre 1909 de l’Or du Rhin (Alberich) de Wagner [version française d’Alfred Ernst] ; le 20 octobre 1910 de Théodora (Justinien) de Xavier Leroux ; le 10 juillet 1920 de Sept Chansons (le Sonneur) de Gian Francesco Malipiero [version française d’Henry Prunières] ; le 3 avril 1922 de Falstaff (Ford) de Giuseppe Verdi [version française de Paul Solanges et Arrigo Boito] ; le 13 avril 1923 de la Khovanchtchina (Chaklowitz) de Modest Moussorgski [version française de R. et M. d’Harcourt] ; le 16 janvier 1925 de Miarka (Gleude) d'Alexandre Georges ; le 24 février 1927 des Burgraves (Hatto) de Léo Sachs. Il y chanta Rigoletto (Rigoletto, 1908) ; Samson et Dalila (Grand Prêtre, 1908) ; Lohengrin (de Telramund, 1909) ; Armide (Ubalde, 1909) ; Sigurd (Grand Prêtre d'Odin, 1909) ; Siegfried (Alberich, 1909) ; Hamlet (Hamlet, 1909) ; Salammbô (Splendius, 1910) ; Aïda (Amonasro, 1910) ; Tristan et Isolde (Kurwenal, 1911) ; Gwendoline (Harald, 1911) ; Tannhäuser (Wolfram, 1911) ; Déjanire (Philoctète, 1912) ; Roma (le Gaulois, 1912) ; les Huguenots (Nevers, 1920) ; Antar (Cheyboub, 1921) ; les Troyens (Chorèbe, 1921) ; l’Heure espagnole (Ramiro, 1921) ; Hérodiade (Hérode, 1921) ; le Jardin du Paradis (Eusèbe, 1924) ; Alceste (Grand Prêtre, 1926) ; le Miracle (Gaucher d'Arcourt, 1927). Chanteur d’opéra de grand talent, il se disait « Enfant de la Bigorre », ayant fait partie à ses débuts des « Chanteurs montagnards d'Alfred Roland », la plus ancienne chorale de France et certainement d'Europe.
Marcellin DUCLOS, né le 20 avril 1879 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 6 février 1969 à Bagnères-de-Bigorre. Fils de Pierre Duclos, tailleur de pierres et de Marie Ferrer, originaire de Bielsa en Espagne, ménagère, mariés à Bagnères-de-Bigorre le 8 septembre 1875. D’abord menuisier, il entre au Conservatoire de Paris en 1905 et devient premier baryton à l'Opéra de Paris pendant trois ans. En 1907, il remporte au Conservatoire de Paris les premiers prix de chant et d’opéra et le second prix d’opéra-comique. Il débuta la même année au Palais Garnier, où il chanta notamment le rôle-titre de Rigoletto, qu'il joua plus de 300 fois. Il fit ses adieux à la scène de l'Opéra le 4 avril 1935 dans l'Or du Rhin (Alberich). Il fut fait chevalier de la Légion d'honneur en 1932. En 1961, sa ville natale de Bagnères-de-Bigorre donna son nom à une rue. Il débuta à l'Opéra de Paris le 6 septembre 1907 dans le rôle de Valentin de Faust. Il y créa le 2 mai 1909 Bacchus (Silène) de Jules Massenet ; le 28 avril 1925 Esther, princesse d’Israël (Aman) d’Antoine Mariotte ; le 6 décembre 1927 les Matines d’amour (Joffroy) de Jules Mazellier. Il y participa à la première le 23 octobre 1908 du Crépuscule des dieux (Alberich) de Richard Wagner [version française d’Alfred Ernst] ; le 17 novembre 1909 de l’Or du Rhin (Alberich) de Wagner [version française d’Alfred Ernst] ; le 20 octobre 1910 de Théodora (Justinien) de Xavier Leroux ; le 10 juillet 1920 de Sept Chansons (le Sonneur) de Gian Francesco Malipiero [version française d’Henry Prunières] ; le 3 avril 1922 de Falstaff (Ford) de Giuseppe Verdi [version française de Paul Solanges et Arrigo Boito] ; le 13 avril 1923 de la Khovanchtchina (Chaklowitz) de Modest Moussorgski [version française de R. et M. d’Harcourt] ; le 16 janvier 1925 de Miarka (Gleude) d'Alexandre Georges ; le 24 février 1927 des Burgraves (Hatto) de Léo Sachs. Il y chanta Rigoletto (Rigoletto, 1908) ; Samson et Dalila (Grand Prêtre, 1908) ; Lohengrin (de Telramund, 1909) ; Armide (Ubalde, 1909) ; Sigurd (Grand Prêtre d'Odin, 1909) ; Siegfried (Alberich, 1909) ; Hamlet (Hamlet, 1909) ; Salammbô (Splendius, 1910) ; Aïda (Amonasro, 1910) ; Tristan et Isolde (Kurwenal, 1911) ; Gwendoline (Harald, 1911) ; Tannhäuser (Wolfram, 1911) ; Déjanire (Philoctète, 1912) ; Roma (le Gaulois, 1912) ; les Huguenots (Nevers, 1920) ; Antar (Cheyboub, 1921) ; les Troyens (Chorèbe, 1921) ; l’Heure espagnole (Ramiro, 1921) ; Hérodiade (Hérode, 1921) ; le Jardin du Paradis (Eusèbe, 1924) ; Alceste (Grand Prêtre, 1926) ; le Miracle (Gaucher d'Arcourt, 1927). Chanteur d’opéra de grand talent, il se disait « Enfant de la Bigorre », ayant fait partie à ses débuts des « Chanteurs montagnards d'Alfred Roland », la plus ancienne chorale de France et certainement d'Europe.
 Marcellin DUCLOS, né le 20 avril 1879 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 6 février 1969 à Bagnères-de-Bigorre. Fils de Pierre Duclos, tailleur de pierres et de Marie Ferrer, originaire de Bielsa en Espagne, ménagère, mariés à Bagnères-de-Bigorre le 8 septembre 1875. D’abord menuisier, il entre au Conservatoire de Paris en 1905 et devient premier baryton à l'Opéra de Paris pendant trois ans. En 1907, il remporte au Conservatoire de Paris les premiers prix de chant et d’opéra et le second prix d’opéra-comique. Il débuta la même année au Palais Garnier, où il chanta notamment le rôle-titre de Rigoletto, qu'il joua plus de 300 fois. Il fit ses adieux à la scène de l'Opéra le 4 avril 1935 dans l'Or du Rhin (Alberich). Il fut fait chevalier de la Légion d'honneur en 1932. En 1961, sa ville natale de Bagnères-de-Bigorre donna son nom à une rue. Il débuta à l'Opéra de Paris le 6 septembre 1907 dans le rôle de Valentin de Faust. Il y créa le 2 mai 1909 Bacchus (Silène) de Jules Massenet ; le 28 avril 1925 Esther, princesse d’Israël (Aman) d’Antoine Mariotte ; le 6 décembre 1927 les Matines d’amour (Joffroy) de Jules Mazellier. Il y participa à la première le 23 octobre 1908 du Crépuscule des dieux (Alberich) de Richard Wagner [version française d’Alfred Ernst] ; le 17 novembre 1909 de l’Or du Rhin (Alberich) de Wagner [version française d’Alfred Ernst] ; le 20 octobre 1910 de Théodora (Justinien) de Xavier Leroux ; le 10 juillet 1920 de Sept Chansons (le Sonneur) de Gian Francesco Malipiero [version française d’Henry Prunières] ; le 3 avril 1922 de Falstaff (Ford) de Giuseppe Verdi [version française de Paul Solanges et Arrigo Boito] ; le 13 avril 1923 de la Khovanchtchina (Chaklowitz) de Modest Moussorgski [version française de R. et M. d’Harcourt] ; le 16 janvier 1925 de Miarka (Gleude) d'Alexandre Georges ; le 24 février 1927 des Burgraves (Hatto) de Léo Sachs. Il y chanta Rigoletto (Rigoletto, 1908) ; Samson et Dalila (Grand Prêtre, 1908) ; Lohengrin (de Telramund, 1909) ; Armide (Ubalde, 1909) ; Sigurd (Grand Prêtre d'Odin, 1909) ; Siegfried (Alberich, 1909) ; Hamlet (Hamlet, 1909) ; Salammbô (Splendius, 1910) ; Aïda (Amonasro, 1910) ; Tristan et Isolde (Kurwenal, 1911) ; Gwendoline (Harald, 1911) ; Tannhäuser (Wolfram, 1911) ; Déjanire (Philoctète, 1912) ; Roma (le Gaulois, 1912) ; les Huguenots (Nevers, 1920) ; Antar (Cheyboub, 1921) ; les Troyens (Chorèbe, 1921) ; l’Heure espagnole (Ramiro, 1921) ; Hérodiade (Hérode, 1921) ; le Jardin du Paradis (Eusèbe, 1924) ; Alceste (Grand Prêtre, 1926) ; le Miracle (Gaucher d'Arcourt, 1927). Chanteur d’opéra de grand talent, il se disait « Enfant de la Bigorre », ayant fait partie à ses débuts des « Chanteurs montagnards d'Alfred Roland », la plus ancienne chorale de France et certainement d'Europe.
Marcellin DUCLOS, né le 20 avril 1879 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 6 février 1969 à Bagnères-de-Bigorre. Fils de Pierre Duclos, tailleur de pierres et de Marie Ferrer, originaire de Bielsa en Espagne, ménagère, mariés à Bagnères-de-Bigorre le 8 septembre 1875. D’abord menuisier, il entre au Conservatoire de Paris en 1905 et devient premier baryton à l'Opéra de Paris pendant trois ans. En 1907, il remporte au Conservatoire de Paris les premiers prix de chant et d’opéra et le second prix d’opéra-comique. Il débuta la même année au Palais Garnier, où il chanta notamment le rôle-titre de Rigoletto, qu'il joua plus de 300 fois. Il fit ses adieux à la scène de l'Opéra le 4 avril 1935 dans l'Or du Rhin (Alberich). Il fut fait chevalier de la Légion d'honneur en 1932. En 1961, sa ville natale de Bagnères-de-Bigorre donna son nom à une rue. Il débuta à l'Opéra de Paris le 6 septembre 1907 dans le rôle de Valentin de Faust. Il y créa le 2 mai 1909 Bacchus (Silène) de Jules Massenet ; le 28 avril 1925 Esther, princesse d’Israël (Aman) d’Antoine Mariotte ; le 6 décembre 1927 les Matines d’amour (Joffroy) de Jules Mazellier. Il y participa à la première le 23 octobre 1908 du Crépuscule des dieux (Alberich) de Richard Wagner [version française d’Alfred Ernst] ; le 17 novembre 1909 de l’Or du Rhin (Alberich) de Wagner [version française d’Alfred Ernst] ; le 20 octobre 1910 de Théodora (Justinien) de Xavier Leroux ; le 10 juillet 1920 de Sept Chansons (le Sonneur) de Gian Francesco Malipiero [version française d’Henry Prunières] ; le 3 avril 1922 de Falstaff (Ford) de Giuseppe Verdi [version française de Paul Solanges et Arrigo Boito] ; le 13 avril 1923 de la Khovanchtchina (Chaklowitz) de Modest Moussorgski [version française de R. et M. d’Harcourt] ; le 16 janvier 1925 de Miarka (Gleude) d'Alexandre Georges ; le 24 février 1927 des Burgraves (Hatto) de Léo Sachs. Il y chanta Rigoletto (Rigoletto, 1908) ; Samson et Dalila (Grand Prêtre, 1908) ; Lohengrin (de Telramund, 1909) ; Armide (Ubalde, 1909) ; Sigurd (Grand Prêtre d'Odin, 1909) ; Siegfried (Alberich, 1909) ; Hamlet (Hamlet, 1909) ; Salammbô (Splendius, 1910) ; Aïda (Amonasro, 1910) ; Tristan et Isolde (Kurwenal, 1911) ; Gwendoline (Harald, 1911) ; Tannhäuser (Wolfram, 1911) ; Déjanire (Philoctète, 1912) ; Roma (le Gaulois, 1912) ; les Huguenots (Nevers, 1920) ; Antar (Cheyboub, 1921) ; les Troyens (Chorèbe, 1921) ; l’Heure espagnole (Ramiro, 1921) ; Hérodiade (Hérode, 1921) ; le Jardin du Paradis (Eusèbe, 1924) ; Alceste (Grand Prêtre, 1926) ; le Miracle (Gaucher d'Arcourt, 1927). Chanteur d’opéra de grand talent, il se disait « Enfant de la Bigorre », ayant fait partie à ses débuts des « Chanteurs montagnards d'Alfred Roland », la plus ancienne chorale de France et certainement d'Europe.DUMERC Céline (1982-XXXX)
Basketteuse médaillée olympique
 Céline DUMERC, née le 9 juillet 1982 à Tarbes, est une joueuse internationale de basket-ball, évoluant au poste de meneuse de jeu de l’équipe de France de basket et depuis 2017 de l'équipe de Basket Landes, dans la ville de Mont-de-Marsan. Très tôt, elle intègre le club de Tarbes Gespe Bigorre (TGB), avant d'intégrer quelques années plus tard le Centre fédéral de basket-ball au sein de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP). Entre 2000 et 2003, c'est au sein de son club de Tarbes qu’elle démarrera sa carrière professionnelle. Ensuite, elle intègrera le club du CJM Bourges, dans lequel elle effectuera une grande partie de sa carrière professionnelle. Elle restera dans ce club pendant près d'une décennie entre 2003 et 2013, avec un intermède de deux années seulement dans le club russe de l'UMMC Ekaterinbourg. En 2006 et 2008, elle remportera notamment deux titres de championne de France avec son club, mais aussi une Coupe de France et le Tournoi de la Fédération en 2006. L'escapade russe, entre 2009 et 2011, se concrétisera par deux titres de championne de Russie. De retour à Bourges en 2011, elle remportera à nouveau un titre de championne de France en 2012. Après une longue carrière en Europe, elle réalise son rêve en étant sélectionnée au sein de l'équipe du Dream d'Atlanta, dans la prestigieuse ligue de WNBA. Et son point d'apothéose est atteint en 2009, lorsqu'elle décroche le titre de championne d'Europe avec l'équipe de France. Elle a également obtenu deux médailles d'argent avec l’équipe de France aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et aux championnats d'Europe de 2013 en France. Depuis la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Londres, elle est la figure emblématique de la Ligue Féminine et l’une des sportives françaises les plus médiatisées. Surnommée Caps’ (de « capsule »), elle s’impose peu à peu comme une des meneuses majeures de l’équipe de France, dont elle deviendra la capitaine. Avec l’équipe de France, elle remporte donc un titre européen, lors du championnat d'Europe 2009, une médaille de bronze lors de l'édition suivante en 2011, la médaille d'argent aux Jeux olympiques 2012 de Londres, puis la médaille d'argent au championnat d'Europe 2013, 2015 et 2017. Recordwoman des sélections avec 262 sélections en équipe nationale (avec les Bleues), elle est la basketteuse française la plus capée de l'histoire du basket-ball français, détrônant Hervé Dubuisson (259 capes) et Paoline Ekambi (254), détenant ainsi le record de sélections en équipe de France de basket-ball, hommes et femmes confondus. Le sommet de sa carrière internationale a certainement été atteint en 2012, aux Jeux olympiques de Londres. Si les Bleues s'inclinèrent face aux imbattables Américaines, Céline verra sa cote de popularité s'envoler et deviendra la première femme récompensée par le prix du sportif de l'année décerné par France Info. Lors de la saison 2013-2014, elle sera sacrée meilleure joueuse française du championnat pour la seconde fois après la saison 2007-2008. Elle sera élue troisième meilleure joueuse française de la saison 2015-2016. En 2017, elle sera sacrée meilleure joueuse française de l'année, succédant à Nando De Colo. À Prague, lors de l'Euro 2017, elle disputera sa dernière compétition avec l'équipe de France. Les Bleues menées rapidement seront incapables de faire tomber une très belle équipe d'Espagne. Lors de ce match à Prague, elle sera la meilleure marqueuse française devenue vice-championne d'Europe pour son 262e et dernier match en bleu. À 34 ans, la meneuse des Bleues quitte les parquets sur une médaille d'argent européenne et en laissant surtout une empreinte énorme sur l'histoire de son sport. Elle restera à jamais la capitaine des "Braqueuses", qui avaient mis le basket féminin en pleine lumière en décrochant l'argent aux Jeux de Londres, le championnat d'Europe 2009 et qui aura pris sa retraite internationale en 2017 après l'Euro. Elle est aussi sextuple championne de France avec Bourges. Tout au long de sa carrière, elle aura décroché une médaille d'or, trois d'argent et une de bronze aux championnats d'Europe, plus une médaille d'argent aux Jeux olympiques. Son palmarès : 1997, médaille de bronze au Championnat d'Europe cadettes ; 2002, médaille de bronze au Championnat d'Europe des 20 ans et moins et finaliste de la Coupe Ronchetti (Tarbes) ; 2003, médaille de bronze au Championnat du monde des 21 ans et moins ; 2003, 2004, 2005, vice-championne de France ; 2006, 2008, 2009, 2012, championne de France ; 2009, championne d'Europe à Riga en Lettonie ; 2010, 2011, championne de Russie ; 2011, médaille de bronze aux Championnats d'Europe en Pologne ; 2012, médaille d'argent aux Jeux olympiques de Londres ; 2013, médaille d'argent aux Championnats d'Europe en France ; 2015, médaille d'argent aux Championnats d'Europe en Hongrie et Roumanie ; 2017, médaille d'argent aux Championnats d'Europe en République tchèque (sa sixième médaille internationale). Capitaine et star des Braqueuses, avec 262 sélections, elle aura marqué près de 1500 points en 11 années de sélection. Elle a été décorée de la médaille Robert Busnel, plus haute distinction de la Fédération française de basket-ball, en juillet 2013 et aussi nommée au rang de chevalier de l'Ordre national du Mérite. En 2016, elle a reçu la médaille d’Honneur de la Ville de Bourges. Cette ancienne capitaine des Bleues et recordwoman du nombre de sélections (262), devrait prendre dans un avenir proche les fonctions de General Manager de l’Équipe de France féminine « lors des prochaines fenêtres internationales » a indiqué la Fédération française de basketball (FFBB). « Elle interviendra également, lorsque son calendrier sportif le lui permettra, sur les Équipes de France jeunes, auprès des joueuses du Pôle France BasketBall - Yvan Mainini et lors des Camps Nationaux de la FFBB ». À 38 ans, à la rentrée 2020, l’ex-meneuse et patronne de l’équipe de France, repart pour une 21e saison professionnelle de basketteuse professionnelle, la quatrième sous les couleurs de Basket Landes. Et alors qu'elle est toujours en activité au sein de l'équipe de Basket Landes, elle va vivre sa première collaboration médiatique, car elle est recrutée en qualité de consultante au sein du service des sports de France Télévisions, en prévision des JO de Tokyo de 2020, au cours desquels elle devrait intervenir pour les rencontres de l'équipe de France féminine de basket.
Céline DUMERC, née le 9 juillet 1982 à Tarbes, est une joueuse internationale de basket-ball, évoluant au poste de meneuse de jeu de l’équipe de France de basket et depuis 2017 de l'équipe de Basket Landes, dans la ville de Mont-de-Marsan. Très tôt, elle intègre le club de Tarbes Gespe Bigorre (TGB), avant d'intégrer quelques années plus tard le Centre fédéral de basket-ball au sein de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP). Entre 2000 et 2003, c'est au sein de son club de Tarbes qu’elle démarrera sa carrière professionnelle. Ensuite, elle intègrera le club du CJM Bourges, dans lequel elle effectuera une grande partie de sa carrière professionnelle. Elle restera dans ce club pendant près d'une décennie entre 2003 et 2013, avec un intermède de deux années seulement dans le club russe de l'UMMC Ekaterinbourg. En 2006 et 2008, elle remportera notamment deux titres de championne de France avec son club, mais aussi une Coupe de France et le Tournoi de la Fédération en 2006. L'escapade russe, entre 2009 et 2011, se concrétisera par deux titres de championne de Russie. De retour à Bourges en 2011, elle remportera à nouveau un titre de championne de France en 2012. Après une longue carrière en Europe, elle réalise son rêve en étant sélectionnée au sein de l'équipe du Dream d'Atlanta, dans la prestigieuse ligue de WNBA. Et son point d'apothéose est atteint en 2009, lorsqu'elle décroche le titre de championne d'Europe avec l'équipe de France. Elle a également obtenu deux médailles d'argent avec l’équipe de France aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et aux championnats d'Europe de 2013 en France. Depuis la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Londres, elle est la figure emblématique de la Ligue Féminine et l’une des sportives françaises les plus médiatisées. Surnommée Caps’ (de « capsule »), elle s’impose peu à peu comme une des meneuses majeures de l’équipe de France, dont elle deviendra la capitaine. Avec l’équipe de France, elle remporte donc un titre européen, lors du championnat d'Europe 2009, une médaille de bronze lors de l'édition suivante en 2011, la médaille d'argent aux Jeux olympiques 2012 de Londres, puis la médaille d'argent au championnat d'Europe 2013, 2015 et 2017. Recordwoman des sélections avec 262 sélections en équipe nationale (avec les Bleues), elle est la basketteuse française la plus capée de l'histoire du basket-ball français, détrônant Hervé Dubuisson (259 capes) et Paoline Ekambi (254), détenant ainsi le record de sélections en équipe de France de basket-ball, hommes et femmes confondus. Le sommet de sa carrière internationale a certainement été atteint en 2012, aux Jeux olympiques de Londres. Si les Bleues s'inclinèrent face aux imbattables Américaines, Céline verra sa cote de popularité s'envoler et deviendra la première femme récompensée par le prix du sportif de l'année décerné par France Info. Lors de la saison 2013-2014, elle sera sacrée meilleure joueuse française du championnat pour la seconde fois après la saison 2007-2008. Elle sera élue troisième meilleure joueuse française de la saison 2015-2016. En 2017, elle sera sacrée meilleure joueuse française de l'année, succédant à Nando De Colo. À Prague, lors de l'Euro 2017, elle disputera sa dernière compétition avec l'équipe de France. Les Bleues menées rapidement seront incapables de faire tomber une très belle équipe d'Espagne. Lors de ce match à Prague, elle sera la meilleure marqueuse française devenue vice-championne d'Europe pour son 262e et dernier match en bleu. À 34 ans, la meneuse des Bleues quitte les parquets sur une médaille d'argent européenne et en laissant surtout une empreinte énorme sur l'histoire de son sport. Elle restera à jamais la capitaine des "Braqueuses", qui avaient mis le basket féminin en pleine lumière en décrochant l'argent aux Jeux de Londres, le championnat d'Europe 2009 et qui aura pris sa retraite internationale en 2017 après l'Euro. Elle est aussi sextuple championne de France avec Bourges. Tout au long de sa carrière, elle aura décroché une médaille d'or, trois d'argent et une de bronze aux championnats d'Europe, plus une médaille d'argent aux Jeux olympiques. Son palmarès : 1997, médaille de bronze au Championnat d'Europe cadettes ; 2002, médaille de bronze au Championnat d'Europe des 20 ans et moins et finaliste de la Coupe Ronchetti (Tarbes) ; 2003, médaille de bronze au Championnat du monde des 21 ans et moins ; 2003, 2004, 2005, vice-championne de France ; 2006, 2008, 2009, 2012, championne de France ; 2009, championne d'Europe à Riga en Lettonie ; 2010, 2011, championne de Russie ; 2011, médaille de bronze aux Championnats d'Europe en Pologne ; 2012, médaille d'argent aux Jeux olympiques de Londres ; 2013, médaille d'argent aux Championnats d'Europe en France ; 2015, médaille d'argent aux Championnats d'Europe en Hongrie et Roumanie ; 2017, médaille d'argent aux Championnats d'Europe en République tchèque (sa sixième médaille internationale). Capitaine et star des Braqueuses, avec 262 sélections, elle aura marqué près de 1500 points en 11 années de sélection. Elle a été décorée de la médaille Robert Busnel, plus haute distinction de la Fédération française de basket-ball, en juillet 2013 et aussi nommée au rang de chevalier de l'Ordre national du Mérite. En 2016, elle a reçu la médaille d’Honneur de la Ville de Bourges. Cette ancienne capitaine des Bleues et recordwoman du nombre de sélections (262), devrait prendre dans un avenir proche les fonctions de General Manager de l’Équipe de France féminine « lors des prochaines fenêtres internationales » a indiqué la Fédération française de basketball (FFBB). « Elle interviendra également, lorsque son calendrier sportif le lui permettra, sur les Équipes de France jeunes, auprès des joueuses du Pôle France BasketBall - Yvan Mainini et lors des Camps Nationaux de la FFBB ». À 38 ans, à la rentrée 2020, l’ex-meneuse et patronne de l’équipe de France, repart pour une 21e saison professionnelle de basketteuse professionnelle, la quatrième sous les couleurs de Basket Landes. Et alors qu'elle est toujours en activité au sein de l'équipe de Basket Landes, elle va vivre sa première collaboration médiatique, car elle est recrutée en qualité de consultante au sein du service des sports de France Télévisions, en prévision des JO de Tokyo de 2020, au cours desquels elle devrait intervenir pour les rencontres de l'équipe de France féminine de basket.
 Céline DUMERC, née le 9 juillet 1982 à Tarbes, est une joueuse internationale de basket-ball, évoluant au poste de meneuse de jeu de l’équipe de France de basket et depuis 2017 de l'équipe de Basket Landes, dans la ville de Mont-de-Marsan. Très tôt, elle intègre le club de Tarbes Gespe Bigorre (TGB), avant d'intégrer quelques années plus tard le Centre fédéral de basket-ball au sein de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP). Entre 2000 et 2003, c'est au sein de son club de Tarbes qu’elle démarrera sa carrière professionnelle. Ensuite, elle intègrera le club du CJM Bourges, dans lequel elle effectuera une grande partie de sa carrière professionnelle. Elle restera dans ce club pendant près d'une décennie entre 2003 et 2013, avec un intermède de deux années seulement dans le club russe de l'UMMC Ekaterinbourg. En 2006 et 2008, elle remportera notamment deux titres de championne de France avec son club, mais aussi une Coupe de France et le Tournoi de la Fédération en 2006. L'escapade russe, entre 2009 et 2011, se concrétisera par deux titres de championne de Russie. De retour à Bourges en 2011, elle remportera à nouveau un titre de championne de France en 2012. Après une longue carrière en Europe, elle réalise son rêve en étant sélectionnée au sein de l'équipe du Dream d'Atlanta, dans la prestigieuse ligue de WNBA. Et son point d'apothéose est atteint en 2009, lorsqu'elle décroche le titre de championne d'Europe avec l'équipe de France. Elle a également obtenu deux médailles d'argent avec l’équipe de France aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et aux championnats d'Europe de 2013 en France. Depuis la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Londres, elle est la figure emblématique de la Ligue Féminine et l’une des sportives françaises les plus médiatisées. Surnommée Caps’ (de « capsule »), elle s’impose peu à peu comme une des meneuses majeures de l’équipe de France, dont elle deviendra la capitaine. Avec l’équipe de France, elle remporte donc un titre européen, lors du championnat d'Europe 2009, une médaille de bronze lors de l'édition suivante en 2011, la médaille d'argent aux Jeux olympiques 2012 de Londres, puis la médaille d'argent au championnat d'Europe 2013, 2015 et 2017. Recordwoman des sélections avec 262 sélections en équipe nationale (avec les Bleues), elle est la basketteuse française la plus capée de l'histoire du basket-ball français, détrônant Hervé Dubuisson (259 capes) et Paoline Ekambi (254), détenant ainsi le record de sélections en équipe de France de basket-ball, hommes et femmes confondus. Le sommet de sa carrière internationale a certainement été atteint en 2012, aux Jeux olympiques de Londres. Si les Bleues s'inclinèrent face aux imbattables Américaines, Céline verra sa cote de popularité s'envoler et deviendra la première femme récompensée par le prix du sportif de l'année décerné par France Info. Lors de la saison 2013-2014, elle sera sacrée meilleure joueuse française du championnat pour la seconde fois après la saison 2007-2008. Elle sera élue troisième meilleure joueuse française de la saison 2015-2016. En 2017, elle sera sacrée meilleure joueuse française de l'année, succédant à Nando De Colo. À Prague, lors de l'Euro 2017, elle disputera sa dernière compétition avec l'équipe de France. Les Bleues menées rapidement seront incapables de faire tomber une très belle équipe d'Espagne. Lors de ce match à Prague, elle sera la meilleure marqueuse française devenue vice-championne d'Europe pour son 262e et dernier match en bleu. À 34 ans, la meneuse des Bleues quitte les parquets sur une médaille d'argent européenne et en laissant surtout une empreinte énorme sur l'histoire de son sport. Elle restera à jamais la capitaine des "Braqueuses", qui avaient mis le basket féminin en pleine lumière en décrochant l'argent aux Jeux de Londres, le championnat d'Europe 2009 et qui aura pris sa retraite internationale en 2017 après l'Euro. Elle est aussi sextuple championne de France avec Bourges. Tout au long de sa carrière, elle aura décroché une médaille d'or, trois d'argent et une de bronze aux championnats d'Europe, plus une médaille d'argent aux Jeux olympiques. Son palmarès : 1997, médaille de bronze au Championnat d'Europe cadettes ; 2002, médaille de bronze au Championnat d'Europe des 20 ans et moins et finaliste de la Coupe Ronchetti (Tarbes) ; 2003, médaille de bronze au Championnat du monde des 21 ans et moins ; 2003, 2004, 2005, vice-championne de France ; 2006, 2008, 2009, 2012, championne de France ; 2009, championne d'Europe à Riga en Lettonie ; 2010, 2011, championne de Russie ; 2011, médaille de bronze aux Championnats d'Europe en Pologne ; 2012, médaille d'argent aux Jeux olympiques de Londres ; 2013, médaille d'argent aux Championnats d'Europe en France ; 2015, médaille d'argent aux Championnats d'Europe en Hongrie et Roumanie ; 2017, médaille d'argent aux Championnats d'Europe en République tchèque (sa sixième médaille internationale). Capitaine et star des Braqueuses, avec 262 sélections, elle aura marqué près de 1500 points en 11 années de sélection. Elle a été décorée de la médaille Robert Busnel, plus haute distinction de la Fédération française de basket-ball, en juillet 2013 et aussi nommée au rang de chevalier de l'Ordre national du Mérite. En 2016, elle a reçu la médaille d’Honneur de la Ville de Bourges. Cette ancienne capitaine des Bleues et recordwoman du nombre de sélections (262), devrait prendre dans un avenir proche les fonctions de General Manager de l’Équipe de France féminine « lors des prochaines fenêtres internationales » a indiqué la Fédération française de basketball (FFBB). « Elle interviendra également, lorsque son calendrier sportif le lui permettra, sur les Équipes de France jeunes, auprès des joueuses du Pôle France BasketBall - Yvan Mainini et lors des Camps Nationaux de la FFBB ». À 38 ans, à la rentrée 2020, l’ex-meneuse et patronne de l’équipe de France, repart pour une 21e saison professionnelle de basketteuse professionnelle, la quatrième sous les couleurs de Basket Landes. Et alors qu'elle est toujours en activité au sein de l'équipe de Basket Landes, elle va vivre sa première collaboration médiatique, car elle est recrutée en qualité de consultante au sein du service des sports de France Télévisions, en prévision des JO de Tokyo de 2020, au cours desquels elle devrait intervenir pour les rencontres de l'équipe de France féminine de basket.
Céline DUMERC, née le 9 juillet 1982 à Tarbes, est une joueuse internationale de basket-ball, évoluant au poste de meneuse de jeu de l’équipe de France de basket et depuis 2017 de l'équipe de Basket Landes, dans la ville de Mont-de-Marsan. Très tôt, elle intègre le club de Tarbes Gespe Bigorre (TGB), avant d'intégrer quelques années plus tard le Centre fédéral de basket-ball au sein de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP). Entre 2000 et 2003, c'est au sein de son club de Tarbes qu’elle démarrera sa carrière professionnelle. Ensuite, elle intègrera le club du CJM Bourges, dans lequel elle effectuera une grande partie de sa carrière professionnelle. Elle restera dans ce club pendant près d'une décennie entre 2003 et 2013, avec un intermède de deux années seulement dans le club russe de l'UMMC Ekaterinbourg. En 2006 et 2008, elle remportera notamment deux titres de championne de France avec son club, mais aussi une Coupe de France et le Tournoi de la Fédération en 2006. L'escapade russe, entre 2009 et 2011, se concrétisera par deux titres de championne de Russie. De retour à Bourges en 2011, elle remportera à nouveau un titre de championne de France en 2012. Après une longue carrière en Europe, elle réalise son rêve en étant sélectionnée au sein de l'équipe du Dream d'Atlanta, dans la prestigieuse ligue de WNBA. Et son point d'apothéose est atteint en 2009, lorsqu'elle décroche le titre de championne d'Europe avec l'équipe de France. Elle a également obtenu deux médailles d'argent avec l’équipe de France aux Jeux olympiques de Londres en 2012 et aux championnats d'Europe de 2013 en France. Depuis la médaille d’argent aux Jeux olympiques de Londres, elle est la figure emblématique de la Ligue Féminine et l’une des sportives françaises les plus médiatisées. Surnommée Caps’ (de « capsule »), elle s’impose peu à peu comme une des meneuses majeures de l’équipe de France, dont elle deviendra la capitaine. Avec l’équipe de France, elle remporte donc un titre européen, lors du championnat d'Europe 2009, une médaille de bronze lors de l'édition suivante en 2011, la médaille d'argent aux Jeux olympiques 2012 de Londres, puis la médaille d'argent au championnat d'Europe 2013, 2015 et 2017. Recordwoman des sélections avec 262 sélections en équipe nationale (avec les Bleues), elle est la basketteuse française la plus capée de l'histoire du basket-ball français, détrônant Hervé Dubuisson (259 capes) et Paoline Ekambi (254), détenant ainsi le record de sélections en équipe de France de basket-ball, hommes et femmes confondus. Le sommet de sa carrière internationale a certainement été atteint en 2012, aux Jeux olympiques de Londres. Si les Bleues s'inclinèrent face aux imbattables Américaines, Céline verra sa cote de popularité s'envoler et deviendra la première femme récompensée par le prix du sportif de l'année décerné par France Info. Lors de la saison 2013-2014, elle sera sacrée meilleure joueuse française du championnat pour la seconde fois après la saison 2007-2008. Elle sera élue troisième meilleure joueuse française de la saison 2015-2016. En 2017, elle sera sacrée meilleure joueuse française de l'année, succédant à Nando De Colo. À Prague, lors de l'Euro 2017, elle disputera sa dernière compétition avec l'équipe de France. Les Bleues menées rapidement seront incapables de faire tomber une très belle équipe d'Espagne. Lors de ce match à Prague, elle sera la meilleure marqueuse française devenue vice-championne d'Europe pour son 262e et dernier match en bleu. À 34 ans, la meneuse des Bleues quitte les parquets sur une médaille d'argent européenne et en laissant surtout une empreinte énorme sur l'histoire de son sport. Elle restera à jamais la capitaine des "Braqueuses", qui avaient mis le basket féminin en pleine lumière en décrochant l'argent aux Jeux de Londres, le championnat d'Europe 2009 et qui aura pris sa retraite internationale en 2017 après l'Euro. Elle est aussi sextuple championne de France avec Bourges. Tout au long de sa carrière, elle aura décroché une médaille d'or, trois d'argent et une de bronze aux championnats d'Europe, plus une médaille d'argent aux Jeux olympiques. Son palmarès : 1997, médaille de bronze au Championnat d'Europe cadettes ; 2002, médaille de bronze au Championnat d'Europe des 20 ans et moins et finaliste de la Coupe Ronchetti (Tarbes) ; 2003, médaille de bronze au Championnat du monde des 21 ans et moins ; 2003, 2004, 2005, vice-championne de France ; 2006, 2008, 2009, 2012, championne de France ; 2009, championne d'Europe à Riga en Lettonie ; 2010, 2011, championne de Russie ; 2011, médaille de bronze aux Championnats d'Europe en Pologne ; 2012, médaille d'argent aux Jeux olympiques de Londres ; 2013, médaille d'argent aux Championnats d'Europe en France ; 2015, médaille d'argent aux Championnats d'Europe en Hongrie et Roumanie ; 2017, médaille d'argent aux Championnats d'Europe en République tchèque (sa sixième médaille internationale). Capitaine et star des Braqueuses, avec 262 sélections, elle aura marqué près de 1500 points en 11 années de sélection. Elle a été décorée de la médaille Robert Busnel, plus haute distinction de la Fédération française de basket-ball, en juillet 2013 et aussi nommée au rang de chevalier de l'Ordre national du Mérite. En 2016, elle a reçu la médaille d’Honneur de la Ville de Bourges. Cette ancienne capitaine des Bleues et recordwoman du nombre de sélections (262), devrait prendre dans un avenir proche les fonctions de General Manager de l’Équipe de France féminine « lors des prochaines fenêtres internationales » a indiqué la Fédération française de basketball (FFBB). « Elle interviendra également, lorsque son calendrier sportif le lui permettra, sur les Équipes de France jeunes, auprès des joueuses du Pôle France BasketBall - Yvan Mainini et lors des Camps Nationaux de la FFBB ». À 38 ans, à la rentrée 2020, l’ex-meneuse et patronne de l’équipe de France, repart pour une 21e saison professionnelle de basketteuse professionnelle, la quatrième sous les couleurs de Basket Landes. Et alors qu'elle est toujours en activité au sein de l'équipe de Basket Landes, elle va vivre sa première collaboration médiatique, car elle est recrutée en qualité de consultante au sein du service des sports de France Télévisions, en prévision des JO de Tokyo de 2020, au cours desquels elle devrait intervenir pour les rencontres de l'équipe de France féminine de basket.DUPARC Henri (1848-1933)
Compositeur, musicien
 Henri DUPARC, né le 21 janvier 1848 à Paris et mort le 12 février 1933 à Mont-de-Marsan, où il s’était retiré en 1924. Il fut un grand compositeur français de la deuxième moitié du XIXème siècle. Son père, Louis Charles Fouques-Duparc (1807-1879), inspecteur général des ponts et chaussées, est directeur des chemins de fer de l'Ouest. Sa mère, Frédérique Amélie de Guaita (1822-1895), fille d'industriels, a publié une dizaine d'ouvrages pieux pour les enfants. Son grand-père, Louis Benoît Fouques-Duparc fut filleul de Louis XV. Henri fit ses études au collège des jésuites de la rue Vaugirard où César Franck, qui enseignait la musique, le considère comme son élève le plus talentueux. Celui-ci lui fait comprendre qu'il ne sera jamais un pianiste virtuose, mais qu'il y a en lui l'étoffe d'un compositeur. La mélodie l’attire et sera le fil conducteur de toute son œuvre. Il fait ensuite des études de droit. En 1867, il compose à l’âge de dix-huit ans une unique sonate pour piano et violoncelle (des fragments sont conservés). En 1868, il publie cinq mélodies. En 1869, il publie chez Flaxland six petites pièces pour piano. Il se lie d'amitié avec Vincent d'Indy et Alexis de Castillon. D'après Merle, il aurait séjourné chez Liszt en 1869 et fait la connaissance de Richard Wagner. Il assiste à la première représentation des Walküre (La Walkyrie) à Munich en 1870. Henri Duparc fut fortement influencé par Wagner. L’époque cruellement éprouvée par la guerre franco-allemande de 1870 met à mal les relations artistiques entre les deux pays. Tiraillé entre Berlioz et Wagner, Duparc se laisse séduire par le mythe allemand et se rend à Munich écouter ses opéras, ce qui aura sur lui une emprise indélébile. Le 9 novembre 1871, il épouse Ellen Mac Swiney, pianiste douée qui accompagna son mari jusqu'au bout en le soutenant d'une affection sans faille. Après la guerre 1870-1871, des musiciens et des écrivains se rencontrent chez Duparc (Gabriel Fauré, Ernest Chausson, Alexis de Castillon, Camille Saint-Saëns, Emmanuel Chabrier). C'est au cours d'une de ces rencontres, en 1871, qu’il fonde avec Camille Saint-Saëns et Romain Bussine, la Société Nationale de Musique, qui donna son premier concert la même année. Duparc est resté longtemps le secrétaire actif de l'organisation. Ses premières œuvres demeurent inédites mais dès 1870, il écrit l'Invitation au voyage, chef d'œuvre inaugurant l'ère parnassienne de la mélodie française. Dans les années 1870 la production de Duparc sera très dense. Son activité de compositeur de mélodies se situe entre les années 1869 et 1884 avec quelques incursions dans le domaine orchestral marqué en 1875 par le poème symphonique Léonore, qui consacre son nom dans la vie musicale officielle. En 1873, il compose une Suite d'orchestre, en 1874 un Poème Nocturne et une Suite de danses (compositions orchestrales perdues). Le 5 mai 1878, il annonce la création des Concerts de Musique Moderne (qu’il codirige avec Vincent d'Indy), qui se donnaient pour but de faire connaître les compositeurs contemporains. En 1879, il assiste à une représentation de Tristan, et refait presque aussitôt un nouveau voyage en Allemagne en compagnie d’Emmanuel Chabrier. Il passe l'hiver 1882-1883 à La Bourboule. De 1880 à 1885, il passe la plus grande partie de l'été à Marnes dans la région parisienne. En 1883 et 1886, il est à Bayreuth en Allemagne. Selon sa correspondance, il aurait fait plusieurs voyages en Irlande à partir de 1884. En 1885, il voit sa santé déjà altérée lui rendre tout travail créateur impossible, et s’arrête de composer à l’âge de trente-huit ans. Les premiers signes de neurasthénie se font sentir. La maladie nerveuse, dont il est atteint depuis de nombreuses années l'empêche définitivement de composer, le contraint à se reposer et il s’isolera dans la foi jusqu’à sa mort. Il se consacre alors à sa famille, produit des gouaches, des pastels ou des sépias et continue de s'intéresser à tous les arts, peignant et dessinant tant qu'il put encore voir. Un autre aspect du talent d’Henri Duparc : celui de dessinateur. Hypersensible et malade des nerfs, n’ayant plus la force de composer à partir de 1885, il se consacre beaucoup à la peinture avec l’aide et sur les conseils d’Henri Lerolle et Henri Harpignies, ce dernier rencontré à La Bourboule quelques années plus tôt. Soit une quarantaine de toiles, de dessins et d’aquarelles de paysages, notamment des Pyrénées. Durant les cinquante années qui lui restent à vivre, Duparc assiste, impuissant et lucide, à la paralysie de son talent. Il vit à Monein, au pied des Pyrénées jusqu'en 1897. Il y conçoit le projet d'un Opéra d'après une nouvelle de Pouchkine, La Roussalka, drame lyrique dont il détruira les esquisses (reste des fragments). À l'abbaye d'Abos dans le Béarn, le poète béarnais Charles de Bordau le présente à Francis Jammes. De 1897 à 1906, il vit à Paris. En 1900, il achève l'orchestration du Testament. En 1902, il entreprend son premier pèlerinage à Lourdes. De 1906 à 1913, il vit en Suisse à La Tour de Peilz (Vevey). En 1906, en compagnie de Paul Claudel et de Francis Jammes il fait le pèlerinage de Lourdes, qui semble être un révélateur pour une grande dévotion religieuse. De 1913 à 1919, il vit à Tarbes dans la très belle maison en haut à droite des allées Leclerc, face à la caserne du 1er RHP. En 1916, il évoque sa cécité. En 1919, il s'installe à Mont-de-Marsan. Il est opéré d'un glaucome le 12 août 1924. Atteint de paralysie, il passe la fin de sa vie dans un profond mysticisme religieux. Devenu entièrement aveugle et paralytique, il meurt le 12 février 1933 à l'âge de 85 ans. Son dernier opus, « La Vie antérieure », aura occupé l'esprit du compositeur pendant dix ans (1874-1884). En dépit de sa brièveté - quatre minutes - cette œuvre a les proportions d'un édifice gothique : la richesse de l'expression harmonique, le lyrisme des moindres inflexions sont extraordinaires. Henri Duparc n'eut qu'un seul élève, Jean Cras (1879-1932), qu'il appelait affectueusement « le fils de mon âme ». Il le considérait un peu comme son disciple. Bien qu'il ait détruit et brûlé un grand nombre de ses compositions, ses dix-sept mélodies, d'une grande facture, sensibles et expressives, ont fait de lui un compositeur majeur de la fin du XIXe siècle. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. Une rue de Tarbes, une école maternelle ainsi que le Conservatoire de musique ont été baptisés de son nom. Le 1er avril 1921, à 73 ans, il fut promu chevalier de la Légion d'honneur. Malgré la brièveté de son activité créatrice, Henri Duparc détient un rôle important dans la vie musicale française de la fin du XIXe siècle. Son mince recueil de mélodies est une des plus belles réussites de la musique française. S'inspirant de textes de Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Leconte de Lisle, Jean Lahor et François Coppée, l'œuvre de Duparc marque un moment décisif de l'évolution du poème lyrique, entre Gounod, Fauré et Debussy. Henri Duparc ne laisse que 28 œuvres (5 musiques pour piano, 1 musique de chambre, 3 musiques symphoniques, 17 mélodies pour voix et piano dont 8 ont été ensuite orchestrées par ses soins, 1 musique sacrée et 1 opéra. Il fut le compositeur de nombreuses mélodies françaises, désormais au répertoire de beaucoup de chanteurs. Ravel qualifiait ses compositions d’ « imparfaites, mais géniales ». Compositeur philanthrope au mysticisme ardent et profond, complété d’un grand amoureux du sud-ouest de la France, il est aujourd'hui encore une référence en ce qui concerne la mélodie française, un summum de raffinement et de réussite. Alors même que son œuvre est petite, mais sans défaut, la mélodie française, celle de Fauré, de Bordes, de Chausson, de Debussy même, ne serait pas ce qu’elle est. Les poésies qu’Henri Duparc a traduites en chant, personne n’a osé les reprendre. Car il avait, du premier coup, atteint la perfection.
Henri DUPARC, né le 21 janvier 1848 à Paris et mort le 12 février 1933 à Mont-de-Marsan, où il s’était retiré en 1924. Il fut un grand compositeur français de la deuxième moitié du XIXème siècle. Son père, Louis Charles Fouques-Duparc (1807-1879), inspecteur général des ponts et chaussées, est directeur des chemins de fer de l'Ouest. Sa mère, Frédérique Amélie de Guaita (1822-1895), fille d'industriels, a publié une dizaine d'ouvrages pieux pour les enfants. Son grand-père, Louis Benoît Fouques-Duparc fut filleul de Louis XV. Henri fit ses études au collège des jésuites de la rue Vaugirard où César Franck, qui enseignait la musique, le considère comme son élève le plus talentueux. Celui-ci lui fait comprendre qu'il ne sera jamais un pianiste virtuose, mais qu'il y a en lui l'étoffe d'un compositeur. La mélodie l’attire et sera le fil conducteur de toute son œuvre. Il fait ensuite des études de droit. En 1867, il compose à l’âge de dix-huit ans une unique sonate pour piano et violoncelle (des fragments sont conservés). En 1868, il publie cinq mélodies. En 1869, il publie chez Flaxland six petites pièces pour piano. Il se lie d'amitié avec Vincent d'Indy et Alexis de Castillon. D'après Merle, il aurait séjourné chez Liszt en 1869 et fait la connaissance de Richard Wagner. Il assiste à la première représentation des Walküre (La Walkyrie) à Munich en 1870. Henri Duparc fut fortement influencé par Wagner. L’époque cruellement éprouvée par la guerre franco-allemande de 1870 met à mal les relations artistiques entre les deux pays. Tiraillé entre Berlioz et Wagner, Duparc se laisse séduire par le mythe allemand et se rend à Munich écouter ses opéras, ce qui aura sur lui une emprise indélébile. Le 9 novembre 1871, il épouse Ellen Mac Swiney, pianiste douée qui accompagna son mari jusqu'au bout en le soutenant d'une affection sans faille. Après la guerre 1870-1871, des musiciens et des écrivains se rencontrent chez Duparc (Gabriel Fauré, Ernest Chausson, Alexis de Castillon, Camille Saint-Saëns, Emmanuel Chabrier). C'est au cours d'une de ces rencontres, en 1871, qu’il fonde avec Camille Saint-Saëns et Romain Bussine, la Société Nationale de Musique, qui donna son premier concert la même année. Duparc est resté longtemps le secrétaire actif de l'organisation. Ses premières œuvres demeurent inédites mais dès 1870, il écrit l'Invitation au voyage, chef d'œuvre inaugurant l'ère parnassienne de la mélodie française. Dans les années 1870 la production de Duparc sera très dense. Son activité de compositeur de mélodies se situe entre les années 1869 et 1884 avec quelques incursions dans le domaine orchestral marqué en 1875 par le poème symphonique Léonore, qui consacre son nom dans la vie musicale officielle. En 1873, il compose une Suite d'orchestre, en 1874 un Poème Nocturne et une Suite de danses (compositions orchestrales perdues). Le 5 mai 1878, il annonce la création des Concerts de Musique Moderne (qu’il codirige avec Vincent d'Indy), qui se donnaient pour but de faire connaître les compositeurs contemporains. En 1879, il assiste à une représentation de Tristan, et refait presque aussitôt un nouveau voyage en Allemagne en compagnie d’Emmanuel Chabrier. Il passe l'hiver 1882-1883 à La Bourboule. De 1880 à 1885, il passe la plus grande partie de l'été à Marnes dans la région parisienne. En 1883 et 1886, il est à Bayreuth en Allemagne. Selon sa correspondance, il aurait fait plusieurs voyages en Irlande à partir de 1884. En 1885, il voit sa santé déjà altérée lui rendre tout travail créateur impossible, et s’arrête de composer à l’âge de trente-huit ans. Les premiers signes de neurasthénie se font sentir. La maladie nerveuse, dont il est atteint depuis de nombreuses années l'empêche définitivement de composer, le contraint à se reposer et il s’isolera dans la foi jusqu’à sa mort. Il se consacre alors à sa famille, produit des gouaches, des pastels ou des sépias et continue de s'intéresser à tous les arts, peignant et dessinant tant qu'il put encore voir. Un autre aspect du talent d’Henri Duparc : celui de dessinateur. Hypersensible et malade des nerfs, n’ayant plus la force de composer à partir de 1885, il se consacre beaucoup à la peinture avec l’aide et sur les conseils d’Henri Lerolle et Henri Harpignies, ce dernier rencontré à La Bourboule quelques années plus tôt. Soit une quarantaine de toiles, de dessins et d’aquarelles de paysages, notamment des Pyrénées. Durant les cinquante années qui lui restent à vivre, Duparc assiste, impuissant et lucide, à la paralysie de son talent. Il vit à Monein, au pied des Pyrénées jusqu'en 1897. Il y conçoit le projet d'un Opéra d'après une nouvelle de Pouchkine, La Roussalka, drame lyrique dont il détruira les esquisses (reste des fragments). À l'abbaye d'Abos dans le Béarn, le poète béarnais Charles de Bordau le présente à Francis Jammes. De 1897 à 1906, il vit à Paris. En 1900, il achève l'orchestration du Testament. En 1902, il entreprend son premier pèlerinage à Lourdes. De 1906 à 1913, il vit en Suisse à La Tour de Peilz (Vevey). En 1906, en compagnie de Paul Claudel et de Francis Jammes il fait le pèlerinage de Lourdes, qui semble être un révélateur pour une grande dévotion religieuse. De 1913 à 1919, il vit à Tarbes dans la très belle maison en haut à droite des allées Leclerc, face à la caserne du 1er RHP. En 1916, il évoque sa cécité. En 1919, il s'installe à Mont-de-Marsan. Il est opéré d'un glaucome le 12 août 1924. Atteint de paralysie, il passe la fin de sa vie dans un profond mysticisme religieux. Devenu entièrement aveugle et paralytique, il meurt le 12 février 1933 à l'âge de 85 ans. Son dernier opus, « La Vie antérieure », aura occupé l'esprit du compositeur pendant dix ans (1874-1884). En dépit de sa brièveté - quatre minutes - cette œuvre a les proportions d'un édifice gothique : la richesse de l'expression harmonique, le lyrisme des moindres inflexions sont extraordinaires. Henri Duparc n'eut qu'un seul élève, Jean Cras (1879-1932), qu'il appelait affectueusement « le fils de mon âme ». Il le considérait un peu comme son disciple. Bien qu'il ait détruit et brûlé un grand nombre de ses compositions, ses dix-sept mélodies, d'une grande facture, sensibles et expressives, ont fait de lui un compositeur majeur de la fin du XIXe siècle. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. Une rue de Tarbes, une école maternelle ainsi que le Conservatoire de musique ont été baptisés de son nom. Le 1er avril 1921, à 73 ans, il fut promu chevalier de la Légion d'honneur. Malgré la brièveté de son activité créatrice, Henri Duparc détient un rôle important dans la vie musicale française de la fin du XIXe siècle. Son mince recueil de mélodies est une des plus belles réussites de la musique française. S'inspirant de textes de Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Leconte de Lisle, Jean Lahor et François Coppée, l'œuvre de Duparc marque un moment décisif de l'évolution du poème lyrique, entre Gounod, Fauré et Debussy. Henri Duparc ne laisse que 28 œuvres (5 musiques pour piano, 1 musique de chambre, 3 musiques symphoniques, 17 mélodies pour voix et piano dont 8 ont été ensuite orchestrées par ses soins, 1 musique sacrée et 1 opéra. Il fut le compositeur de nombreuses mélodies françaises, désormais au répertoire de beaucoup de chanteurs. Ravel qualifiait ses compositions d’ « imparfaites, mais géniales ». Compositeur philanthrope au mysticisme ardent et profond, complété d’un grand amoureux du sud-ouest de la France, il est aujourd'hui encore une référence en ce qui concerne la mélodie française, un summum de raffinement et de réussite. Alors même que son œuvre est petite, mais sans défaut, la mélodie française, celle de Fauré, de Bordes, de Chausson, de Debussy même, ne serait pas ce qu’elle est. Les poésies qu’Henri Duparc a traduites en chant, personne n’a osé les reprendre. Car il avait, du premier coup, atteint la perfection.
 Henri DUPARC, né le 21 janvier 1848 à Paris et mort le 12 février 1933 à Mont-de-Marsan, où il s’était retiré en 1924. Il fut un grand compositeur français de la deuxième moitié du XIXème siècle. Son père, Louis Charles Fouques-Duparc (1807-1879), inspecteur général des ponts et chaussées, est directeur des chemins de fer de l'Ouest. Sa mère, Frédérique Amélie de Guaita (1822-1895), fille d'industriels, a publié une dizaine d'ouvrages pieux pour les enfants. Son grand-père, Louis Benoît Fouques-Duparc fut filleul de Louis XV. Henri fit ses études au collège des jésuites de la rue Vaugirard où César Franck, qui enseignait la musique, le considère comme son élève le plus talentueux. Celui-ci lui fait comprendre qu'il ne sera jamais un pianiste virtuose, mais qu'il y a en lui l'étoffe d'un compositeur. La mélodie l’attire et sera le fil conducteur de toute son œuvre. Il fait ensuite des études de droit. En 1867, il compose à l’âge de dix-huit ans une unique sonate pour piano et violoncelle (des fragments sont conservés). En 1868, il publie cinq mélodies. En 1869, il publie chez Flaxland six petites pièces pour piano. Il se lie d'amitié avec Vincent d'Indy et Alexis de Castillon. D'après Merle, il aurait séjourné chez Liszt en 1869 et fait la connaissance de Richard Wagner. Il assiste à la première représentation des Walküre (La Walkyrie) à Munich en 1870. Henri Duparc fut fortement influencé par Wagner. L’époque cruellement éprouvée par la guerre franco-allemande de 1870 met à mal les relations artistiques entre les deux pays. Tiraillé entre Berlioz et Wagner, Duparc se laisse séduire par le mythe allemand et se rend à Munich écouter ses opéras, ce qui aura sur lui une emprise indélébile. Le 9 novembre 1871, il épouse Ellen Mac Swiney, pianiste douée qui accompagna son mari jusqu'au bout en le soutenant d'une affection sans faille. Après la guerre 1870-1871, des musiciens et des écrivains se rencontrent chez Duparc (Gabriel Fauré, Ernest Chausson, Alexis de Castillon, Camille Saint-Saëns, Emmanuel Chabrier). C'est au cours d'une de ces rencontres, en 1871, qu’il fonde avec Camille Saint-Saëns et Romain Bussine, la Société Nationale de Musique, qui donna son premier concert la même année. Duparc est resté longtemps le secrétaire actif de l'organisation. Ses premières œuvres demeurent inédites mais dès 1870, il écrit l'Invitation au voyage, chef d'œuvre inaugurant l'ère parnassienne de la mélodie française. Dans les années 1870 la production de Duparc sera très dense. Son activité de compositeur de mélodies se situe entre les années 1869 et 1884 avec quelques incursions dans le domaine orchestral marqué en 1875 par le poème symphonique Léonore, qui consacre son nom dans la vie musicale officielle. En 1873, il compose une Suite d'orchestre, en 1874 un Poème Nocturne et une Suite de danses (compositions orchestrales perdues). Le 5 mai 1878, il annonce la création des Concerts de Musique Moderne (qu’il codirige avec Vincent d'Indy), qui se donnaient pour but de faire connaître les compositeurs contemporains. En 1879, il assiste à une représentation de Tristan, et refait presque aussitôt un nouveau voyage en Allemagne en compagnie d’Emmanuel Chabrier. Il passe l'hiver 1882-1883 à La Bourboule. De 1880 à 1885, il passe la plus grande partie de l'été à Marnes dans la région parisienne. En 1883 et 1886, il est à Bayreuth en Allemagne. Selon sa correspondance, il aurait fait plusieurs voyages en Irlande à partir de 1884. En 1885, il voit sa santé déjà altérée lui rendre tout travail créateur impossible, et s’arrête de composer à l’âge de trente-huit ans. Les premiers signes de neurasthénie se font sentir. La maladie nerveuse, dont il est atteint depuis de nombreuses années l'empêche définitivement de composer, le contraint à se reposer et il s’isolera dans la foi jusqu’à sa mort. Il se consacre alors à sa famille, produit des gouaches, des pastels ou des sépias et continue de s'intéresser à tous les arts, peignant et dessinant tant qu'il put encore voir. Un autre aspect du talent d’Henri Duparc : celui de dessinateur. Hypersensible et malade des nerfs, n’ayant plus la force de composer à partir de 1885, il se consacre beaucoup à la peinture avec l’aide et sur les conseils d’Henri Lerolle et Henri Harpignies, ce dernier rencontré à La Bourboule quelques années plus tôt. Soit une quarantaine de toiles, de dessins et d’aquarelles de paysages, notamment des Pyrénées. Durant les cinquante années qui lui restent à vivre, Duparc assiste, impuissant et lucide, à la paralysie de son talent. Il vit à Monein, au pied des Pyrénées jusqu'en 1897. Il y conçoit le projet d'un Opéra d'après une nouvelle de Pouchkine, La Roussalka, drame lyrique dont il détruira les esquisses (reste des fragments). À l'abbaye d'Abos dans le Béarn, le poète béarnais Charles de Bordau le présente à Francis Jammes. De 1897 à 1906, il vit à Paris. En 1900, il achève l'orchestration du Testament. En 1902, il entreprend son premier pèlerinage à Lourdes. De 1906 à 1913, il vit en Suisse à La Tour de Peilz (Vevey). En 1906, en compagnie de Paul Claudel et de Francis Jammes il fait le pèlerinage de Lourdes, qui semble être un révélateur pour une grande dévotion religieuse. De 1913 à 1919, il vit à Tarbes dans la très belle maison en haut à droite des allées Leclerc, face à la caserne du 1er RHP. En 1916, il évoque sa cécité. En 1919, il s'installe à Mont-de-Marsan. Il est opéré d'un glaucome le 12 août 1924. Atteint de paralysie, il passe la fin de sa vie dans un profond mysticisme religieux. Devenu entièrement aveugle et paralytique, il meurt le 12 février 1933 à l'âge de 85 ans. Son dernier opus, « La Vie antérieure », aura occupé l'esprit du compositeur pendant dix ans (1874-1884). En dépit de sa brièveté - quatre minutes - cette œuvre a les proportions d'un édifice gothique : la richesse de l'expression harmonique, le lyrisme des moindres inflexions sont extraordinaires. Henri Duparc n'eut qu'un seul élève, Jean Cras (1879-1932), qu'il appelait affectueusement « le fils de mon âme ». Il le considérait un peu comme son disciple. Bien qu'il ait détruit et brûlé un grand nombre de ses compositions, ses dix-sept mélodies, d'une grande facture, sensibles et expressives, ont fait de lui un compositeur majeur de la fin du XIXe siècle. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. Une rue de Tarbes, une école maternelle ainsi que le Conservatoire de musique ont été baptisés de son nom. Le 1er avril 1921, à 73 ans, il fut promu chevalier de la Légion d'honneur. Malgré la brièveté de son activité créatrice, Henri Duparc détient un rôle important dans la vie musicale française de la fin du XIXe siècle. Son mince recueil de mélodies est une des plus belles réussites de la musique française. S'inspirant de textes de Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Leconte de Lisle, Jean Lahor et François Coppée, l'œuvre de Duparc marque un moment décisif de l'évolution du poème lyrique, entre Gounod, Fauré et Debussy. Henri Duparc ne laisse que 28 œuvres (5 musiques pour piano, 1 musique de chambre, 3 musiques symphoniques, 17 mélodies pour voix et piano dont 8 ont été ensuite orchestrées par ses soins, 1 musique sacrée et 1 opéra. Il fut le compositeur de nombreuses mélodies françaises, désormais au répertoire de beaucoup de chanteurs. Ravel qualifiait ses compositions d’ « imparfaites, mais géniales ». Compositeur philanthrope au mysticisme ardent et profond, complété d’un grand amoureux du sud-ouest de la France, il est aujourd'hui encore une référence en ce qui concerne la mélodie française, un summum de raffinement et de réussite. Alors même que son œuvre est petite, mais sans défaut, la mélodie française, celle de Fauré, de Bordes, de Chausson, de Debussy même, ne serait pas ce qu’elle est. Les poésies qu’Henri Duparc a traduites en chant, personne n’a osé les reprendre. Car il avait, du premier coup, atteint la perfection.
Henri DUPARC, né le 21 janvier 1848 à Paris et mort le 12 février 1933 à Mont-de-Marsan, où il s’était retiré en 1924. Il fut un grand compositeur français de la deuxième moitié du XIXème siècle. Son père, Louis Charles Fouques-Duparc (1807-1879), inspecteur général des ponts et chaussées, est directeur des chemins de fer de l'Ouest. Sa mère, Frédérique Amélie de Guaita (1822-1895), fille d'industriels, a publié une dizaine d'ouvrages pieux pour les enfants. Son grand-père, Louis Benoît Fouques-Duparc fut filleul de Louis XV. Henri fit ses études au collège des jésuites de la rue Vaugirard où César Franck, qui enseignait la musique, le considère comme son élève le plus talentueux. Celui-ci lui fait comprendre qu'il ne sera jamais un pianiste virtuose, mais qu'il y a en lui l'étoffe d'un compositeur. La mélodie l’attire et sera le fil conducteur de toute son œuvre. Il fait ensuite des études de droit. En 1867, il compose à l’âge de dix-huit ans une unique sonate pour piano et violoncelle (des fragments sont conservés). En 1868, il publie cinq mélodies. En 1869, il publie chez Flaxland six petites pièces pour piano. Il se lie d'amitié avec Vincent d'Indy et Alexis de Castillon. D'après Merle, il aurait séjourné chez Liszt en 1869 et fait la connaissance de Richard Wagner. Il assiste à la première représentation des Walküre (La Walkyrie) à Munich en 1870. Henri Duparc fut fortement influencé par Wagner. L’époque cruellement éprouvée par la guerre franco-allemande de 1870 met à mal les relations artistiques entre les deux pays. Tiraillé entre Berlioz et Wagner, Duparc se laisse séduire par le mythe allemand et se rend à Munich écouter ses opéras, ce qui aura sur lui une emprise indélébile. Le 9 novembre 1871, il épouse Ellen Mac Swiney, pianiste douée qui accompagna son mari jusqu'au bout en le soutenant d'une affection sans faille. Après la guerre 1870-1871, des musiciens et des écrivains se rencontrent chez Duparc (Gabriel Fauré, Ernest Chausson, Alexis de Castillon, Camille Saint-Saëns, Emmanuel Chabrier). C'est au cours d'une de ces rencontres, en 1871, qu’il fonde avec Camille Saint-Saëns et Romain Bussine, la Société Nationale de Musique, qui donna son premier concert la même année. Duparc est resté longtemps le secrétaire actif de l'organisation. Ses premières œuvres demeurent inédites mais dès 1870, il écrit l'Invitation au voyage, chef d'œuvre inaugurant l'ère parnassienne de la mélodie française. Dans les années 1870 la production de Duparc sera très dense. Son activité de compositeur de mélodies se situe entre les années 1869 et 1884 avec quelques incursions dans le domaine orchestral marqué en 1875 par le poème symphonique Léonore, qui consacre son nom dans la vie musicale officielle. En 1873, il compose une Suite d'orchestre, en 1874 un Poème Nocturne et une Suite de danses (compositions orchestrales perdues). Le 5 mai 1878, il annonce la création des Concerts de Musique Moderne (qu’il codirige avec Vincent d'Indy), qui se donnaient pour but de faire connaître les compositeurs contemporains. En 1879, il assiste à une représentation de Tristan, et refait presque aussitôt un nouveau voyage en Allemagne en compagnie d’Emmanuel Chabrier. Il passe l'hiver 1882-1883 à La Bourboule. De 1880 à 1885, il passe la plus grande partie de l'été à Marnes dans la région parisienne. En 1883 et 1886, il est à Bayreuth en Allemagne. Selon sa correspondance, il aurait fait plusieurs voyages en Irlande à partir de 1884. En 1885, il voit sa santé déjà altérée lui rendre tout travail créateur impossible, et s’arrête de composer à l’âge de trente-huit ans. Les premiers signes de neurasthénie se font sentir. La maladie nerveuse, dont il est atteint depuis de nombreuses années l'empêche définitivement de composer, le contraint à se reposer et il s’isolera dans la foi jusqu’à sa mort. Il se consacre alors à sa famille, produit des gouaches, des pastels ou des sépias et continue de s'intéresser à tous les arts, peignant et dessinant tant qu'il put encore voir. Un autre aspect du talent d’Henri Duparc : celui de dessinateur. Hypersensible et malade des nerfs, n’ayant plus la force de composer à partir de 1885, il se consacre beaucoup à la peinture avec l’aide et sur les conseils d’Henri Lerolle et Henri Harpignies, ce dernier rencontré à La Bourboule quelques années plus tôt. Soit une quarantaine de toiles, de dessins et d’aquarelles de paysages, notamment des Pyrénées. Durant les cinquante années qui lui restent à vivre, Duparc assiste, impuissant et lucide, à la paralysie de son talent. Il vit à Monein, au pied des Pyrénées jusqu'en 1897. Il y conçoit le projet d'un Opéra d'après une nouvelle de Pouchkine, La Roussalka, drame lyrique dont il détruira les esquisses (reste des fragments). À l'abbaye d'Abos dans le Béarn, le poète béarnais Charles de Bordau le présente à Francis Jammes. De 1897 à 1906, il vit à Paris. En 1900, il achève l'orchestration du Testament. En 1902, il entreprend son premier pèlerinage à Lourdes. De 1906 à 1913, il vit en Suisse à La Tour de Peilz (Vevey). En 1906, en compagnie de Paul Claudel et de Francis Jammes il fait le pèlerinage de Lourdes, qui semble être un révélateur pour une grande dévotion religieuse. De 1913 à 1919, il vit à Tarbes dans la très belle maison en haut à droite des allées Leclerc, face à la caserne du 1er RHP. En 1916, il évoque sa cécité. En 1919, il s'installe à Mont-de-Marsan. Il est opéré d'un glaucome le 12 août 1924. Atteint de paralysie, il passe la fin de sa vie dans un profond mysticisme religieux. Devenu entièrement aveugle et paralytique, il meurt le 12 février 1933 à l'âge de 85 ans. Son dernier opus, « La Vie antérieure », aura occupé l'esprit du compositeur pendant dix ans (1874-1884). En dépit de sa brièveté - quatre minutes - cette œuvre a les proportions d'un édifice gothique : la richesse de l'expression harmonique, le lyrisme des moindres inflexions sont extraordinaires. Henri Duparc n'eut qu'un seul élève, Jean Cras (1879-1932), qu'il appelait affectueusement « le fils de mon âme ». Il le considérait un peu comme son disciple. Bien qu'il ait détruit et brûlé un grand nombre de ses compositions, ses dix-sept mélodies, d'une grande facture, sensibles et expressives, ont fait de lui un compositeur majeur de la fin du XIXe siècle. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise. Une rue de Tarbes, une école maternelle ainsi que le Conservatoire de musique ont été baptisés de son nom. Le 1er avril 1921, à 73 ans, il fut promu chevalier de la Légion d'honneur. Malgré la brièveté de son activité créatrice, Henri Duparc détient un rôle important dans la vie musicale française de la fin du XIXe siècle. Son mince recueil de mélodies est une des plus belles réussites de la musique française. S'inspirant de textes de Charles Baudelaire, Théophile Gautier, Leconte de Lisle, Jean Lahor et François Coppée, l'œuvre de Duparc marque un moment décisif de l'évolution du poème lyrique, entre Gounod, Fauré et Debussy. Henri Duparc ne laisse que 28 œuvres (5 musiques pour piano, 1 musique de chambre, 3 musiques symphoniques, 17 mélodies pour voix et piano dont 8 ont été ensuite orchestrées par ses soins, 1 musique sacrée et 1 opéra. Il fut le compositeur de nombreuses mélodies françaises, désormais au répertoire de beaucoup de chanteurs. Ravel qualifiait ses compositions d’ « imparfaites, mais géniales ». Compositeur philanthrope au mysticisme ardent et profond, complété d’un grand amoureux du sud-ouest de la France, il est aujourd'hui encore une référence en ce qui concerne la mélodie française, un summum de raffinement et de réussite. Alors même que son œuvre est petite, mais sans défaut, la mélodie française, celle de Fauré, de Bordes, de Chausson, de Debussy même, ne serait pas ce qu’elle est. Les poésies qu’Henri Duparc a traduites en chant, personne n’a osé les reprendre. Car il avait, du premier coup, atteint la perfection.DUPLAN Edmond (1930-XXXX)
Auteur-compositeur-interprète
 Edmond DUPLAN, dit « Momon », né le 20 septembre 1930 à Pouzac, est un chanteur-compositeur bigourdan. Il est le chantre de sa région et ses chansons populaires sont connues dans tout le Sud-Ouest et au-delà. Il se produit toujours dans les fêtes de village et à l’occasion de manifestations diverses. Les beaux paysages et les hommes des Pyrénées sont au cœur de son répertoire, tant en français qu’en occitan. Qui n’a jamais chanté, voire simplement fredonné « Le Refuge » ou encore « La Transhumance », reprise par le non moins célèbre groupe de Sangria Gratuite ? Tout le monde connaît ces airs inscrits dans les fêtes du Sud-Ouest. Mais, tout le monde ne connaît pas forcément l’auteur de ces réels tubes, aux refrains archiconnus, devenus des classiques de la culture pyrénéenne. Il est l’auteur-compositeur d’environ 200 chansons et compte à son actif près de 10 albums. On l’appelle "le Cantagoy pyrénéen". La musique lui est venue de manière presque naturelle. Son père, premier prix du Conservatoire de Bordeaux, l’avait intégré dans la chorale, qu’il avait créée à Pouzac, durant la Seconde Guerre mondiale. Le jeune Edmond enchaîna ensuite radio-crochets et concours de chant, mais il ne pensait pas en faire son métier. Pourtant, en 1950, soldat en Tunisie, il avait déjà griffonné quelques paroles sur un air de marche connu. Le sergent voulut que ce soit le chant du bataillon après l’entraînement. Ce fut alors le déclic. Mais la première composition n’arriva qu’en 1952, avec « Au revoir Pyrénées … salut Paris ». Il venait d’arriver à Paris et composa cette chanson sur un coup de spleen, dira-t-il. Loin de ses Pyrénées, il fait ses débuts sur scène dans les grandes brasseries qui accueillent alors des attractions. Il chante en première partie avec de grands noms de l’époque comme Dario Moreno, Marcel Amont ou Sacha Distel. Il se produit également dans les cabarets et au music-hall. Goûtant à la vie parisienne en étant présentateur de cirque pour Fernand Raynaud ou en participant à une opérette avec Luis Mariano et Annie Cordy ou chantant l’opérette avec le « Visa pour l’amour » de Francis Lopez, il n’en oublia pas pour autant ses racines. Puis il décida de s’éloigner de la scène pour se consacrer à son métier de dessinateur publicitaire et au rugby. Il pratiqua le rugby pendant des années dans un petit club de Clamart, où il fut aussi formateur de jeunes à l’école de rugby. Ce n’est qu’en 1980, à l’âge de 50 ans, qu’il regagna sa Bigorre natale et commença à parcourir le Sud-Ouest avec sa guitare pour gagner sa croûte. Des concerts, qu’il ne cessera d’enchaîner. Tandis que son activité de chanteur prend son essor, il devient journaliste, dessinateur de presse et animateur de radio. Depuis les années 1990, il s’est consacré entièrement à la chanson, qu’il interprète si bien avec son bel accent montagnard. Parfois, accompagné de membres de sa famille, qu’il voit comme reprenant son flambeau. Ainsi, Arnaud et Lionel ses fils, Michel Pebay un cousin, et des amis d’enfance, Gérard Mazoua et Floréal Nunez, assurent la première partie, avec leur quintette de chants polyphoniques pyrénéens, « Cœur de Bigorre ». Et si l’écho de son talent a largement dépassé les frontières du "Pays bigourdan" qui l’a inspiré, il reste la figure de proue du folklore pyrénéen. À près de 90 ans, ce troubadour bagnérais chante encore, dans un registre chaleureux et entraînant, sa région et son pays. Il est sans doute une des plus grandes figures de la chanson pyrénéenne contemporaine avec Nadau.
Edmond DUPLAN, dit « Momon », né le 20 septembre 1930 à Pouzac, est un chanteur-compositeur bigourdan. Il est le chantre de sa région et ses chansons populaires sont connues dans tout le Sud-Ouest et au-delà. Il se produit toujours dans les fêtes de village et à l’occasion de manifestations diverses. Les beaux paysages et les hommes des Pyrénées sont au cœur de son répertoire, tant en français qu’en occitan. Qui n’a jamais chanté, voire simplement fredonné « Le Refuge » ou encore « La Transhumance », reprise par le non moins célèbre groupe de Sangria Gratuite ? Tout le monde connaît ces airs inscrits dans les fêtes du Sud-Ouest. Mais, tout le monde ne connaît pas forcément l’auteur de ces réels tubes, aux refrains archiconnus, devenus des classiques de la culture pyrénéenne. Il est l’auteur-compositeur d’environ 200 chansons et compte à son actif près de 10 albums. On l’appelle "le Cantagoy pyrénéen". La musique lui est venue de manière presque naturelle. Son père, premier prix du Conservatoire de Bordeaux, l’avait intégré dans la chorale, qu’il avait créée à Pouzac, durant la Seconde Guerre mondiale. Le jeune Edmond enchaîna ensuite radio-crochets et concours de chant, mais il ne pensait pas en faire son métier. Pourtant, en 1950, soldat en Tunisie, il avait déjà griffonné quelques paroles sur un air de marche connu. Le sergent voulut que ce soit le chant du bataillon après l’entraînement. Ce fut alors le déclic. Mais la première composition n’arriva qu’en 1952, avec « Au revoir Pyrénées … salut Paris ». Il venait d’arriver à Paris et composa cette chanson sur un coup de spleen, dira-t-il. Loin de ses Pyrénées, il fait ses débuts sur scène dans les grandes brasseries qui accueillent alors des attractions. Il chante en première partie avec de grands noms de l’époque comme Dario Moreno, Marcel Amont ou Sacha Distel. Il se produit également dans les cabarets et au music-hall. Goûtant à la vie parisienne en étant présentateur de cirque pour Fernand Raynaud ou en participant à une opérette avec Luis Mariano et Annie Cordy ou chantant l’opérette avec le « Visa pour l’amour » de Francis Lopez, il n’en oublia pas pour autant ses racines. Puis il décida de s’éloigner de la scène pour se consacrer à son métier de dessinateur publicitaire et au rugby. Il pratiqua le rugby pendant des années dans un petit club de Clamart, où il fut aussi formateur de jeunes à l’école de rugby. Ce n’est qu’en 1980, à l’âge de 50 ans, qu’il regagna sa Bigorre natale et commença à parcourir le Sud-Ouest avec sa guitare pour gagner sa croûte. Des concerts, qu’il ne cessera d’enchaîner. Tandis que son activité de chanteur prend son essor, il devient journaliste, dessinateur de presse et animateur de radio. Depuis les années 1990, il s’est consacré entièrement à la chanson, qu’il interprète si bien avec son bel accent montagnard. Parfois, accompagné de membres de sa famille, qu’il voit comme reprenant son flambeau. Ainsi, Arnaud et Lionel ses fils, Michel Pebay un cousin, et des amis d’enfance, Gérard Mazoua et Floréal Nunez, assurent la première partie, avec leur quintette de chants polyphoniques pyrénéens, « Cœur de Bigorre ». Et si l’écho de son talent a largement dépassé les frontières du "Pays bigourdan" qui l’a inspiré, il reste la figure de proue du folklore pyrénéen. À près de 90 ans, ce troubadour bagnérais chante encore, dans un registre chaleureux et entraînant, sa région et son pays. Il est sans doute une des plus grandes figures de la chanson pyrénéenne contemporaine avec Nadau.
 Edmond DUPLAN, dit « Momon », né le 20 septembre 1930 à Pouzac, est un chanteur-compositeur bigourdan. Il est le chantre de sa région et ses chansons populaires sont connues dans tout le Sud-Ouest et au-delà. Il se produit toujours dans les fêtes de village et à l’occasion de manifestations diverses. Les beaux paysages et les hommes des Pyrénées sont au cœur de son répertoire, tant en français qu’en occitan. Qui n’a jamais chanté, voire simplement fredonné « Le Refuge » ou encore « La Transhumance », reprise par le non moins célèbre groupe de Sangria Gratuite ? Tout le monde connaît ces airs inscrits dans les fêtes du Sud-Ouest. Mais, tout le monde ne connaît pas forcément l’auteur de ces réels tubes, aux refrains archiconnus, devenus des classiques de la culture pyrénéenne. Il est l’auteur-compositeur d’environ 200 chansons et compte à son actif près de 10 albums. On l’appelle "le Cantagoy pyrénéen". La musique lui est venue de manière presque naturelle. Son père, premier prix du Conservatoire de Bordeaux, l’avait intégré dans la chorale, qu’il avait créée à Pouzac, durant la Seconde Guerre mondiale. Le jeune Edmond enchaîna ensuite radio-crochets et concours de chant, mais il ne pensait pas en faire son métier. Pourtant, en 1950, soldat en Tunisie, il avait déjà griffonné quelques paroles sur un air de marche connu. Le sergent voulut que ce soit le chant du bataillon après l’entraînement. Ce fut alors le déclic. Mais la première composition n’arriva qu’en 1952, avec « Au revoir Pyrénées … salut Paris ». Il venait d’arriver à Paris et composa cette chanson sur un coup de spleen, dira-t-il. Loin de ses Pyrénées, il fait ses débuts sur scène dans les grandes brasseries qui accueillent alors des attractions. Il chante en première partie avec de grands noms de l’époque comme Dario Moreno, Marcel Amont ou Sacha Distel. Il se produit également dans les cabarets et au music-hall. Goûtant à la vie parisienne en étant présentateur de cirque pour Fernand Raynaud ou en participant à une opérette avec Luis Mariano et Annie Cordy ou chantant l’opérette avec le « Visa pour l’amour » de Francis Lopez, il n’en oublia pas pour autant ses racines. Puis il décida de s’éloigner de la scène pour se consacrer à son métier de dessinateur publicitaire et au rugby. Il pratiqua le rugby pendant des années dans un petit club de Clamart, où il fut aussi formateur de jeunes à l’école de rugby. Ce n’est qu’en 1980, à l’âge de 50 ans, qu’il regagna sa Bigorre natale et commença à parcourir le Sud-Ouest avec sa guitare pour gagner sa croûte. Des concerts, qu’il ne cessera d’enchaîner. Tandis que son activité de chanteur prend son essor, il devient journaliste, dessinateur de presse et animateur de radio. Depuis les années 1990, il s’est consacré entièrement à la chanson, qu’il interprète si bien avec son bel accent montagnard. Parfois, accompagné de membres de sa famille, qu’il voit comme reprenant son flambeau. Ainsi, Arnaud et Lionel ses fils, Michel Pebay un cousin, et des amis d’enfance, Gérard Mazoua et Floréal Nunez, assurent la première partie, avec leur quintette de chants polyphoniques pyrénéens, « Cœur de Bigorre ». Et si l’écho de son talent a largement dépassé les frontières du "Pays bigourdan" qui l’a inspiré, il reste la figure de proue du folklore pyrénéen. À près de 90 ans, ce troubadour bagnérais chante encore, dans un registre chaleureux et entraînant, sa région et son pays. Il est sans doute une des plus grandes figures de la chanson pyrénéenne contemporaine avec Nadau.
Edmond DUPLAN, dit « Momon », né le 20 septembre 1930 à Pouzac, est un chanteur-compositeur bigourdan. Il est le chantre de sa région et ses chansons populaires sont connues dans tout le Sud-Ouest et au-delà. Il se produit toujours dans les fêtes de village et à l’occasion de manifestations diverses. Les beaux paysages et les hommes des Pyrénées sont au cœur de son répertoire, tant en français qu’en occitan. Qui n’a jamais chanté, voire simplement fredonné « Le Refuge » ou encore « La Transhumance », reprise par le non moins célèbre groupe de Sangria Gratuite ? Tout le monde connaît ces airs inscrits dans les fêtes du Sud-Ouest. Mais, tout le monde ne connaît pas forcément l’auteur de ces réels tubes, aux refrains archiconnus, devenus des classiques de la culture pyrénéenne. Il est l’auteur-compositeur d’environ 200 chansons et compte à son actif près de 10 albums. On l’appelle "le Cantagoy pyrénéen". La musique lui est venue de manière presque naturelle. Son père, premier prix du Conservatoire de Bordeaux, l’avait intégré dans la chorale, qu’il avait créée à Pouzac, durant la Seconde Guerre mondiale. Le jeune Edmond enchaîna ensuite radio-crochets et concours de chant, mais il ne pensait pas en faire son métier. Pourtant, en 1950, soldat en Tunisie, il avait déjà griffonné quelques paroles sur un air de marche connu. Le sergent voulut que ce soit le chant du bataillon après l’entraînement. Ce fut alors le déclic. Mais la première composition n’arriva qu’en 1952, avec « Au revoir Pyrénées … salut Paris ». Il venait d’arriver à Paris et composa cette chanson sur un coup de spleen, dira-t-il. Loin de ses Pyrénées, il fait ses débuts sur scène dans les grandes brasseries qui accueillent alors des attractions. Il chante en première partie avec de grands noms de l’époque comme Dario Moreno, Marcel Amont ou Sacha Distel. Il se produit également dans les cabarets et au music-hall. Goûtant à la vie parisienne en étant présentateur de cirque pour Fernand Raynaud ou en participant à une opérette avec Luis Mariano et Annie Cordy ou chantant l’opérette avec le « Visa pour l’amour » de Francis Lopez, il n’en oublia pas pour autant ses racines. Puis il décida de s’éloigner de la scène pour se consacrer à son métier de dessinateur publicitaire et au rugby. Il pratiqua le rugby pendant des années dans un petit club de Clamart, où il fut aussi formateur de jeunes à l’école de rugby. Ce n’est qu’en 1980, à l’âge de 50 ans, qu’il regagna sa Bigorre natale et commença à parcourir le Sud-Ouest avec sa guitare pour gagner sa croûte. Des concerts, qu’il ne cessera d’enchaîner. Tandis que son activité de chanteur prend son essor, il devient journaliste, dessinateur de presse et animateur de radio. Depuis les années 1990, il s’est consacré entièrement à la chanson, qu’il interprète si bien avec son bel accent montagnard. Parfois, accompagné de membres de sa famille, qu’il voit comme reprenant son flambeau. Ainsi, Arnaud et Lionel ses fils, Michel Pebay un cousin, et des amis d’enfance, Gérard Mazoua et Floréal Nunez, assurent la première partie, avec leur quintette de chants polyphoniques pyrénéens, « Cœur de Bigorre ». Et si l’écho de son talent a largement dépassé les frontières du "Pays bigourdan" qui l’a inspiré, il reste la figure de proue du folklore pyrénéen. À près de 90 ans, ce troubadour bagnérais chante encore, dans un registre chaleureux et entraînant, sa région et son pays. Il est sans doute une des plus grandes figures de la chanson pyrénéenne contemporaine avec Nadau.DUPONT Antoine (1996-XXXX)
Demi de mêlée du Stade toulousain et du XV de France, élu meilleur joueur du Tournoi des Six Nations en 2020, 2022 et 2023, sacré meilleur joueur du monde en 2021 par World Rugby et médaillé d'or au rugby à 7 avec la France lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.
 Antoine DUPONT, né le 15 novembre 1996 à Lannemezan, est un joueur international français de rugby à XV évoluant principalement au poste de demi de mêlée. Il mesure 1m74 pour 85 kg. Il joue au sein de l’effectif du Stade toulousain et en équipe de France depuis 2017. Il est originaire du village de Castelnau-Magnoac, où il a commencé le rugby à l’âge de 4 ans au Magnoac FC3. Sa passion depuis tout petit, c'est de jouer au rugby. Il veut suivre les pas de Clément son grand frère, de trois ans son aîné, dans le monde du ballon ovale. Et dès ses premiers entraînements, il va épater tout le monde avec des capacités physiques hors-normes, dit Jean-Philippe Guerrero, son premier entraîneur. « Un surdoué, précoce, avec de la fluidité, un rôle de distributeur et une vision stratégique toujours justes, un catalyseur du jeu offensif et audacieux », résume ainsi Jean-Philippe Guerrero. « Il arrangeait les règles », se rappelle en riant son frère Clément, avec lequel la compétition était permanente. Clément se souvient des duels, des trois contre deux ou trois contre trois qu'Antoine aimait et grâce auxquels il a progressé. Doué, le petit était régulièrement surclassé et jouait contre des plus grands. En 2011, alors qu’il évolue en cadet, il rejoint le centre de formation du FC Auch. Il intègre également le pôle Espoir du lycée Jolimont (aujourd’hui lycée Stéphane-Hessel) à Toulouse, où il passe son Bac S-SVT. Il débute ensuite un DUT mesures physiques à l’IUT d’Orsay, à Paris. Au bout d’un trimestre, il décide d’arrêter et de commencer une licence STAPS, toujours à la faculté d’Orsay, alors qu’il joue au Castres olympique. « J’y suis resté six mois, puis j’ai fini ma licence à Toulouse, à l’université Paul Sabatier », note le rugbyman. En 2018, une fois diplômé, pas question pour lui d’arrêter ses études. Il poursuit alors en s’inscrivant en école de commerce à Toulouse, où il étudie le management du sport. Il a conscience qu’une carrière professionnelle de rugbyman ne dure pas toute une vie, et qu’il aura besoin de se reconvertir après sa retraite de sportif. « Je n’ai pas d’idée précise de reconversion, mais je veux avoir un certain bagage scolaire pour la suite », indique-t-il. Passionné de sport (pas uniquement de rugby), il est curieux de découvrir comment fonctionne cette économie. « Je trouve intéressant de comprendre le business du sport, moi qui baigne dans le monde du rugby depuis mes quatre ans ». En plus d’être l’étoile montante du rugby français et l’un des meilleurs joueurs du Tournoi jusque-ici, ce sportif est donc en master 2 management du sport à l’école de commerce Toulouse School of Management (TBS). En 2014, il dispute la finale du championnat de France Crabos avec Auch et rejoint le Castres olympique à l’issue de la saison. Âgé de 18 ans, le 8 novembre 2014, il fait ses débuts avec l’équipe professionnelle lors d’une rencontre face au RC Toulon en rentrant pour une minute de jeu à la place de Cédric Garcia. En janvier 2015, il est titularisé en Coupe d’Europe pour un match contre les Harlequins, au cours duquel il inscrit son premier essai professionnel. À la suite d’une mêlée castraise à cinq mètres de l’en-but anglais, il récupère le ballon, échappe au plaquage du capitaine londonien Chris Robshaw, et aplatit le ballon sous les poteaux. Membre du pôle espoir de Marcoussis pour la saison 2014-2015, il est sélectionné par Fabien Pelous pour disputer le Tournoi des Six Nations des moins de 20 ans avec l’équipe de France. Il joue trois matches, à chaque fois en tant que remplaçant, et n’est finalement pas retenu pour le championnat du monde junior de la même année. Il joue onze matches toutes compétitions confondues pour sa première année sous les couleurs bleu et blanc du Castres olympique. La saison suivante, en 2015 avec le Castres olympique, il joue 18 matches toutes compétitions confondues. Il réalise notamment un très bon match face à l’US Oyonnax en début de saison, alors que Christophe Urios, son nouvel entraîneur, décide de le titulariser au poste d’ouvreur aux dépens de Romain Cabannes à la suite d’un nombre important de blessés au poste. Il est nommé cette année parmi les meilleurs espoirs lors de la Nuit du rugby. Il est de nouveau appelé en équipe de France des moins de 20 ans pour le Tournoi des Six Nations et pour le championnat du monde junior en juin 2016. Durant cette compétition, il inscrit un total de cinq essais en trois titularisations, dont trois essais contre le Japon en phase de poule. En juillet 2016, il figure sur la Liste développement de 30 joueurs de moins de 23 ans à fort potentiel que les entraîneurs de l’équipe de France suivent pour la saison 2016-2017. En novembre 2016, il est sélectionné dans l’équipe des Barbarians français par Raphaël Ibañez pour affronter une sélection australienne (contre les Wallabies XV l'équipe réserve australienne) au Stade Chaban-Delmas de Bordeaux. Il commence la rencontre en tant que remplaçant de Yann Lesgourgues et réalise une entrée remarquée qui attire l'attention de nombreux observateurs, aidant son équipe à s’imposer sur le score de 19 à 11. En septembre 2016, Antoine Dupont est annoncé partant pour le Stade toulousain par les médias RMC et La Dépêche du Midi, sans que cela soit confirmé officiellement. En novembre, RMC annonce de nouveau la signature du joueur au Stade toulousain, mais cette fois, l’information est démentie par l’entraîneur du Castres olympique. Christophe Urios déclarant « qu’Antoine Dupont est encore en réflexion et n’a pas signé à Toulouse ». Le 29 novembre 2016, le club de Castres annonce sur son site Internet le départ du demi de mêlée à la fin de la saison, sans pour autant préciser pour quel club. Le lendemain, le Stade toulousain annonce l’arrivée du joueur à compter de la saison 2017-2018. L’annonce et la contre-annonce du départ d’Antoine Dupont se déroulent dans un contexte qui voit le joueur s’affirmer en club, où il réalise de bonnes performances et où il voit son temps de jeu augmenter. Les supporters de Castres affichent leur souhait de voir le joueur rester au club et prolonger son contrat. Le 8 mars 2017, il est appelé pour la première fois en équipe de France par Guy Novès à la suite d’une blessure de Maxime Machenaud. Quarante-huit heures après son premier entraînement avec le XV de France, il connaît sa première sélection au Stade olympique de Rome face à l’équipe d’Italie le 11 mars 2017. Une semaine plus tard, il réalise une entrée en jeu remarquée contre le pays de Galles, la France s’imposant 20 à 18 au terme du match international le plus long de l’histoire, se concluant après 20 minutes de temps additionnel. Il participe à la tournée des Bleus en Afrique du Sud, disputant une seule des trois rencontres en tant que remplaçant. Les Français terminant la tournée avec trois défaites cinglantes. En juin 2017, l’encadrement du XV de France l’intègre dans la liste Élite des joueurs protégés par la convention FFR/LNR pour la saison 2017-2018. Antoine rêvait de jouer à Toulouse depuis sa plus tendre enfance. À cinq, six ans, il avait demandé à sa mère pour Noël les maillots des Toulousains Frédéric Michalak et Clément Poitrenaud, aujourd'hui l'un de ses entraîneurs. Arrivé au Stade toulousain qui sort d’un exercice 2016-2017 décevant terminé à la douzième place du classement, Antoine Dupont s’inscrit rapidement dans une première dynamique de victoires en s’imposant au poste de demi de mêlée, aux dépens de l’international Sébastien Bézy. Il inscrit quatre essais lors de ses quatre premiers matches sous ses nouvelles couleurs, dont le premier face à Toulon et un doublé face au champion en titre, Clermont-Ferrand. Il est retenu avec sa sélection nationale pour la série de test matches du mois de novembre. Pour son match d’ouverture, la France est opposée aux All Blacks et Antoine Dupont connaît à cette occasion sa première titularisation avec le maillot bleu. Auteur de quatre franchissements, pour 91 mètres parcourus ballon en main et sept défenseurs battus, il réalise une bonne performance lui permettant d’être élu homme du match, malgré la défaite (18-38). Remplaçant lors de la première journée du Tournoi des Six Nations 2018 contre l’Irlande, il est à l’initiative de l’essai de Teddy Thomas. Quelques minutes après, il se blesse et souffre d’une rupture des ligaments antérieurs du genou droit, qui met un terme à sa saison. Il fait son retour officiel à la compétition le 6 octobre 2018 face à Agen où il joue près de 20 minutes, remplaçant Sébastien Bézy à la fin du match. Après deux matches de coupe d’Europe, il est titularisé face à Perpignan contre qui il inscrit trois essais. Il est de retour dans le groupe France, un mois après son retour à la compétition. Il dispute les trois matches de la tournée en tant que remplaçant de Baptiste Serin, face à l’Afrique du Sud, l’Argentine et les Fidji. De retour à Toulouse, il enchaîne les titularisations au poste de numéro 9, malgré les bonnes performances de Sébastien Bézy. De retour en équipe de France pour le tournoi, il ne dispute pas le premier match, Morgan Parra et Baptiste Serin lui étant préférés. De retour sur le banc face au XV de la rose, il réalise une entrée convaincante, malgré la lourde défaite (8-44). Les performances et les propos d’après match remettant en cause le staff tricolore du titulaire Morgan Parra, l’exclu du groupe. Antoine Dupont est titularisé pour les trois derniers matches du tournoi. Il inscrit son premier essai international face à l’Italie lors du dernier match. Les bonnes performances de l’équipe toulousaine permettent au club de retrouver les phases finales, aussi bien en coupe d’Europe qu’en Top 14. Antoine Dupont dispute le quart de finale et la demi-finale de coupe d’Europe. En quart face au Racing 92, il est titulaire au poste de numéro 9. Il inscrit le premier essai de la rencontre et est replacé au poste de demi d’ouverture en fin de première mi-temps après l’expulsion du numéro 10 titulaire, Zack Holmes. Il inscrit un second essai, est élu homme du match aidant son équipe à se qualifier (22-21). Ainsi, pour la demi-finale face au Leinster, il est titularisé au poste de numéro 10. Finissant premier au classement général du championnat de France, le Stade toulousain est directement qualifié pour les demi-finales. Il est titulaire au poste de demi de mêlée pour le premier match face à La Rochelle, puis en finale face à l’ASM Clermont (24-18) au Stade de France. Il remporte ainsi en 2019 son premier bouclier de Brennus. Présent dans la liste de Jacques Brunel pour la préparation à la coupe du monde 2019 au Japon, il est titulaire lors des trois matches de préparation (contre l’Italie et deux fois contre l’Écosse), où il inscrit deux essais. Retenu dans la liste définitive de 31 joueurs pour disputer la compétition, il commence la compétition en tant que titulaire face à l’Argentine. Victorieuse des Pumas, grâce notamment à un essai de Dupont, la France se qualifie pour les quarts de finale. Gêné par des douleurs à son dos, Antoine Dupont est préservé par le staff de l’équipe de France afin d’être aligné en quart de finale face au pays de Galles. Défaite au bout du suspense 20 à 19, l’équipe de France est éliminée de la compétition. Toujours gêné par des problèmes au dos, Dupont fait son retour sur les pelouses à la fin du mois de décembre 2019. Malgré seulement deux titularisations en club, Antoine Dupont rejoint le XV de France pour démarrer contre le XV de la Rose (équipe d'Angleterre) lors du premier match dans le Tournoi des Six Nations 2020. Auteur d’une performance soulignée par la presse, Dupont participe activement à la victoire française sur les récents vice-champions du monde. Confirmant une certaine régularité au haut niveau, Antoine Dupont est considéré par certains experts comme l’un des meilleurs demis de mêlée du monde. Sa nouvelle performance positive la semaine suivante face à l’Italie montre l’importance prise par Dupont dans le système du nouveau sélectionneur Fabien Galthié. En 2020, il est élu Meilleur joueur du Tournoi des Six Nations à l’issue d’un vote du public parmi une liste de six nominés, choisis par des journalistes de rugby, d'anciens joueurs et des diffuseurs des six pays participants. Cette année 2020, parmi les six nominés, on comptait trois Français : les Toulousains Antoine Dupont, Romain Ntamack et le Gersois Grégory Alldritt. Arrivé en tête des votes avec 46% des suffrages, il est le premier tricolore à recevoir la distinction, créée en 2004. Durant ce Tournoi, le demi de mêlée tricolore a inscrit un essai, délivré quatre passes décisives, parcouru 249 mètres ballon en main et gagné 1543 mètres avec son jeu au pied. En octobre 2021, Fabien Galthié annonce qu'Antoine Dupont sera le capitaine du XV de France pour la tournée d'automne. Il remplace provisoirement Charles Ollivon, blessé pour une longue durée. Sa désignation comme capitaine des Bleus pour les tests d'automne est le témoignage de son influence grandissante au-delà du terrain, où ses qualités naturelles en faisaient déjà depuis quelques saisons l'une des références mondiales à son poste. L'équipe de France remporte ses trois matches, dont une victoire le 20 novembre 2021 face aux All Blacks (40-25), devant 80.000 spectateurs et jusqu’à 7,6 millions de téléspectateurs. La première au Stade de France à Saint-Denis face à la Nouvelle-Zélande depuis 1973. Et le 10 décembre 2021, à tout juste 25 ans, succédant au troisième ligne sud-africain Pieter-Steph Du Toit, couronné en 2019, Antoine Dupont est désigné Meilleur joueur du monde World Rugby. Seuls deux autres internationaux français avaient connu précédemment cette distinction : Fabien Galthié ancien demi de mêlée en 2002, son sélectionneur au moment où il reçoit le prix, et Thierry Dusautoir ancien troisième ligne en 2011. Une reconnaissance internationale qui vient récompenser une année 2021 ponctuée de deux titres avec le Stade toulousain, en Coupe d'Europe et en championnat, et d'une victoire de prestige avec la France en novembre contre la Nouvelle-Zélande. Antoine Dupont, devenu une célébrité du rugby, une figure internationale, toujours très attaché à son clocher, à son terroir natal, a besoin de temps en temps de revenir chez lui et de garder ce lien très important avec ses racines. Dès qu’il le peut, il rend visite à son frère Clément et à son oncle Jean-Luc Gales qui gèrent l’exploitation agricole familiale, où sont élevés 400 porcs noirs de Bigorre, un produit d’exception, bénéficiant de l’appellation d’origine protégée (AOP). "Toto", comme l’appellent ses proches, fait figure aujourd’hui de premier ambassadeur de son village d’origine. Dans le village de Castelnau-Magnoac, les gens sont comblés de voir son évolution. "C’est unanime, car en plus d’avoir une image d’un excellent joueur de rugby, il est sympa, tient à ajouter son premier entraîneur, Jean-Philippe Guerrero. C’est un garçon humble et discret du Sud-Ouest. Il est sympa avec tout le monde quand il revient, il n’a pas changé. Ce n’est pas parce qu’il est célèbre aujourd’hui qu’il oubliera de dire bonjour à quelqu’un qu’il avait connu avant. Il est juste sympa et c’est toujours un plaisir. "C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup", confirme son ancien entraîneur à Castres Christophe Urios. Ses proches regardent cette trajectoire avec bienveillance et humilité. En quittant le village, on se dit que le "surdoué" Antoine Dupont, peut marquer l’histoire de ce sport. Mais que pour les siens, il restera "Toto" de Castelnau-Magnoac. Une pépite du piémont pyrénéen, joueur de rugby de 25 ans ayant émergé ces dernières années pour devenir rapidement une star mondiale du sport, qui est désormais largement reconnu comme l’un des meilleurs n°9 – sinon le meilleur – dans le monde en ce moment. Le demi-arrière remportant en octobre 2020 sa 25e sélection contre l’Irlande, trois ans et demi après ses débuts en Italie en mars 2017. Dupont s'impose, à moins de deux ans de la Coupe du monde en France (2023), comme l'une des égéries d'un sport en mal de superstars internationales comme peuvent l'être Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo en football. "Le rugby français est fier de compter dans ses rangs le meilleur joueur du monde en 2021" a écrit Bernard Laporte sur le réseau social. "Il n'y a jamais eu de joueur de l'année aussi évident qu'Antoine Dupont", a écrit aussi Brian O'Driscoll la légende irlandaise. "Il a été irréel cette année 2021." Avec les Bleus, il est sélectionné, en janvier 2022 pour participer au Tournoi des Six Nations 2022. Il est capitaine des Bleus pour ce tournoi. Les Français remportent tous les matchs de la compétition, réalisant ainsi le Grand Chelem, le dixième de l'histoire du rugby tricolore, le premier depuis douze ans. Après cet excellent tournoi, il est élu, pour la deuxième fois de sa carrière internationale, meilleur joueur du tournoi des Six Nations. En 2023, à l'issue du Tournoi des Six Nations, il est élu meilleur joueur de la compétition pour la troisième fois de sa carrière égalant le record détenu par l'Irlandais Brian O'Driscoll. Cette même année, avec le Stade toulousain, Antoine Dupont remporte le Bouclier de Brennus pour la troisième fois de sa carrière. À l'issue de cette saison, il remporte l'Oscar monde pour la troisième année consécutive. Lors de la Coupe du monde de rugby 2023, les Bleus sont éliminés par les Springboks après une courte défaite 29-28. En fin d'année 2023, il est élu meilleur joueur du Top 14 et meilleur joueur international français lors de la dix-neuvième Nuit du rugby. En 2024, il est titulaire et capitaine avec le Stade toulousain en finale de la Champions Cup au Tottenham Hotspur Stadium de Londres face au Leinster. Les Toulousains remportent le 6e titre de champions d'Europe du club. Antoine Dupont est élu homme du match, mais aussi meilleur joueur de l'édition de Champions Cup 2023-2024. Il devient ainsi le premier joueur de l'histoire à remporter 2 fois le titre du joueur européen de l'année, son premier datant de 2021. Le 28 juin 2024, le Stade toulousain s'impose en finale du Top 14 en surclassant l'Union Bordeaux Bègles sur le score de 59 à 3. Cette victoire permet au Stade toulousain de glaner son 23e bouclier de Brennus. Antoine Dupont, auteur de deux essais, est élu homme du match de la finale. Le 27 juillet 2024, lors des Jeux olympiques de Paris, il est sacré champion olympique en battant les tenants du titre fidjiens en finale. Entré en début de deuxième mi-temps alors que les deux équipes sont à égalité 7-7, il offre sur son premier ballon une passe décisive après une course de 60 m, amenant un essai français avant d'inscrire les deux derniers essais de la rencontre, scellant la victoire française. Il s'agit de la première médaille d'or de la France des Jeux olympiques de Paris 2024. Le 14 septembre 2024, il est élevé au rang de chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur et reçoit la prestigieuse distinction des mains du Président de la République, Emmanuel Macron. Et dire que la future star du rugby, le grand numéro 9, avait failli arrêter le rugby où il s’ennuyait, pour essayer le football où quelques amis jouaient ! Désormais le XV de France actuel possède son Zidane. Une perle rare et merveilleuse, appelée Dupont. Voici donc comment « Toto », pour les intimes, désigné meilleur rugbyman de la planète est passé de Castelnau-Magnoac, village bigourdan que la France du rugby a mis sur la carte au toit du monde. Et l’histoire n’est certainement pas finie …
Antoine DUPONT, né le 15 novembre 1996 à Lannemezan, est un joueur international français de rugby à XV évoluant principalement au poste de demi de mêlée. Il mesure 1m74 pour 85 kg. Il joue au sein de l’effectif du Stade toulousain et en équipe de France depuis 2017. Il est originaire du village de Castelnau-Magnoac, où il a commencé le rugby à l’âge de 4 ans au Magnoac FC3. Sa passion depuis tout petit, c'est de jouer au rugby. Il veut suivre les pas de Clément son grand frère, de trois ans son aîné, dans le monde du ballon ovale. Et dès ses premiers entraînements, il va épater tout le monde avec des capacités physiques hors-normes, dit Jean-Philippe Guerrero, son premier entraîneur. « Un surdoué, précoce, avec de la fluidité, un rôle de distributeur et une vision stratégique toujours justes, un catalyseur du jeu offensif et audacieux », résume ainsi Jean-Philippe Guerrero. « Il arrangeait les règles », se rappelle en riant son frère Clément, avec lequel la compétition était permanente. Clément se souvient des duels, des trois contre deux ou trois contre trois qu'Antoine aimait et grâce auxquels il a progressé. Doué, le petit était régulièrement surclassé et jouait contre des plus grands. En 2011, alors qu’il évolue en cadet, il rejoint le centre de formation du FC Auch. Il intègre également le pôle Espoir du lycée Jolimont (aujourd’hui lycée Stéphane-Hessel) à Toulouse, où il passe son Bac S-SVT. Il débute ensuite un DUT mesures physiques à l’IUT d’Orsay, à Paris. Au bout d’un trimestre, il décide d’arrêter et de commencer une licence STAPS, toujours à la faculté d’Orsay, alors qu’il joue au Castres olympique. « J’y suis resté six mois, puis j’ai fini ma licence à Toulouse, à l’université Paul Sabatier », note le rugbyman. En 2018, une fois diplômé, pas question pour lui d’arrêter ses études. Il poursuit alors en s’inscrivant en école de commerce à Toulouse, où il étudie le management du sport. Il a conscience qu’une carrière professionnelle de rugbyman ne dure pas toute une vie, et qu’il aura besoin de se reconvertir après sa retraite de sportif. « Je n’ai pas d’idée précise de reconversion, mais je veux avoir un certain bagage scolaire pour la suite », indique-t-il. Passionné de sport (pas uniquement de rugby), il est curieux de découvrir comment fonctionne cette économie. « Je trouve intéressant de comprendre le business du sport, moi qui baigne dans le monde du rugby depuis mes quatre ans ». En plus d’être l’étoile montante du rugby français et l’un des meilleurs joueurs du Tournoi jusque-ici, ce sportif est donc en master 2 management du sport à l’école de commerce Toulouse School of Management (TBS). En 2014, il dispute la finale du championnat de France Crabos avec Auch et rejoint le Castres olympique à l’issue de la saison. Âgé de 18 ans, le 8 novembre 2014, il fait ses débuts avec l’équipe professionnelle lors d’une rencontre face au RC Toulon en rentrant pour une minute de jeu à la place de Cédric Garcia. En janvier 2015, il est titularisé en Coupe d’Europe pour un match contre les Harlequins, au cours duquel il inscrit son premier essai professionnel. À la suite d’une mêlée castraise à cinq mètres de l’en-but anglais, il récupère le ballon, échappe au plaquage du capitaine londonien Chris Robshaw, et aplatit le ballon sous les poteaux. Membre du pôle espoir de Marcoussis pour la saison 2014-2015, il est sélectionné par Fabien Pelous pour disputer le Tournoi des Six Nations des moins de 20 ans avec l’équipe de France. Il joue trois matches, à chaque fois en tant que remplaçant, et n’est finalement pas retenu pour le championnat du monde junior de la même année. Il joue onze matches toutes compétitions confondues pour sa première année sous les couleurs bleu et blanc du Castres olympique. La saison suivante, en 2015 avec le Castres olympique, il joue 18 matches toutes compétitions confondues. Il réalise notamment un très bon match face à l’US Oyonnax en début de saison, alors que Christophe Urios, son nouvel entraîneur, décide de le titulariser au poste d’ouvreur aux dépens de Romain Cabannes à la suite d’un nombre important de blessés au poste. Il est nommé cette année parmi les meilleurs espoirs lors de la Nuit du rugby. Il est de nouveau appelé en équipe de France des moins de 20 ans pour le Tournoi des Six Nations et pour le championnat du monde junior en juin 2016. Durant cette compétition, il inscrit un total de cinq essais en trois titularisations, dont trois essais contre le Japon en phase de poule. En juillet 2016, il figure sur la Liste développement de 30 joueurs de moins de 23 ans à fort potentiel que les entraîneurs de l’équipe de France suivent pour la saison 2016-2017. En novembre 2016, il est sélectionné dans l’équipe des Barbarians français par Raphaël Ibañez pour affronter une sélection australienne (contre les Wallabies XV l'équipe réserve australienne) au Stade Chaban-Delmas de Bordeaux. Il commence la rencontre en tant que remplaçant de Yann Lesgourgues et réalise une entrée remarquée qui attire l'attention de nombreux observateurs, aidant son équipe à s’imposer sur le score de 19 à 11. En septembre 2016, Antoine Dupont est annoncé partant pour le Stade toulousain par les médias RMC et La Dépêche du Midi, sans que cela soit confirmé officiellement. En novembre, RMC annonce de nouveau la signature du joueur au Stade toulousain, mais cette fois, l’information est démentie par l’entraîneur du Castres olympique. Christophe Urios déclarant « qu’Antoine Dupont est encore en réflexion et n’a pas signé à Toulouse ». Le 29 novembre 2016, le club de Castres annonce sur son site Internet le départ du demi de mêlée à la fin de la saison, sans pour autant préciser pour quel club. Le lendemain, le Stade toulousain annonce l’arrivée du joueur à compter de la saison 2017-2018. L’annonce et la contre-annonce du départ d’Antoine Dupont se déroulent dans un contexte qui voit le joueur s’affirmer en club, où il réalise de bonnes performances et où il voit son temps de jeu augmenter. Les supporters de Castres affichent leur souhait de voir le joueur rester au club et prolonger son contrat. Le 8 mars 2017, il est appelé pour la première fois en équipe de France par Guy Novès à la suite d’une blessure de Maxime Machenaud. Quarante-huit heures après son premier entraînement avec le XV de France, il connaît sa première sélection au Stade olympique de Rome face à l’équipe d’Italie le 11 mars 2017. Une semaine plus tard, il réalise une entrée en jeu remarquée contre le pays de Galles, la France s’imposant 20 à 18 au terme du match international le plus long de l’histoire, se concluant après 20 minutes de temps additionnel. Il participe à la tournée des Bleus en Afrique du Sud, disputant une seule des trois rencontres en tant que remplaçant. Les Français terminant la tournée avec trois défaites cinglantes. En juin 2017, l’encadrement du XV de France l’intègre dans la liste Élite des joueurs protégés par la convention FFR/LNR pour la saison 2017-2018. Antoine rêvait de jouer à Toulouse depuis sa plus tendre enfance. À cinq, six ans, il avait demandé à sa mère pour Noël les maillots des Toulousains Frédéric Michalak et Clément Poitrenaud, aujourd'hui l'un de ses entraîneurs. Arrivé au Stade toulousain qui sort d’un exercice 2016-2017 décevant terminé à la douzième place du classement, Antoine Dupont s’inscrit rapidement dans une première dynamique de victoires en s’imposant au poste de demi de mêlée, aux dépens de l’international Sébastien Bézy. Il inscrit quatre essais lors de ses quatre premiers matches sous ses nouvelles couleurs, dont le premier face à Toulon et un doublé face au champion en titre, Clermont-Ferrand. Il est retenu avec sa sélection nationale pour la série de test matches du mois de novembre. Pour son match d’ouverture, la France est opposée aux All Blacks et Antoine Dupont connaît à cette occasion sa première titularisation avec le maillot bleu. Auteur de quatre franchissements, pour 91 mètres parcourus ballon en main et sept défenseurs battus, il réalise une bonne performance lui permettant d’être élu homme du match, malgré la défaite (18-38). Remplaçant lors de la première journée du Tournoi des Six Nations 2018 contre l’Irlande, il est à l’initiative de l’essai de Teddy Thomas. Quelques minutes après, il se blesse et souffre d’une rupture des ligaments antérieurs du genou droit, qui met un terme à sa saison. Il fait son retour officiel à la compétition le 6 octobre 2018 face à Agen où il joue près de 20 minutes, remplaçant Sébastien Bézy à la fin du match. Après deux matches de coupe d’Europe, il est titularisé face à Perpignan contre qui il inscrit trois essais. Il est de retour dans le groupe France, un mois après son retour à la compétition. Il dispute les trois matches de la tournée en tant que remplaçant de Baptiste Serin, face à l’Afrique du Sud, l’Argentine et les Fidji. De retour à Toulouse, il enchaîne les titularisations au poste de numéro 9, malgré les bonnes performances de Sébastien Bézy. De retour en équipe de France pour le tournoi, il ne dispute pas le premier match, Morgan Parra et Baptiste Serin lui étant préférés. De retour sur le banc face au XV de la rose, il réalise une entrée convaincante, malgré la lourde défaite (8-44). Les performances et les propos d’après match remettant en cause le staff tricolore du titulaire Morgan Parra, l’exclu du groupe. Antoine Dupont est titularisé pour les trois derniers matches du tournoi. Il inscrit son premier essai international face à l’Italie lors du dernier match. Les bonnes performances de l’équipe toulousaine permettent au club de retrouver les phases finales, aussi bien en coupe d’Europe qu’en Top 14. Antoine Dupont dispute le quart de finale et la demi-finale de coupe d’Europe. En quart face au Racing 92, il est titulaire au poste de numéro 9. Il inscrit le premier essai de la rencontre et est replacé au poste de demi d’ouverture en fin de première mi-temps après l’expulsion du numéro 10 titulaire, Zack Holmes. Il inscrit un second essai, est élu homme du match aidant son équipe à se qualifier (22-21). Ainsi, pour la demi-finale face au Leinster, il est titularisé au poste de numéro 10. Finissant premier au classement général du championnat de France, le Stade toulousain est directement qualifié pour les demi-finales. Il est titulaire au poste de demi de mêlée pour le premier match face à La Rochelle, puis en finale face à l’ASM Clermont (24-18) au Stade de France. Il remporte ainsi en 2019 son premier bouclier de Brennus. Présent dans la liste de Jacques Brunel pour la préparation à la coupe du monde 2019 au Japon, il est titulaire lors des trois matches de préparation (contre l’Italie et deux fois contre l’Écosse), où il inscrit deux essais. Retenu dans la liste définitive de 31 joueurs pour disputer la compétition, il commence la compétition en tant que titulaire face à l’Argentine. Victorieuse des Pumas, grâce notamment à un essai de Dupont, la France se qualifie pour les quarts de finale. Gêné par des douleurs à son dos, Antoine Dupont est préservé par le staff de l’équipe de France afin d’être aligné en quart de finale face au pays de Galles. Défaite au bout du suspense 20 à 19, l’équipe de France est éliminée de la compétition. Toujours gêné par des problèmes au dos, Dupont fait son retour sur les pelouses à la fin du mois de décembre 2019. Malgré seulement deux titularisations en club, Antoine Dupont rejoint le XV de France pour démarrer contre le XV de la Rose (équipe d'Angleterre) lors du premier match dans le Tournoi des Six Nations 2020. Auteur d’une performance soulignée par la presse, Dupont participe activement à la victoire française sur les récents vice-champions du monde. Confirmant une certaine régularité au haut niveau, Antoine Dupont est considéré par certains experts comme l’un des meilleurs demis de mêlée du monde. Sa nouvelle performance positive la semaine suivante face à l’Italie montre l’importance prise par Dupont dans le système du nouveau sélectionneur Fabien Galthié. En 2020, il est élu Meilleur joueur du Tournoi des Six Nations à l’issue d’un vote du public parmi une liste de six nominés, choisis par des journalistes de rugby, d'anciens joueurs et des diffuseurs des six pays participants. Cette année 2020, parmi les six nominés, on comptait trois Français : les Toulousains Antoine Dupont, Romain Ntamack et le Gersois Grégory Alldritt. Arrivé en tête des votes avec 46% des suffrages, il est le premier tricolore à recevoir la distinction, créée en 2004. Durant ce Tournoi, le demi de mêlée tricolore a inscrit un essai, délivré quatre passes décisives, parcouru 249 mètres ballon en main et gagné 1543 mètres avec son jeu au pied. En octobre 2021, Fabien Galthié annonce qu'Antoine Dupont sera le capitaine du XV de France pour la tournée d'automne. Il remplace provisoirement Charles Ollivon, blessé pour une longue durée. Sa désignation comme capitaine des Bleus pour les tests d'automne est le témoignage de son influence grandissante au-delà du terrain, où ses qualités naturelles en faisaient déjà depuis quelques saisons l'une des références mondiales à son poste. L'équipe de France remporte ses trois matches, dont une victoire le 20 novembre 2021 face aux All Blacks (40-25), devant 80.000 spectateurs et jusqu’à 7,6 millions de téléspectateurs. La première au Stade de France à Saint-Denis face à la Nouvelle-Zélande depuis 1973. Et le 10 décembre 2021, à tout juste 25 ans, succédant au troisième ligne sud-africain Pieter-Steph Du Toit, couronné en 2019, Antoine Dupont est désigné Meilleur joueur du monde World Rugby. Seuls deux autres internationaux français avaient connu précédemment cette distinction : Fabien Galthié ancien demi de mêlée en 2002, son sélectionneur au moment où il reçoit le prix, et Thierry Dusautoir ancien troisième ligne en 2011. Une reconnaissance internationale qui vient récompenser une année 2021 ponctuée de deux titres avec le Stade toulousain, en Coupe d'Europe et en championnat, et d'une victoire de prestige avec la France en novembre contre la Nouvelle-Zélande. Antoine Dupont, devenu une célébrité du rugby, une figure internationale, toujours très attaché à son clocher, à son terroir natal, a besoin de temps en temps de revenir chez lui et de garder ce lien très important avec ses racines. Dès qu’il le peut, il rend visite à son frère Clément et à son oncle Jean-Luc Gales qui gèrent l’exploitation agricole familiale, où sont élevés 400 porcs noirs de Bigorre, un produit d’exception, bénéficiant de l’appellation d’origine protégée (AOP). "Toto", comme l’appellent ses proches, fait figure aujourd’hui de premier ambassadeur de son village d’origine. Dans le village de Castelnau-Magnoac, les gens sont comblés de voir son évolution. "C’est unanime, car en plus d’avoir une image d’un excellent joueur de rugby, il est sympa, tient à ajouter son premier entraîneur, Jean-Philippe Guerrero. C’est un garçon humble et discret du Sud-Ouest. Il est sympa avec tout le monde quand il revient, il n’a pas changé. Ce n’est pas parce qu’il est célèbre aujourd’hui qu’il oubliera de dire bonjour à quelqu’un qu’il avait connu avant. Il est juste sympa et c’est toujours un plaisir. "C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup", confirme son ancien entraîneur à Castres Christophe Urios. Ses proches regardent cette trajectoire avec bienveillance et humilité. En quittant le village, on se dit que le "surdoué" Antoine Dupont, peut marquer l’histoire de ce sport. Mais que pour les siens, il restera "Toto" de Castelnau-Magnoac. Une pépite du piémont pyrénéen, joueur de rugby de 25 ans ayant émergé ces dernières années pour devenir rapidement une star mondiale du sport, qui est désormais largement reconnu comme l’un des meilleurs n°9 – sinon le meilleur – dans le monde en ce moment. Le demi-arrière remportant en octobre 2020 sa 25e sélection contre l’Irlande, trois ans et demi après ses débuts en Italie en mars 2017. Dupont s'impose, à moins de deux ans de la Coupe du monde en France (2023), comme l'une des égéries d'un sport en mal de superstars internationales comme peuvent l'être Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo en football. "Le rugby français est fier de compter dans ses rangs le meilleur joueur du monde en 2021" a écrit Bernard Laporte sur le réseau social. "Il n'y a jamais eu de joueur de l'année aussi évident qu'Antoine Dupont", a écrit aussi Brian O'Driscoll la légende irlandaise. "Il a été irréel cette année 2021." Avec les Bleus, il est sélectionné, en janvier 2022 pour participer au Tournoi des Six Nations 2022. Il est capitaine des Bleus pour ce tournoi. Les Français remportent tous les matchs de la compétition, réalisant ainsi le Grand Chelem, le dixième de l'histoire du rugby tricolore, le premier depuis douze ans. Après cet excellent tournoi, il est élu, pour la deuxième fois de sa carrière internationale, meilleur joueur du tournoi des Six Nations. En 2023, à l'issue du Tournoi des Six Nations, il est élu meilleur joueur de la compétition pour la troisième fois de sa carrière égalant le record détenu par l'Irlandais Brian O'Driscoll. Cette même année, avec le Stade toulousain, Antoine Dupont remporte le Bouclier de Brennus pour la troisième fois de sa carrière. À l'issue de cette saison, il remporte l'Oscar monde pour la troisième année consécutive. Lors de la Coupe du monde de rugby 2023, les Bleus sont éliminés par les Springboks après une courte défaite 29-28. En fin d'année 2023, il est élu meilleur joueur du Top 14 et meilleur joueur international français lors de la dix-neuvième Nuit du rugby. En 2024, il est titulaire et capitaine avec le Stade toulousain en finale de la Champions Cup au Tottenham Hotspur Stadium de Londres face au Leinster. Les Toulousains remportent le 6e titre de champions d'Europe du club. Antoine Dupont est élu homme du match, mais aussi meilleur joueur de l'édition de Champions Cup 2023-2024. Il devient ainsi le premier joueur de l'histoire à remporter 2 fois le titre du joueur européen de l'année, son premier datant de 2021. Le 28 juin 2024, le Stade toulousain s'impose en finale du Top 14 en surclassant l'Union Bordeaux Bègles sur le score de 59 à 3. Cette victoire permet au Stade toulousain de glaner son 23e bouclier de Brennus. Antoine Dupont, auteur de deux essais, est élu homme du match de la finale. Le 27 juillet 2024, lors des Jeux olympiques de Paris, il est sacré champion olympique en battant les tenants du titre fidjiens en finale. Entré en début de deuxième mi-temps alors que les deux équipes sont à égalité 7-7, il offre sur son premier ballon une passe décisive après une course de 60 m, amenant un essai français avant d'inscrire les deux derniers essais de la rencontre, scellant la victoire française. Il s'agit de la première médaille d'or de la France des Jeux olympiques de Paris 2024. Le 14 septembre 2024, il est élevé au rang de chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur et reçoit la prestigieuse distinction des mains du Président de la République, Emmanuel Macron. Et dire que la future star du rugby, le grand numéro 9, avait failli arrêter le rugby où il s’ennuyait, pour essayer le football où quelques amis jouaient ! Désormais le XV de France actuel possède son Zidane. Une perle rare et merveilleuse, appelée Dupont. Voici donc comment « Toto », pour les intimes, désigné meilleur rugbyman de la planète est passé de Castelnau-Magnoac, village bigourdan que la France du rugby a mis sur la carte au toit du monde. Et l’histoire n’est certainement pas finie …
 Antoine DUPONT, né le 15 novembre 1996 à Lannemezan, est un joueur international français de rugby à XV évoluant principalement au poste de demi de mêlée. Il mesure 1m74 pour 85 kg. Il joue au sein de l’effectif du Stade toulousain et en équipe de France depuis 2017. Il est originaire du village de Castelnau-Magnoac, où il a commencé le rugby à l’âge de 4 ans au Magnoac FC3. Sa passion depuis tout petit, c'est de jouer au rugby. Il veut suivre les pas de Clément son grand frère, de trois ans son aîné, dans le monde du ballon ovale. Et dès ses premiers entraînements, il va épater tout le monde avec des capacités physiques hors-normes, dit Jean-Philippe Guerrero, son premier entraîneur. « Un surdoué, précoce, avec de la fluidité, un rôle de distributeur et une vision stratégique toujours justes, un catalyseur du jeu offensif et audacieux », résume ainsi Jean-Philippe Guerrero. « Il arrangeait les règles », se rappelle en riant son frère Clément, avec lequel la compétition était permanente. Clément se souvient des duels, des trois contre deux ou trois contre trois qu'Antoine aimait et grâce auxquels il a progressé. Doué, le petit était régulièrement surclassé et jouait contre des plus grands. En 2011, alors qu’il évolue en cadet, il rejoint le centre de formation du FC Auch. Il intègre également le pôle Espoir du lycée Jolimont (aujourd’hui lycée Stéphane-Hessel) à Toulouse, où il passe son Bac S-SVT. Il débute ensuite un DUT mesures physiques à l’IUT d’Orsay, à Paris. Au bout d’un trimestre, il décide d’arrêter et de commencer une licence STAPS, toujours à la faculté d’Orsay, alors qu’il joue au Castres olympique. « J’y suis resté six mois, puis j’ai fini ma licence à Toulouse, à l’université Paul Sabatier », note le rugbyman. En 2018, une fois diplômé, pas question pour lui d’arrêter ses études. Il poursuit alors en s’inscrivant en école de commerce à Toulouse, où il étudie le management du sport. Il a conscience qu’une carrière professionnelle de rugbyman ne dure pas toute une vie, et qu’il aura besoin de se reconvertir après sa retraite de sportif. « Je n’ai pas d’idée précise de reconversion, mais je veux avoir un certain bagage scolaire pour la suite », indique-t-il. Passionné de sport (pas uniquement de rugby), il est curieux de découvrir comment fonctionne cette économie. « Je trouve intéressant de comprendre le business du sport, moi qui baigne dans le monde du rugby depuis mes quatre ans ». En plus d’être l’étoile montante du rugby français et l’un des meilleurs joueurs du Tournoi jusque-ici, ce sportif est donc en master 2 management du sport à l’école de commerce Toulouse School of Management (TBS). En 2014, il dispute la finale du championnat de France Crabos avec Auch et rejoint le Castres olympique à l’issue de la saison. Âgé de 18 ans, le 8 novembre 2014, il fait ses débuts avec l’équipe professionnelle lors d’une rencontre face au RC Toulon en rentrant pour une minute de jeu à la place de Cédric Garcia. En janvier 2015, il est titularisé en Coupe d’Europe pour un match contre les Harlequins, au cours duquel il inscrit son premier essai professionnel. À la suite d’une mêlée castraise à cinq mètres de l’en-but anglais, il récupère le ballon, échappe au plaquage du capitaine londonien Chris Robshaw, et aplatit le ballon sous les poteaux. Membre du pôle espoir de Marcoussis pour la saison 2014-2015, il est sélectionné par Fabien Pelous pour disputer le Tournoi des Six Nations des moins de 20 ans avec l’équipe de France. Il joue trois matches, à chaque fois en tant que remplaçant, et n’est finalement pas retenu pour le championnat du monde junior de la même année. Il joue onze matches toutes compétitions confondues pour sa première année sous les couleurs bleu et blanc du Castres olympique. La saison suivante, en 2015 avec le Castres olympique, il joue 18 matches toutes compétitions confondues. Il réalise notamment un très bon match face à l’US Oyonnax en début de saison, alors que Christophe Urios, son nouvel entraîneur, décide de le titulariser au poste d’ouvreur aux dépens de Romain Cabannes à la suite d’un nombre important de blessés au poste. Il est nommé cette année parmi les meilleurs espoirs lors de la Nuit du rugby. Il est de nouveau appelé en équipe de France des moins de 20 ans pour le Tournoi des Six Nations et pour le championnat du monde junior en juin 2016. Durant cette compétition, il inscrit un total de cinq essais en trois titularisations, dont trois essais contre le Japon en phase de poule. En juillet 2016, il figure sur la Liste développement de 30 joueurs de moins de 23 ans à fort potentiel que les entraîneurs de l’équipe de France suivent pour la saison 2016-2017. En novembre 2016, il est sélectionné dans l’équipe des Barbarians français par Raphaël Ibañez pour affronter une sélection australienne (contre les Wallabies XV l'équipe réserve australienne) au Stade Chaban-Delmas de Bordeaux. Il commence la rencontre en tant que remplaçant de Yann Lesgourgues et réalise une entrée remarquée qui attire l'attention de nombreux observateurs, aidant son équipe à s’imposer sur le score de 19 à 11. En septembre 2016, Antoine Dupont est annoncé partant pour le Stade toulousain par les médias RMC et La Dépêche du Midi, sans que cela soit confirmé officiellement. En novembre, RMC annonce de nouveau la signature du joueur au Stade toulousain, mais cette fois, l’information est démentie par l’entraîneur du Castres olympique. Christophe Urios déclarant « qu’Antoine Dupont est encore en réflexion et n’a pas signé à Toulouse ». Le 29 novembre 2016, le club de Castres annonce sur son site Internet le départ du demi de mêlée à la fin de la saison, sans pour autant préciser pour quel club. Le lendemain, le Stade toulousain annonce l’arrivée du joueur à compter de la saison 2017-2018. L’annonce et la contre-annonce du départ d’Antoine Dupont se déroulent dans un contexte qui voit le joueur s’affirmer en club, où il réalise de bonnes performances et où il voit son temps de jeu augmenter. Les supporters de Castres affichent leur souhait de voir le joueur rester au club et prolonger son contrat. Le 8 mars 2017, il est appelé pour la première fois en équipe de France par Guy Novès à la suite d’une blessure de Maxime Machenaud. Quarante-huit heures après son premier entraînement avec le XV de France, il connaît sa première sélection au Stade olympique de Rome face à l’équipe d’Italie le 11 mars 2017. Une semaine plus tard, il réalise une entrée en jeu remarquée contre le pays de Galles, la France s’imposant 20 à 18 au terme du match international le plus long de l’histoire, se concluant après 20 minutes de temps additionnel. Il participe à la tournée des Bleus en Afrique du Sud, disputant une seule des trois rencontres en tant que remplaçant. Les Français terminant la tournée avec trois défaites cinglantes. En juin 2017, l’encadrement du XV de France l’intègre dans la liste Élite des joueurs protégés par la convention FFR/LNR pour la saison 2017-2018. Antoine rêvait de jouer à Toulouse depuis sa plus tendre enfance. À cinq, six ans, il avait demandé à sa mère pour Noël les maillots des Toulousains Frédéric Michalak et Clément Poitrenaud, aujourd'hui l'un de ses entraîneurs. Arrivé au Stade toulousain qui sort d’un exercice 2016-2017 décevant terminé à la douzième place du classement, Antoine Dupont s’inscrit rapidement dans une première dynamique de victoires en s’imposant au poste de demi de mêlée, aux dépens de l’international Sébastien Bézy. Il inscrit quatre essais lors de ses quatre premiers matches sous ses nouvelles couleurs, dont le premier face à Toulon et un doublé face au champion en titre, Clermont-Ferrand. Il est retenu avec sa sélection nationale pour la série de test matches du mois de novembre. Pour son match d’ouverture, la France est opposée aux All Blacks et Antoine Dupont connaît à cette occasion sa première titularisation avec le maillot bleu. Auteur de quatre franchissements, pour 91 mètres parcourus ballon en main et sept défenseurs battus, il réalise une bonne performance lui permettant d’être élu homme du match, malgré la défaite (18-38). Remplaçant lors de la première journée du Tournoi des Six Nations 2018 contre l’Irlande, il est à l’initiative de l’essai de Teddy Thomas. Quelques minutes après, il se blesse et souffre d’une rupture des ligaments antérieurs du genou droit, qui met un terme à sa saison. Il fait son retour officiel à la compétition le 6 octobre 2018 face à Agen où il joue près de 20 minutes, remplaçant Sébastien Bézy à la fin du match. Après deux matches de coupe d’Europe, il est titularisé face à Perpignan contre qui il inscrit trois essais. Il est de retour dans le groupe France, un mois après son retour à la compétition. Il dispute les trois matches de la tournée en tant que remplaçant de Baptiste Serin, face à l’Afrique du Sud, l’Argentine et les Fidji. De retour à Toulouse, il enchaîne les titularisations au poste de numéro 9, malgré les bonnes performances de Sébastien Bézy. De retour en équipe de France pour le tournoi, il ne dispute pas le premier match, Morgan Parra et Baptiste Serin lui étant préférés. De retour sur le banc face au XV de la rose, il réalise une entrée convaincante, malgré la lourde défaite (8-44). Les performances et les propos d’après match remettant en cause le staff tricolore du titulaire Morgan Parra, l’exclu du groupe. Antoine Dupont est titularisé pour les trois derniers matches du tournoi. Il inscrit son premier essai international face à l’Italie lors du dernier match. Les bonnes performances de l’équipe toulousaine permettent au club de retrouver les phases finales, aussi bien en coupe d’Europe qu’en Top 14. Antoine Dupont dispute le quart de finale et la demi-finale de coupe d’Europe. En quart face au Racing 92, il est titulaire au poste de numéro 9. Il inscrit le premier essai de la rencontre et est replacé au poste de demi d’ouverture en fin de première mi-temps après l’expulsion du numéro 10 titulaire, Zack Holmes. Il inscrit un second essai, est élu homme du match aidant son équipe à se qualifier (22-21). Ainsi, pour la demi-finale face au Leinster, il est titularisé au poste de numéro 10. Finissant premier au classement général du championnat de France, le Stade toulousain est directement qualifié pour les demi-finales. Il est titulaire au poste de demi de mêlée pour le premier match face à La Rochelle, puis en finale face à l’ASM Clermont (24-18) au Stade de France. Il remporte ainsi en 2019 son premier bouclier de Brennus. Présent dans la liste de Jacques Brunel pour la préparation à la coupe du monde 2019 au Japon, il est titulaire lors des trois matches de préparation (contre l’Italie et deux fois contre l’Écosse), où il inscrit deux essais. Retenu dans la liste définitive de 31 joueurs pour disputer la compétition, il commence la compétition en tant que titulaire face à l’Argentine. Victorieuse des Pumas, grâce notamment à un essai de Dupont, la France se qualifie pour les quarts de finale. Gêné par des douleurs à son dos, Antoine Dupont est préservé par le staff de l’équipe de France afin d’être aligné en quart de finale face au pays de Galles. Défaite au bout du suspense 20 à 19, l’équipe de France est éliminée de la compétition. Toujours gêné par des problèmes au dos, Dupont fait son retour sur les pelouses à la fin du mois de décembre 2019. Malgré seulement deux titularisations en club, Antoine Dupont rejoint le XV de France pour démarrer contre le XV de la Rose (équipe d'Angleterre) lors du premier match dans le Tournoi des Six Nations 2020. Auteur d’une performance soulignée par la presse, Dupont participe activement à la victoire française sur les récents vice-champions du monde. Confirmant une certaine régularité au haut niveau, Antoine Dupont est considéré par certains experts comme l’un des meilleurs demis de mêlée du monde. Sa nouvelle performance positive la semaine suivante face à l’Italie montre l’importance prise par Dupont dans le système du nouveau sélectionneur Fabien Galthié. En 2020, il est élu Meilleur joueur du Tournoi des Six Nations à l’issue d’un vote du public parmi une liste de six nominés, choisis par des journalistes de rugby, d'anciens joueurs et des diffuseurs des six pays participants. Cette année 2020, parmi les six nominés, on comptait trois Français : les Toulousains Antoine Dupont, Romain Ntamack et le Gersois Grégory Alldritt. Arrivé en tête des votes avec 46% des suffrages, il est le premier tricolore à recevoir la distinction, créée en 2004. Durant ce Tournoi, le demi de mêlée tricolore a inscrit un essai, délivré quatre passes décisives, parcouru 249 mètres ballon en main et gagné 1543 mètres avec son jeu au pied. En octobre 2021, Fabien Galthié annonce qu'Antoine Dupont sera le capitaine du XV de France pour la tournée d'automne. Il remplace provisoirement Charles Ollivon, blessé pour une longue durée. Sa désignation comme capitaine des Bleus pour les tests d'automne est le témoignage de son influence grandissante au-delà du terrain, où ses qualités naturelles en faisaient déjà depuis quelques saisons l'une des références mondiales à son poste. L'équipe de France remporte ses trois matches, dont une victoire le 20 novembre 2021 face aux All Blacks (40-25), devant 80.000 spectateurs et jusqu’à 7,6 millions de téléspectateurs. La première au Stade de France à Saint-Denis face à la Nouvelle-Zélande depuis 1973. Et le 10 décembre 2021, à tout juste 25 ans, succédant au troisième ligne sud-africain Pieter-Steph Du Toit, couronné en 2019, Antoine Dupont est désigné Meilleur joueur du monde World Rugby. Seuls deux autres internationaux français avaient connu précédemment cette distinction : Fabien Galthié ancien demi de mêlée en 2002, son sélectionneur au moment où il reçoit le prix, et Thierry Dusautoir ancien troisième ligne en 2011. Une reconnaissance internationale qui vient récompenser une année 2021 ponctuée de deux titres avec le Stade toulousain, en Coupe d'Europe et en championnat, et d'une victoire de prestige avec la France en novembre contre la Nouvelle-Zélande. Antoine Dupont, devenu une célébrité du rugby, une figure internationale, toujours très attaché à son clocher, à son terroir natal, a besoin de temps en temps de revenir chez lui et de garder ce lien très important avec ses racines. Dès qu’il le peut, il rend visite à son frère Clément et à son oncle Jean-Luc Gales qui gèrent l’exploitation agricole familiale, où sont élevés 400 porcs noirs de Bigorre, un produit d’exception, bénéficiant de l’appellation d’origine protégée (AOP). "Toto", comme l’appellent ses proches, fait figure aujourd’hui de premier ambassadeur de son village d’origine. Dans le village de Castelnau-Magnoac, les gens sont comblés de voir son évolution. "C’est unanime, car en plus d’avoir une image d’un excellent joueur de rugby, il est sympa, tient à ajouter son premier entraîneur, Jean-Philippe Guerrero. C’est un garçon humble et discret du Sud-Ouest. Il est sympa avec tout le monde quand il revient, il n’a pas changé. Ce n’est pas parce qu’il est célèbre aujourd’hui qu’il oubliera de dire bonjour à quelqu’un qu’il avait connu avant. Il est juste sympa et c’est toujours un plaisir. "C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup", confirme son ancien entraîneur à Castres Christophe Urios. Ses proches regardent cette trajectoire avec bienveillance et humilité. En quittant le village, on se dit que le "surdoué" Antoine Dupont, peut marquer l’histoire de ce sport. Mais que pour les siens, il restera "Toto" de Castelnau-Magnoac. Une pépite du piémont pyrénéen, joueur de rugby de 25 ans ayant émergé ces dernières années pour devenir rapidement une star mondiale du sport, qui est désormais largement reconnu comme l’un des meilleurs n°9 – sinon le meilleur – dans le monde en ce moment. Le demi-arrière remportant en octobre 2020 sa 25e sélection contre l’Irlande, trois ans et demi après ses débuts en Italie en mars 2017. Dupont s'impose, à moins de deux ans de la Coupe du monde en France (2023), comme l'une des égéries d'un sport en mal de superstars internationales comme peuvent l'être Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo en football. "Le rugby français est fier de compter dans ses rangs le meilleur joueur du monde en 2021" a écrit Bernard Laporte sur le réseau social. "Il n'y a jamais eu de joueur de l'année aussi évident qu'Antoine Dupont", a écrit aussi Brian O'Driscoll la légende irlandaise. "Il a été irréel cette année 2021." Avec les Bleus, il est sélectionné, en janvier 2022 pour participer au Tournoi des Six Nations 2022. Il est capitaine des Bleus pour ce tournoi. Les Français remportent tous les matchs de la compétition, réalisant ainsi le Grand Chelem, le dixième de l'histoire du rugby tricolore, le premier depuis douze ans. Après cet excellent tournoi, il est élu, pour la deuxième fois de sa carrière internationale, meilleur joueur du tournoi des Six Nations. En 2023, à l'issue du Tournoi des Six Nations, il est élu meilleur joueur de la compétition pour la troisième fois de sa carrière égalant le record détenu par l'Irlandais Brian O'Driscoll. Cette même année, avec le Stade toulousain, Antoine Dupont remporte le Bouclier de Brennus pour la troisième fois de sa carrière. À l'issue de cette saison, il remporte l'Oscar monde pour la troisième année consécutive. Lors de la Coupe du monde de rugby 2023, les Bleus sont éliminés par les Springboks après une courte défaite 29-28. En fin d'année 2023, il est élu meilleur joueur du Top 14 et meilleur joueur international français lors de la dix-neuvième Nuit du rugby. En 2024, il est titulaire et capitaine avec le Stade toulousain en finale de la Champions Cup au Tottenham Hotspur Stadium de Londres face au Leinster. Les Toulousains remportent le 6e titre de champions d'Europe du club. Antoine Dupont est élu homme du match, mais aussi meilleur joueur de l'édition de Champions Cup 2023-2024. Il devient ainsi le premier joueur de l'histoire à remporter 2 fois le titre du joueur européen de l'année, son premier datant de 2021. Le 28 juin 2024, le Stade toulousain s'impose en finale du Top 14 en surclassant l'Union Bordeaux Bègles sur le score de 59 à 3. Cette victoire permet au Stade toulousain de glaner son 23e bouclier de Brennus. Antoine Dupont, auteur de deux essais, est élu homme du match de la finale. Le 27 juillet 2024, lors des Jeux olympiques de Paris, il est sacré champion olympique en battant les tenants du titre fidjiens en finale. Entré en début de deuxième mi-temps alors que les deux équipes sont à égalité 7-7, il offre sur son premier ballon une passe décisive après une course de 60 m, amenant un essai français avant d'inscrire les deux derniers essais de la rencontre, scellant la victoire française. Il s'agit de la première médaille d'or de la France des Jeux olympiques de Paris 2024. Le 14 septembre 2024, il est élevé au rang de chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur et reçoit la prestigieuse distinction des mains du Président de la République, Emmanuel Macron. Et dire que la future star du rugby, le grand numéro 9, avait failli arrêter le rugby où il s’ennuyait, pour essayer le football où quelques amis jouaient ! Désormais le XV de France actuel possède son Zidane. Une perle rare et merveilleuse, appelée Dupont. Voici donc comment « Toto », pour les intimes, désigné meilleur rugbyman de la planète est passé de Castelnau-Magnoac, village bigourdan que la France du rugby a mis sur la carte au toit du monde. Et l’histoire n’est certainement pas finie …
Antoine DUPONT, né le 15 novembre 1996 à Lannemezan, est un joueur international français de rugby à XV évoluant principalement au poste de demi de mêlée. Il mesure 1m74 pour 85 kg. Il joue au sein de l’effectif du Stade toulousain et en équipe de France depuis 2017. Il est originaire du village de Castelnau-Magnoac, où il a commencé le rugby à l’âge de 4 ans au Magnoac FC3. Sa passion depuis tout petit, c'est de jouer au rugby. Il veut suivre les pas de Clément son grand frère, de trois ans son aîné, dans le monde du ballon ovale. Et dès ses premiers entraînements, il va épater tout le monde avec des capacités physiques hors-normes, dit Jean-Philippe Guerrero, son premier entraîneur. « Un surdoué, précoce, avec de la fluidité, un rôle de distributeur et une vision stratégique toujours justes, un catalyseur du jeu offensif et audacieux », résume ainsi Jean-Philippe Guerrero. « Il arrangeait les règles », se rappelle en riant son frère Clément, avec lequel la compétition était permanente. Clément se souvient des duels, des trois contre deux ou trois contre trois qu'Antoine aimait et grâce auxquels il a progressé. Doué, le petit était régulièrement surclassé et jouait contre des plus grands. En 2011, alors qu’il évolue en cadet, il rejoint le centre de formation du FC Auch. Il intègre également le pôle Espoir du lycée Jolimont (aujourd’hui lycée Stéphane-Hessel) à Toulouse, où il passe son Bac S-SVT. Il débute ensuite un DUT mesures physiques à l’IUT d’Orsay, à Paris. Au bout d’un trimestre, il décide d’arrêter et de commencer une licence STAPS, toujours à la faculté d’Orsay, alors qu’il joue au Castres olympique. « J’y suis resté six mois, puis j’ai fini ma licence à Toulouse, à l’université Paul Sabatier », note le rugbyman. En 2018, une fois diplômé, pas question pour lui d’arrêter ses études. Il poursuit alors en s’inscrivant en école de commerce à Toulouse, où il étudie le management du sport. Il a conscience qu’une carrière professionnelle de rugbyman ne dure pas toute une vie, et qu’il aura besoin de se reconvertir après sa retraite de sportif. « Je n’ai pas d’idée précise de reconversion, mais je veux avoir un certain bagage scolaire pour la suite », indique-t-il. Passionné de sport (pas uniquement de rugby), il est curieux de découvrir comment fonctionne cette économie. « Je trouve intéressant de comprendre le business du sport, moi qui baigne dans le monde du rugby depuis mes quatre ans ». En plus d’être l’étoile montante du rugby français et l’un des meilleurs joueurs du Tournoi jusque-ici, ce sportif est donc en master 2 management du sport à l’école de commerce Toulouse School of Management (TBS). En 2014, il dispute la finale du championnat de France Crabos avec Auch et rejoint le Castres olympique à l’issue de la saison. Âgé de 18 ans, le 8 novembre 2014, il fait ses débuts avec l’équipe professionnelle lors d’une rencontre face au RC Toulon en rentrant pour une minute de jeu à la place de Cédric Garcia. En janvier 2015, il est titularisé en Coupe d’Europe pour un match contre les Harlequins, au cours duquel il inscrit son premier essai professionnel. À la suite d’une mêlée castraise à cinq mètres de l’en-but anglais, il récupère le ballon, échappe au plaquage du capitaine londonien Chris Robshaw, et aplatit le ballon sous les poteaux. Membre du pôle espoir de Marcoussis pour la saison 2014-2015, il est sélectionné par Fabien Pelous pour disputer le Tournoi des Six Nations des moins de 20 ans avec l’équipe de France. Il joue trois matches, à chaque fois en tant que remplaçant, et n’est finalement pas retenu pour le championnat du monde junior de la même année. Il joue onze matches toutes compétitions confondues pour sa première année sous les couleurs bleu et blanc du Castres olympique. La saison suivante, en 2015 avec le Castres olympique, il joue 18 matches toutes compétitions confondues. Il réalise notamment un très bon match face à l’US Oyonnax en début de saison, alors que Christophe Urios, son nouvel entraîneur, décide de le titulariser au poste d’ouvreur aux dépens de Romain Cabannes à la suite d’un nombre important de blessés au poste. Il est nommé cette année parmi les meilleurs espoirs lors de la Nuit du rugby. Il est de nouveau appelé en équipe de France des moins de 20 ans pour le Tournoi des Six Nations et pour le championnat du monde junior en juin 2016. Durant cette compétition, il inscrit un total de cinq essais en trois titularisations, dont trois essais contre le Japon en phase de poule. En juillet 2016, il figure sur la Liste développement de 30 joueurs de moins de 23 ans à fort potentiel que les entraîneurs de l’équipe de France suivent pour la saison 2016-2017. En novembre 2016, il est sélectionné dans l’équipe des Barbarians français par Raphaël Ibañez pour affronter une sélection australienne (contre les Wallabies XV l'équipe réserve australienne) au Stade Chaban-Delmas de Bordeaux. Il commence la rencontre en tant que remplaçant de Yann Lesgourgues et réalise une entrée remarquée qui attire l'attention de nombreux observateurs, aidant son équipe à s’imposer sur le score de 19 à 11. En septembre 2016, Antoine Dupont est annoncé partant pour le Stade toulousain par les médias RMC et La Dépêche du Midi, sans que cela soit confirmé officiellement. En novembre, RMC annonce de nouveau la signature du joueur au Stade toulousain, mais cette fois, l’information est démentie par l’entraîneur du Castres olympique. Christophe Urios déclarant « qu’Antoine Dupont est encore en réflexion et n’a pas signé à Toulouse ». Le 29 novembre 2016, le club de Castres annonce sur son site Internet le départ du demi de mêlée à la fin de la saison, sans pour autant préciser pour quel club. Le lendemain, le Stade toulousain annonce l’arrivée du joueur à compter de la saison 2017-2018. L’annonce et la contre-annonce du départ d’Antoine Dupont se déroulent dans un contexte qui voit le joueur s’affirmer en club, où il réalise de bonnes performances et où il voit son temps de jeu augmenter. Les supporters de Castres affichent leur souhait de voir le joueur rester au club et prolonger son contrat. Le 8 mars 2017, il est appelé pour la première fois en équipe de France par Guy Novès à la suite d’une blessure de Maxime Machenaud. Quarante-huit heures après son premier entraînement avec le XV de France, il connaît sa première sélection au Stade olympique de Rome face à l’équipe d’Italie le 11 mars 2017. Une semaine plus tard, il réalise une entrée en jeu remarquée contre le pays de Galles, la France s’imposant 20 à 18 au terme du match international le plus long de l’histoire, se concluant après 20 minutes de temps additionnel. Il participe à la tournée des Bleus en Afrique du Sud, disputant une seule des trois rencontres en tant que remplaçant. Les Français terminant la tournée avec trois défaites cinglantes. En juin 2017, l’encadrement du XV de France l’intègre dans la liste Élite des joueurs protégés par la convention FFR/LNR pour la saison 2017-2018. Antoine rêvait de jouer à Toulouse depuis sa plus tendre enfance. À cinq, six ans, il avait demandé à sa mère pour Noël les maillots des Toulousains Frédéric Michalak et Clément Poitrenaud, aujourd'hui l'un de ses entraîneurs. Arrivé au Stade toulousain qui sort d’un exercice 2016-2017 décevant terminé à la douzième place du classement, Antoine Dupont s’inscrit rapidement dans une première dynamique de victoires en s’imposant au poste de demi de mêlée, aux dépens de l’international Sébastien Bézy. Il inscrit quatre essais lors de ses quatre premiers matches sous ses nouvelles couleurs, dont le premier face à Toulon et un doublé face au champion en titre, Clermont-Ferrand. Il est retenu avec sa sélection nationale pour la série de test matches du mois de novembre. Pour son match d’ouverture, la France est opposée aux All Blacks et Antoine Dupont connaît à cette occasion sa première titularisation avec le maillot bleu. Auteur de quatre franchissements, pour 91 mètres parcourus ballon en main et sept défenseurs battus, il réalise une bonne performance lui permettant d’être élu homme du match, malgré la défaite (18-38). Remplaçant lors de la première journée du Tournoi des Six Nations 2018 contre l’Irlande, il est à l’initiative de l’essai de Teddy Thomas. Quelques minutes après, il se blesse et souffre d’une rupture des ligaments antérieurs du genou droit, qui met un terme à sa saison. Il fait son retour officiel à la compétition le 6 octobre 2018 face à Agen où il joue près de 20 minutes, remplaçant Sébastien Bézy à la fin du match. Après deux matches de coupe d’Europe, il est titularisé face à Perpignan contre qui il inscrit trois essais. Il est de retour dans le groupe France, un mois après son retour à la compétition. Il dispute les trois matches de la tournée en tant que remplaçant de Baptiste Serin, face à l’Afrique du Sud, l’Argentine et les Fidji. De retour à Toulouse, il enchaîne les titularisations au poste de numéro 9, malgré les bonnes performances de Sébastien Bézy. De retour en équipe de France pour le tournoi, il ne dispute pas le premier match, Morgan Parra et Baptiste Serin lui étant préférés. De retour sur le banc face au XV de la rose, il réalise une entrée convaincante, malgré la lourde défaite (8-44). Les performances et les propos d’après match remettant en cause le staff tricolore du titulaire Morgan Parra, l’exclu du groupe. Antoine Dupont est titularisé pour les trois derniers matches du tournoi. Il inscrit son premier essai international face à l’Italie lors du dernier match. Les bonnes performances de l’équipe toulousaine permettent au club de retrouver les phases finales, aussi bien en coupe d’Europe qu’en Top 14. Antoine Dupont dispute le quart de finale et la demi-finale de coupe d’Europe. En quart face au Racing 92, il est titulaire au poste de numéro 9. Il inscrit le premier essai de la rencontre et est replacé au poste de demi d’ouverture en fin de première mi-temps après l’expulsion du numéro 10 titulaire, Zack Holmes. Il inscrit un second essai, est élu homme du match aidant son équipe à se qualifier (22-21). Ainsi, pour la demi-finale face au Leinster, il est titularisé au poste de numéro 10. Finissant premier au classement général du championnat de France, le Stade toulousain est directement qualifié pour les demi-finales. Il est titulaire au poste de demi de mêlée pour le premier match face à La Rochelle, puis en finale face à l’ASM Clermont (24-18) au Stade de France. Il remporte ainsi en 2019 son premier bouclier de Brennus. Présent dans la liste de Jacques Brunel pour la préparation à la coupe du monde 2019 au Japon, il est titulaire lors des trois matches de préparation (contre l’Italie et deux fois contre l’Écosse), où il inscrit deux essais. Retenu dans la liste définitive de 31 joueurs pour disputer la compétition, il commence la compétition en tant que titulaire face à l’Argentine. Victorieuse des Pumas, grâce notamment à un essai de Dupont, la France se qualifie pour les quarts de finale. Gêné par des douleurs à son dos, Antoine Dupont est préservé par le staff de l’équipe de France afin d’être aligné en quart de finale face au pays de Galles. Défaite au bout du suspense 20 à 19, l’équipe de France est éliminée de la compétition. Toujours gêné par des problèmes au dos, Dupont fait son retour sur les pelouses à la fin du mois de décembre 2019. Malgré seulement deux titularisations en club, Antoine Dupont rejoint le XV de France pour démarrer contre le XV de la Rose (équipe d'Angleterre) lors du premier match dans le Tournoi des Six Nations 2020. Auteur d’une performance soulignée par la presse, Dupont participe activement à la victoire française sur les récents vice-champions du monde. Confirmant une certaine régularité au haut niveau, Antoine Dupont est considéré par certains experts comme l’un des meilleurs demis de mêlée du monde. Sa nouvelle performance positive la semaine suivante face à l’Italie montre l’importance prise par Dupont dans le système du nouveau sélectionneur Fabien Galthié. En 2020, il est élu Meilleur joueur du Tournoi des Six Nations à l’issue d’un vote du public parmi une liste de six nominés, choisis par des journalistes de rugby, d'anciens joueurs et des diffuseurs des six pays participants. Cette année 2020, parmi les six nominés, on comptait trois Français : les Toulousains Antoine Dupont, Romain Ntamack et le Gersois Grégory Alldritt. Arrivé en tête des votes avec 46% des suffrages, il est le premier tricolore à recevoir la distinction, créée en 2004. Durant ce Tournoi, le demi de mêlée tricolore a inscrit un essai, délivré quatre passes décisives, parcouru 249 mètres ballon en main et gagné 1543 mètres avec son jeu au pied. En octobre 2021, Fabien Galthié annonce qu'Antoine Dupont sera le capitaine du XV de France pour la tournée d'automne. Il remplace provisoirement Charles Ollivon, blessé pour une longue durée. Sa désignation comme capitaine des Bleus pour les tests d'automne est le témoignage de son influence grandissante au-delà du terrain, où ses qualités naturelles en faisaient déjà depuis quelques saisons l'une des références mondiales à son poste. L'équipe de France remporte ses trois matches, dont une victoire le 20 novembre 2021 face aux All Blacks (40-25), devant 80.000 spectateurs et jusqu’à 7,6 millions de téléspectateurs. La première au Stade de France à Saint-Denis face à la Nouvelle-Zélande depuis 1973. Et le 10 décembre 2021, à tout juste 25 ans, succédant au troisième ligne sud-africain Pieter-Steph Du Toit, couronné en 2019, Antoine Dupont est désigné Meilleur joueur du monde World Rugby. Seuls deux autres internationaux français avaient connu précédemment cette distinction : Fabien Galthié ancien demi de mêlée en 2002, son sélectionneur au moment où il reçoit le prix, et Thierry Dusautoir ancien troisième ligne en 2011. Une reconnaissance internationale qui vient récompenser une année 2021 ponctuée de deux titres avec le Stade toulousain, en Coupe d'Europe et en championnat, et d'une victoire de prestige avec la France en novembre contre la Nouvelle-Zélande. Antoine Dupont, devenu une célébrité du rugby, une figure internationale, toujours très attaché à son clocher, à son terroir natal, a besoin de temps en temps de revenir chez lui et de garder ce lien très important avec ses racines. Dès qu’il le peut, il rend visite à son frère Clément et à son oncle Jean-Luc Gales qui gèrent l’exploitation agricole familiale, où sont élevés 400 porcs noirs de Bigorre, un produit d’exception, bénéficiant de l’appellation d’origine protégée (AOP). "Toto", comme l’appellent ses proches, fait figure aujourd’hui de premier ambassadeur de son village d’origine. Dans le village de Castelnau-Magnoac, les gens sont comblés de voir son évolution. "C’est unanime, car en plus d’avoir une image d’un excellent joueur de rugby, il est sympa, tient à ajouter son premier entraîneur, Jean-Philippe Guerrero. C’est un garçon humble et discret du Sud-Ouest. Il est sympa avec tout le monde quand il revient, il n’a pas changé. Ce n’est pas parce qu’il est célèbre aujourd’hui qu’il oubliera de dire bonjour à quelqu’un qu’il avait connu avant. Il est juste sympa et c’est toujours un plaisir. "C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup", confirme son ancien entraîneur à Castres Christophe Urios. Ses proches regardent cette trajectoire avec bienveillance et humilité. En quittant le village, on se dit que le "surdoué" Antoine Dupont, peut marquer l’histoire de ce sport. Mais que pour les siens, il restera "Toto" de Castelnau-Magnoac. Une pépite du piémont pyrénéen, joueur de rugby de 25 ans ayant émergé ces dernières années pour devenir rapidement une star mondiale du sport, qui est désormais largement reconnu comme l’un des meilleurs n°9 – sinon le meilleur – dans le monde en ce moment. Le demi-arrière remportant en octobre 2020 sa 25e sélection contre l’Irlande, trois ans et demi après ses débuts en Italie en mars 2017. Dupont s'impose, à moins de deux ans de la Coupe du monde en France (2023), comme l'une des égéries d'un sport en mal de superstars internationales comme peuvent l'être Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo en football. "Le rugby français est fier de compter dans ses rangs le meilleur joueur du monde en 2021" a écrit Bernard Laporte sur le réseau social. "Il n'y a jamais eu de joueur de l'année aussi évident qu'Antoine Dupont", a écrit aussi Brian O'Driscoll la légende irlandaise. "Il a été irréel cette année 2021." Avec les Bleus, il est sélectionné, en janvier 2022 pour participer au Tournoi des Six Nations 2022. Il est capitaine des Bleus pour ce tournoi. Les Français remportent tous les matchs de la compétition, réalisant ainsi le Grand Chelem, le dixième de l'histoire du rugby tricolore, le premier depuis douze ans. Après cet excellent tournoi, il est élu, pour la deuxième fois de sa carrière internationale, meilleur joueur du tournoi des Six Nations. En 2023, à l'issue du Tournoi des Six Nations, il est élu meilleur joueur de la compétition pour la troisième fois de sa carrière égalant le record détenu par l'Irlandais Brian O'Driscoll. Cette même année, avec le Stade toulousain, Antoine Dupont remporte le Bouclier de Brennus pour la troisième fois de sa carrière. À l'issue de cette saison, il remporte l'Oscar monde pour la troisième année consécutive. Lors de la Coupe du monde de rugby 2023, les Bleus sont éliminés par les Springboks après une courte défaite 29-28. En fin d'année 2023, il est élu meilleur joueur du Top 14 et meilleur joueur international français lors de la dix-neuvième Nuit du rugby. En 2024, il est titulaire et capitaine avec le Stade toulousain en finale de la Champions Cup au Tottenham Hotspur Stadium de Londres face au Leinster. Les Toulousains remportent le 6e titre de champions d'Europe du club. Antoine Dupont est élu homme du match, mais aussi meilleur joueur de l'édition de Champions Cup 2023-2024. Il devient ainsi le premier joueur de l'histoire à remporter 2 fois le titre du joueur européen de l'année, son premier datant de 2021. Le 28 juin 2024, le Stade toulousain s'impose en finale du Top 14 en surclassant l'Union Bordeaux Bègles sur le score de 59 à 3. Cette victoire permet au Stade toulousain de glaner son 23e bouclier de Brennus. Antoine Dupont, auteur de deux essais, est élu homme du match de la finale. Le 27 juillet 2024, lors des Jeux olympiques de Paris, il est sacré champion olympique en battant les tenants du titre fidjiens en finale. Entré en début de deuxième mi-temps alors que les deux équipes sont à égalité 7-7, il offre sur son premier ballon une passe décisive après une course de 60 m, amenant un essai français avant d'inscrire les deux derniers essais de la rencontre, scellant la victoire française. Il s'agit de la première médaille d'or de la France des Jeux olympiques de Paris 2024. Le 14 septembre 2024, il est élevé au rang de chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur et reçoit la prestigieuse distinction des mains du Président de la République, Emmanuel Macron. Et dire que la future star du rugby, le grand numéro 9, avait failli arrêter le rugby où il s’ennuyait, pour essayer le football où quelques amis jouaient ! Désormais le XV de France actuel possède son Zidane. Une perle rare et merveilleuse, appelée Dupont. Voici donc comment « Toto », pour les intimes, désigné meilleur rugbyman de la planète est passé de Castelnau-Magnoac, village bigourdan que la France du rugby a mis sur la carte au toit du monde. Et l’histoire n’est certainement pas finie …DUPOUEY Christophe (1968-XXXX)
Vététiste, champion du monde de VTT
 Christophe DUPOUEY, né le 8 août 1968 à Tarbes et mort le 4 février 2009 dans la même ville, est un coureur cycliste français spécialiste de VTT cross-country. Dans cette discipline, il est vainqueur de la Coupe du monde en 1996 et Champion du monde en 1998. Il a également participé aux JO de 1996, où il a pris la quatrième place. Auteur de bons résultats chez les amateurs, il est notamment vice-champion du monde militaire de cyclo-cross en 1990, il est approché par l'équipe professionnelle espagnole ONCE. Christophe Dupouey souhaitant donner la priorité à sa carrière en VTT, les négociations n'aboutissent pas. Spécialiste du cross-country, il remporte la Coupe du monde de 1996. Il participe cette année-là aux Jeux olympiques d'Atlanta, où il prend la quatrième place. Deux ans plus tard, il est sacré Champion du monde à Mont Sainte-Anne au Canada. Gardant l'espoir de faire carrière sur route, à l'image de Miguel Martinez, il passe la fin de l'année 2002 au sein de l'équipe Oktos en tant que stagiaire, mais ne décroche pas de contrat pour 2003. Il met fin à sa carrière en 2004. Impliqué avec son ami Laurent Roux dans l'affaire de dopage au « pot belge » qui éclate en 2005, il est condamné à une peine de prison de trois mois avec sursis en 2006. Depuis 2008, Christophe Dupouey était responsable du réseau vel'en ville, système de vélos en libre-service de la ville de Tarbes, où il résidait. L'ancien champion VTT était amer à cause de la place qui fut accordée dans les médias à l'affaire de dopage dite de Cahors, où il se sentit « trahi ». Autre raison d'amertume ou de frustration, il aurait voulu faire carrière sur la route. Même durant les dernières années de sa vie, il avait tenté sa chance, mais sans succès. Atteint de dépression, il se suicide le 4 février 2009, à l’âge de 40 ans. Son palmarès en VTT : 4e du cross-country aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996 ; Champion d'Europe de cross-country en 1996 ; Champion du monde de cross-country au Mont Sainte-Anne (Québec) en 1998 ; Champion d'Europe de cross-country en 1998 ; Champion de France de cross-country en 1998 ; Champion de France de cross-country en 2002. Double Champion d'Europe de VTT (1996 et 1998), il avait aussi effectué une brève tentative sur la route en qualité de stagiaire lors de la fin de saison 2002 sous le maillot d'Oktos-Saint Quentin. À la fin de l'année 1994, Christophe Dupouey était un homme un peu désabusé. Le club cycliste où il possédait une licence amateur disparaît corps et biens. Les perspectives ne sont plus guère excitantes pour le sportif tarbais. Il parlait même d'abandonner le vélo. Puis « pour s'amuser », il s'essaye au VTT, spécialité cross-country. Les dirigeants de la team SUNN Chipie, qui sont visiblement des gens avisés, ne tardent pas à lui proposer un contrat professionnel de trois ans. « Mes employeurs ont fait un pari sur moi », expliquait-il. Dix-huit mois après, à mi-parcours du contrat, le pari était déjà gagné. Christophe Dupouey, qui avait vingt-sept ans à l’époque, s'est très vite hissé parmi l'élite mondiale du VTT. Très vite, il prit solidement son courage et son guidon à deux mains et, même dans les passages vertigineux, ne quittait plus son engin. « J'ai trouvé avec le VTT, le genre d'efforts qui me convenait le mieux. C'est plus intense que le cyclisme sur route. L'effort est plus court, mais plus violent. Les pulsations cardiaques sont très hautes (150 à la minute) et ne redescendent jamais. ». Et curieusement, il effectuait l'essentiel de son entraînement non pas sur un site de VTT, mais sur route : six jours sur sept, de quinze à vingt heures par semaine. Sa méthode se voulait empirique : « Je n'ai pas d'entraîneur. Je base ma préparation sur mes sensations, mon expérience. » L'homme ne regrettait d'ailleurs pas le cyclisme sur route : « Le VTT, c'est une autre mentalité. Tout le monde se dit bonjour, même à un haut niveau. Le VTT, c'est fun. » Fun, peut-être, mais un sport où on peut atteindre le plus haut niveau en dix-huit mois et en se passant des services d'un entraîneur, était-il bien sérieux ? Christophe Dupouey répondait au contraire, que les courses de VTT connaissaient un énorme engouement populaire et que les places sur le podium étaient chères : « Certains cyclistes professionnels, qui ont essayé le VTT, en pensant que le niveau était bas, sont vite retournés aux épreuves sur route. » Le VTT bénéficiant alors de la reconnaissance olympique, Christophe Dupouey figurera, avec Miguel Martinez, parmi les Français sélectionnés pour Atlanta. En couple avec Valérie, il était le père de deux filles. Christophe qui connut ses heures de gloire, en VTT, lui, l'ancien spécialiste de cyclo-cross, Champion du monde 1998 au Canada, devant un certain Jérôme Chiotti, deux fois Champion d'Europe, deux fois Champion de France, deux fois vainqueur du Roc d'Azur… deux fois sélectionné pour les JO à Atlanta et Sydney. Affichant un sacré parcours sportif avec un palmarès incroyable auréolé de titres nationaux, européens et mondiaux en VTT, il restera un très grand champion, qui aura marqué son sport et sa discipline d’une empreinte indélébile et fait rêver le public. Presque 10 ans de carrière au plus haut niveau lui ont permis de participer à deux Olympiades, et fait de ce Bigourdan un des plus gros palmarès du VTT mondial.
Christophe DUPOUEY, né le 8 août 1968 à Tarbes et mort le 4 février 2009 dans la même ville, est un coureur cycliste français spécialiste de VTT cross-country. Dans cette discipline, il est vainqueur de la Coupe du monde en 1996 et Champion du monde en 1998. Il a également participé aux JO de 1996, où il a pris la quatrième place. Auteur de bons résultats chez les amateurs, il est notamment vice-champion du monde militaire de cyclo-cross en 1990, il est approché par l'équipe professionnelle espagnole ONCE. Christophe Dupouey souhaitant donner la priorité à sa carrière en VTT, les négociations n'aboutissent pas. Spécialiste du cross-country, il remporte la Coupe du monde de 1996. Il participe cette année-là aux Jeux olympiques d'Atlanta, où il prend la quatrième place. Deux ans plus tard, il est sacré Champion du monde à Mont Sainte-Anne au Canada. Gardant l'espoir de faire carrière sur route, à l'image de Miguel Martinez, il passe la fin de l'année 2002 au sein de l'équipe Oktos en tant que stagiaire, mais ne décroche pas de contrat pour 2003. Il met fin à sa carrière en 2004. Impliqué avec son ami Laurent Roux dans l'affaire de dopage au « pot belge » qui éclate en 2005, il est condamné à une peine de prison de trois mois avec sursis en 2006. Depuis 2008, Christophe Dupouey était responsable du réseau vel'en ville, système de vélos en libre-service de la ville de Tarbes, où il résidait. L'ancien champion VTT était amer à cause de la place qui fut accordée dans les médias à l'affaire de dopage dite de Cahors, où il se sentit « trahi ». Autre raison d'amertume ou de frustration, il aurait voulu faire carrière sur la route. Même durant les dernières années de sa vie, il avait tenté sa chance, mais sans succès. Atteint de dépression, il se suicide le 4 février 2009, à l’âge de 40 ans. Son palmarès en VTT : 4e du cross-country aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996 ; Champion d'Europe de cross-country en 1996 ; Champion du monde de cross-country au Mont Sainte-Anne (Québec) en 1998 ; Champion d'Europe de cross-country en 1998 ; Champion de France de cross-country en 1998 ; Champion de France de cross-country en 2002. Double Champion d'Europe de VTT (1996 et 1998), il avait aussi effectué une brève tentative sur la route en qualité de stagiaire lors de la fin de saison 2002 sous le maillot d'Oktos-Saint Quentin. À la fin de l'année 1994, Christophe Dupouey était un homme un peu désabusé. Le club cycliste où il possédait une licence amateur disparaît corps et biens. Les perspectives ne sont plus guère excitantes pour le sportif tarbais. Il parlait même d'abandonner le vélo. Puis « pour s'amuser », il s'essaye au VTT, spécialité cross-country. Les dirigeants de la team SUNN Chipie, qui sont visiblement des gens avisés, ne tardent pas à lui proposer un contrat professionnel de trois ans. « Mes employeurs ont fait un pari sur moi », expliquait-il. Dix-huit mois après, à mi-parcours du contrat, le pari était déjà gagné. Christophe Dupouey, qui avait vingt-sept ans à l’époque, s'est très vite hissé parmi l'élite mondiale du VTT. Très vite, il prit solidement son courage et son guidon à deux mains et, même dans les passages vertigineux, ne quittait plus son engin. « J'ai trouvé avec le VTT, le genre d'efforts qui me convenait le mieux. C'est plus intense que le cyclisme sur route. L'effort est plus court, mais plus violent. Les pulsations cardiaques sont très hautes (150 à la minute) et ne redescendent jamais. ». Et curieusement, il effectuait l'essentiel de son entraînement non pas sur un site de VTT, mais sur route : six jours sur sept, de quinze à vingt heures par semaine. Sa méthode se voulait empirique : « Je n'ai pas d'entraîneur. Je base ma préparation sur mes sensations, mon expérience. » L'homme ne regrettait d'ailleurs pas le cyclisme sur route : « Le VTT, c'est une autre mentalité. Tout le monde se dit bonjour, même à un haut niveau. Le VTT, c'est fun. » Fun, peut-être, mais un sport où on peut atteindre le plus haut niveau en dix-huit mois et en se passant des services d'un entraîneur, était-il bien sérieux ? Christophe Dupouey répondait au contraire, que les courses de VTT connaissaient un énorme engouement populaire et que les places sur le podium étaient chères : « Certains cyclistes professionnels, qui ont essayé le VTT, en pensant que le niveau était bas, sont vite retournés aux épreuves sur route. » Le VTT bénéficiant alors de la reconnaissance olympique, Christophe Dupouey figurera, avec Miguel Martinez, parmi les Français sélectionnés pour Atlanta. En couple avec Valérie, il était le père de deux filles. Christophe qui connut ses heures de gloire, en VTT, lui, l'ancien spécialiste de cyclo-cross, Champion du monde 1998 au Canada, devant un certain Jérôme Chiotti, deux fois Champion d'Europe, deux fois Champion de France, deux fois vainqueur du Roc d'Azur… deux fois sélectionné pour les JO à Atlanta et Sydney. Affichant un sacré parcours sportif avec un palmarès incroyable auréolé de titres nationaux, européens et mondiaux en VTT, il restera un très grand champion, qui aura marqué son sport et sa discipline d’une empreinte indélébile et fait rêver le public. Presque 10 ans de carrière au plus haut niveau lui ont permis de participer à deux Olympiades, et fait de ce Bigourdan un des plus gros palmarès du VTT mondial.
 Christophe DUPOUEY, né le 8 août 1968 à Tarbes et mort le 4 février 2009 dans la même ville, est un coureur cycliste français spécialiste de VTT cross-country. Dans cette discipline, il est vainqueur de la Coupe du monde en 1996 et Champion du monde en 1998. Il a également participé aux JO de 1996, où il a pris la quatrième place. Auteur de bons résultats chez les amateurs, il est notamment vice-champion du monde militaire de cyclo-cross en 1990, il est approché par l'équipe professionnelle espagnole ONCE. Christophe Dupouey souhaitant donner la priorité à sa carrière en VTT, les négociations n'aboutissent pas. Spécialiste du cross-country, il remporte la Coupe du monde de 1996. Il participe cette année-là aux Jeux olympiques d'Atlanta, où il prend la quatrième place. Deux ans plus tard, il est sacré Champion du monde à Mont Sainte-Anne au Canada. Gardant l'espoir de faire carrière sur route, à l'image de Miguel Martinez, il passe la fin de l'année 2002 au sein de l'équipe Oktos en tant que stagiaire, mais ne décroche pas de contrat pour 2003. Il met fin à sa carrière en 2004. Impliqué avec son ami Laurent Roux dans l'affaire de dopage au « pot belge » qui éclate en 2005, il est condamné à une peine de prison de trois mois avec sursis en 2006. Depuis 2008, Christophe Dupouey était responsable du réseau vel'en ville, système de vélos en libre-service de la ville de Tarbes, où il résidait. L'ancien champion VTT était amer à cause de la place qui fut accordée dans les médias à l'affaire de dopage dite de Cahors, où il se sentit « trahi ». Autre raison d'amertume ou de frustration, il aurait voulu faire carrière sur la route. Même durant les dernières années de sa vie, il avait tenté sa chance, mais sans succès. Atteint de dépression, il se suicide le 4 février 2009, à l’âge de 40 ans. Son palmarès en VTT : 4e du cross-country aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996 ; Champion d'Europe de cross-country en 1996 ; Champion du monde de cross-country au Mont Sainte-Anne (Québec) en 1998 ; Champion d'Europe de cross-country en 1998 ; Champion de France de cross-country en 1998 ; Champion de France de cross-country en 2002. Double Champion d'Europe de VTT (1996 et 1998), il avait aussi effectué une brève tentative sur la route en qualité de stagiaire lors de la fin de saison 2002 sous le maillot d'Oktos-Saint Quentin. À la fin de l'année 1994, Christophe Dupouey était un homme un peu désabusé. Le club cycliste où il possédait une licence amateur disparaît corps et biens. Les perspectives ne sont plus guère excitantes pour le sportif tarbais. Il parlait même d'abandonner le vélo. Puis « pour s'amuser », il s'essaye au VTT, spécialité cross-country. Les dirigeants de la team SUNN Chipie, qui sont visiblement des gens avisés, ne tardent pas à lui proposer un contrat professionnel de trois ans. « Mes employeurs ont fait un pari sur moi », expliquait-il. Dix-huit mois après, à mi-parcours du contrat, le pari était déjà gagné. Christophe Dupouey, qui avait vingt-sept ans à l’époque, s'est très vite hissé parmi l'élite mondiale du VTT. Très vite, il prit solidement son courage et son guidon à deux mains et, même dans les passages vertigineux, ne quittait plus son engin. « J'ai trouvé avec le VTT, le genre d'efforts qui me convenait le mieux. C'est plus intense que le cyclisme sur route. L'effort est plus court, mais plus violent. Les pulsations cardiaques sont très hautes (150 à la minute) et ne redescendent jamais. ». Et curieusement, il effectuait l'essentiel de son entraînement non pas sur un site de VTT, mais sur route : six jours sur sept, de quinze à vingt heures par semaine. Sa méthode se voulait empirique : « Je n'ai pas d'entraîneur. Je base ma préparation sur mes sensations, mon expérience. » L'homme ne regrettait d'ailleurs pas le cyclisme sur route : « Le VTT, c'est une autre mentalité. Tout le monde se dit bonjour, même à un haut niveau. Le VTT, c'est fun. » Fun, peut-être, mais un sport où on peut atteindre le plus haut niveau en dix-huit mois et en se passant des services d'un entraîneur, était-il bien sérieux ? Christophe Dupouey répondait au contraire, que les courses de VTT connaissaient un énorme engouement populaire et que les places sur le podium étaient chères : « Certains cyclistes professionnels, qui ont essayé le VTT, en pensant que le niveau était bas, sont vite retournés aux épreuves sur route. » Le VTT bénéficiant alors de la reconnaissance olympique, Christophe Dupouey figurera, avec Miguel Martinez, parmi les Français sélectionnés pour Atlanta. En couple avec Valérie, il était le père de deux filles. Christophe qui connut ses heures de gloire, en VTT, lui, l'ancien spécialiste de cyclo-cross, Champion du monde 1998 au Canada, devant un certain Jérôme Chiotti, deux fois Champion d'Europe, deux fois Champion de France, deux fois vainqueur du Roc d'Azur… deux fois sélectionné pour les JO à Atlanta et Sydney. Affichant un sacré parcours sportif avec un palmarès incroyable auréolé de titres nationaux, européens et mondiaux en VTT, il restera un très grand champion, qui aura marqué son sport et sa discipline d’une empreinte indélébile et fait rêver le public. Presque 10 ans de carrière au plus haut niveau lui ont permis de participer à deux Olympiades, et fait de ce Bigourdan un des plus gros palmarès du VTT mondial.
Christophe DUPOUEY, né le 8 août 1968 à Tarbes et mort le 4 février 2009 dans la même ville, est un coureur cycliste français spécialiste de VTT cross-country. Dans cette discipline, il est vainqueur de la Coupe du monde en 1996 et Champion du monde en 1998. Il a également participé aux JO de 1996, où il a pris la quatrième place. Auteur de bons résultats chez les amateurs, il est notamment vice-champion du monde militaire de cyclo-cross en 1990, il est approché par l'équipe professionnelle espagnole ONCE. Christophe Dupouey souhaitant donner la priorité à sa carrière en VTT, les négociations n'aboutissent pas. Spécialiste du cross-country, il remporte la Coupe du monde de 1996. Il participe cette année-là aux Jeux olympiques d'Atlanta, où il prend la quatrième place. Deux ans plus tard, il est sacré Champion du monde à Mont Sainte-Anne au Canada. Gardant l'espoir de faire carrière sur route, à l'image de Miguel Martinez, il passe la fin de l'année 2002 au sein de l'équipe Oktos en tant que stagiaire, mais ne décroche pas de contrat pour 2003. Il met fin à sa carrière en 2004. Impliqué avec son ami Laurent Roux dans l'affaire de dopage au « pot belge » qui éclate en 2005, il est condamné à une peine de prison de trois mois avec sursis en 2006. Depuis 2008, Christophe Dupouey était responsable du réseau vel'en ville, système de vélos en libre-service de la ville de Tarbes, où il résidait. L'ancien champion VTT était amer à cause de la place qui fut accordée dans les médias à l'affaire de dopage dite de Cahors, où il se sentit « trahi ». Autre raison d'amertume ou de frustration, il aurait voulu faire carrière sur la route. Même durant les dernières années de sa vie, il avait tenté sa chance, mais sans succès. Atteint de dépression, il se suicide le 4 février 2009, à l’âge de 40 ans. Son palmarès en VTT : 4e du cross-country aux Jeux olympiques d’Atlanta en 1996 ; Champion d'Europe de cross-country en 1996 ; Champion du monde de cross-country au Mont Sainte-Anne (Québec) en 1998 ; Champion d'Europe de cross-country en 1998 ; Champion de France de cross-country en 1998 ; Champion de France de cross-country en 2002. Double Champion d'Europe de VTT (1996 et 1998), il avait aussi effectué une brève tentative sur la route en qualité de stagiaire lors de la fin de saison 2002 sous le maillot d'Oktos-Saint Quentin. À la fin de l'année 1994, Christophe Dupouey était un homme un peu désabusé. Le club cycliste où il possédait une licence amateur disparaît corps et biens. Les perspectives ne sont plus guère excitantes pour le sportif tarbais. Il parlait même d'abandonner le vélo. Puis « pour s'amuser », il s'essaye au VTT, spécialité cross-country. Les dirigeants de la team SUNN Chipie, qui sont visiblement des gens avisés, ne tardent pas à lui proposer un contrat professionnel de trois ans. « Mes employeurs ont fait un pari sur moi », expliquait-il. Dix-huit mois après, à mi-parcours du contrat, le pari était déjà gagné. Christophe Dupouey, qui avait vingt-sept ans à l’époque, s'est très vite hissé parmi l'élite mondiale du VTT. Très vite, il prit solidement son courage et son guidon à deux mains et, même dans les passages vertigineux, ne quittait plus son engin. « J'ai trouvé avec le VTT, le genre d'efforts qui me convenait le mieux. C'est plus intense que le cyclisme sur route. L'effort est plus court, mais plus violent. Les pulsations cardiaques sont très hautes (150 à la minute) et ne redescendent jamais. ». Et curieusement, il effectuait l'essentiel de son entraînement non pas sur un site de VTT, mais sur route : six jours sur sept, de quinze à vingt heures par semaine. Sa méthode se voulait empirique : « Je n'ai pas d'entraîneur. Je base ma préparation sur mes sensations, mon expérience. » L'homme ne regrettait d'ailleurs pas le cyclisme sur route : « Le VTT, c'est une autre mentalité. Tout le monde se dit bonjour, même à un haut niveau. Le VTT, c'est fun. » Fun, peut-être, mais un sport où on peut atteindre le plus haut niveau en dix-huit mois et en se passant des services d'un entraîneur, était-il bien sérieux ? Christophe Dupouey répondait au contraire, que les courses de VTT connaissaient un énorme engouement populaire et que les places sur le podium étaient chères : « Certains cyclistes professionnels, qui ont essayé le VTT, en pensant que le niveau était bas, sont vite retournés aux épreuves sur route. » Le VTT bénéficiant alors de la reconnaissance olympique, Christophe Dupouey figurera, avec Miguel Martinez, parmi les Français sélectionnés pour Atlanta. En couple avec Valérie, il était le père de deux filles. Christophe qui connut ses heures de gloire, en VTT, lui, l'ancien spécialiste de cyclo-cross, Champion du monde 1998 au Canada, devant un certain Jérôme Chiotti, deux fois Champion d'Europe, deux fois Champion de France, deux fois vainqueur du Roc d'Azur… deux fois sélectionné pour les JO à Atlanta et Sydney. Affichant un sacré parcours sportif avec un palmarès incroyable auréolé de titres nationaux, européens et mondiaux en VTT, il restera un très grand champion, qui aura marqué son sport et sa discipline d’une empreinte indélébile et fait rêver le public. Presque 10 ans de carrière au plus haut niveau lui ont permis de participer à deux Olympiades, et fait de ce Bigourdan un des plus gros palmarès du VTT mondial.DUPUY Jean (1844-1919)
Sénateur des Hautes-Pyrénées de 1891 à 1919
 Jean DUPUY, né le 1er octobre 1844 à Saint-Palais en Gironde, et mort le 31 décembre 1919 à Paris, à l’âge de 75 ans. Après avoir essuyé un échec en Gironde en 1887, il se fait élire sénateur des Hautes-Pyrénées en 1891. D’origine modeste, fils de Jacques Dupuy, « sergier », mercier quelque peu colporteur et cultivateur, qui s’était marié le 7 septembre 1842 avec Magdeleine Thérèse, de l’hospice des enfants abandonnés de Bordeaux, domestique qui ne savait pas lire, Jean Dupuy va à l’école de Saint-Palais et complète son instruction auprès du curé et du maire. Puis il aide son père aux champs et au magasin. Un jour, il décide de ne plus jamais travailler la terre et entre, contre l’avis de ses parents, comme « saute-ruisseau » chez un huissier. En octobre 1865, il se rend à Paris avec son frère Charles et il travaille pendant plusieurs années chez un avoué. Il vit difficilement. Il a cependant beaucoup de succès auprès des clients de l’étude. En 1870, il est mobilisé dans la Garde nationale. Après la Commune, pendant laquelle il se lie d’amitié avec des révolutionnaires, il se marie avec Sophie-Alexandrine Legrand, fille de bourgeois aisés, exerçant la profession de doreurs dans le quartier du Marais. Avec ses économies et la dot de son épouse, il achète en 1873, une étude d’huissier rue d’Aboukir, qui lui ouvre les portes de la réussite. En décembre 1873 naît de ce mariage Marie Dupuy, qui épousera à 24 ans, François Arago, petit-fils du grand astronome. Jean Dupuy fait de son étude d’huissier la plus importante de Paris. Il est un conseiller d’affaires dont le jugement sûr est vite célèbre dans le monde des finances et du barreau. En 1879, il devient président du conseil de surveillance du Petit Parisien et à la mort de Paul Piégut, en 1888, le propriétaire-gérant directeur et seul actionnaire. Il renouvelle la formule du journal et sous son impulsion, ce journal atteindra le plus grand tirage du monde, atteignant 1 million d’exemplaires lors de l’affaire Dreyfus et qui ira jusqu’à 3 millions en 1918. Il était déjà propriétaire-directeur du Siècle depuis le 16 novembre 1887. Jean et Sophie Dupuy aiment beaucoup recevoir, et parmi leurs hôtes se trouvent Alexandre Ribot, Maurice Rouvier, René Waldeck-Rousseau, qui firent partie tous les trois, en 1881, du ministère Gambetta. À la fin de cette même année, Jean Dupuy cède son étude d’huissier à son frère aîné Charles, et ouvre en janvier 1882, au 16, rue de Gramont, un cabinet d’affaires. Il est élu sénateur des Hautes-Pyrénées le 4 janvier 1891, au premier tour de scrutin, par 401 voix sur 695 votants. Inscrit au groupe de la gauche républicaine, Jean Dupuy est combattu par les partis d’extrême gauche et d’extrême droite. Ce républicain, catholique de naissance, anticlérical de conviction, est amené à protéger Lourdes de toute sa puissance. Au Sénat, où l’avait d’ailleurs précédée sa solide réputation de travailleur, il fait partie de la plupart des Commissions : Finances, Marine, Algérie, etc. Il s’oppose le 14 mars 1891, sous la signature de Jean Frollo (pseudonyme collectif), dans son journal, à la suppression du régime de libre échange institué en 1860 entre la France et les autres pays, réclamée par Jules Méline, ministre de l’Agriculture dans le deuxième Cabinet Freycinet. Les membres du comité du syndicat de la presse, dont Jean Dupuy faisait partie depuis plusieurs années, l’appel lent à la présidence de ce syndicat et du comité général des associations de la presse. Ce mandat lui est confirmé pour quatre ans, en 1899, par l’assemblée générale des membres du syndicat. Comme rapporteur de la réforme de l’instruction criminelle, il prend une part décisive, en 1897, à l’établissement de l’instruction contradictoire. Pendant trois années consécutives, il rapporte le budget de l’Agriculture. Aussi, est-ce à ce ministère, dont il avait pu ainsi étudier tous les organes, qu’il fut appelé le 22 juin 1899, lors de la constitution du premier Cabinet Waldeck-Rousseau. Ce Gouvernement surprit la Chambre et l’opinion par sa composition, car il réunissait des républicains progressistes et des radicaux socialistes avec le général de Galliffet - surtout connu par sa répression sanglante de la Commune de 1871 et qui démissionna d’ailleurs le 30 mai 1900 - et le socialiste Alexandre Millerand. Comme ministre de l’Agriculture, Jean Dupuy a organisé définitivement le Crédit agricole et a créé l’Office des renseignements agricoles. Son nom restera surtout attaché au développement de l’usage de l’alcool industriel. Jean Dupuy, avec Millerand et Galliffet, encouragea Waldeck-Rousseau à demander la grâce de Dreyfus, qui fut signée par Émile Loubet le 20 septembre 1889. Le 28 janvier 1900, il est réélu sénateur des Hautes-Pyrénées au premier tour de scrutin par 552 voix sur 699 votants, malgré une protestation du lieutenant-colonel Monteil qui avait obtenu 95 voix, après une campagne électorale violente au cours de laquelle ses adversaires l’avaient accusé de pactiser avec les pires ennemis de la société. Le 20 avril, il inaugura le Palais de l’Horticulture de l’Exposition universelle. Le 11 juin 1900, il défend à la Chambre les producteurs français de blé au cours de la discussion d’un projet de loi concernant l’importation et l’exportation des blés et farines. Il fait primer la préférence nationale, ce qui constitue une inversion complète de ses précédentes prises de position doctrinale - à la fin des années 1880 - favorables aux thèses libre-échangistes. Au début de 1902, le tirage du Petit Parisien dépasse pour la première fois le million d’exemplaires. Un mois après les élections législatives d’avril 1902, Waldeck-Rousseau, fatigué, se démet avec son Cabinet. C’est la première fois qu’un ministère de la IIIe République se retire sans avoir été mis en minorité. Jean Dupuy attendra sept ans pour retrouver un portefeuille ministériel. Le Petit Parisien étrenne, le 4 avril 1904, un nouveau sous-titre : « Le plus fort tirage des journaux du monde entier ». Le 7 avril 1905, Jean Dupuy intervient au Sénat dans la discussion du budget de la Guerre et sur la répression de la fraude sur les vins. En mai et juin, il sert de négociateur officieux entre le Gouvernement français et l’ambassadeur d’Allemagne à Paris, sur l’affaire du Maroc. En juillet, le prince Hugo von Radolin, ambassadeur d’Allemagne en France, et le comte Witte, président du Conseil des ministres russe, demandent à Jean Dupuy d’être ambassadeur de France à Berlin pour favoriser une politique de rapprochement entre la France, l’Allemagne et la Russie, mais il refuse à cause de la position de l’Allemagne vis-à-vis de l’Alsace-Lorraine. En mars 1906, il est élu président de l’Union républicaine. Le 3 janvier 1909, il est réélu pour la troisième fois sénateur des Hautes-Pyrénées au premier tour de scrutin par 557 voix sur 673 votants. Dans le premier Cabinet Briand, constitué le 24 juillet 1909, Jean Dupuy revient au Gouvernement avec le portefeuille du Commerce et de l’Industrie. Le 2 novembre 1910, Aristide Briand remet sa démission. Le lendemain, désigné à nouveau par le président de la République, il constitue un ministère assez différent du précédent, dans lequel Jean Dupuy conserve cependant son poste. Quatre mois plus tard, après une campagne menée à propos d’une indemnité allouée à la N’Goko Sangha, Briand remet pour la seconde fois la démission de son Cabinet au président Fallières. Jean Dupuy retourne à son banc de sénateur. Le 24 mars 1911, il est élu vice-président du Sénat, par 142 voix sur 145 suffrages exprimés ; le 22 décembre, le Sénat nomme une Commission chargée d’étudier la cession par la France à l’Allemagne de 275 kilomètres carrés du Congo français. Jean Dupuy en est élu l’un des vice-présidents. Cette question entraîne la chute du Cabinet Caillaux. Le 14 janvier 1912, il est de nouveau ministre : Raymond Poincaré lui confie les Travaux publics et les PTT dans son premier ministère. À ce titre, Jean Dupuy demande une répression énergique des infractions aux règlements de la circulation automobile, pour que diminue le nombre des morts par accidents. En 1913, alors qu’il y était invité, Jean Dupuy refuse de se présenter aux élections présidentielles. Il a été un candidat potentiel à la présidence, en 1906 et en 1913. Poincaré étant élu président de la République le 17 janvier 1913, Briand est chargé de constituer son troisième ministère, dans lequel Jean Dupuy conserve les Travaux publics et les PTT. Trois mois plus tard, Briand remet sa démission et Louis Barthou forme un Cabinet dont Jean Dupuy ne fait pas partie. Il est réélu vice-président du Sénat le 17 juin 1913, par 166 voix sur 168 suffrages exprimés. Après la chute de ce Cabinet, Jean Dupuy est appelé par Poincaré à former le Gouvernement, mais il renonce après deux jours de consultations. Le 15 janvier 1914, il est encore élu vice-président du Sénat avec 126 voix sur 217 suffrages exprimés. Les élections générales législatives du 26 avril entraînent la démission du Cabinet Gaston Doumergue. Poincaré fait appel à Jean Dupuy pour le remplacer, mais ce dernier refuse. Ribot lui confie les Travaux publics dans son ministère du 9 juin 1914, qui n’eut que trois jours d’existence. Au début de la guerre mondiale, Jean Dupuy décide de rester à Paris malgré le départ du Gouvernement pour Bordeaux. En qualité de président du Comité des associations de la presse française, il demande au Sénat, le 5 août 1915, la réduction des droits de douane sur l’importation du papier journal. Le 15 octobre 1916, il écrit, à propos de l’ouverture de la souscription du deuxième emprunt de guerre : « Le capital gardé dans un bas de laine est non seulement stérile, mais coupable. » Inlassable, le directeur du Petit Parisien continue à mener de front toutes ses activités : le journal, l’usine, les Hautes-Pyrénées, les Commissions sénatoriales. Il devient propriétaire du journal Excelsior qui avait été fondé en 1910 par Sir Basil Zaharoff, mystérieux et célèbre fournisseur de guerre. Homme d’affaires, homme politique, homme d’État, Jean Dupuy fut avant tout un homme de journal. Sa phrase préférée était : « Pour réussir dans la vie, il suffit de travailler et de posséder la connaissance des hommes. » En 1917, Jean Dupuy avait alerté Clemenceau sur les douteux agissements de Paul Polo, qui se disait conseiller du commerce extérieur et avait monté une affaire de protection des marques d’origine. Cet escroc fut fusillé comme espion le 18 avril 1918. Le 17 septembre 1917, Poincaré confie à Paul Painlevé la mission de former un Gouvernement. Il conserve la plupart des ministres du précédent Cabinet et nomme cinq ministres d’État membres du Comité de guerre : Barthou, Bourgeois, Doumer, Franklin-Bouillon et Jean Dupuy. Ce ministère est renversé en novembre ; Jean Dupuy a été ministre pour la dernière fois. Foch et Clemenceau s’opposent, en avril 1919, sur les conditions de paix à imposer à l’Allemagne et Jean Dupuy, chargé par Poincaré de les réconcilier, ne pourra mener à bien cette tâche. Le 28 septembre, il participe à l’hommage rendu par la ville de Tarbes à son glorieux citoyen, le maréchal Foch. Il revient malade de sa campagne électorale. Sa vie s’achève le 31 décembre 1919, à Paris, à l’âge de 75 ans. Son éloge funèbre est prononcé le 13 janvier 1920 par M. Gustave Denis, président d’âge du Sénat : « Il ne recherchait pas les honneurs, mais il ne refusa jamais son nom et son influence quand il jugea qu’ils pouvaient être utiles à son pays et à la République. » « Il laissera au Sénat le souvenir d’un excellent collègue, tout dévoué à ses amis, dont la conversation pleine de charme était nourrie d’idées et de faits. Il représentait bien notre vieille race française, toute pétrie d’honneur, de loyauté, de vigoureux bon sens, de force de travail qui, après avoir étonné le monde par son allure magnifique pendant la guerre, ne l’étonnera pas moins par l’énergie qu’elle mettra, pendant la paix, à reconstruire sa maison dévastée. » Jean Dupuy fut vice-président du Sénat (1911-1919), président du comité général des associations de la presse française, président du syndicat de la presse parisienne (1897-1919), membre du conseil supérieur des haras, vice-président de la société nationale d’encouragement à l’agriculture, membre de l’académie d’agriculture, membre du comité supérieur de l’agriculture. Il était Commandeur du Mérite agricole, Grand-Croix de l’Ordre de l’Aigle blanc de Russie. En 1913, il lança la revue « La Science et la Vie », actuel « Science et Vie ». À son décès, Le Petit Parisien dépasse alors les deux millions d’exemplaires, ce qui constitue le plus fort tirage au monde de cette époque. Ses fils Pierre et Paul Dupuy ancien député des Hautes-Pyrénées, prendront sa succession à la tête du quotidien avant de créer d’autres groupes de presse. Il repose avec son fils, Pierre Dupuy (1876-1968) sous-secrétaire d’État à la marine marchande et député de la Gironde, et son beau-fils, le député François Arago (1862-1937) au cimetière du Père Lachaise. De son action politique, il reste un domaine toujours à l’honneur : c’est lui qui a lancé le projet permettant à un accusé d’être assisté d’un avocat, dès son arrestation. Le Lycée technique d’État de Tarbes porte le nom de Jean Dupuy, sénateur des Hautes-Pyrénées. Anciennement Grand Séminaire construit sous Napoléon III en 1850, est devenu l’École nationale professionnelle (ENP), suite à la loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905. Celle-ci est née d’une volonté départementale, municipale et industrielle. Il aura fallu toute l’opiniâtreté de Jean Dupuy, alors sénateur des Hautes-Pyrénées, pour obtenir de Raymond Poincaré, président de la République, qu’il signe l’arrêté de création de l’École nationale professionnelle de Tarbes, devenue ensuite Lycée technique Jean Dupuy. Elle verra le jour par la loi du 25 juillet 1914 signée à Stockholm par le président de la République de l’époque, Raymond Poincaré, qui se rendait en Russie. La première promotion ne sera accueillie seulement qu’en octobre 1925, en raison de la Première Guerre Mondiale. C’est le 21 novembre 1926 qu’est inaugurée l’École Nationale Professionnelle (ENP) Jean Dupuy. Raymond Poincaré et Édouard Herriot, ministre de l’Instruction publique font le déplacement à Tarbes. Pour cette occasion un buste avait été sculpté par Firmin Michelet. Sixième du genre, en France, elle n’existera donc officiellement qu’à partir de 1926. À l’époque le recrutement se faisait par un concours extrêmement sévère et le port de l’uniforme était obligatoire. Nombre d’ingénieurs, de techniciens, de professionnels dans des domaines divers et variés ont fait leur préparation dans l’établissement tarbais, qui se targue d’avoir la plus ancienne classe de préparation aux grandes écoles. Ainsi les bâtiments du lycée Jean Dupuy sont voués à l’enseignement public depuis 1926. Successivement ENP (École nationale professionnelle) spécialisée dans les métiers de l’industrie jusque dans les années 1960, puis lycée technique d’État, l’établissement se transforme en 2011 en Lycée polyvalent Jean Dupuy. Le samedi 25 janvier 2025 le lycée Jean Dupuy a célébré son 100e anniversaire, marquant un siècle d’histoire et d’éducation. L’établissement a accueilli entre 500 et 600 personnes pour cette occasion spéciale. Les plus anciens élèves ont découvert un établissement modernisé, qui a su rester à la pointe des technologies, mais sans oublier la tradition. Dans le cadre du programme de ce centenaire, et au-delà de la célébration, un événement majeur a eu lieu : l’inauguration du déplacement au cœur du site de la statue de Jean-Dupuy, à l’origine de l’établissement, qui a été dévoilée. Les anciens élèves de l’ENP et du LTE sont nos meilleurs ambassadeurs d’un enseignement d'excellence dispensé par des professeurs d’élite, passionnés et exigeants. Un livre couvrant la période entre 1925 et 1960, et comportant des documents, des photographies, des anecdotes, mais aussi des discours des directeurs et professeurs qui ont fait de l’ENP, une des plus prestigieuses de France, a été écrit et publié par Pierre Torrecillos, dont les fonds de culottes ont été usés à Jean Dupuy, de 1948 à 1952. Un exemplaire a été remis ce samedi 25 janvier 2025 à chaque participant du centenaire de l’ENP. Marcel Gendulphe, ancien élève (1960-63) et proviseur de l’établissement entre 1998 et 2005, est aujourd’hui le président de l’Association des anciens de l’ENP et du lycée Jean-Dupuy de Tarbes.
Jean DUPUY, né le 1er octobre 1844 à Saint-Palais en Gironde, et mort le 31 décembre 1919 à Paris, à l’âge de 75 ans. Après avoir essuyé un échec en Gironde en 1887, il se fait élire sénateur des Hautes-Pyrénées en 1891. D’origine modeste, fils de Jacques Dupuy, « sergier », mercier quelque peu colporteur et cultivateur, qui s’était marié le 7 septembre 1842 avec Magdeleine Thérèse, de l’hospice des enfants abandonnés de Bordeaux, domestique qui ne savait pas lire, Jean Dupuy va à l’école de Saint-Palais et complète son instruction auprès du curé et du maire. Puis il aide son père aux champs et au magasin. Un jour, il décide de ne plus jamais travailler la terre et entre, contre l’avis de ses parents, comme « saute-ruisseau » chez un huissier. En octobre 1865, il se rend à Paris avec son frère Charles et il travaille pendant plusieurs années chez un avoué. Il vit difficilement. Il a cependant beaucoup de succès auprès des clients de l’étude. En 1870, il est mobilisé dans la Garde nationale. Après la Commune, pendant laquelle il se lie d’amitié avec des révolutionnaires, il se marie avec Sophie-Alexandrine Legrand, fille de bourgeois aisés, exerçant la profession de doreurs dans le quartier du Marais. Avec ses économies et la dot de son épouse, il achète en 1873, une étude d’huissier rue d’Aboukir, qui lui ouvre les portes de la réussite. En décembre 1873 naît de ce mariage Marie Dupuy, qui épousera à 24 ans, François Arago, petit-fils du grand astronome. Jean Dupuy fait de son étude d’huissier la plus importante de Paris. Il est un conseiller d’affaires dont le jugement sûr est vite célèbre dans le monde des finances et du barreau. En 1879, il devient président du conseil de surveillance du Petit Parisien et à la mort de Paul Piégut, en 1888, le propriétaire-gérant directeur et seul actionnaire. Il renouvelle la formule du journal et sous son impulsion, ce journal atteindra le plus grand tirage du monde, atteignant 1 million d’exemplaires lors de l’affaire Dreyfus et qui ira jusqu’à 3 millions en 1918. Il était déjà propriétaire-directeur du Siècle depuis le 16 novembre 1887. Jean et Sophie Dupuy aiment beaucoup recevoir, et parmi leurs hôtes se trouvent Alexandre Ribot, Maurice Rouvier, René Waldeck-Rousseau, qui firent partie tous les trois, en 1881, du ministère Gambetta. À la fin de cette même année, Jean Dupuy cède son étude d’huissier à son frère aîné Charles, et ouvre en janvier 1882, au 16, rue de Gramont, un cabinet d’affaires. Il est élu sénateur des Hautes-Pyrénées le 4 janvier 1891, au premier tour de scrutin, par 401 voix sur 695 votants. Inscrit au groupe de la gauche républicaine, Jean Dupuy est combattu par les partis d’extrême gauche et d’extrême droite. Ce républicain, catholique de naissance, anticlérical de conviction, est amené à protéger Lourdes de toute sa puissance. Au Sénat, où l’avait d’ailleurs précédée sa solide réputation de travailleur, il fait partie de la plupart des Commissions : Finances, Marine, Algérie, etc. Il s’oppose le 14 mars 1891, sous la signature de Jean Frollo (pseudonyme collectif), dans son journal, à la suppression du régime de libre échange institué en 1860 entre la France et les autres pays, réclamée par Jules Méline, ministre de l’Agriculture dans le deuxième Cabinet Freycinet. Les membres du comité du syndicat de la presse, dont Jean Dupuy faisait partie depuis plusieurs années, l’appel lent à la présidence de ce syndicat et du comité général des associations de la presse. Ce mandat lui est confirmé pour quatre ans, en 1899, par l’assemblée générale des membres du syndicat. Comme rapporteur de la réforme de l’instruction criminelle, il prend une part décisive, en 1897, à l’établissement de l’instruction contradictoire. Pendant trois années consécutives, il rapporte le budget de l’Agriculture. Aussi, est-ce à ce ministère, dont il avait pu ainsi étudier tous les organes, qu’il fut appelé le 22 juin 1899, lors de la constitution du premier Cabinet Waldeck-Rousseau. Ce Gouvernement surprit la Chambre et l’opinion par sa composition, car il réunissait des républicains progressistes et des radicaux socialistes avec le général de Galliffet - surtout connu par sa répression sanglante de la Commune de 1871 et qui démissionna d’ailleurs le 30 mai 1900 - et le socialiste Alexandre Millerand. Comme ministre de l’Agriculture, Jean Dupuy a organisé définitivement le Crédit agricole et a créé l’Office des renseignements agricoles. Son nom restera surtout attaché au développement de l’usage de l’alcool industriel. Jean Dupuy, avec Millerand et Galliffet, encouragea Waldeck-Rousseau à demander la grâce de Dreyfus, qui fut signée par Émile Loubet le 20 septembre 1889. Le 28 janvier 1900, il est réélu sénateur des Hautes-Pyrénées au premier tour de scrutin par 552 voix sur 699 votants, malgré une protestation du lieutenant-colonel Monteil qui avait obtenu 95 voix, après une campagne électorale violente au cours de laquelle ses adversaires l’avaient accusé de pactiser avec les pires ennemis de la société. Le 20 avril, il inaugura le Palais de l’Horticulture de l’Exposition universelle. Le 11 juin 1900, il défend à la Chambre les producteurs français de blé au cours de la discussion d’un projet de loi concernant l’importation et l’exportation des blés et farines. Il fait primer la préférence nationale, ce qui constitue une inversion complète de ses précédentes prises de position doctrinale - à la fin des années 1880 - favorables aux thèses libre-échangistes. Au début de 1902, le tirage du Petit Parisien dépasse pour la première fois le million d’exemplaires. Un mois après les élections législatives d’avril 1902, Waldeck-Rousseau, fatigué, se démet avec son Cabinet. C’est la première fois qu’un ministère de la IIIe République se retire sans avoir été mis en minorité. Jean Dupuy attendra sept ans pour retrouver un portefeuille ministériel. Le Petit Parisien étrenne, le 4 avril 1904, un nouveau sous-titre : « Le plus fort tirage des journaux du monde entier ». Le 7 avril 1905, Jean Dupuy intervient au Sénat dans la discussion du budget de la Guerre et sur la répression de la fraude sur les vins. En mai et juin, il sert de négociateur officieux entre le Gouvernement français et l’ambassadeur d’Allemagne à Paris, sur l’affaire du Maroc. En juillet, le prince Hugo von Radolin, ambassadeur d’Allemagne en France, et le comte Witte, président du Conseil des ministres russe, demandent à Jean Dupuy d’être ambassadeur de France à Berlin pour favoriser une politique de rapprochement entre la France, l’Allemagne et la Russie, mais il refuse à cause de la position de l’Allemagne vis-à-vis de l’Alsace-Lorraine. En mars 1906, il est élu président de l’Union républicaine. Le 3 janvier 1909, il est réélu pour la troisième fois sénateur des Hautes-Pyrénées au premier tour de scrutin par 557 voix sur 673 votants. Dans le premier Cabinet Briand, constitué le 24 juillet 1909, Jean Dupuy revient au Gouvernement avec le portefeuille du Commerce et de l’Industrie. Le 2 novembre 1910, Aristide Briand remet sa démission. Le lendemain, désigné à nouveau par le président de la République, il constitue un ministère assez différent du précédent, dans lequel Jean Dupuy conserve cependant son poste. Quatre mois plus tard, après une campagne menée à propos d’une indemnité allouée à la N’Goko Sangha, Briand remet pour la seconde fois la démission de son Cabinet au président Fallières. Jean Dupuy retourne à son banc de sénateur. Le 24 mars 1911, il est élu vice-président du Sénat, par 142 voix sur 145 suffrages exprimés ; le 22 décembre, le Sénat nomme une Commission chargée d’étudier la cession par la France à l’Allemagne de 275 kilomètres carrés du Congo français. Jean Dupuy en est élu l’un des vice-présidents. Cette question entraîne la chute du Cabinet Caillaux. Le 14 janvier 1912, il est de nouveau ministre : Raymond Poincaré lui confie les Travaux publics et les PTT dans son premier ministère. À ce titre, Jean Dupuy demande une répression énergique des infractions aux règlements de la circulation automobile, pour que diminue le nombre des morts par accidents. En 1913, alors qu’il y était invité, Jean Dupuy refuse de se présenter aux élections présidentielles. Il a été un candidat potentiel à la présidence, en 1906 et en 1913. Poincaré étant élu président de la République le 17 janvier 1913, Briand est chargé de constituer son troisième ministère, dans lequel Jean Dupuy conserve les Travaux publics et les PTT. Trois mois plus tard, Briand remet sa démission et Louis Barthou forme un Cabinet dont Jean Dupuy ne fait pas partie. Il est réélu vice-président du Sénat le 17 juin 1913, par 166 voix sur 168 suffrages exprimés. Après la chute de ce Cabinet, Jean Dupuy est appelé par Poincaré à former le Gouvernement, mais il renonce après deux jours de consultations. Le 15 janvier 1914, il est encore élu vice-président du Sénat avec 126 voix sur 217 suffrages exprimés. Les élections générales législatives du 26 avril entraînent la démission du Cabinet Gaston Doumergue. Poincaré fait appel à Jean Dupuy pour le remplacer, mais ce dernier refuse. Ribot lui confie les Travaux publics dans son ministère du 9 juin 1914, qui n’eut que trois jours d’existence. Au début de la guerre mondiale, Jean Dupuy décide de rester à Paris malgré le départ du Gouvernement pour Bordeaux. En qualité de président du Comité des associations de la presse française, il demande au Sénat, le 5 août 1915, la réduction des droits de douane sur l’importation du papier journal. Le 15 octobre 1916, il écrit, à propos de l’ouverture de la souscription du deuxième emprunt de guerre : « Le capital gardé dans un bas de laine est non seulement stérile, mais coupable. » Inlassable, le directeur du Petit Parisien continue à mener de front toutes ses activités : le journal, l’usine, les Hautes-Pyrénées, les Commissions sénatoriales. Il devient propriétaire du journal Excelsior qui avait été fondé en 1910 par Sir Basil Zaharoff, mystérieux et célèbre fournisseur de guerre. Homme d’affaires, homme politique, homme d’État, Jean Dupuy fut avant tout un homme de journal. Sa phrase préférée était : « Pour réussir dans la vie, il suffit de travailler et de posséder la connaissance des hommes. » En 1917, Jean Dupuy avait alerté Clemenceau sur les douteux agissements de Paul Polo, qui se disait conseiller du commerce extérieur et avait monté une affaire de protection des marques d’origine. Cet escroc fut fusillé comme espion le 18 avril 1918. Le 17 septembre 1917, Poincaré confie à Paul Painlevé la mission de former un Gouvernement. Il conserve la plupart des ministres du précédent Cabinet et nomme cinq ministres d’État membres du Comité de guerre : Barthou, Bourgeois, Doumer, Franklin-Bouillon et Jean Dupuy. Ce ministère est renversé en novembre ; Jean Dupuy a été ministre pour la dernière fois. Foch et Clemenceau s’opposent, en avril 1919, sur les conditions de paix à imposer à l’Allemagne et Jean Dupuy, chargé par Poincaré de les réconcilier, ne pourra mener à bien cette tâche. Le 28 septembre, il participe à l’hommage rendu par la ville de Tarbes à son glorieux citoyen, le maréchal Foch. Il revient malade de sa campagne électorale. Sa vie s’achève le 31 décembre 1919, à Paris, à l’âge de 75 ans. Son éloge funèbre est prononcé le 13 janvier 1920 par M. Gustave Denis, président d’âge du Sénat : « Il ne recherchait pas les honneurs, mais il ne refusa jamais son nom et son influence quand il jugea qu’ils pouvaient être utiles à son pays et à la République. » « Il laissera au Sénat le souvenir d’un excellent collègue, tout dévoué à ses amis, dont la conversation pleine de charme était nourrie d’idées et de faits. Il représentait bien notre vieille race française, toute pétrie d’honneur, de loyauté, de vigoureux bon sens, de force de travail qui, après avoir étonné le monde par son allure magnifique pendant la guerre, ne l’étonnera pas moins par l’énergie qu’elle mettra, pendant la paix, à reconstruire sa maison dévastée. » Jean Dupuy fut vice-président du Sénat (1911-1919), président du comité général des associations de la presse française, président du syndicat de la presse parisienne (1897-1919), membre du conseil supérieur des haras, vice-président de la société nationale d’encouragement à l’agriculture, membre de l’académie d’agriculture, membre du comité supérieur de l’agriculture. Il était Commandeur du Mérite agricole, Grand-Croix de l’Ordre de l’Aigle blanc de Russie. En 1913, il lança la revue « La Science et la Vie », actuel « Science et Vie ». À son décès, Le Petit Parisien dépasse alors les deux millions d’exemplaires, ce qui constitue le plus fort tirage au monde de cette époque. Ses fils Pierre et Paul Dupuy ancien député des Hautes-Pyrénées, prendront sa succession à la tête du quotidien avant de créer d’autres groupes de presse. Il repose avec son fils, Pierre Dupuy (1876-1968) sous-secrétaire d’État à la marine marchande et député de la Gironde, et son beau-fils, le député François Arago (1862-1937) au cimetière du Père Lachaise. De son action politique, il reste un domaine toujours à l’honneur : c’est lui qui a lancé le projet permettant à un accusé d’être assisté d’un avocat, dès son arrestation. Le Lycée technique d’État de Tarbes porte le nom de Jean Dupuy, sénateur des Hautes-Pyrénées. Anciennement Grand Séminaire construit sous Napoléon III en 1850, est devenu l’École nationale professionnelle (ENP), suite à la loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905. Celle-ci est née d’une volonté départementale, municipale et industrielle. Il aura fallu toute l’opiniâtreté de Jean Dupuy, alors sénateur des Hautes-Pyrénées, pour obtenir de Raymond Poincaré, président de la République, qu’il signe l’arrêté de création de l’École nationale professionnelle de Tarbes, devenue ensuite Lycée technique Jean Dupuy. Elle verra le jour par la loi du 25 juillet 1914 signée à Stockholm par le président de la République de l’époque, Raymond Poincaré, qui se rendait en Russie. La première promotion ne sera accueillie seulement qu’en octobre 1925, en raison de la Première Guerre Mondiale. C’est le 21 novembre 1926 qu’est inaugurée l’École Nationale Professionnelle (ENP) Jean Dupuy. Raymond Poincaré et Édouard Herriot, ministre de l’Instruction publique font le déplacement à Tarbes. Pour cette occasion un buste avait été sculpté par Firmin Michelet. Sixième du genre, en France, elle n’existera donc officiellement qu’à partir de 1926. À l’époque le recrutement se faisait par un concours extrêmement sévère et le port de l’uniforme était obligatoire. Nombre d’ingénieurs, de techniciens, de professionnels dans des domaines divers et variés ont fait leur préparation dans l’établissement tarbais, qui se targue d’avoir la plus ancienne classe de préparation aux grandes écoles. Ainsi les bâtiments du lycée Jean Dupuy sont voués à l’enseignement public depuis 1926. Successivement ENP (École nationale professionnelle) spécialisée dans les métiers de l’industrie jusque dans les années 1960, puis lycée technique d’État, l’établissement se transforme en 2011 en Lycée polyvalent Jean Dupuy. Le samedi 25 janvier 2025 le lycée Jean Dupuy a célébré son 100e anniversaire, marquant un siècle d’histoire et d’éducation. L’établissement a accueilli entre 500 et 600 personnes pour cette occasion spéciale. Les plus anciens élèves ont découvert un établissement modernisé, qui a su rester à la pointe des technologies, mais sans oublier la tradition. Dans le cadre du programme de ce centenaire, et au-delà de la célébration, un événement majeur a eu lieu : l’inauguration du déplacement au cœur du site de la statue de Jean-Dupuy, à l’origine de l’établissement, qui a été dévoilée. Les anciens élèves de l’ENP et du LTE sont nos meilleurs ambassadeurs d’un enseignement d'excellence dispensé par des professeurs d’élite, passionnés et exigeants. Un livre couvrant la période entre 1925 et 1960, et comportant des documents, des photographies, des anecdotes, mais aussi des discours des directeurs et professeurs qui ont fait de l’ENP, une des plus prestigieuses de France, a été écrit et publié par Pierre Torrecillos, dont les fonds de culottes ont été usés à Jean Dupuy, de 1948 à 1952. Un exemplaire a été remis ce samedi 25 janvier 2025 à chaque participant du centenaire de l’ENP. Marcel Gendulphe, ancien élève (1960-63) et proviseur de l’établissement entre 1998 et 2005, est aujourd’hui le président de l’Association des anciens de l’ENP et du lycée Jean-Dupuy de Tarbes.
 Jean DUPUY, né le 1er octobre 1844 à Saint-Palais en Gironde, et mort le 31 décembre 1919 à Paris, à l’âge de 75 ans. Après avoir essuyé un échec en Gironde en 1887, il se fait élire sénateur des Hautes-Pyrénées en 1891. D’origine modeste, fils de Jacques Dupuy, « sergier », mercier quelque peu colporteur et cultivateur, qui s’était marié le 7 septembre 1842 avec Magdeleine Thérèse, de l’hospice des enfants abandonnés de Bordeaux, domestique qui ne savait pas lire, Jean Dupuy va à l’école de Saint-Palais et complète son instruction auprès du curé et du maire. Puis il aide son père aux champs et au magasin. Un jour, il décide de ne plus jamais travailler la terre et entre, contre l’avis de ses parents, comme « saute-ruisseau » chez un huissier. En octobre 1865, il se rend à Paris avec son frère Charles et il travaille pendant plusieurs années chez un avoué. Il vit difficilement. Il a cependant beaucoup de succès auprès des clients de l’étude. En 1870, il est mobilisé dans la Garde nationale. Après la Commune, pendant laquelle il se lie d’amitié avec des révolutionnaires, il se marie avec Sophie-Alexandrine Legrand, fille de bourgeois aisés, exerçant la profession de doreurs dans le quartier du Marais. Avec ses économies et la dot de son épouse, il achète en 1873, une étude d’huissier rue d’Aboukir, qui lui ouvre les portes de la réussite. En décembre 1873 naît de ce mariage Marie Dupuy, qui épousera à 24 ans, François Arago, petit-fils du grand astronome. Jean Dupuy fait de son étude d’huissier la plus importante de Paris. Il est un conseiller d’affaires dont le jugement sûr est vite célèbre dans le monde des finances et du barreau. En 1879, il devient président du conseil de surveillance du Petit Parisien et à la mort de Paul Piégut, en 1888, le propriétaire-gérant directeur et seul actionnaire. Il renouvelle la formule du journal et sous son impulsion, ce journal atteindra le plus grand tirage du monde, atteignant 1 million d’exemplaires lors de l’affaire Dreyfus et qui ira jusqu’à 3 millions en 1918. Il était déjà propriétaire-directeur du Siècle depuis le 16 novembre 1887. Jean et Sophie Dupuy aiment beaucoup recevoir, et parmi leurs hôtes se trouvent Alexandre Ribot, Maurice Rouvier, René Waldeck-Rousseau, qui firent partie tous les trois, en 1881, du ministère Gambetta. À la fin de cette même année, Jean Dupuy cède son étude d’huissier à son frère aîné Charles, et ouvre en janvier 1882, au 16, rue de Gramont, un cabinet d’affaires. Il est élu sénateur des Hautes-Pyrénées le 4 janvier 1891, au premier tour de scrutin, par 401 voix sur 695 votants. Inscrit au groupe de la gauche républicaine, Jean Dupuy est combattu par les partis d’extrême gauche et d’extrême droite. Ce républicain, catholique de naissance, anticlérical de conviction, est amené à protéger Lourdes de toute sa puissance. Au Sénat, où l’avait d’ailleurs précédée sa solide réputation de travailleur, il fait partie de la plupart des Commissions : Finances, Marine, Algérie, etc. Il s’oppose le 14 mars 1891, sous la signature de Jean Frollo (pseudonyme collectif), dans son journal, à la suppression du régime de libre échange institué en 1860 entre la France et les autres pays, réclamée par Jules Méline, ministre de l’Agriculture dans le deuxième Cabinet Freycinet. Les membres du comité du syndicat de la presse, dont Jean Dupuy faisait partie depuis plusieurs années, l’appel lent à la présidence de ce syndicat et du comité général des associations de la presse. Ce mandat lui est confirmé pour quatre ans, en 1899, par l’assemblée générale des membres du syndicat. Comme rapporteur de la réforme de l’instruction criminelle, il prend une part décisive, en 1897, à l’établissement de l’instruction contradictoire. Pendant trois années consécutives, il rapporte le budget de l’Agriculture. Aussi, est-ce à ce ministère, dont il avait pu ainsi étudier tous les organes, qu’il fut appelé le 22 juin 1899, lors de la constitution du premier Cabinet Waldeck-Rousseau. Ce Gouvernement surprit la Chambre et l’opinion par sa composition, car il réunissait des républicains progressistes et des radicaux socialistes avec le général de Galliffet - surtout connu par sa répression sanglante de la Commune de 1871 et qui démissionna d’ailleurs le 30 mai 1900 - et le socialiste Alexandre Millerand. Comme ministre de l’Agriculture, Jean Dupuy a organisé définitivement le Crédit agricole et a créé l’Office des renseignements agricoles. Son nom restera surtout attaché au développement de l’usage de l’alcool industriel. Jean Dupuy, avec Millerand et Galliffet, encouragea Waldeck-Rousseau à demander la grâce de Dreyfus, qui fut signée par Émile Loubet le 20 septembre 1889. Le 28 janvier 1900, il est réélu sénateur des Hautes-Pyrénées au premier tour de scrutin par 552 voix sur 699 votants, malgré une protestation du lieutenant-colonel Monteil qui avait obtenu 95 voix, après une campagne électorale violente au cours de laquelle ses adversaires l’avaient accusé de pactiser avec les pires ennemis de la société. Le 20 avril, il inaugura le Palais de l’Horticulture de l’Exposition universelle. Le 11 juin 1900, il défend à la Chambre les producteurs français de blé au cours de la discussion d’un projet de loi concernant l’importation et l’exportation des blés et farines. Il fait primer la préférence nationale, ce qui constitue une inversion complète de ses précédentes prises de position doctrinale - à la fin des années 1880 - favorables aux thèses libre-échangistes. Au début de 1902, le tirage du Petit Parisien dépasse pour la première fois le million d’exemplaires. Un mois après les élections législatives d’avril 1902, Waldeck-Rousseau, fatigué, se démet avec son Cabinet. C’est la première fois qu’un ministère de la IIIe République se retire sans avoir été mis en minorité. Jean Dupuy attendra sept ans pour retrouver un portefeuille ministériel. Le Petit Parisien étrenne, le 4 avril 1904, un nouveau sous-titre : « Le plus fort tirage des journaux du monde entier ». Le 7 avril 1905, Jean Dupuy intervient au Sénat dans la discussion du budget de la Guerre et sur la répression de la fraude sur les vins. En mai et juin, il sert de négociateur officieux entre le Gouvernement français et l’ambassadeur d’Allemagne à Paris, sur l’affaire du Maroc. En juillet, le prince Hugo von Radolin, ambassadeur d’Allemagne en France, et le comte Witte, président du Conseil des ministres russe, demandent à Jean Dupuy d’être ambassadeur de France à Berlin pour favoriser une politique de rapprochement entre la France, l’Allemagne et la Russie, mais il refuse à cause de la position de l’Allemagne vis-à-vis de l’Alsace-Lorraine. En mars 1906, il est élu président de l’Union républicaine. Le 3 janvier 1909, il est réélu pour la troisième fois sénateur des Hautes-Pyrénées au premier tour de scrutin par 557 voix sur 673 votants. Dans le premier Cabinet Briand, constitué le 24 juillet 1909, Jean Dupuy revient au Gouvernement avec le portefeuille du Commerce et de l’Industrie. Le 2 novembre 1910, Aristide Briand remet sa démission. Le lendemain, désigné à nouveau par le président de la République, il constitue un ministère assez différent du précédent, dans lequel Jean Dupuy conserve cependant son poste. Quatre mois plus tard, après une campagne menée à propos d’une indemnité allouée à la N’Goko Sangha, Briand remet pour la seconde fois la démission de son Cabinet au président Fallières. Jean Dupuy retourne à son banc de sénateur. Le 24 mars 1911, il est élu vice-président du Sénat, par 142 voix sur 145 suffrages exprimés ; le 22 décembre, le Sénat nomme une Commission chargée d’étudier la cession par la France à l’Allemagne de 275 kilomètres carrés du Congo français. Jean Dupuy en est élu l’un des vice-présidents. Cette question entraîne la chute du Cabinet Caillaux. Le 14 janvier 1912, il est de nouveau ministre : Raymond Poincaré lui confie les Travaux publics et les PTT dans son premier ministère. À ce titre, Jean Dupuy demande une répression énergique des infractions aux règlements de la circulation automobile, pour que diminue le nombre des morts par accidents. En 1913, alors qu’il y était invité, Jean Dupuy refuse de se présenter aux élections présidentielles. Il a été un candidat potentiel à la présidence, en 1906 et en 1913. Poincaré étant élu président de la République le 17 janvier 1913, Briand est chargé de constituer son troisième ministère, dans lequel Jean Dupuy conserve les Travaux publics et les PTT. Trois mois plus tard, Briand remet sa démission et Louis Barthou forme un Cabinet dont Jean Dupuy ne fait pas partie. Il est réélu vice-président du Sénat le 17 juin 1913, par 166 voix sur 168 suffrages exprimés. Après la chute de ce Cabinet, Jean Dupuy est appelé par Poincaré à former le Gouvernement, mais il renonce après deux jours de consultations. Le 15 janvier 1914, il est encore élu vice-président du Sénat avec 126 voix sur 217 suffrages exprimés. Les élections générales législatives du 26 avril entraînent la démission du Cabinet Gaston Doumergue. Poincaré fait appel à Jean Dupuy pour le remplacer, mais ce dernier refuse. Ribot lui confie les Travaux publics dans son ministère du 9 juin 1914, qui n’eut que trois jours d’existence. Au début de la guerre mondiale, Jean Dupuy décide de rester à Paris malgré le départ du Gouvernement pour Bordeaux. En qualité de président du Comité des associations de la presse française, il demande au Sénat, le 5 août 1915, la réduction des droits de douane sur l’importation du papier journal. Le 15 octobre 1916, il écrit, à propos de l’ouverture de la souscription du deuxième emprunt de guerre : « Le capital gardé dans un bas de laine est non seulement stérile, mais coupable. » Inlassable, le directeur du Petit Parisien continue à mener de front toutes ses activités : le journal, l’usine, les Hautes-Pyrénées, les Commissions sénatoriales. Il devient propriétaire du journal Excelsior qui avait été fondé en 1910 par Sir Basil Zaharoff, mystérieux et célèbre fournisseur de guerre. Homme d’affaires, homme politique, homme d’État, Jean Dupuy fut avant tout un homme de journal. Sa phrase préférée était : « Pour réussir dans la vie, il suffit de travailler et de posséder la connaissance des hommes. » En 1917, Jean Dupuy avait alerté Clemenceau sur les douteux agissements de Paul Polo, qui se disait conseiller du commerce extérieur et avait monté une affaire de protection des marques d’origine. Cet escroc fut fusillé comme espion le 18 avril 1918. Le 17 septembre 1917, Poincaré confie à Paul Painlevé la mission de former un Gouvernement. Il conserve la plupart des ministres du précédent Cabinet et nomme cinq ministres d’État membres du Comité de guerre : Barthou, Bourgeois, Doumer, Franklin-Bouillon et Jean Dupuy. Ce ministère est renversé en novembre ; Jean Dupuy a été ministre pour la dernière fois. Foch et Clemenceau s’opposent, en avril 1919, sur les conditions de paix à imposer à l’Allemagne et Jean Dupuy, chargé par Poincaré de les réconcilier, ne pourra mener à bien cette tâche. Le 28 septembre, il participe à l’hommage rendu par la ville de Tarbes à son glorieux citoyen, le maréchal Foch. Il revient malade de sa campagne électorale. Sa vie s’achève le 31 décembre 1919, à Paris, à l’âge de 75 ans. Son éloge funèbre est prononcé le 13 janvier 1920 par M. Gustave Denis, président d’âge du Sénat : « Il ne recherchait pas les honneurs, mais il ne refusa jamais son nom et son influence quand il jugea qu’ils pouvaient être utiles à son pays et à la République. » « Il laissera au Sénat le souvenir d’un excellent collègue, tout dévoué à ses amis, dont la conversation pleine de charme était nourrie d’idées et de faits. Il représentait bien notre vieille race française, toute pétrie d’honneur, de loyauté, de vigoureux bon sens, de force de travail qui, après avoir étonné le monde par son allure magnifique pendant la guerre, ne l’étonnera pas moins par l’énergie qu’elle mettra, pendant la paix, à reconstruire sa maison dévastée. » Jean Dupuy fut vice-président du Sénat (1911-1919), président du comité général des associations de la presse française, président du syndicat de la presse parisienne (1897-1919), membre du conseil supérieur des haras, vice-président de la société nationale d’encouragement à l’agriculture, membre de l’académie d’agriculture, membre du comité supérieur de l’agriculture. Il était Commandeur du Mérite agricole, Grand-Croix de l’Ordre de l’Aigle blanc de Russie. En 1913, il lança la revue « La Science et la Vie », actuel « Science et Vie ». À son décès, Le Petit Parisien dépasse alors les deux millions d’exemplaires, ce qui constitue le plus fort tirage au monde de cette époque. Ses fils Pierre et Paul Dupuy ancien député des Hautes-Pyrénées, prendront sa succession à la tête du quotidien avant de créer d’autres groupes de presse. Il repose avec son fils, Pierre Dupuy (1876-1968) sous-secrétaire d’État à la marine marchande et député de la Gironde, et son beau-fils, le député François Arago (1862-1937) au cimetière du Père Lachaise. De son action politique, il reste un domaine toujours à l’honneur : c’est lui qui a lancé le projet permettant à un accusé d’être assisté d’un avocat, dès son arrestation. Le Lycée technique d’État de Tarbes porte le nom de Jean Dupuy, sénateur des Hautes-Pyrénées. Anciennement Grand Séminaire construit sous Napoléon III en 1850, est devenu l’École nationale professionnelle (ENP), suite à la loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905. Celle-ci est née d’une volonté départementale, municipale et industrielle. Il aura fallu toute l’opiniâtreté de Jean Dupuy, alors sénateur des Hautes-Pyrénées, pour obtenir de Raymond Poincaré, président de la République, qu’il signe l’arrêté de création de l’École nationale professionnelle de Tarbes, devenue ensuite Lycée technique Jean Dupuy. Elle verra le jour par la loi du 25 juillet 1914 signée à Stockholm par le président de la République de l’époque, Raymond Poincaré, qui se rendait en Russie. La première promotion ne sera accueillie seulement qu’en octobre 1925, en raison de la Première Guerre Mondiale. C’est le 21 novembre 1926 qu’est inaugurée l’École Nationale Professionnelle (ENP) Jean Dupuy. Raymond Poincaré et Édouard Herriot, ministre de l’Instruction publique font le déplacement à Tarbes. Pour cette occasion un buste avait été sculpté par Firmin Michelet. Sixième du genre, en France, elle n’existera donc officiellement qu’à partir de 1926. À l’époque le recrutement se faisait par un concours extrêmement sévère et le port de l’uniforme était obligatoire. Nombre d’ingénieurs, de techniciens, de professionnels dans des domaines divers et variés ont fait leur préparation dans l’établissement tarbais, qui se targue d’avoir la plus ancienne classe de préparation aux grandes écoles. Ainsi les bâtiments du lycée Jean Dupuy sont voués à l’enseignement public depuis 1926. Successivement ENP (École nationale professionnelle) spécialisée dans les métiers de l’industrie jusque dans les années 1960, puis lycée technique d’État, l’établissement se transforme en 2011 en Lycée polyvalent Jean Dupuy. Le samedi 25 janvier 2025 le lycée Jean Dupuy a célébré son 100e anniversaire, marquant un siècle d’histoire et d’éducation. L’établissement a accueilli entre 500 et 600 personnes pour cette occasion spéciale. Les plus anciens élèves ont découvert un établissement modernisé, qui a su rester à la pointe des technologies, mais sans oublier la tradition. Dans le cadre du programme de ce centenaire, et au-delà de la célébration, un événement majeur a eu lieu : l’inauguration du déplacement au cœur du site de la statue de Jean-Dupuy, à l’origine de l’établissement, qui a été dévoilée. Les anciens élèves de l’ENP et du LTE sont nos meilleurs ambassadeurs d’un enseignement d'excellence dispensé par des professeurs d’élite, passionnés et exigeants. Un livre couvrant la période entre 1925 et 1960, et comportant des documents, des photographies, des anecdotes, mais aussi des discours des directeurs et professeurs qui ont fait de l’ENP, une des plus prestigieuses de France, a été écrit et publié par Pierre Torrecillos, dont les fonds de culottes ont été usés à Jean Dupuy, de 1948 à 1952. Un exemplaire a été remis ce samedi 25 janvier 2025 à chaque participant du centenaire de l’ENP. Marcel Gendulphe, ancien élève (1960-63) et proviseur de l’établissement entre 1998 et 2005, est aujourd’hui le président de l’Association des anciens de l’ENP et du lycée Jean-Dupuy de Tarbes.
Jean DUPUY, né le 1er octobre 1844 à Saint-Palais en Gironde, et mort le 31 décembre 1919 à Paris, à l’âge de 75 ans. Après avoir essuyé un échec en Gironde en 1887, il se fait élire sénateur des Hautes-Pyrénées en 1891. D’origine modeste, fils de Jacques Dupuy, « sergier », mercier quelque peu colporteur et cultivateur, qui s’était marié le 7 septembre 1842 avec Magdeleine Thérèse, de l’hospice des enfants abandonnés de Bordeaux, domestique qui ne savait pas lire, Jean Dupuy va à l’école de Saint-Palais et complète son instruction auprès du curé et du maire. Puis il aide son père aux champs et au magasin. Un jour, il décide de ne plus jamais travailler la terre et entre, contre l’avis de ses parents, comme « saute-ruisseau » chez un huissier. En octobre 1865, il se rend à Paris avec son frère Charles et il travaille pendant plusieurs années chez un avoué. Il vit difficilement. Il a cependant beaucoup de succès auprès des clients de l’étude. En 1870, il est mobilisé dans la Garde nationale. Après la Commune, pendant laquelle il se lie d’amitié avec des révolutionnaires, il se marie avec Sophie-Alexandrine Legrand, fille de bourgeois aisés, exerçant la profession de doreurs dans le quartier du Marais. Avec ses économies et la dot de son épouse, il achète en 1873, une étude d’huissier rue d’Aboukir, qui lui ouvre les portes de la réussite. En décembre 1873 naît de ce mariage Marie Dupuy, qui épousera à 24 ans, François Arago, petit-fils du grand astronome. Jean Dupuy fait de son étude d’huissier la plus importante de Paris. Il est un conseiller d’affaires dont le jugement sûr est vite célèbre dans le monde des finances et du barreau. En 1879, il devient président du conseil de surveillance du Petit Parisien et à la mort de Paul Piégut, en 1888, le propriétaire-gérant directeur et seul actionnaire. Il renouvelle la formule du journal et sous son impulsion, ce journal atteindra le plus grand tirage du monde, atteignant 1 million d’exemplaires lors de l’affaire Dreyfus et qui ira jusqu’à 3 millions en 1918. Il était déjà propriétaire-directeur du Siècle depuis le 16 novembre 1887. Jean et Sophie Dupuy aiment beaucoup recevoir, et parmi leurs hôtes se trouvent Alexandre Ribot, Maurice Rouvier, René Waldeck-Rousseau, qui firent partie tous les trois, en 1881, du ministère Gambetta. À la fin de cette même année, Jean Dupuy cède son étude d’huissier à son frère aîné Charles, et ouvre en janvier 1882, au 16, rue de Gramont, un cabinet d’affaires. Il est élu sénateur des Hautes-Pyrénées le 4 janvier 1891, au premier tour de scrutin, par 401 voix sur 695 votants. Inscrit au groupe de la gauche républicaine, Jean Dupuy est combattu par les partis d’extrême gauche et d’extrême droite. Ce républicain, catholique de naissance, anticlérical de conviction, est amené à protéger Lourdes de toute sa puissance. Au Sénat, où l’avait d’ailleurs précédée sa solide réputation de travailleur, il fait partie de la plupart des Commissions : Finances, Marine, Algérie, etc. Il s’oppose le 14 mars 1891, sous la signature de Jean Frollo (pseudonyme collectif), dans son journal, à la suppression du régime de libre échange institué en 1860 entre la France et les autres pays, réclamée par Jules Méline, ministre de l’Agriculture dans le deuxième Cabinet Freycinet. Les membres du comité du syndicat de la presse, dont Jean Dupuy faisait partie depuis plusieurs années, l’appel lent à la présidence de ce syndicat et du comité général des associations de la presse. Ce mandat lui est confirmé pour quatre ans, en 1899, par l’assemblée générale des membres du syndicat. Comme rapporteur de la réforme de l’instruction criminelle, il prend une part décisive, en 1897, à l’établissement de l’instruction contradictoire. Pendant trois années consécutives, il rapporte le budget de l’Agriculture. Aussi, est-ce à ce ministère, dont il avait pu ainsi étudier tous les organes, qu’il fut appelé le 22 juin 1899, lors de la constitution du premier Cabinet Waldeck-Rousseau. Ce Gouvernement surprit la Chambre et l’opinion par sa composition, car il réunissait des républicains progressistes et des radicaux socialistes avec le général de Galliffet - surtout connu par sa répression sanglante de la Commune de 1871 et qui démissionna d’ailleurs le 30 mai 1900 - et le socialiste Alexandre Millerand. Comme ministre de l’Agriculture, Jean Dupuy a organisé définitivement le Crédit agricole et a créé l’Office des renseignements agricoles. Son nom restera surtout attaché au développement de l’usage de l’alcool industriel. Jean Dupuy, avec Millerand et Galliffet, encouragea Waldeck-Rousseau à demander la grâce de Dreyfus, qui fut signée par Émile Loubet le 20 septembre 1889. Le 28 janvier 1900, il est réélu sénateur des Hautes-Pyrénées au premier tour de scrutin par 552 voix sur 699 votants, malgré une protestation du lieutenant-colonel Monteil qui avait obtenu 95 voix, après une campagne électorale violente au cours de laquelle ses adversaires l’avaient accusé de pactiser avec les pires ennemis de la société. Le 20 avril, il inaugura le Palais de l’Horticulture de l’Exposition universelle. Le 11 juin 1900, il défend à la Chambre les producteurs français de blé au cours de la discussion d’un projet de loi concernant l’importation et l’exportation des blés et farines. Il fait primer la préférence nationale, ce qui constitue une inversion complète de ses précédentes prises de position doctrinale - à la fin des années 1880 - favorables aux thèses libre-échangistes. Au début de 1902, le tirage du Petit Parisien dépasse pour la première fois le million d’exemplaires. Un mois après les élections législatives d’avril 1902, Waldeck-Rousseau, fatigué, se démet avec son Cabinet. C’est la première fois qu’un ministère de la IIIe République se retire sans avoir été mis en minorité. Jean Dupuy attendra sept ans pour retrouver un portefeuille ministériel. Le Petit Parisien étrenne, le 4 avril 1904, un nouveau sous-titre : « Le plus fort tirage des journaux du monde entier ». Le 7 avril 1905, Jean Dupuy intervient au Sénat dans la discussion du budget de la Guerre et sur la répression de la fraude sur les vins. En mai et juin, il sert de négociateur officieux entre le Gouvernement français et l’ambassadeur d’Allemagne à Paris, sur l’affaire du Maroc. En juillet, le prince Hugo von Radolin, ambassadeur d’Allemagne en France, et le comte Witte, président du Conseil des ministres russe, demandent à Jean Dupuy d’être ambassadeur de France à Berlin pour favoriser une politique de rapprochement entre la France, l’Allemagne et la Russie, mais il refuse à cause de la position de l’Allemagne vis-à-vis de l’Alsace-Lorraine. En mars 1906, il est élu président de l’Union républicaine. Le 3 janvier 1909, il est réélu pour la troisième fois sénateur des Hautes-Pyrénées au premier tour de scrutin par 557 voix sur 673 votants. Dans le premier Cabinet Briand, constitué le 24 juillet 1909, Jean Dupuy revient au Gouvernement avec le portefeuille du Commerce et de l’Industrie. Le 2 novembre 1910, Aristide Briand remet sa démission. Le lendemain, désigné à nouveau par le président de la République, il constitue un ministère assez différent du précédent, dans lequel Jean Dupuy conserve cependant son poste. Quatre mois plus tard, après une campagne menée à propos d’une indemnité allouée à la N’Goko Sangha, Briand remet pour la seconde fois la démission de son Cabinet au président Fallières. Jean Dupuy retourne à son banc de sénateur. Le 24 mars 1911, il est élu vice-président du Sénat, par 142 voix sur 145 suffrages exprimés ; le 22 décembre, le Sénat nomme une Commission chargée d’étudier la cession par la France à l’Allemagne de 275 kilomètres carrés du Congo français. Jean Dupuy en est élu l’un des vice-présidents. Cette question entraîne la chute du Cabinet Caillaux. Le 14 janvier 1912, il est de nouveau ministre : Raymond Poincaré lui confie les Travaux publics et les PTT dans son premier ministère. À ce titre, Jean Dupuy demande une répression énergique des infractions aux règlements de la circulation automobile, pour que diminue le nombre des morts par accidents. En 1913, alors qu’il y était invité, Jean Dupuy refuse de se présenter aux élections présidentielles. Il a été un candidat potentiel à la présidence, en 1906 et en 1913. Poincaré étant élu président de la République le 17 janvier 1913, Briand est chargé de constituer son troisième ministère, dans lequel Jean Dupuy conserve les Travaux publics et les PTT. Trois mois plus tard, Briand remet sa démission et Louis Barthou forme un Cabinet dont Jean Dupuy ne fait pas partie. Il est réélu vice-président du Sénat le 17 juin 1913, par 166 voix sur 168 suffrages exprimés. Après la chute de ce Cabinet, Jean Dupuy est appelé par Poincaré à former le Gouvernement, mais il renonce après deux jours de consultations. Le 15 janvier 1914, il est encore élu vice-président du Sénat avec 126 voix sur 217 suffrages exprimés. Les élections générales législatives du 26 avril entraînent la démission du Cabinet Gaston Doumergue. Poincaré fait appel à Jean Dupuy pour le remplacer, mais ce dernier refuse. Ribot lui confie les Travaux publics dans son ministère du 9 juin 1914, qui n’eut que trois jours d’existence. Au début de la guerre mondiale, Jean Dupuy décide de rester à Paris malgré le départ du Gouvernement pour Bordeaux. En qualité de président du Comité des associations de la presse française, il demande au Sénat, le 5 août 1915, la réduction des droits de douane sur l’importation du papier journal. Le 15 octobre 1916, il écrit, à propos de l’ouverture de la souscription du deuxième emprunt de guerre : « Le capital gardé dans un bas de laine est non seulement stérile, mais coupable. » Inlassable, le directeur du Petit Parisien continue à mener de front toutes ses activités : le journal, l’usine, les Hautes-Pyrénées, les Commissions sénatoriales. Il devient propriétaire du journal Excelsior qui avait été fondé en 1910 par Sir Basil Zaharoff, mystérieux et célèbre fournisseur de guerre. Homme d’affaires, homme politique, homme d’État, Jean Dupuy fut avant tout un homme de journal. Sa phrase préférée était : « Pour réussir dans la vie, il suffit de travailler et de posséder la connaissance des hommes. » En 1917, Jean Dupuy avait alerté Clemenceau sur les douteux agissements de Paul Polo, qui se disait conseiller du commerce extérieur et avait monté une affaire de protection des marques d’origine. Cet escroc fut fusillé comme espion le 18 avril 1918. Le 17 septembre 1917, Poincaré confie à Paul Painlevé la mission de former un Gouvernement. Il conserve la plupart des ministres du précédent Cabinet et nomme cinq ministres d’État membres du Comité de guerre : Barthou, Bourgeois, Doumer, Franklin-Bouillon et Jean Dupuy. Ce ministère est renversé en novembre ; Jean Dupuy a été ministre pour la dernière fois. Foch et Clemenceau s’opposent, en avril 1919, sur les conditions de paix à imposer à l’Allemagne et Jean Dupuy, chargé par Poincaré de les réconcilier, ne pourra mener à bien cette tâche. Le 28 septembre, il participe à l’hommage rendu par la ville de Tarbes à son glorieux citoyen, le maréchal Foch. Il revient malade de sa campagne électorale. Sa vie s’achève le 31 décembre 1919, à Paris, à l’âge de 75 ans. Son éloge funèbre est prononcé le 13 janvier 1920 par M. Gustave Denis, président d’âge du Sénat : « Il ne recherchait pas les honneurs, mais il ne refusa jamais son nom et son influence quand il jugea qu’ils pouvaient être utiles à son pays et à la République. » « Il laissera au Sénat le souvenir d’un excellent collègue, tout dévoué à ses amis, dont la conversation pleine de charme était nourrie d’idées et de faits. Il représentait bien notre vieille race française, toute pétrie d’honneur, de loyauté, de vigoureux bon sens, de force de travail qui, après avoir étonné le monde par son allure magnifique pendant la guerre, ne l’étonnera pas moins par l’énergie qu’elle mettra, pendant la paix, à reconstruire sa maison dévastée. » Jean Dupuy fut vice-président du Sénat (1911-1919), président du comité général des associations de la presse française, président du syndicat de la presse parisienne (1897-1919), membre du conseil supérieur des haras, vice-président de la société nationale d’encouragement à l’agriculture, membre de l’académie d’agriculture, membre du comité supérieur de l’agriculture. Il était Commandeur du Mérite agricole, Grand-Croix de l’Ordre de l’Aigle blanc de Russie. En 1913, il lança la revue « La Science et la Vie », actuel « Science et Vie ». À son décès, Le Petit Parisien dépasse alors les deux millions d’exemplaires, ce qui constitue le plus fort tirage au monde de cette époque. Ses fils Pierre et Paul Dupuy ancien député des Hautes-Pyrénées, prendront sa succession à la tête du quotidien avant de créer d’autres groupes de presse. Il repose avec son fils, Pierre Dupuy (1876-1968) sous-secrétaire d’État à la marine marchande et député de la Gironde, et son beau-fils, le député François Arago (1862-1937) au cimetière du Père Lachaise. De son action politique, il reste un domaine toujours à l’honneur : c’est lui qui a lancé le projet permettant à un accusé d’être assisté d’un avocat, dès son arrestation. Le Lycée technique d’État de Tarbes porte le nom de Jean Dupuy, sénateur des Hautes-Pyrénées. Anciennement Grand Séminaire construit sous Napoléon III en 1850, est devenu l’École nationale professionnelle (ENP), suite à la loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905. Celle-ci est née d’une volonté départementale, municipale et industrielle. Il aura fallu toute l’opiniâtreté de Jean Dupuy, alors sénateur des Hautes-Pyrénées, pour obtenir de Raymond Poincaré, président de la République, qu’il signe l’arrêté de création de l’École nationale professionnelle de Tarbes, devenue ensuite Lycée technique Jean Dupuy. Elle verra le jour par la loi du 25 juillet 1914 signée à Stockholm par le président de la République de l’époque, Raymond Poincaré, qui se rendait en Russie. La première promotion ne sera accueillie seulement qu’en octobre 1925, en raison de la Première Guerre Mondiale. C’est le 21 novembre 1926 qu’est inaugurée l’École Nationale Professionnelle (ENP) Jean Dupuy. Raymond Poincaré et Édouard Herriot, ministre de l’Instruction publique font le déplacement à Tarbes. Pour cette occasion un buste avait été sculpté par Firmin Michelet. Sixième du genre, en France, elle n’existera donc officiellement qu’à partir de 1926. À l’époque le recrutement se faisait par un concours extrêmement sévère et le port de l’uniforme était obligatoire. Nombre d’ingénieurs, de techniciens, de professionnels dans des domaines divers et variés ont fait leur préparation dans l’établissement tarbais, qui se targue d’avoir la plus ancienne classe de préparation aux grandes écoles. Ainsi les bâtiments du lycée Jean Dupuy sont voués à l’enseignement public depuis 1926. Successivement ENP (École nationale professionnelle) spécialisée dans les métiers de l’industrie jusque dans les années 1960, puis lycée technique d’État, l’établissement se transforme en 2011 en Lycée polyvalent Jean Dupuy. Le samedi 25 janvier 2025 le lycée Jean Dupuy a célébré son 100e anniversaire, marquant un siècle d’histoire et d’éducation. L’établissement a accueilli entre 500 et 600 personnes pour cette occasion spéciale. Les plus anciens élèves ont découvert un établissement modernisé, qui a su rester à la pointe des technologies, mais sans oublier la tradition. Dans le cadre du programme de ce centenaire, et au-delà de la célébration, un événement majeur a eu lieu : l’inauguration du déplacement au cœur du site de la statue de Jean-Dupuy, à l’origine de l’établissement, qui a été dévoilée. Les anciens élèves de l’ENP et du LTE sont nos meilleurs ambassadeurs d’un enseignement d'excellence dispensé par des professeurs d’élite, passionnés et exigeants. Un livre couvrant la période entre 1925 et 1960, et comportant des documents, des photographies, des anecdotes, mais aussi des discours des directeurs et professeurs qui ont fait de l’ENP, une des plus prestigieuses de France, a été écrit et publié par Pierre Torrecillos, dont les fonds de culottes ont été usés à Jean Dupuy, de 1948 à 1952. Un exemplaire a été remis ce samedi 25 janvier 2025 à chaque participant du centenaire de l’ENP. Marcel Gendulphe, ancien élève (1960-63) et proviseur de l’établissement entre 1998 et 2005, est aujourd’hui le président de l’Association des anciens de l’ENP et du lycée Jean-Dupuy de Tarbes.DUPUY Jean-Vincent (1934-2010)
Joueur de rugby à XV, trois-quarts aile gauche du Stadoceste tarbais et de l'équipe de France et très grande figure du rugby bigourdan
 Jean DUPUY, dit « Pipiou » né le 25 mai 1934 à Vic-en-Bigorre et mort le 27 octobre 2010 à Tarbes, à l’âge de 76 ans. Joueur de rugby à XV international, il a joué à divers postes, dès les années 50. Adolescent, il est clarinettiste à l'orphéon de Vic-en-Bigorre. Il débute à 19 ans avec le Stadoceste tarbais et fait toute sa carrière de haut-niveau dans ce club, de 1953 à 1969, où il donnera le meilleur et où il fut très vite un ailier gauche redouté. Pendant 16 ans, il a offert au public de Jules-Soulé le maximum de ce qui peut se faire sur un terrain de rugby. Très rapide (moins de 11 secondes au 100 mètres) et très puissant, ses placages font des ravages dans les lignes adverses, et il est l'un des tout meilleurs ailiers mondiaux du début des années 1960, les cheveux flush, le menton en avant et la moustache fournie. Jouant également au centre, il est replacé en troisième ligne à la fin de sa carrière. « Ailier, 3/4 ailes, Jean savait tout faire en club et en équipe nationale », dira de lui Jean Lapasset. Après le Stadoceste tarbais, il rejoindra l'Union sportive vicquoise (US Vic), dont il fut également l'entraîneur, et le rugby dans la peau il jouera bien après la quarantaine pour les couleurs de sa ville natale. Il tiendra ensuite un garage station-service à Tarbes, puis jusqu'à sa mort, le bar « Chez Pipiou » à Vic-en-Bigorre. Ce joueur atypique, que l'on a aussi surnommé « Le phénomène » ou « L'indestructible », un athlète tout en muscles (1,75m et 85 kg), sprinteur, capable d'accélérations prodigieuses, véritable ouragan, lutteur, combattant, imprévisible, féroce défenseur, a été un formidable ailier. Ce monstre sacré du rugby mondial est venu au Stado en 1953, sur les conseils de son ami Georges Despau. International pour la première fois le 4 janvier 1956, à 21 ans, il sera 40 fois capé de 1956 à 1964, et participera à trois tournées dans l'hémisphère Sud. Inscrivant 19 essais avec l'équipe tricolore (les Bleus), le plus beau restera celui du test de Wellington, en 1961. Une véritable tempête, ce jour-là, une course de 60 mètres face à un vent de fin du monde, la meute des All Blacks aux trousses et le « terrific » Yates revenant en travers. Mais rien ne pouvait stopper « Pipiou ». Il terminera cette folle chevauchée dans l'angle droit de l'en-but néo-zélandais. Ça aurait pu être l'essai de la première victoire de l'équipe de France en Nouvelle Zélande. Hélas, à la dernière minute, les All Blacks ne l'ont pas voulu ainsi… Après ce sensationnel fait d'armes, il sera sacré meilleur ailier du monde. Il a fait lever les tribunes et a enchanté les populaires de tous les stades de la planète. Le joueur s'est aussi attiré l'estime, le respect et l'amitié de tous ses adversaires par une loyauté et une correction exemplaires. Un immense joueur de rugby » du Stadoceste tarbais (1953 à 1969) et de l'US Vic. Sélectionné à 40 reprises et auteur de 19 essais, Pipiou Dupuy aura marqué l'équipe de France, avec des essais d'anthologie, comme à Dublin en 1959 ou en Nouvelle-Zélande en 1961. Il participa également à quatre tournées de l'équipe de France, en Afrique du Sud (1958 – match nul 3-3 au Cap face aux Springboks et victoire historique 9-5 à Johannesburg et en 1964 – victorieux à Springs), en Argentine (1960) et en Nouvelle-Zélande (1961) et aux quatre immenses victoires successives dans le Tournoi des cinq nations entre 1959 et 1962 et au match du siècle à Colombes contre les Springboks qui se solda par un 0 à 0. Connu pour sa modestie, sa gentillesse, sa franchise, son goût de la vie, son bon cœur, sa sensibilité, son éternel sourire dessiné sous le béret vissé sur sa tête, Pipiou s'identifiait « à son pays natal, sa Bigorre. Généreux, solide en amitié, bon vivant quand il jouait et il l’était resté, Pipiou était toujours d'accord pour partager un bon repas. Il était hors du commun pour son respect des autres. Jamais de nostalgie sur sa carrière » avait encore souligné, dans l’hommage qui lui fut rendu, Bernard Lapasset en rappelant son implication au sein du Stado lors de la saison victorieuse de 1973 (un Stado qui attendra 1973 pour conquérir le bouclier de Brennus). Il ne fut l'homme que d'un seul club qui est aussi le symbole de l'attachement à un maillot, celui frappé de la tête d'Ours, restant ainsi fidèle au Stado. Un joueur emblématique qui représentait le haut niveau du rugby en Bigorre. Il aura marqué son époque de la plus belle façon qu'il soit. Son palmarès : Vainqueur à quatre reprises consécutives du Tournoi des Cinq Nations. En 1959 ; 1960 (ex æquo avec l'Angleterre) ; 1961 ; 1962. Jean Dupuy, un nom devenu une légende du XV de France entre 1953 et 1969, qui restera indélébilement attaché à celui du Stado et à l'histoire du rugby. Son épouse Monique et son fils Marc ont fait restaurer la demeure familiale, datant du XVIIIe siècle, en un gîte de charme, niché dans la petite ville de Vic-en-Bigorre, contribuant ainsi à la préservation de la mémoire de Jean Dupuy. Un site idéal pour un séjour dédié à la détente, des vacances en famille ou entre amis dans un environnement fleuri hors du commun. Jean est décédé le 27 octobre 2010 à Tarbes et ses obsèques furent célébrées le samedi 30 octobre 2010, en l’église Saint-Martin de Vic-en-Bigorre. Une plaque commémorative a été dévoilée en 2012 à sa mémoire.
Jean DUPUY, dit « Pipiou » né le 25 mai 1934 à Vic-en-Bigorre et mort le 27 octobre 2010 à Tarbes, à l’âge de 76 ans. Joueur de rugby à XV international, il a joué à divers postes, dès les années 50. Adolescent, il est clarinettiste à l'orphéon de Vic-en-Bigorre. Il débute à 19 ans avec le Stadoceste tarbais et fait toute sa carrière de haut-niveau dans ce club, de 1953 à 1969, où il donnera le meilleur et où il fut très vite un ailier gauche redouté. Pendant 16 ans, il a offert au public de Jules-Soulé le maximum de ce qui peut se faire sur un terrain de rugby. Très rapide (moins de 11 secondes au 100 mètres) et très puissant, ses placages font des ravages dans les lignes adverses, et il est l'un des tout meilleurs ailiers mondiaux du début des années 1960, les cheveux flush, le menton en avant et la moustache fournie. Jouant également au centre, il est replacé en troisième ligne à la fin de sa carrière. « Ailier, 3/4 ailes, Jean savait tout faire en club et en équipe nationale », dira de lui Jean Lapasset. Après le Stadoceste tarbais, il rejoindra l'Union sportive vicquoise (US Vic), dont il fut également l'entraîneur, et le rugby dans la peau il jouera bien après la quarantaine pour les couleurs de sa ville natale. Il tiendra ensuite un garage station-service à Tarbes, puis jusqu'à sa mort, le bar « Chez Pipiou » à Vic-en-Bigorre. Ce joueur atypique, que l'on a aussi surnommé « Le phénomène » ou « L'indestructible », un athlète tout en muscles (1,75m et 85 kg), sprinteur, capable d'accélérations prodigieuses, véritable ouragan, lutteur, combattant, imprévisible, féroce défenseur, a été un formidable ailier. Ce monstre sacré du rugby mondial est venu au Stado en 1953, sur les conseils de son ami Georges Despau. International pour la première fois le 4 janvier 1956, à 21 ans, il sera 40 fois capé de 1956 à 1964, et participera à trois tournées dans l'hémisphère Sud. Inscrivant 19 essais avec l'équipe tricolore (les Bleus), le plus beau restera celui du test de Wellington, en 1961. Une véritable tempête, ce jour-là, une course de 60 mètres face à un vent de fin du monde, la meute des All Blacks aux trousses et le « terrific » Yates revenant en travers. Mais rien ne pouvait stopper « Pipiou ». Il terminera cette folle chevauchée dans l'angle droit de l'en-but néo-zélandais. Ça aurait pu être l'essai de la première victoire de l'équipe de France en Nouvelle Zélande. Hélas, à la dernière minute, les All Blacks ne l'ont pas voulu ainsi… Après ce sensationnel fait d'armes, il sera sacré meilleur ailier du monde. Il a fait lever les tribunes et a enchanté les populaires de tous les stades de la planète. Le joueur s'est aussi attiré l'estime, le respect et l'amitié de tous ses adversaires par une loyauté et une correction exemplaires. Un immense joueur de rugby » du Stadoceste tarbais (1953 à 1969) et de l'US Vic. Sélectionné à 40 reprises et auteur de 19 essais, Pipiou Dupuy aura marqué l'équipe de France, avec des essais d'anthologie, comme à Dublin en 1959 ou en Nouvelle-Zélande en 1961. Il participa également à quatre tournées de l'équipe de France, en Afrique du Sud (1958 – match nul 3-3 au Cap face aux Springboks et victoire historique 9-5 à Johannesburg et en 1964 – victorieux à Springs), en Argentine (1960) et en Nouvelle-Zélande (1961) et aux quatre immenses victoires successives dans le Tournoi des cinq nations entre 1959 et 1962 et au match du siècle à Colombes contre les Springboks qui se solda par un 0 à 0. Connu pour sa modestie, sa gentillesse, sa franchise, son goût de la vie, son bon cœur, sa sensibilité, son éternel sourire dessiné sous le béret vissé sur sa tête, Pipiou s'identifiait « à son pays natal, sa Bigorre. Généreux, solide en amitié, bon vivant quand il jouait et il l’était resté, Pipiou était toujours d'accord pour partager un bon repas. Il était hors du commun pour son respect des autres. Jamais de nostalgie sur sa carrière » avait encore souligné, dans l’hommage qui lui fut rendu, Bernard Lapasset en rappelant son implication au sein du Stado lors de la saison victorieuse de 1973 (un Stado qui attendra 1973 pour conquérir le bouclier de Brennus). Il ne fut l'homme que d'un seul club qui est aussi le symbole de l'attachement à un maillot, celui frappé de la tête d'Ours, restant ainsi fidèle au Stado. Un joueur emblématique qui représentait le haut niveau du rugby en Bigorre. Il aura marqué son époque de la plus belle façon qu'il soit. Son palmarès : Vainqueur à quatre reprises consécutives du Tournoi des Cinq Nations. En 1959 ; 1960 (ex æquo avec l'Angleterre) ; 1961 ; 1962. Jean Dupuy, un nom devenu une légende du XV de France entre 1953 et 1969, qui restera indélébilement attaché à celui du Stado et à l'histoire du rugby. Son épouse Monique et son fils Marc ont fait restaurer la demeure familiale, datant du XVIIIe siècle, en un gîte de charme, niché dans la petite ville de Vic-en-Bigorre, contribuant ainsi à la préservation de la mémoire de Jean Dupuy. Un site idéal pour un séjour dédié à la détente, des vacances en famille ou entre amis dans un environnement fleuri hors du commun. Jean est décédé le 27 octobre 2010 à Tarbes et ses obsèques furent célébrées le samedi 30 octobre 2010, en l’église Saint-Martin de Vic-en-Bigorre. Une plaque commémorative a été dévoilée en 2012 à sa mémoire.
 Jean DUPUY, dit « Pipiou » né le 25 mai 1934 à Vic-en-Bigorre et mort le 27 octobre 2010 à Tarbes, à l’âge de 76 ans. Joueur de rugby à XV international, il a joué à divers postes, dès les années 50. Adolescent, il est clarinettiste à l'orphéon de Vic-en-Bigorre. Il débute à 19 ans avec le Stadoceste tarbais et fait toute sa carrière de haut-niveau dans ce club, de 1953 à 1969, où il donnera le meilleur et où il fut très vite un ailier gauche redouté. Pendant 16 ans, il a offert au public de Jules-Soulé le maximum de ce qui peut se faire sur un terrain de rugby. Très rapide (moins de 11 secondes au 100 mètres) et très puissant, ses placages font des ravages dans les lignes adverses, et il est l'un des tout meilleurs ailiers mondiaux du début des années 1960, les cheveux flush, le menton en avant et la moustache fournie. Jouant également au centre, il est replacé en troisième ligne à la fin de sa carrière. « Ailier, 3/4 ailes, Jean savait tout faire en club et en équipe nationale », dira de lui Jean Lapasset. Après le Stadoceste tarbais, il rejoindra l'Union sportive vicquoise (US Vic), dont il fut également l'entraîneur, et le rugby dans la peau il jouera bien après la quarantaine pour les couleurs de sa ville natale. Il tiendra ensuite un garage station-service à Tarbes, puis jusqu'à sa mort, le bar « Chez Pipiou » à Vic-en-Bigorre. Ce joueur atypique, que l'on a aussi surnommé « Le phénomène » ou « L'indestructible », un athlète tout en muscles (1,75m et 85 kg), sprinteur, capable d'accélérations prodigieuses, véritable ouragan, lutteur, combattant, imprévisible, féroce défenseur, a été un formidable ailier. Ce monstre sacré du rugby mondial est venu au Stado en 1953, sur les conseils de son ami Georges Despau. International pour la première fois le 4 janvier 1956, à 21 ans, il sera 40 fois capé de 1956 à 1964, et participera à trois tournées dans l'hémisphère Sud. Inscrivant 19 essais avec l'équipe tricolore (les Bleus), le plus beau restera celui du test de Wellington, en 1961. Une véritable tempête, ce jour-là, une course de 60 mètres face à un vent de fin du monde, la meute des All Blacks aux trousses et le « terrific » Yates revenant en travers. Mais rien ne pouvait stopper « Pipiou ». Il terminera cette folle chevauchée dans l'angle droit de l'en-but néo-zélandais. Ça aurait pu être l'essai de la première victoire de l'équipe de France en Nouvelle Zélande. Hélas, à la dernière minute, les All Blacks ne l'ont pas voulu ainsi… Après ce sensationnel fait d'armes, il sera sacré meilleur ailier du monde. Il a fait lever les tribunes et a enchanté les populaires de tous les stades de la planète. Le joueur s'est aussi attiré l'estime, le respect et l'amitié de tous ses adversaires par une loyauté et une correction exemplaires. Un immense joueur de rugby » du Stadoceste tarbais (1953 à 1969) et de l'US Vic. Sélectionné à 40 reprises et auteur de 19 essais, Pipiou Dupuy aura marqué l'équipe de France, avec des essais d'anthologie, comme à Dublin en 1959 ou en Nouvelle-Zélande en 1961. Il participa également à quatre tournées de l'équipe de France, en Afrique du Sud (1958 – match nul 3-3 au Cap face aux Springboks et victoire historique 9-5 à Johannesburg et en 1964 – victorieux à Springs), en Argentine (1960) et en Nouvelle-Zélande (1961) et aux quatre immenses victoires successives dans le Tournoi des cinq nations entre 1959 et 1962 et au match du siècle à Colombes contre les Springboks qui se solda par un 0 à 0. Connu pour sa modestie, sa gentillesse, sa franchise, son goût de la vie, son bon cœur, sa sensibilité, son éternel sourire dessiné sous le béret vissé sur sa tête, Pipiou s'identifiait « à son pays natal, sa Bigorre. Généreux, solide en amitié, bon vivant quand il jouait et il l’était resté, Pipiou était toujours d'accord pour partager un bon repas. Il était hors du commun pour son respect des autres. Jamais de nostalgie sur sa carrière » avait encore souligné, dans l’hommage qui lui fut rendu, Bernard Lapasset en rappelant son implication au sein du Stado lors de la saison victorieuse de 1973 (un Stado qui attendra 1973 pour conquérir le bouclier de Brennus). Il ne fut l'homme que d'un seul club qui est aussi le symbole de l'attachement à un maillot, celui frappé de la tête d'Ours, restant ainsi fidèle au Stado. Un joueur emblématique qui représentait le haut niveau du rugby en Bigorre. Il aura marqué son époque de la plus belle façon qu'il soit. Son palmarès : Vainqueur à quatre reprises consécutives du Tournoi des Cinq Nations. En 1959 ; 1960 (ex æquo avec l'Angleterre) ; 1961 ; 1962. Jean Dupuy, un nom devenu une légende du XV de France entre 1953 et 1969, qui restera indélébilement attaché à celui du Stado et à l'histoire du rugby. Son épouse Monique et son fils Marc ont fait restaurer la demeure familiale, datant du XVIIIe siècle, en un gîte de charme, niché dans la petite ville de Vic-en-Bigorre, contribuant ainsi à la préservation de la mémoire de Jean Dupuy. Un site idéal pour un séjour dédié à la détente, des vacances en famille ou entre amis dans un environnement fleuri hors du commun. Jean est décédé le 27 octobre 2010 à Tarbes et ses obsèques furent célébrées le samedi 30 octobre 2010, en l’église Saint-Martin de Vic-en-Bigorre. Une plaque commémorative a été dévoilée en 2012 à sa mémoire.
Jean DUPUY, dit « Pipiou » né le 25 mai 1934 à Vic-en-Bigorre et mort le 27 octobre 2010 à Tarbes, à l’âge de 76 ans. Joueur de rugby à XV international, il a joué à divers postes, dès les années 50. Adolescent, il est clarinettiste à l'orphéon de Vic-en-Bigorre. Il débute à 19 ans avec le Stadoceste tarbais et fait toute sa carrière de haut-niveau dans ce club, de 1953 à 1969, où il donnera le meilleur et où il fut très vite un ailier gauche redouté. Pendant 16 ans, il a offert au public de Jules-Soulé le maximum de ce qui peut se faire sur un terrain de rugby. Très rapide (moins de 11 secondes au 100 mètres) et très puissant, ses placages font des ravages dans les lignes adverses, et il est l'un des tout meilleurs ailiers mondiaux du début des années 1960, les cheveux flush, le menton en avant et la moustache fournie. Jouant également au centre, il est replacé en troisième ligne à la fin de sa carrière. « Ailier, 3/4 ailes, Jean savait tout faire en club et en équipe nationale », dira de lui Jean Lapasset. Après le Stadoceste tarbais, il rejoindra l'Union sportive vicquoise (US Vic), dont il fut également l'entraîneur, et le rugby dans la peau il jouera bien après la quarantaine pour les couleurs de sa ville natale. Il tiendra ensuite un garage station-service à Tarbes, puis jusqu'à sa mort, le bar « Chez Pipiou » à Vic-en-Bigorre. Ce joueur atypique, que l'on a aussi surnommé « Le phénomène » ou « L'indestructible », un athlète tout en muscles (1,75m et 85 kg), sprinteur, capable d'accélérations prodigieuses, véritable ouragan, lutteur, combattant, imprévisible, féroce défenseur, a été un formidable ailier. Ce monstre sacré du rugby mondial est venu au Stado en 1953, sur les conseils de son ami Georges Despau. International pour la première fois le 4 janvier 1956, à 21 ans, il sera 40 fois capé de 1956 à 1964, et participera à trois tournées dans l'hémisphère Sud. Inscrivant 19 essais avec l'équipe tricolore (les Bleus), le plus beau restera celui du test de Wellington, en 1961. Une véritable tempête, ce jour-là, une course de 60 mètres face à un vent de fin du monde, la meute des All Blacks aux trousses et le « terrific » Yates revenant en travers. Mais rien ne pouvait stopper « Pipiou ». Il terminera cette folle chevauchée dans l'angle droit de l'en-but néo-zélandais. Ça aurait pu être l'essai de la première victoire de l'équipe de France en Nouvelle Zélande. Hélas, à la dernière minute, les All Blacks ne l'ont pas voulu ainsi… Après ce sensationnel fait d'armes, il sera sacré meilleur ailier du monde. Il a fait lever les tribunes et a enchanté les populaires de tous les stades de la planète. Le joueur s'est aussi attiré l'estime, le respect et l'amitié de tous ses adversaires par une loyauté et une correction exemplaires. Un immense joueur de rugby » du Stadoceste tarbais (1953 à 1969) et de l'US Vic. Sélectionné à 40 reprises et auteur de 19 essais, Pipiou Dupuy aura marqué l'équipe de France, avec des essais d'anthologie, comme à Dublin en 1959 ou en Nouvelle-Zélande en 1961. Il participa également à quatre tournées de l'équipe de France, en Afrique du Sud (1958 – match nul 3-3 au Cap face aux Springboks et victoire historique 9-5 à Johannesburg et en 1964 – victorieux à Springs), en Argentine (1960) et en Nouvelle-Zélande (1961) et aux quatre immenses victoires successives dans le Tournoi des cinq nations entre 1959 et 1962 et au match du siècle à Colombes contre les Springboks qui se solda par un 0 à 0. Connu pour sa modestie, sa gentillesse, sa franchise, son goût de la vie, son bon cœur, sa sensibilité, son éternel sourire dessiné sous le béret vissé sur sa tête, Pipiou s'identifiait « à son pays natal, sa Bigorre. Généreux, solide en amitié, bon vivant quand il jouait et il l’était resté, Pipiou était toujours d'accord pour partager un bon repas. Il était hors du commun pour son respect des autres. Jamais de nostalgie sur sa carrière » avait encore souligné, dans l’hommage qui lui fut rendu, Bernard Lapasset en rappelant son implication au sein du Stado lors de la saison victorieuse de 1973 (un Stado qui attendra 1973 pour conquérir le bouclier de Brennus). Il ne fut l'homme que d'un seul club qui est aussi le symbole de l'attachement à un maillot, celui frappé de la tête d'Ours, restant ainsi fidèle au Stado. Un joueur emblématique qui représentait le haut niveau du rugby en Bigorre. Il aura marqué son époque de la plus belle façon qu'il soit. Son palmarès : Vainqueur à quatre reprises consécutives du Tournoi des Cinq Nations. En 1959 ; 1960 (ex æquo avec l'Angleterre) ; 1961 ; 1962. Jean Dupuy, un nom devenu une légende du XV de France entre 1953 et 1969, qui restera indélébilement attaché à celui du Stado et à l'histoire du rugby. Son épouse Monique et son fils Marc ont fait restaurer la demeure familiale, datant du XVIIIe siècle, en un gîte de charme, niché dans la petite ville de Vic-en-Bigorre, contribuant ainsi à la préservation de la mémoire de Jean Dupuy. Un site idéal pour un séjour dédié à la détente, des vacances en famille ou entre amis dans un environnement fleuri hors du commun. Jean est décédé le 27 octobre 2010 à Tarbes et ses obsèques furent célébrées le samedi 30 octobre 2010, en l’église Saint-Martin de Vic-en-Bigorre. Une plaque commémorative a été dévoilée en 2012 à sa mémoire.EMBRUN Éliane (1923-2009)
Chanteuse et actrice
 Éliane EMBRUN, née Éliane Branchard, le 28 mars 1923 à Argelès-Gazost et décédée le 17 février 2009 à Argelès-Gazost, a connu une célébrité internationale dans les années 1950. Elle restera dans la mémoire de nostalgiques de ces années, la chanteuse de charme la plus sensuelle par sa voix au timbre exceptionnel. Elle était la fille de René Marcel Branchard, qui exerçait la profession de mécanicien électricien et de Victorine Dupond. Elle grandit à Argelès-Gazost, chante dès son plus jeune âge et prend des cours de danse à Tarbes, sans penser un seul instant à faire carrière dans le monde du spectacle. Très jeune, elle épouse le 6 octobre 1939 à Argelès-Gazost, Maurice Jean Bangratz, qui exerçait la profession de dessinateur. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le couple part s’installer à Paris. Elle prend des cours de chant avec Paulette Vétheuil, qui lui écrit la musique de « Au chant des mandolines », le premier disque qu’elle enregistrera en 1947. Sa voix est immédiatement remarquée. Elle est prise alors dans le tourbillon des émissions de radio, les galas à Paris, en province et à l’étranger. Elle commence à chanter dans des cabarets comme Le Drap d’Or et donne des galas en France et en Belgique. En 1949, elle enregistre « Congo » et « Si j’étais une cigarette », sa chanson fétiche et remportera le Prix Lucienne Boyer et le Premier prix d’interprétation au concours de la chanson de Deauville, avec « Qu’il était doux », d’Henri Contet, son compagnon durant plus de dix ans et qui était le père de sa fille Dominique. Elle enregistra alors accompagnée par les meilleurs orchestres comme celui de Raymond Legrand ou celui d’Albert Lasry. Elle participera à des tournées au Liban, en Belgique, au Brésil, en Égypte. En 1950, il y aura le Tour de France dans la caravane publicitaire. Et à partir de 1950, elle apparaît et chante aussi dans plusieurs films, se produit au Brésil et au Moyen-Orient, participe à plusieurs émissions de télévision et divorcera. Ainsi, en 1950, elle participa au film « Quai de Grenelle », d’Emil-Edwin Reinert, en réalisant les parties chantées du personnage de « Simone Lamy », qui est joué à l’écran par Françoise Arnoul. En 1951, elle tient un rôle dans le film « Une fille à croquer » de Raoul André, aux côtés de Maurice Biraud, de Serge Reggiani et de Louise Carletti. La même année elle participe au film « Rue des Saussaies », de Ralph Habib, en réalisant les parties chantées du personnage de « Jeanne Masson », qui est joué à l’écran par Anne Vernon. Pendant ces années 1950, elle apparaît souvent dans les émissions « Music-Hall Parade » de Gilles Margaritis, qu’elle admire beaucoup. Mais en 1963, elle suspend sa carrière pour des raisons personnelles et familiales et se retire à Argelès-Gazost dans ses chères Pyrénées, retrouver ses parents, veiller sur les études de sa fille Dominique et s’adonner à ses sports favoris. En 1990, elle se produit dans l’émission « La Chance aux Chansons » et recommence occasionnellement à donner des galas ou à animer les soirées des casinos en France et en Belgique. En 1993, elle enregistre vingt chansons publiées sur le CD « Douce France ». Considérée comme une chanteuse de charme, elle maîtrisait une diction parfaite et savait s’investir dans un répertoire choisi et exigeant comme « Mes jeunes années » de Trenet, « Mélancolie » de Pierre Dudan, « Boléro pour l’inconnu » de Bruno Coquatrix, ainsi que dans les grands standards de la chanson américaine. Enchaînant créations et succès, elle nous laisse de merveilleux enregistrements, une voix expressive et sensuelle, un physique juvénile et sexy, qui l’imposèrent immédiatement comme l’une des meilleures chanteuses de charme des années 50. Chansons connues : Au chant des mandolines (1947), Valse perdue (1947), Clopin clopant (1948), La semaine d’amour (1948), Congo (1949), Pense à moi (1949), Qu’il était doux (1949), Amoureusement (1950), La nuit s’achève (1950), La ronde de l’amour (1950), Mam’zelle dimanche (1950), Rose de Belleville (1950), Si j’étais une cigarette (1950), Boléro pour l’inconnu (1950), Le moulin d’Isabelle (1951), Petite étoile d’or (1951), Pour un oui pour un non (1951), Fumée aux yeux (1952), La complainte des infidèles (1952), M’aimerez-vous toujours mon amour ? (1952), Sans ton amour (1952), Un chalet dans les pins (1952), Ça m’fait quelque chose (1953), Domino (1953), Embrasse-moi bien (1953), La fontaine aux fées, La valse au village, Mes jeunes années, Garde-moi toujours, La Fontaine amoureuse, Dans ses bras, Mélancolie, Je t’aimerai toujours, Tennessee valse, Virginie mon amie, Où irons-nous dimanche prochain?, Esclave, Embrasse-moi bien, Fumée aux yeux, Trop jeune.
Éliane EMBRUN, née Éliane Branchard, le 28 mars 1923 à Argelès-Gazost et décédée le 17 février 2009 à Argelès-Gazost, a connu une célébrité internationale dans les années 1950. Elle restera dans la mémoire de nostalgiques de ces années, la chanteuse de charme la plus sensuelle par sa voix au timbre exceptionnel. Elle était la fille de René Marcel Branchard, qui exerçait la profession de mécanicien électricien et de Victorine Dupond. Elle grandit à Argelès-Gazost, chante dès son plus jeune âge et prend des cours de danse à Tarbes, sans penser un seul instant à faire carrière dans le monde du spectacle. Très jeune, elle épouse le 6 octobre 1939 à Argelès-Gazost, Maurice Jean Bangratz, qui exerçait la profession de dessinateur. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le couple part s’installer à Paris. Elle prend des cours de chant avec Paulette Vétheuil, qui lui écrit la musique de « Au chant des mandolines », le premier disque qu’elle enregistrera en 1947. Sa voix est immédiatement remarquée. Elle est prise alors dans le tourbillon des émissions de radio, les galas à Paris, en province et à l’étranger. Elle commence à chanter dans des cabarets comme Le Drap d’Or et donne des galas en France et en Belgique. En 1949, elle enregistre « Congo » et « Si j’étais une cigarette », sa chanson fétiche et remportera le Prix Lucienne Boyer et le Premier prix d’interprétation au concours de la chanson de Deauville, avec « Qu’il était doux », d’Henri Contet, son compagnon durant plus de dix ans et qui était le père de sa fille Dominique. Elle enregistra alors accompagnée par les meilleurs orchestres comme celui de Raymond Legrand ou celui d’Albert Lasry. Elle participera à des tournées au Liban, en Belgique, au Brésil, en Égypte. En 1950, il y aura le Tour de France dans la caravane publicitaire. Et à partir de 1950, elle apparaît et chante aussi dans plusieurs films, se produit au Brésil et au Moyen-Orient, participe à plusieurs émissions de télévision et divorcera. Ainsi, en 1950, elle participa au film « Quai de Grenelle », d’Emil-Edwin Reinert, en réalisant les parties chantées du personnage de « Simone Lamy », qui est joué à l’écran par Françoise Arnoul. En 1951, elle tient un rôle dans le film « Une fille à croquer » de Raoul André, aux côtés de Maurice Biraud, de Serge Reggiani et de Louise Carletti. La même année elle participe au film « Rue des Saussaies », de Ralph Habib, en réalisant les parties chantées du personnage de « Jeanne Masson », qui est joué à l’écran par Anne Vernon. Pendant ces années 1950, elle apparaît souvent dans les émissions « Music-Hall Parade » de Gilles Margaritis, qu’elle admire beaucoup. Mais en 1963, elle suspend sa carrière pour des raisons personnelles et familiales et se retire à Argelès-Gazost dans ses chères Pyrénées, retrouver ses parents, veiller sur les études de sa fille Dominique et s’adonner à ses sports favoris. En 1990, elle se produit dans l’émission « La Chance aux Chansons » et recommence occasionnellement à donner des galas ou à animer les soirées des casinos en France et en Belgique. En 1993, elle enregistre vingt chansons publiées sur le CD « Douce France ». Considérée comme une chanteuse de charme, elle maîtrisait une diction parfaite et savait s’investir dans un répertoire choisi et exigeant comme « Mes jeunes années » de Trenet, « Mélancolie » de Pierre Dudan, « Boléro pour l’inconnu » de Bruno Coquatrix, ainsi que dans les grands standards de la chanson américaine. Enchaînant créations et succès, elle nous laisse de merveilleux enregistrements, une voix expressive et sensuelle, un physique juvénile et sexy, qui l’imposèrent immédiatement comme l’une des meilleures chanteuses de charme des années 50. Chansons connues : Au chant des mandolines (1947), Valse perdue (1947), Clopin clopant (1948), La semaine d’amour (1948), Congo (1949), Pense à moi (1949), Qu’il était doux (1949), Amoureusement (1950), La nuit s’achève (1950), La ronde de l’amour (1950), Mam’zelle dimanche (1950), Rose de Belleville (1950), Si j’étais une cigarette (1950), Boléro pour l’inconnu (1950), Le moulin d’Isabelle (1951), Petite étoile d’or (1951), Pour un oui pour un non (1951), Fumée aux yeux (1952), La complainte des infidèles (1952), M’aimerez-vous toujours mon amour ? (1952), Sans ton amour (1952), Un chalet dans les pins (1952), Ça m’fait quelque chose (1953), Domino (1953), Embrasse-moi bien (1953), La fontaine aux fées, La valse au village, Mes jeunes années, Garde-moi toujours, La Fontaine amoureuse, Dans ses bras, Mélancolie, Je t’aimerai toujours, Tennessee valse, Virginie mon amie, Où irons-nous dimanche prochain?, Esclave, Embrasse-moi bien, Fumée aux yeux, Trop jeune.
 Éliane EMBRUN, née Éliane Branchard, le 28 mars 1923 à Argelès-Gazost et décédée le 17 février 2009 à Argelès-Gazost, a connu une célébrité internationale dans les années 1950. Elle restera dans la mémoire de nostalgiques de ces années, la chanteuse de charme la plus sensuelle par sa voix au timbre exceptionnel. Elle était la fille de René Marcel Branchard, qui exerçait la profession de mécanicien électricien et de Victorine Dupond. Elle grandit à Argelès-Gazost, chante dès son plus jeune âge et prend des cours de danse à Tarbes, sans penser un seul instant à faire carrière dans le monde du spectacle. Très jeune, elle épouse le 6 octobre 1939 à Argelès-Gazost, Maurice Jean Bangratz, qui exerçait la profession de dessinateur. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le couple part s’installer à Paris. Elle prend des cours de chant avec Paulette Vétheuil, qui lui écrit la musique de « Au chant des mandolines », le premier disque qu’elle enregistrera en 1947. Sa voix est immédiatement remarquée. Elle est prise alors dans le tourbillon des émissions de radio, les galas à Paris, en province et à l’étranger. Elle commence à chanter dans des cabarets comme Le Drap d’Or et donne des galas en France et en Belgique. En 1949, elle enregistre « Congo » et « Si j’étais une cigarette », sa chanson fétiche et remportera le Prix Lucienne Boyer et le Premier prix d’interprétation au concours de la chanson de Deauville, avec « Qu’il était doux », d’Henri Contet, son compagnon durant plus de dix ans et qui était le père de sa fille Dominique. Elle enregistra alors accompagnée par les meilleurs orchestres comme celui de Raymond Legrand ou celui d’Albert Lasry. Elle participera à des tournées au Liban, en Belgique, au Brésil, en Égypte. En 1950, il y aura le Tour de France dans la caravane publicitaire. Et à partir de 1950, elle apparaît et chante aussi dans plusieurs films, se produit au Brésil et au Moyen-Orient, participe à plusieurs émissions de télévision et divorcera. Ainsi, en 1950, elle participa au film « Quai de Grenelle », d’Emil-Edwin Reinert, en réalisant les parties chantées du personnage de « Simone Lamy », qui est joué à l’écran par Françoise Arnoul. En 1951, elle tient un rôle dans le film « Une fille à croquer » de Raoul André, aux côtés de Maurice Biraud, de Serge Reggiani et de Louise Carletti. La même année elle participe au film « Rue des Saussaies », de Ralph Habib, en réalisant les parties chantées du personnage de « Jeanne Masson », qui est joué à l’écran par Anne Vernon. Pendant ces années 1950, elle apparaît souvent dans les émissions « Music-Hall Parade » de Gilles Margaritis, qu’elle admire beaucoup. Mais en 1963, elle suspend sa carrière pour des raisons personnelles et familiales et se retire à Argelès-Gazost dans ses chères Pyrénées, retrouver ses parents, veiller sur les études de sa fille Dominique et s’adonner à ses sports favoris. En 1990, elle se produit dans l’émission « La Chance aux Chansons » et recommence occasionnellement à donner des galas ou à animer les soirées des casinos en France et en Belgique. En 1993, elle enregistre vingt chansons publiées sur le CD « Douce France ». Considérée comme une chanteuse de charme, elle maîtrisait une diction parfaite et savait s’investir dans un répertoire choisi et exigeant comme « Mes jeunes années » de Trenet, « Mélancolie » de Pierre Dudan, « Boléro pour l’inconnu » de Bruno Coquatrix, ainsi que dans les grands standards de la chanson américaine. Enchaînant créations et succès, elle nous laisse de merveilleux enregistrements, une voix expressive et sensuelle, un physique juvénile et sexy, qui l’imposèrent immédiatement comme l’une des meilleures chanteuses de charme des années 50. Chansons connues : Au chant des mandolines (1947), Valse perdue (1947), Clopin clopant (1948), La semaine d’amour (1948), Congo (1949), Pense à moi (1949), Qu’il était doux (1949), Amoureusement (1950), La nuit s’achève (1950), La ronde de l’amour (1950), Mam’zelle dimanche (1950), Rose de Belleville (1950), Si j’étais une cigarette (1950), Boléro pour l’inconnu (1950), Le moulin d’Isabelle (1951), Petite étoile d’or (1951), Pour un oui pour un non (1951), Fumée aux yeux (1952), La complainte des infidèles (1952), M’aimerez-vous toujours mon amour ? (1952), Sans ton amour (1952), Un chalet dans les pins (1952), Ça m’fait quelque chose (1953), Domino (1953), Embrasse-moi bien (1953), La fontaine aux fées, La valse au village, Mes jeunes années, Garde-moi toujours, La Fontaine amoureuse, Dans ses bras, Mélancolie, Je t’aimerai toujours, Tennessee valse, Virginie mon amie, Où irons-nous dimanche prochain?, Esclave, Embrasse-moi bien, Fumée aux yeux, Trop jeune.
Éliane EMBRUN, née Éliane Branchard, le 28 mars 1923 à Argelès-Gazost et décédée le 17 février 2009 à Argelès-Gazost, a connu une célébrité internationale dans les années 1950. Elle restera dans la mémoire de nostalgiques de ces années, la chanteuse de charme la plus sensuelle par sa voix au timbre exceptionnel. Elle était la fille de René Marcel Branchard, qui exerçait la profession de mécanicien électricien et de Victorine Dupond. Elle grandit à Argelès-Gazost, chante dès son plus jeune âge et prend des cours de danse à Tarbes, sans penser un seul instant à faire carrière dans le monde du spectacle. Très jeune, elle épouse le 6 octobre 1939 à Argelès-Gazost, Maurice Jean Bangratz, qui exerçait la profession de dessinateur. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le couple part s’installer à Paris. Elle prend des cours de chant avec Paulette Vétheuil, qui lui écrit la musique de « Au chant des mandolines », le premier disque qu’elle enregistrera en 1947. Sa voix est immédiatement remarquée. Elle est prise alors dans le tourbillon des émissions de radio, les galas à Paris, en province et à l’étranger. Elle commence à chanter dans des cabarets comme Le Drap d’Or et donne des galas en France et en Belgique. En 1949, elle enregistre « Congo » et « Si j’étais une cigarette », sa chanson fétiche et remportera le Prix Lucienne Boyer et le Premier prix d’interprétation au concours de la chanson de Deauville, avec « Qu’il était doux », d’Henri Contet, son compagnon durant plus de dix ans et qui était le père de sa fille Dominique. Elle enregistra alors accompagnée par les meilleurs orchestres comme celui de Raymond Legrand ou celui d’Albert Lasry. Elle participera à des tournées au Liban, en Belgique, au Brésil, en Égypte. En 1950, il y aura le Tour de France dans la caravane publicitaire. Et à partir de 1950, elle apparaît et chante aussi dans plusieurs films, se produit au Brésil et au Moyen-Orient, participe à plusieurs émissions de télévision et divorcera. Ainsi, en 1950, elle participa au film « Quai de Grenelle », d’Emil-Edwin Reinert, en réalisant les parties chantées du personnage de « Simone Lamy », qui est joué à l’écran par Françoise Arnoul. En 1951, elle tient un rôle dans le film « Une fille à croquer » de Raoul André, aux côtés de Maurice Biraud, de Serge Reggiani et de Louise Carletti. La même année elle participe au film « Rue des Saussaies », de Ralph Habib, en réalisant les parties chantées du personnage de « Jeanne Masson », qui est joué à l’écran par Anne Vernon. Pendant ces années 1950, elle apparaît souvent dans les émissions « Music-Hall Parade » de Gilles Margaritis, qu’elle admire beaucoup. Mais en 1963, elle suspend sa carrière pour des raisons personnelles et familiales et se retire à Argelès-Gazost dans ses chères Pyrénées, retrouver ses parents, veiller sur les études de sa fille Dominique et s’adonner à ses sports favoris. En 1990, elle se produit dans l’émission « La Chance aux Chansons » et recommence occasionnellement à donner des galas ou à animer les soirées des casinos en France et en Belgique. En 1993, elle enregistre vingt chansons publiées sur le CD « Douce France ». Considérée comme une chanteuse de charme, elle maîtrisait une diction parfaite et savait s’investir dans un répertoire choisi et exigeant comme « Mes jeunes années » de Trenet, « Mélancolie » de Pierre Dudan, « Boléro pour l’inconnu » de Bruno Coquatrix, ainsi que dans les grands standards de la chanson américaine. Enchaînant créations et succès, elle nous laisse de merveilleux enregistrements, une voix expressive et sensuelle, un physique juvénile et sexy, qui l’imposèrent immédiatement comme l’une des meilleures chanteuses de charme des années 50. Chansons connues : Au chant des mandolines (1947), Valse perdue (1947), Clopin clopant (1948), La semaine d’amour (1948), Congo (1949), Pense à moi (1949), Qu’il était doux (1949), Amoureusement (1950), La nuit s’achève (1950), La ronde de l’amour (1950), Mam’zelle dimanche (1950), Rose de Belleville (1950), Si j’étais une cigarette (1950), Boléro pour l’inconnu (1950), Le moulin d’Isabelle (1951), Petite étoile d’or (1951), Pour un oui pour un non (1951), Fumée aux yeux (1952), La complainte des infidèles (1952), M’aimerez-vous toujours mon amour ? (1952), Sans ton amour (1952), Un chalet dans les pins (1952), Ça m’fait quelque chose (1953), Domino (1953), Embrasse-moi bien (1953), La fontaine aux fées, La valse au village, Mes jeunes années, Garde-moi toujours, La Fontaine amoureuse, Dans ses bras, Mélancolie, Je t’aimerai toujours, Tennessee valse, Virginie mon amie, Où irons-nous dimanche prochain?, Esclave, Embrasse-moi bien, Fumée aux yeux, Trop jeune.FLEMATTI Robert (1942-XXXX)
Alpiniste et guide de haute montagne, compagnon de cordée de René Desmaison lors des grandes premières hivernales des années 60 à Chamonix : le Pilier du Frêney, le Linceul ou la face sud du Fou
 Robert (Umberto) FLEMATTI, né en 1942 près du lac de Côme, en Italie, est un passionné de montagne et l’un des plus grands alpinistes français de sa génération. Il est connu pour avoir franchi la frontière franco-italienne clandestinement à l’âge de 6 ans, en réalisant plus de 300 km à pied, en tenant la main de sa mère, pour rejoindre son père qui travaillait sur les grands barrages pyrénéens. Ainsi en mars 1949, il deviendra un enfant d’Arrens, au fin fond du Val d’Azun. Passionné par le sport, le Balaïtous se révèle vite sa montagne fétiche, où il apprend à repérer isards et abris. À 15 ans, avec son copain Charles Poulot, il réussit une première par Las Néous, avec, à l’arrivée, fesses et doigts glacés. “Je m’étais frotté au risque et ça m’avait tellement plu que je n’attendais qu’une chose : recommencer.” Robert part travailler sur des chantiers, puis enchaîne deux années comme moniteur de ski à La Mongie. Mais ses payes fondent comme neige au soleil. Lucien Cantet, le président du club de ski de fond local, et le maire d’Arrens, le Dr Lebreton, l’inscrivent à un stage de l’École nationale d’alpinisme qui se déroule à Gavarnie, sous la férule d’Armand Charlet, le directeur technique. Retenu, Robert Flematti devient aspirant guide avant de revenir au pays, sur les sentiers qui mènent au… Balaïtous. Son but : réaliser des courses en temps record sur cette montagne hérissée d’à-pics, rude et austère. “Toujours avec Charlot, nous avons enchaîné l’arête du Castérioux et l’arête du Diable, où nous fûmes sur le point de prendre la foudre, après avoir entendu les abeilles.” Devenu guide à Chamonix en 1966, Flematti entre à l’École militaire de haute montagne (EMHM), en faisant partie d’une équipe de secours pour sauver deux alpinistes bloqués aux Drus. En septembre de cette année-là, avec le guide René Desmaison et un fidèle client, Lucien Carcassès, Flematti repart dans les Pyrénées enchaîner l’éperon nord de l’aiguille de Labassa et le Petit Balaïtous, où Carcassès se retrouve pendu la tête en bas, à quelques mètres du sol. Deux ans après, ils traversent les Pyrénées, ascensionnant tous les sommets principaux, de l’Ossau au Canigou. Mais il entre dans la légende avec son copain de cordée René Desmaison pour deux grandes tentatives de premières. Celle au pilier du Frêney, la voie la plus difficile du Mont Blanc, qui a déjà coûté la vie à quatre alpinistes. En janvier 1967, ils réussissent, gelés jusqu’aux os, sans nourriture depuis deux jours. Leur retour en héros à Chamonix sera son plus grand souvenir. Un an après, en 1968, ils récidivent avec l’ascension hivernale du Linceul dans la face nord des Grandes Jorasses, après avoir essuyé 13 jours de mauvais temps, “mais c’est sur l’expérience qu’on peut sauver sa vie par la vitesse de décision et d’action”. Robert raconte : « Après douze jours et douze nuits (si l’on veut bien appeler ça des nuits !), le ventre vide depuis deux ou trois jours, et où l’on se régale à croquer à pleines dents une plaquette de beurre gelée à – 30°, où la peur se colle à la peau et devient l’amie intime des grands moments, où l’on ne sait plus trop ni pourquoi ni comment, car les questions deviennent inutiles, et pourtant, chose étrange, il y a un peu de rêve encore. Pour moi, par exemple, je savais qu’il y avait énormément de choses à faire et à voir, et je me promettais, une fois dans la vallée, de me promener, de me promener. Puis il y avait quelques moments de grand vide … Ce fut long pour atteindre l’arête des hirondelles, nous arrivâmes à quelques mètres puis … ce vent violent, cette tornade, folie des éléments ; souffle et jambes coupées, accrochés à la paroi, telles deux petites mouches, nous ne savions comment faire pour nous abriter. Il fallait à tout prix installer la tente ; que de gestes et d’efforts en vain, cela était impossible et pourtant il le fallait. Toute ma vie, je me souviendrai de cet instant. Les cordes se soulevaient, tourbillonnaient, s’entremêlaient. La tempête se ruait sur nous dans toute sa violence. Il y avait quelque chose de l’enfer. Ce fut, je l’avoue sans honte aucune, le moment où ma peur fut la plus grande. Ce fut quelque chose que d’arriver dans des conditions inhumaines au bout de l’objectif, au prix d’efforts inouïs, avec la fatigue, la faim, le froid et cet espoir mêlé au désespoir, pour y trouver cette tempête qui voulait nous arracher notre chance de réussite et peut-être encore plus : notre vie. Mais le linceul ne nous a pas gardés … ». Par deux fois, il échappera à la mort dans les Alpes. Alpiniste, guide de haute montagne à Chamonix, il a gravi les plus hauts sommets du monde en compagnie de René Desmaison et réalisé plusieurs premières dans les années soixante (Pilier du Frêney, Linceul, face sud du Fou...). Plusieurs voies portent son nom, dont une dans le Rocher d'Archiane. En 2007, il fera partie de l’équipe qui monta la Coupe du Monde de Rugby, le si précieux trophée William Web Ellis, au sommet du Mont-Blanc, sur le toit de l’Europe. Retraité depuis 2002, après une brillante carrière à l’École nationale de ski et d’alpinisme de Chamonix, Robert Flematti est revenu hanter les voies du Balaïtous et vit actuellement dans les Pyrénées de sa jeunesse, précisément dans sa grange du Col du Soulor à Arrens-Marsous. Mais pour Robert (ou Umberto), celui qui lui tient à cœur et qui lui pèse le plus, c’est son fils Grégory, enseveli dans une avalanche le 20 octobre 2005 au pied des Annapurnas. Instructeur de générations d'alpinistes à l’École militaire de haute montagne, Flematti était partisan d'un alpinisme ludique motivé par la joie de grimper et le sens de l'amitié et bien loin de tout enjeu médiatique. Il est l’auteur du livre « Flemattissime – Des Pyrénées aux Alpes » paru en 2006, aux Éditions Guérin.
Robert (Umberto) FLEMATTI, né en 1942 près du lac de Côme, en Italie, est un passionné de montagne et l’un des plus grands alpinistes français de sa génération. Il est connu pour avoir franchi la frontière franco-italienne clandestinement à l’âge de 6 ans, en réalisant plus de 300 km à pied, en tenant la main de sa mère, pour rejoindre son père qui travaillait sur les grands barrages pyrénéens. Ainsi en mars 1949, il deviendra un enfant d’Arrens, au fin fond du Val d’Azun. Passionné par le sport, le Balaïtous se révèle vite sa montagne fétiche, où il apprend à repérer isards et abris. À 15 ans, avec son copain Charles Poulot, il réussit une première par Las Néous, avec, à l’arrivée, fesses et doigts glacés. “Je m’étais frotté au risque et ça m’avait tellement plu que je n’attendais qu’une chose : recommencer.” Robert part travailler sur des chantiers, puis enchaîne deux années comme moniteur de ski à La Mongie. Mais ses payes fondent comme neige au soleil. Lucien Cantet, le président du club de ski de fond local, et le maire d’Arrens, le Dr Lebreton, l’inscrivent à un stage de l’École nationale d’alpinisme qui se déroule à Gavarnie, sous la férule d’Armand Charlet, le directeur technique. Retenu, Robert Flematti devient aspirant guide avant de revenir au pays, sur les sentiers qui mènent au… Balaïtous. Son but : réaliser des courses en temps record sur cette montagne hérissée d’à-pics, rude et austère. “Toujours avec Charlot, nous avons enchaîné l’arête du Castérioux et l’arête du Diable, où nous fûmes sur le point de prendre la foudre, après avoir entendu les abeilles.” Devenu guide à Chamonix en 1966, Flematti entre à l’École militaire de haute montagne (EMHM), en faisant partie d’une équipe de secours pour sauver deux alpinistes bloqués aux Drus. En septembre de cette année-là, avec le guide René Desmaison et un fidèle client, Lucien Carcassès, Flematti repart dans les Pyrénées enchaîner l’éperon nord de l’aiguille de Labassa et le Petit Balaïtous, où Carcassès se retrouve pendu la tête en bas, à quelques mètres du sol. Deux ans après, ils traversent les Pyrénées, ascensionnant tous les sommets principaux, de l’Ossau au Canigou. Mais il entre dans la légende avec son copain de cordée René Desmaison pour deux grandes tentatives de premières. Celle au pilier du Frêney, la voie la plus difficile du Mont Blanc, qui a déjà coûté la vie à quatre alpinistes. En janvier 1967, ils réussissent, gelés jusqu’aux os, sans nourriture depuis deux jours. Leur retour en héros à Chamonix sera son plus grand souvenir. Un an après, en 1968, ils récidivent avec l’ascension hivernale du Linceul dans la face nord des Grandes Jorasses, après avoir essuyé 13 jours de mauvais temps, “mais c’est sur l’expérience qu’on peut sauver sa vie par la vitesse de décision et d’action”. Robert raconte : « Après douze jours et douze nuits (si l’on veut bien appeler ça des nuits !), le ventre vide depuis deux ou trois jours, et où l’on se régale à croquer à pleines dents une plaquette de beurre gelée à – 30°, où la peur se colle à la peau et devient l’amie intime des grands moments, où l’on ne sait plus trop ni pourquoi ni comment, car les questions deviennent inutiles, et pourtant, chose étrange, il y a un peu de rêve encore. Pour moi, par exemple, je savais qu’il y avait énormément de choses à faire et à voir, et je me promettais, une fois dans la vallée, de me promener, de me promener. Puis il y avait quelques moments de grand vide … Ce fut long pour atteindre l’arête des hirondelles, nous arrivâmes à quelques mètres puis … ce vent violent, cette tornade, folie des éléments ; souffle et jambes coupées, accrochés à la paroi, telles deux petites mouches, nous ne savions comment faire pour nous abriter. Il fallait à tout prix installer la tente ; que de gestes et d’efforts en vain, cela était impossible et pourtant il le fallait. Toute ma vie, je me souviendrai de cet instant. Les cordes se soulevaient, tourbillonnaient, s’entremêlaient. La tempête se ruait sur nous dans toute sa violence. Il y avait quelque chose de l’enfer. Ce fut, je l’avoue sans honte aucune, le moment où ma peur fut la plus grande. Ce fut quelque chose que d’arriver dans des conditions inhumaines au bout de l’objectif, au prix d’efforts inouïs, avec la fatigue, la faim, le froid et cet espoir mêlé au désespoir, pour y trouver cette tempête qui voulait nous arracher notre chance de réussite et peut-être encore plus : notre vie. Mais le linceul ne nous a pas gardés … ». Par deux fois, il échappera à la mort dans les Alpes. Alpiniste, guide de haute montagne à Chamonix, il a gravi les plus hauts sommets du monde en compagnie de René Desmaison et réalisé plusieurs premières dans les années soixante (Pilier du Frêney, Linceul, face sud du Fou...). Plusieurs voies portent son nom, dont une dans le Rocher d'Archiane. En 2007, il fera partie de l’équipe qui monta la Coupe du Monde de Rugby, le si précieux trophée William Web Ellis, au sommet du Mont-Blanc, sur le toit de l’Europe. Retraité depuis 2002, après une brillante carrière à l’École nationale de ski et d’alpinisme de Chamonix, Robert Flematti est revenu hanter les voies du Balaïtous et vit actuellement dans les Pyrénées de sa jeunesse, précisément dans sa grange du Col du Soulor à Arrens-Marsous. Mais pour Robert (ou Umberto), celui qui lui tient à cœur et qui lui pèse le plus, c’est son fils Grégory, enseveli dans une avalanche le 20 octobre 2005 au pied des Annapurnas. Instructeur de générations d'alpinistes à l’École militaire de haute montagne, Flematti était partisan d'un alpinisme ludique motivé par la joie de grimper et le sens de l'amitié et bien loin de tout enjeu médiatique. Il est l’auteur du livre « Flemattissime – Des Pyrénées aux Alpes » paru en 2006, aux Éditions Guérin.
 Robert (Umberto) FLEMATTI, né en 1942 près du lac de Côme, en Italie, est un passionné de montagne et l’un des plus grands alpinistes français de sa génération. Il est connu pour avoir franchi la frontière franco-italienne clandestinement à l’âge de 6 ans, en réalisant plus de 300 km à pied, en tenant la main de sa mère, pour rejoindre son père qui travaillait sur les grands barrages pyrénéens. Ainsi en mars 1949, il deviendra un enfant d’Arrens, au fin fond du Val d’Azun. Passionné par le sport, le Balaïtous se révèle vite sa montagne fétiche, où il apprend à repérer isards et abris. À 15 ans, avec son copain Charles Poulot, il réussit une première par Las Néous, avec, à l’arrivée, fesses et doigts glacés. “Je m’étais frotté au risque et ça m’avait tellement plu que je n’attendais qu’une chose : recommencer.” Robert part travailler sur des chantiers, puis enchaîne deux années comme moniteur de ski à La Mongie. Mais ses payes fondent comme neige au soleil. Lucien Cantet, le président du club de ski de fond local, et le maire d’Arrens, le Dr Lebreton, l’inscrivent à un stage de l’École nationale d’alpinisme qui se déroule à Gavarnie, sous la férule d’Armand Charlet, le directeur technique. Retenu, Robert Flematti devient aspirant guide avant de revenir au pays, sur les sentiers qui mènent au… Balaïtous. Son but : réaliser des courses en temps record sur cette montagne hérissée d’à-pics, rude et austère. “Toujours avec Charlot, nous avons enchaîné l’arête du Castérioux et l’arête du Diable, où nous fûmes sur le point de prendre la foudre, après avoir entendu les abeilles.” Devenu guide à Chamonix en 1966, Flematti entre à l’École militaire de haute montagne (EMHM), en faisant partie d’une équipe de secours pour sauver deux alpinistes bloqués aux Drus. En septembre de cette année-là, avec le guide René Desmaison et un fidèle client, Lucien Carcassès, Flematti repart dans les Pyrénées enchaîner l’éperon nord de l’aiguille de Labassa et le Petit Balaïtous, où Carcassès se retrouve pendu la tête en bas, à quelques mètres du sol. Deux ans après, ils traversent les Pyrénées, ascensionnant tous les sommets principaux, de l’Ossau au Canigou. Mais il entre dans la légende avec son copain de cordée René Desmaison pour deux grandes tentatives de premières. Celle au pilier du Frêney, la voie la plus difficile du Mont Blanc, qui a déjà coûté la vie à quatre alpinistes. En janvier 1967, ils réussissent, gelés jusqu’aux os, sans nourriture depuis deux jours. Leur retour en héros à Chamonix sera son plus grand souvenir. Un an après, en 1968, ils récidivent avec l’ascension hivernale du Linceul dans la face nord des Grandes Jorasses, après avoir essuyé 13 jours de mauvais temps, “mais c’est sur l’expérience qu’on peut sauver sa vie par la vitesse de décision et d’action”. Robert raconte : « Après douze jours et douze nuits (si l’on veut bien appeler ça des nuits !), le ventre vide depuis deux ou trois jours, et où l’on se régale à croquer à pleines dents une plaquette de beurre gelée à – 30°, où la peur se colle à la peau et devient l’amie intime des grands moments, où l’on ne sait plus trop ni pourquoi ni comment, car les questions deviennent inutiles, et pourtant, chose étrange, il y a un peu de rêve encore. Pour moi, par exemple, je savais qu’il y avait énormément de choses à faire et à voir, et je me promettais, une fois dans la vallée, de me promener, de me promener. Puis il y avait quelques moments de grand vide … Ce fut long pour atteindre l’arête des hirondelles, nous arrivâmes à quelques mètres puis … ce vent violent, cette tornade, folie des éléments ; souffle et jambes coupées, accrochés à la paroi, telles deux petites mouches, nous ne savions comment faire pour nous abriter. Il fallait à tout prix installer la tente ; que de gestes et d’efforts en vain, cela était impossible et pourtant il le fallait. Toute ma vie, je me souviendrai de cet instant. Les cordes se soulevaient, tourbillonnaient, s’entremêlaient. La tempête se ruait sur nous dans toute sa violence. Il y avait quelque chose de l’enfer. Ce fut, je l’avoue sans honte aucune, le moment où ma peur fut la plus grande. Ce fut quelque chose que d’arriver dans des conditions inhumaines au bout de l’objectif, au prix d’efforts inouïs, avec la fatigue, la faim, le froid et cet espoir mêlé au désespoir, pour y trouver cette tempête qui voulait nous arracher notre chance de réussite et peut-être encore plus : notre vie. Mais le linceul ne nous a pas gardés … ». Par deux fois, il échappera à la mort dans les Alpes. Alpiniste, guide de haute montagne à Chamonix, il a gravi les plus hauts sommets du monde en compagnie de René Desmaison et réalisé plusieurs premières dans les années soixante (Pilier du Frêney, Linceul, face sud du Fou...). Plusieurs voies portent son nom, dont une dans le Rocher d'Archiane. En 2007, il fera partie de l’équipe qui monta la Coupe du Monde de Rugby, le si précieux trophée William Web Ellis, au sommet du Mont-Blanc, sur le toit de l’Europe. Retraité depuis 2002, après une brillante carrière à l’École nationale de ski et d’alpinisme de Chamonix, Robert Flematti est revenu hanter les voies du Balaïtous et vit actuellement dans les Pyrénées de sa jeunesse, précisément dans sa grange du Col du Soulor à Arrens-Marsous. Mais pour Robert (ou Umberto), celui qui lui tient à cœur et qui lui pèse le plus, c’est son fils Grégory, enseveli dans une avalanche le 20 octobre 2005 au pied des Annapurnas. Instructeur de générations d'alpinistes à l’École militaire de haute montagne, Flematti était partisan d'un alpinisme ludique motivé par la joie de grimper et le sens de l'amitié et bien loin de tout enjeu médiatique. Il est l’auteur du livre « Flemattissime – Des Pyrénées aux Alpes » paru en 2006, aux Éditions Guérin.
Robert (Umberto) FLEMATTI, né en 1942 près du lac de Côme, en Italie, est un passionné de montagne et l’un des plus grands alpinistes français de sa génération. Il est connu pour avoir franchi la frontière franco-italienne clandestinement à l’âge de 6 ans, en réalisant plus de 300 km à pied, en tenant la main de sa mère, pour rejoindre son père qui travaillait sur les grands barrages pyrénéens. Ainsi en mars 1949, il deviendra un enfant d’Arrens, au fin fond du Val d’Azun. Passionné par le sport, le Balaïtous se révèle vite sa montagne fétiche, où il apprend à repérer isards et abris. À 15 ans, avec son copain Charles Poulot, il réussit une première par Las Néous, avec, à l’arrivée, fesses et doigts glacés. “Je m’étais frotté au risque et ça m’avait tellement plu que je n’attendais qu’une chose : recommencer.” Robert part travailler sur des chantiers, puis enchaîne deux années comme moniteur de ski à La Mongie. Mais ses payes fondent comme neige au soleil. Lucien Cantet, le président du club de ski de fond local, et le maire d’Arrens, le Dr Lebreton, l’inscrivent à un stage de l’École nationale d’alpinisme qui se déroule à Gavarnie, sous la férule d’Armand Charlet, le directeur technique. Retenu, Robert Flematti devient aspirant guide avant de revenir au pays, sur les sentiers qui mènent au… Balaïtous. Son but : réaliser des courses en temps record sur cette montagne hérissée d’à-pics, rude et austère. “Toujours avec Charlot, nous avons enchaîné l’arête du Castérioux et l’arête du Diable, où nous fûmes sur le point de prendre la foudre, après avoir entendu les abeilles.” Devenu guide à Chamonix en 1966, Flematti entre à l’École militaire de haute montagne (EMHM), en faisant partie d’une équipe de secours pour sauver deux alpinistes bloqués aux Drus. En septembre de cette année-là, avec le guide René Desmaison et un fidèle client, Lucien Carcassès, Flematti repart dans les Pyrénées enchaîner l’éperon nord de l’aiguille de Labassa et le Petit Balaïtous, où Carcassès se retrouve pendu la tête en bas, à quelques mètres du sol. Deux ans après, ils traversent les Pyrénées, ascensionnant tous les sommets principaux, de l’Ossau au Canigou. Mais il entre dans la légende avec son copain de cordée René Desmaison pour deux grandes tentatives de premières. Celle au pilier du Frêney, la voie la plus difficile du Mont Blanc, qui a déjà coûté la vie à quatre alpinistes. En janvier 1967, ils réussissent, gelés jusqu’aux os, sans nourriture depuis deux jours. Leur retour en héros à Chamonix sera son plus grand souvenir. Un an après, en 1968, ils récidivent avec l’ascension hivernale du Linceul dans la face nord des Grandes Jorasses, après avoir essuyé 13 jours de mauvais temps, “mais c’est sur l’expérience qu’on peut sauver sa vie par la vitesse de décision et d’action”. Robert raconte : « Après douze jours et douze nuits (si l’on veut bien appeler ça des nuits !), le ventre vide depuis deux ou trois jours, et où l’on se régale à croquer à pleines dents une plaquette de beurre gelée à – 30°, où la peur se colle à la peau et devient l’amie intime des grands moments, où l’on ne sait plus trop ni pourquoi ni comment, car les questions deviennent inutiles, et pourtant, chose étrange, il y a un peu de rêve encore. Pour moi, par exemple, je savais qu’il y avait énormément de choses à faire et à voir, et je me promettais, une fois dans la vallée, de me promener, de me promener. Puis il y avait quelques moments de grand vide … Ce fut long pour atteindre l’arête des hirondelles, nous arrivâmes à quelques mètres puis … ce vent violent, cette tornade, folie des éléments ; souffle et jambes coupées, accrochés à la paroi, telles deux petites mouches, nous ne savions comment faire pour nous abriter. Il fallait à tout prix installer la tente ; que de gestes et d’efforts en vain, cela était impossible et pourtant il le fallait. Toute ma vie, je me souviendrai de cet instant. Les cordes se soulevaient, tourbillonnaient, s’entremêlaient. La tempête se ruait sur nous dans toute sa violence. Il y avait quelque chose de l’enfer. Ce fut, je l’avoue sans honte aucune, le moment où ma peur fut la plus grande. Ce fut quelque chose que d’arriver dans des conditions inhumaines au bout de l’objectif, au prix d’efforts inouïs, avec la fatigue, la faim, le froid et cet espoir mêlé au désespoir, pour y trouver cette tempête qui voulait nous arracher notre chance de réussite et peut-être encore plus : notre vie. Mais le linceul ne nous a pas gardés … ». Par deux fois, il échappera à la mort dans les Alpes. Alpiniste, guide de haute montagne à Chamonix, il a gravi les plus hauts sommets du monde en compagnie de René Desmaison et réalisé plusieurs premières dans les années soixante (Pilier du Frêney, Linceul, face sud du Fou...). Plusieurs voies portent son nom, dont une dans le Rocher d'Archiane. En 2007, il fera partie de l’équipe qui monta la Coupe du Monde de Rugby, le si précieux trophée William Web Ellis, au sommet du Mont-Blanc, sur le toit de l’Europe. Retraité depuis 2002, après une brillante carrière à l’École nationale de ski et d’alpinisme de Chamonix, Robert Flematti est revenu hanter les voies du Balaïtous et vit actuellement dans les Pyrénées de sa jeunesse, précisément dans sa grange du Col du Soulor à Arrens-Marsous. Mais pour Robert (ou Umberto), celui qui lui tient à cœur et qui lui pèse le plus, c’est son fils Grégory, enseveli dans une avalanche le 20 octobre 2005 au pied des Annapurnas. Instructeur de générations d'alpinistes à l’École militaire de haute montagne, Flematti était partisan d'un alpinisme ludique motivé par la joie de grimper et le sens de l'amitié et bien loin de tout enjeu médiatique. Il est l’auteur du livre « Flemattissime – Des Pyrénées aux Alpes » paru en 2006, aux Éditions Guérin.FOCH Ferdinand (1851-1929)
Maréchal de France, de Grande-Bretagne et de Pologne, membre de l’Académie française et de l’Académie des sciences
 Ferdinand FOCH, né le 2 octobre 1851 à Tarbes et mort le 20 mars 1929 à Paris, à l’âge de 77 ans, laisse le souvenir d’une reconnaissance mondiale. Généralissime des armées alliées pendant la Première Guerre mondiale, promu maréchal de France le 7 août 1918. Fils d’un fonctionnaire languedocien, il fit ses études, au gré des mutations de son père, d’abord à Tarbes et Rodez, puis à Saint-Étienne et à Metz. Quand éclata la guerre de 1870, il s’engagea au 4e Régiment d’infanterie. Ayant choisi de rester dans l’armée, il entra à l’École Polytechnique, d’où il sortit en 1873. Ses études terminées, il choisit l’Artillerie et fut affecté au 24e Régiment d’artillerie à Tarbes, avec le grade de lieutenant. En 1885, il entre à l’École supérieure de Guerre, d’où il sort dans les premiers. Il y est professeur de stratégie et de tactique de 1895 à 1901. De 1907 à 1911, il dirige l’École de Guerre, avec le grade de général (il gravit ainsi les échelons de la hiérarchie militaire : lieutenant-colonel en 1898, colonel en 1903, général de brigade en 1907, général de division en 1911, général de corps d’armée en 1913, à la tête du XXe corps d’armée à Nancy). De cet enseignement, sont nés deux ouvrages : « Des principes de la guerre » (1903) et « De la conduite de la guerre » (1904). Dès août 1914, placé à la tête du XXe corps d’armée, il contribua effectivement à enrayer la progression de l’armée allemande en Lorraine. Adjoint de Joffre, il coordonna les troupes alliées qui stoppèrent les Allemands dans leur « Course à la Mer » (septembre / novembre 1914). Nommé à la tête des armées du Nord, il dirigea en 1915 l’offensive d’Artois et, en 1916, la bataille de la Somme. À la fin de l’année 1916, il ne fut pas épargné par la disgrâce qui toucha Joffre. En 1917, rappelé, il fut nommé chef d’État-major général auprès du gouvernement et désigné comme Commandant en chef des Armées alliées en avril 1918. Il fut à l’origine de la contre-offensive qui aboutit à la victoire de la seconde bataille de la Marne, puis à la capitulation de l’armée allemande, concrétisée par l’armistice du 11 novembre 1918, qu’il signa à 5h15 dans un wagon dans la forêt de Compiègne à Rethondes. Le jour de la signature de l’armistice, à laquelle il présida, il fut reçu à l’Académie des sciences et, dix jours plus tard, le 21 novembre, à l’Académie française, à l’unanimité des vingt-trois votants, au fauteuil du marquis de Vogüé et, en 1919, il devient président du Conseil supérieur de la guerre. Lors du défilé de la Victoire le 14 juillet 1919 sur les Champs-Elysées, il défila à la tête des armées alliées. Il repose depuis 1937 sous le dôme des Invalides à Paris parmi les grands maréchaux de France qui ont servi la nation. Au cœur de la ville de Tarbes, dans le quartier historique, près de la cathédrale de la Sède, se trouve la Maison natale du Maréchal Foch. Classée Monument Historique en 1938, cette maison est devenue un musée en 1951, où sont présentés collections, souvenirs et documents lui ayant appartenu ou témoignant de la grande popularité de ce vainqueur de la Première Guerre mondiale. Le 1er mars 2008, elle a fait l’objet d’un transfert de propriété de l’État à la ville de Tarbes. Une statue équestre du Maréchal Foch en bronze des sculpteurs Robert Wlérick et Raymond Martin, est située sur la place du Trocadéro-et-du-11-Novembre dans le 16e arrondissement de Paris. À Tarbes, face à la caserne du 1er Régiment des Hussards Parachutistes, une statue du maréchal, représenté à cheval, trône dans une magistrale mise en scène au bout des allées Leclerc et la plus belle rue de cette ville porte son nom. Il restera dans les mémoires un des plus grands personnages de la Première Guerre mondiale, celui qui mena les Alliés à la victoire. Il est aussi le tarbais le plus célèbre du XXe siècle.
Ferdinand FOCH, né le 2 octobre 1851 à Tarbes et mort le 20 mars 1929 à Paris, à l’âge de 77 ans, laisse le souvenir d’une reconnaissance mondiale. Généralissime des armées alliées pendant la Première Guerre mondiale, promu maréchal de France le 7 août 1918. Fils d’un fonctionnaire languedocien, il fit ses études, au gré des mutations de son père, d’abord à Tarbes et Rodez, puis à Saint-Étienne et à Metz. Quand éclata la guerre de 1870, il s’engagea au 4e Régiment d’infanterie. Ayant choisi de rester dans l’armée, il entra à l’École Polytechnique, d’où il sortit en 1873. Ses études terminées, il choisit l’Artillerie et fut affecté au 24e Régiment d’artillerie à Tarbes, avec le grade de lieutenant. En 1885, il entre à l’École supérieure de Guerre, d’où il sort dans les premiers. Il y est professeur de stratégie et de tactique de 1895 à 1901. De 1907 à 1911, il dirige l’École de Guerre, avec le grade de général (il gravit ainsi les échelons de la hiérarchie militaire : lieutenant-colonel en 1898, colonel en 1903, général de brigade en 1907, général de division en 1911, général de corps d’armée en 1913, à la tête du XXe corps d’armée à Nancy). De cet enseignement, sont nés deux ouvrages : « Des principes de la guerre » (1903) et « De la conduite de la guerre » (1904). Dès août 1914, placé à la tête du XXe corps d’armée, il contribua effectivement à enrayer la progression de l’armée allemande en Lorraine. Adjoint de Joffre, il coordonna les troupes alliées qui stoppèrent les Allemands dans leur « Course à la Mer » (septembre / novembre 1914). Nommé à la tête des armées du Nord, il dirigea en 1915 l’offensive d’Artois et, en 1916, la bataille de la Somme. À la fin de l’année 1916, il ne fut pas épargné par la disgrâce qui toucha Joffre. En 1917, rappelé, il fut nommé chef d’État-major général auprès du gouvernement et désigné comme Commandant en chef des Armées alliées en avril 1918. Il fut à l’origine de la contre-offensive qui aboutit à la victoire de la seconde bataille de la Marne, puis à la capitulation de l’armée allemande, concrétisée par l’armistice du 11 novembre 1918, qu’il signa à 5h15 dans un wagon dans la forêt de Compiègne à Rethondes. Le jour de la signature de l’armistice, à laquelle il présida, il fut reçu à l’Académie des sciences et, dix jours plus tard, le 21 novembre, à l’Académie française, à l’unanimité des vingt-trois votants, au fauteuil du marquis de Vogüé et, en 1919, il devient président du Conseil supérieur de la guerre. Lors du défilé de la Victoire le 14 juillet 1919 sur les Champs-Elysées, il défila à la tête des armées alliées. Il repose depuis 1937 sous le dôme des Invalides à Paris parmi les grands maréchaux de France qui ont servi la nation. Au cœur de la ville de Tarbes, dans le quartier historique, près de la cathédrale de la Sède, se trouve la Maison natale du Maréchal Foch. Classée Monument Historique en 1938, cette maison est devenue un musée en 1951, où sont présentés collections, souvenirs et documents lui ayant appartenu ou témoignant de la grande popularité de ce vainqueur de la Première Guerre mondiale. Le 1er mars 2008, elle a fait l’objet d’un transfert de propriété de l’État à la ville de Tarbes. Une statue équestre du Maréchal Foch en bronze des sculpteurs Robert Wlérick et Raymond Martin, est située sur la place du Trocadéro-et-du-11-Novembre dans le 16e arrondissement de Paris. À Tarbes, face à la caserne du 1er Régiment des Hussards Parachutistes, une statue du maréchal, représenté à cheval, trône dans une magistrale mise en scène au bout des allées Leclerc et la plus belle rue de cette ville porte son nom. Il restera dans les mémoires un des plus grands personnages de la Première Guerre mondiale, celui qui mena les Alliés à la victoire. Il est aussi le tarbais le plus célèbre du XXe siècle.
 Ferdinand FOCH, né le 2 octobre 1851 à Tarbes et mort le 20 mars 1929 à Paris, à l’âge de 77 ans, laisse le souvenir d’une reconnaissance mondiale. Généralissime des armées alliées pendant la Première Guerre mondiale, promu maréchal de France le 7 août 1918. Fils d’un fonctionnaire languedocien, il fit ses études, au gré des mutations de son père, d’abord à Tarbes et Rodez, puis à Saint-Étienne et à Metz. Quand éclata la guerre de 1870, il s’engagea au 4e Régiment d’infanterie. Ayant choisi de rester dans l’armée, il entra à l’École Polytechnique, d’où il sortit en 1873. Ses études terminées, il choisit l’Artillerie et fut affecté au 24e Régiment d’artillerie à Tarbes, avec le grade de lieutenant. En 1885, il entre à l’École supérieure de Guerre, d’où il sort dans les premiers. Il y est professeur de stratégie et de tactique de 1895 à 1901. De 1907 à 1911, il dirige l’École de Guerre, avec le grade de général (il gravit ainsi les échelons de la hiérarchie militaire : lieutenant-colonel en 1898, colonel en 1903, général de brigade en 1907, général de division en 1911, général de corps d’armée en 1913, à la tête du XXe corps d’armée à Nancy). De cet enseignement, sont nés deux ouvrages : « Des principes de la guerre » (1903) et « De la conduite de la guerre » (1904). Dès août 1914, placé à la tête du XXe corps d’armée, il contribua effectivement à enrayer la progression de l’armée allemande en Lorraine. Adjoint de Joffre, il coordonna les troupes alliées qui stoppèrent les Allemands dans leur « Course à la Mer » (septembre / novembre 1914). Nommé à la tête des armées du Nord, il dirigea en 1915 l’offensive d’Artois et, en 1916, la bataille de la Somme. À la fin de l’année 1916, il ne fut pas épargné par la disgrâce qui toucha Joffre. En 1917, rappelé, il fut nommé chef d’État-major général auprès du gouvernement et désigné comme Commandant en chef des Armées alliées en avril 1918. Il fut à l’origine de la contre-offensive qui aboutit à la victoire de la seconde bataille de la Marne, puis à la capitulation de l’armée allemande, concrétisée par l’armistice du 11 novembre 1918, qu’il signa à 5h15 dans un wagon dans la forêt de Compiègne à Rethondes. Le jour de la signature de l’armistice, à laquelle il présida, il fut reçu à l’Académie des sciences et, dix jours plus tard, le 21 novembre, à l’Académie française, à l’unanimité des vingt-trois votants, au fauteuil du marquis de Vogüé et, en 1919, il devient président du Conseil supérieur de la guerre. Lors du défilé de la Victoire le 14 juillet 1919 sur les Champs-Elysées, il défila à la tête des armées alliées. Il repose depuis 1937 sous le dôme des Invalides à Paris parmi les grands maréchaux de France qui ont servi la nation. Au cœur de la ville de Tarbes, dans le quartier historique, près de la cathédrale de la Sède, se trouve la Maison natale du Maréchal Foch. Classée Monument Historique en 1938, cette maison est devenue un musée en 1951, où sont présentés collections, souvenirs et documents lui ayant appartenu ou témoignant de la grande popularité de ce vainqueur de la Première Guerre mondiale. Le 1er mars 2008, elle a fait l’objet d’un transfert de propriété de l’État à la ville de Tarbes. Une statue équestre du Maréchal Foch en bronze des sculpteurs Robert Wlérick et Raymond Martin, est située sur la place du Trocadéro-et-du-11-Novembre dans le 16e arrondissement de Paris. À Tarbes, face à la caserne du 1er Régiment des Hussards Parachutistes, une statue du maréchal, représenté à cheval, trône dans une magistrale mise en scène au bout des allées Leclerc et la plus belle rue de cette ville porte son nom. Il restera dans les mémoires un des plus grands personnages de la Première Guerre mondiale, celui qui mena les Alliés à la victoire. Il est aussi le tarbais le plus célèbre du XXe siècle.
Ferdinand FOCH, né le 2 octobre 1851 à Tarbes et mort le 20 mars 1929 à Paris, à l’âge de 77 ans, laisse le souvenir d’une reconnaissance mondiale. Généralissime des armées alliées pendant la Première Guerre mondiale, promu maréchal de France le 7 août 1918. Fils d’un fonctionnaire languedocien, il fit ses études, au gré des mutations de son père, d’abord à Tarbes et Rodez, puis à Saint-Étienne et à Metz. Quand éclata la guerre de 1870, il s’engagea au 4e Régiment d’infanterie. Ayant choisi de rester dans l’armée, il entra à l’École Polytechnique, d’où il sortit en 1873. Ses études terminées, il choisit l’Artillerie et fut affecté au 24e Régiment d’artillerie à Tarbes, avec le grade de lieutenant. En 1885, il entre à l’École supérieure de Guerre, d’où il sort dans les premiers. Il y est professeur de stratégie et de tactique de 1895 à 1901. De 1907 à 1911, il dirige l’École de Guerre, avec le grade de général (il gravit ainsi les échelons de la hiérarchie militaire : lieutenant-colonel en 1898, colonel en 1903, général de brigade en 1907, général de division en 1911, général de corps d’armée en 1913, à la tête du XXe corps d’armée à Nancy). De cet enseignement, sont nés deux ouvrages : « Des principes de la guerre » (1903) et « De la conduite de la guerre » (1904). Dès août 1914, placé à la tête du XXe corps d’armée, il contribua effectivement à enrayer la progression de l’armée allemande en Lorraine. Adjoint de Joffre, il coordonna les troupes alliées qui stoppèrent les Allemands dans leur « Course à la Mer » (septembre / novembre 1914). Nommé à la tête des armées du Nord, il dirigea en 1915 l’offensive d’Artois et, en 1916, la bataille de la Somme. À la fin de l’année 1916, il ne fut pas épargné par la disgrâce qui toucha Joffre. En 1917, rappelé, il fut nommé chef d’État-major général auprès du gouvernement et désigné comme Commandant en chef des Armées alliées en avril 1918. Il fut à l’origine de la contre-offensive qui aboutit à la victoire de la seconde bataille de la Marne, puis à la capitulation de l’armée allemande, concrétisée par l’armistice du 11 novembre 1918, qu’il signa à 5h15 dans un wagon dans la forêt de Compiègne à Rethondes. Le jour de la signature de l’armistice, à laquelle il présida, il fut reçu à l’Académie des sciences et, dix jours plus tard, le 21 novembre, à l’Académie française, à l’unanimité des vingt-trois votants, au fauteuil du marquis de Vogüé et, en 1919, il devient président du Conseil supérieur de la guerre. Lors du défilé de la Victoire le 14 juillet 1919 sur les Champs-Elysées, il défila à la tête des armées alliées. Il repose depuis 1937 sous le dôme des Invalides à Paris parmi les grands maréchaux de France qui ont servi la nation. Au cœur de la ville de Tarbes, dans le quartier historique, près de la cathédrale de la Sède, se trouve la Maison natale du Maréchal Foch. Classée Monument Historique en 1938, cette maison est devenue un musée en 1951, où sont présentés collections, souvenirs et documents lui ayant appartenu ou témoignant de la grande popularité de ce vainqueur de la Première Guerre mondiale. Le 1er mars 2008, elle a fait l’objet d’un transfert de propriété de l’État à la ville de Tarbes. Une statue équestre du Maréchal Foch en bronze des sculpteurs Robert Wlérick et Raymond Martin, est située sur la place du Trocadéro-et-du-11-Novembre dans le 16e arrondissement de Paris. À Tarbes, face à la caserne du 1er Régiment des Hussards Parachutistes, une statue du maréchal, représenté à cheval, trône dans une magistrale mise en scène au bout des allées Leclerc et la plus belle rue de cette ville porte son nom. Il restera dans les mémoires un des plus grands personnages de la Première Guerre mondiale, celui qui mena les Alliés à la victoire. Il est aussi le tarbais le plus célèbre du XXe siècle.FORGUES Wilfried (Sandra) (1969-XXXX)
Kayakiste champion olympique
 Wilfried FORGUES, devenu Sandra, née le 22 décembre 1969 à Tarbes, prénommée jusqu'en 2016 Wilfrid Forgues, est une sportive française. Elle a remporté le titre de champion olympique masculin de canoë biplace en 1996 à Atlanta, avec son coéquipier Frank Adisson. Non content d'être un des meilleurs kayakistes du monde, Wilfrid Forgues parvient à décrocher un DEA d'informatique en 1994. Ce sera la porte de sa reconversion. Fille de professeurs, Sandra Forgues grandit à Gerde en tant que garçon prénommé Wilfrid, son enfance étant marquée par son désir d'être une fille. Elle se lance à corps perdu dans le sport et ses études, sa carrière de kayakiste se terminant aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Alors qu’elle mène une vie épanouie de père de famille marié avec deux enfants, directrice technique de Media Broadcast Technologies, présidente du Conseil d’administration du CREPS de Toulouse, elle a été présidente de l'ONG du Flocon à la Vague jusqu'en janvier 2019, Wilfrid, ancien champion mondial de canoë, décide de franchir le pas fin 2016, à l’aube de ses 50 ans, afin de devenir Sandra en révélant sa transidentité. Ce jour de novembre 2016, où Sandra s'est enfin décidée à franchir la frontière, qui séparait les deux personnes qui vivaient en elle, ce moment où elle s'est libérée de ce corps d'homme qui emprisonnait son cœur et son esprit de femme. Une transition vers une nouvelle vie, mais un vrai combat et une onde de choc, non sans conséquences sur l’équilibre familial. Car il (elle) partageait une vie harmonieuse avec Fabienne sa femme et leurs deux ados, un fils et une fille alors âgés de 16 et 20 ans. Et il aura fallu un long travail d'explication pour que son père aussi comprenne que ce n'était pas une lubie et qu'il fasse le deuil de son fils. Nul doute qu’il faudra encore du temps pour que l'acceptation soit totale. "Le lien très fort avec ma femme a permis à mes enfants de surmonter ce cataclysme." Et c’est également en 2016 aussi que Wilfried annonce à son partenaire de canoë Frank Adisson sa décision de changer de sexe. « Pendant que lui rêvait d'un corps de femme, moi je rêvais d'avoir son corps musclé », confiait, Frank Adisson, son ami champion olympique en 1996. Plus tard le 9 mars 2018, elle le révèlera au quotidien L’Équipe. Elle entreprend alors sa transition. Sandra Forgues a désormais changé d'identité officiellement et vit aujourd'hui en tant que femme. Elle travaille en tant que responsable du système d'information dans la société DSI entreprise adaptée et solidaire. Son palmarès : Trois fois champion de France ; Médaille de bronze en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone en Espagne ; Médaille d'or en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta aux États-Unis ; 7e en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 2000 à Sydney ; Médaille d'or en individuel au championnat du monde à Spittal (Autriche - junior) en 1986 ; Médailles d'or aux championnats du monde de slalom à Tacen en Slovénie en 1991 et à Tres Coroas au Brésil en 1997 ; Médaille d'argent en individuel et par équipe au championnat du monde de slalom à Nottingham au Royaume-Uni en 1995 ; Médaille de bronze au championnat du monde à Mezzana en Italie en 1993. Tarnais depuis 1997, Wilfrid avait vécu 20 ans avec sa femme et ses 2 enfants à Saint-Sulpice. Devenu Sandra, elle a refusé de disparaître dans l'anonymat d'une grande ville. Bien au contraire, elle s'est installée, tout à côté, à Saint-Agnan, village de 300 habitants, bien intégrée dans un petit lotissement tout juste sorti de terre. « J'ai des voisins géniaux. Ma transition s'est passée dans de bonnes conditions. » Son seul regret c'est d'avoir perdu la femme de sa vie, Fabienne, cette femme chérie. Et pour ses enfants il (elle) restera toujours leur papa, et sa famille continuera d'exister. En 2019, la Bagnéraise Sandra Forgues a été candidate aux municipales de Toulouse sur la liste conduite par Nadia Pellefigue (PS), emboîtant ainsi le pas à son père, ancien membre du PS en Bigorre. Un engagement politique, où elle pourrait mettre à profit son expérience et ses compétences dans le domaine sportif, plus que pour des convictions politiques. "Sur le moment, on peut vivre de son sport, mais après, c'est autre chose". Diplômé en informatique en 1994 puis chargé de projet à France Télécom de 1995 à 2000, il bénéficiait d'un contrat aménagé afin de pouvoir continuer la compétition au plus haut niveau sans négliger sa carrière d'ingénieur. En 2000, sa carrière de sportif est sur le déclin. Il saisit alors sa chance quand France Télécom offrit à ses salariés un plan d'aide à la création d'entreprise pour les candidats volontaires au départ. "Ils me couvraient en cas d'échec dans un premier temps" confiera l'ancien champion olympique pour expliquer sa décision. "Mon frère m'a proposé de créer une filiale de son entreprise d'informatique ». Kelern, rebaptisée depuis, Media Broadcast Technology, naît en septembre 2000. Il propose des interfaces informatiques aux régies audiovisuelles. C'est alors une nouvelle aventure qui redémarre. Au quotidien, Wilfrid Forgues se comporte comme un athlète qui se donne un objectif et qui se remet en cause fréquemment. Le milieu des affaires en revanche est une découverte. « Dans le sport, il y a un règlement et c'est que le meilleur gagne. Dans l'entreprise, il y a moins de règles. Si dans le sport on respecte l'adversaire, dans le business, on rencontre des tueurs », témoigne le kayakiste. « Si j'avais une utopie sportive, je n'en ai aucune dans l'entreprise. » En revanche, il se sert peu de son carnet d'adresses. Mais s'il ne met pas en avant son palmarès dans ses relations d'affaires, il reconnait que ceux qui l'apprennent ou le savent peuvent considérer ces états de service comme un gage. « Ils se disent que c'est un gars qui ne lâche pas le morceau ». Aujourd'hui sa société réalise un bon chiffre d'affaires et compte parmi ses clients Canal+, Radio France, TF1 et France Télévision. Sandra a raconté récemment son parcours dans son livre paru le 16 juin 2018 : Un jour peut-être... (chez Outdoor- Éditions). Ce récit au parlé vrai, empreint d’émotion mais toujours ponctué d’humour, est un témoignage précieux qui contribuera sans aucun doute à mieux faire comprendre et mieux accepter la transidentité au sein de notre société française.
Wilfried FORGUES, devenu Sandra, née le 22 décembre 1969 à Tarbes, prénommée jusqu'en 2016 Wilfrid Forgues, est une sportive française. Elle a remporté le titre de champion olympique masculin de canoë biplace en 1996 à Atlanta, avec son coéquipier Frank Adisson. Non content d'être un des meilleurs kayakistes du monde, Wilfrid Forgues parvient à décrocher un DEA d'informatique en 1994. Ce sera la porte de sa reconversion. Fille de professeurs, Sandra Forgues grandit à Gerde en tant que garçon prénommé Wilfrid, son enfance étant marquée par son désir d'être une fille. Elle se lance à corps perdu dans le sport et ses études, sa carrière de kayakiste se terminant aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Alors qu’elle mène une vie épanouie de père de famille marié avec deux enfants, directrice technique de Media Broadcast Technologies, présidente du Conseil d’administration du CREPS de Toulouse, elle a été présidente de l'ONG du Flocon à la Vague jusqu'en janvier 2019, Wilfrid, ancien champion mondial de canoë, décide de franchir le pas fin 2016, à l’aube de ses 50 ans, afin de devenir Sandra en révélant sa transidentité. Ce jour de novembre 2016, où Sandra s'est enfin décidée à franchir la frontière, qui séparait les deux personnes qui vivaient en elle, ce moment où elle s'est libérée de ce corps d'homme qui emprisonnait son cœur et son esprit de femme. Une transition vers une nouvelle vie, mais un vrai combat et une onde de choc, non sans conséquences sur l’équilibre familial. Car il (elle) partageait une vie harmonieuse avec Fabienne sa femme et leurs deux ados, un fils et une fille alors âgés de 16 et 20 ans. Et il aura fallu un long travail d'explication pour que son père aussi comprenne que ce n'était pas une lubie et qu'il fasse le deuil de son fils. Nul doute qu’il faudra encore du temps pour que l'acceptation soit totale. "Le lien très fort avec ma femme a permis à mes enfants de surmonter ce cataclysme." Et c’est également en 2016 aussi que Wilfried annonce à son partenaire de canoë Frank Adisson sa décision de changer de sexe. « Pendant que lui rêvait d'un corps de femme, moi je rêvais d'avoir son corps musclé », confiait, Frank Adisson, son ami champion olympique en 1996. Plus tard le 9 mars 2018, elle le révèlera au quotidien L’Équipe. Elle entreprend alors sa transition. Sandra Forgues a désormais changé d'identité officiellement et vit aujourd'hui en tant que femme. Elle travaille en tant que responsable du système d'information dans la société DSI entreprise adaptée et solidaire. Son palmarès : Trois fois champion de France ; Médaille de bronze en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone en Espagne ; Médaille d'or en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta aux États-Unis ; 7e en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 2000 à Sydney ; Médaille d'or en individuel au championnat du monde à Spittal (Autriche - junior) en 1986 ; Médailles d'or aux championnats du monde de slalom à Tacen en Slovénie en 1991 et à Tres Coroas au Brésil en 1997 ; Médaille d'argent en individuel et par équipe au championnat du monde de slalom à Nottingham au Royaume-Uni en 1995 ; Médaille de bronze au championnat du monde à Mezzana en Italie en 1993. Tarnais depuis 1997, Wilfrid avait vécu 20 ans avec sa femme et ses 2 enfants à Saint-Sulpice. Devenu Sandra, elle a refusé de disparaître dans l'anonymat d'une grande ville. Bien au contraire, elle s'est installée, tout à côté, à Saint-Agnan, village de 300 habitants, bien intégrée dans un petit lotissement tout juste sorti de terre. « J'ai des voisins géniaux. Ma transition s'est passée dans de bonnes conditions. » Son seul regret c'est d'avoir perdu la femme de sa vie, Fabienne, cette femme chérie. Et pour ses enfants il (elle) restera toujours leur papa, et sa famille continuera d'exister. En 2019, la Bagnéraise Sandra Forgues a été candidate aux municipales de Toulouse sur la liste conduite par Nadia Pellefigue (PS), emboîtant ainsi le pas à son père, ancien membre du PS en Bigorre. Un engagement politique, où elle pourrait mettre à profit son expérience et ses compétences dans le domaine sportif, plus que pour des convictions politiques. "Sur le moment, on peut vivre de son sport, mais après, c'est autre chose". Diplômé en informatique en 1994 puis chargé de projet à France Télécom de 1995 à 2000, il bénéficiait d'un contrat aménagé afin de pouvoir continuer la compétition au plus haut niveau sans négliger sa carrière d'ingénieur. En 2000, sa carrière de sportif est sur le déclin. Il saisit alors sa chance quand France Télécom offrit à ses salariés un plan d'aide à la création d'entreprise pour les candidats volontaires au départ. "Ils me couvraient en cas d'échec dans un premier temps" confiera l'ancien champion olympique pour expliquer sa décision. "Mon frère m'a proposé de créer une filiale de son entreprise d'informatique ». Kelern, rebaptisée depuis, Media Broadcast Technology, naît en septembre 2000. Il propose des interfaces informatiques aux régies audiovisuelles. C'est alors une nouvelle aventure qui redémarre. Au quotidien, Wilfrid Forgues se comporte comme un athlète qui se donne un objectif et qui se remet en cause fréquemment. Le milieu des affaires en revanche est une découverte. « Dans le sport, il y a un règlement et c'est que le meilleur gagne. Dans l'entreprise, il y a moins de règles. Si dans le sport on respecte l'adversaire, dans le business, on rencontre des tueurs », témoigne le kayakiste. « Si j'avais une utopie sportive, je n'en ai aucune dans l'entreprise. » En revanche, il se sert peu de son carnet d'adresses. Mais s'il ne met pas en avant son palmarès dans ses relations d'affaires, il reconnait que ceux qui l'apprennent ou le savent peuvent considérer ces états de service comme un gage. « Ils se disent que c'est un gars qui ne lâche pas le morceau ». Aujourd'hui sa société réalise un bon chiffre d'affaires et compte parmi ses clients Canal+, Radio France, TF1 et France Télévision. Sandra a raconté récemment son parcours dans son livre paru le 16 juin 2018 : Un jour peut-être... (chez Outdoor- Éditions). Ce récit au parlé vrai, empreint d’émotion mais toujours ponctué d’humour, est un témoignage précieux qui contribuera sans aucun doute à mieux faire comprendre et mieux accepter la transidentité au sein de notre société française.
 Wilfried FORGUES, devenu Sandra, née le 22 décembre 1969 à Tarbes, prénommée jusqu'en 2016 Wilfrid Forgues, est une sportive française. Elle a remporté le titre de champion olympique masculin de canoë biplace en 1996 à Atlanta, avec son coéquipier Frank Adisson. Non content d'être un des meilleurs kayakistes du monde, Wilfrid Forgues parvient à décrocher un DEA d'informatique en 1994. Ce sera la porte de sa reconversion. Fille de professeurs, Sandra Forgues grandit à Gerde en tant que garçon prénommé Wilfrid, son enfance étant marquée par son désir d'être une fille. Elle se lance à corps perdu dans le sport et ses études, sa carrière de kayakiste se terminant aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Alors qu’elle mène une vie épanouie de père de famille marié avec deux enfants, directrice technique de Media Broadcast Technologies, présidente du Conseil d’administration du CREPS de Toulouse, elle a été présidente de l'ONG du Flocon à la Vague jusqu'en janvier 2019, Wilfrid, ancien champion mondial de canoë, décide de franchir le pas fin 2016, à l’aube de ses 50 ans, afin de devenir Sandra en révélant sa transidentité. Ce jour de novembre 2016, où Sandra s'est enfin décidée à franchir la frontière, qui séparait les deux personnes qui vivaient en elle, ce moment où elle s'est libérée de ce corps d'homme qui emprisonnait son cœur et son esprit de femme. Une transition vers une nouvelle vie, mais un vrai combat et une onde de choc, non sans conséquences sur l’équilibre familial. Car il (elle) partageait une vie harmonieuse avec Fabienne sa femme et leurs deux ados, un fils et une fille alors âgés de 16 et 20 ans. Et il aura fallu un long travail d'explication pour que son père aussi comprenne que ce n'était pas une lubie et qu'il fasse le deuil de son fils. Nul doute qu’il faudra encore du temps pour que l'acceptation soit totale. "Le lien très fort avec ma femme a permis à mes enfants de surmonter ce cataclysme." Et c’est également en 2016 aussi que Wilfried annonce à son partenaire de canoë Frank Adisson sa décision de changer de sexe. « Pendant que lui rêvait d'un corps de femme, moi je rêvais d'avoir son corps musclé », confiait, Frank Adisson, son ami champion olympique en 1996. Plus tard le 9 mars 2018, elle le révèlera au quotidien L’Équipe. Elle entreprend alors sa transition. Sandra Forgues a désormais changé d'identité officiellement et vit aujourd'hui en tant que femme. Elle travaille en tant que responsable du système d'information dans la société DSI entreprise adaptée et solidaire. Son palmarès : Trois fois champion de France ; Médaille de bronze en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone en Espagne ; Médaille d'or en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta aux États-Unis ; 7e en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 2000 à Sydney ; Médaille d'or en individuel au championnat du monde à Spittal (Autriche - junior) en 1986 ; Médailles d'or aux championnats du monde de slalom à Tacen en Slovénie en 1991 et à Tres Coroas au Brésil en 1997 ; Médaille d'argent en individuel et par équipe au championnat du monde de slalom à Nottingham au Royaume-Uni en 1995 ; Médaille de bronze au championnat du monde à Mezzana en Italie en 1993. Tarnais depuis 1997, Wilfrid avait vécu 20 ans avec sa femme et ses 2 enfants à Saint-Sulpice. Devenu Sandra, elle a refusé de disparaître dans l'anonymat d'une grande ville. Bien au contraire, elle s'est installée, tout à côté, à Saint-Agnan, village de 300 habitants, bien intégrée dans un petit lotissement tout juste sorti de terre. « J'ai des voisins géniaux. Ma transition s'est passée dans de bonnes conditions. » Son seul regret c'est d'avoir perdu la femme de sa vie, Fabienne, cette femme chérie. Et pour ses enfants il (elle) restera toujours leur papa, et sa famille continuera d'exister. En 2019, la Bagnéraise Sandra Forgues a été candidate aux municipales de Toulouse sur la liste conduite par Nadia Pellefigue (PS), emboîtant ainsi le pas à son père, ancien membre du PS en Bigorre. Un engagement politique, où elle pourrait mettre à profit son expérience et ses compétences dans le domaine sportif, plus que pour des convictions politiques. "Sur le moment, on peut vivre de son sport, mais après, c'est autre chose". Diplômé en informatique en 1994 puis chargé de projet à France Télécom de 1995 à 2000, il bénéficiait d'un contrat aménagé afin de pouvoir continuer la compétition au plus haut niveau sans négliger sa carrière d'ingénieur. En 2000, sa carrière de sportif est sur le déclin. Il saisit alors sa chance quand France Télécom offrit à ses salariés un plan d'aide à la création d'entreprise pour les candidats volontaires au départ. "Ils me couvraient en cas d'échec dans un premier temps" confiera l'ancien champion olympique pour expliquer sa décision. "Mon frère m'a proposé de créer une filiale de son entreprise d'informatique ». Kelern, rebaptisée depuis, Media Broadcast Technology, naît en septembre 2000. Il propose des interfaces informatiques aux régies audiovisuelles. C'est alors une nouvelle aventure qui redémarre. Au quotidien, Wilfrid Forgues se comporte comme un athlète qui se donne un objectif et qui se remet en cause fréquemment. Le milieu des affaires en revanche est une découverte. « Dans le sport, il y a un règlement et c'est que le meilleur gagne. Dans l'entreprise, il y a moins de règles. Si dans le sport on respecte l'adversaire, dans le business, on rencontre des tueurs », témoigne le kayakiste. « Si j'avais une utopie sportive, je n'en ai aucune dans l'entreprise. » En revanche, il se sert peu de son carnet d'adresses. Mais s'il ne met pas en avant son palmarès dans ses relations d'affaires, il reconnait que ceux qui l'apprennent ou le savent peuvent considérer ces états de service comme un gage. « Ils se disent que c'est un gars qui ne lâche pas le morceau ». Aujourd'hui sa société réalise un bon chiffre d'affaires et compte parmi ses clients Canal+, Radio France, TF1 et France Télévision. Sandra a raconté récemment son parcours dans son livre paru le 16 juin 2018 : Un jour peut-être... (chez Outdoor- Éditions). Ce récit au parlé vrai, empreint d’émotion mais toujours ponctué d’humour, est un témoignage précieux qui contribuera sans aucun doute à mieux faire comprendre et mieux accepter la transidentité au sein de notre société française.
Wilfried FORGUES, devenu Sandra, née le 22 décembre 1969 à Tarbes, prénommée jusqu'en 2016 Wilfrid Forgues, est une sportive française. Elle a remporté le titre de champion olympique masculin de canoë biplace en 1996 à Atlanta, avec son coéquipier Frank Adisson. Non content d'être un des meilleurs kayakistes du monde, Wilfrid Forgues parvient à décrocher un DEA d'informatique en 1994. Ce sera la porte de sa reconversion. Fille de professeurs, Sandra Forgues grandit à Gerde en tant que garçon prénommé Wilfrid, son enfance étant marquée par son désir d'être une fille. Elle se lance à corps perdu dans le sport et ses études, sa carrière de kayakiste se terminant aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Alors qu’elle mène une vie épanouie de père de famille marié avec deux enfants, directrice technique de Media Broadcast Technologies, présidente du Conseil d’administration du CREPS de Toulouse, elle a été présidente de l'ONG du Flocon à la Vague jusqu'en janvier 2019, Wilfrid, ancien champion mondial de canoë, décide de franchir le pas fin 2016, à l’aube de ses 50 ans, afin de devenir Sandra en révélant sa transidentité. Ce jour de novembre 2016, où Sandra s'est enfin décidée à franchir la frontière, qui séparait les deux personnes qui vivaient en elle, ce moment où elle s'est libérée de ce corps d'homme qui emprisonnait son cœur et son esprit de femme. Une transition vers une nouvelle vie, mais un vrai combat et une onde de choc, non sans conséquences sur l’équilibre familial. Car il (elle) partageait une vie harmonieuse avec Fabienne sa femme et leurs deux ados, un fils et une fille alors âgés de 16 et 20 ans. Et il aura fallu un long travail d'explication pour que son père aussi comprenne que ce n'était pas une lubie et qu'il fasse le deuil de son fils. Nul doute qu’il faudra encore du temps pour que l'acceptation soit totale. "Le lien très fort avec ma femme a permis à mes enfants de surmonter ce cataclysme." Et c’est également en 2016 aussi que Wilfried annonce à son partenaire de canoë Frank Adisson sa décision de changer de sexe. « Pendant que lui rêvait d'un corps de femme, moi je rêvais d'avoir son corps musclé », confiait, Frank Adisson, son ami champion olympique en 1996. Plus tard le 9 mars 2018, elle le révèlera au quotidien L’Équipe. Elle entreprend alors sa transition. Sandra Forgues a désormais changé d'identité officiellement et vit aujourd'hui en tant que femme. Elle travaille en tant que responsable du système d'information dans la société DSI entreprise adaptée et solidaire. Son palmarès : Trois fois champion de France ; Médaille de bronze en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1992 à Barcelone en Espagne ; Médaille d'or en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta aux États-Unis ; 7e en slalom C-2 aux Jeux olympiques de 2000 à Sydney ; Médaille d'or en individuel au championnat du monde à Spittal (Autriche - junior) en 1986 ; Médailles d'or aux championnats du monde de slalom à Tacen en Slovénie en 1991 et à Tres Coroas au Brésil en 1997 ; Médaille d'argent en individuel et par équipe au championnat du monde de slalom à Nottingham au Royaume-Uni en 1995 ; Médaille de bronze au championnat du monde à Mezzana en Italie en 1993. Tarnais depuis 1997, Wilfrid avait vécu 20 ans avec sa femme et ses 2 enfants à Saint-Sulpice. Devenu Sandra, elle a refusé de disparaître dans l'anonymat d'une grande ville. Bien au contraire, elle s'est installée, tout à côté, à Saint-Agnan, village de 300 habitants, bien intégrée dans un petit lotissement tout juste sorti de terre. « J'ai des voisins géniaux. Ma transition s'est passée dans de bonnes conditions. » Son seul regret c'est d'avoir perdu la femme de sa vie, Fabienne, cette femme chérie. Et pour ses enfants il (elle) restera toujours leur papa, et sa famille continuera d'exister. En 2019, la Bagnéraise Sandra Forgues a été candidate aux municipales de Toulouse sur la liste conduite par Nadia Pellefigue (PS), emboîtant ainsi le pas à son père, ancien membre du PS en Bigorre. Un engagement politique, où elle pourrait mettre à profit son expérience et ses compétences dans le domaine sportif, plus que pour des convictions politiques. "Sur le moment, on peut vivre de son sport, mais après, c'est autre chose". Diplômé en informatique en 1994 puis chargé de projet à France Télécom de 1995 à 2000, il bénéficiait d'un contrat aménagé afin de pouvoir continuer la compétition au plus haut niveau sans négliger sa carrière d'ingénieur. En 2000, sa carrière de sportif est sur le déclin. Il saisit alors sa chance quand France Télécom offrit à ses salariés un plan d'aide à la création d'entreprise pour les candidats volontaires au départ. "Ils me couvraient en cas d'échec dans un premier temps" confiera l'ancien champion olympique pour expliquer sa décision. "Mon frère m'a proposé de créer une filiale de son entreprise d'informatique ». Kelern, rebaptisée depuis, Media Broadcast Technology, naît en septembre 2000. Il propose des interfaces informatiques aux régies audiovisuelles. C'est alors une nouvelle aventure qui redémarre. Au quotidien, Wilfrid Forgues se comporte comme un athlète qui se donne un objectif et qui se remet en cause fréquemment. Le milieu des affaires en revanche est une découverte. « Dans le sport, il y a un règlement et c'est que le meilleur gagne. Dans l'entreprise, il y a moins de règles. Si dans le sport on respecte l'adversaire, dans le business, on rencontre des tueurs », témoigne le kayakiste. « Si j'avais une utopie sportive, je n'en ai aucune dans l'entreprise. » En revanche, il se sert peu de son carnet d'adresses. Mais s'il ne met pas en avant son palmarès dans ses relations d'affaires, il reconnait que ceux qui l'apprennent ou le savent peuvent considérer ces états de service comme un gage. « Ils se disent que c'est un gars qui ne lâche pas le morceau ». Aujourd'hui sa société réalise un bon chiffre d'affaires et compte parmi ses clients Canal+, Radio France, TF1 et France Télévision. Sandra a raconté récemment son parcours dans son livre paru le 16 juin 2018 : Un jour peut-être... (chez Outdoor- Éditions). Ce récit au parlé vrai, empreint d’émotion mais toujours ponctué d’humour, est un témoignage précieux qui contribuera sans aucun doute à mieux faire comprendre et mieux accepter la transidentité au sein de notre société française.FOURCADE Martin (1988-XXXX)
Biathlète quintuple champion olympique, Bigourdan par alliance
 Martin FOURCADE, surnommé « l’Ogre catalan » est né le 14 septembre 1988 à Céret dans les Pyrénées-Orientales. C’est dans le village de La Llagonne où il a grandi que s’est forgée sa vocation sportive. Fils de Marcel Fourcade, accompagnateur en montagne et de Gisèle orthophoniste, il suit sa scolarité au lycée climatique de Font-Romeu. Il est un biathlète à la silhouette affûtée (1,84 m, 78 kg) qui collectionne les médailles depuis maintenant plus de 9 ans. La moisson a commencé lors des Mondiaux 2011 avec le titre en poursuite et la troisième place en relais mixte. Aussi précis au tir que rapide et endurant sur ses skis, ce champion pyrénéen s’est forgé au fil des ans un palmarès unique avec cinq médailles d’or, dont deux gagnées en 2014 aux JO de Sotchi en Russie et trois en 2018 aux JO de Pyeongchang en Corée du Sud, deux médailles d’argent obtenues aux JO de Vancouver en 2010 et de Sotchi en 2014, 11 fois champion du monde entre 2011 et 2017, dont 10 titres mondiaux individuels et un en relais mixte et 6 fois vainqueur du Gros Globe de cristal. Il est d’ailleurs le seul biathlète à avoir ainsi remporté sept fois d’affilée le classement général de la Coupe du monde en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Il détient le record de victoires sur une saison (14 en 2016-2017 à égalité avec Magdalena Forsberg, auteure de cet exploit en 2000-2001), de Globes de cristal remportés (33), du nombre de points marqués sur un hiver (1322 en 2016-2017) et du nombre de podiums consécutifs en Coupe du monde (28 depuis 2017). Avec sept médailles olympiques il est le plus titré des sportifs français aux JO (été et hiver confondus). En 2016, aux championnats du monde, il dispute sa compétition la plus aboutie à Oslo-Holmenkollen, avec quatre médailles d’or et une en argent. En Coupe du monde, il réalise trois Grands Chelems dans les quatre spécialités (sprint, poursuite, individuel, mass start) en remportant tous les Globes de cristal mis en jeu lors des saisons 2012-2013, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. Il compte plus de 186 podiums dont 150 podiums individuels et quelque 83 premières places au total, ce qui fait de lui le meilleur biathlète français de l’histoire et un des meilleurs de tous les temps. Il est d’ores et déjà une légende mondiale du biathlon. Le 26 septembre 2017, il a été désigné porte-drapeau de l’équipe de France pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang 2018. Le 12 février 2018 il y est sacré une 3e fois lors de l’épreuve de poursuite. Et le 18 février il décroche le titre olympique sur la mass start au terme d’un sprint de folie face à Simon Schempp et dépasse le record de Jean-Claude Killy en s’adjugeant un quatrième titre olympique. Le 20 février il remporte avec Marie Dorin-Habert, Anaïs Bescond et Simon Desthieux, l’or du relais mixte. Une première dans l’histoire du ski français. Et il se rapproche un peu de la référence en la matière, le norvégien Ole-Einar Björndalen, considéré comme le plus grand biathlète de l’histoire avec 20 titres de champion du monde et 13 médailles olympiques dont huit en or, quatre en argent et une en bronze. Martin domine sa discipline, le biathlon, depuis 7 ans désormais et s’est forgé un palmarès sans égal. Cette régularité dans les résultats au plus haut niveau, son mental de fer, ses capacités physiques hors normes, son professionnalisme, sa façon de gérer les courses, son style et son exceptionnelle vitesse sur les skis font l’admiration de nombreux observateurs, mais c’est également la personnalité du champion qui séduit, au-delà des pistes et des champs de tir. Sportif discret mais engagé, il est aussi un homme épanoui, papa heureux et comblé de deux petites filles : Marion l’aînée née en septembre 2015 et Inès née en mars 2017. Un rôle de père qu’il prend très à cœur. Malgré un palmarès hors du commun, les titres et la gloire ne l’ont jamais éloigné de ses racines et de sa famille. S’il reste assez discret sur sa vie privée, on sait que depuis une dizaine d’années il partage sa vie avec Hélène Uzabiaga, originaire d’Argelès-Gazost. C’est lors d’un stage de biathlon dans les Alpes qu’il croise pour la première fois le regard d’Hélène, alors qu’ils étaient très jeunes. Si les amoureux se sont éloignés quelque temps, ils se sont retrouvés en 2008 pour ne plus jamais se quitter. Hélène a participé de son côté à des courses de ski de fond et particulièrement en Val d’Azun. Sa famille est établie à Argelès-Gazost mais aussi à Préchac. Titulaire d’un diplôme de professeur des écoles, Hélène travaille la journée auprès d’enfants déficients. Aujourd’hui, le couple est installé à Villard-de-Lans dans l’Isère. Une compagne qui accepte les sacrifices qu’impose la carrière exceptionnelle de Martin. Celui dont le cœur bat pour la vallée des Gaves vient régulièrement en Bigorre pour partager du temps en famille et s’entraîner avec des amis fondeurs lavedanais sur les pistes de Gavarnie, Cauterets et du Tourmalet. Il est engagé dans l’Armée de terre et fait partie de l’École militaire de haute montagne (EMHM) de Chamonix. Le 4 octobre 2017, il s’est vu remettre de nouveaux galons par le chef d’État-Major des Armées, et a eu l’honneur d’être promu au grade de sous-lieutenant. Il fait également partie de l’équipe de France militaire de ski depuis 2008. En dehors des pistes, il a récemment fait parler de lui en publiant son premier livre, un journal autobiographique : « Martin Fourcade: Mon rêve d’or et de neige », paru chez Hachette Marabout en novembre 2017. Il profite de ce livre pour évoquer sa relation avec son grand frère Simon né le 25 avril 1984, champion biathlète comme lui et qui fut sélectionné pour les JO d’hiver de 2006 à Turin, 2010 à Vancouver et 2014 à Sotchi. Depuis la saison 2011/2012, Martin possède une piste bleue à son nom sur le secteur de La Calme à Font-Romeu. En 2013, il devient le premier Français à recevoir la plus haute récompense norvégienne décernée aux skieurs, la médaille Holmenkollen. Et en 2014, il a été élevé au rang de chevalier de la Légion d’honneur et a fait son entrée dans le Petit Robert. En 2015 il avait été désigné vainqueur du Prix Olivier Schwarz, distinction qui entre dans le palmarès des RMC Sport Awards. En 2018, il est élevé au rang d’Officier de l'ordre de la Légion d'Honneur. Et la même année il rejoint le conseil d’administration des Jeux Olympiques de Paris 2024. Si pour le gamin de Font-Romeu dans les Pyrénées, le premier défi était de ravir le leadership mondial aux Norvégiens, aujourd’hui à 31 ans, il a gagné sa place au panthéon des sportifs français qui ont brillé aux JO. A 31 ans passé, il signe son 11ème titre mondial individuel, le 19 février 2020 lors des championnats du monde d'Antholz-Anterselva en Italie pour égaler le total record de Ole Einar Bjørndalen. Quintuple champion olympique, il remporte sa 12e médaille d'or (11 individuelles et une par équipe) aux championnats du monde. Il remporte également le relais masculin avec Émilien Jacquelin, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet. Ce samedi 22 février 2020, 19 ans après son dernier titre, la France a remporté le relais masculin des Mondiaux de biathlon devançant la Norvège et l’Allemagne, avec qui ils ont longtemps partagé la tête de course. En mars 2020, à l’âge de 31 ans, Martin Fourcade, le biathlète quintuple champion olympique a choisi de mettre un terme à son incroyable carrière et de tirer sa révérence. Il a raccroché les skis et la carabine après un ultime succès à Kontiolahti en Finlande, échouant de peu dans la quête d’un huitième Globe de cristal au profit de Johannes Boe. Il a remporté la dernière course de sa carrière le samedi 14 mars mais ne termine qu'à la deuxième place de la Coupe du monde, derrière le Norvégien Johannes Boe, lauréat du Gros Globe de cristal pour la deuxième année consécutive. Martin est passé tout près de l'exploit, échouant finalement à deux petites longueurs du Norvégien au classement final de la Coupe du monde. Avec pas moins de sept médailles olympiques, cinq en or et deux en argent, 28 médailles mondiales (13 en or dont 11 individuelles, 10 en argent et 5 en bronze) et sept Gros Globes de cristal de rang, il aura littéralement tout gagné. Depuis l’annonce de sa retraite il a reçu une pluie d’hommages, qui l’ont extrêmement touché. En 2019, il doutait de ses capacités et en 2020, il se demandait s’il réussirait à relever le défi de revenir au top. Martin Fourcade continuera de promouvoir le biathlon et sans doute passera-t-il beaucoup plus de temps à la maison avec ses proches, Hélène, Manon et Inès et dans les Hautes-Pyrénées, où il compte de nombreux d’amis.
Martin FOURCADE, surnommé « l’Ogre catalan » est né le 14 septembre 1988 à Céret dans les Pyrénées-Orientales. C’est dans le village de La Llagonne où il a grandi que s’est forgée sa vocation sportive. Fils de Marcel Fourcade, accompagnateur en montagne et de Gisèle orthophoniste, il suit sa scolarité au lycée climatique de Font-Romeu. Il est un biathlète à la silhouette affûtée (1,84 m, 78 kg) qui collectionne les médailles depuis maintenant plus de 9 ans. La moisson a commencé lors des Mondiaux 2011 avec le titre en poursuite et la troisième place en relais mixte. Aussi précis au tir que rapide et endurant sur ses skis, ce champion pyrénéen s’est forgé au fil des ans un palmarès unique avec cinq médailles d’or, dont deux gagnées en 2014 aux JO de Sotchi en Russie et trois en 2018 aux JO de Pyeongchang en Corée du Sud, deux médailles d’argent obtenues aux JO de Vancouver en 2010 et de Sotchi en 2014, 11 fois champion du monde entre 2011 et 2017, dont 10 titres mondiaux individuels et un en relais mixte et 6 fois vainqueur du Gros Globe de cristal. Il est d’ailleurs le seul biathlète à avoir ainsi remporté sept fois d’affilée le classement général de la Coupe du monde en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Il détient le record de victoires sur une saison (14 en 2016-2017 à égalité avec Magdalena Forsberg, auteure de cet exploit en 2000-2001), de Globes de cristal remportés (33), du nombre de points marqués sur un hiver (1322 en 2016-2017) et du nombre de podiums consécutifs en Coupe du monde (28 depuis 2017). Avec sept médailles olympiques il est le plus titré des sportifs français aux JO (été et hiver confondus). En 2016, aux championnats du monde, il dispute sa compétition la plus aboutie à Oslo-Holmenkollen, avec quatre médailles d’or et une en argent. En Coupe du monde, il réalise trois Grands Chelems dans les quatre spécialités (sprint, poursuite, individuel, mass start) en remportant tous les Globes de cristal mis en jeu lors des saisons 2012-2013, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. Il compte plus de 186 podiums dont 150 podiums individuels et quelque 83 premières places au total, ce qui fait de lui le meilleur biathlète français de l’histoire et un des meilleurs de tous les temps. Il est d’ores et déjà une légende mondiale du biathlon. Le 26 septembre 2017, il a été désigné porte-drapeau de l’équipe de France pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang 2018. Le 12 février 2018 il y est sacré une 3e fois lors de l’épreuve de poursuite. Et le 18 février il décroche le titre olympique sur la mass start au terme d’un sprint de folie face à Simon Schempp et dépasse le record de Jean-Claude Killy en s’adjugeant un quatrième titre olympique. Le 20 février il remporte avec Marie Dorin-Habert, Anaïs Bescond et Simon Desthieux, l’or du relais mixte. Une première dans l’histoire du ski français. Et il se rapproche un peu de la référence en la matière, le norvégien Ole-Einar Björndalen, considéré comme le plus grand biathlète de l’histoire avec 20 titres de champion du monde et 13 médailles olympiques dont huit en or, quatre en argent et une en bronze. Martin domine sa discipline, le biathlon, depuis 7 ans désormais et s’est forgé un palmarès sans égal. Cette régularité dans les résultats au plus haut niveau, son mental de fer, ses capacités physiques hors normes, son professionnalisme, sa façon de gérer les courses, son style et son exceptionnelle vitesse sur les skis font l’admiration de nombreux observateurs, mais c’est également la personnalité du champion qui séduit, au-delà des pistes et des champs de tir. Sportif discret mais engagé, il est aussi un homme épanoui, papa heureux et comblé de deux petites filles : Marion l’aînée née en septembre 2015 et Inès née en mars 2017. Un rôle de père qu’il prend très à cœur. Malgré un palmarès hors du commun, les titres et la gloire ne l’ont jamais éloigné de ses racines et de sa famille. S’il reste assez discret sur sa vie privée, on sait que depuis une dizaine d’années il partage sa vie avec Hélène Uzabiaga, originaire d’Argelès-Gazost. C’est lors d’un stage de biathlon dans les Alpes qu’il croise pour la première fois le regard d’Hélène, alors qu’ils étaient très jeunes. Si les amoureux se sont éloignés quelque temps, ils se sont retrouvés en 2008 pour ne plus jamais se quitter. Hélène a participé de son côté à des courses de ski de fond et particulièrement en Val d’Azun. Sa famille est établie à Argelès-Gazost mais aussi à Préchac. Titulaire d’un diplôme de professeur des écoles, Hélène travaille la journée auprès d’enfants déficients. Aujourd’hui, le couple est installé à Villard-de-Lans dans l’Isère. Une compagne qui accepte les sacrifices qu’impose la carrière exceptionnelle de Martin. Celui dont le cœur bat pour la vallée des Gaves vient régulièrement en Bigorre pour partager du temps en famille et s’entraîner avec des amis fondeurs lavedanais sur les pistes de Gavarnie, Cauterets et du Tourmalet. Il est engagé dans l’Armée de terre et fait partie de l’École militaire de haute montagne (EMHM) de Chamonix. Le 4 octobre 2017, il s’est vu remettre de nouveaux galons par le chef d’État-Major des Armées, et a eu l’honneur d’être promu au grade de sous-lieutenant. Il fait également partie de l’équipe de France militaire de ski depuis 2008. En dehors des pistes, il a récemment fait parler de lui en publiant son premier livre, un journal autobiographique : « Martin Fourcade: Mon rêve d’or et de neige », paru chez Hachette Marabout en novembre 2017. Il profite de ce livre pour évoquer sa relation avec son grand frère Simon né le 25 avril 1984, champion biathlète comme lui et qui fut sélectionné pour les JO d’hiver de 2006 à Turin, 2010 à Vancouver et 2014 à Sotchi. Depuis la saison 2011/2012, Martin possède une piste bleue à son nom sur le secteur de La Calme à Font-Romeu. En 2013, il devient le premier Français à recevoir la plus haute récompense norvégienne décernée aux skieurs, la médaille Holmenkollen. Et en 2014, il a été élevé au rang de chevalier de la Légion d’honneur et a fait son entrée dans le Petit Robert. En 2015 il avait été désigné vainqueur du Prix Olivier Schwarz, distinction qui entre dans le palmarès des RMC Sport Awards. En 2018, il est élevé au rang d’Officier de l'ordre de la Légion d'Honneur. Et la même année il rejoint le conseil d’administration des Jeux Olympiques de Paris 2024. Si pour le gamin de Font-Romeu dans les Pyrénées, le premier défi était de ravir le leadership mondial aux Norvégiens, aujourd’hui à 31 ans, il a gagné sa place au panthéon des sportifs français qui ont brillé aux JO. A 31 ans passé, il signe son 11ème titre mondial individuel, le 19 février 2020 lors des championnats du monde d'Antholz-Anterselva en Italie pour égaler le total record de Ole Einar Bjørndalen. Quintuple champion olympique, il remporte sa 12e médaille d'or (11 individuelles et une par équipe) aux championnats du monde. Il remporte également le relais masculin avec Émilien Jacquelin, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet. Ce samedi 22 février 2020, 19 ans après son dernier titre, la France a remporté le relais masculin des Mondiaux de biathlon devançant la Norvège et l’Allemagne, avec qui ils ont longtemps partagé la tête de course. En mars 2020, à l’âge de 31 ans, Martin Fourcade, le biathlète quintuple champion olympique a choisi de mettre un terme à son incroyable carrière et de tirer sa révérence. Il a raccroché les skis et la carabine après un ultime succès à Kontiolahti en Finlande, échouant de peu dans la quête d’un huitième Globe de cristal au profit de Johannes Boe. Il a remporté la dernière course de sa carrière le samedi 14 mars mais ne termine qu'à la deuxième place de la Coupe du monde, derrière le Norvégien Johannes Boe, lauréat du Gros Globe de cristal pour la deuxième année consécutive. Martin est passé tout près de l'exploit, échouant finalement à deux petites longueurs du Norvégien au classement final de la Coupe du monde. Avec pas moins de sept médailles olympiques, cinq en or et deux en argent, 28 médailles mondiales (13 en or dont 11 individuelles, 10 en argent et 5 en bronze) et sept Gros Globes de cristal de rang, il aura littéralement tout gagné. Depuis l’annonce de sa retraite il a reçu une pluie d’hommages, qui l’ont extrêmement touché. En 2019, il doutait de ses capacités et en 2020, il se demandait s’il réussirait à relever le défi de revenir au top. Martin Fourcade continuera de promouvoir le biathlon et sans doute passera-t-il beaucoup plus de temps à la maison avec ses proches, Hélène, Manon et Inès et dans les Hautes-Pyrénées, où il compte de nombreux d’amis.
 Martin FOURCADE, surnommé « l’Ogre catalan » est né le 14 septembre 1988 à Céret dans les Pyrénées-Orientales. C’est dans le village de La Llagonne où il a grandi que s’est forgée sa vocation sportive. Fils de Marcel Fourcade, accompagnateur en montagne et de Gisèle orthophoniste, il suit sa scolarité au lycée climatique de Font-Romeu. Il est un biathlète à la silhouette affûtée (1,84 m, 78 kg) qui collectionne les médailles depuis maintenant plus de 9 ans. La moisson a commencé lors des Mondiaux 2011 avec le titre en poursuite et la troisième place en relais mixte. Aussi précis au tir que rapide et endurant sur ses skis, ce champion pyrénéen s’est forgé au fil des ans un palmarès unique avec cinq médailles d’or, dont deux gagnées en 2014 aux JO de Sotchi en Russie et trois en 2018 aux JO de Pyeongchang en Corée du Sud, deux médailles d’argent obtenues aux JO de Vancouver en 2010 et de Sotchi en 2014, 11 fois champion du monde entre 2011 et 2017, dont 10 titres mondiaux individuels et un en relais mixte et 6 fois vainqueur du Gros Globe de cristal. Il est d’ailleurs le seul biathlète à avoir ainsi remporté sept fois d’affilée le classement général de la Coupe du monde en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Il détient le record de victoires sur une saison (14 en 2016-2017 à égalité avec Magdalena Forsberg, auteure de cet exploit en 2000-2001), de Globes de cristal remportés (33), du nombre de points marqués sur un hiver (1322 en 2016-2017) et du nombre de podiums consécutifs en Coupe du monde (28 depuis 2017). Avec sept médailles olympiques il est le plus titré des sportifs français aux JO (été et hiver confondus). En 2016, aux championnats du monde, il dispute sa compétition la plus aboutie à Oslo-Holmenkollen, avec quatre médailles d’or et une en argent. En Coupe du monde, il réalise trois Grands Chelems dans les quatre spécialités (sprint, poursuite, individuel, mass start) en remportant tous les Globes de cristal mis en jeu lors des saisons 2012-2013, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. Il compte plus de 186 podiums dont 150 podiums individuels et quelque 83 premières places au total, ce qui fait de lui le meilleur biathlète français de l’histoire et un des meilleurs de tous les temps. Il est d’ores et déjà une légende mondiale du biathlon. Le 26 septembre 2017, il a été désigné porte-drapeau de l’équipe de France pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang 2018. Le 12 février 2018 il y est sacré une 3e fois lors de l’épreuve de poursuite. Et le 18 février il décroche le titre olympique sur la mass start au terme d’un sprint de folie face à Simon Schempp et dépasse le record de Jean-Claude Killy en s’adjugeant un quatrième titre olympique. Le 20 février il remporte avec Marie Dorin-Habert, Anaïs Bescond et Simon Desthieux, l’or du relais mixte. Une première dans l’histoire du ski français. Et il se rapproche un peu de la référence en la matière, le norvégien Ole-Einar Björndalen, considéré comme le plus grand biathlète de l’histoire avec 20 titres de champion du monde et 13 médailles olympiques dont huit en or, quatre en argent et une en bronze. Martin domine sa discipline, le biathlon, depuis 7 ans désormais et s’est forgé un palmarès sans égal. Cette régularité dans les résultats au plus haut niveau, son mental de fer, ses capacités physiques hors normes, son professionnalisme, sa façon de gérer les courses, son style et son exceptionnelle vitesse sur les skis font l’admiration de nombreux observateurs, mais c’est également la personnalité du champion qui séduit, au-delà des pistes et des champs de tir. Sportif discret mais engagé, il est aussi un homme épanoui, papa heureux et comblé de deux petites filles : Marion l’aînée née en septembre 2015 et Inès née en mars 2017. Un rôle de père qu’il prend très à cœur. Malgré un palmarès hors du commun, les titres et la gloire ne l’ont jamais éloigné de ses racines et de sa famille. S’il reste assez discret sur sa vie privée, on sait que depuis une dizaine d’années il partage sa vie avec Hélène Uzabiaga, originaire d’Argelès-Gazost. C’est lors d’un stage de biathlon dans les Alpes qu’il croise pour la première fois le regard d’Hélène, alors qu’ils étaient très jeunes. Si les amoureux se sont éloignés quelque temps, ils se sont retrouvés en 2008 pour ne plus jamais se quitter. Hélène a participé de son côté à des courses de ski de fond et particulièrement en Val d’Azun. Sa famille est établie à Argelès-Gazost mais aussi à Préchac. Titulaire d’un diplôme de professeur des écoles, Hélène travaille la journée auprès d’enfants déficients. Aujourd’hui, le couple est installé à Villard-de-Lans dans l’Isère. Une compagne qui accepte les sacrifices qu’impose la carrière exceptionnelle de Martin. Celui dont le cœur bat pour la vallée des Gaves vient régulièrement en Bigorre pour partager du temps en famille et s’entraîner avec des amis fondeurs lavedanais sur les pistes de Gavarnie, Cauterets et du Tourmalet. Il est engagé dans l’Armée de terre et fait partie de l’École militaire de haute montagne (EMHM) de Chamonix. Le 4 octobre 2017, il s’est vu remettre de nouveaux galons par le chef d’État-Major des Armées, et a eu l’honneur d’être promu au grade de sous-lieutenant. Il fait également partie de l’équipe de France militaire de ski depuis 2008. En dehors des pistes, il a récemment fait parler de lui en publiant son premier livre, un journal autobiographique : « Martin Fourcade: Mon rêve d’or et de neige », paru chez Hachette Marabout en novembre 2017. Il profite de ce livre pour évoquer sa relation avec son grand frère Simon né le 25 avril 1984, champion biathlète comme lui et qui fut sélectionné pour les JO d’hiver de 2006 à Turin, 2010 à Vancouver et 2014 à Sotchi. Depuis la saison 2011/2012, Martin possède une piste bleue à son nom sur le secteur de La Calme à Font-Romeu. En 2013, il devient le premier Français à recevoir la plus haute récompense norvégienne décernée aux skieurs, la médaille Holmenkollen. Et en 2014, il a été élevé au rang de chevalier de la Légion d’honneur et a fait son entrée dans le Petit Robert. En 2015 il avait été désigné vainqueur du Prix Olivier Schwarz, distinction qui entre dans le palmarès des RMC Sport Awards. En 2018, il est élevé au rang d’Officier de l'ordre de la Légion d'Honneur. Et la même année il rejoint le conseil d’administration des Jeux Olympiques de Paris 2024. Si pour le gamin de Font-Romeu dans les Pyrénées, le premier défi était de ravir le leadership mondial aux Norvégiens, aujourd’hui à 31 ans, il a gagné sa place au panthéon des sportifs français qui ont brillé aux JO. A 31 ans passé, il signe son 11ème titre mondial individuel, le 19 février 2020 lors des championnats du monde d'Antholz-Anterselva en Italie pour égaler le total record de Ole Einar Bjørndalen. Quintuple champion olympique, il remporte sa 12e médaille d'or (11 individuelles et une par équipe) aux championnats du monde. Il remporte également le relais masculin avec Émilien Jacquelin, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet. Ce samedi 22 février 2020, 19 ans après son dernier titre, la France a remporté le relais masculin des Mondiaux de biathlon devançant la Norvège et l’Allemagne, avec qui ils ont longtemps partagé la tête de course. En mars 2020, à l’âge de 31 ans, Martin Fourcade, le biathlète quintuple champion olympique a choisi de mettre un terme à son incroyable carrière et de tirer sa révérence. Il a raccroché les skis et la carabine après un ultime succès à Kontiolahti en Finlande, échouant de peu dans la quête d’un huitième Globe de cristal au profit de Johannes Boe. Il a remporté la dernière course de sa carrière le samedi 14 mars mais ne termine qu'à la deuxième place de la Coupe du monde, derrière le Norvégien Johannes Boe, lauréat du Gros Globe de cristal pour la deuxième année consécutive. Martin est passé tout près de l'exploit, échouant finalement à deux petites longueurs du Norvégien au classement final de la Coupe du monde. Avec pas moins de sept médailles olympiques, cinq en or et deux en argent, 28 médailles mondiales (13 en or dont 11 individuelles, 10 en argent et 5 en bronze) et sept Gros Globes de cristal de rang, il aura littéralement tout gagné. Depuis l’annonce de sa retraite il a reçu une pluie d’hommages, qui l’ont extrêmement touché. En 2019, il doutait de ses capacités et en 2020, il se demandait s’il réussirait à relever le défi de revenir au top. Martin Fourcade continuera de promouvoir le biathlon et sans doute passera-t-il beaucoup plus de temps à la maison avec ses proches, Hélène, Manon et Inès et dans les Hautes-Pyrénées, où il compte de nombreux d’amis.
Martin FOURCADE, surnommé « l’Ogre catalan » est né le 14 septembre 1988 à Céret dans les Pyrénées-Orientales. C’est dans le village de La Llagonne où il a grandi que s’est forgée sa vocation sportive. Fils de Marcel Fourcade, accompagnateur en montagne et de Gisèle orthophoniste, il suit sa scolarité au lycée climatique de Font-Romeu. Il est un biathlète à la silhouette affûtée (1,84 m, 78 kg) qui collectionne les médailles depuis maintenant plus de 9 ans. La moisson a commencé lors des Mondiaux 2011 avec le titre en poursuite et la troisième place en relais mixte. Aussi précis au tir que rapide et endurant sur ses skis, ce champion pyrénéen s’est forgé au fil des ans un palmarès unique avec cinq médailles d’or, dont deux gagnées en 2014 aux JO de Sotchi en Russie et trois en 2018 aux JO de Pyeongchang en Corée du Sud, deux médailles d’argent obtenues aux JO de Vancouver en 2010 et de Sotchi en 2014, 11 fois champion du monde entre 2011 et 2017, dont 10 titres mondiaux individuels et un en relais mixte et 6 fois vainqueur du Gros Globe de cristal. Il est d’ailleurs le seul biathlète à avoir ainsi remporté sept fois d’affilée le classement général de la Coupe du monde en 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Il détient le record de victoires sur une saison (14 en 2016-2017 à égalité avec Magdalena Forsberg, auteure de cet exploit en 2000-2001), de Globes de cristal remportés (33), du nombre de points marqués sur un hiver (1322 en 2016-2017) et du nombre de podiums consécutifs en Coupe du monde (28 depuis 2017). Avec sept médailles olympiques il est le plus titré des sportifs français aux JO (été et hiver confondus). En 2016, aux championnats du monde, il dispute sa compétition la plus aboutie à Oslo-Holmenkollen, avec quatre médailles d’or et une en argent. En Coupe du monde, il réalise trois Grands Chelems dans les quatre spécialités (sprint, poursuite, individuel, mass start) en remportant tous les Globes de cristal mis en jeu lors des saisons 2012-2013, 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018. Il compte plus de 186 podiums dont 150 podiums individuels et quelque 83 premières places au total, ce qui fait de lui le meilleur biathlète français de l’histoire et un des meilleurs de tous les temps. Il est d’ores et déjà une légende mondiale du biathlon. Le 26 septembre 2017, il a été désigné porte-drapeau de l’équipe de France pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang 2018. Le 12 février 2018 il y est sacré une 3e fois lors de l’épreuve de poursuite. Et le 18 février il décroche le titre olympique sur la mass start au terme d’un sprint de folie face à Simon Schempp et dépasse le record de Jean-Claude Killy en s’adjugeant un quatrième titre olympique. Le 20 février il remporte avec Marie Dorin-Habert, Anaïs Bescond et Simon Desthieux, l’or du relais mixte. Une première dans l’histoire du ski français. Et il se rapproche un peu de la référence en la matière, le norvégien Ole-Einar Björndalen, considéré comme le plus grand biathlète de l’histoire avec 20 titres de champion du monde et 13 médailles olympiques dont huit en or, quatre en argent et une en bronze. Martin domine sa discipline, le biathlon, depuis 7 ans désormais et s’est forgé un palmarès sans égal. Cette régularité dans les résultats au plus haut niveau, son mental de fer, ses capacités physiques hors normes, son professionnalisme, sa façon de gérer les courses, son style et son exceptionnelle vitesse sur les skis font l’admiration de nombreux observateurs, mais c’est également la personnalité du champion qui séduit, au-delà des pistes et des champs de tir. Sportif discret mais engagé, il est aussi un homme épanoui, papa heureux et comblé de deux petites filles : Marion l’aînée née en septembre 2015 et Inès née en mars 2017. Un rôle de père qu’il prend très à cœur. Malgré un palmarès hors du commun, les titres et la gloire ne l’ont jamais éloigné de ses racines et de sa famille. S’il reste assez discret sur sa vie privée, on sait que depuis une dizaine d’années il partage sa vie avec Hélène Uzabiaga, originaire d’Argelès-Gazost. C’est lors d’un stage de biathlon dans les Alpes qu’il croise pour la première fois le regard d’Hélène, alors qu’ils étaient très jeunes. Si les amoureux se sont éloignés quelque temps, ils se sont retrouvés en 2008 pour ne plus jamais se quitter. Hélène a participé de son côté à des courses de ski de fond et particulièrement en Val d’Azun. Sa famille est établie à Argelès-Gazost mais aussi à Préchac. Titulaire d’un diplôme de professeur des écoles, Hélène travaille la journée auprès d’enfants déficients. Aujourd’hui, le couple est installé à Villard-de-Lans dans l’Isère. Une compagne qui accepte les sacrifices qu’impose la carrière exceptionnelle de Martin. Celui dont le cœur bat pour la vallée des Gaves vient régulièrement en Bigorre pour partager du temps en famille et s’entraîner avec des amis fondeurs lavedanais sur les pistes de Gavarnie, Cauterets et du Tourmalet. Il est engagé dans l’Armée de terre et fait partie de l’École militaire de haute montagne (EMHM) de Chamonix. Le 4 octobre 2017, il s’est vu remettre de nouveaux galons par le chef d’État-Major des Armées, et a eu l’honneur d’être promu au grade de sous-lieutenant. Il fait également partie de l’équipe de France militaire de ski depuis 2008. En dehors des pistes, il a récemment fait parler de lui en publiant son premier livre, un journal autobiographique : « Martin Fourcade: Mon rêve d’or et de neige », paru chez Hachette Marabout en novembre 2017. Il profite de ce livre pour évoquer sa relation avec son grand frère Simon né le 25 avril 1984, champion biathlète comme lui et qui fut sélectionné pour les JO d’hiver de 2006 à Turin, 2010 à Vancouver et 2014 à Sotchi. Depuis la saison 2011/2012, Martin possède une piste bleue à son nom sur le secteur de La Calme à Font-Romeu. En 2013, il devient le premier Français à recevoir la plus haute récompense norvégienne décernée aux skieurs, la médaille Holmenkollen. Et en 2014, il a été élevé au rang de chevalier de la Légion d’honneur et a fait son entrée dans le Petit Robert. En 2015 il avait été désigné vainqueur du Prix Olivier Schwarz, distinction qui entre dans le palmarès des RMC Sport Awards. En 2018, il est élevé au rang d’Officier de l'ordre de la Légion d'Honneur. Et la même année il rejoint le conseil d’administration des Jeux Olympiques de Paris 2024. Si pour le gamin de Font-Romeu dans les Pyrénées, le premier défi était de ravir le leadership mondial aux Norvégiens, aujourd’hui à 31 ans, il a gagné sa place au panthéon des sportifs français qui ont brillé aux JO. A 31 ans passé, il signe son 11ème titre mondial individuel, le 19 février 2020 lors des championnats du monde d'Antholz-Anterselva en Italie pour égaler le total record de Ole Einar Bjørndalen. Quintuple champion olympique, il remporte sa 12e médaille d'or (11 individuelles et une par équipe) aux championnats du monde. Il remporte également le relais masculin avec Émilien Jacquelin, Simon Desthieux et Quentin Fillon Maillet. Ce samedi 22 février 2020, 19 ans après son dernier titre, la France a remporté le relais masculin des Mondiaux de biathlon devançant la Norvège et l’Allemagne, avec qui ils ont longtemps partagé la tête de course. En mars 2020, à l’âge de 31 ans, Martin Fourcade, le biathlète quintuple champion olympique a choisi de mettre un terme à son incroyable carrière et de tirer sa révérence. Il a raccroché les skis et la carabine après un ultime succès à Kontiolahti en Finlande, échouant de peu dans la quête d’un huitième Globe de cristal au profit de Johannes Boe. Il a remporté la dernière course de sa carrière le samedi 14 mars mais ne termine qu'à la deuxième place de la Coupe du monde, derrière le Norvégien Johannes Boe, lauréat du Gros Globe de cristal pour la deuxième année consécutive. Martin est passé tout près de l'exploit, échouant finalement à deux petites longueurs du Norvégien au classement final de la Coupe du monde. Avec pas moins de sept médailles olympiques, cinq en or et deux en argent, 28 médailles mondiales (13 en or dont 11 individuelles, 10 en argent et 5 en bronze) et sept Gros Globes de cristal de rang, il aura littéralement tout gagné. Depuis l’annonce de sa retraite il a reçu une pluie d’hommages, qui l’ont extrêmement touché. En 2019, il doutait de ses capacités et en 2020, il se demandait s’il réussirait à relever le défi de revenir au top. Martin Fourcade continuera de promouvoir le biathlon et sans doute passera-t-il beaucoup plus de temps à la maison avec ses proches, Hélène, Manon et Inès et dans les Hautes-Pyrénées, où il compte de nombreux d’amis.FOURISCOT Cédrik (1977-XXXX)
Consul général de France à New York
 Cédrik FOURISCOT, né le 30 août 1977 à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées est diplomate de carrière et spécialiste des questions européennes. Dans sa jeunesse, il a pratiqué le football en club et aussi le tennis en compétition. Élève du lycée Théophile Gautier (1992-1995), il est diplômé de l’Institut d’études politiques de Toulouse (promo 2000) et titulaire d’un master en négociations internationales à l’Université Paris-Saclay. Depuis le 24 juin 2024, il occupe le poste prestigieux de Consul général de France à New York (États-Unis). Il a débuté sa carrière professionnelle diplomatique à l’ambassade de France à Chypre en tant que chef de chancellerie et vice-consul (2007-2009). Il a ensuite travaillé sur les questions politiques du ministère des Affaires étrangères, à la direction de l’Union européenne, de 2009 à 2014, puis à nouveau entre 2019 et 2022, chargé notamment du suivi des relations extérieures de l’UE avec l’Amérique, la Russie et l’Asie – au moment de la présidence française du Conseil de l’Union Européenne, de janvier à juin 2022. Entre ces deux périodes, de 2015 à 2019, il a intégré la Représentation permanente de la France auprès de l’UE, à Bruxelles (Belgique), en tant que conseiller-négociateur français pour les dossiers liés à l’Afrique du Nord et au Moyen-Orient ainsi que sur les questions de défense européenne et de sécurité. Par ailleurs en 2019-2020 il a effectué une mission en tant que conseiller du directeur politique du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), en passant ensuite par d’autres postes prestigieux, puisqu’il était jusqu’en janvier 2024 conseiller pour les Affaires européennes au cabinet de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et directeur de cabinet adjoint de la secrétaire d’État en charge de l’Europe, Laurence Boone. Pendant dix-huit mois, il a ainsi assuré la coordination politique de la gestion des affaires européennes au Quai d’Orsay. Sur un plan plus personnel, il voue un attachement profond à sa ville natale et il adore aussi le sport, passionné de football depuis ses débuts de footballeur au Tarbes Pyrénées Football (TPF) et qui a gardé de ces années dans le Sud-Ouest une certaine vision du travail en équipe.
Cédrik FOURISCOT, né le 30 août 1977 à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées est diplomate de carrière et spécialiste des questions européennes. Dans sa jeunesse, il a pratiqué le football en club et aussi le tennis en compétition. Élève du lycée Théophile Gautier (1992-1995), il est diplômé de l’Institut d’études politiques de Toulouse (promo 2000) et titulaire d’un master en négociations internationales à l’Université Paris-Saclay. Depuis le 24 juin 2024, il occupe le poste prestigieux de Consul général de France à New York (États-Unis). Il a débuté sa carrière professionnelle diplomatique à l’ambassade de France à Chypre en tant que chef de chancellerie et vice-consul (2007-2009). Il a ensuite travaillé sur les questions politiques du ministère des Affaires étrangères, à la direction de l’Union européenne, de 2009 à 2014, puis à nouveau entre 2019 et 2022, chargé notamment du suivi des relations extérieures de l’UE avec l’Amérique, la Russie et l’Asie – au moment de la présidence française du Conseil de l’Union Européenne, de janvier à juin 2022. Entre ces deux périodes, de 2015 à 2019, il a intégré la Représentation permanente de la France auprès de l’UE, à Bruxelles (Belgique), en tant que conseiller-négociateur français pour les dossiers liés à l’Afrique du Nord et au Moyen-Orient ainsi que sur les questions de défense européenne et de sécurité. Par ailleurs en 2019-2020 il a effectué une mission en tant que conseiller du directeur politique du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), en passant ensuite par d’autres postes prestigieux, puisqu’il était jusqu’en janvier 2024 conseiller pour les Affaires européennes au cabinet de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et directeur de cabinet adjoint de la secrétaire d’État en charge de l’Europe, Laurence Boone. Pendant dix-huit mois, il a ainsi assuré la coordination politique de la gestion des affaires européennes au Quai d’Orsay. Sur un plan plus personnel, il voue un attachement profond à sa ville natale et il adore aussi le sport, passionné de football depuis ses débuts de footballeur au Tarbes Pyrénées Football (TPF) et qui a gardé de ces années dans le Sud-Ouest une certaine vision du travail en équipe.
 Cédrik FOURISCOT, né le 30 août 1977 à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées est diplomate de carrière et spécialiste des questions européennes. Dans sa jeunesse, il a pratiqué le football en club et aussi le tennis en compétition. Élève du lycée Théophile Gautier (1992-1995), il est diplômé de l’Institut d’études politiques de Toulouse (promo 2000) et titulaire d’un master en négociations internationales à l’Université Paris-Saclay. Depuis le 24 juin 2024, il occupe le poste prestigieux de Consul général de France à New York (États-Unis). Il a débuté sa carrière professionnelle diplomatique à l’ambassade de France à Chypre en tant que chef de chancellerie et vice-consul (2007-2009). Il a ensuite travaillé sur les questions politiques du ministère des Affaires étrangères, à la direction de l’Union européenne, de 2009 à 2014, puis à nouveau entre 2019 et 2022, chargé notamment du suivi des relations extérieures de l’UE avec l’Amérique, la Russie et l’Asie – au moment de la présidence française du Conseil de l’Union Européenne, de janvier à juin 2022. Entre ces deux périodes, de 2015 à 2019, il a intégré la Représentation permanente de la France auprès de l’UE, à Bruxelles (Belgique), en tant que conseiller-négociateur français pour les dossiers liés à l’Afrique du Nord et au Moyen-Orient ainsi que sur les questions de défense européenne et de sécurité. Par ailleurs en 2019-2020 il a effectué une mission en tant que conseiller du directeur politique du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), en passant ensuite par d’autres postes prestigieux, puisqu’il était jusqu’en janvier 2024 conseiller pour les Affaires européennes au cabinet de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et directeur de cabinet adjoint de la secrétaire d’État en charge de l’Europe, Laurence Boone. Pendant dix-huit mois, il a ainsi assuré la coordination politique de la gestion des affaires européennes au Quai d’Orsay. Sur un plan plus personnel, il voue un attachement profond à sa ville natale et il adore aussi le sport, passionné de football depuis ses débuts de footballeur au Tarbes Pyrénées Football (TPF) et qui a gardé de ces années dans le Sud-Ouest une certaine vision du travail en équipe.
Cédrik FOURISCOT, né le 30 août 1977 à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées est diplomate de carrière et spécialiste des questions européennes. Dans sa jeunesse, il a pratiqué le football en club et aussi le tennis en compétition. Élève du lycée Théophile Gautier (1992-1995), il est diplômé de l’Institut d’études politiques de Toulouse (promo 2000) et titulaire d’un master en négociations internationales à l’Université Paris-Saclay. Depuis le 24 juin 2024, il occupe le poste prestigieux de Consul général de France à New York (États-Unis). Il a débuté sa carrière professionnelle diplomatique à l’ambassade de France à Chypre en tant que chef de chancellerie et vice-consul (2007-2009). Il a ensuite travaillé sur les questions politiques du ministère des Affaires étrangères, à la direction de l’Union européenne, de 2009 à 2014, puis à nouveau entre 2019 et 2022, chargé notamment du suivi des relations extérieures de l’UE avec l’Amérique, la Russie et l’Asie – au moment de la présidence française du Conseil de l’Union Européenne, de janvier à juin 2022. Entre ces deux périodes, de 2015 à 2019, il a intégré la Représentation permanente de la France auprès de l’UE, à Bruxelles (Belgique), en tant que conseiller-négociateur français pour les dossiers liés à l’Afrique du Nord et au Moyen-Orient ainsi que sur les questions de défense européenne et de sécurité. Par ailleurs en 2019-2020 il a effectué une mission en tant que conseiller du directeur politique du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), en passant ensuite par d’autres postes prestigieux, puisqu’il était jusqu’en janvier 2024 conseiller pour les Affaires européennes au cabinet de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, et directeur de cabinet adjoint de la secrétaire d’État en charge de l’Europe, Laurence Boone. Pendant dix-huit mois, il a ainsi assuré la coordination politique de la gestion des affaires européennes au Quai d’Orsay. Sur un plan plus personnel, il voue un attachement profond à sa ville natale et il adore aussi le sport, passionné de football depuis ses débuts de footballeur au Tarbes Pyrénées Football (TPF) et qui a gardé de ces années dans le Sud-Ouest une certaine vision du travail en équipe.FRAY David (1981-XXXX)
Grand pianiste de musique classique
 David FRAY, né le 24 mai 1981 à Tarbes est pianiste. Il commence le piano à 4 ans, et dès son plus jeune âge baigne dans les arts et dans la culture allemande. Ses choix musicaux le portent vers le répertoire allemand, et tout spécialement vers le compositeur Jean-Sébastien Bach. À 14 ans, il est distingué par le Conservatoire de Tarbes, où il obtient trois médailles d’or : piano, musique de chambre et formation musicale. La même année il remporte le concours des jeunes talents d’Aix- en-Provence, ce qui lui permet de jouer l’année suivante le concerto de Grieg avec le Sinfonia de Manchester, dirigé par Michel Brandt. En 1999, à l’âge de 17 ans, il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM) et de Danse de Paris dans la classe de Jacques Rouvier, où il obtient son diplôme de formation supérieure avec une mention très bien au récital du prix. En 2002, il est admis à l’unanimité en cycle de perfectionnement dans la classe de Jacques Rouvier et en formation supérieure de musique de chambre dans la classe de Christian Ivaldi. Il s’est produit, entre autres, à la Cité de la musique (2002), au Théâtre Mogador à Paris (2003), au Festival de La Roque-d'Anthéron (été 2004), au festival d’Entrecasteaux dans le Var, à la 15e édition de La Folle Journée de Nantes (2009), Place des Arts de Montréal et à l'Alti Hall de Kyoto (Japon). Il a collaboré avec des orchestres internationaux de renom comme l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre national de France, l’Orchestre du Mozarteum de Salzbourg, l’Orchestre du Bayerische Rundfunk, l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam, l’Orchestre Métropolitain du Grand Montréal. En 2009, il a fait ses débuts aux États-Unis avec le Cleveland Orchestra, suivi par des concerts avec le Boston Symphony, le San Francisco Symphony, le New York Philharmonic, le Chicago Symphony et le Los Angeles Philharmonic. Il a donné des récitals en Espagne, en Angleterre, en Amérique du Sud, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, en Corée. Il a multiplié les récompenses et les distinctions. En 2004, après s’être vu attribuer le 2e Grand Prix au Concours international de musique de Montréal et le prix de la meilleure interprétation d'une œuvre canadienne, la maison de disques canadienne ATMA Classique signe avec lui un contrat et lui fait enregistrer son premier disque consacré à Schubert et Liszt. En 2006, Virgin Classics signe avec lui un contrat d’exclusivité. L’année suivante, un disque est publié — enregistrement qui met « en miroir » les œuvres de Bach avec celles de Pierre Boulez. En 2008, le second disque est consacré aux quatre concertos pour clavier et cordes de Bach, pour lesquels il est accompagné par l’Orchestre de Chambre de Brême. Il a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux prix allemand Echo Klassik pour instrumentiste de l'année et le YoungTalent Award du Ruhr Piano Festival. En 2008, il a été nommé Newcomer of the Year par le BBC Music Magazine. Depuis 2008, il a enregistré des concertos de Bach, les Impromptus et Moments musicaux de Schubert, et les 22e et 25e concertos pour piano de Mozart. Son interprétation de la Wanderer-Fantaisie de Schubert, filmée par Bruno Monsaingeon à la Roque d'Anthéron en 2004, est également parue en DVD. En 2010, il a reçu le titre de "Soliste instrumental de l'année" lors des 17e Victoires de la musique classique. Dernière parution, les sonates pour violon et piano de JS Bach avec le violoniste Renaud Capuçon (mars 2019). Un disque dynamique, plein de lumière et de profonde gravité. Il est l’un des pianistes les plus doués de sa génération.
David FRAY, né le 24 mai 1981 à Tarbes est pianiste. Il commence le piano à 4 ans, et dès son plus jeune âge baigne dans les arts et dans la culture allemande. Ses choix musicaux le portent vers le répertoire allemand, et tout spécialement vers le compositeur Jean-Sébastien Bach. À 14 ans, il est distingué par le Conservatoire de Tarbes, où il obtient trois médailles d’or : piano, musique de chambre et formation musicale. La même année il remporte le concours des jeunes talents d’Aix- en-Provence, ce qui lui permet de jouer l’année suivante le concerto de Grieg avec le Sinfonia de Manchester, dirigé par Michel Brandt. En 1999, à l’âge de 17 ans, il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM) et de Danse de Paris dans la classe de Jacques Rouvier, où il obtient son diplôme de formation supérieure avec une mention très bien au récital du prix. En 2002, il est admis à l’unanimité en cycle de perfectionnement dans la classe de Jacques Rouvier et en formation supérieure de musique de chambre dans la classe de Christian Ivaldi. Il s’est produit, entre autres, à la Cité de la musique (2002), au Théâtre Mogador à Paris (2003), au Festival de La Roque-d'Anthéron (été 2004), au festival d’Entrecasteaux dans le Var, à la 15e édition de La Folle Journée de Nantes (2009), Place des Arts de Montréal et à l'Alti Hall de Kyoto (Japon). Il a collaboré avec des orchestres internationaux de renom comme l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre national de France, l’Orchestre du Mozarteum de Salzbourg, l’Orchestre du Bayerische Rundfunk, l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam, l’Orchestre Métropolitain du Grand Montréal. En 2009, il a fait ses débuts aux États-Unis avec le Cleveland Orchestra, suivi par des concerts avec le Boston Symphony, le San Francisco Symphony, le New York Philharmonic, le Chicago Symphony et le Los Angeles Philharmonic. Il a donné des récitals en Espagne, en Angleterre, en Amérique du Sud, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, en Corée. Il a multiplié les récompenses et les distinctions. En 2004, après s’être vu attribuer le 2e Grand Prix au Concours international de musique de Montréal et le prix de la meilleure interprétation d'une œuvre canadienne, la maison de disques canadienne ATMA Classique signe avec lui un contrat et lui fait enregistrer son premier disque consacré à Schubert et Liszt. En 2006, Virgin Classics signe avec lui un contrat d’exclusivité. L’année suivante, un disque est publié — enregistrement qui met « en miroir » les œuvres de Bach avec celles de Pierre Boulez. En 2008, le second disque est consacré aux quatre concertos pour clavier et cordes de Bach, pour lesquels il est accompagné par l’Orchestre de Chambre de Brême. Il a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux prix allemand Echo Klassik pour instrumentiste de l'année et le YoungTalent Award du Ruhr Piano Festival. En 2008, il a été nommé Newcomer of the Year par le BBC Music Magazine. Depuis 2008, il a enregistré des concertos de Bach, les Impromptus et Moments musicaux de Schubert, et les 22e et 25e concertos pour piano de Mozart. Son interprétation de la Wanderer-Fantaisie de Schubert, filmée par Bruno Monsaingeon à la Roque d'Anthéron en 2004, est également parue en DVD. En 2010, il a reçu le titre de "Soliste instrumental de l'année" lors des 17e Victoires de la musique classique. Dernière parution, les sonates pour violon et piano de JS Bach avec le violoniste Renaud Capuçon (mars 2019). Un disque dynamique, plein de lumière et de profonde gravité. Il est l’un des pianistes les plus doués de sa génération.
 David FRAY, né le 24 mai 1981 à Tarbes est pianiste. Il commence le piano à 4 ans, et dès son plus jeune âge baigne dans les arts et dans la culture allemande. Ses choix musicaux le portent vers le répertoire allemand, et tout spécialement vers le compositeur Jean-Sébastien Bach. À 14 ans, il est distingué par le Conservatoire de Tarbes, où il obtient trois médailles d’or : piano, musique de chambre et formation musicale. La même année il remporte le concours des jeunes talents d’Aix- en-Provence, ce qui lui permet de jouer l’année suivante le concerto de Grieg avec le Sinfonia de Manchester, dirigé par Michel Brandt. En 1999, à l’âge de 17 ans, il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM) et de Danse de Paris dans la classe de Jacques Rouvier, où il obtient son diplôme de formation supérieure avec une mention très bien au récital du prix. En 2002, il est admis à l’unanimité en cycle de perfectionnement dans la classe de Jacques Rouvier et en formation supérieure de musique de chambre dans la classe de Christian Ivaldi. Il s’est produit, entre autres, à la Cité de la musique (2002), au Théâtre Mogador à Paris (2003), au Festival de La Roque-d'Anthéron (été 2004), au festival d’Entrecasteaux dans le Var, à la 15e édition de La Folle Journée de Nantes (2009), Place des Arts de Montréal et à l'Alti Hall de Kyoto (Japon). Il a collaboré avec des orchestres internationaux de renom comme l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre national de France, l’Orchestre du Mozarteum de Salzbourg, l’Orchestre du Bayerische Rundfunk, l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam, l’Orchestre Métropolitain du Grand Montréal. En 2009, il a fait ses débuts aux États-Unis avec le Cleveland Orchestra, suivi par des concerts avec le Boston Symphony, le San Francisco Symphony, le New York Philharmonic, le Chicago Symphony et le Los Angeles Philharmonic. Il a donné des récitals en Espagne, en Angleterre, en Amérique du Sud, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, en Corée. Il a multiplié les récompenses et les distinctions. En 2004, après s’être vu attribuer le 2e Grand Prix au Concours international de musique de Montréal et le prix de la meilleure interprétation d'une œuvre canadienne, la maison de disques canadienne ATMA Classique signe avec lui un contrat et lui fait enregistrer son premier disque consacré à Schubert et Liszt. En 2006, Virgin Classics signe avec lui un contrat d’exclusivité. L’année suivante, un disque est publié — enregistrement qui met « en miroir » les œuvres de Bach avec celles de Pierre Boulez. En 2008, le second disque est consacré aux quatre concertos pour clavier et cordes de Bach, pour lesquels il est accompagné par l’Orchestre de Chambre de Brême. Il a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux prix allemand Echo Klassik pour instrumentiste de l'année et le YoungTalent Award du Ruhr Piano Festival. En 2008, il a été nommé Newcomer of the Year par le BBC Music Magazine. Depuis 2008, il a enregistré des concertos de Bach, les Impromptus et Moments musicaux de Schubert, et les 22e et 25e concertos pour piano de Mozart. Son interprétation de la Wanderer-Fantaisie de Schubert, filmée par Bruno Monsaingeon à la Roque d'Anthéron en 2004, est également parue en DVD. En 2010, il a reçu le titre de "Soliste instrumental de l'année" lors des 17e Victoires de la musique classique. Dernière parution, les sonates pour violon et piano de JS Bach avec le violoniste Renaud Capuçon (mars 2019). Un disque dynamique, plein de lumière et de profonde gravité. Il est l’un des pianistes les plus doués de sa génération.
David FRAY, né le 24 mai 1981 à Tarbes est pianiste. Il commence le piano à 4 ans, et dès son plus jeune âge baigne dans les arts et dans la culture allemande. Ses choix musicaux le portent vers le répertoire allemand, et tout spécialement vers le compositeur Jean-Sébastien Bach. À 14 ans, il est distingué par le Conservatoire de Tarbes, où il obtient trois médailles d’or : piano, musique de chambre et formation musicale. La même année il remporte le concours des jeunes talents d’Aix- en-Provence, ce qui lui permet de jouer l’année suivante le concerto de Grieg avec le Sinfonia de Manchester, dirigé par Michel Brandt. En 1999, à l’âge de 17 ans, il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM) et de Danse de Paris dans la classe de Jacques Rouvier, où il obtient son diplôme de formation supérieure avec une mention très bien au récital du prix. En 2002, il est admis à l’unanimité en cycle de perfectionnement dans la classe de Jacques Rouvier et en formation supérieure de musique de chambre dans la classe de Christian Ivaldi. Il s’est produit, entre autres, à la Cité de la musique (2002), au Théâtre Mogador à Paris (2003), au Festival de La Roque-d'Anthéron (été 2004), au festival d’Entrecasteaux dans le Var, à la 15e édition de La Folle Journée de Nantes (2009), Place des Arts de Montréal et à l'Alti Hall de Kyoto (Japon). Il a collaboré avec des orchestres internationaux de renom comme l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre national de France, l’Orchestre du Mozarteum de Salzbourg, l’Orchestre du Bayerische Rundfunk, l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam, l’Orchestre Métropolitain du Grand Montréal. En 2009, il a fait ses débuts aux États-Unis avec le Cleveland Orchestra, suivi par des concerts avec le Boston Symphony, le San Francisco Symphony, le New York Philharmonic, le Chicago Symphony et le Los Angeles Philharmonic. Il a donné des récitals en Espagne, en Angleterre, en Amérique du Sud, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, en Corée. Il a multiplié les récompenses et les distinctions. En 2004, après s’être vu attribuer le 2e Grand Prix au Concours international de musique de Montréal et le prix de la meilleure interprétation d'une œuvre canadienne, la maison de disques canadienne ATMA Classique signe avec lui un contrat et lui fait enregistrer son premier disque consacré à Schubert et Liszt. En 2006, Virgin Classics signe avec lui un contrat d’exclusivité. L’année suivante, un disque est publié — enregistrement qui met « en miroir » les œuvres de Bach avec celles de Pierre Boulez. En 2008, le second disque est consacré aux quatre concertos pour clavier et cordes de Bach, pour lesquels il est accompagné par l’Orchestre de Chambre de Brême. Il a reçu de nombreux prix, dont le prestigieux prix allemand Echo Klassik pour instrumentiste de l'année et le YoungTalent Award du Ruhr Piano Festival. En 2008, il a été nommé Newcomer of the Year par le BBC Music Magazine. Depuis 2008, il a enregistré des concertos de Bach, les Impromptus et Moments musicaux de Schubert, et les 22e et 25e concertos pour piano de Mozart. Son interprétation de la Wanderer-Fantaisie de Schubert, filmée par Bruno Monsaingeon à la Roque d'Anthéron en 2004, est également parue en DVD. En 2010, il a reçu le titre de "Soliste instrumental de l'année" lors des 17e Victoires de la musique classique. Dernière parution, les sonates pour violon et piano de JS Bach avec le violoniste Renaud Capuçon (mars 2019). Un disque dynamique, plein de lumière et de profonde gravité. Il est l’un des pianistes les plus doués de sa génération.FURCY Rodrigue (1981-XXXX)
Préfet des Hautes-Pyrénées, ancien chef de cabinet adjoint du Président de la République
 Rodrigue FURCY, né en 1981 à Tourcoing, sans doute est-il le plus jeune préfet qu’a connu le département des Hautes-Pyrénées. Dans le cadre d'un important mouvement préfectoral, confirmé par Gabriel Attal, porte-parole du Gouvernement à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 29 juillet 2020, Rodrigue Furcy, administrateur civil hors classe, a été nommé Préfet des Hautes-Pyrénées, à compter du 24 août. Rodrigue Furcy a grandi en banlieue parisienne. Entre 1999 et 2003, il fait ses études à l'Institut d’études politiques (IEP) de Rennes avant de revenir en région parisienne. De 2003 à 2007, il a travaillé comme chargé de mission à la mairie du 19ème arrondissement de Paris, où il s’est occupé de la politique de la ville et de l’urbanisme. Après avoir passé en interne le concours d’entrée à l’ENA, de janvier 2008 à mars 2010 il est élève de l’École nationale d’administration – promotion "Emile Zola". À sa sortie de l’ENA, en 2010, il choisit le corps préfectoral en étant sous-préfet et directeur de cabinet du préfet de la Loire, à Saint-Étienne. De décembre 2011 à août 2013, il a été secrétaire général de la préfecture des Alpes de Haute-Provence, à Digne-les-Bains, un département rural de montagne, ayant une certaine ressemblance avec les Hautes-Pyrénées. En 2014, il a fait la mobilité statutaire à l’ENA comme directeur adjoint des stages. En 2015, il rejoint le ministère de l’Intérieur, occupant le poste de chef du bureau de management du corps préfectoral, qui assure la fonction RH des sous-préfets. En mai 2017, il a été nommé à la présidence de la République comme chef de cabinet adjoint auprès du président de la République Emmanuel Macron, en charge de ses déplacements et de son agenda. Poste qu’il a occupé jusqu’au dimanche 23 août 2020. Les Hautes-Pyrénées, il les connaît un peu pour y être venu en vacances dans sa jeunesse, pour faire de la montagne mais pas pour skier. Rodrigue Furcy, un homme de grande qualité, en qui le président Macron ne peut qu'avoir pleinement confiance. Mais aussi un proche pour le président de la République, lui permettant d’avoir un œil bienveillant sur un département auquel il est attaché. Rodrigue Furcy a annoncé dans une première allocution publique, vouloir être un préfet de "terrain".
Rodrigue FURCY, né en 1981 à Tourcoing, sans doute est-il le plus jeune préfet qu’a connu le département des Hautes-Pyrénées. Dans le cadre d'un important mouvement préfectoral, confirmé par Gabriel Attal, porte-parole du Gouvernement à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 29 juillet 2020, Rodrigue Furcy, administrateur civil hors classe, a été nommé Préfet des Hautes-Pyrénées, à compter du 24 août. Rodrigue Furcy a grandi en banlieue parisienne. Entre 1999 et 2003, il fait ses études à l'Institut d’études politiques (IEP) de Rennes avant de revenir en région parisienne. De 2003 à 2007, il a travaillé comme chargé de mission à la mairie du 19ème arrondissement de Paris, où il s’est occupé de la politique de la ville et de l’urbanisme. Après avoir passé en interne le concours d’entrée à l’ENA, de janvier 2008 à mars 2010 il est élève de l’École nationale d’administration – promotion "Emile Zola". À sa sortie de l’ENA, en 2010, il choisit le corps préfectoral en étant sous-préfet et directeur de cabinet du préfet de la Loire, à Saint-Étienne. De décembre 2011 à août 2013, il a été secrétaire général de la préfecture des Alpes de Haute-Provence, à Digne-les-Bains, un département rural de montagne, ayant une certaine ressemblance avec les Hautes-Pyrénées. En 2014, il a fait la mobilité statutaire à l’ENA comme directeur adjoint des stages. En 2015, il rejoint le ministère de l’Intérieur, occupant le poste de chef du bureau de management du corps préfectoral, qui assure la fonction RH des sous-préfets. En mai 2017, il a été nommé à la présidence de la République comme chef de cabinet adjoint auprès du président de la République Emmanuel Macron, en charge de ses déplacements et de son agenda. Poste qu’il a occupé jusqu’au dimanche 23 août 2020. Les Hautes-Pyrénées, il les connaît un peu pour y être venu en vacances dans sa jeunesse, pour faire de la montagne mais pas pour skier. Rodrigue Furcy, un homme de grande qualité, en qui le président Macron ne peut qu'avoir pleinement confiance. Mais aussi un proche pour le président de la République, lui permettant d’avoir un œil bienveillant sur un département auquel il est attaché. Rodrigue Furcy a annoncé dans une première allocution publique, vouloir être un préfet de "terrain".
 Rodrigue FURCY, né en 1981 à Tourcoing, sans doute est-il le plus jeune préfet qu’a connu le département des Hautes-Pyrénées. Dans le cadre d'un important mouvement préfectoral, confirmé par Gabriel Attal, porte-parole du Gouvernement à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 29 juillet 2020, Rodrigue Furcy, administrateur civil hors classe, a été nommé Préfet des Hautes-Pyrénées, à compter du 24 août. Rodrigue Furcy a grandi en banlieue parisienne. Entre 1999 et 2003, il fait ses études à l'Institut d’études politiques (IEP) de Rennes avant de revenir en région parisienne. De 2003 à 2007, il a travaillé comme chargé de mission à la mairie du 19ème arrondissement de Paris, où il s’est occupé de la politique de la ville et de l’urbanisme. Après avoir passé en interne le concours d’entrée à l’ENA, de janvier 2008 à mars 2010 il est élève de l’École nationale d’administration – promotion "Emile Zola". À sa sortie de l’ENA, en 2010, il choisit le corps préfectoral en étant sous-préfet et directeur de cabinet du préfet de la Loire, à Saint-Étienne. De décembre 2011 à août 2013, il a été secrétaire général de la préfecture des Alpes de Haute-Provence, à Digne-les-Bains, un département rural de montagne, ayant une certaine ressemblance avec les Hautes-Pyrénées. En 2014, il a fait la mobilité statutaire à l’ENA comme directeur adjoint des stages. En 2015, il rejoint le ministère de l’Intérieur, occupant le poste de chef du bureau de management du corps préfectoral, qui assure la fonction RH des sous-préfets. En mai 2017, il a été nommé à la présidence de la République comme chef de cabinet adjoint auprès du président de la République Emmanuel Macron, en charge de ses déplacements et de son agenda. Poste qu’il a occupé jusqu’au dimanche 23 août 2020. Les Hautes-Pyrénées, il les connaît un peu pour y être venu en vacances dans sa jeunesse, pour faire de la montagne mais pas pour skier. Rodrigue Furcy, un homme de grande qualité, en qui le président Macron ne peut qu'avoir pleinement confiance. Mais aussi un proche pour le président de la République, lui permettant d’avoir un œil bienveillant sur un département auquel il est attaché. Rodrigue Furcy a annoncé dans une première allocution publique, vouloir être un préfet de "terrain".
Rodrigue FURCY, né en 1981 à Tourcoing, sans doute est-il le plus jeune préfet qu’a connu le département des Hautes-Pyrénées. Dans le cadre d'un important mouvement préfectoral, confirmé par Gabriel Attal, porte-parole du Gouvernement à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 29 juillet 2020, Rodrigue Furcy, administrateur civil hors classe, a été nommé Préfet des Hautes-Pyrénées, à compter du 24 août. Rodrigue Furcy a grandi en banlieue parisienne. Entre 1999 et 2003, il fait ses études à l'Institut d’études politiques (IEP) de Rennes avant de revenir en région parisienne. De 2003 à 2007, il a travaillé comme chargé de mission à la mairie du 19ème arrondissement de Paris, où il s’est occupé de la politique de la ville et de l’urbanisme. Après avoir passé en interne le concours d’entrée à l’ENA, de janvier 2008 à mars 2010 il est élève de l’École nationale d’administration – promotion "Emile Zola". À sa sortie de l’ENA, en 2010, il choisit le corps préfectoral en étant sous-préfet et directeur de cabinet du préfet de la Loire, à Saint-Étienne. De décembre 2011 à août 2013, il a été secrétaire général de la préfecture des Alpes de Haute-Provence, à Digne-les-Bains, un département rural de montagne, ayant une certaine ressemblance avec les Hautes-Pyrénées. En 2014, il a fait la mobilité statutaire à l’ENA comme directeur adjoint des stages. En 2015, il rejoint le ministère de l’Intérieur, occupant le poste de chef du bureau de management du corps préfectoral, qui assure la fonction RH des sous-préfets. En mai 2017, il a été nommé à la présidence de la République comme chef de cabinet adjoint auprès du président de la République Emmanuel Macron, en charge de ses déplacements et de son agenda. Poste qu’il a occupé jusqu’au dimanche 23 août 2020. Les Hautes-Pyrénées, il les connaît un peu pour y être venu en vacances dans sa jeunesse, pour faire de la montagne mais pas pour skier. Rodrigue Furcy, un homme de grande qualité, en qui le président Macron ne peut qu'avoir pleinement confiance. Mais aussi un proche pour le président de la République, lui permettant d’avoir un œil bienveillant sur un département auquel il est attaché. Rodrigue Furcy a annoncé dans une première allocution publique, vouloir être un préfet de "terrain".GACHASSIN Jean (1941-XXXX)
Joueur international de rugby à XV, président de la Fédération française de tennis
 Jean GACHASSIN, alias "Peter Pan", né le 23 décembre 1941 à Bagnères-de-Bigorre, est un joueur de rugby à XV international, qui a joué à divers postes, celui d’ailier, demi d’ouverture, arrière et centre dans les années 60. Surnommé « Peter Pan », il est le plus petit joueur de l’histoire du XV de France (1m61, 62 kg). Sa vivacité, son aisance à esquiver l’adversaire, son art du contrepied et sa vitesse de course lui ont permis de faire le bonheur de l’équipe de France de rugby de 1961 à 1969. Par la suite de 2009 à 2017, il est devenu président de la Fédération française de tennis (FFT). À 17 ans, il est sélectionné en équipe de France de rugby espoirs. En club, il évolue avec le Football club lourdais de 1960 à 1969, puis avec le Stade bagnérais de 1969 à 1978. Il remporte un titre de champion de France avec le FC Lourdes en 1968 face à Toulon, et le Challenge Yves du Manoir par deux fois en 1966 et 1967. En équipe de France (32 sélections internationales sous le maillot bleu - 8 essais), il remporte le Tournoi des Cinq Nations en 1961 et 1967, avant de réussir le Grand Chelem en 1968, dans le Tournoi des Cinq Nations, même si le 23 mars 1968 il ne disputa pas le dernier match sur la pelouse de l’Arms Park à Cardiff contre les Gallois. En 1964, il participe à une tournée en Afrique du Sud. En 1990, en compagnie de Philippe Dintrans, il réussit à faire fusionner l’équipe du Stadoceste tarbais avec celle du Cercle amical lannemezanais sous le nom de « Lannemezan Tarbes Hautes-Pyrénées ». En fin de carrière, président du tennis-club de Bagnères-de-Bigorre de 1971 à 1993, président du comité départemental de tennis des Hautes-Pyrénées de 1984 à 1990, il gravit petit à petit les échelons. Il occupe la présidence de la Ligue de tennis de Midi-Pyrénées de 1993 à 2009, avant de prendre la vice-présidence de la Fédération française de tennis en 1997. En 2006, l’académie des Sports lui remet le prix Alain Danet pour sa reconversion professionnelle réussie. Le 8 février 2009, il succède à Christian Bîmes au poste de président de la Fédération française de tennis. Après deux mandats à la tête de la FFT il passera la main en février 2017, à près de 76 ans. Le 23 septembre 2011, il est élu vice-président de la Fédération internationale de tennis pour la période 2011-2013 et il est réélu en 2013 pour un nouveau mandat de deux ans. Marié en 1963 à Marie-Germaine, agrégée d’anglais, il a deux enfants et quatre petits-enfants. Par ailleurs, il a été président du Conseil d’administration du CREPS de Toulouse pendant cinq ans, président de l’office municipal des sports de Bagnères-de-Bigorre pendant 14 ans, adjoint au maire de Bagnères-de-Bigorre chargé du tourisme (1989-2010) et président de l’office du tourisme de Bagnères-de-Bigorre pendant 21 ans. Comme joueur de tennis, il a participé au rassemblement des meilleurs espoirs du tennis français à l’âge de 17 ans - son meilleur classement : 2/6. Il fut aussi dans sa jeunesse, champion des Pyrénées de slalom géant, champion des Pyrénées du 100 mètres en 10''8. C’est un de ses fils, Christian, qui lui succède comme huissier de justice à Bagnères-de-Bigorre. Il est par ailleurs auteur de plusieurs livres. « Le rugby est une fête » paru chez Solar en 1969, « Lux, Dourthe, Maso, Trillo, Carré d'as du rugby » éd. Solar, 1970, « Le Rugby des villages » éd. Les éditeurs français réunis, 1974, « Jean Gachassin - Jeux, sets et matchs » paru chez Cristel en 2017, « Gachassin par Jean Gachassin » paru aux Editions Jacob-Duvernet en 2019.
Jean GACHASSIN, alias "Peter Pan", né le 23 décembre 1941 à Bagnères-de-Bigorre, est un joueur de rugby à XV international, qui a joué à divers postes, celui d’ailier, demi d’ouverture, arrière et centre dans les années 60. Surnommé « Peter Pan », il est le plus petit joueur de l’histoire du XV de France (1m61, 62 kg). Sa vivacité, son aisance à esquiver l’adversaire, son art du contrepied et sa vitesse de course lui ont permis de faire le bonheur de l’équipe de France de rugby de 1961 à 1969. Par la suite de 2009 à 2017, il est devenu président de la Fédération française de tennis (FFT). À 17 ans, il est sélectionné en équipe de France de rugby espoirs. En club, il évolue avec le Football club lourdais de 1960 à 1969, puis avec le Stade bagnérais de 1969 à 1978. Il remporte un titre de champion de France avec le FC Lourdes en 1968 face à Toulon, et le Challenge Yves du Manoir par deux fois en 1966 et 1967. En équipe de France (32 sélections internationales sous le maillot bleu - 8 essais), il remporte le Tournoi des Cinq Nations en 1961 et 1967, avant de réussir le Grand Chelem en 1968, dans le Tournoi des Cinq Nations, même si le 23 mars 1968 il ne disputa pas le dernier match sur la pelouse de l’Arms Park à Cardiff contre les Gallois. En 1964, il participe à une tournée en Afrique du Sud. En 1990, en compagnie de Philippe Dintrans, il réussit à faire fusionner l’équipe du Stadoceste tarbais avec celle du Cercle amical lannemezanais sous le nom de « Lannemezan Tarbes Hautes-Pyrénées ». En fin de carrière, président du tennis-club de Bagnères-de-Bigorre de 1971 à 1993, président du comité départemental de tennis des Hautes-Pyrénées de 1984 à 1990, il gravit petit à petit les échelons. Il occupe la présidence de la Ligue de tennis de Midi-Pyrénées de 1993 à 2009, avant de prendre la vice-présidence de la Fédération française de tennis en 1997. En 2006, l’académie des Sports lui remet le prix Alain Danet pour sa reconversion professionnelle réussie. Le 8 février 2009, il succède à Christian Bîmes au poste de président de la Fédération française de tennis. Après deux mandats à la tête de la FFT il passera la main en février 2017, à près de 76 ans. Le 23 septembre 2011, il est élu vice-président de la Fédération internationale de tennis pour la période 2011-2013 et il est réélu en 2013 pour un nouveau mandat de deux ans. Marié en 1963 à Marie-Germaine, agrégée d’anglais, il a deux enfants et quatre petits-enfants. Par ailleurs, il a été président du Conseil d’administration du CREPS de Toulouse pendant cinq ans, président de l’office municipal des sports de Bagnères-de-Bigorre pendant 14 ans, adjoint au maire de Bagnères-de-Bigorre chargé du tourisme (1989-2010) et président de l’office du tourisme de Bagnères-de-Bigorre pendant 21 ans. Comme joueur de tennis, il a participé au rassemblement des meilleurs espoirs du tennis français à l’âge de 17 ans - son meilleur classement : 2/6. Il fut aussi dans sa jeunesse, champion des Pyrénées de slalom géant, champion des Pyrénées du 100 mètres en 10''8. C’est un de ses fils, Christian, qui lui succède comme huissier de justice à Bagnères-de-Bigorre. Il est par ailleurs auteur de plusieurs livres. « Le rugby est une fête » paru chez Solar en 1969, « Lux, Dourthe, Maso, Trillo, Carré d'as du rugby » éd. Solar, 1970, « Le Rugby des villages » éd. Les éditeurs français réunis, 1974, « Jean Gachassin - Jeux, sets et matchs » paru chez Cristel en 2017, « Gachassin par Jean Gachassin » paru aux Editions Jacob-Duvernet en 2019.
 Jean GACHASSIN, alias "Peter Pan", né le 23 décembre 1941 à Bagnères-de-Bigorre, est un joueur de rugby à XV international, qui a joué à divers postes, celui d’ailier, demi d’ouverture, arrière et centre dans les années 60. Surnommé « Peter Pan », il est le plus petit joueur de l’histoire du XV de France (1m61, 62 kg). Sa vivacité, son aisance à esquiver l’adversaire, son art du contrepied et sa vitesse de course lui ont permis de faire le bonheur de l’équipe de France de rugby de 1961 à 1969. Par la suite de 2009 à 2017, il est devenu président de la Fédération française de tennis (FFT). À 17 ans, il est sélectionné en équipe de France de rugby espoirs. En club, il évolue avec le Football club lourdais de 1960 à 1969, puis avec le Stade bagnérais de 1969 à 1978. Il remporte un titre de champion de France avec le FC Lourdes en 1968 face à Toulon, et le Challenge Yves du Manoir par deux fois en 1966 et 1967. En équipe de France (32 sélections internationales sous le maillot bleu - 8 essais), il remporte le Tournoi des Cinq Nations en 1961 et 1967, avant de réussir le Grand Chelem en 1968, dans le Tournoi des Cinq Nations, même si le 23 mars 1968 il ne disputa pas le dernier match sur la pelouse de l’Arms Park à Cardiff contre les Gallois. En 1964, il participe à une tournée en Afrique du Sud. En 1990, en compagnie de Philippe Dintrans, il réussit à faire fusionner l’équipe du Stadoceste tarbais avec celle du Cercle amical lannemezanais sous le nom de « Lannemezan Tarbes Hautes-Pyrénées ». En fin de carrière, président du tennis-club de Bagnères-de-Bigorre de 1971 à 1993, président du comité départemental de tennis des Hautes-Pyrénées de 1984 à 1990, il gravit petit à petit les échelons. Il occupe la présidence de la Ligue de tennis de Midi-Pyrénées de 1993 à 2009, avant de prendre la vice-présidence de la Fédération française de tennis en 1997. En 2006, l’académie des Sports lui remet le prix Alain Danet pour sa reconversion professionnelle réussie. Le 8 février 2009, il succède à Christian Bîmes au poste de président de la Fédération française de tennis. Après deux mandats à la tête de la FFT il passera la main en février 2017, à près de 76 ans. Le 23 septembre 2011, il est élu vice-président de la Fédération internationale de tennis pour la période 2011-2013 et il est réélu en 2013 pour un nouveau mandat de deux ans. Marié en 1963 à Marie-Germaine, agrégée d’anglais, il a deux enfants et quatre petits-enfants. Par ailleurs, il a été président du Conseil d’administration du CREPS de Toulouse pendant cinq ans, président de l’office municipal des sports de Bagnères-de-Bigorre pendant 14 ans, adjoint au maire de Bagnères-de-Bigorre chargé du tourisme (1989-2010) et président de l’office du tourisme de Bagnères-de-Bigorre pendant 21 ans. Comme joueur de tennis, il a participé au rassemblement des meilleurs espoirs du tennis français à l’âge de 17 ans - son meilleur classement : 2/6. Il fut aussi dans sa jeunesse, champion des Pyrénées de slalom géant, champion des Pyrénées du 100 mètres en 10''8. C’est un de ses fils, Christian, qui lui succède comme huissier de justice à Bagnères-de-Bigorre. Il est par ailleurs auteur de plusieurs livres. « Le rugby est une fête » paru chez Solar en 1969, « Lux, Dourthe, Maso, Trillo, Carré d'as du rugby » éd. Solar, 1970, « Le Rugby des villages » éd. Les éditeurs français réunis, 1974, « Jean Gachassin - Jeux, sets et matchs » paru chez Cristel en 2017, « Gachassin par Jean Gachassin » paru aux Editions Jacob-Duvernet en 2019.
Jean GACHASSIN, alias "Peter Pan", né le 23 décembre 1941 à Bagnères-de-Bigorre, est un joueur de rugby à XV international, qui a joué à divers postes, celui d’ailier, demi d’ouverture, arrière et centre dans les années 60. Surnommé « Peter Pan », il est le plus petit joueur de l’histoire du XV de France (1m61, 62 kg). Sa vivacité, son aisance à esquiver l’adversaire, son art du contrepied et sa vitesse de course lui ont permis de faire le bonheur de l’équipe de France de rugby de 1961 à 1969. Par la suite de 2009 à 2017, il est devenu président de la Fédération française de tennis (FFT). À 17 ans, il est sélectionné en équipe de France de rugby espoirs. En club, il évolue avec le Football club lourdais de 1960 à 1969, puis avec le Stade bagnérais de 1969 à 1978. Il remporte un titre de champion de France avec le FC Lourdes en 1968 face à Toulon, et le Challenge Yves du Manoir par deux fois en 1966 et 1967. En équipe de France (32 sélections internationales sous le maillot bleu - 8 essais), il remporte le Tournoi des Cinq Nations en 1961 et 1967, avant de réussir le Grand Chelem en 1968, dans le Tournoi des Cinq Nations, même si le 23 mars 1968 il ne disputa pas le dernier match sur la pelouse de l’Arms Park à Cardiff contre les Gallois. En 1964, il participe à une tournée en Afrique du Sud. En 1990, en compagnie de Philippe Dintrans, il réussit à faire fusionner l’équipe du Stadoceste tarbais avec celle du Cercle amical lannemezanais sous le nom de « Lannemezan Tarbes Hautes-Pyrénées ». En fin de carrière, président du tennis-club de Bagnères-de-Bigorre de 1971 à 1993, président du comité départemental de tennis des Hautes-Pyrénées de 1984 à 1990, il gravit petit à petit les échelons. Il occupe la présidence de la Ligue de tennis de Midi-Pyrénées de 1993 à 2009, avant de prendre la vice-présidence de la Fédération française de tennis en 1997. En 2006, l’académie des Sports lui remet le prix Alain Danet pour sa reconversion professionnelle réussie. Le 8 février 2009, il succède à Christian Bîmes au poste de président de la Fédération française de tennis. Après deux mandats à la tête de la FFT il passera la main en février 2017, à près de 76 ans. Le 23 septembre 2011, il est élu vice-président de la Fédération internationale de tennis pour la période 2011-2013 et il est réélu en 2013 pour un nouveau mandat de deux ans. Marié en 1963 à Marie-Germaine, agrégée d’anglais, il a deux enfants et quatre petits-enfants. Par ailleurs, il a été président du Conseil d’administration du CREPS de Toulouse pendant cinq ans, président de l’office municipal des sports de Bagnères-de-Bigorre pendant 14 ans, adjoint au maire de Bagnères-de-Bigorre chargé du tourisme (1989-2010) et président de l’office du tourisme de Bagnères-de-Bigorre pendant 21 ans. Comme joueur de tennis, il a participé au rassemblement des meilleurs espoirs du tennis français à l’âge de 17 ans - son meilleur classement : 2/6. Il fut aussi dans sa jeunesse, champion des Pyrénées de slalom géant, champion des Pyrénées du 100 mètres en 10''8. C’est un de ses fils, Christian, qui lui succède comme huissier de justice à Bagnères-de-Bigorre. Il est par ailleurs auteur de plusieurs livres. « Le rugby est une fête » paru chez Solar en 1969, « Lux, Dourthe, Maso, Trillo, Carré d'as du rugby » éd. Solar, 1970, « Le Rugby des villages » éd. Les éditeurs français réunis, 1974, « Jean Gachassin - Jeux, sets et matchs » paru chez Cristel en 2017, « Gachassin par Jean Gachassin » paru aux Editions Jacob-Duvernet en 2019.GARUET Jean-Pierre (1953-XXXX)
Pilier international de rugby à XV
 Jean-Pierre GARUET, dit « le Professeur ou Garuche », né le 15 juin 1953 à Pontacq a occupé le poste de pilier droit au Football-Club Lourdais de 1969 à 1991, où il commença à endosser le maillot « rouge et bleu » en équipe cadets puis en juniors et en équipe de France, où il totalisera 42 sélections entre 1983 et 1990. Il a été l’un des meilleurs et plus féroces piliers de l’histoire du rugby mondial, mesurant 1m77 pour 105kg de muscles. Il fut élu deux fois meilleur pilier du monde dans les années 1980. Il participa au total à 7 éditions du Tournoi des Cinq Nations. Il débuta en sélection nationale le 13 novembre 1983 contre l'Australie. Il sera le tout premier joueur du XV de France expulsé en match officiel : alors que la France affronte l'Irlande au Parc des Princes, lors du Tournoi des Cinq Nations 1984, il est expulsé par l'arbitre gallois Clive Norling (Pays de Galle) pour une fourchette sur le troisième ligne irlandais John O'Driscoll. Au banquet officiel, Albert Ferrasse, président de la FFR, le traite d'imbécile. On frise l'incident diplomatique. Jean-Pierre Rives, capitaine de l’équipe prendra la parole pour défendre son coéquipier. À la suite de cette expulsion, il sera suspendu pour trois mois, mais pourra partir avec ses petits camarades pour la tournée de l’été en Nouvelle-Zélande. Après le Grand Chelem de 1987, il sera sacré par les Anglais, du titre honorifique de « meilleur pilier du monde ». En 1984, il sera demi-finaliste du Championnat de France de rugby à XV de première division avec le FC Lourdes. Le 15 novembre 1986 à Nantes, il participa à la victoire française face aux Blacks (16-3). Rencontre entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande connue sous le nom de « La bataille de Nantes ». En 1987, il sera vainqueur avec les Bleus du Tournoi des Cinq Nations contre l’Irlande (19-13), en réussissant un Grand Chelem (quatre victoires en quatre matchs). Il fut de la première aventure mondiale en 1987 et constituait avec ses deux compères, Daniel Dubroca et le basque Pascal Ondarts, une première ligne coriace qui faisait reculer régulièrement les attelages des équipes adverses. Dans cette finale de coupe du Monde de 1987, les Bleus s’inclinèrent contre la Nouvelle-Zélande (29-9). La sélection nationale sera vice-championne du monde. Il aura gagné le Tournoi des Cinq Nations en 1986 à égalité avec l’Écosse, en 1987 (Grand Chelem), en 1988 à égalité avec le Pays de Galles et en 1989, la France remportant le Tournoi quatre années consécutives. Le 10 mai 1986, il fut invité avec les Barbarians français pour jouer contre l'Écosse à Agen. Les Baa-Baas l'emportèrent 32 à 19. Le 22 mai 1988, il jouera de nouveau avec les Barbarians français contre l'Irlande à La Rochelle. Les Baa-Baas l'emportèrent 41 à 26. Il arrêtera d'être joueur et raccrochera les crampons en 1991, après une dernière saison à l’âge de 38 ans. Il sera alors président du Comité départemental de rugby des Hautes-Pyrénées en 1991 et du Comité régional en 1995, ainsi que vice-président de son club de Lourdes et sélectionneur de l'équipe de France du temps où Pierre Berbizier était entraîneur du XV de France. Il exercera la fonction d'adjoint au maire de Lourdes jusqu'en 2014.
Jean-Pierre GARUET, dit « le Professeur ou Garuche », né le 15 juin 1953 à Pontacq a occupé le poste de pilier droit au Football-Club Lourdais de 1969 à 1991, où il commença à endosser le maillot « rouge et bleu » en équipe cadets puis en juniors et en équipe de France, où il totalisera 42 sélections entre 1983 et 1990. Il a été l’un des meilleurs et plus féroces piliers de l’histoire du rugby mondial, mesurant 1m77 pour 105kg de muscles. Il fut élu deux fois meilleur pilier du monde dans les années 1980. Il participa au total à 7 éditions du Tournoi des Cinq Nations. Il débuta en sélection nationale le 13 novembre 1983 contre l'Australie. Il sera le tout premier joueur du XV de France expulsé en match officiel : alors que la France affronte l'Irlande au Parc des Princes, lors du Tournoi des Cinq Nations 1984, il est expulsé par l'arbitre gallois Clive Norling (Pays de Galle) pour une fourchette sur le troisième ligne irlandais John O'Driscoll. Au banquet officiel, Albert Ferrasse, président de la FFR, le traite d'imbécile. On frise l'incident diplomatique. Jean-Pierre Rives, capitaine de l’équipe prendra la parole pour défendre son coéquipier. À la suite de cette expulsion, il sera suspendu pour trois mois, mais pourra partir avec ses petits camarades pour la tournée de l’été en Nouvelle-Zélande. Après le Grand Chelem de 1987, il sera sacré par les Anglais, du titre honorifique de « meilleur pilier du monde ». En 1984, il sera demi-finaliste du Championnat de France de rugby à XV de première division avec le FC Lourdes. Le 15 novembre 1986 à Nantes, il participa à la victoire française face aux Blacks (16-3). Rencontre entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande connue sous le nom de « La bataille de Nantes ». En 1987, il sera vainqueur avec les Bleus du Tournoi des Cinq Nations contre l’Irlande (19-13), en réussissant un Grand Chelem (quatre victoires en quatre matchs). Il fut de la première aventure mondiale en 1987 et constituait avec ses deux compères, Daniel Dubroca et le basque Pascal Ondarts, une première ligne coriace qui faisait reculer régulièrement les attelages des équipes adverses. Dans cette finale de coupe du Monde de 1987, les Bleus s’inclinèrent contre la Nouvelle-Zélande (29-9). La sélection nationale sera vice-championne du monde. Il aura gagné le Tournoi des Cinq Nations en 1986 à égalité avec l’Écosse, en 1987 (Grand Chelem), en 1988 à égalité avec le Pays de Galles et en 1989, la France remportant le Tournoi quatre années consécutives. Le 10 mai 1986, il fut invité avec les Barbarians français pour jouer contre l'Écosse à Agen. Les Baa-Baas l'emportèrent 32 à 19. Le 22 mai 1988, il jouera de nouveau avec les Barbarians français contre l'Irlande à La Rochelle. Les Baa-Baas l'emportèrent 41 à 26. Il arrêtera d'être joueur et raccrochera les crampons en 1991, après une dernière saison à l’âge de 38 ans. Il sera alors président du Comité départemental de rugby des Hautes-Pyrénées en 1991 et du Comité régional en 1995, ainsi que vice-président de son club de Lourdes et sélectionneur de l'équipe de France du temps où Pierre Berbizier était entraîneur du XV de France. Il exercera la fonction d'adjoint au maire de Lourdes jusqu'en 2014.
 Jean-Pierre GARUET, dit « le Professeur ou Garuche », né le 15 juin 1953 à Pontacq a occupé le poste de pilier droit au Football-Club Lourdais de 1969 à 1991, où il commença à endosser le maillot « rouge et bleu » en équipe cadets puis en juniors et en équipe de France, où il totalisera 42 sélections entre 1983 et 1990. Il a été l’un des meilleurs et plus féroces piliers de l’histoire du rugby mondial, mesurant 1m77 pour 105kg de muscles. Il fut élu deux fois meilleur pilier du monde dans les années 1980. Il participa au total à 7 éditions du Tournoi des Cinq Nations. Il débuta en sélection nationale le 13 novembre 1983 contre l'Australie. Il sera le tout premier joueur du XV de France expulsé en match officiel : alors que la France affronte l'Irlande au Parc des Princes, lors du Tournoi des Cinq Nations 1984, il est expulsé par l'arbitre gallois Clive Norling (Pays de Galle) pour une fourchette sur le troisième ligne irlandais John O'Driscoll. Au banquet officiel, Albert Ferrasse, président de la FFR, le traite d'imbécile. On frise l'incident diplomatique. Jean-Pierre Rives, capitaine de l’équipe prendra la parole pour défendre son coéquipier. À la suite de cette expulsion, il sera suspendu pour trois mois, mais pourra partir avec ses petits camarades pour la tournée de l’été en Nouvelle-Zélande. Après le Grand Chelem de 1987, il sera sacré par les Anglais, du titre honorifique de « meilleur pilier du monde ». En 1984, il sera demi-finaliste du Championnat de France de rugby à XV de première division avec le FC Lourdes. Le 15 novembre 1986 à Nantes, il participa à la victoire française face aux Blacks (16-3). Rencontre entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande connue sous le nom de « La bataille de Nantes ». En 1987, il sera vainqueur avec les Bleus du Tournoi des Cinq Nations contre l’Irlande (19-13), en réussissant un Grand Chelem (quatre victoires en quatre matchs). Il fut de la première aventure mondiale en 1987 et constituait avec ses deux compères, Daniel Dubroca et le basque Pascal Ondarts, une première ligne coriace qui faisait reculer régulièrement les attelages des équipes adverses. Dans cette finale de coupe du Monde de 1987, les Bleus s’inclinèrent contre la Nouvelle-Zélande (29-9). La sélection nationale sera vice-championne du monde. Il aura gagné le Tournoi des Cinq Nations en 1986 à égalité avec l’Écosse, en 1987 (Grand Chelem), en 1988 à égalité avec le Pays de Galles et en 1989, la France remportant le Tournoi quatre années consécutives. Le 10 mai 1986, il fut invité avec les Barbarians français pour jouer contre l'Écosse à Agen. Les Baa-Baas l'emportèrent 32 à 19. Le 22 mai 1988, il jouera de nouveau avec les Barbarians français contre l'Irlande à La Rochelle. Les Baa-Baas l'emportèrent 41 à 26. Il arrêtera d'être joueur et raccrochera les crampons en 1991, après une dernière saison à l’âge de 38 ans. Il sera alors président du Comité départemental de rugby des Hautes-Pyrénées en 1991 et du Comité régional en 1995, ainsi que vice-président de son club de Lourdes et sélectionneur de l'équipe de France du temps où Pierre Berbizier était entraîneur du XV de France. Il exercera la fonction d'adjoint au maire de Lourdes jusqu'en 2014.
Jean-Pierre GARUET, dit « le Professeur ou Garuche », né le 15 juin 1953 à Pontacq a occupé le poste de pilier droit au Football-Club Lourdais de 1969 à 1991, où il commença à endosser le maillot « rouge et bleu » en équipe cadets puis en juniors et en équipe de France, où il totalisera 42 sélections entre 1983 et 1990. Il a été l’un des meilleurs et plus féroces piliers de l’histoire du rugby mondial, mesurant 1m77 pour 105kg de muscles. Il fut élu deux fois meilleur pilier du monde dans les années 1980. Il participa au total à 7 éditions du Tournoi des Cinq Nations. Il débuta en sélection nationale le 13 novembre 1983 contre l'Australie. Il sera le tout premier joueur du XV de France expulsé en match officiel : alors que la France affronte l'Irlande au Parc des Princes, lors du Tournoi des Cinq Nations 1984, il est expulsé par l'arbitre gallois Clive Norling (Pays de Galle) pour une fourchette sur le troisième ligne irlandais John O'Driscoll. Au banquet officiel, Albert Ferrasse, président de la FFR, le traite d'imbécile. On frise l'incident diplomatique. Jean-Pierre Rives, capitaine de l’équipe prendra la parole pour défendre son coéquipier. À la suite de cette expulsion, il sera suspendu pour trois mois, mais pourra partir avec ses petits camarades pour la tournée de l’été en Nouvelle-Zélande. Après le Grand Chelem de 1987, il sera sacré par les Anglais, du titre honorifique de « meilleur pilier du monde ». En 1984, il sera demi-finaliste du Championnat de France de rugby à XV de première division avec le FC Lourdes. Le 15 novembre 1986 à Nantes, il participa à la victoire française face aux Blacks (16-3). Rencontre entre le XV de France et la Nouvelle-Zélande connue sous le nom de « La bataille de Nantes ». En 1987, il sera vainqueur avec les Bleus du Tournoi des Cinq Nations contre l’Irlande (19-13), en réussissant un Grand Chelem (quatre victoires en quatre matchs). Il fut de la première aventure mondiale en 1987 et constituait avec ses deux compères, Daniel Dubroca et le basque Pascal Ondarts, une première ligne coriace qui faisait reculer régulièrement les attelages des équipes adverses. Dans cette finale de coupe du Monde de 1987, les Bleus s’inclinèrent contre la Nouvelle-Zélande (29-9). La sélection nationale sera vice-championne du monde. Il aura gagné le Tournoi des Cinq Nations en 1986 à égalité avec l’Écosse, en 1987 (Grand Chelem), en 1988 à égalité avec le Pays de Galles et en 1989, la France remportant le Tournoi quatre années consécutives. Le 10 mai 1986, il fut invité avec les Barbarians français pour jouer contre l'Écosse à Agen. Les Baa-Baas l'emportèrent 32 à 19. Le 22 mai 1988, il jouera de nouveau avec les Barbarians français contre l'Irlande à La Rochelle. Les Baa-Baas l'emportèrent 41 à 26. Il arrêtera d'être joueur et raccrochera les crampons en 1991, après une dernière saison à l’âge de 38 ans. Il sera alors président du Comité départemental de rugby des Hautes-Pyrénées en 1991 et du Comité régional en 1995, ainsi que vice-président de son club de Lourdes et sélectionneur de l'équipe de France du temps où Pierre Berbizier était entraîneur du XV de France. Il exercera la fonction d'adjoint au maire de Lourdes jusqu'en 2014.GAURIER Ludovic (1875-1931)
Prêtre, spéléologue et pyrénéiste, spécialiste de la glaciologie et de la limnologie des Pyrénées
 Ludovic GAURIER, né le 2 août 1875 à Bayon-sur-Gironde, dans une famille à la longue tradition maritime et mort à Pau le 16 septembre 1931, à l’âge de 56 ans. Tous sont marins, sauf lui. Il deviendra montagnard. Parmi les plus grands noms du Pyrénéisme, celui de Ludovic Gaurier est l’un des moins connus. Il est pourtant parmi les tout premiers. Il est le fils d'un capitaine au long cours, descendant d'une lignée de marins de l'île d'Oléron. À 16 ans, des soins pour des maux de gorge l'amènent à Argelès-Gazost, dans les Pyrénées. En 1896, à l’âge de 21 ans, il entre dans les ordres, est ordonné prêtre le 4 juin 1898 et devient professeur de sciences naturelles au collège de Pons. En 1900, pour soigner un début de laryngite, il vient à Cauterets prendre les eaux. Ce séjour thermal va être une révélation pour le jeune abbé professeur. Conquis par les Pyrénées, il fait des excursions et commence à s'intéresser aux glaciers du Vignemale. Il reviendra désormais chaque année. Pendant ses cours, il fait étudier à ses élèves les récits d'Henry Russell. Le 19 août 1902, avec le guide Paul Batou, il réussit l'ascension du Vignemale et débute une série d’observations sur le glacier et les lacs alentour. Il entre en correspondance avec Russell, qu'il rencontre en 1904 aux grottes Bellevue. C'est le début d'une solide amitié entre le vieux montagnard et le néophyte. Gaurier a 29 ans et Russell 70. En 1905, Ludovic Gaurier, frappé de surdité, doit abandonner l'enseignement et s’installe à Pau. Mais, ce n’est pas en tant que grimpeur que Ludovic Gaurier se fera connaître. À l’époque, le gouvernement français a besoin de connaître exactement les ressources en eaux des montagnes pour entreprendre leur exploitation. Il se consacre alors à l'étude des glaciers et névés, observant leurs mouvements et transformations : l'année précédente, le ministère de l'agriculture lui a commandé une étude sur les glaciers pyrénéens, qu'il poursuit jusqu'en 1909, reprenant les premiers travaux d'Émile Belloc et d'Eugène Trutat commencés en 1873. Il marquera plusieurs glaciers et certaines de ces marques sont toujours utilisées de nos jours. En 1905, il publie "Observations glaciaires faites au Vignemale". En 1907 donc, à la demande de l'État, il commença à se livrer à l'étude des lacs pyrénéens. De 1907 à 1909, il s'occupa de ceux de la vallée d'Ossau. Ces premiers travaux limnologiques frappèrent l'attention du ministère de l'Agriculture qui, prenant les frais à sa charge, lui confia le soin d'étudier tous les lacs du versant français. En 1919, le ministère des Travaux Publics ajouta aussi son concours pour établir une documentation précise sur toutes les forces que pouvaient fournir les lacs étagés des Pyrénées pour assurer le fonctionnement d'usines de toutes sortes, et notamment d'usines hydroélectriques. Pour aboutir aux résultats demandés par les deux ministères qui avaient pris l'œuvre à leur charge, le travail était considérable, il fallait dresser une carte complète des lacs qui existent dans la zone des Pyrénées françaises, et en étudier la profondeur et les caractères. Ludovic Gaurier répertorie 520 lacs sur le seul versant français (il dit lui-même que cet inventaire est incomplet, car on en découvre sur le terrain bien plus que sur la carte de l'État-major), en mesure et cartographie 253 avec des instruments de visée et de mesure qu'il emporte avec lui. Des mesures bathymétriques, qu’il effectue à partir d’un canot de toile (esquif) démontable devenu célèbre. Ce travail lui prend cinquante mois, pendant lesquels il vit dans des campements précaires et itinérants, qui n’ont absolument rien à voir avec notre camping moderne : les conditions de vie sous les tentes, en altitude, par tous les temps, sont homériques. Il est surnommé « l'Ours », et il en fit l’emblème de son fanion. En 1910, il publie une "Étude hydrologique des gaves de Pau et d'Oloron". Par ailleurs il avait étudié le complexe massif de Piedrafita et après plus de 6 ans de travail, il en acheva la carte en 1910. À la déclaration de guerre, en 1914, il est mobilisé et affecté à la 18e section d'infirmiers militaires, puis au comité de propagande touristique fondé par le Touring Club de France. En 1917, il est envoyé en Amérique du Sud et aux Antilles, pour faire connaître la France et les Pyrénées. Il revient en France en 1919. En 1921, il publie "Études glaciaires dans les Pyrénées françaises et espagnoles de 1900 à 1909". En 1929, il publie son premier Atlas contenant les cartes bathymétriques de 210 lacs pyrénéens français. Toutes ces cartes sont levées à grande échelle, au 1/1000e ou 1/2000e, ce qui a permis d'y inscrire les cotes des sondages qui ont été exécutés avec précision. Chaque carte est accompagnée d'une notice sur le régime d'écoulement du bassin, sur sa faune et sa flore, sur les voies d'accès au lac et sur les possibilités de captage. Dans chaque bassin, la nature du sol est étudiée, spécialement autour des déversoirs et des barrages naturels. Cet atlas n'a été tiré qu'à un petit nombre d'exemplaires et parmi les endroits qui en possèdent, il y a l'Académie des sciences et la Société de Géographie. Ludovic Gaurier fait partie de cette élite des pyrénéistes du XXe siècle naissant. C'est un photographe expérimenté (il réalise, parmi les premiers, des photographies panoramiques et stéréoscopiques). Il est poète, peintre, aquarelliste. Il s'est passionné pour l'étude, mais le sport ne lui a pas fait défaut, ne serait-ce que pour lui permettre de poursuivre ses recherches dans toutes les conditions. Il fut également l’un des tout premiers pionniers du ski. Il va utiliser ce moyen de locomotion sur une paire de planches en bois, d’abord pour ses études et ses observations hivernales, ensuite pour la compétition. En 1905, Louis Falisse, initiateur du ski dans les Pyrénées, lui donne ses premières leçons dans le cirque du Ger. Très vite, il va sur le glacier d'Ossoue et réalise une ascension hivernale du Vignemale. Les 14 et 15 mai 1906, dans une tentative d'ascension du Mont Perdu à skis, lui et ses compagnons doivent passer une très mauvaise nuit à la brèche de Roland. L'idée d'avoir là un abri, sinon un refuge (le refuge des Sarradets viendra cinquante ans plus tard), l'incite à rechercher, et à trouver, à peu de distance de la Fausse Brèche, une grotte qui, aménagée, deviendra la « Villa Gaurier » et rendra bien des services. Dès lors, cet abri servira de refuge pour les courses dans le massif. La section du CAF du Sud- Ouest finance des travaux d’aménagement (agrandissement et construction d’un mur) en septembre 1911. Le 06 juin 1906, avec Falisse, ils réussissent enfin la première ascension du Mont Perdu à skis. Gaurier participe au concours international de ski à Briançon, en 1906, et fait à Grenoble une conférence sur « le ski dans les Pyrénées », qu'il renouvelle en 1907 à Bordeaux, Cauterets, Saintes et Toulouse. Il agrémente ses conférences de projections photographiques. En 1922, L’Académie des sciences lui remet le prix Gay. En 1929, il reçoit la grande médaille d’honneur de la société de topographie de France. En 1931, peu avant sa mort, il a été fait chevalier de la Légion d'honneur pour services rendus à la France. Après une dernière campagne d’exploration de lacs, il s'éteint à Pau le 16 septembre 1931. À titre posthume en 1934, sera publié "Les lacs des Pyrénées françaises", réédité en 1988, grâce au travail de mise en ordre de ses divers écrits et notes par quelques-uns de ses amis, particulièrement MM. Willemin, Martel et le docteur Armand Sarramon. Très proche de Russell, dont il fut le confesseur, il repose au panthéon des pyrénéistes célèbres du cimetière de Gavarnie aux côtés de Georges Ledormeur, de Célestin Passet, non loin de Franz Schrader. Vingt-cinq années à parcourir et à gravir la chaîne pyrénéenne, de l'Atlantique à la Méditerranée, à pied, à cheval, à ski, en longues campagnes d'été, en courses hivernales, avaient scellé entre Ludovic Gaurier et la montagne une relation passionnée d'une incomparable richesse. En témoignent, ses ouvrages d’importance, ses articles, ses conférences, ses poèmes et ses aquarelles (il fut poète et peintre à ses heures), sa correspondance avec le comte Henry Russell ou bien encore sa précieuse collection de photographies, dont il maîtrisait très bien la technique. Ses clichés, bien souvent, par le cadrage et la mise en scène, ont une valeur artistique. L’abbé Ludovic Gaurier qui arpenta au total plus de 500 lacs, depuis ceux du bassin du Gave de Pau jusqu’à ceux de l’Aude et de la Têt dans les Pyrénées-Orientales, et dont son atlas fait toujours référence avec 520 lacs répertoriés et 253 cartographiés, fut par ailleurs membre de la société Ramond. Et son nom reste aujourd’hui encore associé à cette grotte, qu'il découvrit et qu'il aménagea près de la Fausse Brèche à Gavarnie et à qui il donna le nom de « Villa Gaurier ». Un siècle à peine nous sépare de ces figures exceptionnelles du monde pyrénéen tels que Gaurier, Ledormeur, Russel, Ramond et tant d’autres qui, en vouant leur vie à ces montagnes, ont fait apparaître et imposé, à la place du terme générique "alpiniste", le néologisme "pyrénéiste", et nous ont laissé un précieux témoignage, tant écrit qu'iconographique, sur cette époque où tout encore était aventure. Homme de science, Ludovic Gaurier fut donc aussi conférencier afin de promouvoir, en France et en Espagne, le campement en haute montagne et le ski qui en était à ses premiers balbutiements. Pour avoir consacré sa vie aux Pyrénées, il fait partie, avec Russel, Schrader, Meillon, Ledormeur, Ramond... de ceux qui auront donné au "Pyrénéisme" ses lettres de noblesse. Une rue de la ville de Pau porte son nom.
Ludovic GAURIER, né le 2 août 1875 à Bayon-sur-Gironde, dans une famille à la longue tradition maritime et mort à Pau le 16 septembre 1931, à l’âge de 56 ans. Tous sont marins, sauf lui. Il deviendra montagnard. Parmi les plus grands noms du Pyrénéisme, celui de Ludovic Gaurier est l’un des moins connus. Il est pourtant parmi les tout premiers. Il est le fils d'un capitaine au long cours, descendant d'une lignée de marins de l'île d'Oléron. À 16 ans, des soins pour des maux de gorge l'amènent à Argelès-Gazost, dans les Pyrénées. En 1896, à l’âge de 21 ans, il entre dans les ordres, est ordonné prêtre le 4 juin 1898 et devient professeur de sciences naturelles au collège de Pons. En 1900, pour soigner un début de laryngite, il vient à Cauterets prendre les eaux. Ce séjour thermal va être une révélation pour le jeune abbé professeur. Conquis par les Pyrénées, il fait des excursions et commence à s'intéresser aux glaciers du Vignemale. Il reviendra désormais chaque année. Pendant ses cours, il fait étudier à ses élèves les récits d'Henry Russell. Le 19 août 1902, avec le guide Paul Batou, il réussit l'ascension du Vignemale et débute une série d’observations sur le glacier et les lacs alentour. Il entre en correspondance avec Russell, qu'il rencontre en 1904 aux grottes Bellevue. C'est le début d'une solide amitié entre le vieux montagnard et le néophyte. Gaurier a 29 ans et Russell 70. En 1905, Ludovic Gaurier, frappé de surdité, doit abandonner l'enseignement et s’installe à Pau. Mais, ce n’est pas en tant que grimpeur que Ludovic Gaurier se fera connaître. À l’époque, le gouvernement français a besoin de connaître exactement les ressources en eaux des montagnes pour entreprendre leur exploitation. Il se consacre alors à l'étude des glaciers et névés, observant leurs mouvements et transformations : l'année précédente, le ministère de l'agriculture lui a commandé une étude sur les glaciers pyrénéens, qu'il poursuit jusqu'en 1909, reprenant les premiers travaux d'Émile Belloc et d'Eugène Trutat commencés en 1873. Il marquera plusieurs glaciers et certaines de ces marques sont toujours utilisées de nos jours. En 1905, il publie "Observations glaciaires faites au Vignemale". En 1907 donc, à la demande de l'État, il commença à se livrer à l'étude des lacs pyrénéens. De 1907 à 1909, il s'occupa de ceux de la vallée d'Ossau. Ces premiers travaux limnologiques frappèrent l'attention du ministère de l'Agriculture qui, prenant les frais à sa charge, lui confia le soin d'étudier tous les lacs du versant français. En 1919, le ministère des Travaux Publics ajouta aussi son concours pour établir une documentation précise sur toutes les forces que pouvaient fournir les lacs étagés des Pyrénées pour assurer le fonctionnement d'usines de toutes sortes, et notamment d'usines hydroélectriques. Pour aboutir aux résultats demandés par les deux ministères qui avaient pris l'œuvre à leur charge, le travail était considérable, il fallait dresser une carte complète des lacs qui existent dans la zone des Pyrénées françaises, et en étudier la profondeur et les caractères. Ludovic Gaurier répertorie 520 lacs sur le seul versant français (il dit lui-même que cet inventaire est incomplet, car on en découvre sur le terrain bien plus que sur la carte de l'État-major), en mesure et cartographie 253 avec des instruments de visée et de mesure qu'il emporte avec lui. Des mesures bathymétriques, qu’il effectue à partir d’un canot de toile (esquif) démontable devenu célèbre. Ce travail lui prend cinquante mois, pendant lesquels il vit dans des campements précaires et itinérants, qui n’ont absolument rien à voir avec notre camping moderne : les conditions de vie sous les tentes, en altitude, par tous les temps, sont homériques. Il est surnommé « l'Ours », et il en fit l’emblème de son fanion. En 1910, il publie une "Étude hydrologique des gaves de Pau et d'Oloron". Par ailleurs il avait étudié le complexe massif de Piedrafita et après plus de 6 ans de travail, il en acheva la carte en 1910. À la déclaration de guerre, en 1914, il est mobilisé et affecté à la 18e section d'infirmiers militaires, puis au comité de propagande touristique fondé par le Touring Club de France. En 1917, il est envoyé en Amérique du Sud et aux Antilles, pour faire connaître la France et les Pyrénées. Il revient en France en 1919. En 1921, il publie "Études glaciaires dans les Pyrénées françaises et espagnoles de 1900 à 1909". En 1929, il publie son premier Atlas contenant les cartes bathymétriques de 210 lacs pyrénéens français. Toutes ces cartes sont levées à grande échelle, au 1/1000e ou 1/2000e, ce qui a permis d'y inscrire les cotes des sondages qui ont été exécutés avec précision. Chaque carte est accompagnée d'une notice sur le régime d'écoulement du bassin, sur sa faune et sa flore, sur les voies d'accès au lac et sur les possibilités de captage. Dans chaque bassin, la nature du sol est étudiée, spécialement autour des déversoirs et des barrages naturels. Cet atlas n'a été tiré qu'à un petit nombre d'exemplaires et parmi les endroits qui en possèdent, il y a l'Académie des sciences et la Société de Géographie. Ludovic Gaurier fait partie de cette élite des pyrénéistes du XXe siècle naissant. C'est un photographe expérimenté (il réalise, parmi les premiers, des photographies panoramiques et stéréoscopiques). Il est poète, peintre, aquarelliste. Il s'est passionné pour l'étude, mais le sport ne lui a pas fait défaut, ne serait-ce que pour lui permettre de poursuivre ses recherches dans toutes les conditions. Il fut également l’un des tout premiers pionniers du ski. Il va utiliser ce moyen de locomotion sur une paire de planches en bois, d’abord pour ses études et ses observations hivernales, ensuite pour la compétition. En 1905, Louis Falisse, initiateur du ski dans les Pyrénées, lui donne ses premières leçons dans le cirque du Ger. Très vite, il va sur le glacier d'Ossoue et réalise une ascension hivernale du Vignemale. Les 14 et 15 mai 1906, dans une tentative d'ascension du Mont Perdu à skis, lui et ses compagnons doivent passer une très mauvaise nuit à la brèche de Roland. L'idée d'avoir là un abri, sinon un refuge (le refuge des Sarradets viendra cinquante ans plus tard), l'incite à rechercher, et à trouver, à peu de distance de la Fausse Brèche, une grotte qui, aménagée, deviendra la « Villa Gaurier » et rendra bien des services. Dès lors, cet abri servira de refuge pour les courses dans le massif. La section du CAF du Sud- Ouest finance des travaux d’aménagement (agrandissement et construction d’un mur) en septembre 1911. Le 06 juin 1906, avec Falisse, ils réussissent enfin la première ascension du Mont Perdu à skis. Gaurier participe au concours international de ski à Briançon, en 1906, et fait à Grenoble une conférence sur « le ski dans les Pyrénées », qu'il renouvelle en 1907 à Bordeaux, Cauterets, Saintes et Toulouse. Il agrémente ses conférences de projections photographiques. En 1922, L’Académie des sciences lui remet le prix Gay. En 1929, il reçoit la grande médaille d’honneur de la société de topographie de France. En 1931, peu avant sa mort, il a été fait chevalier de la Légion d'honneur pour services rendus à la France. Après une dernière campagne d’exploration de lacs, il s'éteint à Pau le 16 septembre 1931. À titre posthume en 1934, sera publié "Les lacs des Pyrénées françaises", réédité en 1988, grâce au travail de mise en ordre de ses divers écrits et notes par quelques-uns de ses amis, particulièrement MM. Willemin, Martel et le docteur Armand Sarramon. Très proche de Russell, dont il fut le confesseur, il repose au panthéon des pyrénéistes célèbres du cimetière de Gavarnie aux côtés de Georges Ledormeur, de Célestin Passet, non loin de Franz Schrader. Vingt-cinq années à parcourir et à gravir la chaîne pyrénéenne, de l'Atlantique à la Méditerranée, à pied, à cheval, à ski, en longues campagnes d'été, en courses hivernales, avaient scellé entre Ludovic Gaurier et la montagne une relation passionnée d'une incomparable richesse. En témoignent, ses ouvrages d’importance, ses articles, ses conférences, ses poèmes et ses aquarelles (il fut poète et peintre à ses heures), sa correspondance avec le comte Henry Russell ou bien encore sa précieuse collection de photographies, dont il maîtrisait très bien la technique. Ses clichés, bien souvent, par le cadrage et la mise en scène, ont une valeur artistique. L’abbé Ludovic Gaurier qui arpenta au total plus de 500 lacs, depuis ceux du bassin du Gave de Pau jusqu’à ceux de l’Aude et de la Têt dans les Pyrénées-Orientales, et dont son atlas fait toujours référence avec 520 lacs répertoriés et 253 cartographiés, fut par ailleurs membre de la société Ramond. Et son nom reste aujourd’hui encore associé à cette grotte, qu'il découvrit et qu'il aménagea près de la Fausse Brèche à Gavarnie et à qui il donna le nom de « Villa Gaurier ». Un siècle à peine nous sépare de ces figures exceptionnelles du monde pyrénéen tels que Gaurier, Ledormeur, Russel, Ramond et tant d’autres qui, en vouant leur vie à ces montagnes, ont fait apparaître et imposé, à la place du terme générique "alpiniste", le néologisme "pyrénéiste", et nous ont laissé un précieux témoignage, tant écrit qu'iconographique, sur cette époque où tout encore était aventure. Homme de science, Ludovic Gaurier fut donc aussi conférencier afin de promouvoir, en France et en Espagne, le campement en haute montagne et le ski qui en était à ses premiers balbutiements. Pour avoir consacré sa vie aux Pyrénées, il fait partie, avec Russel, Schrader, Meillon, Ledormeur, Ramond... de ceux qui auront donné au "Pyrénéisme" ses lettres de noblesse. Une rue de la ville de Pau porte son nom.
 Ludovic GAURIER, né le 2 août 1875 à Bayon-sur-Gironde, dans une famille à la longue tradition maritime et mort à Pau le 16 septembre 1931, à l’âge de 56 ans. Tous sont marins, sauf lui. Il deviendra montagnard. Parmi les plus grands noms du Pyrénéisme, celui de Ludovic Gaurier est l’un des moins connus. Il est pourtant parmi les tout premiers. Il est le fils d'un capitaine au long cours, descendant d'une lignée de marins de l'île d'Oléron. À 16 ans, des soins pour des maux de gorge l'amènent à Argelès-Gazost, dans les Pyrénées. En 1896, à l’âge de 21 ans, il entre dans les ordres, est ordonné prêtre le 4 juin 1898 et devient professeur de sciences naturelles au collège de Pons. En 1900, pour soigner un début de laryngite, il vient à Cauterets prendre les eaux. Ce séjour thermal va être une révélation pour le jeune abbé professeur. Conquis par les Pyrénées, il fait des excursions et commence à s'intéresser aux glaciers du Vignemale. Il reviendra désormais chaque année. Pendant ses cours, il fait étudier à ses élèves les récits d'Henry Russell. Le 19 août 1902, avec le guide Paul Batou, il réussit l'ascension du Vignemale et débute une série d’observations sur le glacier et les lacs alentour. Il entre en correspondance avec Russell, qu'il rencontre en 1904 aux grottes Bellevue. C'est le début d'une solide amitié entre le vieux montagnard et le néophyte. Gaurier a 29 ans et Russell 70. En 1905, Ludovic Gaurier, frappé de surdité, doit abandonner l'enseignement et s’installe à Pau. Mais, ce n’est pas en tant que grimpeur que Ludovic Gaurier se fera connaître. À l’époque, le gouvernement français a besoin de connaître exactement les ressources en eaux des montagnes pour entreprendre leur exploitation. Il se consacre alors à l'étude des glaciers et névés, observant leurs mouvements et transformations : l'année précédente, le ministère de l'agriculture lui a commandé une étude sur les glaciers pyrénéens, qu'il poursuit jusqu'en 1909, reprenant les premiers travaux d'Émile Belloc et d'Eugène Trutat commencés en 1873. Il marquera plusieurs glaciers et certaines de ces marques sont toujours utilisées de nos jours. En 1905, il publie "Observations glaciaires faites au Vignemale". En 1907 donc, à la demande de l'État, il commença à se livrer à l'étude des lacs pyrénéens. De 1907 à 1909, il s'occupa de ceux de la vallée d'Ossau. Ces premiers travaux limnologiques frappèrent l'attention du ministère de l'Agriculture qui, prenant les frais à sa charge, lui confia le soin d'étudier tous les lacs du versant français. En 1919, le ministère des Travaux Publics ajouta aussi son concours pour établir une documentation précise sur toutes les forces que pouvaient fournir les lacs étagés des Pyrénées pour assurer le fonctionnement d'usines de toutes sortes, et notamment d'usines hydroélectriques. Pour aboutir aux résultats demandés par les deux ministères qui avaient pris l'œuvre à leur charge, le travail était considérable, il fallait dresser une carte complète des lacs qui existent dans la zone des Pyrénées françaises, et en étudier la profondeur et les caractères. Ludovic Gaurier répertorie 520 lacs sur le seul versant français (il dit lui-même que cet inventaire est incomplet, car on en découvre sur le terrain bien plus que sur la carte de l'État-major), en mesure et cartographie 253 avec des instruments de visée et de mesure qu'il emporte avec lui. Des mesures bathymétriques, qu’il effectue à partir d’un canot de toile (esquif) démontable devenu célèbre. Ce travail lui prend cinquante mois, pendant lesquels il vit dans des campements précaires et itinérants, qui n’ont absolument rien à voir avec notre camping moderne : les conditions de vie sous les tentes, en altitude, par tous les temps, sont homériques. Il est surnommé « l'Ours », et il en fit l’emblème de son fanion. En 1910, il publie une "Étude hydrologique des gaves de Pau et d'Oloron". Par ailleurs il avait étudié le complexe massif de Piedrafita et après plus de 6 ans de travail, il en acheva la carte en 1910. À la déclaration de guerre, en 1914, il est mobilisé et affecté à la 18e section d'infirmiers militaires, puis au comité de propagande touristique fondé par le Touring Club de France. En 1917, il est envoyé en Amérique du Sud et aux Antilles, pour faire connaître la France et les Pyrénées. Il revient en France en 1919. En 1921, il publie "Études glaciaires dans les Pyrénées françaises et espagnoles de 1900 à 1909". En 1929, il publie son premier Atlas contenant les cartes bathymétriques de 210 lacs pyrénéens français. Toutes ces cartes sont levées à grande échelle, au 1/1000e ou 1/2000e, ce qui a permis d'y inscrire les cotes des sondages qui ont été exécutés avec précision. Chaque carte est accompagnée d'une notice sur le régime d'écoulement du bassin, sur sa faune et sa flore, sur les voies d'accès au lac et sur les possibilités de captage. Dans chaque bassin, la nature du sol est étudiée, spécialement autour des déversoirs et des barrages naturels. Cet atlas n'a été tiré qu'à un petit nombre d'exemplaires et parmi les endroits qui en possèdent, il y a l'Académie des sciences et la Société de Géographie. Ludovic Gaurier fait partie de cette élite des pyrénéistes du XXe siècle naissant. C'est un photographe expérimenté (il réalise, parmi les premiers, des photographies panoramiques et stéréoscopiques). Il est poète, peintre, aquarelliste. Il s'est passionné pour l'étude, mais le sport ne lui a pas fait défaut, ne serait-ce que pour lui permettre de poursuivre ses recherches dans toutes les conditions. Il fut également l’un des tout premiers pionniers du ski. Il va utiliser ce moyen de locomotion sur une paire de planches en bois, d’abord pour ses études et ses observations hivernales, ensuite pour la compétition. En 1905, Louis Falisse, initiateur du ski dans les Pyrénées, lui donne ses premières leçons dans le cirque du Ger. Très vite, il va sur le glacier d'Ossoue et réalise une ascension hivernale du Vignemale. Les 14 et 15 mai 1906, dans une tentative d'ascension du Mont Perdu à skis, lui et ses compagnons doivent passer une très mauvaise nuit à la brèche de Roland. L'idée d'avoir là un abri, sinon un refuge (le refuge des Sarradets viendra cinquante ans plus tard), l'incite à rechercher, et à trouver, à peu de distance de la Fausse Brèche, une grotte qui, aménagée, deviendra la « Villa Gaurier » et rendra bien des services. Dès lors, cet abri servira de refuge pour les courses dans le massif. La section du CAF du Sud- Ouest finance des travaux d’aménagement (agrandissement et construction d’un mur) en septembre 1911. Le 06 juin 1906, avec Falisse, ils réussissent enfin la première ascension du Mont Perdu à skis. Gaurier participe au concours international de ski à Briançon, en 1906, et fait à Grenoble une conférence sur « le ski dans les Pyrénées », qu'il renouvelle en 1907 à Bordeaux, Cauterets, Saintes et Toulouse. Il agrémente ses conférences de projections photographiques. En 1922, L’Académie des sciences lui remet le prix Gay. En 1929, il reçoit la grande médaille d’honneur de la société de topographie de France. En 1931, peu avant sa mort, il a été fait chevalier de la Légion d'honneur pour services rendus à la France. Après une dernière campagne d’exploration de lacs, il s'éteint à Pau le 16 septembre 1931. À titre posthume en 1934, sera publié "Les lacs des Pyrénées françaises", réédité en 1988, grâce au travail de mise en ordre de ses divers écrits et notes par quelques-uns de ses amis, particulièrement MM. Willemin, Martel et le docteur Armand Sarramon. Très proche de Russell, dont il fut le confesseur, il repose au panthéon des pyrénéistes célèbres du cimetière de Gavarnie aux côtés de Georges Ledormeur, de Célestin Passet, non loin de Franz Schrader. Vingt-cinq années à parcourir et à gravir la chaîne pyrénéenne, de l'Atlantique à la Méditerranée, à pied, à cheval, à ski, en longues campagnes d'été, en courses hivernales, avaient scellé entre Ludovic Gaurier et la montagne une relation passionnée d'une incomparable richesse. En témoignent, ses ouvrages d’importance, ses articles, ses conférences, ses poèmes et ses aquarelles (il fut poète et peintre à ses heures), sa correspondance avec le comte Henry Russell ou bien encore sa précieuse collection de photographies, dont il maîtrisait très bien la technique. Ses clichés, bien souvent, par le cadrage et la mise en scène, ont une valeur artistique. L’abbé Ludovic Gaurier qui arpenta au total plus de 500 lacs, depuis ceux du bassin du Gave de Pau jusqu’à ceux de l’Aude et de la Têt dans les Pyrénées-Orientales, et dont son atlas fait toujours référence avec 520 lacs répertoriés et 253 cartographiés, fut par ailleurs membre de la société Ramond. Et son nom reste aujourd’hui encore associé à cette grotte, qu'il découvrit et qu'il aménagea près de la Fausse Brèche à Gavarnie et à qui il donna le nom de « Villa Gaurier ». Un siècle à peine nous sépare de ces figures exceptionnelles du monde pyrénéen tels que Gaurier, Ledormeur, Russel, Ramond et tant d’autres qui, en vouant leur vie à ces montagnes, ont fait apparaître et imposé, à la place du terme générique "alpiniste", le néologisme "pyrénéiste", et nous ont laissé un précieux témoignage, tant écrit qu'iconographique, sur cette époque où tout encore était aventure. Homme de science, Ludovic Gaurier fut donc aussi conférencier afin de promouvoir, en France et en Espagne, le campement en haute montagne et le ski qui en était à ses premiers balbutiements. Pour avoir consacré sa vie aux Pyrénées, il fait partie, avec Russel, Schrader, Meillon, Ledormeur, Ramond... de ceux qui auront donné au "Pyrénéisme" ses lettres de noblesse. Une rue de la ville de Pau porte son nom.
Ludovic GAURIER, né le 2 août 1875 à Bayon-sur-Gironde, dans une famille à la longue tradition maritime et mort à Pau le 16 septembre 1931, à l’âge de 56 ans. Tous sont marins, sauf lui. Il deviendra montagnard. Parmi les plus grands noms du Pyrénéisme, celui de Ludovic Gaurier est l’un des moins connus. Il est pourtant parmi les tout premiers. Il est le fils d'un capitaine au long cours, descendant d'une lignée de marins de l'île d'Oléron. À 16 ans, des soins pour des maux de gorge l'amènent à Argelès-Gazost, dans les Pyrénées. En 1896, à l’âge de 21 ans, il entre dans les ordres, est ordonné prêtre le 4 juin 1898 et devient professeur de sciences naturelles au collège de Pons. En 1900, pour soigner un début de laryngite, il vient à Cauterets prendre les eaux. Ce séjour thermal va être une révélation pour le jeune abbé professeur. Conquis par les Pyrénées, il fait des excursions et commence à s'intéresser aux glaciers du Vignemale. Il reviendra désormais chaque année. Pendant ses cours, il fait étudier à ses élèves les récits d'Henry Russell. Le 19 août 1902, avec le guide Paul Batou, il réussit l'ascension du Vignemale et débute une série d’observations sur le glacier et les lacs alentour. Il entre en correspondance avec Russell, qu'il rencontre en 1904 aux grottes Bellevue. C'est le début d'une solide amitié entre le vieux montagnard et le néophyte. Gaurier a 29 ans et Russell 70. En 1905, Ludovic Gaurier, frappé de surdité, doit abandonner l'enseignement et s’installe à Pau. Mais, ce n’est pas en tant que grimpeur que Ludovic Gaurier se fera connaître. À l’époque, le gouvernement français a besoin de connaître exactement les ressources en eaux des montagnes pour entreprendre leur exploitation. Il se consacre alors à l'étude des glaciers et névés, observant leurs mouvements et transformations : l'année précédente, le ministère de l'agriculture lui a commandé une étude sur les glaciers pyrénéens, qu'il poursuit jusqu'en 1909, reprenant les premiers travaux d'Émile Belloc et d'Eugène Trutat commencés en 1873. Il marquera plusieurs glaciers et certaines de ces marques sont toujours utilisées de nos jours. En 1905, il publie "Observations glaciaires faites au Vignemale". En 1907 donc, à la demande de l'État, il commença à se livrer à l'étude des lacs pyrénéens. De 1907 à 1909, il s'occupa de ceux de la vallée d'Ossau. Ces premiers travaux limnologiques frappèrent l'attention du ministère de l'Agriculture qui, prenant les frais à sa charge, lui confia le soin d'étudier tous les lacs du versant français. En 1919, le ministère des Travaux Publics ajouta aussi son concours pour établir une documentation précise sur toutes les forces que pouvaient fournir les lacs étagés des Pyrénées pour assurer le fonctionnement d'usines de toutes sortes, et notamment d'usines hydroélectriques. Pour aboutir aux résultats demandés par les deux ministères qui avaient pris l'œuvre à leur charge, le travail était considérable, il fallait dresser une carte complète des lacs qui existent dans la zone des Pyrénées françaises, et en étudier la profondeur et les caractères. Ludovic Gaurier répertorie 520 lacs sur le seul versant français (il dit lui-même que cet inventaire est incomplet, car on en découvre sur le terrain bien plus que sur la carte de l'État-major), en mesure et cartographie 253 avec des instruments de visée et de mesure qu'il emporte avec lui. Des mesures bathymétriques, qu’il effectue à partir d’un canot de toile (esquif) démontable devenu célèbre. Ce travail lui prend cinquante mois, pendant lesquels il vit dans des campements précaires et itinérants, qui n’ont absolument rien à voir avec notre camping moderne : les conditions de vie sous les tentes, en altitude, par tous les temps, sont homériques. Il est surnommé « l'Ours », et il en fit l’emblème de son fanion. En 1910, il publie une "Étude hydrologique des gaves de Pau et d'Oloron". Par ailleurs il avait étudié le complexe massif de Piedrafita et après plus de 6 ans de travail, il en acheva la carte en 1910. À la déclaration de guerre, en 1914, il est mobilisé et affecté à la 18e section d'infirmiers militaires, puis au comité de propagande touristique fondé par le Touring Club de France. En 1917, il est envoyé en Amérique du Sud et aux Antilles, pour faire connaître la France et les Pyrénées. Il revient en France en 1919. En 1921, il publie "Études glaciaires dans les Pyrénées françaises et espagnoles de 1900 à 1909". En 1929, il publie son premier Atlas contenant les cartes bathymétriques de 210 lacs pyrénéens français. Toutes ces cartes sont levées à grande échelle, au 1/1000e ou 1/2000e, ce qui a permis d'y inscrire les cotes des sondages qui ont été exécutés avec précision. Chaque carte est accompagnée d'une notice sur le régime d'écoulement du bassin, sur sa faune et sa flore, sur les voies d'accès au lac et sur les possibilités de captage. Dans chaque bassin, la nature du sol est étudiée, spécialement autour des déversoirs et des barrages naturels. Cet atlas n'a été tiré qu'à un petit nombre d'exemplaires et parmi les endroits qui en possèdent, il y a l'Académie des sciences et la Société de Géographie. Ludovic Gaurier fait partie de cette élite des pyrénéistes du XXe siècle naissant. C'est un photographe expérimenté (il réalise, parmi les premiers, des photographies panoramiques et stéréoscopiques). Il est poète, peintre, aquarelliste. Il s'est passionné pour l'étude, mais le sport ne lui a pas fait défaut, ne serait-ce que pour lui permettre de poursuivre ses recherches dans toutes les conditions. Il fut également l’un des tout premiers pionniers du ski. Il va utiliser ce moyen de locomotion sur une paire de planches en bois, d’abord pour ses études et ses observations hivernales, ensuite pour la compétition. En 1905, Louis Falisse, initiateur du ski dans les Pyrénées, lui donne ses premières leçons dans le cirque du Ger. Très vite, il va sur le glacier d'Ossoue et réalise une ascension hivernale du Vignemale. Les 14 et 15 mai 1906, dans une tentative d'ascension du Mont Perdu à skis, lui et ses compagnons doivent passer une très mauvaise nuit à la brèche de Roland. L'idée d'avoir là un abri, sinon un refuge (le refuge des Sarradets viendra cinquante ans plus tard), l'incite à rechercher, et à trouver, à peu de distance de la Fausse Brèche, une grotte qui, aménagée, deviendra la « Villa Gaurier » et rendra bien des services. Dès lors, cet abri servira de refuge pour les courses dans le massif. La section du CAF du Sud- Ouest finance des travaux d’aménagement (agrandissement et construction d’un mur) en septembre 1911. Le 06 juin 1906, avec Falisse, ils réussissent enfin la première ascension du Mont Perdu à skis. Gaurier participe au concours international de ski à Briançon, en 1906, et fait à Grenoble une conférence sur « le ski dans les Pyrénées », qu'il renouvelle en 1907 à Bordeaux, Cauterets, Saintes et Toulouse. Il agrémente ses conférences de projections photographiques. En 1922, L’Académie des sciences lui remet le prix Gay. En 1929, il reçoit la grande médaille d’honneur de la société de topographie de France. En 1931, peu avant sa mort, il a été fait chevalier de la Légion d'honneur pour services rendus à la France. Après une dernière campagne d’exploration de lacs, il s'éteint à Pau le 16 septembre 1931. À titre posthume en 1934, sera publié "Les lacs des Pyrénées françaises", réédité en 1988, grâce au travail de mise en ordre de ses divers écrits et notes par quelques-uns de ses amis, particulièrement MM. Willemin, Martel et le docteur Armand Sarramon. Très proche de Russell, dont il fut le confesseur, il repose au panthéon des pyrénéistes célèbres du cimetière de Gavarnie aux côtés de Georges Ledormeur, de Célestin Passet, non loin de Franz Schrader. Vingt-cinq années à parcourir et à gravir la chaîne pyrénéenne, de l'Atlantique à la Méditerranée, à pied, à cheval, à ski, en longues campagnes d'été, en courses hivernales, avaient scellé entre Ludovic Gaurier et la montagne une relation passionnée d'une incomparable richesse. En témoignent, ses ouvrages d’importance, ses articles, ses conférences, ses poèmes et ses aquarelles (il fut poète et peintre à ses heures), sa correspondance avec le comte Henry Russell ou bien encore sa précieuse collection de photographies, dont il maîtrisait très bien la technique. Ses clichés, bien souvent, par le cadrage et la mise en scène, ont une valeur artistique. L’abbé Ludovic Gaurier qui arpenta au total plus de 500 lacs, depuis ceux du bassin du Gave de Pau jusqu’à ceux de l’Aude et de la Têt dans les Pyrénées-Orientales, et dont son atlas fait toujours référence avec 520 lacs répertoriés et 253 cartographiés, fut par ailleurs membre de la société Ramond. Et son nom reste aujourd’hui encore associé à cette grotte, qu'il découvrit et qu'il aménagea près de la Fausse Brèche à Gavarnie et à qui il donna le nom de « Villa Gaurier ». Un siècle à peine nous sépare de ces figures exceptionnelles du monde pyrénéen tels que Gaurier, Ledormeur, Russel, Ramond et tant d’autres qui, en vouant leur vie à ces montagnes, ont fait apparaître et imposé, à la place du terme générique "alpiniste", le néologisme "pyrénéiste", et nous ont laissé un précieux témoignage, tant écrit qu'iconographique, sur cette époque où tout encore était aventure. Homme de science, Ludovic Gaurier fut donc aussi conférencier afin de promouvoir, en France et en Espagne, le campement en haute montagne et le ski qui en était à ses premiers balbutiements. Pour avoir consacré sa vie aux Pyrénées, il fait partie, avec Russel, Schrader, Meillon, Ledormeur, Ramond... de ceux qui auront donné au "Pyrénéisme" ses lettres de noblesse. Une rue de la ville de Pau porte son nom.GAUTIER Théophile (1811-1872)
Poète, écrivain, peintre et critique d’art
 Théophile GAUTIER, né le 30 août 1811 à Tarbes et mort à Neuilly-sur-Seine le 23 octobre 1872, à l’âge de 61 ans. Issu d’une famille de petite bourgeoisie, il a trois ans en 1814 lorsque sa famille s’installe à Paris. Il fit ses études au lycée Louis-le-Grand et au collège Charlemagne, où il se liera d’amitié avec Gérard de Nerval, avec qui il partagera la passion pour les poètes latins et l’étude de la langue française. Il se destinait initialement à une carrière de peintre et fréquenta pendant deux ans l’atelier de Rioult. Mais le 27 juin 1829, il fit une rencontre décisive, celle de Victor Hugo, qui lui fera prendre conscience de sa vocation d’écrivain. Lié à la jeunesse romantique, il se passionnera pour les débats artistiques et, lors de la bataille d’Hernani en 1830, il se fera le défenseur de Victor Hugo contre les tenants du classicisme en arborant, le soir de la première représentation, un gilet rouge flamboyant. En pleine révolution de juillet 1830, il publiera son premier recueil, "Poésies", financé par son père. Ces premiers poèmes montrent que c’était un jeune poète fort brillant. C’est le 4 mai 1831 qu’il publiera la nouvelle : "Cafetière", son premier conte fantastique. En 1833, il écrira à la demande d’un éditeur un recueil de nouvelles, "Les Jeunes-France", dans lequel il décrira de façon cocasse le milieu des artistes romantiques. Il récidivera avec le roman "Mademoiselle de Maupin" en 1835, et prendra définitivement ses distances avec les romantiques. En 1835, Honoré de Balzac envoie Jules Sandeau lui proposer une collaboration au journal "La Chronique de Paris" où il publiera ses premières nouvelles de nature fantastique : "La Mort amoureuse" (1836) et "La Chaîne d’or" (1837). D’autres nouvelles et contes fantastiques suivront : "Le Pied de momie" (1840), "Arria Marcella" (1852) ou encore "Spirite" (1865). Il publiera ainsi plusieurs nouvelles ainsi que des critiques d’art. En 1836, il collaborera aussi avec la France littéraire et La Presse. Il écrira plus de 1200 articles et travaillera sans relâche, comme un forçat. Il travaillera dans la presse jusqu’en 1855 puis se consacrera au Moniteur universel jusqu’en 1868. A partir de 1850 il se détachera du mouvement romantique, avec sa théorie de « l’art pour l’art ». Il deviendra précurseur du mouvement poétique du Parnasse, il bannira les outrances romantiques et se reconnaîtra dans le seul respect de l’art et du culte de la beauté. Malgré ses difficultés matérielles, il sera poète presque officiel à la fin de sa carrière sous l’Empire. En 1868, il sera nommé bibliothécaire de la princesse Mathilde et fréquentera les salons littéraires du Second Empire et les milieux artistiques. Il entreprendra une histoire du romantisme qui restera inachevée car atteint d’une maladie de cœur, il décèdera le 23 octobre 1872. À sa mort, Victor Hugo et Mallarmé témoigneront de l’importance de cet écrivain par deux poèmes qui furent réunis sous le titre du "Tombeau de Théophile Gautier" (1873). Il se fit également connaître en tant que critique d’art, domaine où il excella. Il écrira des pièces de théâtre et même un opéra, "Giselle" (1841), qui sera un grand succès. Il publiera un recueil de poèmes, "Émaux et camées" en 1852, qui lui apportera la reconnaissance de ses pairs. Ami de Baudelaire, il rencontra les écrivains de l’époque, Flaubert, Dumas fils et Feydeau. Baudelaire qui lui dédia son recueil "Les Fleurs du mal" en 1857. Grand voyageur, il visita l’Espagne, l’Angleterre, l’Algérie, l’Italie, la Grèce, la Turquie, la Russie et l’Égypte, s’inspirant de ses nombreux voyages pour écrire des nouvelles, des poèmes et des récits de voyages. Il fut l’auteur de deux grands romans, "Le Roman de la momie" (1858) et "Le Capitaine Fracasse" (1863), son œuvre la plus connue. En résumé, il fut un auteur passionné par les arts. Il aura écrit des romans, des nouvelles, des essais, des poèmes, des pièces de théâtre, des ballets, des récits de voyages ainsi que des critiques musicales, dramatiques, littéraires et artistiques. Mais il fut également artiste peintre et dessinateur. En 1857, il s’était installé avec sa compagne et ses filles dans une petite maison à Neuilly-sur-Seine, où il recevait ses amis. Avec la chute de l’Empire en 1870, il perd la pension qui le faisait vivre. Sa femme l’a quitté, ses filles se sont mariées. Il s’éteint le 23 octobre 1872 à Neuilly-sur-Seine et sera inhumé au cimetière de Montmartre à Paris. Edmond de Goncourt relate son "enterrement pompeux" au cours duquel Dumas fils lira l’éloge funèbre. Il avait reçu en 1840 la Croix de chevalier de la Légion d’honneur puis avait été promu officier en 1858. À Tarbes, un lycée qui a plus de cinq siècles d’existence porte son nom depuis 1912. À son grand regret, il ne retourna à son lieu de naissance qu’une seule fois pour y passer vingt-quatre heures. En 1859, de retour d’un voyage en Russie, il passe à Tarbes, où il est né rue du Bourg-Vieux (23 rue Brauhauban), avant de se rendre à Bagnères-de-Bigorre faire des excursions. Il se rend incognito au lycée de Tarbes, où évidemment il n’avait jamais été élève, pour voir son pupitre d’écolier sur lequel il aurait fait ses études. Il y fut reçu par le proviseur Nicolas Patry qui lui montra le fameux pupitre, lequel était quelconque, mais à son aspect il éprouva une émotion irrésistible, même s’il n’était pas son pupitre. Un buste de Théophile Gautier, modelé en 1890 par sa propre fille Judith, est exposé dans le jardin Massey de la ville de Tarbes depuis le 25 juillet 1897.
Théophile GAUTIER, né le 30 août 1811 à Tarbes et mort à Neuilly-sur-Seine le 23 octobre 1872, à l’âge de 61 ans. Issu d’une famille de petite bourgeoisie, il a trois ans en 1814 lorsque sa famille s’installe à Paris. Il fit ses études au lycée Louis-le-Grand et au collège Charlemagne, où il se liera d’amitié avec Gérard de Nerval, avec qui il partagera la passion pour les poètes latins et l’étude de la langue française. Il se destinait initialement à une carrière de peintre et fréquenta pendant deux ans l’atelier de Rioult. Mais le 27 juin 1829, il fit une rencontre décisive, celle de Victor Hugo, qui lui fera prendre conscience de sa vocation d’écrivain. Lié à la jeunesse romantique, il se passionnera pour les débats artistiques et, lors de la bataille d’Hernani en 1830, il se fera le défenseur de Victor Hugo contre les tenants du classicisme en arborant, le soir de la première représentation, un gilet rouge flamboyant. En pleine révolution de juillet 1830, il publiera son premier recueil, "Poésies", financé par son père. Ces premiers poèmes montrent que c’était un jeune poète fort brillant. C’est le 4 mai 1831 qu’il publiera la nouvelle : "Cafetière", son premier conte fantastique. En 1833, il écrira à la demande d’un éditeur un recueil de nouvelles, "Les Jeunes-France", dans lequel il décrira de façon cocasse le milieu des artistes romantiques. Il récidivera avec le roman "Mademoiselle de Maupin" en 1835, et prendra définitivement ses distances avec les romantiques. En 1835, Honoré de Balzac envoie Jules Sandeau lui proposer une collaboration au journal "La Chronique de Paris" où il publiera ses premières nouvelles de nature fantastique : "La Mort amoureuse" (1836) et "La Chaîne d’or" (1837). D’autres nouvelles et contes fantastiques suivront : "Le Pied de momie" (1840), "Arria Marcella" (1852) ou encore "Spirite" (1865). Il publiera ainsi plusieurs nouvelles ainsi que des critiques d’art. En 1836, il collaborera aussi avec la France littéraire et La Presse. Il écrira plus de 1200 articles et travaillera sans relâche, comme un forçat. Il travaillera dans la presse jusqu’en 1855 puis se consacrera au Moniteur universel jusqu’en 1868. A partir de 1850 il se détachera du mouvement romantique, avec sa théorie de « l’art pour l’art ». Il deviendra précurseur du mouvement poétique du Parnasse, il bannira les outrances romantiques et se reconnaîtra dans le seul respect de l’art et du culte de la beauté. Malgré ses difficultés matérielles, il sera poète presque officiel à la fin de sa carrière sous l’Empire. En 1868, il sera nommé bibliothécaire de la princesse Mathilde et fréquentera les salons littéraires du Second Empire et les milieux artistiques. Il entreprendra une histoire du romantisme qui restera inachevée car atteint d’une maladie de cœur, il décèdera le 23 octobre 1872. À sa mort, Victor Hugo et Mallarmé témoigneront de l’importance de cet écrivain par deux poèmes qui furent réunis sous le titre du "Tombeau de Théophile Gautier" (1873). Il se fit également connaître en tant que critique d’art, domaine où il excella. Il écrira des pièces de théâtre et même un opéra, "Giselle" (1841), qui sera un grand succès. Il publiera un recueil de poèmes, "Émaux et camées" en 1852, qui lui apportera la reconnaissance de ses pairs. Ami de Baudelaire, il rencontra les écrivains de l’époque, Flaubert, Dumas fils et Feydeau. Baudelaire qui lui dédia son recueil "Les Fleurs du mal" en 1857. Grand voyageur, il visita l’Espagne, l’Angleterre, l’Algérie, l’Italie, la Grèce, la Turquie, la Russie et l’Égypte, s’inspirant de ses nombreux voyages pour écrire des nouvelles, des poèmes et des récits de voyages. Il fut l’auteur de deux grands romans, "Le Roman de la momie" (1858) et "Le Capitaine Fracasse" (1863), son œuvre la plus connue. En résumé, il fut un auteur passionné par les arts. Il aura écrit des romans, des nouvelles, des essais, des poèmes, des pièces de théâtre, des ballets, des récits de voyages ainsi que des critiques musicales, dramatiques, littéraires et artistiques. Mais il fut également artiste peintre et dessinateur. En 1857, il s’était installé avec sa compagne et ses filles dans une petite maison à Neuilly-sur-Seine, où il recevait ses amis. Avec la chute de l’Empire en 1870, il perd la pension qui le faisait vivre. Sa femme l’a quitté, ses filles se sont mariées. Il s’éteint le 23 octobre 1872 à Neuilly-sur-Seine et sera inhumé au cimetière de Montmartre à Paris. Edmond de Goncourt relate son "enterrement pompeux" au cours duquel Dumas fils lira l’éloge funèbre. Il avait reçu en 1840 la Croix de chevalier de la Légion d’honneur puis avait été promu officier en 1858. À Tarbes, un lycée qui a plus de cinq siècles d’existence porte son nom depuis 1912. À son grand regret, il ne retourna à son lieu de naissance qu’une seule fois pour y passer vingt-quatre heures. En 1859, de retour d’un voyage en Russie, il passe à Tarbes, où il est né rue du Bourg-Vieux (23 rue Brauhauban), avant de se rendre à Bagnères-de-Bigorre faire des excursions. Il se rend incognito au lycée de Tarbes, où évidemment il n’avait jamais été élève, pour voir son pupitre d’écolier sur lequel il aurait fait ses études. Il y fut reçu par le proviseur Nicolas Patry qui lui montra le fameux pupitre, lequel était quelconque, mais à son aspect il éprouva une émotion irrésistible, même s’il n’était pas son pupitre. Un buste de Théophile Gautier, modelé en 1890 par sa propre fille Judith, est exposé dans le jardin Massey de la ville de Tarbes depuis le 25 juillet 1897.
 Théophile GAUTIER, né le 30 août 1811 à Tarbes et mort à Neuilly-sur-Seine le 23 octobre 1872, à l’âge de 61 ans. Issu d’une famille de petite bourgeoisie, il a trois ans en 1814 lorsque sa famille s’installe à Paris. Il fit ses études au lycée Louis-le-Grand et au collège Charlemagne, où il se liera d’amitié avec Gérard de Nerval, avec qui il partagera la passion pour les poètes latins et l’étude de la langue française. Il se destinait initialement à une carrière de peintre et fréquenta pendant deux ans l’atelier de Rioult. Mais le 27 juin 1829, il fit une rencontre décisive, celle de Victor Hugo, qui lui fera prendre conscience de sa vocation d’écrivain. Lié à la jeunesse romantique, il se passionnera pour les débats artistiques et, lors de la bataille d’Hernani en 1830, il se fera le défenseur de Victor Hugo contre les tenants du classicisme en arborant, le soir de la première représentation, un gilet rouge flamboyant. En pleine révolution de juillet 1830, il publiera son premier recueil, "Poésies", financé par son père. Ces premiers poèmes montrent que c’était un jeune poète fort brillant. C’est le 4 mai 1831 qu’il publiera la nouvelle : "Cafetière", son premier conte fantastique. En 1833, il écrira à la demande d’un éditeur un recueil de nouvelles, "Les Jeunes-France", dans lequel il décrira de façon cocasse le milieu des artistes romantiques. Il récidivera avec le roman "Mademoiselle de Maupin" en 1835, et prendra définitivement ses distances avec les romantiques. En 1835, Honoré de Balzac envoie Jules Sandeau lui proposer une collaboration au journal "La Chronique de Paris" où il publiera ses premières nouvelles de nature fantastique : "La Mort amoureuse" (1836) et "La Chaîne d’or" (1837). D’autres nouvelles et contes fantastiques suivront : "Le Pied de momie" (1840), "Arria Marcella" (1852) ou encore "Spirite" (1865). Il publiera ainsi plusieurs nouvelles ainsi que des critiques d’art. En 1836, il collaborera aussi avec la France littéraire et La Presse. Il écrira plus de 1200 articles et travaillera sans relâche, comme un forçat. Il travaillera dans la presse jusqu’en 1855 puis se consacrera au Moniteur universel jusqu’en 1868. A partir de 1850 il se détachera du mouvement romantique, avec sa théorie de « l’art pour l’art ». Il deviendra précurseur du mouvement poétique du Parnasse, il bannira les outrances romantiques et se reconnaîtra dans le seul respect de l’art et du culte de la beauté. Malgré ses difficultés matérielles, il sera poète presque officiel à la fin de sa carrière sous l’Empire. En 1868, il sera nommé bibliothécaire de la princesse Mathilde et fréquentera les salons littéraires du Second Empire et les milieux artistiques. Il entreprendra une histoire du romantisme qui restera inachevée car atteint d’une maladie de cœur, il décèdera le 23 octobre 1872. À sa mort, Victor Hugo et Mallarmé témoigneront de l’importance de cet écrivain par deux poèmes qui furent réunis sous le titre du "Tombeau de Théophile Gautier" (1873). Il se fit également connaître en tant que critique d’art, domaine où il excella. Il écrira des pièces de théâtre et même un opéra, "Giselle" (1841), qui sera un grand succès. Il publiera un recueil de poèmes, "Émaux et camées" en 1852, qui lui apportera la reconnaissance de ses pairs. Ami de Baudelaire, il rencontra les écrivains de l’époque, Flaubert, Dumas fils et Feydeau. Baudelaire qui lui dédia son recueil "Les Fleurs du mal" en 1857. Grand voyageur, il visita l’Espagne, l’Angleterre, l’Algérie, l’Italie, la Grèce, la Turquie, la Russie et l’Égypte, s’inspirant de ses nombreux voyages pour écrire des nouvelles, des poèmes et des récits de voyages. Il fut l’auteur de deux grands romans, "Le Roman de la momie" (1858) et "Le Capitaine Fracasse" (1863), son œuvre la plus connue. En résumé, il fut un auteur passionné par les arts. Il aura écrit des romans, des nouvelles, des essais, des poèmes, des pièces de théâtre, des ballets, des récits de voyages ainsi que des critiques musicales, dramatiques, littéraires et artistiques. Mais il fut également artiste peintre et dessinateur. En 1857, il s’était installé avec sa compagne et ses filles dans une petite maison à Neuilly-sur-Seine, où il recevait ses amis. Avec la chute de l’Empire en 1870, il perd la pension qui le faisait vivre. Sa femme l’a quitté, ses filles se sont mariées. Il s’éteint le 23 octobre 1872 à Neuilly-sur-Seine et sera inhumé au cimetière de Montmartre à Paris. Edmond de Goncourt relate son "enterrement pompeux" au cours duquel Dumas fils lira l’éloge funèbre. Il avait reçu en 1840 la Croix de chevalier de la Légion d’honneur puis avait été promu officier en 1858. À Tarbes, un lycée qui a plus de cinq siècles d’existence porte son nom depuis 1912. À son grand regret, il ne retourna à son lieu de naissance qu’une seule fois pour y passer vingt-quatre heures. En 1859, de retour d’un voyage en Russie, il passe à Tarbes, où il est né rue du Bourg-Vieux (23 rue Brauhauban), avant de se rendre à Bagnères-de-Bigorre faire des excursions. Il se rend incognito au lycée de Tarbes, où évidemment il n’avait jamais été élève, pour voir son pupitre d’écolier sur lequel il aurait fait ses études. Il y fut reçu par le proviseur Nicolas Patry qui lui montra le fameux pupitre, lequel était quelconque, mais à son aspect il éprouva une émotion irrésistible, même s’il n’était pas son pupitre. Un buste de Théophile Gautier, modelé en 1890 par sa propre fille Judith, est exposé dans le jardin Massey de la ville de Tarbes depuis le 25 juillet 1897.
Théophile GAUTIER, né le 30 août 1811 à Tarbes et mort à Neuilly-sur-Seine le 23 octobre 1872, à l’âge de 61 ans. Issu d’une famille de petite bourgeoisie, il a trois ans en 1814 lorsque sa famille s’installe à Paris. Il fit ses études au lycée Louis-le-Grand et au collège Charlemagne, où il se liera d’amitié avec Gérard de Nerval, avec qui il partagera la passion pour les poètes latins et l’étude de la langue française. Il se destinait initialement à une carrière de peintre et fréquenta pendant deux ans l’atelier de Rioult. Mais le 27 juin 1829, il fit une rencontre décisive, celle de Victor Hugo, qui lui fera prendre conscience de sa vocation d’écrivain. Lié à la jeunesse romantique, il se passionnera pour les débats artistiques et, lors de la bataille d’Hernani en 1830, il se fera le défenseur de Victor Hugo contre les tenants du classicisme en arborant, le soir de la première représentation, un gilet rouge flamboyant. En pleine révolution de juillet 1830, il publiera son premier recueil, "Poésies", financé par son père. Ces premiers poèmes montrent que c’était un jeune poète fort brillant. C’est le 4 mai 1831 qu’il publiera la nouvelle : "Cafetière", son premier conte fantastique. En 1833, il écrira à la demande d’un éditeur un recueil de nouvelles, "Les Jeunes-France", dans lequel il décrira de façon cocasse le milieu des artistes romantiques. Il récidivera avec le roman "Mademoiselle de Maupin" en 1835, et prendra définitivement ses distances avec les romantiques. En 1835, Honoré de Balzac envoie Jules Sandeau lui proposer une collaboration au journal "La Chronique de Paris" où il publiera ses premières nouvelles de nature fantastique : "La Mort amoureuse" (1836) et "La Chaîne d’or" (1837). D’autres nouvelles et contes fantastiques suivront : "Le Pied de momie" (1840), "Arria Marcella" (1852) ou encore "Spirite" (1865). Il publiera ainsi plusieurs nouvelles ainsi que des critiques d’art. En 1836, il collaborera aussi avec la France littéraire et La Presse. Il écrira plus de 1200 articles et travaillera sans relâche, comme un forçat. Il travaillera dans la presse jusqu’en 1855 puis se consacrera au Moniteur universel jusqu’en 1868. A partir de 1850 il se détachera du mouvement romantique, avec sa théorie de « l’art pour l’art ». Il deviendra précurseur du mouvement poétique du Parnasse, il bannira les outrances romantiques et se reconnaîtra dans le seul respect de l’art et du culte de la beauté. Malgré ses difficultés matérielles, il sera poète presque officiel à la fin de sa carrière sous l’Empire. En 1868, il sera nommé bibliothécaire de la princesse Mathilde et fréquentera les salons littéraires du Second Empire et les milieux artistiques. Il entreprendra une histoire du romantisme qui restera inachevée car atteint d’une maladie de cœur, il décèdera le 23 octobre 1872. À sa mort, Victor Hugo et Mallarmé témoigneront de l’importance de cet écrivain par deux poèmes qui furent réunis sous le titre du "Tombeau de Théophile Gautier" (1873). Il se fit également connaître en tant que critique d’art, domaine où il excella. Il écrira des pièces de théâtre et même un opéra, "Giselle" (1841), qui sera un grand succès. Il publiera un recueil de poèmes, "Émaux et camées" en 1852, qui lui apportera la reconnaissance de ses pairs. Ami de Baudelaire, il rencontra les écrivains de l’époque, Flaubert, Dumas fils et Feydeau. Baudelaire qui lui dédia son recueil "Les Fleurs du mal" en 1857. Grand voyageur, il visita l’Espagne, l’Angleterre, l’Algérie, l’Italie, la Grèce, la Turquie, la Russie et l’Égypte, s’inspirant de ses nombreux voyages pour écrire des nouvelles, des poèmes et des récits de voyages. Il fut l’auteur de deux grands romans, "Le Roman de la momie" (1858) et "Le Capitaine Fracasse" (1863), son œuvre la plus connue. En résumé, il fut un auteur passionné par les arts. Il aura écrit des romans, des nouvelles, des essais, des poèmes, des pièces de théâtre, des ballets, des récits de voyages ainsi que des critiques musicales, dramatiques, littéraires et artistiques. Mais il fut également artiste peintre et dessinateur. En 1857, il s’était installé avec sa compagne et ses filles dans une petite maison à Neuilly-sur-Seine, où il recevait ses amis. Avec la chute de l’Empire en 1870, il perd la pension qui le faisait vivre. Sa femme l’a quitté, ses filles se sont mariées. Il s’éteint le 23 octobre 1872 à Neuilly-sur-Seine et sera inhumé au cimetière de Montmartre à Paris. Edmond de Goncourt relate son "enterrement pompeux" au cours duquel Dumas fils lira l’éloge funèbre. Il avait reçu en 1840 la Croix de chevalier de la Légion d’honneur puis avait été promu officier en 1858. À Tarbes, un lycée qui a plus de cinq siècles d’existence porte son nom depuis 1912. À son grand regret, il ne retourna à son lieu de naissance qu’une seule fois pour y passer vingt-quatre heures. En 1859, de retour d’un voyage en Russie, il passe à Tarbes, où il est né rue du Bourg-Vieux (23 rue Brauhauban), avant de se rendre à Bagnères-de-Bigorre faire des excursions. Il se rend incognito au lycée de Tarbes, où évidemment il n’avait jamais été élève, pour voir son pupitre d’écolier sur lequel il aurait fait ses études. Il y fut reçu par le proviseur Nicolas Patry qui lui montra le fameux pupitre, lequel était quelconque, mais à son aspect il éprouva une émotion irrésistible, même s’il n’était pas son pupitre. Un buste de Théophile Gautier, modelé en 1890 par sa propre fille Judith, est exposé dans le jardin Massey de la ville de Tarbes depuis le 25 juillet 1897.GAYRAUD Agnès (1979-XXXX)
Agnès GAYRAUD, née le 19 février 1979 à Tarbes est une philosophe, journaliste et auteure-compositrice-interprète du projet musical « La Féline », et dont les albums ont été qualifiés de « pop mystique » par France Culture ». Normalienne, agrégée et docteure en philosophie, elle enseigne à l’École Nationale des Beaux-Arts de Lyon. Elle a d’abord étudié la littérature au lycée Théophile-Gautier de Tarbes. En 1997, à l’âge de 18 ans, elle intègre la classe d'hypokhâgne puis de khâgne au lycée Pierre-de-Fermat à Toulouse. Normalienne, elle rejoint l'École normale supérieure « Normale Sup' » rue d’Ulm à Paris en 2000 et l'université Paris IV-Sorbonne en 2002. Agrégée de philosophie, elle est lauréate de la Bourse de la Fondation Thiers remise par l'Institut de France en 2008. En 2010, diplômée d'un doctorat en histoire de la philosophie, elle est l'auteure de la thèse « La Critique de la subjectivité et de ses figures chez Theodor W. Adorno : une construction moderne » soutenue à l’université Paris IV-Sorbonne et couronnée d’une mention très honorable avec les félicitations du jury. La même année, elle obtient une bourse d’excellence de l’université de Montréal. Attachée temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) à l'université Paris IV-Sorbonne jusqu'en 2011, elle exerce une année au département littérature dans la prestigieuse université de Stanford en Californie. Après avoir été professeure d'esthétique à l'École nationale d'art de la Villa Arson à Nice, une institution dédiée à l’art contemporain, elle devient enseignante théorique, des arts plastiques et de création textuelle à École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (ENSBA) de Lyon. Journaliste, elle entretient sa plume critique dans les pages Culture du quotidien Libération où elle décortique principalement la musique pop. Elle est également auteure pour la rubrique littérature de Philosophie Magazine. En 2018, elle publie un essai philosophique sur l’esthétique des musiques populaires enregistrées, « Dialectique de la pop » aux éditions La Découverte / La rue musicale, collection "Culture sonore". Dans cet ouvrage, Agnès se penche sur la profondeur de cette musique longtemps qualifiée de « légère » et cantonnée à un statut d’objet de consommation. Elle y déploie tous ses paradoxes, au cœur des œuvres musicales elles-mêmes, pour révéler les ramifications esthétiques d’une richesse insoupçonnée de ce qui a peut-être été l’art musical le plus important du XXe siècle. Agnès alimente régulièrement un blog personnel de réflexion sur la musique nommé « Moderne, c'est déjà vieux ». En 2008, d'abord en trio puis accompagnée de Xavier Thiry au synthétiseur, musicien de Hello Kurt, Agnès Gayraud au chant, à la guitare, à l’écriture et à la composition se mue en La Féline. Le projet musical tire son nom de La Féline, film d’horreur du réalisateur français Jacques Tourneur, sorti sur les écrans en 1942. Entre 2009 et 2012, le duo édite différents EP (extended play) sur le Label Balades sonores, dont Écho composé de reprises. Le premier album de la formation, « Adieu l'enfance » est publié chez Kwaidan Records en 2014. La Féline récidive en 2017 avec la sortie de « Triomphe ». Un nouvel album sort en 2019 chez Kwaidan Records « Vie future ». La musique, fut sa passion dès l'enfance. « L’enfant que j’étais a très tôt écrit des textes, et chanté ces textes. J’avais un petit enregistreur, j’avais déjà ce rapport à l’enregistrement, et c’est resté un rapport à la musique comme pratique presque quotidienne d’inventer des chansons. La philosophie, sous ce nom-là, en tant que telle, je l’ai découverte plus tard. C’est la dimension pluridisciplinaire de la philosophie qui m’a intéressée. Il me semblait que je pouvais m’attarder sur la métaphysique, la philosophie des sciences, l’anthropologie, l’esthétique, la réflexion sur l’art… ». Sa rencontre avec Theodor W. Adorno, philosophe allemand bien connu pour être le grand contempteur des musiques populaires et dont elle est spécialiste : « Je me suis intéressée à Adorno parce que je cherchais un livre de métaphysique du XXe siècle. On m’a conseillé "Dialectique négative". Je voulais un texte difficile, m’affronter à quelque chose d’exigeant, je n’ai pas été déçue. Le texte est passionnant, étrangement construit, et au fond n’est pas un texte de métaphysique mais un texte qui cherche les conditions d’un sujet philosophique alors même qu’on ne croit plus à la métaphysique… Mais ce texte a un tel rapport obsessionnel à l’histoire de la métaphysique qu’il en devient métaphysique. Adorno n’est pas un penseur pessimiste, il utilise la négativité comme outil critique et rhétorique. Dans un de ses textes, il défend l’idée d’exagération que la pensée doit utiliser comme une méthode, enfoncer le clou jusqu’à l’absurde pour que quelque chose bouge, faire craquer le vernis. Il ne s’agit donc pas de négativité comme projet, mais comme ruse, technique de survie dans un contexte si négatif que seule la négativité peut le faire exploser. » Depuis 2008, Agnès mène une activité de musicienne au sein du projet La Féline. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle est quelqu’un qui multiplie les activités. Autrice de disques de pop en français sous le nom de La Féline depuis plus de dix ans, elle a tout récemment fait paraître GRIVE (Schubert Music Publishing/Modulor Records), nouvel oiseau discographique, anglophone cette fois, en duo avec Paul Régimbeau, alias Mondkopf. Tout ceci en précisant qu’elle a déjà bien avancé sur son prochain album à elle et commencé à plancher sur un prochain livre. Ses penseurs qui l’accompagnent : Theodor Adorno et Tristan Garcia, dont la pensée partage intimement sa vie depuis plus de vingt ans. En résumé, elle est l’autrice en 2018 de Dialectique de la pop, un essai philosophique sur la musique populaire enregistrée. Journaliste, elle est critique musicale pour Libération et mène depuis 2008 une riche carrière musicale sous le nom de La Féline, autrice de trois albums, Adieu l’enfance (2014), Triomphe (2017) et Vie future (2019) et la sortie de son dernier EP "Alentour de Lune" le 02 octobre 2020. « Ce que je peux dire, en quelques mots, c’est que l’envie de chanter, en public, des compositions de mon cru, est très ancienne : j’ai écrit mes premières chansons vers l’âge de six ans. Je n’ai pas fait d’études musicales, mais cette volonté d’écrire des chansons et de les interpréter a toujours été extrêmement forte. Ce n’est que vers l’âge de 11 ans que j’ai eu mon premier instrument, une guitare — pour pouvoir jouer « One » de Metallica, dont j’étais fan. J’ai été élevée par une mère seule, sans pouvoir assumer cette volonté d’être artiste tout de suite. Il fallait un « filet de sécurité ». J’étais bonne élève, et j’aimais les humanités, la philo a été une grande découverte, donc je me suis lancée, parallèlement, dans des études de philo. Au moment où je suis en DEA de philosophie, je fonde La Féline (vers 2008) qui est mon incarnation musicale, à ce jour la plus productive (je viens de me lancer dans un autre projet nommé Grive, avec Paul Régimbeau de Mondkopf). » Agnès n’arrive pas bien à dire aujourd’hui si la musique est son métier, car elle vit plus de l’enseignement et un peu de ses droits d’auteurs, mais la musique, c’est sa vie. Artiste femme, elle avait même partagé la scène avec le regretté auteur-compositeur-chanteur Christophe.
 Philosophe, journaliste et auteure-compositrice-interprète
Philosophe, journaliste et auteure-compositrice-interprète
Agnès GAYRAUD, née le 19 février 1979 à Tarbes est une philosophe, journaliste et auteure-compositrice-interprète du projet musical « La Féline », et dont les albums ont été qualifiés de « pop mystique » par France Culture ». Normalienne, agrégée et docteure en philosophie, elle enseigne à l’École Nationale des Beaux-Arts de Lyon. Elle a d’abord étudié la littérature au lycée Théophile-Gautier de Tarbes. En 1997, à l’âge de 18 ans, elle intègre la classe d'hypokhâgne puis de khâgne au lycée Pierre-de-Fermat à Toulouse. Normalienne, elle rejoint l'École normale supérieure « Normale Sup' » rue d’Ulm à Paris en 2000 et l'université Paris IV-Sorbonne en 2002. Agrégée de philosophie, elle est lauréate de la Bourse de la Fondation Thiers remise par l'Institut de France en 2008. En 2010, diplômée d'un doctorat en histoire de la philosophie, elle est l'auteure de la thèse « La Critique de la subjectivité et de ses figures chez Theodor W. Adorno : une construction moderne » soutenue à l’université Paris IV-Sorbonne et couronnée d’une mention très honorable avec les félicitations du jury. La même année, elle obtient une bourse d’excellence de l’université de Montréal. Attachée temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) à l'université Paris IV-Sorbonne jusqu'en 2011, elle exerce une année au département littérature dans la prestigieuse université de Stanford en Californie. Après avoir été professeure d'esthétique à l'École nationale d'art de la Villa Arson à Nice, une institution dédiée à l’art contemporain, elle devient enseignante théorique, des arts plastiques et de création textuelle à École Nationale Supérieure des Beaux-Arts (ENSBA) de Lyon. Journaliste, elle entretient sa plume critique dans les pages Culture du quotidien Libération où elle décortique principalement la musique pop. Elle est également auteure pour la rubrique littérature de Philosophie Magazine. En 2018, elle publie un essai philosophique sur l’esthétique des musiques populaires enregistrées, « Dialectique de la pop » aux éditions La Découverte / La rue musicale, collection "Culture sonore". Dans cet ouvrage, Agnès se penche sur la profondeur de cette musique longtemps qualifiée de « légère » et cantonnée à un statut d’objet de consommation. Elle y déploie tous ses paradoxes, au cœur des œuvres musicales elles-mêmes, pour révéler les ramifications esthétiques d’une richesse insoupçonnée de ce qui a peut-être été l’art musical le plus important du XXe siècle. Agnès alimente régulièrement un blog personnel de réflexion sur la musique nommé « Moderne, c'est déjà vieux ». En 2008, d'abord en trio puis accompagnée de Xavier Thiry au synthétiseur, musicien de Hello Kurt, Agnès Gayraud au chant, à la guitare, à l’écriture et à la composition se mue en La Féline. Le projet musical tire son nom de La Féline, film d’horreur du réalisateur français Jacques Tourneur, sorti sur les écrans en 1942. Entre 2009 et 2012, le duo édite différents EP (extended play) sur le Label Balades sonores, dont Écho composé de reprises. Le premier album de la formation, « Adieu l'enfance » est publié chez Kwaidan Records en 2014. La Féline récidive en 2017 avec la sortie de « Triomphe ». Un nouvel album sort en 2019 chez Kwaidan Records « Vie future ». La musique, fut sa passion dès l'enfance. « L’enfant que j’étais a très tôt écrit des textes, et chanté ces textes. J’avais un petit enregistreur, j’avais déjà ce rapport à l’enregistrement, et c’est resté un rapport à la musique comme pratique presque quotidienne d’inventer des chansons. La philosophie, sous ce nom-là, en tant que telle, je l’ai découverte plus tard. C’est la dimension pluridisciplinaire de la philosophie qui m’a intéressée. Il me semblait que je pouvais m’attarder sur la métaphysique, la philosophie des sciences, l’anthropologie, l’esthétique, la réflexion sur l’art… ». Sa rencontre avec Theodor W. Adorno, philosophe allemand bien connu pour être le grand contempteur des musiques populaires et dont elle est spécialiste : « Je me suis intéressée à Adorno parce que je cherchais un livre de métaphysique du XXe siècle. On m’a conseillé "Dialectique négative". Je voulais un texte difficile, m’affronter à quelque chose d’exigeant, je n’ai pas été déçue. Le texte est passionnant, étrangement construit, et au fond n’est pas un texte de métaphysique mais un texte qui cherche les conditions d’un sujet philosophique alors même qu’on ne croit plus à la métaphysique… Mais ce texte a un tel rapport obsessionnel à l’histoire de la métaphysique qu’il en devient métaphysique. Adorno n’est pas un penseur pessimiste, il utilise la négativité comme outil critique et rhétorique. Dans un de ses textes, il défend l’idée d’exagération que la pensée doit utiliser comme une méthode, enfoncer le clou jusqu’à l’absurde pour que quelque chose bouge, faire craquer le vernis. Il ne s’agit donc pas de négativité comme projet, mais comme ruse, technique de survie dans un contexte si négatif que seule la négativité peut le faire exploser. » Depuis 2008, Agnès mène une activité de musicienne au sein du projet La Féline. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle est quelqu’un qui multiplie les activités. Autrice de disques de pop en français sous le nom de La Féline depuis plus de dix ans, elle a tout récemment fait paraître GRIVE (Schubert Music Publishing/Modulor Records), nouvel oiseau discographique, anglophone cette fois, en duo avec Paul Régimbeau, alias Mondkopf. Tout ceci en précisant qu’elle a déjà bien avancé sur son prochain album à elle et commencé à plancher sur un prochain livre. Ses penseurs qui l’accompagnent : Theodor Adorno et Tristan Garcia, dont la pensée partage intimement sa vie depuis plus de vingt ans. En résumé, elle est l’autrice en 2018 de Dialectique de la pop, un essai philosophique sur la musique populaire enregistrée. Journaliste, elle est critique musicale pour Libération et mène depuis 2008 une riche carrière musicale sous le nom de La Féline, autrice de trois albums, Adieu l’enfance (2014), Triomphe (2017) et Vie future (2019) et la sortie de son dernier EP "Alentour de Lune" le 02 octobre 2020. « Ce que je peux dire, en quelques mots, c’est que l’envie de chanter, en public, des compositions de mon cru, est très ancienne : j’ai écrit mes premières chansons vers l’âge de six ans. Je n’ai pas fait d’études musicales, mais cette volonté d’écrire des chansons et de les interpréter a toujours été extrêmement forte. Ce n’est que vers l’âge de 11 ans que j’ai eu mon premier instrument, une guitare — pour pouvoir jouer « One » de Metallica, dont j’étais fan. J’ai été élevée par une mère seule, sans pouvoir assumer cette volonté d’être artiste tout de suite. Il fallait un « filet de sécurité ». J’étais bonne élève, et j’aimais les humanités, la philo a été une grande découverte, donc je me suis lancée, parallèlement, dans des études de philo. Au moment où je suis en DEA de philosophie, je fonde La Féline (vers 2008) qui est mon incarnation musicale, à ce jour la plus productive (je viens de me lancer dans un autre projet nommé Grive, avec Paul Régimbeau de Mondkopf). » Agnès n’arrive pas bien à dire aujourd’hui si la musique est son métier, car elle vit plus de l’enseignement et un peu de ses droits d’auteurs, mais la musique, c’est sa vie. Artiste femme, elle avait même partagé la scène avec le regretté auteur-compositeur-chanteur Christophe.
GENÈS Henri (1919-2005)
Acteur et chansonnier
 Henri GENÈS, de son vrai nom Henri GÉNÉBÉS, né le 2 juillet 1919 à Tarbes et mort le 22 août 2005 à Saint-Cloud, à l’âge de 86 ans, connut divers succès grâce à des titres de chansons comiques. Il fit ses études au lycée de Tarbes, où il décrocha son bac, tout en jouant au rugby et en s’intéressant à la chanson. Il fut remarqué par le baryton Robert Jysor, lors de concours-crochets. Monté tout jeune à Paris, il y enchaîna de petits rôles de 1945 à 1995. Il débutera au théâtre. En même temps, il se produira dans plusieurs cabarets dont « Tonton » et au music-hall. Il fréquentera plusieurs établissements de la région parisienne, partageant parfois l’affiche avec Bourvil, et parmi ces salles, Pacra et enfin Bobino, où Jacques Hélian et son orchestre tenaient la vedette. C’est lors des répétitions de l’opérette « Quatre jours à Paris » (rôle de Nicolas, 1948), qu’il rencontra l’actrice Jeannette Batti, qui sera souvent sa partenaire sur scène et à l’écran et qu’il épousera plus tard. D’une première union il avait déjà une fille, Martine. Avec Jeannette, il créera en 1949 « Monsieur Bourgogne » également de Francis Lopez. Puis « L’école des femmes nues » de Henri Betti (1950). Ray Ventura l’engagera pour 5 films : « La petite chocolatière (1949) », « Nous irons à Paris (1949) » l’une des rares réussites du cinéma musical français de cette période, « Pigalle Saint-Germain-des-Prés (1950) », « Nous irons à Monte-Carlo (1951) » et « Femmes de Paris (1953) ». On se souvient particulièrement de son personnage de Julien, dans les œuvres initiées par Ray Ventura. Au cinéma, on le verra encore dans « Les amants de Bras-Mort (1950) », auprès de Nicole Courcel, « La reine Margot (1954) », auprès de Jeanne Moreau, où il fut un remarquable « Annibal de Coconas », « Trois de la Canebière (1956) » et « Trois de la Marine (1957) », auprès de Marcel Merkès. En 1958, il créa « Coquin de Printemps » de Guy Magenta, mais devenu paralysé du visage à la suite d’une attaque cérébrale, absent de la scène et des studios de 1958 à 1963, il devra céder sa place à Fernand Sardou. Rétabli, il partira en tournées pour plusieurs opérettes : « La route fleurie », « L’auberge du cheval blanc » et bien d’autres. Mais il ne parviendra plus à décrocher des rôles importants au cinéma, préférant collectionner les apparitions clin d’œil. Il se produira aussi volontiers dans des seconds rôles à la télévision. Sa santé s’améliorant, il assurera une tournée de « Coquin de printemps ». Il créera encore dans la capitale « Cristobal le magnifique » de Lopez (1963). En opérette, sa carrière se poursuivra en province, où il interprétera « La route fleurie » et « Mam’zelle Nitouche ». Il créera ensuite « Viva Napoli ! » auprès de Rudy Hirigoyen (Lille, 1969) puis plus tard « C’est pas l’Pérou » de Jack Ledru (Lille, 1976). Plus tard encore, il inscrira à son répertoire le rôle de Bistagne dans « L’auberge du Cheval Blanc » et celui du curé dans « Méditerranée ». Au début des années 60, participant aux succès de Gérard Oury, on le retrouvera au cinéma dans « Le Corniaud (1964), La Grande Vadrouille (1966), Le Cerveau (1969) » et la plupart des films interprétés par Louis de Funès auquel il donna régulièrement la réplique « Le Petit Baigneur (1968) de Robert Dhéry, La Soupe aux choux (1981) de Jean Girault », mais encore dans certains feuilletons télévisés comme « Nans le Berger (1974) » de Roland Bernard et « Allez France (1964) » de Robert Dhéry. Il est celui qui met de l’ambiance, à l’image de la troisième mi-temps chère aux joueurs de rugby. Il était le supporter le plus enthousiaste dans « Allez France ! ». Bien plus tard ce sera « Le provincial » auprès de Roland Giraud. À la télévision, il obtint de bons rôles dont « Nans le Berger » et « Fini de rire fillette ». Au théâtre, il interprétera « Le marché aux puces » et « Les Coucous », sa partenaire étant une fois encore Jeannette Batti. S’il n’a pas accédé à une notoriété comparable à celle de Bourvil ou de Louis de Funès, doué d’un talent d’amuseur certain, il aura connu néanmoins un succès indiscutable tout au long de sa carrière. Il fut un acteur, chanteur et humoriste, qui aura aussi marqué de son écrasante personnalité quelques tubes tels "La Tantina de Burgos", "Fatigué de naissance", ou encore "Le facteur de Santa Cruz", titre avec lequel il obtiendra le Grand Prix du Disque en 1957. Il interpréta ces airs joyeux au son des accordéons d’André Verchuren, Aimable ou Yvette Horner. Il mena une carrière dans les cabarets et l’opérette « La route enchantée », enregistrant de nombreuses chansons comiques, dont « Le Facteur de Santa Cruz » et « La Tantina de Burgos », « On est les minets de la plage » en duo avec un autre joyeux luron, Jean Lefebvre et il fut un acteur de théâtre. À partir des années 1990, il abandonnera les plateaux de cinéma et prendra définitivement sa retraite. Décédé le lundi 22 août 2005 à l’âge de 86 ans, l’acteur-chanteur tarbais a été inhumé dans l’intimité à Neuilly-Sur-Seine. Il était ce qu’on appelle un acteur à accent, celui de la Bigorre, qui était devenu sa signature. Il portait aussi bien le béret du bon vivant que le képi du gendarme au cinéma. Personnage à la silhouette rebondie, il avait mené une carrière dans les cabarets et l’opérette, enregistrant de nombreuses chansons comiques et avait incarné la jovialité du Sud-Ouest dans plus d’une centaine de films. Voici cités quelques-uns des plus grands succès du plus enthousiaste des fantaisistes français : La tactique du gendarme - Chiquita, Madame - À Saint-Germain-des-Prés - La Pagaïa - On n’est pas des manchots - L’œil en coulisse - Sidi-Bel-Abbès - Tantina de Burgos - Tire l’aiguille - Baba Baïon - Je n’sais pas dire "non" - La Matelote - À Toulon - Le vrai mambo - À la Garenne-Bezons - Hop Digui-Di - Allez à la pêche - T’épier - Le facteur de Santa Cruz - Vache de java - El Coryza - Coquin de printemps - Le quadrille à Virginie - Les mecs de Mexico - Comme Papa - Fatigué de naissance - La caissière du grand café.
Henri GENÈS, de son vrai nom Henri GÉNÉBÉS, né le 2 juillet 1919 à Tarbes et mort le 22 août 2005 à Saint-Cloud, à l’âge de 86 ans, connut divers succès grâce à des titres de chansons comiques. Il fit ses études au lycée de Tarbes, où il décrocha son bac, tout en jouant au rugby et en s’intéressant à la chanson. Il fut remarqué par le baryton Robert Jysor, lors de concours-crochets. Monté tout jeune à Paris, il y enchaîna de petits rôles de 1945 à 1995. Il débutera au théâtre. En même temps, il se produira dans plusieurs cabarets dont « Tonton » et au music-hall. Il fréquentera plusieurs établissements de la région parisienne, partageant parfois l’affiche avec Bourvil, et parmi ces salles, Pacra et enfin Bobino, où Jacques Hélian et son orchestre tenaient la vedette. C’est lors des répétitions de l’opérette « Quatre jours à Paris » (rôle de Nicolas, 1948), qu’il rencontra l’actrice Jeannette Batti, qui sera souvent sa partenaire sur scène et à l’écran et qu’il épousera plus tard. D’une première union il avait déjà une fille, Martine. Avec Jeannette, il créera en 1949 « Monsieur Bourgogne » également de Francis Lopez. Puis « L’école des femmes nues » de Henri Betti (1950). Ray Ventura l’engagera pour 5 films : « La petite chocolatière (1949) », « Nous irons à Paris (1949) » l’une des rares réussites du cinéma musical français de cette période, « Pigalle Saint-Germain-des-Prés (1950) », « Nous irons à Monte-Carlo (1951) » et « Femmes de Paris (1953) ». On se souvient particulièrement de son personnage de Julien, dans les œuvres initiées par Ray Ventura. Au cinéma, on le verra encore dans « Les amants de Bras-Mort (1950) », auprès de Nicole Courcel, « La reine Margot (1954) », auprès de Jeanne Moreau, où il fut un remarquable « Annibal de Coconas », « Trois de la Canebière (1956) » et « Trois de la Marine (1957) », auprès de Marcel Merkès. En 1958, il créa « Coquin de Printemps » de Guy Magenta, mais devenu paralysé du visage à la suite d’une attaque cérébrale, absent de la scène et des studios de 1958 à 1963, il devra céder sa place à Fernand Sardou. Rétabli, il partira en tournées pour plusieurs opérettes : « La route fleurie », « L’auberge du cheval blanc » et bien d’autres. Mais il ne parviendra plus à décrocher des rôles importants au cinéma, préférant collectionner les apparitions clin d’œil. Il se produira aussi volontiers dans des seconds rôles à la télévision. Sa santé s’améliorant, il assurera une tournée de « Coquin de printemps ». Il créera encore dans la capitale « Cristobal le magnifique » de Lopez (1963). En opérette, sa carrière se poursuivra en province, où il interprétera « La route fleurie » et « Mam’zelle Nitouche ». Il créera ensuite « Viva Napoli ! » auprès de Rudy Hirigoyen (Lille, 1969) puis plus tard « C’est pas l’Pérou » de Jack Ledru (Lille, 1976). Plus tard encore, il inscrira à son répertoire le rôle de Bistagne dans « L’auberge du Cheval Blanc » et celui du curé dans « Méditerranée ». Au début des années 60, participant aux succès de Gérard Oury, on le retrouvera au cinéma dans « Le Corniaud (1964), La Grande Vadrouille (1966), Le Cerveau (1969) » et la plupart des films interprétés par Louis de Funès auquel il donna régulièrement la réplique « Le Petit Baigneur (1968) de Robert Dhéry, La Soupe aux choux (1981) de Jean Girault », mais encore dans certains feuilletons télévisés comme « Nans le Berger (1974) » de Roland Bernard et « Allez France (1964) » de Robert Dhéry. Il est celui qui met de l’ambiance, à l’image de la troisième mi-temps chère aux joueurs de rugby. Il était le supporter le plus enthousiaste dans « Allez France ! ». Bien plus tard ce sera « Le provincial » auprès de Roland Giraud. À la télévision, il obtint de bons rôles dont « Nans le Berger » et « Fini de rire fillette ». Au théâtre, il interprétera « Le marché aux puces » et « Les Coucous », sa partenaire étant une fois encore Jeannette Batti. S’il n’a pas accédé à une notoriété comparable à celle de Bourvil ou de Louis de Funès, doué d’un talent d’amuseur certain, il aura connu néanmoins un succès indiscutable tout au long de sa carrière. Il fut un acteur, chanteur et humoriste, qui aura aussi marqué de son écrasante personnalité quelques tubes tels "La Tantina de Burgos", "Fatigué de naissance", ou encore "Le facteur de Santa Cruz", titre avec lequel il obtiendra le Grand Prix du Disque en 1957. Il interpréta ces airs joyeux au son des accordéons d’André Verchuren, Aimable ou Yvette Horner. Il mena une carrière dans les cabarets et l’opérette « La route enchantée », enregistrant de nombreuses chansons comiques, dont « Le Facteur de Santa Cruz » et « La Tantina de Burgos », « On est les minets de la plage » en duo avec un autre joyeux luron, Jean Lefebvre et il fut un acteur de théâtre. À partir des années 1990, il abandonnera les plateaux de cinéma et prendra définitivement sa retraite. Décédé le lundi 22 août 2005 à l’âge de 86 ans, l’acteur-chanteur tarbais a été inhumé dans l’intimité à Neuilly-Sur-Seine. Il était ce qu’on appelle un acteur à accent, celui de la Bigorre, qui était devenu sa signature. Il portait aussi bien le béret du bon vivant que le képi du gendarme au cinéma. Personnage à la silhouette rebondie, il avait mené une carrière dans les cabarets et l’opérette, enregistrant de nombreuses chansons comiques et avait incarné la jovialité du Sud-Ouest dans plus d’une centaine de films. Voici cités quelques-uns des plus grands succès du plus enthousiaste des fantaisistes français : La tactique du gendarme - Chiquita, Madame - À Saint-Germain-des-Prés - La Pagaïa - On n’est pas des manchots - L’œil en coulisse - Sidi-Bel-Abbès - Tantina de Burgos - Tire l’aiguille - Baba Baïon - Je n’sais pas dire "non" - La Matelote - À Toulon - Le vrai mambo - À la Garenne-Bezons - Hop Digui-Di - Allez à la pêche - T’épier - Le facteur de Santa Cruz - Vache de java - El Coryza - Coquin de printemps - Le quadrille à Virginie - Les mecs de Mexico - Comme Papa - Fatigué de naissance - La caissière du grand café.
 Henri GENÈS, de son vrai nom Henri GÉNÉBÉS, né le 2 juillet 1919 à Tarbes et mort le 22 août 2005 à Saint-Cloud, à l’âge de 86 ans, connut divers succès grâce à des titres de chansons comiques. Il fit ses études au lycée de Tarbes, où il décrocha son bac, tout en jouant au rugby et en s’intéressant à la chanson. Il fut remarqué par le baryton Robert Jysor, lors de concours-crochets. Monté tout jeune à Paris, il y enchaîna de petits rôles de 1945 à 1995. Il débutera au théâtre. En même temps, il se produira dans plusieurs cabarets dont « Tonton » et au music-hall. Il fréquentera plusieurs établissements de la région parisienne, partageant parfois l’affiche avec Bourvil, et parmi ces salles, Pacra et enfin Bobino, où Jacques Hélian et son orchestre tenaient la vedette. C’est lors des répétitions de l’opérette « Quatre jours à Paris » (rôle de Nicolas, 1948), qu’il rencontra l’actrice Jeannette Batti, qui sera souvent sa partenaire sur scène et à l’écran et qu’il épousera plus tard. D’une première union il avait déjà une fille, Martine. Avec Jeannette, il créera en 1949 « Monsieur Bourgogne » également de Francis Lopez. Puis « L’école des femmes nues » de Henri Betti (1950). Ray Ventura l’engagera pour 5 films : « La petite chocolatière (1949) », « Nous irons à Paris (1949) » l’une des rares réussites du cinéma musical français de cette période, « Pigalle Saint-Germain-des-Prés (1950) », « Nous irons à Monte-Carlo (1951) » et « Femmes de Paris (1953) ». On se souvient particulièrement de son personnage de Julien, dans les œuvres initiées par Ray Ventura. Au cinéma, on le verra encore dans « Les amants de Bras-Mort (1950) », auprès de Nicole Courcel, « La reine Margot (1954) », auprès de Jeanne Moreau, où il fut un remarquable « Annibal de Coconas », « Trois de la Canebière (1956) » et « Trois de la Marine (1957) », auprès de Marcel Merkès. En 1958, il créa « Coquin de Printemps » de Guy Magenta, mais devenu paralysé du visage à la suite d’une attaque cérébrale, absent de la scène et des studios de 1958 à 1963, il devra céder sa place à Fernand Sardou. Rétabli, il partira en tournées pour plusieurs opérettes : « La route fleurie », « L’auberge du cheval blanc » et bien d’autres. Mais il ne parviendra plus à décrocher des rôles importants au cinéma, préférant collectionner les apparitions clin d’œil. Il se produira aussi volontiers dans des seconds rôles à la télévision. Sa santé s’améliorant, il assurera une tournée de « Coquin de printemps ». Il créera encore dans la capitale « Cristobal le magnifique » de Lopez (1963). En opérette, sa carrière se poursuivra en province, où il interprétera « La route fleurie » et « Mam’zelle Nitouche ». Il créera ensuite « Viva Napoli ! » auprès de Rudy Hirigoyen (Lille, 1969) puis plus tard « C’est pas l’Pérou » de Jack Ledru (Lille, 1976). Plus tard encore, il inscrira à son répertoire le rôle de Bistagne dans « L’auberge du Cheval Blanc » et celui du curé dans « Méditerranée ». Au début des années 60, participant aux succès de Gérard Oury, on le retrouvera au cinéma dans « Le Corniaud (1964), La Grande Vadrouille (1966), Le Cerveau (1969) » et la plupart des films interprétés par Louis de Funès auquel il donna régulièrement la réplique « Le Petit Baigneur (1968) de Robert Dhéry, La Soupe aux choux (1981) de Jean Girault », mais encore dans certains feuilletons télévisés comme « Nans le Berger (1974) » de Roland Bernard et « Allez France (1964) » de Robert Dhéry. Il est celui qui met de l’ambiance, à l’image de la troisième mi-temps chère aux joueurs de rugby. Il était le supporter le plus enthousiaste dans « Allez France ! ». Bien plus tard ce sera « Le provincial » auprès de Roland Giraud. À la télévision, il obtint de bons rôles dont « Nans le Berger » et « Fini de rire fillette ». Au théâtre, il interprétera « Le marché aux puces » et « Les Coucous », sa partenaire étant une fois encore Jeannette Batti. S’il n’a pas accédé à une notoriété comparable à celle de Bourvil ou de Louis de Funès, doué d’un talent d’amuseur certain, il aura connu néanmoins un succès indiscutable tout au long de sa carrière. Il fut un acteur, chanteur et humoriste, qui aura aussi marqué de son écrasante personnalité quelques tubes tels "La Tantina de Burgos", "Fatigué de naissance", ou encore "Le facteur de Santa Cruz", titre avec lequel il obtiendra le Grand Prix du Disque en 1957. Il interpréta ces airs joyeux au son des accordéons d’André Verchuren, Aimable ou Yvette Horner. Il mena une carrière dans les cabarets et l’opérette « La route enchantée », enregistrant de nombreuses chansons comiques, dont « Le Facteur de Santa Cruz » et « La Tantina de Burgos », « On est les minets de la plage » en duo avec un autre joyeux luron, Jean Lefebvre et il fut un acteur de théâtre. À partir des années 1990, il abandonnera les plateaux de cinéma et prendra définitivement sa retraite. Décédé le lundi 22 août 2005 à l’âge de 86 ans, l’acteur-chanteur tarbais a été inhumé dans l’intimité à Neuilly-Sur-Seine. Il était ce qu’on appelle un acteur à accent, celui de la Bigorre, qui était devenu sa signature. Il portait aussi bien le béret du bon vivant que le képi du gendarme au cinéma. Personnage à la silhouette rebondie, il avait mené une carrière dans les cabarets et l’opérette, enregistrant de nombreuses chansons comiques et avait incarné la jovialité du Sud-Ouest dans plus d’une centaine de films. Voici cités quelques-uns des plus grands succès du plus enthousiaste des fantaisistes français : La tactique du gendarme - Chiquita, Madame - À Saint-Germain-des-Prés - La Pagaïa - On n’est pas des manchots - L’œil en coulisse - Sidi-Bel-Abbès - Tantina de Burgos - Tire l’aiguille - Baba Baïon - Je n’sais pas dire "non" - La Matelote - À Toulon - Le vrai mambo - À la Garenne-Bezons - Hop Digui-Di - Allez à la pêche - T’épier - Le facteur de Santa Cruz - Vache de java - El Coryza - Coquin de printemps - Le quadrille à Virginie - Les mecs de Mexico - Comme Papa - Fatigué de naissance - La caissière du grand café.
Henri GENÈS, de son vrai nom Henri GÉNÉBÉS, né le 2 juillet 1919 à Tarbes et mort le 22 août 2005 à Saint-Cloud, à l’âge de 86 ans, connut divers succès grâce à des titres de chansons comiques. Il fit ses études au lycée de Tarbes, où il décrocha son bac, tout en jouant au rugby et en s’intéressant à la chanson. Il fut remarqué par le baryton Robert Jysor, lors de concours-crochets. Monté tout jeune à Paris, il y enchaîna de petits rôles de 1945 à 1995. Il débutera au théâtre. En même temps, il se produira dans plusieurs cabarets dont « Tonton » et au music-hall. Il fréquentera plusieurs établissements de la région parisienne, partageant parfois l’affiche avec Bourvil, et parmi ces salles, Pacra et enfin Bobino, où Jacques Hélian et son orchestre tenaient la vedette. C’est lors des répétitions de l’opérette « Quatre jours à Paris » (rôle de Nicolas, 1948), qu’il rencontra l’actrice Jeannette Batti, qui sera souvent sa partenaire sur scène et à l’écran et qu’il épousera plus tard. D’une première union il avait déjà une fille, Martine. Avec Jeannette, il créera en 1949 « Monsieur Bourgogne » également de Francis Lopez. Puis « L’école des femmes nues » de Henri Betti (1950). Ray Ventura l’engagera pour 5 films : « La petite chocolatière (1949) », « Nous irons à Paris (1949) » l’une des rares réussites du cinéma musical français de cette période, « Pigalle Saint-Germain-des-Prés (1950) », « Nous irons à Monte-Carlo (1951) » et « Femmes de Paris (1953) ». On se souvient particulièrement de son personnage de Julien, dans les œuvres initiées par Ray Ventura. Au cinéma, on le verra encore dans « Les amants de Bras-Mort (1950) », auprès de Nicole Courcel, « La reine Margot (1954) », auprès de Jeanne Moreau, où il fut un remarquable « Annibal de Coconas », « Trois de la Canebière (1956) » et « Trois de la Marine (1957) », auprès de Marcel Merkès. En 1958, il créa « Coquin de Printemps » de Guy Magenta, mais devenu paralysé du visage à la suite d’une attaque cérébrale, absent de la scène et des studios de 1958 à 1963, il devra céder sa place à Fernand Sardou. Rétabli, il partira en tournées pour plusieurs opérettes : « La route fleurie », « L’auberge du cheval blanc » et bien d’autres. Mais il ne parviendra plus à décrocher des rôles importants au cinéma, préférant collectionner les apparitions clin d’œil. Il se produira aussi volontiers dans des seconds rôles à la télévision. Sa santé s’améliorant, il assurera une tournée de « Coquin de printemps ». Il créera encore dans la capitale « Cristobal le magnifique » de Lopez (1963). En opérette, sa carrière se poursuivra en province, où il interprétera « La route fleurie » et « Mam’zelle Nitouche ». Il créera ensuite « Viva Napoli ! » auprès de Rudy Hirigoyen (Lille, 1969) puis plus tard « C’est pas l’Pérou » de Jack Ledru (Lille, 1976). Plus tard encore, il inscrira à son répertoire le rôle de Bistagne dans « L’auberge du Cheval Blanc » et celui du curé dans « Méditerranée ». Au début des années 60, participant aux succès de Gérard Oury, on le retrouvera au cinéma dans « Le Corniaud (1964), La Grande Vadrouille (1966), Le Cerveau (1969) » et la plupart des films interprétés par Louis de Funès auquel il donna régulièrement la réplique « Le Petit Baigneur (1968) de Robert Dhéry, La Soupe aux choux (1981) de Jean Girault », mais encore dans certains feuilletons télévisés comme « Nans le Berger (1974) » de Roland Bernard et « Allez France (1964) » de Robert Dhéry. Il est celui qui met de l’ambiance, à l’image de la troisième mi-temps chère aux joueurs de rugby. Il était le supporter le plus enthousiaste dans « Allez France ! ». Bien plus tard ce sera « Le provincial » auprès de Roland Giraud. À la télévision, il obtint de bons rôles dont « Nans le Berger » et « Fini de rire fillette ». Au théâtre, il interprétera « Le marché aux puces » et « Les Coucous », sa partenaire étant une fois encore Jeannette Batti. S’il n’a pas accédé à une notoriété comparable à celle de Bourvil ou de Louis de Funès, doué d’un talent d’amuseur certain, il aura connu néanmoins un succès indiscutable tout au long de sa carrière. Il fut un acteur, chanteur et humoriste, qui aura aussi marqué de son écrasante personnalité quelques tubes tels "La Tantina de Burgos", "Fatigué de naissance", ou encore "Le facteur de Santa Cruz", titre avec lequel il obtiendra le Grand Prix du Disque en 1957. Il interpréta ces airs joyeux au son des accordéons d’André Verchuren, Aimable ou Yvette Horner. Il mena une carrière dans les cabarets et l’opérette « La route enchantée », enregistrant de nombreuses chansons comiques, dont « Le Facteur de Santa Cruz » et « La Tantina de Burgos », « On est les minets de la plage » en duo avec un autre joyeux luron, Jean Lefebvre et il fut un acteur de théâtre. À partir des années 1990, il abandonnera les plateaux de cinéma et prendra définitivement sa retraite. Décédé le lundi 22 août 2005 à l’âge de 86 ans, l’acteur-chanteur tarbais a été inhumé dans l’intimité à Neuilly-Sur-Seine. Il était ce qu’on appelle un acteur à accent, celui de la Bigorre, qui était devenu sa signature. Il portait aussi bien le béret du bon vivant que le képi du gendarme au cinéma. Personnage à la silhouette rebondie, il avait mené une carrière dans les cabarets et l’opérette, enregistrant de nombreuses chansons comiques et avait incarné la jovialité du Sud-Ouest dans plus d’une centaine de films. Voici cités quelques-uns des plus grands succès du plus enthousiaste des fantaisistes français : La tactique du gendarme - Chiquita, Madame - À Saint-Germain-des-Prés - La Pagaïa - On n’est pas des manchots - L’œil en coulisse - Sidi-Bel-Abbès - Tantina de Burgos - Tire l’aiguille - Baba Baïon - Je n’sais pas dire "non" - La Matelote - À Toulon - Le vrai mambo - À la Garenne-Bezons - Hop Digui-Di - Allez à la pêche - T’épier - Le facteur de Santa Cruz - Vache de java - El Coryza - Coquin de printemps - Le quadrille à Virginie - Les mecs de Mexico - Comme Papa - Fatigué de naissance - La caissière du grand café.GION Christian (1940-XXXX)
Réalisateur, scénariste et acteur
 Christian GION, né à Lourdes le 10 mars 1940. Lycéen à Théophile Gautier à Tarbes, puis diplômé d’HEC, il est devenu sur le tard, metteur en scène. Il fait partie des réalisateurs de comédies populaires des années 1980. Sans atteindre les sommets de Claude Zidi, il a réalisé quelques gros succès. On lui doit de nombreux films « commerciaux » à tendance humoristique et aux titres évocateurs : C’est dur pour tout le monde (1975) avec Claude Piéplu, Le Pion (1978) avec Michel Galabru, J’ai rencontré le Père Noël (1983), Le Gagnant avec Michel Galabru et Stéphane Audran, Le Provincial (1990) avec Roland Giraud, dont l’action se passe en partie dans le Lavedan, Les Insaisissables (2000) avec Daniel Prévost. Le Pion reste une fable pleine d'optimisme et le meilleur film de Gion. Le plus connu et qui passe de temps en temps à la télévision est sans conteste Pétrole ! Pétrole ! (1981) avec J.-P. Marielle, B. Blier et H. Guybet, ayant reçu un certain succès ; le gag de l’avion avec le terrain de tennis sur lequel jouent des Arabes coiffés de leur keffieh et qui s’ouvre brusquement pour faire place à une piscine est restée dans de nombreuses mémoires ; comme la scène de la prière sur des tapis qui se tournent en permanence vers la Mecque, selon les directions que prenait l’avion. Surfant sur la mode Les Sous-doués réalisé par Claude Zidi, il livre Les Diplômés du dernier rang. Pour l'occasion, il réutilise Michel Galabru (présent dans le film de Zidi), et fait débuter Patrick Bruel. Le film connaît un certain succès, tout comme Le Bourreau des cœurs, reposant uniquement sur le personnage d'Aldo (la classe) Maccione. Il avait projeté en 1993, de faire un film sur la vie de Bernadette en Omnimax. À ses débuts, il avait réalisé un petit film sur les sanctuaires et les pèlerinages de Lourdes. Il a été projeté lors des journées du cinéma à Lourdes (Lourdes au Cinéma, 2010). À la demande du maire Philippe Douste-Blazy, il accepte en 1996 de reprendre en tant que président l’équipe de rugby de Lourdes (FCL) pendant les saisons 1996-1997 et 1997-1998. Michel Crauste prendra sa succession. Il est président de Lapaca production (film). Comme réalisateur il a produit de nombreux films comme : « Les Encerclés », avec Jacques Higelin, Brigitte Fontaine, Rufus (1967) ; « Les Couples du Bois de Boulogne » (réalisé sous le nom de Bernard Legrand) avec Philippe Gasté, Anne Libert (1974) ; « C'est dur pour tout le monde » avec Bernard Blier, Francis Perrin (1975) ; « Le Jardin des supplices », avec Roger Van Hool, Jacqueline Kerry (1976) ; « Superwoman » (réalisé sous le nom de Romain Pacy) (1976) ; « One, Two, Two : 122, rue de Provence », avec Francis Huster, Nicole Calfan (1977) ; « Le Pion » avec Henri Guybet, Claude Jade, Maureen Kerwin (1978) ; « Le Gagnant » avec Philippe Ruggieri, Michel Galabru (1979) ; « Pétrole ! Pétrole ! » avec Jean-Pierre Marielle, Bernard Blier (1981) ; « Les Diplômés du dernier rang » avec Patrick Bruel, Marie Laforêt, Michel Galabru (1982) ; « Le Bourreau des cœurs » avec Aldo Maccione, Anna Maria Rizzoli (1983) ; « J'ai rencontré le Père Noël » avec Karen Cheryl, Armand Meffre (1984) ; « Pizzaiolo et Mozzarel » avec Aldo Maccione, Marthe Villalonga (1985) ; « Le Provincial » avec Roland Giraud, Gabrielle Lazure (1989) ; « Sup de fric » avec Jean Poiret, Anthony Delon, Valérie Mairesse (1992) ; « Les Insaisissables » avec Daniel Prévost, Dominique Guillo (1999). Comme acteur, il a joué dans : « Association de malfaiteurs » de Claude Zidi (Le rôle de présentateur à la soirée HEC) (1987) ; « Profil bas » de Claude Zidi (le rôle du directeur de l'hôpital) (1993) ; « Ripoux 3 » de Claude Zidi (rôle du gérant de la guinguette) (2003). Christian Gion commence sa carrière comme d'autres, à tourner des films un peu chauds dans le milieu des années 1970, tels « Les couples du bois de Boulogne » ou « Le Jardin des supplices ». Prenant ensuite conscience de son potentiel comique, il se lance un objectif : faire marrer le public français. Il réalisera une douzaine de films dits "drôles" qui, faute de faire rire la France entière, feront passer de bons moments aux spectateurs. On retiendra entre autres son film pyrénéen « Le Provincial » avec Roland Giraud, Maurice Vaudaux, Gabrielle Lazure et Michel Galabru, qui se cache derrière ce pitch qui fait rêver : « Bernard vit heureux dans son petit village des Pyrénées, où il passe son temps à faire visiter aux touristes ce coin qu'il aime tant. Nathalie, elle, connaît la folie de la vie parisienne. Partie tourner un film publicitaire, elle rencontre Bernard dans son milieu, puis l'emmène à Paris pour la suite du film... » Un film tourné entre Gavarnie et Lourdes pour moitié et l’autre partie à Paris. On reconnaît bien les communes de Chèze, Ouzous, Arcizac-ez-Angles. Des scènes au Donjon des Aigles à Beaucens et au stade de rugby de Lourdes, où on aperçoit dans les vestiaires Hueber, Garuet, Rancoule, Armary ainsi que les joueurs de l’époque. L’idée de ce film lui était venue à partir de l’expérience de Jean-Sébastien Gion, un universitaire Bigourdan, créateur de la Maison de la Découverte Pyrénéenne à Bagnères-de-Bigorre. Engagé comme assistant technique du film « Le Provincial (1989) » et participant très efficacement au tournage, c’est Roland Giraud qui incarne son personnage dans le film. Christian Gion a aussi raconté ses souvenirs de lycéen tarbais dans « Le Pion ». Des scènes savoureuses et parfois en occitan (Michel Galabru est excellent). À noter une autre apparition, celle de notre chanteur local Edmond Duplan qui fait danser les acteurs principaux. Henri Genès tient un rôle formidable de curé bigourdan. Un bel hymne à la Bigorre qui fait passer de très bons moments. Et c’est après avoir vu « Le pion (1978) » que Claude Zidi eut l’idée de réaliser le film humoristique « Les Sous-doués », sorti en 1980, avec Daniel Auteuil, Maria Pacôme, Tonie Marshall, Michel Galabru, Philippe Taccini, Hubert Deschamps, Catherine Erhardy, Raymond Bussières...
Christian GION, né à Lourdes le 10 mars 1940. Lycéen à Théophile Gautier à Tarbes, puis diplômé d’HEC, il est devenu sur le tard, metteur en scène. Il fait partie des réalisateurs de comédies populaires des années 1980. Sans atteindre les sommets de Claude Zidi, il a réalisé quelques gros succès. On lui doit de nombreux films « commerciaux » à tendance humoristique et aux titres évocateurs : C’est dur pour tout le monde (1975) avec Claude Piéplu, Le Pion (1978) avec Michel Galabru, J’ai rencontré le Père Noël (1983), Le Gagnant avec Michel Galabru et Stéphane Audran, Le Provincial (1990) avec Roland Giraud, dont l’action se passe en partie dans le Lavedan, Les Insaisissables (2000) avec Daniel Prévost. Le Pion reste une fable pleine d'optimisme et le meilleur film de Gion. Le plus connu et qui passe de temps en temps à la télévision est sans conteste Pétrole ! Pétrole ! (1981) avec J.-P. Marielle, B. Blier et H. Guybet, ayant reçu un certain succès ; le gag de l’avion avec le terrain de tennis sur lequel jouent des Arabes coiffés de leur keffieh et qui s’ouvre brusquement pour faire place à une piscine est restée dans de nombreuses mémoires ; comme la scène de la prière sur des tapis qui se tournent en permanence vers la Mecque, selon les directions que prenait l’avion. Surfant sur la mode Les Sous-doués réalisé par Claude Zidi, il livre Les Diplômés du dernier rang. Pour l'occasion, il réutilise Michel Galabru (présent dans le film de Zidi), et fait débuter Patrick Bruel. Le film connaît un certain succès, tout comme Le Bourreau des cœurs, reposant uniquement sur le personnage d'Aldo (la classe) Maccione. Il avait projeté en 1993, de faire un film sur la vie de Bernadette en Omnimax. À ses débuts, il avait réalisé un petit film sur les sanctuaires et les pèlerinages de Lourdes. Il a été projeté lors des journées du cinéma à Lourdes (Lourdes au Cinéma, 2010). À la demande du maire Philippe Douste-Blazy, il accepte en 1996 de reprendre en tant que président l’équipe de rugby de Lourdes (FCL) pendant les saisons 1996-1997 et 1997-1998. Michel Crauste prendra sa succession. Il est président de Lapaca production (film). Comme réalisateur il a produit de nombreux films comme : « Les Encerclés », avec Jacques Higelin, Brigitte Fontaine, Rufus (1967) ; « Les Couples du Bois de Boulogne » (réalisé sous le nom de Bernard Legrand) avec Philippe Gasté, Anne Libert (1974) ; « C'est dur pour tout le monde » avec Bernard Blier, Francis Perrin (1975) ; « Le Jardin des supplices », avec Roger Van Hool, Jacqueline Kerry (1976) ; « Superwoman » (réalisé sous le nom de Romain Pacy) (1976) ; « One, Two, Two : 122, rue de Provence », avec Francis Huster, Nicole Calfan (1977) ; « Le Pion » avec Henri Guybet, Claude Jade, Maureen Kerwin (1978) ; « Le Gagnant » avec Philippe Ruggieri, Michel Galabru (1979) ; « Pétrole ! Pétrole ! » avec Jean-Pierre Marielle, Bernard Blier (1981) ; « Les Diplômés du dernier rang » avec Patrick Bruel, Marie Laforêt, Michel Galabru (1982) ; « Le Bourreau des cœurs » avec Aldo Maccione, Anna Maria Rizzoli (1983) ; « J'ai rencontré le Père Noël » avec Karen Cheryl, Armand Meffre (1984) ; « Pizzaiolo et Mozzarel » avec Aldo Maccione, Marthe Villalonga (1985) ; « Le Provincial » avec Roland Giraud, Gabrielle Lazure (1989) ; « Sup de fric » avec Jean Poiret, Anthony Delon, Valérie Mairesse (1992) ; « Les Insaisissables » avec Daniel Prévost, Dominique Guillo (1999). Comme acteur, il a joué dans : « Association de malfaiteurs » de Claude Zidi (Le rôle de présentateur à la soirée HEC) (1987) ; « Profil bas » de Claude Zidi (le rôle du directeur de l'hôpital) (1993) ; « Ripoux 3 » de Claude Zidi (rôle du gérant de la guinguette) (2003). Christian Gion commence sa carrière comme d'autres, à tourner des films un peu chauds dans le milieu des années 1970, tels « Les couples du bois de Boulogne » ou « Le Jardin des supplices ». Prenant ensuite conscience de son potentiel comique, il se lance un objectif : faire marrer le public français. Il réalisera une douzaine de films dits "drôles" qui, faute de faire rire la France entière, feront passer de bons moments aux spectateurs. On retiendra entre autres son film pyrénéen « Le Provincial » avec Roland Giraud, Maurice Vaudaux, Gabrielle Lazure et Michel Galabru, qui se cache derrière ce pitch qui fait rêver : « Bernard vit heureux dans son petit village des Pyrénées, où il passe son temps à faire visiter aux touristes ce coin qu'il aime tant. Nathalie, elle, connaît la folie de la vie parisienne. Partie tourner un film publicitaire, elle rencontre Bernard dans son milieu, puis l'emmène à Paris pour la suite du film... » Un film tourné entre Gavarnie et Lourdes pour moitié et l’autre partie à Paris. On reconnaît bien les communes de Chèze, Ouzous, Arcizac-ez-Angles. Des scènes au Donjon des Aigles à Beaucens et au stade de rugby de Lourdes, où on aperçoit dans les vestiaires Hueber, Garuet, Rancoule, Armary ainsi que les joueurs de l’époque. L’idée de ce film lui était venue à partir de l’expérience de Jean-Sébastien Gion, un universitaire Bigourdan, créateur de la Maison de la Découverte Pyrénéenne à Bagnères-de-Bigorre. Engagé comme assistant technique du film « Le Provincial (1989) » et participant très efficacement au tournage, c’est Roland Giraud qui incarne son personnage dans le film. Christian Gion a aussi raconté ses souvenirs de lycéen tarbais dans « Le Pion ». Des scènes savoureuses et parfois en occitan (Michel Galabru est excellent). À noter une autre apparition, celle de notre chanteur local Edmond Duplan qui fait danser les acteurs principaux. Henri Genès tient un rôle formidable de curé bigourdan. Un bel hymne à la Bigorre qui fait passer de très bons moments. Et c’est après avoir vu « Le pion (1978) » que Claude Zidi eut l’idée de réaliser le film humoristique « Les Sous-doués », sorti en 1980, avec Daniel Auteuil, Maria Pacôme, Tonie Marshall, Michel Galabru, Philippe Taccini, Hubert Deschamps, Catherine Erhardy, Raymond Bussières...
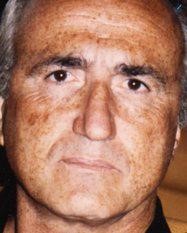 Christian GION, né à Lourdes le 10 mars 1940. Lycéen à Théophile Gautier à Tarbes, puis diplômé d’HEC, il est devenu sur le tard, metteur en scène. Il fait partie des réalisateurs de comédies populaires des années 1980. Sans atteindre les sommets de Claude Zidi, il a réalisé quelques gros succès. On lui doit de nombreux films « commerciaux » à tendance humoristique et aux titres évocateurs : C’est dur pour tout le monde (1975) avec Claude Piéplu, Le Pion (1978) avec Michel Galabru, J’ai rencontré le Père Noël (1983), Le Gagnant avec Michel Galabru et Stéphane Audran, Le Provincial (1990) avec Roland Giraud, dont l’action se passe en partie dans le Lavedan, Les Insaisissables (2000) avec Daniel Prévost. Le Pion reste une fable pleine d'optimisme et le meilleur film de Gion. Le plus connu et qui passe de temps en temps à la télévision est sans conteste Pétrole ! Pétrole ! (1981) avec J.-P. Marielle, B. Blier et H. Guybet, ayant reçu un certain succès ; le gag de l’avion avec le terrain de tennis sur lequel jouent des Arabes coiffés de leur keffieh et qui s’ouvre brusquement pour faire place à une piscine est restée dans de nombreuses mémoires ; comme la scène de la prière sur des tapis qui se tournent en permanence vers la Mecque, selon les directions que prenait l’avion. Surfant sur la mode Les Sous-doués réalisé par Claude Zidi, il livre Les Diplômés du dernier rang. Pour l'occasion, il réutilise Michel Galabru (présent dans le film de Zidi), et fait débuter Patrick Bruel. Le film connaît un certain succès, tout comme Le Bourreau des cœurs, reposant uniquement sur le personnage d'Aldo (la classe) Maccione. Il avait projeté en 1993, de faire un film sur la vie de Bernadette en Omnimax. À ses débuts, il avait réalisé un petit film sur les sanctuaires et les pèlerinages de Lourdes. Il a été projeté lors des journées du cinéma à Lourdes (Lourdes au Cinéma, 2010). À la demande du maire Philippe Douste-Blazy, il accepte en 1996 de reprendre en tant que président l’équipe de rugby de Lourdes (FCL) pendant les saisons 1996-1997 et 1997-1998. Michel Crauste prendra sa succession. Il est président de Lapaca production (film). Comme réalisateur il a produit de nombreux films comme : « Les Encerclés », avec Jacques Higelin, Brigitte Fontaine, Rufus (1967) ; « Les Couples du Bois de Boulogne » (réalisé sous le nom de Bernard Legrand) avec Philippe Gasté, Anne Libert (1974) ; « C'est dur pour tout le monde » avec Bernard Blier, Francis Perrin (1975) ; « Le Jardin des supplices », avec Roger Van Hool, Jacqueline Kerry (1976) ; « Superwoman » (réalisé sous le nom de Romain Pacy) (1976) ; « One, Two, Two : 122, rue de Provence », avec Francis Huster, Nicole Calfan (1977) ; « Le Pion » avec Henri Guybet, Claude Jade, Maureen Kerwin (1978) ; « Le Gagnant » avec Philippe Ruggieri, Michel Galabru (1979) ; « Pétrole ! Pétrole ! » avec Jean-Pierre Marielle, Bernard Blier (1981) ; « Les Diplômés du dernier rang » avec Patrick Bruel, Marie Laforêt, Michel Galabru (1982) ; « Le Bourreau des cœurs » avec Aldo Maccione, Anna Maria Rizzoli (1983) ; « J'ai rencontré le Père Noël » avec Karen Cheryl, Armand Meffre (1984) ; « Pizzaiolo et Mozzarel » avec Aldo Maccione, Marthe Villalonga (1985) ; « Le Provincial » avec Roland Giraud, Gabrielle Lazure (1989) ; « Sup de fric » avec Jean Poiret, Anthony Delon, Valérie Mairesse (1992) ; « Les Insaisissables » avec Daniel Prévost, Dominique Guillo (1999). Comme acteur, il a joué dans : « Association de malfaiteurs » de Claude Zidi (Le rôle de présentateur à la soirée HEC) (1987) ; « Profil bas » de Claude Zidi (le rôle du directeur de l'hôpital) (1993) ; « Ripoux 3 » de Claude Zidi (rôle du gérant de la guinguette) (2003). Christian Gion commence sa carrière comme d'autres, à tourner des films un peu chauds dans le milieu des années 1970, tels « Les couples du bois de Boulogne » ou « Le Jardin des supplices ». Prenant ensuite conscience de son potentiel comique, il se lance un objectif : faire marrer le public français. Il réalisera une douzaine de films dits "drôles" qui, faute de faire rire la France entière, feront passer de bons moments aux spectateurs. On retiendra entre autres son film pyrénéen « Le Provincial » avec Roland Giraud, Maurice Vaudaux, Gabrielle Lazure et Michel Galabru, qui se cache derrière ce pitch qui fait rêver : « Bernard vit heureux dans son petit village des Pyrénées, où il passe son temps à faire visiter aux touristes ce coin qu'il aime tant. Nathalie, elle, connaît la folie de la vie parisienne. Partie tourner un film publicitaire, elle rencontre Bernard dans son milieu, puis l'emmène à Paris pour la suite du film... » Un film tourné entre Gavarnie et Lourdes pour moitié et l’autre partie à Paris. On reconnaît bien les communes de Chèze, Ouzous, Arcizac-ez-Angles. Des scènes au Donjon des Aigles à Beaucens et au stade de rugby de Lourdes, où on aperçoit dans les vestiaires Hueber, Garuet, Rancoule, Armary ainsi que les joueurs de l’époque. L’idée de ce film lui était venue à partir de l’expérience de Jean-Sébastien Gion, un universitaire Bigourdan, créateur de la Maison de la Découverte Pyrénéenne à Bagnères-de-Bigorre. Engagé comme assistant technique du film « Le Provincial (1989) » et participant très efficacement au tournage, c’est Roland Giraud qui incarne son personnage dans le film. Christian Gion a aussi raconté ses souvenirs de lycéen tarbais dans « Le Pion ». Des scènes savoureuses et parfois en occitan (Michel Galabru est excellent). À noter une autre apparition, celle de notre chanteur local Edmond Duplan qui fait danser les acteurs principaux. Henri Genès tient un rôle formidable de curé bigourdan. Un bel hymne à la Bigorre qui fait passer de très bons moments. Et c’est après avoir vu « Le pion (1978) » que Claude Zidi eut l’idée de réaliser le film humoristique « Les Sous-doués », sorti en 1980, avec Daniel Auteuil, Maria Pacôme, Tonie Marshall, Michel Galabru, Philippe Taccini, Hubert Deschamps, Catherine Erhardy, Raymond Bussières...
Christian GION, né à Lourdes le 10 mars 1940. Lycéen à Théophile Gautier à Tarbes, puis diplômé d’HEC, il est devenu sur le tard, metteur en scène. Il fait partie des réalisateurs de comédies populaires des années 1980. Sans atteindre les sommets de Claude Zidi, il a réalisé quelques gros succès. On lui doit de nombreux films « commerciaux » à tendance humoristique et aux titres évocateurs : C’est dur pour tout le monde (1975) avec Claude Piéplu, Le Pion (1978) avec Michel Galabru, J’ai rencontré le Père Noël (1983), Le Gagnant avec Michel Galabru et Stéphane Audran, Le Provincial (1990) avec Roland Giraud, dont l’action se passe en partie dans le Lavedan, Les Insaisissables (2000) avec Daniel Prévost. Le Pion reste une fable pleine d'optimisme et le meilleur film de Gion. Le plus connu et qui passe de temps en temps à la télévision est sans conteste Pétrole ! Pétrole ! (1981) avec J.-P. Marielle, B. Blier et H. Guybet, ayant reçu un certain succès ; le gag de l’avion avec le terrain de tennis sur lequel jouent des Arabes coiffés de leur keffieh et qui s’ouvre brusquement pour faire place à une piscine est restée dans de nombreuses mémoires ; comme la scène de la prière sur des tapis qui se tournent en permanence vers la Mecque, selon les directions que prenait l’avion. Surfant sur la mode Les Sous-doués réalisé par Claude Zidi, il livre Les Diplômés du dernier rang. Pour l'occasion, il réutilise Michel Galabru (présent dans le film de Zidi), et fait débuter Patrick Bruel. Le film connaît un certain succès, tout comme Le Bourreau des cœurs, reposant uniquement sur le personnage d'Aldo (la classe) Maccione. Il avait projeté en 1993, de faire un film sur la vie de Bernadette en Omnimax. À ses débuts, il avait réalisé un petit film sur les sanctuaires et les pèlerinages de Lourdes. Il a été projeté lors des journées du cinéma à Lourdes (Lourdes au Cinéma, 2010). À la demande du maire Philippe Douste-Blazy, il accepte en 1996 de reprendre en tant que président l’équipe de rugby de Lourdes (FCL) pendant les saisons 1996-1997 et 1997-1998. Michel Crauste prendra sa succession. Il est président de Lapaca production (film). Comme réalisateur il a produit de nombreux films comme : « Les Encerclés », avec Jacques Higelin, Brigitte Fontaine, Rufus (1967) ; « Les Couples du Bois de Boulogne » (réalisé sous le nom de Bernard Legrand) avec Philippe Gasté, Anne Libert (1974) ; « C'est dur pour tout le monde » avec Bernard Blier, Francis Perrin (1975) ; « Le Jardin des supplices », avec Roger Van Hool, Jacqueline Kerry (1976) ; « Superwoman » (réalisé sous le nom de Romain Pacy) (1976) ; « One, Two, Two : 122, rue de Provence », avec Francis Huster, Nicole Calfan (1977) ; « Le Pion » avec Henri Guybet, Claude Jade, Maureen Kerwin (1978) ; « Le Gagnant » avec Philippe Ruggieri, Michel Galabru (1979) ; « Pétrole ! Pétrole ! » avec Jean-Pierre Marielle, Bernard Blier (1981) ; « Les Diplômés du dernier rang » avec Patrick Bruel, Marie Laforêt, Michel Galabru (1982) ; « Le Bourreau des cœurs » avec Aldo Maccione, Anna Maria Rizzoli (1983) ; « J'ai rencontré le Père Noël » avec Karen Cheryl, Armand Meffre (1984) ; « Pizzaiolo et Mozzarel » avec Aldo Maccione, Marthe Villalonga (1985) ; « Le Provincial » avec Roland Giraud, Gabrielle Lazure (1989) ; « Sup de fric » avec Jean Poiret, Anthony Delon, Valérie Mairesse (1992) ; « Les Insaisissables » avec Daniel Prévost, Dominique Guillo (1999). Comme acteur, il a joué dans : « Association de malfaiteurs » de Claude Zidi (Le rôle de présentateur à la soirée HEC) (1987) ; « Profil bas » de Claude Zidi (le rôle du directeur de l'hôpital) (1993) ; « Ripoux 3 » de Claude Zidi (rôle du gérant de la guinguette) (2003). Christian Gion commence sa carrière comme d'autres, à tourner des films un peu chauds dans le milieu des années 1970, tels « Les couples du bois de Boulogne » ou « Le Jardin des supplices ». Prenant ensuite conscience de son potentiel comique, il se lance un objectif : faire marrer le public français. Il réalisera une douzaine de films dits "drôles" qui, faute de faire rire la France entière, feront passer de bons moments aux spectateurs. On retiendra entre autres son film pyrénéen « Le Provincial » avec Roland Giraud, Maurice Vaudaux, Gabrielle Lazure et Michel Galabru, qui se cache derrière ce pitch qui fait rêver : « Bernard vit heureux dans son petit village des Pyrénées, où il passe son temps à faire visiter aux touristes ce coin qu'il aime tant. Nathalie, elle, connaît la folie de la vie parisienne. Partie tourner un film publicitaire, elle rencontre Bernard dans son milieu, puis l'emmène à Paris pour la suite du film... » Un film tourné entre Gavarnie et Lourdes pour moitié et l’autre partie à Paris. On reconnaît bien les communes de Chèze, Ouzous, Arcizac-ez-Angles. Des scènes au Donjon des Aigles à Beaucens et au stade de rugby de Lourdes, où on aperçoit dans les vestiaires Hueber, Garuet, Rancoule, Armary ainsi que les joueurs de l’époque. L’idée de ce film lui était venue à partir de l’expérience de Jean-Sébastien Gion, un universitaire Bigourdan, créateur de la Maison de la Découverte Pyrénéenne à Bagnères-de-Bigorre. Engagé comme assistant technique du film « Le Provincial (1989) » et participant très efficacement au tournage, c’est Roland Giraud qui incarne son personnage dans le film. Christian Gion a aussi raconté ses souvenirs de lycéen tarbais dans « Le Pion ». Des scènes savoureuses et parfois en occitan (Michel Galabru est excellent). À noter une autre apparition, celle de notre chanteur local Edmond Duplan qui fait danser les acteurs principaux. Henri Genès tient un rôle formidable de curé bigourdan. Un bel hymne à la Bigorre qui fait passer de très bons moments. Et c’est après avoir vu « Le pion (1978) » que Claude Zidi eut l’idée de réaliser le film humoristique « Les Sous-doués », sorti en 1980, avec Daniel Auteuil, Maria Pacôme, Tonie Marshall, Michel Galabru, Philippe Taccini, Hubert Deschamps, Catherine Erhardy, Raymond Bussières...GLAVANY Jean (1949-XXXX)
Homme politique et avocat
 Jean GLAVANY, né le 14 mai 1949 à Sceaux dans les Hauts-de-Seine est un homme politique et un avocat français. Fils de Roland Glavany, grande figure de l'armée de l'air et de l'aviation, il est licencié en sociologie et en sciences économiques, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, et titulaire d'un doctorat d'économie urbaine. Proche collaborateur de François Mitterrand, il fut son chef de cabinet de 1981 à 1988, lors de son premier septennat présidentiel. Nommé préfet hors cadre de 1988 à 1992, il sera chargé comme délégué de l'organisation des Jeux olympiques d’hiver d'Albertville. De 1988 à 2011, il sera successivement maire de Maubourguet (1989-1995, 1995-2001), conseiller régional de Midi-Pyrénées (1992-1993), vice-président du Conseil général des Hautes-Pyrénées (1992-2002 – canton de Maubourguet), président du Grand Tarbes (2001-2008), conseiller municipal de Tarbes (2008-2011) et conseiller général du canton d’Aureilhan depuis 2011 et réélu conseiller départemental en 2015. Après avoir échoué aux législatives de 1988, il sera député pendant vingt ans, élu à cinq reprises dans les Hautes-Pyrénées. Député de la 3ème circonscription des Hautes-Pyrénées (1993-1997, 1997-1998, 2002-2007, 2007-2012) puis député de la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées (2012-2017). En 1991, il exercera en tant que maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris. En 1992, maire de Maubourguet depuis trois ans, il est nommé secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique auprès du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Culture dans le gouvernement Pierre Bérégovoy (1992-1993), puis il fut ministre de l'Agriculture et de la Pêche lors du retour de la gauche au pouvoir dans le gouvernement Jospin (1998-2002). Succédant le 20 octobre 1998 à Louis Le Pensec au ministère de l'Agriculture, rue de Varenne, pendant trois ans, il aura eu à gérer les dossiers difficiles de la vache folle et de la fièvre aphteuse. Après la défaite de Lionel Jospin à l'élection présidentielle d'avril 2002, dont il était le directeur de campagne, il redevient député des Hautes-Pyrénées lors des législatives qui suivent. Jean Glavany est entré au PS en 1973, et sa carrière politique démarre réellement à Issy-les-Moulineaux, où il fait plusieurs fois acte de candidature : en 1977 à l’occasion des municipales, en 1978 pour une municipale partielle et en 1979 lorsque François Mitterrand vient le soutenir aux élections cantonales. A chaque fois sans succès. De nouveau candidat en 1983, cette fois-ci comme tête de liste, il devient conseiller municipal d’opposition. En 1979, le Premier secrétaire du Parti socialiste François Mitterrand décide alors de faire de lui un de ses plus proches collaborateurs. Il sera délégué général auprès du premier secrétaire du PS de 1979 à 1981. En mai 1981, il fera partie de « l’antenne présidentielle » qui, dès le lendemain de l’élection, a préparé la passation de pouvoir entre Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand. Il sera son chef de cabinet lorsque celui-ci accède à la présidence de la République en mai 1981 et le restera tout au long du premier septennat (1981-1988). En 1986, il s’installe dans les Hautes-Pyrénées et devient rapidement une figure du paysage politique local. De 1993 à 1998 puis de 2002 à 2012, Jean Glavany sera député de la 3ème circonscription des Hautes-Pyrénées. En 1998, il entrera au gouvernement Jospin comme ministre de l'Agriculture et de la pêche. Élu local, il siège un an (1992-1993) au Conseil régional de Midi-Pyrénées. Élu également en 1992 au Conseil général des Hautes-Pyrénées, il en assurera la vice-présidence pendant 10 ans. En 2001, en seconde position sur la liste de Pierre Dussert, il devient adjoint au maire d’Aureilhan. Président du Grand Tarbes (2001-2008), il annonce le 21 septembre 2007 dans « La Nouvelle République des Pyrénées », qu'il se présente aux élections municipales à Tarbes. La liste "Construisons l'avenir de Tarbes" qu'il conduit à cette occasion recueille 38,32 % des voix lors du premier tour du scrutin le 9 mars 2008, et accuse un retard de 9,1 points face à son adversaire Gérard Trémège, maire UMP sortant (47,42 % des voix). Il est finalement battu au second tour de l'élection municipale de Tarbes, le 16 mars 2008, ne recueillant que 45,66 % des suffrages contre 54,34% pour la liste conduite par Gérard Trémège. Il fait le choix de siéger dans l'opposition municipale par respect pour les électeurs lui ayant accordé leur confiance. Le 27 mars 2011, il est élu conseiller général du canton d’Aureilhan. Le 14 avril 2011, il annonce qu'il démissionne du conseil municipal de Tarbes afin de ne pas cumuler avec son mandat de conseiller général. Député des Hautes-Pyrénées, il est de nouveau élu en 2012 mais dans la 1ère circonscription. Il est "Secrétaire national à la laïcité" dans le bureau du Parti socialiste. En 2012, il est candidat à la présidence de l'Assemblée nationale, face à Claude Bartolone, Élisabeth Guigou, tous deux élus de Seine-Saint-Denis et Daniel Vaillant, député de Paris. Arrivé second à l'issue du premier tour de vote, derrière Claude Bartolone, il se retire au profit de ce dernier. En mars 2015, il est élu conseiller départemental du canton d'Aureilhan en tandem avec Geneviève Isson. En 2017, investi par le Parti Socialiste, il affirme soutenir le Président Emmanuel Macron tout en se présentant contre son candidat officiel, Jean-Bernard Sempastous, désigné par La République En Marche (LREM). Jean Glavany est éliminé dès le premier tour dans les Hautes-Pyrénées avec 14,61 % des voix contre 43,15 % pour Jean-Bernard Sempastous, qui arrive en tête. Jean Glavany est membre du Conseil d'administration de l'association des amis de l'Institut François-Mitterrand. Il est aussi co-fondateur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), qui récolte des fonds pour la recherche, aux côtés du professeur Gérard Saillant et de Jean Todt, et président de la Fondation Un cœur. Commandeur de l'ordre du Mérite maritime ex officio, en tant que ministre chargé des Affaires maritimes, Jean Glavany a été promu chevalier de la Légion d'honneur le 1er janvier 2020 pour 44 ans au service de la nation. Il est par ailleurs l’auteur de nombreux ouvrages « Sport et Socialisme – 1981 » avec Dominique Duvauchelle, « Vers la nouvelle République, ou Comment moderniser la constitution – 1991 », « Mitterrand, Jospin et nous – 1998 », « Politique folle – 2001 », « Le cap et la route – 2005 » avec Claude Sérillon, « A fleur d'îles – 2009 » avec François Cante-Pacos, « La laïcité : un combat pour la paix – 2011 », « La mer est toujours ronde – 2014 ». Comme membre de la Commission des Affaires étrangères (2002-2017), il est l'auteur de nombreux rapports et notamment de « L'Afghanistan, un chemin pour la paix » avec Henri Plagnol en 2009 », puis « La géopolitique de l'eau » en 2011. Il sera également président du groupe Amitié France-Afrique du Sud, et membre de la Commission nationale du Secret Défense. En 2013, il sera membre de l'Observatoire de la Laïcité, mis en place par le Président de la République. Membre du Parti socialiste depuis 1973, il a été porte-parole du mouvement de 1993 à 1995 sous Laurent Fabius, Michel Rocard et Henri Emmanuelli et à plusieurs reprises secrétaire national. Depuis 2010, il est avocat auprès du barreau de Paris. Il est aussi le père de trois enfants, dont deux fils rugbymen et une fille qui joue au volley. Passionné de rugby, de navigation, de voile, de plongée sous-marine et de danse, ce Bigourdan de cœur aura marqué de sa notoriété le panorama politique des Hautes-Pyrénées, durant ces trente dernières années, avec une franchise qui plaît au monde rural.
Jean GLAVANY, né le 14 mai 1949 à Sceaux dans les Hauts-de-Seine est un homme politique et un avocat français. Fils de Roland Glavany, grande figure de l'armée de l'air et de l'aviation, il est licencié en sociologie et en sciences économiques, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, et titulaire d'un doctorat d'économie urbaine. Proche collaborateur de François Mitterrand, il fut son chef de cabinet de 1981 à 1988, lors de son premier septennat présidentiel. Nommé préfet hors cadre de 1988 à 1992, il sera chargé comme délégué de l'organisation des Jeux olympiques d’hiver d'Albertville. De 1988 à 2011, il sera successivement maire de Maubourguet (1989-1995, 1995-2001), conseiller régional de Midi-Pyrénées (1992-1993), vice-président du Conseil général des Hautes-Pyrénées (1992-2002 – canton de Maubourguet), président du Grand Tarbes (2001-2008), conseiller municipal de Tarbes (2008-2011) et conseiller général du canton d’Aureilhan depuis 2011 et réélu conseiller départemental en 2015. Après avoir échoué aux législatives de 1988, il sera député pendant vingt ans, élu à cinq reprises dans les Hautes-Pyrénées. Député de la 3ème circonscription des Hautes-Pyrénées (1993-1997, 1997-1998, 2002-2007, 2007-2012) puis député de la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées (2012-2017). En 1991, il exercera en tant que maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris. En 1992, maire de Maubourguet depuis trois ans, il est nommé secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique auprès du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Culture dans le gouvernement Pierre Bérégovoy (1992-1993), puis il fut ministre de l'Agriculture et de la Pêche lors du retour de la gauche au pouvoir dans le gouvernement Jospin (1998-2002). Succédant le 20 octobre 1998 à Louis Le Pensec au ministère de l'Agriculture, rue de Varenne, pendant trois ans, il aura eu à gérer les dossiers difficiles de la vache folle et de la fièvre aphteuse. Après la défaite de Lionel Jospin à l'élection présidentielle d'avril 2002, dont il était le directeur de campagne, il redevient député des Hautes-Pyrénées lors des législatives qui suivent. Jean Glavany est entré au PS en 1973, et sa carrière politique démarre réellement à Issy-les-Moulineaux, où il fait plusieurs fois acte de candidature : en 1977 à l’occasion des municipales, en 1978 pour une municipale partielle et en 1979 lorsque François Mitterrand vient le soutenir aux élections cantonales. A chaque fois sans succès. De nouveau candidat en 1983, cette fois-ci comme tête de liste, il devient conseiller municipal d’opposition. En 1979, le Premier secrétaire du Parti socialiste François Mitterrand décide alors de faire de lui un de ses plus proches collaborateurs. Il sera délégué général auprès du premier secrétaire du PS de 1979 à 1981. En mai 1981, il fera partie de « l’antenne présidentielle » qui, dès le lendemain de l’élection, a préparé la passation de pouvoir entre Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand. Il sera son chef de cabinet lorsque celui-ci accède à la présidence de la République en mai 1981 et le restera tout au long du premier septennat (1981-1988). En 1986, il s’installe dans les Hautes-Pyrénées et devient rapidement une figure du paysage politique local. De 1993 à 1998 puis de 2002 à 2012, Jean Glavany sera député de la 3ème circonscription des Hautes-Pyrénées. En 1998, il entrera au gouvernement Jospin comme ministre de l'Agriculture et de la pêche. Élu local, il siège un an (1992-1993) au Conseil régional de Midi-Pyrénées. Élu également en 1992 au Conseil général des Hautes-Pyrénées, il en assurera la vice-présidence pendant 10 ans. En 2001, en seconde position sur la liste de Pierre Dussert, il devient adjoint au maire d’Aureilhan. Président du Grand Tarbes (2001-2008), il annonce le 21 septembre 2007 dans « La Nouvelle République des Pyrénées », qu'il se présente aux élections municipales à Tarbes. La liste "Construisons l'avenir de Tarbes" qu'il conduit à cette occasion recueille 38,32 % des voix lors du premier tour du scrutin le 9 mars 2008, et accuse un retard de 9,1 points face à son adversaire Gérard Trémège, maire UMP sortant (47,42 % des voix). Il est finalement battu au second tour de l'élection municipale de Tarbes, le 16 mars 2008, ne recueillant que 45,66 % des suffrages contre 54,34% pour la liste conduite par Gérard Trémège. Il fait le choix de siéger dans l'opposition municipale par respect pour les électeurs lui ayant accordé leur confiance. Le 27 mars 2011, il est élu conseiller général du canton d’Aureilhan. Le 14 avril 2011, il annonce qu'il démissionne du conseil municipal de Tarbes afin de ne pas cumuler avec son mandat de conseiller général. Député des Hautes-Pyrénées, il est de nouveau élu en 2012 mais dans la 1ère circonscription. Il est "Secrétaire national à la laïcité" dans le bureau du Parti socialiste. En 2012, il est candidat à la présidence de l'Assemblée nationale, face à Claude Bartolone, Élisabeth Guigou, tous deux élus de Seine-Saint-Denis et Daniel Vaillant, député de Paris. Arrivé second à l'issue du premier tour de vote, derrière Claude Bartolone, il se retire au profit de ce dernier. En mars 2015, il est élu conseiller départemental du canton d'Aureilhan en tandem avec Geneviève Isson. En 2017, investi par le Parti Socialiste, il affirme soutenir le Président Emmanuel Macron tout en se présentant contre son candidat officiel, Jean-Bernard Sempastous, désigné par La République En Marche (LREM). Jean Glavany est éliminé dès le premier tour dans les Hautes-Pyrénées avec 14,61 % des voix contre 43,15 % pour Jean-Bernard Sempastous, qui arrive en tête. Jean Glavany est membre du Conseil d'administration de l'association des amis de l'Institut François-Mitterrand. Il est aussi co-fondateur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), qui récolte des fonds pour la recherche, aux côtés du professeur Gérard Saillant et de Jean Todt, et président de la Fondation Un cœur. Commandeur de l'ordre du Mérite maritime ex officio, en tant que ministre chargé des Affaires maritimes, Jean Glavany a été promu chevalier de la Légion d'honneur le 1er janvier 2020 pour 44 ans au service de la nation. Il est par ailleurs l’auteur de nombreux ouvrages « Sport et Socialisme – 1981 » avec Dominique Duvauchelle, « Vers la nouvelle République, ou Comment moderniser la constitution – 1991 », « Mitterrand, Jospin et nous – 1998 », « Politique folle – 2001 », « Le cap et la route – 2005 » avec Claude Sérillon, « A fleur d'îles – 2009 » avec François Cante-Pacos, « La laïcité : un combat pour la paix – 2011 », « La mer est toujours ronde – 2014 ». Comme membre de la Commission des Affaires étrangères (2002-2017), il est l'auteur de nombreux rapports et notamment de « L'Afghanistan, un chemin pour la paix » avec Henri Plagnol en 2009 », puis « La géopolitique de l'eau » en 2011. Il sera également président du groupe Amitié France-Afrique du Sud, et membre de la Commission nationale du Secret Défense. En 2013, il sera membre de l'Observatoire de la Laïcité, mis en place par le Président de la République. Membre du Parti socialiste depuis 1973, il a été porte-parole du mouvement de 1993 à 1995 sous Laurent Fabius, Michel Rocard et Henri Emmanuelli et à plusieurs reprises secrétaire national. Depuis 2010, il est avocat auprès du barreau de Paris. Il est aussi le père de trois enfants, dont deux fils rugbymen et une fille qui joue au volley. Passionné de rugby, de navigation, de voile, de plongée sous-marine et de danse, ce Bigourdan de cœur aura marqué de sa notoriété le panorama politique des Hautes-Pyrénées, durant ces trente dernières années, avec une franchise qui plaît au monde rural.
 Jean GLAVANY, né le 14 mai 1949 à Sceaux dans les Hauts-de-Seine est un homme politique et un avocat français. Fils de Roland Glavany, grande figure de l'armée de l'air et de l'aviation, il est licencié en sociologie et en sciences économiques, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, et titulaire d'un doctorat d'économie urbaine. Proche collaborateur de François Mitterrand, il fut son chef de cabinet de 1981 à 1988, lors de son premier septennat présidentiel. Nommé préfet hors cadre de 1988 à 1992, il sera chargé comme délégué de l'organisation des Jeux olympiques d’hiver d'Albertville. De 1988 à 2011, il sera successivement maire de Maubourguet (1989-1995, 1995-2001), conseiller régional de Midi-Pyrénées (1992-1993), vice-président du Conseil général des Hautes-Pyrénées (1992-2002 – canton de Maubourguet), président du Grand Tarbes (2001-2008), conseiller municipal de Tarbes (2008-2011) et conseiller général du canton d’Aureilhan depuis 2011 et réélu conseiller départemental en 2015. Après avoir échoué aux législatives de 1988, il sera député pendant vingt ans, élu à cinq reprises dans les Hautes-Pyrénées. Député de la 3ème circonscription des Hautes-Pyrénées (1993-1997, 1997-1998, 2002-2007, 2007-2012) puis député de la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées (2012-2017). En 1991, il exercera en tant que maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris. En 1992, maire de Maubourguet depuis trois ans, il est nommé secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique auprès du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Culture dans le gouvernement Pierre Bérégovoy (1992-1993), puis il fut ministre de l'Agriculture et de la Pêche lors du retour de la gauche au pouvoir dans le gouvernement Jospin (1998-2002). Succédant le 20 octobre 1998 à Louis Le Pensec au ministère de l'Agriculture, rue de Varenne, pendant trois ans, il aura eu à gérer les dossiers difficiles de la vache folle et de la fièvre aphteuse. Après la défaite de Lionel Jospin à l'élection présidentielle d'avril 2002, dont il était le directeur de campagne, il redevient député des Hautes-Pyrénées lors des législatives qui suivent. Jean Glavany est entré au PS en 1973, et sa carrière politique démarre réellement à Issy-les-Moulineaux, où il fait plusieurs fois acte de candidature : en 1977 à l’occasion des municipales, en 1978 pour une municipale partielle et en 1979 lorsque François Mitterrand vient le soutenir aux élections cantonales. A chaque fois sans succès. De nouveau candidat en 1983, cette fois-ci comme tête de liste, il devient conseiller municipal d’opposition. En 1979, le Premier secrétaire du Parti socialiste François Mitterrand décide alors de faire de lui un de ses plus proches collaborateurs. Il sera délégué général auprès du premier secrétaire du PS de 1979 à 1981. En mai 1981, il fera partie de « l’antenne présidentielle » qui, dès le lendemain de l’élection, a préparé la passation de pouvoir entre Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand. Il sera son chef de cabinet lorsque celui-ci accède à la présidence de la République en mai 1981 et le restera tout au long du premier septennat (1981-1988). En 1986, il s’installe dans les Hautes-Pyrénées et devient rapidement une figure du paysage politique local. De 1993 à 1998 puis de 2002 à 2012, Jean Glavany sera député de la 3ème circonscription des Hautes-Pyrénées. En 1998, il entrera au gouvernement Jospin comme ministre de l'Agriculture et de la pêche. Élu local, il siège un an (1992-1993) au Conseil régional de Midi-Pyrénées. Élu également en 1992 au Conseil général des Hautes-Pyrénées, il en assurera la vice-présidence pendant 10 ans. En 2001, en seconde position sur la liste de Pierre Dussert, il devient adjoint au maire d’Aureilhan. Président du Grand Tarbes (2001-2008), il annonce le 21 septembre 2007 dans « La Nouvelle République des Pyrénées », qu'il se présente aux élections municipales à Tarbes. La liste "Construisons l'avenir de Tarbes" qu'il conduit à cette occasion recueille 38,32 % des voix lors du premier tour du scrutin le 9 mars 2008, et accuse un retard de 9,1 points face à son adversaire Gérard Trémège, maire UMP sortant (47,42 % des voix). Il est finalement battu au second tour de l'élection municipale de Tarbes, le 16 mars 2008, ne recueillant que 45,66 % des suffrages contre 54,34% pour la liste conduite par Gérard Trémège. Il fait le choix de siéger dans l'opposition municipale par respect pour les électeurs lui ayant accordé leur confiance. Le 27 mars 2011, il est élu conseiller général du canton d’Aureilhan. Le 14 avril 2011, il annonce qu'il démissionne du conseil municipal de Tarbes afin de ne pas cumuler avec son mandat de conseiller général. Député des Hautes-Pyrénées, il est de nouveau élu en 2012 mais dans la 1ère circonscription. Il est "Secrétaire national à la laïcité" dans le bureau du Parti socialiste. En 2012, il est candidat à la présidence de l'Assemblée nationale, face à Claude Bartolone, Élisabeth Guigou, tous deux élus de Seine-Saint-Denis et Daniel Vaillant, député de Paris. Arrivé second à l'issue du premier tour de vote, derrière Claude Bartolone, il se retire au profit de ce dernier. En mars 2015, il est élu conseiller départemental du canton d'Aureilhan en tandem avec Geneviève Isson. En 2017, investi par le Parti Socialiste, il affirme soutenir le Président Emmanuel Macron tout en se présentant contre son candidat officiel, Jean-Bernard Sempastous, désigné par La République En Marche (LREM). Jean Glavany est éliminé dès le premier tour dans les Hautes-Pyrénées avec 14,61 % des voix contre 43,15 % pour Jean-Bernard Sempastous, qui arrive en tête. Jean Glavany est membre du Conseil d'administration de l'association des amis de l'Institut François-Mitterrand. Il est aussi co-fondateur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), qui récolte des fonds pour la recherche, aux côtés du professeur Gérard Saillant et de Jean Todt, et président de la Fondation Un cœur. Commandeur de l'ordre du Mérite maritime ex officio, en tant que ministre chargé des Affaires maritimes, Jean Glavany a été promu chevalier de la Légion d'honneur le 1er janvier 2020 pour 44 ans au service de la nation. Il est par ailleurs l’auteur de nombreux ouvrages « Sport et Socialisme – 1981 » avec Dominique Duvauchelle, « Vers la nouvelle République, ou Comment moderniser la constitution – 1991 », « Mitterrand, Jospin et nous – 1998 », « Politique folle – 2001 », « Le cap et la route – 2005 » avec Claude Sérillon, « A fleur d'îles – 2009 » avec François Cante-Pacos, « La laïcité : un combat pour la paix – 2011 », « La mer est toujours ronde – 2014 ». Comme membre de la Commission des Affaires étrangères (2002-2017), il est l'auteur de nombreux rapports et notamment de « L'Afghanistan, un chemin pour la paix » avec Henri Plagnol en 2009 », puis « La géopolitique de l'eau » en 2011. Il sera également président du groupe Amitié France-Afrique du Sud, et membre de la Commission nationale du Secret Défense. En 2013, il sera membre de l'Observatoire de la Laïcité, mis en place par le Président de la République. Membre du Parti socialiste depuis 1973, il a été porte-parole du mouvement de 1993 à 1995 sous Laurent Fabius, Michel Rocard et Henri Emmanuelli et à plusieurs reprises secrétaire national. Depuis 2010, il est avocat auprès du barreau de Paris. Il est aussi le père de trois enfants, dont deux fils rugbymen et une fille qui joue au volley. Passionné de rugby, de navigation, de voile, de plongée sous-marine et de danse, ce Bigourdan de cœur aura marqué de sa notoriété le panorama politique des Hautes-Pyrénées, durant ces trente dernières années, avec une franchise qui plaît au monde rural.
Jean GLAVANY, né le 14 mai 1949 à Sceaux dans les Hauts-de-Seine est un homme politique et un avocat français. Fils de Roland Glavany, grande figure de l'armée de l'air et de l'aviation, il est licencié en sociologie et en sciences économiques, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, et titulaire d'un doctorat d'économie urbaine. Proche collaborateur de François Mitterrand, il fut son chef de cabinet de 1981 à 1988, lors de son premier septennat présidentiel. Nommé préfet hors cadre de 1988 à 1992, il sera chargé comme délégué de l'organisation des Jeux olympiques d’hiver d'Albertville. De 1988 à 2011, il sera successivement maire de Maubourguet (1989-1995, 1995-2001), conseiller régional de Midi-Pyrénées (1992-1993), vice-président du Conseil général des Hautes-Pyrénées (1992-2002 – canton de Maubourguet), président du Grand Tarbes (2001-2008), conseiller municipal de Tarbes (2008-2011) et conseiller général du canton d’Aureilhan depuis 2011 et réélu conseiller départemental en 2015. Après avoir échoué aux législatives de 1988, il sera député pendant vingt ans, élu à cinq reprises dans les Hautes-Pyrénées. Député de la 3ème circonscription des Hautes-Pyrénées (1993-1997, 1997-1998, 2002-2007, 2007-2012) puis député de la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées (2012-2017). En 1991, il exercera en tant que maître de conférences à l'Institut d'études politiques de Paris. En 1992, maire de Maubourguet depuis trois ans, il est nommé secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique auprès du ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et de la Culture dans le gouvernement Pierre Bérégovoy (1992-1993), puis il fut ministre de l'Agriculture et de la Pêche lors du retour de la gauche au pouvoir dans le gouvernement Jospin (1998-2002). Succédant le 20 octobre 1998 à Louis Le Pensec au ministère de l'Agriculture, rue de Varenne, pendant trois ans, il aura eu à gérer les dossiers difficiles de la vache folle et de la fièvre aphteuse. Après la défaite de Lionel Jospin à l'élection présidentielle d'avril 2002, dont il était le directeur de campagne, il redevient député des Hautes-Pyrénées lors des législatives qui suivent. Jean Glavany est entré au PS en 1973, et sa carrière politique démarre réellement à Issy-les-Moulineaux, où il fait plusieurs fois acte de candidature : en 1977 à l’occasion des municipales, en 1978 pour une municipale partielle et en 1979 lorsque François Mitterrand vient le soutenir aux élections cantonales. A chaque fois sans succès. De nouveau candidat en 1983, cette fois-ci comme tête de liste, il devient conseiller municipal d’opposition. En 1979, le Premier secrétaire du Parti socialiste François Mitterrand décide alors de faire de lui un de ses plus proches collaborateurs. Il sera délégué général auprès du premier secrétaire du PS de 1979 à 1981. En mai 1981, il fera partie de « l’antenne présidentielle » qui, dès le lendemain de l’élection, a préparé la passation de pouvoir entre Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand. Il sera son chef de cabinet lorsque celui-ci accède à la présidence de la République en mai 1981 et le restera tout au long du premier septennat (1981-1988). En 1986, il s’installe dans les Hautes-Pyrénées et devient rapidement une figure du paysage politique local. De 1993 à 1998 puis de 2002 à 2012, Jean Glavany sera député de la 3ème circonscription des Hautes-Pyrénées. En 1998, il entrera au gouvernement Jospin comme ministre de l'Agriculture et de la pêche. Élu local, il siège un an (1992-1993) au Conseil régional de Midi-Pyrénées. Élu également en 1992 au Conseil général des Hautes-Pyrénées, il en assurera la vice-présidence pendant 10 ans. En 2001, en seconde position sur la liste de Pierre Dussert, il devient adjoint au maire d’Aureilhan. Président du Grand Tarbes (2001-2008), il annonce le 21 septembre 2007 dans « La Nouvelle République des Pyrénées », qu'il se présente aux élections municipales à Tarbes. La liste "Construisons l'avenir de Tarbes" qu'il conduit à cette occasion recueille 38,32 % des voix lors du premier tour du scrutin le 9 mars 2008, et accuse un retard de 9,1 points face à son adversaire Gérard Trémège, maire UMP sortant (47,42 % des voix). Il est finalement battu au second tour de l'élection municipale de Tarbes, le 16 mars 2008, ne recueillant que 45,66 % des suffrages contre 54,34% pour la liste conduite par Gérard Trémège. Il fait le choix de siéger dans l'opposition municipale par respect pour les électeurs lui ayant accordé leur confiance. Le 27 mars 2011, il est élu conseiller général du canton d’Aureilhan. Le 14 avril 2011, il annonce qu'il démissionne du conseil municipal de Tarbes afin de ne pas cumuler avec son mandat de conseiller général. Député des Hautes-Pyrénées, il est de nouveau élu en 2012 mais dans la 1ère circonscription. Il est "Secrétaire national à la laïcité" dans le bureau du Parti socialiste. En 2012, il est candidat à la présidence de l'Assemblée nationale, face à Claude Bartolone, Élisabeth Guigou, tous deux élus de Seine-Saint-Denis et Daniel Vaillant, député de Paris. Arrivé second à l'issue du premier tour de vote, derrière Claude Bartolone, il se retire au profit de ce dernier. En mars 2015, il est élu conseiller départemental du canton d'Aureilhan en tandem avec Geneviève Isson. En 2017, investi par le Parti Socialiste, il affirme soutenir le Président Emmanuel Macron tout en se présentant contre son candidat officiel, Jean-Bernard Sempastous, désigné par La République En Marche (LREM). Jean Glavany est éliminé dès le premier tour dans les Hautes-Pyrénées avec 14,61 % des voix contre 43,15 % pour Jean-Bernard Sempastous, qui arrive en tête. Jean Glavany est membre du Conseil d'administration de l'association des amis de l'Institut François-Mitterrand. Il est aussi co-fondateur de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière (ICM), qui récolte des fonds pour la recherche, aux côtés du professeur Gérard Saillant et de Jean Todt, et président de la Fondation Un cœur. Commandeur de l'ordre du Mérite maritime ex officio, en tant que ministre chargé des Affaires maritimes, Jean Glavany a été promu chevalier de la Légion d'honneur le 1er janvier 2020 pour 44 ans au service de la nation. Il est par ailleurs l’auteur de nombreux ouvrages « Sport et Socialisme – 1981 » avec Dominique Duvauchelle, « Vers la nouvelle République, ou Comment moderniser la constitution – 1991 », « Mitterrand, Jospin et nous – 1998 », « Politique folle – 2001 », « Le cap et la route – 2005 » avec Claude Sérillon, « A fleur d'îles – 2009 » avec François Cante-Pacos, « La laïcité : un combat pour la paix – 2011 », « La mer est toujours ronde – 2014 ». Comme membre de la Commission des Affaires étrangères (2002-2017), il est l'auteur de nombreux rapports et notamment de « L'Afghanistan, un chemin pour la paix » avec Henri Plagnol en 2009 », puis « La géopolitique de l'eau » en 2011. Il sera également président du groupe Amitié France-Afrique du Sud, et membre de la Commission nationale du Secret Défense. En 2013, il sera membre de l'Observatoire de la Laïcité, mis en place par le Président de la République. Membre du Parti socialiste depuis 1973, il a été porte-parole du mouvement de 1993 à 1995 sous Laurent Fabius, Michel Rocard et Henri Emmanuelli et à plusieurs reprises secrétaire national. Depuis 2010, il est avocat auprès du barreau de Paris. Il est aussi le père de trois enfants, dont deux fils rugbymen et une fille qui joue au volley. Passionné de rugby, de navigation, de voile, de plongée sous-marine et de danse, ce Bigourdan de cœur aura marqué de sa notoriété le panorama politique des Hautes-Pyrénées, durant ces trente dernières années, avec une franchise qui plaît au monde rural.GOURSAU Henri (1950-XXXX)
Lexicographe, terminologue, éditeur et lauréat du Guinness des records
 Henri GOURSAU, né le 23 mars 1950 à Arrens-Marsous, est l’auteur d’une cinquantaine de dictionnaires utilisés dans le monde entier. Fils d’agriculteurs, il passe ses plus jeunes années à l’école communale et à aider ses parents aux travaux des champs. Après des études au collège d’Argelès-Gazost, au lycée Jean-Dupuy à Tarbes puis à l’université à Toulouse, il entre en 1972 chez Air France. Il fait ses premières armes à Orly dans la maintenance des réacteurs des avions Airbus, et se heurte à une difficulté qui sera le départ de la bible de l’aéronautique, "Le Goursau". "Les réacteurs étaient américains, produits par General Electric ou Pratt & Whitney et tous les manuels techniques étaient en anglais", raconte-t-il en rappelant le ballet des mécaniciens, des techniciens, des ingénieurs, d’un bureau à l’autre, pour tenter de traduire les directives. Il commence alors à noter sur un calepin des mots techniques anglais concernant tous les secteurs d’un avion, et leur traduction en français. Sa femme Monique les recopie le soir à la machine à écrire, après son travail et une fois les trois enfants couchés. Le calepin devient un énorme classeur au fur et à mesure des recherches interminables dans des livres, des magazines d’aviation, des manuels, ou auprès d’Air France, Matra, Dassault, Snias, Snecma, Latécoère, Cnes, Supaéro, Enac... "Je suis allé au bout, jusqu’à épuiser le sujet", se félicite-t-il. 20 000 heures lui furent néanmoins nécessaires pour sa réalisation. Il présente alors son manuscrit à Air France, qui le prend de haut. Il fait le tour des éditeurs, qui refusent de le recevoir. Mais si beaucoup auraient abandonné, lui jamais. Et puisque personne ne veut de son ouvrage, il le fera imprimer à compte d’auteur sur ses propres deniers. Aujourd’hui, le "Dictionnaire de l’aéronautique et de l’espace" est l’ouvrage de référence, qui a trouvé sa place dans les appareils d’Air France et de l’armée de l’air, les aéro-clubs, dans toutes les écoles et entreprises d’aviation, de France et de l’étranger, en salle de contrôle du centre spatial de Kourou et de Cap Canaveral. Ce livre est devenu la pierre angulaire d’une pyramide de lexiques traitant de sujets spécialisés (termes militaires, football en dix langues, mots de la marine, de l’automobile, de la médecine, de la gastronomie...), mais visant également le grand public comme le "Dictionnaire international - 16 langues pour voyager" inscrit dans le Livre Guinness des records ou le "Dictionnaire des mots savants de la Langue française". Quelque 250 langues figurent aujourd’hui dans tous ses dictionnaires. Entré en 1997 dans le fameux Livre Guinness des Records, il détient le record mondial absolu du plus grand nombre de langues contenues dans un dictionnaire. Avec 56 dictionnaires écrits et publiés en 40 ans, il affiche un palmarès de distinctions et de titres fort honorifiques : En 1984, il obtient le diplôme de l’Aéro-Club de France pour les qualités de son "dictionnaire de l’aéronautique et de l’espace". En 1985, lui est décernée la médaille de l’aéronautique sur proposition du ministre des Transports. En 1988, parmi quelque 300 candidats, il remporte le premier prix au concours vidéotex État-Région Midi-Pyrénées pour son projet de création d’un "Centre européen de terminologie télématique". En 1993, il est élu "Toulousain de l’Année" par un jury de la Jeune Chambre Économique sur le thème de l’Europe. Et enfin le 23 avril 1997, il est admis comme membre dans la prestigieuse Académie des sciences de New York, qui compte plus de 40 prix Nobel et d’éminents savants. Ses premiers dictionnaires publiés pour la première fois en 1982 concernaient tous les vocables ayant trait à l’aéronautique et à l’espace, traduits de l’anglais vers le français et inversement. Ces ouvrages intitulés " Dictionnaire de l’aéronautique et de l’espace " sont devenus des outils incontournables pour les professionnels et pilotes du monde entier. Ils sont préfacés par le secrétaire général du Conseil international de la langue française, le ministre de la Recherche et de la Technologie, le ministre de l’Éducation nationale et le président d’Air France. En 1989, il publie le premier "Dictionnaire européen des mots usuels" en six langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais), riche de 50.000 traductions, dont le Président François Mitterrand écrira "que ce dictionnaire à l’usage européen représente un travail intéressant et dont l’impact sera important". Ce dictionnaire européen sera publié dans une quinzaine de pays. En 1994, il édite le " Dictionnaire anglais-russe de l’aéronautique et de l’espace " à la demande des USA et de la Russie pour faciliter les futures missions conjointes entre la navette spatiale et la Station Mir des deux grandes puissances lancées dans la conquête spatiale, ainsi que celles de la future Station spatiale internationale (ISS). Cet ouvrage est préfacé par d’éminentes personnalités, dont les présidents de la NASA, de l’agence spatiale russe RKA, d’Airbus et de Tupolev. En 1995, il revient avec le " Dictionnaire technique et scientifique anglais-français et français-anglais " réunissant en deux tomes quelque 80.000 traductions issues d’une cinquantaine de secteurs industriels et scientifiques. En 1996, il publie un dictionnaire polyglotte, qui n’existait encore nulle part au monde : le " Dictionnaire international 16 langues pour voyager ". Quelque 8000 mots usuels français y sont traduits dans une correspondance parfaite en anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, danois, suédois, norvégien, finnois, russe, grec, polonais, hongrois et tchèque soit plus de 120.000 traductions. L’ouvrage idéal pour le voyageur professionnel, le touriste, l’enseignant, et le traducteur ou pour accueillir des visiteurs étrangers. Il est préfacé par le ministre de la Culture et par le président d’Air France, qui qualifient ce livre de " travail titanesque et de bel exemple pour l’Europe en marche". Ce dictionnaire figure dans la bibliothèque de référence de l’Académie française ayant retenu toute l’attention du Secrétaire perpétuel. D’autres ouvrages et dictionnaires viendront compléter la collection. En 2004, la publication de « Cap sur Mars » avec le Dr Robert Zubrin, fondateur et président de la Mars Society, préfacé par les astronautes Buzz Aldrin et Patrick Baudry et du "Dictionnaire d’abréviations aéronautiques". Puis le "Dictionnaire anglais-français des termes d’aviation". En 2005, il publie le "Dictionnaire technique de l’automobile anglais-français", le "Dictionnaire anglais-français des termes de marine" et le "Dictionnaire des termes techniques français-anglais/anglais-français" préfacé par le président de l’Académie des technologies. En 2006, il publie le "Dictionnaire de médecine anglais-français" et le "Dictionnaire militaire anglais-français". En 2008 le "Dictionnaire pour voyageurs et touristes français-anglais/anglais-français des termes du tourisme, du voyage, de l’hébergement et de la gastronomie". En 2010, le "Dictionnaire de l’aéronautique en 20 Langues", publié en deux volumes de 480 pages et préfacés par le président d’Airbus, puis le "Grand dictionnaire de football" avec 50 000 expressions footballistiques françaises et 25 000 traductions étrangères en 10 langues, préfacé par le président de la Fédération Française de Football et en 2011 le "Dictionnaire français-anglais des phrases et expressions usuelles" comptant plus de 3500 entrées. En 2012, il publie un dictionnaire multilingue : "Le Tour du monde en 180 langues". 200 phrases et expressions usuelles y sont traduites du français en 180 langues étrangères et régionales. Une première mondiale par le nombre de langues contenues dans un dictionnaire. Quelque 300 linguistes et académiciens français et étrangers ont participé à sa rédaction. En 2013, il publie le "Dictionnaire français-anglais des phrases et mots de la vie quotidienne", qui contient plus de 12500 phrases usuelles et quelque 8000 mots courants traduits du français en anglais. Un ouvrage indispensable pour apprendre l’anglais ou voyager dans le monde. Cette même année, il publie aussi le "Dictionnaire des mots savants de la langue française" qui réunit quelque 4000 mots peu usités du langage raffiné, choisis parmi les trésors que notre belle langue recèle. Les définitions qu’il donne sont très explicites afin d’être comprises par tout le monde. En 2014, il publie plusieurs dictionnaires multilingues. D’abord le "Dictionnaire des langues régionales de France" dans lequel 200 phrases clés sont traduites en 55 langues, dialectes et patois de métropole, transfrontaliers et des Outre-mer. Une centaine de linguistes et locuteurs de toutes les régions ont participé à sa rédaction. Ce livre magnifique a été salué par tout le service du Dictionnaire de l’Académie française et a été présenté par Jean-Pierre Pernaut au JT de 13h sur TF1. Suivront d’autres publications comme le "Dictionnaire des langues officielles de l’Union européenne" salué par le président de la Commission européenne et par la Fondation Robert Schuman, puis le "Dictionnaire de voyage en Asie en 70 langues", le "Dictionnaire de voyage en Amérique en 30 langues", le "Dictionnaire de voyage en Afrique en 40 langues" et le "Dictionnaire de voyage en Europe en 40 langues". En 2014, il publie "Les Codes de la Bourse du XXIe siècle", qui contient les définitions de 450 termes financiers et boursiers et qui est préfacé par Jean-Pierre Gaillard, journaliste économique, spécialisé dans la Bourse. Puis il publie la même année le "Dictionnaire français-espagnol des phrases et expressions usuelles" comptant quelque 4000 entrées. En 2015, il publie un ouvrage qui n’existait pas, le "Dictionnaire des anglicismes", qui inventorie et définit plus de 5000 emprunts à la langue anglaise. Suivra la publication du "Dictionnaire multilingue de football" avec ses 2500 mots, phrases et expressions du langage footballistique traduits du français en 10 autres langues. Un ouvrage destiné à faciliter la communication avec les joueurs étrangers. Fin 2015, en pleine crise migratoire, il publie un dictionnaire spécial réfugiés et migrants syriens sous le titre anglais "Special dictionary for Syrian refugees". 200 phrases usuelles sont ici traduites de l’arabe syrien en 26 langues européennes. Il offre 2500 exemplaires à quelques associations et organisations humanitaires de France et de l’étranger, dont la Croix-Rouge. Une initiative saluée par la Présidence de la République Française et le Cabinet du Premier ministre. En 2016, il publie le "Dictionnaire français-anglais/anglais-français des termes de cuisine", qui regroupe les traductions bilingues de plus de 3000 mots de l’univers gastronomique. Cette même année il publie un "Dictionnaire français-anglais/anglais-français de dialogue médical", qui devrait permettre une meilleure communication entre le personnel médical français et les patients étrangers et surtout anglophones. En juin 2017, au moment où Thomas Pesquet quitte la Station spatiale internationale pour regagner la Terre, en compagnie du Russe Oleg Novitski, il publie le "Dictionnaire français-russe/russe-français de l’aéronautique et de l’espace" en deux volumes de 950 pages chacun. Ces livres sont préfacés par les présidents du CNES et de l’Agence spatiale russe "Roscosmos" et par Sergueï Krikalev, cosmonaute russe et ancien recordman du monde de durée de séjour dans l’espace en temps cumulé – 803 jours en six missions. En 2019, il publie le "Dictionnaire 200 phrases pour voyager dans le monde", qui réunit les 200 phrases les plus indispensables lorsque vous voyagez à l’étranger, classées par ordre alphabétique, et traduites en 13 langues parmi les plus parlées dans le monde. Et enfin, en avril 2020, en pleine crise sanitaire de Covid-19, il met en ligne le DiCovid-19, premier vrai dictionnaire consacré à cette épidémie, qui regroupe 230 termes, dont les définitions ont été soigneusement élaborées pour permettre aux citoyens de mieux comprendre la situation qu’ils vivent. En 2012, il a été fait Citoyen d’honneur de Saint-Orens de Gameville, où il réside et reçoit des mains du maire la médaille de la ville. Durant quarante ans, il aura eu à cœur de défendre la langue française contre le danger d’anglicisation des vocabulaires techniques et scientifiques, de lutter contre le danger d’appauvrissement de la langue française et de favoriser le dialogue des langues. Amoureux de sa Bigorre natale, il fut aussi l’initiateur du projet de construction d’un Centre de maintenance aéronautique européen (CMAE) sur l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. En 1997, il prit l’initiative de solliciter la CCI de Tarbes afin de lui présenter son idée de créer sur la zone aéroportuaire un vaste complexe aéronautique, qui emploierait plus d’un millier de personnes. De 1997 à 2005, il collaborera activement avec la CCI de Tarbes pour monter ce projet ambitieux. En dépit de tous ses efforts et de toutes les volontés politiques et institutionnelles déployées localement, ce grand centre de maintenance d’avions de ligne ne verra pas le jour. Mais en compensation, il sera décidé la création en 2006, d’un centre de déconstruction d’avions : la société Tarmac Aerosave, issue d’un partenariat d’industriels et basée actuellement à Ossun. Marié en 1972 avec Monique Durocher, son indéfectible soutien, originaire d’Arcizans-Avant, ils sont les parents heureux de 3 enfants : l’aîné, Thierry, qui édite des topo-guides ainsi que les aventures de Pitou le petit isard, Jérôme, le cadet, qui s’est chargé de la mise en application numérique des dictionnaires et la benjamine, Magali, qui est à l’origine du dictionnaire de dialogue médical français/anglais.
Henri GOURSAU, né le 23 mars 1950 à Arrens-Marsous, est l’auteur d’une cinquantaine de dictionnaires utilisés dans le monde entier. Fils d’agriculteurs, il passe ses plus jeunes années à l’école communale et à aider ses parents aux travaux des champs. Après des études au collège d’Argelès-Gazost, au lycée Jean-Dupuy à Tarbes puis à l’université à Toulouse, il entre en 1972 chez Air France. Il fait ses premières armes à Orly dans la maintenance des réacteurs des avions Airbus, et se heurte à une difficulté qui sera le départ de la bible de l’aéronautique, "Le Goursau". "Les réacteurs étaient américains, produits par General Electric ou Pratt & Whitney et tous les manuels techniques étaient en anglais", raconte-t-il en rappelant le ballet des mécaniciens, des techniciens, des ingénieurs, d’un bureau à l’autre, pour tenter de traduire les directives. Il commence alors à noter sur un calepin des mots techniques anglais concernant tous les secteurs d’un avion, et leur traduction en français. Sa femme Monique les recopie le soir à la machine à écrire, après son travail et une fois les trois enfants couchés. Le calepin devient un énorme classeur au fur et à mesure des recherches interminables dans des livres, des magazines d’aviation, des manuels, ou auprès d’Air France, Matra, Dassault, Snias, Snecma, Latécoère, Cnes, Supaéro, Enac... "Je suis allé au bout, jusqu’à épuiser le sujet", se félicite-t-il. 20 000 heures lui furent néanmoins nécessaires pour sa réalisation. Il présente alors son manuscrit à Air France, qui le prend de haut. Il fait le tour des éditeurs, qui refusent de le recevoir. Mais si beaucoup auraient abandonné, lui jamais. Et puisque personne ne veut de son ouvrage, il le fera imprimer à compte d’auteur sur ses propres deniers. Aujourd’hui, le "Dictionnaire de l’aéronautique et de l’espace" est l’ouvrage de référence, qui a trouvé sa place dans les appareils d’Air France et de l’armée de l’air, les aéro-clubs, dans toutes les écoles et entreprises d’aviation, de France et de l’étranger, en salle de contrôle du centre spatial de Kourou et de Cap Canaveral. Ce livre est devenu la pierre angulaire d’une pyramide de lexiques traitant de sujets spécialisés (termes militaires, football en dix langues, mots de la marine, de l’automobile, de la médecine, de la gastronomie...), mais visant également le grand public comme le "Dictionnaire international - 16 langues pour voyager" inscrit dans le Livre Guinness des records ou le "Dictionnaire des mots savants de la Langue française". Quelque 250 langues figurent aujourd’hui dans tous ses dictionnaires. Entré en 1997 dans le fameux Livre Guinness des Records, il détient le record mondial absolu du plus grand nombre de langues contenues dans un dictionnaire. Avec 56 dictionnaires écrits et publiés en 40 ans, il affiche un palmarès de distinctions et de titres fort honorifiques : En 1984, il obtient le diplôme de l’Aéro-Club de France pour les qualités de son "dictionnaire de l’aéronautique et de l’espace". En 1985, lui est décernée la médaille de l’aéronautique sur proposition du ministre des Transports. En 1988, parmi quelque 300 candidats, il remporte le premier prix au concours vidéotex État-Région Midi-Pyrénées pour son projet de création d’un "Centre européen de terminologie télématique". En 1993, il est élu "Toulousain de l’Année" par un jury de la Jeune Chambre Économique sur le thème de l’Europe. Et enfin le 23 avril 1997, il est admis comme membre dans la prestigieuse Académie des sciences de New York, qui compte plus de 40 prix Nobel et d’éminents savants. Ses premiers dictionnaires publiés pour la première fois en 1982 concernaient tous les vocables ayant trait à l’aéronautique et à l’espace, traduits de l’anglais vers le français et inversement. Ces ouvrages intitulés " Dictionnaire de l’aéronautique et de l’espace " sont devenus des outils incontournables pour les professionnels et pilotes du monde entier. Ils sont préfacés par le secrétaire général du Conseil international de la langue française, le ministre de la Recherche et de la Technologie, le ministre de l’Éducation nationale et le président d’Air France. En 1989, il publie le premier "Dictionnaire européen des mots usuels" en six langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais), riche de 50.000 traductions, dont le Président François Mitterrand écrira "que ce dictionnaire à l’usage européen représente un travail intéressant et dont l’impact sera important". Ce dictionnaire européen sera publié dans une quinzaine de pays. En 1994, il édite le " Dictionnaire anglais-russe de l’aéronautique et de l’espace " à la demande des USA et de la Russie pour faciliter les futures missions conjointes entre la navette spatiale et la Station Mir des deux grandes puissances lancées dans la conquête spatiale, ainsi que celles de la future Station spatiale internationale (ISS). Cet ouvrage est préfacé par d’éminentes personnalités, dont les présidents de la NASA, de l’agence spatiale russe RKA, d’Airbus et de Tupolev. En 1995, il revient avec le " Dictionnaire technique et scientifique anglais-français et français-anglais " réunissant en deux tomes quelque 80.000 traductions issues d’une cinquantaine de secteurs industriels et scientifiques. En 1996, il publie un dictionnaire polyglotte, qui n’existait encore nulle part au monde : le " Dictionnaire international 16 langues pour voyager ". Quelque 8000 mots usuels français y sont traduits dans une correspondance parfaite en anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, danois, suédois, norvégien, finnois, russe, grec, polonais, hongrois et tchèque soit plus de 120.000 traductions. L’ouvrage idéal pour le voyageur professionnel, le touriste, l’enseignant, et le traducteur ou pour accueillir des visiteurs étrangers. Il est préfacé par le ministre de la Culture et par le président d’Air France, qui qualifient ce livre de " travail titanesque et de bel exemple pour l’Europe en marche". Ce dictionnaire figure dans la bibliothèque de référence de l’Académie française ayant retenu toute l’attention du Secrétaire perpétuel. D’autres ouvrages et dictionnaires viendront compléter la collection. En 2004, la publication de « Cap sur Mars » avec le Dr Robert Zubrin, fondateur et président de la Mars Society, préfacé par les astronautes Buzz Aldrin et Patrick Baudry et du "Dictionnaire d’abréviations aéronautiques". Puis le "Dictionnaire anglais-français des termes d’aviation". En 2005, il publie le "Dictionnaire technique de l’automobile anglais-français", le "Dictionnaire anglais-français des termes de marine" et le "Dictionnaire des termes techniques français-anglais/anglais-français" préfacé par le président de l’Académie des technologies. En 2006, il publie le "Dictionnaire de médecine anglais-français" et le "Dictionnaire militaire anglais-français". En 2008 le "Dictionnaire pour voyageurs et touristes français-anglais/anglais-français des termes du tourisme, du voyage, de l’hébergement et de la gastronomie". En 2010, le "Dictionnaire de l’aéronautique en 20 Langues", publié en deux volumes de 480 pages et préfacés par le président d’Airbus, puis le "Grand dictionnaire de football" avec 50 000 expressions footballistiques françaises et 25 000 traductions étrangères en 10 langues, préfacé par le président de la Fédération Française de Football et en 2011 le "Dictionnaire français-anglais des phrases et expressions usuelles" comptant plus de 3500 entrées. En 2012, il publie un dictionnaire multilingue : "Le Tour du monde en 180 langues". 200 phrases et expressions usuelles y sont traduites du français en 180 langues étrangères et régionales. Une première mondiale par le nombre de langues contenues dans un dictionnaire. Quelque 300 linguistes et académiciens français et étrangers ont participé à sa rédaction. En 2013, il publie le "Dictionnaire français-anglais des phrases et mots de la vie quotidienne", qui contient plus de 12500 phrases usuelles et quelque 8000 mots courants traduits du français en anglais. Un ouvrage indispensable pour apprendre l’anglais ou voyager dans le monde. Cette même année, il publie aussi le "Dictionnaire des mots savants de la langue française" qui réunit quelque 4000 mots peu usités du langage raffiné, choisis parmi les trésors que notre belle langue recèle. Les définitions qu’il donne sont très explicites afin d’être comprises par tout le monde. En 2014, il publie plusieurs dictionnaires multilingues. D’abord le "Dictionnaire des langues régionales de France" dans lequel 200 phrases clés sont traduites en 55 langues, dialectes et patois de métropole, transfrontaliers et des Outre-mer. Une centaine de linguistes et locuteurs de toutes les régions ont participé à sa rédaction. Ce livre magnifique a été salué par tout le service du Dictionnaire de l’Académie française et a été présenté par Jean-Pierre Pernaut au JT de 13h sur TF1. Suivront d’autres publications comme le "Dictionnaire des langues officielles de l’Union européenne" salué par le président de la Commission européenne et par la Fondation Robert Schuman, puis le "Dictionnaire de voyage en Asie en 70 langues", le "Dictionnaire de voyage en Amérique en 30 langues", le "Dictionnaire de voyage en Afrique en 40 langues" et le "Dictionnaire de voyage en Europe en 40 langues". En 2014, il publie "Les Codes de la Bourse du XXIe siècle", qui contient les définitions de 450 termes financiers et boursiers et qui est préfacé par Jean-Pierre Gaillard, journaliste économique, spécialisé dans la Bourse. Puis il publie la même année le "Dictionnaire français-espagnol des phrases et expressions usuelles" comptant quelque 4000 entrées. En 2015, il publie un ouvrage qui n’existait pas, le "Dictionnaire des anglicismes", qui inventorie et définit plus de 5000 emprunts à la langue anglaise. Suivra la publication du "Dictionnaire multilingue de football" avec ses 2500 mots, phrases et expressions du langage footballistique traduits du français en 10 autres langues. Un ouvrage destiné à faciliter la communication avec les joueurs étrangers. Fin 2015, en pleine crise migratoire, il publie un dictionnaire spécial réfugiés et migrants syriens sous le titre anglais "Special dictionary for Syrian refugees". 200 phrases usuelles sont ici traduites de l’arabe syrien en 26 langues européennes. Il offre 2500 exemplaires à quelques associations et organisations humanitaires de France et de l’étranger, dont la Croix-Rouge. Une initiative saluée par la Présidence de la République Française et le Cabinet du Premier ministre. En 2016, il publie le "Dictionnaire français-anglais/anglais-français des termes de cuisine", qui regroupe les traductions bilingues de plus de 3000 mots de l’univers gastronomique. Cette même année il publie un "Dictionnaire français-anglais/anglais-français de dialogue médical", qui devrait permettre une meilleure communication entre le personnel médical français et les patients étrangers et surtout anglophones. En juin 2017, au moment où Thomas Pesquet quitte la Station spatiale internationale pour regagner la Terre, en compagnie du Russe Oleg Novitski, il publie le "Dictionnaire français-russe/russe-français de l’aéronautique et de l’espace" en deux volumes de 950 pages chacun. Ces livres sont préfacés par les présidents du CNES et de l’Agence spatiale russe "Roscosmos" et par Sergueï Krikalev, cosmonaute russe et ancien recordman du monde de durée de séjour dans l’espace en temps cumulé – 803 jours en six missions. En 2019, il publie le "Dictionnaire 200 phrases pour voyager dans le monde", qui réunit les 200 phrases les plus indispensables lorsque vous voyagez à l’étranger, classées par ordre alphabétique, et traduites en 13 langues parmi les plus parlées dans le monde. Et enfin, en avril 2020, en pleine crise sanitaire de Covid-19, il met en ligne le DiCovid-19, premier vrai dictionnaire consacré à cette épidémie, qui regroupe 230 termes, dont les définitions ont été soigneusement élaborées pour permettre aux citoyens de mieux comprendre la situation qu’ils vivent. En 2012, il a été fait Citoyen d’honneur de Saint-Orens de Gameville, où il réside et reçoit des mains du maire la médaille de la ville. Durant quarante ans, il aura eu à cœur de défendre la langue française contre le danger d’anglicisation des vocabulaires techniques et scientifiques, de lutter contre le danger d’appauvrissement de la langue française et de favoriser le dialogue des langues. Amoureux de sa Bigorre natale, il fut aussi l’initiateur du projet de construction d’un Centre de maintenance aéronautique européen (CMAE) sur l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. En 1997, il prit l’initiative de solliciter la CCI de Tarbes afin de lui présenter son idée de créer sur la zone aéroportuaire un vaste complexe aéronautique, qui emploierait plus d’un millier de personnes. De 1997 à 2005, il collaborera activement avec la CCI de Tarbes pour monter ce projet ambitieux. En dépit de tous ses efforts et de toutes les volontés politiques et institutionnelles déployées localement, ce grand centre de maintenance d’avions de ligne ne verra pas le jour. Mais en compensation, il sera décidé la création en 2006, d’un centre de déconstruction d’avions : la société Tarmac Aerosave, issue d’un partenariat d’industriels et basée actuellement à Ossun. Marié en 1972 avec Monique Durocher, son indéfectible soutien, originaire d’Arcizans-Avant, ils sont les parents heureux de 3 enfants : l’aîné, Thierry, qui édite des topo-guides ainsi que les aventures de Pitou le petit isard, Jérôme, le cadet, qui s’est chargé de la mise en application numérique des dictionnaires et la benjamine, Magali, qui est à l’origine du dictionnaire de dialogue médical français/anglais.
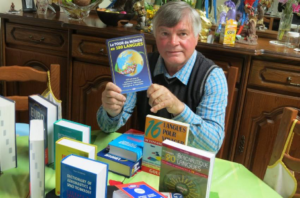 Henri GOURSAU, né le 23 mars 1950 à Arrens-Marsous, est l’auteur d’une cinquantaine de dictionnaires utilisés dans le monde entier. Fils d’agriculteurs, il passe ses plus jeunes années à l’école communale et à aider ses parents aux travaux des champs. Après des études au collège d’Argelès-Gazost, au lycée Jean-Dupuy à Tarbes puis à l’université à Toulouse, il entre en 1972 chez Air France. Il fait ses premières armes à Orly dans la maintenance des réacteurs des avions Airbus, et se heurte à une difficulté qui sera le départ de la bible de l’aéronautique, "Le Goursau". "Les réacteurs étaient américains, produits par General Electric ou Pratt & Whitney et tous les manuels techniques étaient en anglais", raconte-t-il en rappelant le ballet des mécaniciens, des techniciens, des ingénieurs, d’un bureau à l’autre, pour tenter de traduire les directives. Il commence alors à noter sur un calepin des mots techniques anglais concernant tous les secteurs d’un avion, et leur traduction en français. Sa femme Monique les recopie le soir à la machine à écrire, après son travail et une fois les trois enfants couchés. Le calepin devient un énorme classeur au fur et à mesure des recherches interminables dans des livres, des magazines d’aviation, des manuels, ou auprès d’Air France, Matra, Dassault, Snias, Snecma, Latécoère, Cnes, Supaéro, Enac... "Je suis allé au bout, jusqu’à épuiser le sujet", se félicite-t-il. 20 000 heures lui furent néanmoins nécessaires pour sa réalisation. Il présente alors son manuscrit à Air France, qui le prend de haut. Il fait le tour des éditeurs, qui refusent de le recevoir. Mais si beaucoup auraient abandonné, lui jamais. Et puisque personne ne veut de son ouvrage, il le fera imprimer à compte d’auteur sur ses propres deniers. Aujourd’hui, le "Dictionnaire de l’aéronautique et de l’espace" est l’ouvrage de référence, qui a trouvé sa place dans les appareils d’Air France et de l’armée de l’air, les aéro-clubs, dans toutes les écoles et entreprises d’aviation, de France et de l’étranger, en salle de contrôle du centre spatial de Kourou et de Cap Canaveral. Ce livre est devenu la pierre angulaire d’une pyramide de lexiques traitant de sujets spécialisés (termes militaires, football en dix langues, mots de la marine, de l’automobile, de la médecine, de la gastronomie...), mais visant également le grand public comme le "Dictionnaire international - 16 langues pour voyager" inscrit dans le Livre Guinness des records ou le "Dictionnaire des mots savants de la Langue française". Quelque 250 langues figurent aujourd’hui dans tous ses dictionnaires. Entré en 1997 dans le fameux Livre Guinness des Records, il détient le record mondial absolu du plus grand nombre de langues contenues dans un dictionnaire. Avec 56 dictionnaires écrits et publiés en 40 ans, il affiche un palmarès de distinctions et de titres fort honorifiques : En 1984, il obtient le diplôme de l’Aéro-Club de France pour les qualités de son "dictionnaire de l’aéronautique et de l’espace". En 1985, lui est décernée la médaille de l’aéronautique sur proposition du ministre des Transports. En 1988, parmi quelque 300 candidats, il remporte le premier prix au concours vidéotex État-Région Midi-Pyrénées pour son projet de création d’un "Centre européen de terminologie télématique". En 1993, il est élu "Toulousain de l’Année" par un jury de la Jeune Chambre Économique sur le thème de l’Europe. Et enfin le 23 avril 1997, il est admis comme membre dans la prestigieuse Académie des sciences de New York, qui compte plus de 40 prix Nobel et d’éminents savants. Ses premiers dictionnaires publiés pour la première fois en 1982 concernaient tous les vocables ayant trait à l’aéronautique et à l’espace, traduits de l’anglais vers le français et inversement. Ces ouvrages intitulés " Dictionnaire de l’aéronautique et de l’espace " sont devenus des outils incontournables pour les professionnels et pilotes du monde entier. Ils sont préfacés par le secrétaire général du Conseil international de la langue française, le ministre de la Recherche et de la Technologie, le ministre de l’Éducation nationale et le président d’Air France. En 1989, il publie le premier "Dictionnaire européen des mots usuels" en six langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais), riche de 50.000 traductions, dont le Président François Mitterrand écrira "que ce dictionnaire à l’usage européen représente un travail intéressant et dont l’impact sera important". Ce dictionnaire européen sera publié dans une quinzaine de pays. En 1994, il édite le " Dictionnaire anglais-russe de l’aéronautique et de l’espace " à la demande des USA et de la Russie pour faciliter les futures missions conjointes entre la navette spatiale et la Station Mir des deux grandes puissances lancées dans la conquête spatiale, ainsi que celles de la future Station spatiale internationale (ISS). Cet ouvrage est préfacé par d’éminentes personnalités, dont les présidents de la NASA, de l’agence spatiale russe RKA, d’Airbus et de Tupolev. En 1995, il revient avec le " Dictionnaire technique et scientifique anglais-français et français-anglais " réunissant en deux tomes quelque 80.000 traductions issues d’une cinquantaine de secteurs industriels et scientifiques. En 1996, il publie un dictionnaire polyglotte, qui n’existait encore nulle part au monde : le " Dictionnaire international 16 langues pour voyager ". Quelque 8000 mots usuels français y sont traduits dans une correspondance parfaite en anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, danois, suédois, norvégien, finnois, russe, grec, polonais, hongrois et tchèque soit plus de 120.000 traductions. L’ouvrage idéal pour le voyageur professionnel, le touriste, l’enseignant, et le traducteur ou pour accueillir des visiteurs étrangers. Il est préfacé par le ministre de la Culture et par le président d’Air France, qui qualifient ce livre de " travail titanesque et de bel exemple pour l’Europe en marche". Ce dictionnaire figure dans la bibliothèque de référence de l’Académie française ayant retenu toute l’attention du Secrétaire perpétuel. D’autres ouvrages et dictionnaires viendront compléter la collection. En 2004, la publication de « Cap sur Mars » avec le Dr Robert Zubrin, fondateur et président de la Mars Society, préfacé par les astronautes Buzz Aldrin et Patrick Baudry et du "Dictionnaire d’abréviations aéronautiques". Puis le "Dictionnaire anglais-français des termes d’aviation". En 2005, il publie le "Dictionnaire technique de l’automobile anglais-français", le "Dictionnaire anglais-français des termes de marine" et le "Dictionnaire des termes techniques français-anglais/anglais-français" préfacé par le président de l’Académie des technologies. En 2006, il publie le "Dictionnaire de médecine anglais-français" et le "Dictionnaire militaire anglais-français". En 2008 le "Dictionnaire pour voyageurs et touristes français-anglais/anglais-français des termes du tourisme, du voyage, de l’hébergement et de la gastronomie". En 2010, le "Dictionnaire de l’aéronautique en 20 Langues", publié en deux volumes de 480 pages et préfacés par le président d’Airbus, puis le "Grand dictionnaire de football" avec 50 000 expressions footballistiques françaises et 25 000 traductions étrangères en 10 langues, préfacé par le président de la Fédération Française de Football et en 2011 le "Dictionnaire français-anglais des phrases et expressions usuelles" comptant plus de 3500 entrées. En 2012, il publie un dictionnaire multilingue : "Le Tour du monde en 180 langues". 200 phrases et expressions usuelles y sont traduites du français en 180 langues étrangères et régionales. Une première mondiale par le nombre de langues contenues dans un dictionnaire. Quelque 300 linguistes et académiciens français et étrangers ont participé à sa rédaction. En 2013, il publie le "Dictionnaire français-anglais des phrases et mots de la vie quotidienne", qui contient plus de 12500 phrases usuelles et quelque 8000 mots courants traduits du français en anglais. Un ouvrage indispensable pour apprendre l’anglais ou voyager dans le monde. Cette même année, il publie aussi le "Dictionnaire des mots savants de la langue française" qui réunit quelque 4000 mots peu usités du langage raffiné, choisis parmi les trésors que notre belle langue recèle. Les définitions qu’il donne sont très explicites afin d’être comprises par tout le monde. En 2014, il publie plusieurs dictionnaires multilingues. D’abord le "Dictionnaire des langues régionales de France" dans lequel 200 phrases clés sont traduites en 55 langues, dialectes et patois de métropole, transfrontaliers et des Outre-mer. Une centaine de linguistes et locuteurs de toutes les régions ont participé à sa rédaction. Ce livre magnifique a été salué par tout le service du Dictionnaire de l’Académie française et a été présenté par Jean-Pierre Pernaut au JT de 13h sur TF1. Suivront d’autres publications comme le "Dictionnaire des langues officielles de l’Union européenne" salué par le président de la Commission européenne et par la Fondation Robert Schuman, puis le "Dictionnaire de voyage en Asie en 70 langues", le "Dictionnaire de voyage en Amérique en 30 langues", le "Dictionnaire de voyage en Afrique en 40 langues" et le "Dictionnaire de voyage en Europe en 40 langues". En 2014, il publie "Les Codes de la Bourse du XXIe siècle", qui contient les définitions de 450 termes financiers et boursiers et qui est préfacé par Jean-Pierre Gaillard, journaliste économique, spécialisé dans la Bourse. Puis il publie la même année le "Dictionnaire français-espagnol des phrases et expressions usuelles" comptant quelque 4000 entrées. En 2015, il publie un ouvrage qui n’existait pas, le "Dictionnaire des anglicismes", qui inventorie et définit plus de 5000 emprunts à la langue anglaise. Suivra la publication du "Dictionnaire multilingue de football" avec ses 2500 mots, phrases et expressions du langage footballistique traduits du français en 10 autres langues. Un ouvrage destiné à faciliter la communication avec les joueurs étrangers. Fin 2015, en pleine crise migratoire, il publie un dictionnaire spécial réfugiés et migrants syriens sous le titre anglais "Special dictionary for Syrian refugees". 200 phrases usuelles sont ici traduites de l’arabe syrien en 26 langues européennes. Il offre 2500 exemplaires à quelques associations et organisations humanitaires de France et de l’étranger, dont la Croix-Rouge. Une initiative saluée par la Présidence de la République Française et le Cabinet du Premier ministre. En 2016, il publie le "Dictionnaire français-anglais/anglais-français des termes de cuisine", qui regroupe les traductions bilingues de plus de 3000 mots de l’univers gastronomique. Cette même année il publie un "Dictionnaire français-anglais/anglais-français de dialogue médical", qui devrait permettre une meilleure communication entre le personnel médical français et les patients étrangers et surtout anglophones. En juin 2017, au moment où Thomas Pesquet quitte la Station spatiale internationale pour regagner la Terre, en compagnie du Russe Oleg Novitski, il publie le "Dictionnaire français-russe/russe-français de l’aéronautique et de l’espace" en deux volumes de 950 pages chacun. Ces livres sont préfacés par les présidents du CNES et de l’Agence spatiale russe "Roscosmos" et par Sergueï Krikalev, cosmonaute russe et ancien recordman du monde de durée de séjour dans l’espace en temps cumulé – 803 jours en six missions. En 2019, il publie le "Dictionnaire 200 phrases pour voyager dans le monde", qui réunit les 200 phrases les plus indispensables lorsque vous voyagez à l’étranger, classées par ordre alphabétique, et traduites en 13 langues parmi les plus parlées dans le monde. Et enfin, en avril 2020, en pleine crise sanitaire de Covid-19, il met en ligne le DiCovid-19, premier vrai dictionnaire consacré à cette épidémie, qui regroupe 230 termes, dont les définitions ont été soigneusement élaborées pour permettre aux citoyens de mieux comprendre la situation qu’ils vivent. En 2012, il a été fait Citoyen d’honneur de Saint-Orens de Gameville, où il réside et reçoit des mains du maire la médaille de la ville. Durant quarante ans, il aura eu à cœur de défendre la langue française contre le danger d’anglicisation des vocabulaires techniques et scientifiques, de lutter contre le danger d’appauvrissement de la langue française et de favoriser le dialogue des langues. Amoureux de sa Bigorre natale, il fut aussi l’initiateur du projet de construction d’un Centre de maintenance aéronautique européen (CMAE) sur l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. En 1997, il prit l’initiative de solliciter la CCI de Tarbes afin de lui présenter son idée de créer sur la zone aéroportuaire un vaste complexe aéronautique, qui emploierait plus d’un millier de personnes. De 1997 à 2005, il collaborera activement avec la CCI de Tarbes pour monter ce projet ambitieux. En dépit de tous ses efforts et de toutes les volontés politiques et institutionnelles déployées localement, ce grand centre de maintenance d’avions de ligne ne verra pas le jour. Mais en compensation, il sera décidé la création en 2006, d’un centre de déconstruction d’avions : la société Tarmac Aerosave, issue d’un partenariat d’industriels et basée actuellement à Ossun. Marié en 1972 avec Monique Durocher, son indéfectible soutien, originaire d’Arcizans-Avant, ils sont les parents heureux de 3 enfants : l’aîné, Thierry, qui édite des topo-guides ainsi que les aventures de Pitou le petit isard, Jérôme, le cadet, qui s’est chargé de la mise en application numérique des dictionnaires et la benjamine, Magali, qui est à l’origine du dictionnaire de dialogue médical français/anglais.
Henri GOURSAU, né le 23 mars 1950 à Arrens-Marsous, est l’auteur d’une cinquantaine de dictionnaires utilisés dans le monde entier. Fils d’agriculteurs, il passe ses plus jeunes années à l’école communale et à aider ses parents aux travaux des champs. Après des études au collège d’Argelès-Gazost, au lycée Jean-Dupuy à Tarbes puis à l’université à Toulouse, il entre en 1972 chez Air France. Il fait ses premières armes à Orly dans la maintenance des réacteurs des avions Airbus, et se heurte à une difficulté qui sera le départ de la bible de l’aéronautique, "Le Goursau". "Les réacteurs étaient américains, produits par General Electric ou Pratt & Whitney et tous les manuels techniques étaient en anglais", raconte-t-il en rappelant le ballet des mécaniciens, des techniciens, des ingénieurs, d’un bureau à l’autre, pour tenter de traduire les directives. Il commence alors à noter sur un calepin des mots techniques anglais concernant tous les secteurs d’un avion, et leur traduction en français. Sa femme Monique les recopie le soir à la machine à écrire, après son travail et une fois les trois enfants couchés. Le calepin devient un énorme classeur au fur et à mesure des recherches interminables dans des livres, des magazines d’aviation, des manuels, ou auprès d’Air France, Matra, Dassault, Snias, Snecma, Latécoère, Cnes, Supaéro, Enac... "Je suis allé au bout, jusqu’à épuiser le sujet", se félicite-t-il. 20 000 heures lui furent néanmoins nécessaires pour sa réalisation. Il présente alors son manuscrit à Air France, qui le prend de haut. Il fait le tour des éditeurs, qui refusent de le recevoir. Mais si beaucoup auraient abandonné, lui jamais. Et puisque personne ne veut de son ouvrage, il le fera imprimer à compte d’auteur sur ses propres deniers. Aujourd’hui, le "Dictionnaire de l’aéronautique et de l’espace" est l’ouvrage de référence, qui a trouvé sa place dans les appareils d’Air France et de l’armée de l’air, les aéro-clubs, dans toutes les écoles et entreprises d’aviation, de France et de l’étranger, en salle de contrôle du centre spatial de Kourou et de Cap Canaveral. Ce livre est devenu la pierre angulaire d’une pyramide de lexiques traitant de sujets spécialisés (termes militaires, football en dix langues, mots de la marine, de l’automobile, de la médecine, de la gastronomie...), mais visant également le grand public comme le "Dictionnaire international - 16 langues pour voyager" inscrit dans le Livre Guinness des records ou le "Dictionnaire des mots savants de la Langue française". Quelque 250 langues figurent aujourd’hui dans tous ses dictionnaires. Entré en 1997 dans le fameux Livre Guinness des Records, il détient le record mondial absolu du plus grand nombre de langues contenues dans un dictionnaire. Avec 56 dictionnaires écrits et publiés en 40 ans, il affiche un palmarès de distinctions et de titres fort honorifiques : En 1984, il obtient le diplôme de l’Aéro-Club de France pour les qualités de son "dictionnaire de l’aéronautique et de l’espace". En 1985, lui est décernée la médaille de l’aéronautique sur proposition du ministre des Transports. En 1988, parmi quelque 300 candidats, il remporte le premier prix au concours vidéotex État-Région Midi-Pyrénées pour son projet de création d’un "Centre européen de terminologie télématique". En 1993, il est élu "Toulousain de l’Année" par un jury de la Jeune Chambre Économique sur le thème de l’Europe. Et enfin le 23 avril 1997, il est admis comme membre dans la prestigieuse Académie des sciences de New York, qui compte plus de 40 prix Nobel et d’éminents savants. Ses premiers dictionnaires publiés pour la première fois en 1982 concernaient tous les vocables ayant trait à l’aéronautique et à l’espace, traduits de l’anglais vers le français et inversement. Ces ouvrages intitulés " Dictionnaire de l’aéronautique et de l’espace " sont devenus des outils incontournables pour les professionnels et pilotes du monde entier. Ils sont préfacés par le secrétaire général du Conseil international de la langue française, le ministre de la Recherche et de la Technologie, le ministre de l’Éducation nationale et le président d’Air France. En 1989, il publie le premier "Dictionnaire européen des mots usuels" en six langues (français, anglais, allemand, espagnol, italien, portugais), riche de 50.000 traductions, dont le Président François Mitterrand écrira "que ce dictionnaire à l’usage européen représente un travail intéressant et dont l’impact sera important". Ce dictionnaire européen sera publié dans une quinzaine de pays. En 1994, il édite le " Dictionnaire anglais-russe de l’aéronautique et de l’espace " à la demande des USA et de la Russie pour faciliter les futures missions conjointes entre la navette spatiale et la Station Mir des deux grandes puissances lancées dans la conquête spatiale, ainsi que celles de la future Station spatiale internationale (ISS). Cet ouvrage est préfacé par d’éminentes personnalités, dont les présidents de la NASA, de l’agence spatiale russe RKA, d’Airbus et de Tupolev. En 1995, il revient avec le " Dictionnaire technique et scientifique anglais-français et français-anglais " réunissant en deux tomes quelque 80.000 traductions issues d’une cinquantaine de secteurs industriels et scientifiques. En 1996, il publie un dictionnaire polyglotte, qui n’existait encore nulle part au monde : le " Dictionnaire international 16 langues pour voyager ". Quelque 8000 mots usuels français y sont traduits dans une correspondance parfaite en anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, néerlandais, danois, suédois, norvégien, finnois, russe, grec, polonais, hongrois et tchèque soit plus de 120.000 traductions. L’ouvrage idéal pour le voyageur professionnel, le touriste, l’enseignant, et le traducteur ou pour accueillir des visiteurs étrangers. Il est préfacé par le ministre de la Culture et par le président d’Air France, qui qualifient ce livre de " travail titanesque et de bel exemple pour l’Europe en marche". Ce dictionnaire figure dans la bibliothèque de référence de l’Académie française ayant retenu toute l’attention du Secrétaire perpétuel. D’autres ouvrages et dictionnaires viendront compléter la collection. En 2004, la publication de « Cap sur Mars » avec le Dr Robert Zubrin, fondateur et président de la Mars Society, préfacé par les astronautes Buzz Aldrin et Patrick Baudry et du "Dictionnaire d’abréviations aéronautiques". Puis le "Dictionnaire anglais-français des termes d’aviation". En 2005, il publie le "Dictionnaire technique de l’automobile anglais-français", le "Dictionnaire anglais-français des termes de marine" et le "Dictionnaire des termes techniques français-anglais/anglais-français" préfacé par le président de l’Académie des technologies. En 2006, il publie le "Dictionnaire de médecine anglais-français" et le "Dictionnaire militaire anglais-français". En 2008 le "Dictionnaire pour voyageurs et touristes français-anglais/anglais-français des termes du tourisme, du voyage, de l’hébergement et de la gastronomie". En 2010, le "Dictionnaire de l’aéronautique en 20 Langues", publié en deux volumes de 480 pages et préfacés par le président d’Airbus, puis le "Grand dictionnaire de football" avec 50 000 expressions footballistiques françaises et 25 000 traductions étrangères en 10 langues, préfacé par le président de la Fédération Française de Football et en 2011 le "Dictionnaire français-anglais des phrases et expressions usuelles" comptant plus de 3500 entrées. En 2012, il publie un dictionnaire multilingue : "Le Tour du monde en 180 langues". 200 phrases et expressions usuelles y sont traduites du français en 180 langues étrangères et régionales. Une première mondiale par le nombre de langues contenues dans un dictionnaire. Quelque 300 linguistes et académiciens français et étrangers ont participé à sa rédaction. En 2013, il publie le "Dictionnaire français-anglais des phrases et mots de la vie quotidienne", qui contient plus de 12500 phrases usuelles et quelque 8000 mots courants traduits du français en anglais. Un ouvrage indispensable pour apprendre l’anglais ou voyager dans le monde. Cette même année, il publie aussi le "Dictionnaire des mots savants de la langue française" qui réunit quelque 4000 mots peu usités du langage raffiné, choisis parmi les trésors que notre belle langue recèle. Les définitions qu’il donne sont très explicites afin d’être comprises par tout le monde. En 2014, il publie plusieurs dictionnaires multilingues. D’abord le "Dictionnaire des langues régionales de France" dans lequel 200 phrases clés sont traduites en 55 langues, dialectes et patois de métropole, transfrontaliers et des Outre-mer. Une centaine de linguistes et locuteurs de toutes les régions ont participé à sa rédaction. Ce livre magnifique a été salué par tout le service du Dictionnaire de l’Académie française et a été présenté par Jean-Pierre Pernaut au JT de 13h sur TF1. Suivront d’autres publications comme le "Dictionnaire des langues officielles de l’Union européenne" salué par le président de la Commission européenne et par la Fondation Robert Schuman, puis le "Dictionnaire de voyage en Asie en 70 langues", le "Dictionnaire de voyage en Amérique en 30 langues", le "Dictionnaire de voyage en Afrique en 40 langues" et le "Dictionnaire de voyage en Europe en 40 langues". En 2014, il publie "Les Codes de la Bourse du XXIe siècle", qui contient les définitions de 450 termes financiers et boursiers et qui est préfacé par Jean-Pierre Gaillard, journaliste économique, spécialisé dans la Bourse. Puis il publie la même année le "Dictionnaire français-espagnol des phrases et expressions usuelles" comptant quelque 4000 entrées. En 2015, il publie un ouvrage qui n’existait pas, le "Dictionnaire des anglicismes", qui inventorie et définit plus de 5000 emprunts à la langue anglaise. Suivra la publication du "Dictionnaire multilingue de football" avec ses 2500 mots, phrases et expressions du langage footballistique traduits du français en 10 autres langues. Un ouvrage destiné à faciliter la communication avec les joueurs étrangers. Fin 2015, en pleine crise migratoire, il publie un dictionnaire spécial réfugiés et migrants syriens sous le titre anglais "Special dictionary for Syrian refugees". 200 phrases usuelles sont ici traduites de l’arabe syrien en 26 langues européennes. Il offre 2500 exemplaires à quelques associations et organisations humanitaires de France et de l’étranger, dont la Croix-Rouge. Une initiative saluée par la Présidence de la République Française et le Cabinet du Premier ministre. En 2016, il publie le "Dictionnaire français-anglais/anglais-français des termes de cuisine", qui regroupe les traductions bilingues de plus de 3000 mots de l’univers gastronomique. Cette même année il publie un "Dictionnaire français-anglais/anglais-français de dialogue médical", qui devrait permettre une meilleure communication entre le personnel médical français et les patients étrangers et surtout anglophones. En juin 2017, au moment où Thomas Pesquet quitte la Station spatiale internationale pour regagner la Terre, en compagnie du Russe Oleg Novitski, il publie le "Dictionnaire français-russe/russe-français de l’aéronautique et de l’espace" en deux volumes de 950 pages chacun. Ces livres sont préfacés par les présidents du CNES et de l’Agence spatiale russe "Roscosmos" et par Sergueï Krikalev, cosmonaute russe et ancien recordman du monde de durée de séjour dans l’espace en temps cumulé – 803 jours en six missions. En 2019, il publie le "Dictionnaire 200 phrases pour voyager dans le monde", qui réunit les 200 phrases les plus indispensables lorsque vous voyagez à l’étranger, classées par ordre alphabétique, et traduites en 13 langues parmi les plus parlées dans le monde. Et enfin, en avril 2020, en pleine crise sanitaire de Covid-19, il met en ligne le DiCovid-19, premier vrai dictionnaire consacré à cette épidémie, qui regroupe 230 termes, dont les définitions ont été soigneusement élaborées pour permettre aux citoyens de mieux comprendre la situation qu’ils vivent. En 2012, il a été fait Citoyen d’honneur de Saint-Orens de Gameville, où il réside et reçoit des mains du maire la médaille de la ville. Durant quarante ans, il aura eu à cœur de défendre la langue française contre le danger d’anglicisation des vocabulaires techniques et scientifiques, de lutter contre le danger d’appauvrissement de la langue française et de favoriser le dialogue des langues. Amoureux de sa Bigorre natale, il fut aussi l’initiateur du projet de construction d’un Centre de maintenance aéronautique européen (CMAE) sur l’aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. En 1997, il prit l’initiative de solliciter la CCI de Tarbes afin de lui présenter son idée de créer sur la zone aéroportuaire un vaste complexe aéronautique, qui emploierait plus d’un millier de personnes. De 1997 à 2005, il collaborera activement avec la CCI de Tarbes pour monter ce projet ambitieux. En dépit de tous ses efforts et de toutes les volontés politiques et institutionnelles déployées localement, ce grand centre de maintenance d’avions de ligne ne verra pas le jour. Mais en compensation, il sera décidé la création en 2006, d’un centre de déconstruction d’avions : la société Tarmac Aerosave, issue d’un partenariat d’industriels et basée actuellement à Ossun. Marié en 1972 avec Monique Durocher, son indéfectible soutien, originaire d’Arcizans-Avant, ils sont les parents heureux de 3 enfants : l’aîné, Thierry, qui édite des topo-guides ainsi que les aventures de Pitou le petit isard, Jérôme, le cadet, qui s’est chargé de la mise en application numérique des dictionnaires et la benjamine, Magali, qui est à l’origine du dictionnaire de dialogue médical français/anglais.GRANGE Jean-Baptiste (1984-XXXX)
Skieur alpin double champion du monde de slalom, dont la famille maternelle est Lourdaise
 Jean-Baptiste GRANGE, né dans une famille de skieurs le 10 octobre 1984 à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie, est double champion du monde de slalom 2011 et 2015 et vainqueur de la Coupe du monde en 2009. Il est également médaillé de bronze en slalom aux mondiaux 2007 à Åre en Suède, et auteur de neuf succès (huit en slalom, un en combiné) en Coupe du monde. Il est le seul skieur français à avoir remporté deux titres mondiaux en slalom, et le premier français à être sacré champion du monde de ski alpin depuis Michel Vion en 1982. Il participa trois fois aux Jeux olympiques d'hiver (en 2006, 2014 et 2018) sans gagner de médaille. Sa mère et son père sont tous les deux d’anciens skieurs de haut niveau membres de l’équipe de France dans les années 70, ainsi que sa tante Bernadette et son oncle Christian, directeur de l’ESF de Valloire. Mais Jean-Baptiste Grange a du sang et des racines lourdaises du côté de sa famille maternelle. Son grand-père, René Levrel, fondateur du club de gymnastique à Lourdes, a donné son nom à la salle de gym lorsque celle-ci a été transférée des anciens abattoirs au Palais des sports de Lannedarré en 1989. Mais c'est surtout sa maman, Annick Levrel, née en 1956 à Lourdes, qui a transmis le virus de la glisse à Jean-Baptiste. Annick a fait ses premiers pas sur la neige au sein du Ski-Club lourdais, avec ses meilleures copines, Danièle et Dominique Fanlou. Annick se révèlera fort douée en ski et gravira rapidement les échelons avec ses deux amies. Elle accèdera à l'équipe de France Espoirs. Malgré le haut niveau du ski pyrénéen de l'époque, Annick doit se résoudre à quitter Lourdes, à 15 ans et demi, pour entrer en section sport-études à Villard-de-Lans. Et, c'est à l'équipe de France, skis aux pieds, qu'elle rencontrera son futur mari Jean-Pierre Grange. Comme toute skieuse pyrénéenne de bon rang, à l’exemple d’Annie Famose ou d’Isabelle Mir, Annick Levrel exportera son talent dans les Alpes. Elle s’y établira avec son mari, devient prof de gym et aura trois enfants, dont deux fils : François-Cyril, d'un bon niveau, qui a allumé la flamme olympique des Jeux d'Albertville en 1992 avec Michel Platini, Jean-Baptiste, le second de la fratrie, qui fut entraîné par sa mère jusqu'en minime avant d'intégrer les filières de formation de la Fédération française, et de prendre son envol pour les sommets avec, à 22 ans à peine, une médaille de bronze mondiale, et à 26 ans, la première médaille d’or de sa carrière, ainsi que leur sœur Alexia, restée proche de l'équipe de France, dont elle s'amusa à tricoter les bandeaux aux couleurs nationales. Jean-Baptiste a fait sa première descente à l’âge de deux ans avec ses parents, tous les deux membres de l’équipe de France de ski alpin, qui le feront inscrire au Ski Club de Valloire-Galibier. Petit, il ne rêvait pas forcément de décrocher des médailles ou d’être champion olympique, mais surtout de faire partie des meilleurs skieurs du monde. Il était programmé pour devenir champion, mais à l'âge de 10 ans, en raison d'une double hernie discale, il porte un corset et marche comme un vieux. Contre l'avis du médecin, il prend quand même la direction de la section ski de son collège savoyard. C'est à l'encontre de ce diagnostic, qu'il intègre une formation « ski-étude » au collège à Modane, dont est responsable sa mère. La suite montrera qu’il avait fait le bon choix. Vainqueur de la Coupe du monde de slalom en 2009, il se voit décerner le globe de cristal de la spécialité, puis champion du monde en 2011 à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne, enfin il remporte son deuxième titre en 2015 à Beaver Creek dans le Colorado, après quatre ans sans voir un seul podium à cause notamment des blessures et des douleurs au dos qui rythment sa carrière. "J'ai du mal à réaliser. J'étais à dix mille lieues de penser que j'avais la force de faire ça. Il y a eu quatre ans de galère, pas de confiance. Je suis comme dans un rêve. Je me demande quand je vais me réveiller", déclara le champion du monde. Si aux Championnats du monde à Åre en 2007, c’est ce jeune homme discret et réservé qui sauve l’équipe de France du zéro pointé avec le bronze du slalom, il manque d’un rien le globe de cristal de la spécialité l’année suivante, en 2008. Puis aux Mondiaux de Val d’Isère en 2009, dont il est la tête d’affiche et le grand favori, lui, le maître des piquets, laisse deux médailles d’or qui lui étaient promises lui filer sous le nez. Les critiques fusent, il en sera très marqué. Le 6 décembre 2009, la nuit tombe sur sa saison à Beaver Creek. Sans même tomber, son genou droit craque et c’est la très classique déchirure du ligament croisé antérieur. Opération, six mois de rééducation. Le moral dans les chaussettes, Jean-Baptiste Grange voit les promesses de l’or olympique s’envoler. En février 2010, il est donc forfait pour les Jeux olympiques de Vancouver. En novembre 2010, il renaît de ses cendres dès la première épreuve de la Coupe du monde à Levi en Finlande, qu’il domine d’un bout à l’autre. Mais, c’est en guide de la haute montagne bleue que Grange a pu prendre sa revanche le 20 février 2011, en devenant le premier Français au masculin champion du monde de ski alpin depuis 1982. Et pour marquer l'histoire de son sport, il faut l'écrire en lettres dorées. Ce sera chose faite depuis cet après-midi à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne avec ce fabuleux titre mondial. Une médaille d’or que la France attendait depuis 1982, voire depuis le sacre en slalom d’Augert en 1970 ! Jean-Baptiste Grange qui entre définitivement dans la grande histoire du ski français, devenant l’un des plus talentueux skieurs alpins. Une performance qu’il renouvelle quatre ans après son sacre de Garmisch, le dimanche 15 février à Beaver Creek (USA). Dans des conditions météo difficiles, le Mauriennais a réalisé une manche parfaite, survolant le tracé, ne commettant aucune erreur et accédant à la première marche du podium. Ainsi, le skieur de Valloire devient le premier français à remporter deux titres mondiaux en slalom, et le cinquième après Henri Oreiller, Jean-Claude Killy, Émile Allais et Guy Périllat à remporter au moins deux titres mondiaux. Son palmarès en France : 3e aux championnats de France de slalom géant en 2008 ; triple champion de France de slalom en 2006, 2009 et 2015 ; vice-champion de France de slalom en 2008 et 2016, 3e en 2017 et 2018. Militaire de l'armée de Terre, il vit depuis sa naissance à Valloire en région Rhône-Alpes. Le 12 avril 2009, il fut promu au titre de Chevalier de la Légion d'honneur et en juin 2009, après avoir remporté son globe de cristal de slalom, il fut élu skieur le plus populaire en France. Nul doute aussi que ce slalomeur prodige, fils et petit-fils de Bigourdans bien connus, aura durant toutes ces années de grand champion, fait la fierté de sa famille restée ancrée dans le piémont pyrénéen.
Jean-Baptiste GRANGE, né dans une famille de skieurs le 10 octobre 1984 à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie, est double champion du monde de slalom 2011 et 2015 et vainqueur de la Coupe du monde en 2009. Il est également médaillé de bronze en slalom aux mondiaux 2007 à Åre en Suède, et auteur de neuf succès (huit en slalom, un en combiné) en Coupe du monde. Il est le seul skieur français à avoir remporté deux titres mondiaux en slalom, et le premier français à être sacré champion du monde de ski alpin depuis Michel Vion en 1982. Il participa trois fois aux Jeux olympiques d'hiver (en 2006, 2014 et 2018) sans gagner de médaille. Sa mère et son père sont tous les deux d’anciens skieurs de haut niveau membres de l’équipe de France dans les années 70, ainsi que sa tante Bernadette et son oncle Christian, directeur de l’ESF de Valloire. Mais Jean-Baptiste Grange a du sang et des racines lourdaises du côté de sa famille maternelle. Son grand-père, René Levrel, fondateur du club de gymnastique à Lourdes, a donné son nom à la salle de gym lorsque celle-ci a été transférée des anciens abattoirs au Palais des sports de Lannedarré en 1989. Mais c'est surtout sa maman, Annick Levrel, née en 1956 à Lourdes, qui a transmis le virus de la glisse à Jean-Baptiste. Annick a fait ses premiers pas sur la neige au sein du Ski-Club lourdais, avec ses meilleures copines, Danièle et Dominique Fanlou. Annick se révèlera fort douée en ski et gravira rapidement les échelons avec ses deux amies. Elle accèdera à l'équipe de France Espoirs. Malgré le haut niveau du ski pyrénéen de l'époque, Annick doit se résoudre à quitter Lourdes, à 15 ans et demi, pour entrer en section sport-études à Villard-de-Lans. Et, c'est à l'équipe de France, skis aux pieds, qu'elle rencontrera son futur mari Jean-Pierre Grange. Comme toute skieuse pyrénéenne de bon rang, à l’exemple d’Annie Famose ou d’Isabelle Mir, Annick Levrel exportera son talent dans les Alpes. Elle s’y établira avec son mari, devient prof de gym et aura trois enfants, dont deux fils : François-Cyril, d'un bon niveau, qui a allumé la flamme olympique des Jeux d'Albertville en 1992 avec Michel Platini, Jean-Baptiste, le second de la fratrie, qui fut entraîné par sa mère jusqu'en minime avant d'intégrer les filières de formation de la Fédération française, et de prendre son envol pour les sommets avec, à 22 ans à peine, une médaille de bronze mondiale, et à 26 ans, la première médaille d’or de sa carrière, ainsi que leur sœur Alexia, restée proche de l'équipe de France, dont elle s'amusa à tricoter les bandeaux aux couleurs nationales. Jean-Baptiste a fait sa première descente à l’âge de deux ans avec ses parents, tous les deux membres de l’équipe de France de ski alpin, qui le feront inscrire au Ski Club de Valloire-Galibier. Petit, il ne rêvait pas forcément de décrocher des médailles ou d’être champion olympique, mais surtout de faire partie des meilleurs skieurs du monde. Il était programmé pour devenir champion, mais à l'âge de 10 ans, en raison d'une double hernie discale, il porte un corset et marche comme un vieux. Contre l'avis du médecin, il prend quand même la direction de la section ski de son collège savoyard. C'est à l'encontre de ce diagnostic, qu'il intègre une formation « ski-étude » au collège à Modane, dont est responsable sa mère. La suite montrera qu’il avait fait le bon choix. Vainqueur de la Coupe du monde de slalom en 2009, il se voit décerner le globe de cristal de la spécialité, puis champion du monde en 2011 à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne, enfin il remporte son deuxième titre en 2015 à Beaver Creek dans le Colorado, après quatre ans sans voir un seul podium à cause notamment des blessures et des douleurs au dos qui rythment sa carrière. "J'ai du mal à réaliser. J'étais à dix mille lieues de penser que j'avais la force de faire ça. Il y a eu quatre ans de galère, pas de confiance. Je suis comme dans un rêve. Je me demande quand je vais me réveiller", déclara le champion du monde. Si aux Championnats du monde à Åre en 2007, c’est ce jeune homme discret et réservé qui sauve l’équipe de France du zéro pointé avec le bronze du slalom, il manque d’un rien le globe de cristal de la spécialité l’année suivante, en 2008. Puis aux Mondiaux de Val d’Isère en 2009, dont il est la tête d’affiche et le grand favori, lui, le maître des piquets, laisse deux médailles d’or qui lui étaient promises lui filer sous le nez. Les critiques fusent, il en sera très marqué. Le 6 décembre 2009, la nuit tombe sur sa saison à Beaver Creek. Sans même tomber, son genou droit craque et c’est la très classique déchirure du ligament croisé antérieur. Opération, six mois de rééducation. Le moral dans les chaussettes, Jean-Baptiste Grange voit les promesses de l’or olympique s’envoler. En février 2010, il est donc forfait pour les Jeux olympiques de Vancouver. En novembre 2010, il renaît de ses cendres dès la première épreuve de la Coupe du monde à Levi en Finlande, qu’il domine d’un bout à l’autre. Mais, c’est en guide de la haute montagne bleue que Grange a pu prendre sa revanche le 20 février 2011, en devenant le premier Français au masculin champion du monde de ski alpin depuis 1982. Et pour marquer l'histoire de son sport, il faut l'écrire en lettres dorées. Ce sera chose faite depuis cet après-midi à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne avec ce fabuleux titre mondial. Une médaille d’or que la France attendait depuis 1982, voire depuis le sacre en slalom d’Augert en 1970 ! Jean-Baptiste Grange qui entre définitivement dans la grande histoire du ski français, devenant l’un des plus talentueux skieurs alpins. Une performance qu’il renouvelle quatre ans après son sacre de Garmisch, le dimanche 15 février à Beaver Creek (USA). Dans des conditions météo difficiles, le Mauriennais a réalisé une manche parfaite, survolant le tracé, ne commettant aucune erreur et accédant à la première marche du podium. Ainsi, le skieur de Valloire devient le premier français à remporter deux titres mondiaux en slalom, et le cinquième après Henri Oreiller, Jean-Claude Killy, Émile Allais et Guy Périllat à remporter au moins deux titres mondiaux. Son palmarès en France : 3e aux championnats de France de slalom géant en 2008 ; triple champion de France de slalom en 2006, 2009 et 2015 ; vice-champion de France de slalom en 2008 et 2016, 3e en 2017 et 2018. Militaire de l'armée de Terre, il vit depuis sa naissance à Valloire en région Rhône-Alpes. Le 12 avril 2009, il fut promu au titre de Chevalier de la Légion d'honneur et en juin 2009, après avoir remporté son globe de cristal de slalom, il fut élu skieur le plus populaire en France. Nul doute aussi que ce slalomeur prodige, fils et petit-fils de Bigourdans bien connus, aura durant toutes ces années de grand champion, fait la fierté de sa famille restée ancrée dans le piémont pyrénéen.
 Jean-Baptiste GRANGE, né dans une famille de skieurs le 10 octobre 1984 à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie, est double champion du monde de slalom 2011 et 2015 et vainqueur de la Coupe du monde en 2009. Il est également médaillé de bronze en slalom aux mondiaux 2007 à Åre en Suède, et auteur de neuf succès (huit en slalom, un en combiné) en Coupe du monde. Il est le seul skieur français à avoir remporté deux titres mondiaux en slalom, et le premier français à être sacré champion du monde de ski alpin depuis Michel Vion en 1982. Il participa trois fois aux Jeux olympiques d'hiver (en 2006, 2014 et 2018) sans gagner de médaille. Sa mère et son père sont tous les deux d’anciens skieurs de haut niveau membres de l’équipe de France dans les années 70, ainsi que sa tante Bernadette et son oncle Christian, directeur de l’ESF de Valloire. Mais Jean-Baptiste Grange a du sang et des racines lourdaises du côté de sa famille maternelle. Son grand-père, René Levrel, fondateur du club de gymnastique à Lourdes, a donné son nom à la salle de gym lorsque celle-ci a été transférée des anciens abattoirs au Palais des sports de Lannedarré en 1989. Mais c'est surtout sa maman, Annick Levrel, née en 1956 à Lourdes, qui a transmis le virus de la glisse à Jean-Baptiste. Annick a fait ses premiers pas sur la neige au sein du Ski-Club lourdais, avec ses meilleures copines, Danièle et Dominique Fanlou. Annick se révèlera fort douée en ski et gravira rapidement les échelons avec ses deux amies. Elle accèdera à l'équipe de France Espoirs. Malgré le haut niveau du ski pyrénéen de l'époque, Annick doit se résoudre à quitter Lourdes, à 15 ans et demi, pour entrer en section sport-études à Villard-de-Lans. Et, c'est à l'équipe de France, skis aux pieds, qu'elle rencontrera son futur mari Jean-Pierre Grange. Comme toute skieuse pyrénéenne de bon rang, à l’exemple d’Annie Famose ou d’Isabelle Mir, Annick Levrel exportera son talent dans les Alpes. Elle s’y établira avec son mari, devient prof de gym et aura trois enfants, dont deux fils : François-Cyril, d'un bon niveau, qui a allumé la flamme olympique des Jeux d'Albertville en 1992 avec Michel Platini, Jean-Baptiste, le second de la fratrie, qui fut entraîné par sa mère jusqu'en minime avant d'intégrer les filières de formation de la Fédération française, et de prendre son envol pour les sommets avec, à 22 ans à peine, une médaille de bronze mondiale, et à 26 ans, la première médaille d’or de sa carrière, ainsi que leur sœur Alexia, restée proche de l'équipe de France, dont elle s'amusa à tricoter les bandeaux aux couleurs nationales. Jean-Baptiste a fait sa première descente à l’âge de deux ans avec ses parents, tous les deux membres de l’équipe de France de ski alpin, qui le feront inscrire au Ski Club de Valloire-Galibier. Petit, il ne rêvait pas forcément de décrocher des médailles ou d’être champion olympique, mais surtout de faire partie des meilleurs skieurs du monde. Il était programmé pour devenir champion, mais à l'âge de 10 ans, en raison d'une double hernie discale, il porte un corset et marche comme un vieux. Contre l'avis du médecin, il prend quand même la direction de la section ski de son collège savoyard. C'est à l'encontre de ce diagnostic, qu'il intègre une formation « ski-étude » au collège à Modane, dont est responsable sa mère. La suite montrera qu’il avait fait le bon choix. Vainqueur de la Coupe du monde de slalom en 2009, il se voit décerner le globe de cristal de la spécialité, puis champion du monde en 2011 à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne, enfin il remporte son deuxième titre en 2015 à Beaver Creek dans le Colorado, après quatre ans sans voir un seul podium à cause notamment des blessures et des douleurs au dos qui rythment sa carrière. "J'ai du mal à réaliser. J'étais à dix mille lieues de penser que j'avais la force de faire ça. Il y a eu quatre ans de galère, pas de confiance. Je suis comme dans un rêve. Je me demande quand je vais me réveiller", déclara le champion du monde. Si aux Championnats du monde à Åre en 2007, c’est ce jeune homme discret et réservé qui sauve l’équipe de France du zéro pointé avec le bronze du slalom, il manque d’un rien le globe de cristal de la spécialité l’année suivante, en 2008. Puis aux Mondiaux de Val d’Isère en 2009, dont il est la tête d’affiche et le grand favori, lui, le maître des piquets, laisse deux médailles d’or qui lui étaient promises lui filer sous le nez. Les critiques fusent, il en sera très marqué. Le 6 décembre 2009, la nuit tombe sur sa saison à Beaver Creek. Sans même tomber, son genou droit craque et c’est la très classique déchirure du ligament croisé antérieur. Opération, six mois de rééducation. Le moral dans les chaussettes, Jean-Baptiste Grange voit les promesses de l’or olympique s’envoler. En février 2010, il est donc forfait pour les Jeux olympiques de Vancouver. En novembre 2010, il renaît de ses cendres dès la première épreuve de la Coupe du monde à Levi en Finlande, qu’il domine d’un bout à l’autre. Mais, c’est en guide de la haute montagne bleue que Grange a pu prendre sa revanche le 20 février 2011, en devenant le premier Français au masculin champion du monde de ski alpin depuis 1982. Et pour marquer l'histoire de son sport, il faut l'écrire en lettres dorées. Ce sera chose faite depuis cet après-midi à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne avec ce fabuleux titre mondial. Une médaille d’or que la France attendait depuis 1982, voire depuis le sacre en slalom d’Augert en 1970 ! Jean-Baptiste Grange qui entre définitivement dans la grande histoire du ski français, devenant l’un des plus talentueux skieurs alpins. Une performance qu’il renouvelle quatre ans après son sacre de Garmisch, le dimanche 15 février à Beaver Creek (USA). Dans des conditions météo difficiles, le Mauriennais a réalisé une manche parfaite, survolant le tracé, ne commettant aucune erreur et accédant à la première marche du podium. Ainsi, le skieur de Valloire devient le premier français à remporter deux titres mondiaux en slalom, et le cinquième après Henri Oreiller, Jean-Claude Killy, Émile Allais et Guy Périllat à remporter au moins deux titres mondiaux. Son palmarès en France : 3e aux championnats de France de slalom géant en 2008 ; triple champion de France de slalom en 2006, 2009 et 2015 ; vice-champion de France de slalom en 2008 et 2016, 3e en 2017 et 2018. Militaire de l'armée de Terre, il vit depuis sa naissance à Valloire en région Rhône-Alpes. Le 12 avril 2009, il fut promu au titre de Chevalier de la Légion d'honneur et en juin 2009, après avoir remporté son globe de cristal de slalom, il fut élu skieur le plus populaire en France. Nul doute aussi que ce slalomeur prodige, fils et petit-fils de Bigourdans bien connus, aura durant toutes ces années de grand champion, fait la fierté de sa famille restée ancrée dans le piémont pyrénéen.
Jean-Baptiste GRANGE, né dans une famille de skieurs le 10 octobre 1984 à Saint-Jean-de-Maurienne en Savoie, est double champion du monde de slalom 2011 et 2015 et vainqueur de la Coupe du monde en 2009. Il est également médaillé de bronze en slalom aux mondiaux 2007 à Åre en Suède, et auteur de neuf succès (huit en slalom, un en combiné) en Coupe du monde. Il est le seul skieur français à avoir remporté deux titres mondiaux en slalom, et le premier français à être sacré champion du monde de ski alpin depuis Michel Vion en 1982. Il participa trois fois aux Jeux olympiques d'hiver (en 2006, 2014 et 2018) sans gagner de médaille. Sa mère et son père sont tous les deux d’anciens skieurs de haut niveau membres de l’équipe de France dans les années 70, ainsi que sa tante Bernadette et son oncle Christian, directeur de l’ESF de Valloire. Mais Jean-Baptiste Grange a du sang et des racines lourdaises du côté de sa famille maternelle. Son grand-père, René Levrel, fondateur du club de gymnastique à Lourdes, a donné son nom à la salle de gym lorsque celle-ci a été transférée des anciens abattoirs au Palais des sports de Lannedarré en 1989. Mais c'est surtout sa maman, Annick Levrel, née en 1956 à Lourdes, qui a transmis le virus de la glisse à Jean-Baptiste. Annick a fait ses premiers pas sur la neige au sein du Ski-Club lourdais, avec ses meilleures copines, Danièle et Dominique Fanlou. Annick se révèlera fort douée en ski et gravira rapidement les échelons avec ses deux amies. Elle accèdera à l'équipe de France Espoirs. Malgré le haut niveau du ski pyrénéen de l'époque, Annick doit se résoudre à quitter Lourdes, à 15 ans et demi, pour entrer en section sport-études à Villard-de-Lans. Et, c'est à l'équipe de France, skis aux pieds, qu'elle rencontrera son futur mari Jean-Pierre Grange. Comme toute skieuse pyrénéenne de bon rang, à l’exemple d’Annie Famose ou d’Isabelle Mir, Annick Levrel exportera son talent dans les Alpes. Elle s’y établira avec son mari, devient prof de gym et aura trois enfants, dont deux fils : François-Cyril, d'un bon niveau, qui a allumé la flamme olympique des Jeux d'Albertville en 1992 avec Michel Platini, Jean-Baptiste, le second de la fratrie, qui fut entraîné par sa mère jusqu'en minime avant d'intégrer les filières de formation de la Fédération française, et de prendre son envol pour les sommets avec, à 22 ans à peine, une médaille de bronze mondiale, et à 26 ans, la première médaille d’or de sa carrière, ainsi que leur sœur Alexia, restée proche de l'équipe de France, dont elle s'amusa à tricoter les bandeaux aux couleurs nationales. Jean-Baptiste a fait sa première descente à l’âge de deux ans avec ses parents, tous les deux membres de l’équipe de France de ski alpin, qui le feront inscrire au Ski Club de Valloire-Galibier. Petit, il ne rêvait pas forcément de décrocher des médailles ou d’être champion olympique, mais surtout de faire partie des meilleurs skieurs du monde. Il était programmé pour devenir champion, mais à l'âge de 10 ans, en raison d'une double hernie discale, il porte un corset et marche comme un vieux. Contre l'avis du médecin, il prend quand même la direction de la section ski de son collège savoyard. C'est à l'encontre de ce diagnostic, qu'il intègre une formation « ski-étude » au collège à Modane, dont est responsable sa mère. La suite montrera qu’il avait fait le bon choix. Vainqueur de la Coupe du monde de slalom en 2009, il se voit décerner le globe de cristal de la spécialité, puis champion du monde en 2011 à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne, enfin il remporte son deuxième titre en 2015 à Beaver Creek dans le Colorado, après quatre ans sans voir un seul podium à cause notamment des blessures et des douleurs au dos qui rythment sa carrière. "J'ai du mal à réaliser. J'étais à dix mille lieues de penser que j'avais la force de faire ça. Il y a eu quatre ans de galère, pas de confiance. Je suis comme dans un rêve. Je me demande quand je vais me réveiller", déclara le champion du monde. Si aux Championnats du monde à Åre en 2007, c’est ce jeune homme discret et réservé qui sauve l’équipe de France du zéro pointé avec le bronze du slalom, il manque d’un rien le globe de cristal de la spécialité l’année suivante, en 2008. Puis aux Mondiaux de Val d’Isère en 2009, dont il est la tête d’affiche et le grand favori, lui, le maître des piquets, laisse deux médailles d’or qui lui étaient promises lui filer sous le nez. Les critiques fusent, il en sera très marqué. Le 6 décembre 2009, la nuit tombe sur sa saison à Beaver Creek. Sans même tomber, son genou droit craque et c’est la très classique déchirure du ligament croisé antérieur. Opération, six mois de rééducation. Le moral dans les chaussettes, Jean-Baptiste Grange voit les promesses de l’or olympique s’envoler. En février 2010, il est donc forfait pour les Jeux olympiques de Vancouver. En novembre 2010, il renaît de ses cendres dès la première épreuve de la Coupe du monde à Levi en Finlande, qu’il domine d’un bout à l’autre. Mais, c’est en guide de la haute montagne bleue que Grange a pu prendre sa revanche le 20 février 2011, en devenant le premier Français au masculin champion du monde de ski alpin depuis 1982. Et pour marquer l'histoire de son sport, il faut l'écrire en lettres dorées. Ce sera chose faite depuis cet après-midi à Garmisch-Partenkirchen en Allemagne avec ce fabuleux titre mondial. Une médaille d’or que la France attendait depuis 1982, voire depuis le sacre en slalom d’Augert en 1970 ! Jean-Baptiste Grange qui entre définitivement dans la grande histoire du ski français, devenant l’un des plus talentueux skieurs alpins. Une performance qu’il renouvelle quatre ans après son sacre de Garmisch, le dimanche 15 février à Beaver Creek (USA). Dans des conditions météo difficiles, le Mauriennais a réalisé une manche parfaite, survolant le tracé, ne commettant aucune erreur et accédant à la première marche du podium. Ainsi, le skieur de Valloire devient le premier français à remporter deux titres mondiaux en slalom, et le cinquième après Henri Oreiller, Jean-Claude Killy, Émile Allais et Guy Périllat à remporter au moins deux titres mondiaux. Son palmarès en France : 3e aux championnats de France de slalom géant en 2008 ; triple champion de France de slalom en 2006, 2009 et 2015 ; vice-champion de France de slalom en 2008 et 2016, 3e en 2017 et 2018. Militaire de l'armée de Terre, il vit depuis sa naissance à Valloire en région Rhône-Alpes. Le 12 avril 2009, il fut promu au titre de Chevalier de la Légion d'honneur et en juin 2009, après avoir remporté son globe de cristal de slalom, il fut élu skieur le plus populaire en France. Nul doute aussi que ce slalomeur prodige, fils et petit-fils de Bigourdans bien connus, aura durant toutes ces années de grand champion, fait la fierté de sa famille restée ancrée dans le piémont pyrénéen.GUTH Paul (1910-1997)
Professeur de lettres, artiste, écrivain, journaliste
 Paul GUTH, né le 5 mars 1910 à Ossun et mort le 29 octobre 1997 à Ville-d’Avray, à l’âge de 87 ans. Il est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages parfois teintés d’histoire, d’anecdotes contemporaines ou de critiques sur ce qu’il considérait comme les maux de son siècle. Il fit partie des premiers comités de la Société des poètes et artistes de France à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Issu d’une famille modeste, son père était mécanicien à Toulouse, ses parents habitaient Villeneuve-sur-Lot, ses grands-parents étaient des paysans. Sa mère d’origine bigourdane, était venue accoucher dans la maison familiale d’Ossun. S’il passa toute son enfance à Villeneuve-sur-Lot, il revenait régulièrement à Ossun, lors des vacances scolaires. Il fera de brillantes études à Villeneuve-sur-Lot, et le bac en poche il poursuivra au lycée Louis-le-Grand à Paris (où il obtiendra un prix d’Excellence), afin de préparer l’École normale supérieure avec comme condisciple Thierry Maulnier. Il appela cette classe la « Khâgne des Années folles », qui réunissait Robert Brasillach, Maurice Bardèche, René Étiemble, Paul Guth lui-même, Robert Merle, Henri Queffelec, Roger Vailland, Georges Pompidou, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Louis Achille et le Vietnamien Pham Duy Khiem. Puis il fera des études supérieures à la Sorbonne et deviendra en 1933 un des plus jeunes agrégés de France. Le 6 avril 1936, il épousa à Grasse, Juliette Loubère, une villeneuvoise, qu’il connaissait depuis l’enfance. Pendant dix ans, de 1933 à 1944, il sera professeur de français, latin et grec aux lycées de Dijon, de Rouen puis de Janson-de-Sailly à Paris, où il eut notamment pour élève, Valéry Giscard d’Estaing, ancien Président de la République. Il avait la vocation pédagogique chevillée au corps. Après la Libération, il abandonnera l’enseignement et se consacrera d’abord à la littérature puis au journalisme et à la radio. En 1946, il obtiendra même le Prix du Théâtre pour « Fugues ». En 1953, il publiera « Les Mémoires d’un Naïf », premier roman à succès d’une chronique qui comptera sept volumes. Il y raconte la vie de son personnage récurrent, « le Naïf », professeur de français, qui sous une grande naïveté, cache une imagination fertile. Une série d’ouvrages qui feront sa notoriété. Son œuvre comprend aussi une série romanesque de quatre volumes sur Jeanne la Mince qu’il publia entre 1960 et 1969. Dans cette série, il retrace la vie d’une jeune femme, Jeanne la Mince, qui part à la découverte du monde. Il reviendra au roman en 1977 avec « Le Chat Beauté », un livre d’une brûlante actualité, où hardiment, il règle ses comptes avec lui-même, avec les autres, avec la vie. La même année, toujours aussi narquois et réactionnaire, il publiera « Notre drôle d’époque comme si vous y étiez », où il s’en prend à l’étrange existence que nous menons tous, dans tous les domaines. En 1976, « les Lettres à votre fils qui en a ras le bol » seront un cri d’amour pour les jeunes et d’espoir en leur bonheur et leur courage. Il évoque également sans détour la plupart des problèmes de la jeunesse. Trois ans plus tard, dans « Lettre ouverte aux futurs illettrés », il s’adresse avec une foi et une passion déchirantes, à un jeune lycéen, qu’il appelle Jacques, et le met en garde sur l’avenir qui l’attend comme les cinquante millions de « taupes » qui peuplaient alors notre cher pays. Par ailleurs, il aura également participé à la rédaction de livres pour enfants. Parmi eux, en 1944, il publia chez Gallimard « Les Passagers de la Grande Ourse » en compagnie de Paul Grimault. Le livre raconte une histoire pour enfants, relatant les péripéties de Gô et de son petit chien Sniff, qui s’introduisent sur le chantier en construction d’un aéroscaphe baptisé « La Grande Ourse ». En 1984, il écrivit « Une enfance pour la vie », un ouvrage dans lequel il revient sur son enfance et son adolescence passées à Villeneuve-sur-Lot. Pour ce livre, il obtiendra le prix Chateaubriand. Il interviendra souvent à la télévision, dans des émissions plus ou moins culturelles comme « les Grosses Têtes » sur RTL. Sa diction précieuse en faisait un invité de choix dans un style « Vieille France ». On lui doit aussi une exceptionnelle biographie de Mazarin et une non moins exceptionnelle Histoire de la littérature française. Il avait obtenu plusieurs fois le prix de l’Académie française, et malgré plusieurs tentatives n’y sera jamais élu (1987, « Discours de déception à l’Académie française » édité chez Plon). Candidat en 1973, il sera battu par Jean d’Ormesson. Ce fut un de ses plus grands regrets sans doute. Enfin, en 1994, après cinquante ans de vie littéraire, c’est en philosophe qu’il livrera ses réflexions sur notre société et ses contemporains. Peu de temps après son décès, la famille Guth fit don de 6 000 livres ayant appartenu à l’écrivain à la ville de Villeneuve-sur-Lot. Parmi ces ouvrages des manuscrits inédits, la correspondance avec des écrivains célèbres des années 50 à 70 (et en particulier Marcel Pagnol) ainsi que des toiles de maîtres. Les dons ont été répartis entre la bibliothèque municipale et le musée de Gajac. En 1980, il avait été nommé Citoyen d’honneur de Villeneuve-sur-Lot. Quelques citations de Paul Guth : « La chance, c’est ce qu’on ne mérite pas », « Jadis les analphabètes étaient ceux qui n’allaient pas à l’école ; aujourd’hui ce sont ceux qui y vont », « Fonder la culture sur le présent et la vitesse, c’est l’asseoir sur du vent », Construire du neuf sur le présent c’est bâtir du néant sur du rien », « Les jaloux détruisent ce qu’ils sont incapables de créer ». Président de l’Académie des provinces françaises, romancier, essayiste, chroniqueur, mémorialiste, historien, pamphlétaire, il excella dans tous les genres en mêlant toujours une tendre patte de velours à sa griffe acérée.
Paul GUTH, né le 5 mars 1910 à Ossun et mort le 29 octobre 1997 à Ville-d’Avray, à l’âge de 87 ans. Il est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages parfois teintés d’histoire, d’anecdotes contemporaines ou de critiques sur ce qu’il considérait comme les maux de son siècle. Il fit partie des premiers comités de la Société des poètes et artistes de France à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Issu d’une famille modeste, son père était mécanicien à Toulouse, ses parents habitaient Villeneuve-sur-Lot, ses grands-parents étaient des paysans. Sa mère d’origine bigourdane, était venue accoucher dans la maison familiale d’Ossun. S’il passa toute son enfance à Villeneuve-sur-Lot, il revenait régulièrement à Ossun, lors des vacances scolaires. Il fera de brillantes études à Villeneuve-sur-Lot, et le bac en poche il poursuivra au lycée Louis-le-Grand à Paris (où il obtiendra un prix d’Excellence), afin de préparer l’École normale supérieure avec comme condisciple Thierry Maulnier. Il appela cette classe la « Khâgne des Années folles », qui réunissait Robert Brasillach, Maurice Bardèche, René Étiemble, Paul Guth lui-même, Robert Merle, Henri Queffelec, Roger Vailland, Georges Pompidou, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Louis Achille et le Vietnamien Pham Duy Khiem. Puis il fera des études supérieures à la Sorbonne et deviendra en 1933 un des plus jeunes agrégés de France. Le 6 avril 1936, il épousa à Grasse, Juliette Loubère, une villeneuvoise, qu’il connaissait depuis l’enfance. Pendant dix ans, de 1933 à 1944, il sera professeur de français, latin et grec aux lycées de Dijon, de Rouen puis de Janson-de-Sailly à Paris, où il eut notamment pour élève, Valéry Giscard d’Estaing, ancien Président de la République. Il avait la vocation pédagogique chevillée au corps. Après la Libération, il abandonnera l’enseignement et se consacrera d’abord à la littérature puis au journalisme et à la radio. En 1946, il obtiendra même le Prix du Théâtre pour « Fugues ». En 1953, il publiera « Les Mémoires d’un Naïf », premier roman à succès d’une chronique qui comptera sept volumes. Il y raconte la vie de son personnage récurrent, « le Naïf », professeur de français, qui sous une grande naïveté, cache une imagination fertile. Une série d’ouvrages qui feront sa notoriété. Son œuvre comprend aussi une série romanesque de quatre volumes sur Jeanne la Mince qu’il publia entre 1960 et 1969. Dans cette série, il retrace la vie d’une jeune femme, Jeanne la Mince, qui part à la découverte du monde. Il reviendra au roman en 1977 avec « Le Chat Beauté », un livre d’une brûlante actualité, où hardiment, il règle ses comptes avec lui-même, avec les autres, avec la vie. La même année, toujours aussi narquois et réactionnaire, il publiera « Notre drôle d’époque comme si vous y étiez », où il s’en prend à l’étrange existence que nous menons tous, dans tous les domaines. En 1976, « les Lettres à votre fils qui en a ras le bol » seront un cri d’amour pour les jeunes et d’espoir en leur bonheur et leur courage. Il évoque également sans détour la plupart des problèmes de la jeunesse. Trois ans plus tard, dans « Lettre ouverte aux futurs illettrés », il s’adresse avec une foi et une passion déchirantes, à un jeune lycéen, qu’il appelle Jacques, et le met en garde sur l’avenir qui l’attend comme les cinquante millions de « taupes » qui peuplaient alors notre cher pays. Par ailleurs, il aura également participé à la rédaction de livres pour enfants. Parmi eux, en 1944, il publia chez Gallimard « Les Passagers de la Grande Ourse » en compagnie de Paul Grimault. Le livre raconte une histoire pour enfants, relatant les péripéties de Gô et de son petit chien Sniff, qui s’introduisent sur le chantier en construction d’un aéroscaphe baptisé « La Grande Ourse ». En 1984, il écrivit « Une enfance pour la vie », un ouvrage dans lequel il revient sur son enfance et son adolescence passées à Villeneuve-sur-Lot. Pour ce livre, il obtiendra le prix Chateaubriand. Il interviendra souvent à la télévision, dans des émissions plus ou moins culturelles comme « les Grosses Têtes » sur RTL. Sa diction précieuse en faisait un invité de choix dans un style « Vieille France ». On lui doit aussi une exceptionnelle biographie de Mazarin et une non moins exceptionnelle Histoire de la littérature française. Il avait obtenu plusieurs fois le prix de l’Académie française, et malgré plusieurs tentatives n’y sera jamais élu (1987, « Discours de déception à l’Académie française » édité chez Plon). Candidat en 1973, il sera battu par Jean d’Ormesson. Ce fut un de ses plus grands regrets sans doute. Enfin, en 1994, après cinquante ans de vie littéraire, c’est en philosophe qu’il livrera ses réflexions sur notre société et ses contemporains. Peu de temps après son décès, la famille Guth fit don de 6 000 livres ayant appartenu à l’écrivain à la ville de Villeneuve-sur-Lot. Parmi ces ouvrages des manuscrits inédits, la correspondance avec des écrivains célèbres des années 50 à 70 (et en particulier Marcel Pagnol) ainsi que des toiles de maîtres. Les dons ont été répartis entre la bibliothèque municipale et le musée de Gajac. En 1980, il avait été nommé Citoyen d’honneur de Villeneuve-sur-Lot. Quelques citations de Paul Guth : « La chance, c’est ce qu’on ne mérite pas », « Jadis les analphabètes étaient ceux qui n’allaient pas à l’école ; aujourd’hui ce sont ceux qui y vont », « Fonder la culture sur le présent et la vitesse, c’est l’asseoir sur du vent », Construire du neuf sur le présent c’est bâtir du néant sur du rien », « Les jaloux détruisent ce qu’ils sont incapables de créer ». Président de l’Académie des provinces françaises, romancier, essayiste, chroniqueur, mémorialiste, historien, pamphlétaire, il excella dans tous les genres en mêlant toujours une tendre patte de velours à sa griffe acérée.
 Paul GUTH, né le 5 mars 1910 à Ossun et mort le 29 octobre 1997 à Ville-d’Avray, à l’âge de 87 ans. Il est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages parfois teintés d’histoire, d’anecdotes contemporaines ou de critiques sur ce qu’il considérait comme les maux de son siècle. Il fit partie des premiers comités de la Société des poètes et artistes de France à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Issu d’une famille modeste, son père était mécanicien à Toulouse, ses parents habitaient Villeneuve-sur-Lot, ses grands-parents étaient des paysans. Sa mère d’origine bigourdane, était venue accoucher dans la maison familiale d’Ossun. S’il passa toute son enfance à Villeneuve-sur-Lot, il revenait régulièrement à Ossun, lors des vacances scolaires. Il fera de brillantes études à Villeneuve-sur-Lot, et le bac en poche il poursuivra au lycée Louis-le-Grand à Paris (où il obtiendra un prix d’Excellence), afin de préparer l’École normale supérieure avec comme condisciple Thierry Maulnier. Il appela cette classe la « Khâgne des Années folles », qui réunissait Robert Brasillach, Maurice Bardèche, René Étiemble, Paul Guth lui-même, Robert Merle, Henri Queffelec, Roger Vailland, Georges Pompidou, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Louis Achille et le Vietnamien Pham Duy Khiem. Puis il fera des études supérieures à la Sorbonne et deviendra en 1933 un des plus jeunes agrégés de France. Le 6 avril 1936, il épousa à Grasse, Juliette Loubère, une villeneuvoise, qu’il connaissait depuis l’enfance. Pendant dix ans, de 1933 à 1944, il sera professeur de français, latin et grec aux lycées de Dijon, de Rouen puis de Janson-de-Sailly à Paris, où il eut notamment pour élève, Valéry Giscard d’Estaing, ancien Président de la République. Il avait la vocation pédagogique chevillée au corps. Après la Libération, il abandonnera l’enseignement et se consacrera d’abord à la littérature puis au journalisme et à la radio. En 1946, il obtiendra même le Prix du Théâtre pour « Fugues ». En 1953, il publiera « Les Mémoires d’un Naïf », premier roman à succès d’une chronique qui comptera sept volumes. Il y raconte la vie de son personnage récurrent, « le Naïf », professeur de français, qui sous une grande naïveté, cache une imagination fertile. Une série d’ouvrages qui feront sa notoriété. Son œuvre comprend aussi une série romanesque de quatre volumes sur Jeanne la Mince qu’il publia entre 1960 et 1969. Dans cette série, il retrace la vie d’une jeune femme, Jeanne la Mince, qui part à la découverte du monde. Il reviendra au roman en 1977 avec « Le Chat Beauté », un livre d’une brûlante actualité, où hardiment, il règle ses comptes avec lui-même, avec les autres, avec la vie. La même année, toujours aussi narquois et réactionnaire, il publiera « Notre drôle d’époque comme si vous y étiez », où il s’en prend à l’étrange existence que nous menons tous, dans tous les domaines. En 1976, « les Lettres à votre fils qui en a ras le bol » seront un cri d’amour pour les jeunes et d’espoir en leur bonheur et leur courage. Il évoque également sans détour la plupart des problèmes de la jeunesse. Trois ans plus tard, dans « Lettre ouverte aux futurs illettrés », il s’adresse avec une foi et une passion déchirantes, à un jeune lycéen, qu’il appelle Jacques, et le met en garde sur l’avenir qui l’attend comme les cinquante millions de « taupes » qui peuplaient alors notre cher pays. Par ailleurs, il aura également participé à la rédaction de livres pour enfants. Parmi eux, en 1944, il publia chez Gallimard « Les Passagers de la Grande Ourse » en compagnie de Paul Grimault. Le livre raconte une histoire pour enfants, relatant les péripéties de Gô et de son petit chien Sniff, qui s’introduisent sur le chantier en construction d’un aéroscaphe baptisé « La Grande Ourse ». En 1984, il écrivit « Une enfance pour la vie », un ouvrage dans lequel il revient sur son enfance et son adolescence passées à Villeneuve-sur-Lot. Pour ce livre, il obtiendra le prix Chateaubriand. Il interviendra souvent à la télévision, dans des émissions plus ou moins culturelles comme « les Grosses Têtes » sur RTL. Sa diction précieuse en faisait un invité de choix dans un style « Vieille France ». On lui doit aussi une exceptionnelle biographie de Mazarin et une non moins exceptionnelle Histoire de la littérature française. Il avait obtenu plusieurs fois le prix de l’Académie française, et malgré plusieurs tentatives n’y sera jamais élu (1987, « Discours de déception à l’Académie française » édité chez Plon). Candidat en 1973, il sera battu par Jean d’Ormesson. Ce fut un de ses plus grands regrets sans doute. Enfin, en 1994, après cinquante ans de vie littéraire, c’est en philosophe qu’il livrera ses réflexions sur notre société et ses contemporains. Peu de temps après son décès, la famille Guth fit don de 6 000 livres ayant appartenu à l’écrivain à la ville de Villeneuve-sur-Lot. Parmi ces ouvrages des manuscrits inédits, la correspondance avec des écrivains célèbres des années 50 à 70 (et en particulier Marcel Pagnol) ainsi que des toiles de maîtres. Les dons ont été répartis entre la bibliothèque municipale et le musée de Gajac. En 1980, il avait été nommé Citoyen d’honneur de Villeneuve-sur-Lot. Quelques citations de Paul Guth : « La chance, c’est ce qu’on ne mérite pas », « Jadis les analphabètes étaient ceux qui n’allaient pas à l’école ; aujourd’hui ce sont ceux qui y vont », « Fonder la culture sur le présent et la vitesse, c’est l’asseoir sur du vent », Construire du neuf sur le présent c’est bâtir du néant sur du rien », « Les jaloux détruisent ce qu’ils sont incapables de créer ». Président de l’Académie des provinces françaises, romancier, essayiste, chroniqueur, mémorialiste, historien, pamphlétaire, il excella dans tous les genres en mêlant toujours une tendre patte de velours à sa griffe acérée.
Paul GUTH, né le 5 mars 1910 à Ossun et mort le 29 octobre 1997 à Ville-d’Avray, à l’âge de 87 ans. Il est l’auteur d’une cinquantaine d’ouvrages parfois teintés d’histoire, d’anecdotes contemporaines ou de critiques sur ce qu’il considérait comme les maux de son siècle. Il fit partie des premiers comités de la Société des poètes et artistes de France à la fin des années 1950 et au début des années 1960. Issu d’une famille modeste, son père était mécanicien à Toulouse, ses parents habitaient Villeneuve-sur-Lot, ses grands-parents étaient des paysans. Sa mère d’origine bigourdane, était venue accoucher dans la maison familiale d’Ossun. S’il passa toute son enfance à Villeneuve-sur-Lot, il revenait régulièrement à Ossun, lors des vacances scolaires. Il fera de brillantes études à Villeneuve-sur-Lot, et le bac en poche il poursuivra au lycée Louis-le-Grand à Paris (où il obtiendra un prix d’Excellence), afin de préparer l’École normale supérieure avec comme condisciple Thierry Maulnier. Il appela cette classe la « Khâgne des Années folles », qui réunissait Robert Brasillach, Maurice Bardèche, René Étiemble, Paul Guth lui-même, Robert Merle, Henri Queffelec, Roger Vailland, Georges Pompidou, Léopold Sédar Senghor, Aimé Césaire, Louis Achille et le Vietnamien Pham Duy Khiem. Puis il fera des études supérieures à la Sorbonne et deviendra en 1933 un des plus jeunes agrégés de France. Le 6 avril 1936, il épousa à Grasse, Juliette Loubère, une villeneuvoise, qu’il connaissait depuis l’enfance. Pendant dix ans, de 1933 à 1944, il sera professeur de français, latin et grec aux lycées de Dijon, de Rouen puis de Janson-de-Sailly à Paris, où il eut notamment pour élève, Valéry Giscard d’Estaing, ancien Président de la République. Il avait la vocation pédagogique chevillée au corps. Après la Libération, il abandonnera l’enseignement et se consacrera d’abord à la littérature puis au journalisme et à la radio. En 1946, il obtiendra même le Prix du Théâtre pour « Fugues ». En 1953, il publiera « Les Mémoires d’un Naïf », premier roman à succès d’une chronique qui comptera sept volumes. Il y raconte la vie de son personnage récurrent, « le Naïf », professeur de français, qui sous une grande naïveté, cache une imagination fertile. Une série d’ouvrages qui feront sa notoriété. Son œuvre comprend aussi une série romanesque de quatre volumes sur Jeanne la Mince qu’il publia entre 1960 et 1969. Dans cette série, il retrace la vie d’une jeune femme, Jeanne la Mince, qui part à la découverte du monde. Il reviendra au roman en 1977 avec « Le Chat Beauté », un livre d’une brûlante actualité, où hardiment, il règle ses comptes avec lui-même, avec les autres, avec la vie. La même année, toujours aussi narquois et réactionnaire, il publiera « Notre drôle d’époque comme si vous y étiez », où il s’en prend à l’étrange existence que nous menons tous, dans tous les domaines. En 1976, « les Lettres à votre fils qui en a ras le bol » seront un cri d’amour pour les jeunes et d’espoir en leur bonheur et leur courage. Il évoque également sans détour la plupart des problèmes de la jeunesse. Trois ans plus tard, dans « Lettre ouverte aux futurs illettrés », il s’adresse avec une foi et une passion déchirantes, à un jeune lycéen, qu’il appelle Jacques, et le met en garde sur l’avenir qui l’attend comme les cinquante millions de « taupes » qui peuplaient alors notre cher pays. Par ailleurs, il aura également participé à la rédaction de livres pour enfants. Parmi eux, en 1944, il publia chez Gallimard « Les Passagers de la Grande Ourse » en compagnie de Paul Grimault. Le livre raconte une histoire pour enfants, relatant les péripéties de Gô et de son petit chien Sniff, qui s’introduisent sur le chantier en construction d’un aéroscaphe baptisé « La Grande Ourse ». En 1984, il écrivit « Une enfance pour la vie », un ouvrage dans lequel il revient sur son enfance et son adolescence passées à Villeneuve-sur-Lot. Pour ce livre, il obtiendra le prix Chateaubriand. Il interviendra souvent à la télévision, dans des émissions plus ou moins culturelles comme « les Grosses Têtes » sur RTL. Sa diction précieuse en faisait un invité de choix dans un style « Vieille France ». On lui doit aussi une exceptionnelle biographie de Mazarin et une non moins exceptionnelle Histoire de la littérature française. Il avait obtenu plusieurs fois le prix de l’Académie française, et malgré plusieurs tentatives n’y sera jamais élu (1987, « Discours de déception à l’Académie française » édité chez Plon). Candidat en 1973, il sera battu par Jean d’Ormesson. Ce fut un de ses plus grands regrets sans doute. Enfin, en 1994, après cinquante ans de vie littéraire, c’est en philosophe qu’il livrera ses réflexions sur notre société et ses contemporains. Peu de temps après son décès, la famille Guth fit don de 6 000 livres ayant appartenu à l’écrivain à la ville de Villeneuve-sur-Lot. Parmi ces ouvrages des manuscrits inédits, la correspondance avec des écrivains célèbres des années 50 à 70 (et en particulier Marcel Pagnol) ainsi que des toiles de maîtres. Les dons ont été répartis entre la bibliothèque municipale et le musée de Gajac. En 1980, il avait été nommé Citoyen d’honneur de Villeneuve-sur-Lot. Quelques citations de Paul Guth : « La chance, c’est ce qu’on ne mérite pas », « Jadis les analphabètes étaient ceux qui n’allaient pas à l’école ; aujourd’hui ce sont ceux qui y vont », « Fonder la culture sur le présent et la vitesse, c’est l’asseoir sur du vent », Construire du neuf sur le présent c’est bâtir du néant sur du rien », « Les jaloux détruisent ce qu’ils sont incapables de créer ». Président de l’Académie des provinces françaises, romancier, essayiste, chroniqueur, mémorialiste, historien, pamphlétaire, il excella dans tous les genres en mêlant toujours une tendre patte de velours à sa griffe acérée.HORNER Yvette (1922-2018)
Accordéoniste, pianiste, compositrice et reine du musette
 Yvette HORNER, de son vrai nom Yvette Hornère, née le 22 septembre 1922 à Tarbes et décédée le 11 juin 2018 à Courbevoie, à l'âge de 95 ans, est la plus célèbre accordéoniste de France. Fille d’un entrepreneur en bâtiment, elle étudie la musique au Conservatoire de Tarbes puis au Conservatoire de Toulouse et elle remporte son Premier Prix de piano à l’âge de 11 ans. Jeune pianiste surdouée elle est contrainte par sa mère de délaisser le piano au profit de l’accordéon. Après des débuts dans sa région natale, elle monte à Paris pour donner une nouvelle dimension à sa carrière naissante. Elle est l’élève de Robert Bréard. En 1948, elle remporte la Coupe du monde d’accordéon qui fait d’elle une vedette quasiment du jour au lendemain. Deux ans après son sacre mondial elle est lauréate du Grand Prix du disque de l’Académie Charles-Cros en 1950, grâce à l’album "Le Jardin secret". En 1952, la société Calor, la marque de fers à repasser, qui sponsorise le Tour de France, lui propose de faire la grande boucle et ainsi d’aller à la rencontre du public en animant sur un podium les arrivées du Tour. Elle bénéficie du soutien et de l’attention indéfectibles de son mari René Droesch, ancien footballeur professionnel aux Girondins de Bordeaux rencontré en 1936, qui la conseille et la cajole. C’est avec son accord qu’elle commence à suivre la caravane du Tour de France à partir de 1952. Et elle devient extrêmement populaire en accompagnant la caravane publicitaire du Tour de France à onze reprises (de 1952 à 1963). Elle jouait sur tout le parcours, coiffée d’un sombrero et assise sur une chaise fixée sur le toit d’une Citroën Traction, aux couleurs de la marque Suze. Elle sera surnommée « Vévette, la femme aux doigts d’Or » dans l’Aubisque et le Tourmalet. Durant sa longue carrière de 70 ans de scène, elle donne plus de 2.000 concerts et réalise quelque 150 disques, dont les ventes ont atteint les 32 millions d’exemplaires. Elle a aussi joué à l’Opéra pour Béjart et de grandes œuvres classiques avec des orchestres symphoniques en Italie et en Angleterre. En 1989, elle participe avec éclat aux cérémonies du Bicentenaire de la Révolution Française, en se produisant avec l’Orchestre National de Jazz dirigé pour la circonstance par Quicy Jones. Et pour son spectacle au Casino de Paris en 1990, c’est Jean-Paul Gaultier qui conçoit ses tenues de scène des plus branchées. En 1995, sort l’album "Yvette Horner et les Cash" où elle joue du rap, du rock, et même du metal. En 1997, elle se produit avec Marcel Azzola et l’Orchestre Philharmonique Européen au Palais des Congrès à Paris et en 1998, c’est le chorégraphe Maurice Béjart qui l’invite pour sa version du ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski. Ensuite, en 2001 elle se frotte au free jazz pour le Festival Sons d’Hiver. En 2005, elle publie ses mémoires intitulées "Le Biscuit dans la poche". Elle a également enregistré pour le chanteur anglais Boy George. Elle a collaboré avec de grands noms du classique, comme le pianiste Samson François, ou bien encore l’harmoniciste américain Charlie McCoy avec lequel elle a fait un album de country à Nashville. Elle aura su adapter l’accordéon à de nombreux styles de musique pour en faire l’un des plus beaux instruments. Ce qui lui plaît, c’est d’avoir ainsi mêlé divers styles musicaux. De la rumba camarguaise très festive avec Los Chicos aux chants traditionnels des Pyrénées avec Marcel Amont. Son album Double d’Or sort en 2007. En 2010, avec André Verchuren elle prend part à la tournée « la Plus Grande Guinguette du monde » en succédant à Michel Pruvot. En 2011, elle participe à l’album "Bichon" de Julien Doré et met une dernière touche à la re-sortie de son album Hors Normes - produit à compte d’auteur en 2007 - où figurent Richard Galliano, Didier Lockwood, Lio et Marcel Amont. La pochette est dessinée par Jean-Paul Gaultier, couturier l’ayant plusieurs fois habillée, dont en marinière. À 90 ans, elle sera de retour dans les bacs. Un nouvel album réalisé par Patrick Brugalières, intitulé "Yvette Hors Norme", est édité en mai 2012. « Je ne peux pas me passer de musique. Le soufflet de mon accordéon est comme un battement de mon cœur. J’ai passé ma vie à apprendre et je sais que j’apprendrai jusqu’à mon dernier souffle, en éternelle élève… La Musique, c’est le cœur qui bat. Que ce disque, qui m’est si cher, en soit le témoignage », confiera-t-elle à la sortie de cet opus. Toute sa vie, elle a fait preuve d’une détermination, d’une volonté à toute épreuve et à plus de 90 ans elle gardait encore une image intacte d’icône à la chevelure incandescente, devenue tellement « nationale » dans l’inconscient collectif français. Son parcours a été pour le moins exceptionnel ! Chaque année elle se faisait une joie de venir en vacances à Tarbes pour retrouver sa famille, ses amis et ses racines. Le 17 avril 2002, elle fut promue commandeur de l’Ordre national du Mérite. Nommée officier de l’Ordre national de la Légion d’honneur le 17 décembre 1996, elle est élevée au grade de Commandeur le 22 avril 2011 et décorée le 28 septembre. Elle est aussi citoyenne d’Honneur des villes de Tarbes, de Pau et de Nogent-sur-Marne où un square porte son nom. À Tarbes, le foyer du Théâtre des Nouveautés, réplique de celui de l'Opéra Garnier, porte le nom d’Yvette Horner, inauguré et baptisé le 1er octobre 2004. Les obsèques d'Yvette Horner, décédée le 11 juin 2018 à l'âge de 95 ans, ont eu lieu le 20 juin à la cathédrale Notre-Dame de La Sède à Tarbes, sa ville natale. Elle a été inhumée dans le caveau familial au cimetière Saint-Jean, auprès de son mari et de ses parents. Le mardi 19 juin une première cérémonie avait eu lieu en son honneur. Quelque 200 personnes avaient assisté à la messe qui s'est déroulée à l'église Saint-Roch de Paris, parmi lesquelles l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, le couturier Jean-Paul Gaultier, les chanteurs Nicoletta et Michel Orso, le biographe Fabien Lecoeuvre mais aussi Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. « Elle n'était pas malade. Elle est morte des suites d'une vie bien remplie » a déclaré son agent Jean-Pierre Brun, qui s'est dit certain qu'elle allait désormais "faire valser les anges au grand bal dans les nuages".
Yvette HORNER, de son vrai nom Yvette Hornère, née le 22 septembre 1922 à Tarbes et décédée le 11 juin 2018 à Courbevoie, à l'âge de 95 ans, est la plus célèbre accordéoniste de France. Fille d’un entrepreneur en bâtiment, elle étudie la musique au Conservatoire de Tarbes puis au Conservatoire de Toulouse et elle remporte son Premier Prix de piano à l’âge de 11 ans. Jeune pianiste surdouée elle est contrainte par sa mère de délaisser le piano au profit de l’accordéon. Après des débuts dans sa région natale, elle monte à Paris pour donner une nouvelle dimension à sa carrière naissante. Elle est l’élève de Robert Bréard. En 1948, elle remporte la Coupe du monde d’accordéon qui fait d’elle une vedette quasiment du jour au lendemain. Deux ans après son sacre mondial elle est lauréate du Grand Prix du disque de l’Académie Charles-Cros en 1950, grâce à l’album "Le Jardin secret". En 1952, la société Calor, la marque de fers à repasser, qui sponsorise le Tour de France, lui propose de faire la grande boucle et ainsi d’aller à la rencontre du public en animant sur un podium les arrivées du Tour. Elle bénéficie du soutien et de l’attention indéfectibles de son mari René Droesch, ancien footballeur professionnel aux Girondins de Bordeaux rencontré en 1936, qui la conseille et la cajole. C’est avec son accord qu’elle commence à suivre la caravane du Tour de France à partir de 1952. Et elle devient extrêmement populaire en accompagnant la caravane publicitaire du Tour de France à onze reprises (de 1952 à 1963). Elle jouait sur tout le parcours, coiffée d’un sombrero et assise sur une chaise fixée sur le toit d’une Citroën Traction, aux couleurs de la marque Suze. Elle sera surnommée « Vévette, la femme aux doigts d’Or » dans l’Aubisque et le Tourmalet. Durant sa longue carrière de 70 ans de scène, elle donne plus de 2.000 concerts et réalise quelque 150 disques, dont les ventes ont atteint les 32 millions d’exemplaires. Elle a aussi joué à l’Opéra pour Béjart et de grandes œuvres classiques avec des orchestres symphoniques en Italie et en Angleterre. En 1989, elle participe avec éclat aux cérémonies du Bicentenaire de la Révolution Française, en se produisant avec l’Orchestre National de Jazz dirigé pour la circonstance par Quicy Jones. Et pour son spectacle au Casino de Paris en 1990, c’est Jean-Paul Gaultier qui conçoit ses tenues de scène des plus branchées. En 1995, sort l’album "Yvette Horner et les Cash" où elle joue du rap, du rock, et même du metal. En 1997, elle se produit avec Marcel Azzola et l’Orchestre Philharmonique Européen au Palais des Congrès à Paris et en 1998, c’est le chorégraphe Maurice Béjart qui l’invite pour sa version du ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski. Ensuite, en 2001 elle se frotte au free jazz pour le Festival Sons d’Hiver. En 2005, elle publie ses mémoires intitulées "Le Biscuit dans la poche". Elle a également enregistré pour le chanteur anglais Boy George. Elle a collaboré avec de grands noms du classique, comme le pianiste Samson François, ou bien encore l’harmoniciste américain Charlie McCoy avec lequel elle a fait un album de country à Nashville. Elle aura su adapter l’accordéon à de nombreux styles de musique pour en faire l’un des plus beaux instruments. Ce qui lui plaît, c’est d’avoir ainsi mêlé divers styles musicaux. De la rumba camarguaise très festive avec Los Chicos aux chants traditionnels des Pyrénées avec Marcel Amont. Son album Double d’Or sort en 2007. En 2010, avec André Verchuren elle prend part à la tournée « la Plus Grande Guinguette du monde » en succédant à Michel Pruvot. En 2011, elle participe à l’album "Bichon" de Julien Doré et met une dernière touche à la re-sortie de son album Hors Normes - produit à compte d’auteur en 2007 - où figurent Richard Galliano, Didier Lockwood, Lio et Marcel Amont. La pochette est dessinée par Jean-Paul Gaultier, couturier l’ayant plusieurs fois habillée, dont en marinière. À 90 ans, elle sera de retour dans les bacs. Un nouvel album réalisé par Patrick Brugalières, intitulé "Yvette Hors Norme", est édité en mai 2012. « Je ne peux pas me passer de musique. Le soufflet de mon accordéon est comme un battement de mon cœur. J’ai passé ma vie à apprendre et je sais que j’apprendrai jusqu’à mon dernier souffle, en éternelle élève… La Musique, c’est le cœur qui bat. Que ce disque, qui m’est si cher, en soit le témoignage », confiera-t-elle à la sortie de cet opus. Toute sa vie, elle a fait preuve d’une détermination, d’une volonté à toute épreuve et à plus de 90 ans elle gardait encore une image intacte d’icône à la chevelure incandescente, devenue tellement « nationale » dans l’inconscient collectif français. Son parcours a été pour le moins exceptionnel ! Chaque année elle se faisait une joie de venir en vacances à Tarbes pour retrouver sa famille, ses amis et ses racines. Le 17 avril 2002, elle fut promue commandeur de l’Ordre national du Mérite. Nommée officier de l’Ordre national de la Légion d’honneur le 17 décembre 1996, elle est élevée au grade de Commandeur le 22 avril 2011 et décorée le 28 septembre. Elle est aussi citoyenne d’Honneur des villes de Tarbes, de Pau et de Nogent-sur-Marne où un square porte son nom. À Tarbes, le foyer du Théâtre des Nouveautés, réplique de celui de l'Opéra Garnier, porte le nom d’Yvette Horner, inauguré et baptisé le 1er octobre 2004. Les obsèques d'Yvette Horner, décédée le 11 juin 2018 à l'âge de 95 ans, ont eu lieu le 20 juin à la cathédrale Notre-Dame de La Sède à Tarbes, sa ville natale. Elle a été inhumée dans le caveau familial au cimetière Saint-Jean, auprès de son mari et de ses parents. Le mardi 19 juin une première cérémonie avait eu lieu en son honneur. Quelque 200 personnes avaient assisté à la messe qui s'est déroulée à l'église Saint-Roch de Paris, parmi lesquelles l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, le couturier Jean-Paul Gaultier, les chanteurs Nicoletta et Michel Orso, le biographe Fabien Lecoeuvre mais aussi Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. « Elle n'était pas malade. Elle est morte des suites d'une vie bien remplie » a déclaré son agent Jean-Pierre Brun, qui s'est dit certain qu'elle allait désormais "faire valser les anges au grand bal dans les nuages".
 Yvette HORNER, de son vrai nom Yvette Hornère, née le 22 septembre 1922 à Tarbes et décédée le 11 juin 2018 à Courbevoie, à l'âge de 95 ans, est la plus célèbre accordéoniste de France. Fille d’un entrepreneur en bâtiment, elle étudie la musique au Conservatoire de Tarbes puis au Conservatoire de Toulouse et elle remporte son Premier Prix de piano à l’âge de 11 ans. Jeune pianiste surdouée elle est contrainte par sa mère de délaisser le piano au profit de l’accordéon. Après des débuts dans sa région natale, elle monte à Paris pour donner une nouvelle dimension à sa carrière naissante. Elle est l’élève de Robert Bréard. En 1948, elle remporte la Coupe du monde d’accordéon qui fait d’elle une vedette quasiment du jour au lendemain. Deux ans après son sacre mondial elle est lauréate du Grand Prix du disque de l’Académie Charles-Cros en 1950, grâce à l’album "Le Jardin secret". En 1952, la société Calor, la marque de fers à repasser, qui sponsorise le Tour de France, lui propose de faire la grande boucle et ainsi d’aller à la rencontre du public en animant sur un podium les arrivées du Tour. Elle bénéficie du soutien et de l’attention indéfectibles de son mari René Droesch, ancien footballeur professionnel aux Girondins de Bordeaux rencontré en 1936, qui la conseille et la cajole. C’est avec son accord qu’elle commence à suivre la caravane du Tour de France à partir de 1952. Et elle devient extrêmement populaire en accompagnant la caravane publicitaire du Tour de France à onze reprises (de 1952 à 1963). Elle jouait sur tout le parcours, coiffée d’un sombrero et assise sur une chaise fixée sur le toit d’une Citroën Traction, aux couleurs de la marque Suze. Elle sera surnommée « Vévette, la femme aux doigts d’Or » dans l’Aubisque et le Tourmalet. Durant sa longue carrière de 70 ans de scène, elle donne plus de 2.000 concerts et réalise quelque 150 disques, dont les ventes ont atteint les 32 millions d’exemplaires. Elle a aussi joué à l’Opéra pour Béjart et de grandes œuvres classiques avec des orchestres symphoniques en Italie et en Angleterre. En 1989, elle participe avec éclat aux cérémonies du Bicentenaire de la Révolution Française, en se produisant avec l’Orchestre National de Jazz dirigé pour la circonstance par Quicy Jones. Et pour son spectacle au Casino de Paris en 1990, c’est Jean-Paul Gaultier qui conçoit ses tenues de scène des plus branchées. En 1995, sort l’album "Yvette Horner et les Cash" où elle joue du rap, du rock, et même du metal. En 1997, elle se produit avec Marcel Azzola et l’Orchestre Philharmonique Européen au Palais des Congrès à Paris et en 1998, c’est le chorégraphe Maurice Béjart qui l’invite pour sa version du ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski. Ensuite, en 2001 elle se frotte au free jazz pour le Festival Sons d’Hiver. En 2005, elle publie ses mémoires intitulées "Le Biscuit dans la poche". Elle a également enregistré pour le chanteur anglais Boy George. Elle a collaboré avec de grands noms du classique, comme le pianiste Samson François, ou bien encore l’harmoniciste américain Charlie McCoy avec lequel elle a fait un album de country à Nashville. Elle aura su adapter l’accordéon à de nombreux styles de musique pour en faire l’un des plus beaux instruments. Ce qui lui plaît, c’est d’avoir ainsi mêlé divers styles musicaux. De la rumba camarguaise très festive avec Los Chicos aux chants traditionnels des Pyrénées avec Marcel Amont. Son album Double d’Or sort en 2007. En 2010, avec André Verchuren elle prend part à la tournée « la Plus Grande Guinguette du monde » en succédant à Michel Pruvot. En 2011, elle participe à l’album "Bichon" de Julien Doré et met une dernière touche à la re-sortie de son album Hors Normes - produit à compte d’auteur en 2007 - où figurent Richard Galliano, Didier Lockwood, Lio et Marcel Amont. La pochette est dessinée par Jean-Paul Gaultier, couturier l’ayant plusieurs fois habillée, dont en marinière. À 90 ans, elle sera de retour dans les bacs. Un nouvel album réalisé par Patrick Brugalières, intitulé "Yvette Hors Norme", est édité en mai 2012. « Je ne peux pas me passer de musique. Le soufflet de mon accordéon est comme un battement de mon cœur. J’ai passé ma vie à apprendre et je sais que j’apprendrai jusqu’à mon dernier souffle, en éternelle élève… La Musique, c’est le cœur qui bat. Que ce disque, qui m’est si cher, en soit le témoignage », confiera-t-elle à la sortie de cet opus. Toute sa vie, elle a fait preuve d’une détermination, d’une volonté à toute épreuve et à plus de 90 ans elle gardait encore une image intacte d’icône à la chevelure incandescente, devenue tellement « nationale » dans l’inconscient collectif français. Son parcours a été pour le moins exceptionnel ! Chaque année elle se faisait une joie de venir en vacances à Tarbes pour retrouver sa famille, ses amis et ses racines. Le 17 avril 2002, elle fut promue commandeur de l’Ordre national du Mérite. Nommée officier de l’Ordre national de la Légion d’honneur le 17 décembre 1996, elle est élevée au grade de Commandeur le 22 avril 2011 et décorée le 28 septembre. Elle est aussi citoyenne d’Honneur des villes de Tarbes, de Pau et de Nogent-sur-Marne où un square porte son nom. À Tarbes, le foyer du Théâtre des Nouveautés, réplique de celui de l'Opéra Garnier, porte le nom d’Yvette Horner, inauguré et baptisé le 1er octobre 2004. Les obsèques d'Yvette Horner, décédée le 11 juin 2018 à l'âge de 95 ans, ont eu lieu le 20 juin à la cathédrale Notre-Dame de La Sède à Tarbes, sa ville natale. Elle a été inhumée dans le caveau familial au cimetière Saint-Jean, auprès de son mari et de ses parents. Le mardi 19 juin une première cérémonie avait eu lieu en son honneur. Quelque 200 personnes avaient assisté à la messe qui s'est déroulée à l'église Saint-Roch de Paris, parmi lesquelles l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, le couturier Jean-Paul Gaultier, les chanteurs Nicoletta et Michel Orso, le biographe Fabien Lecoeuvre mais aussi Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. « Elle n'était pas malade. Elle est morte des suites d'une vie bien remplie » a déclaré son agent Jean-Pierre Brun, qui s'est dit certain qu'elle allait désormais "faire valser les anges au grand bal dans les nuages".
Yvette HORNER, de son vrai nom Yvette Hornère, née le 22 septembre 1922 à Tarbes et décédée le 11 juin 2018 à Courbevoie, à l'âge de 95 ans, est la plus célèbre accordéoniste de France. Fille d’un entrepreneur en bâtiment, elle étudie la musique au Conservatoire de Tarbes puis au Conservatoire de Toulouse et elle remporte son Premier Prix de piano à l’âge de 11 ans. Jeune pianiste surdouée elle est contrainte par sa mère de délaisser le piano au profit de l’accordéon. Après des débuts dans sa région natale, elle monte à Paris pour donner une nouvelle dimension à sa carrière naissante. Elle est l’élève de Robert Bréard. En 1948, elle remporte la Coupe du monde d’accordéon qui fait d’elle une vedette quasiment du jour au lendemain. Deux ans après son sacre mondial elle est lauréate du Grand Prix du disque de l’Académie Charles-Cros en 1950, grâce à l’album "Le Jardin secret". En 1952, la société Calor, la marque de fers à repasser, qui sponsorise le Tour de France, lui propose de faire la grande boucle et ainsi d’aller à la rencontre du public en animant sur un podium les arrivées du Tour. Elle bénéficie du soutien et de l’attention indéfectibles de son mari René Droesch, ancien footballeur professionnel aux Girondins de Bordeaux rencontré en 1936, qui la conseille et la cajole. C’est avec son accord qu’elle commence à suivre la caravane du Tour de France à partir de 1952. Et elle devient extrêmement populaire en accompagnant la caravane publicitaire du Tour de France à onze reprises (de 1952 à 1963). Elle jouait sur tout le parcours, coiffée d’un sombrero et assise sur une chaise fixée sur le toit d’une Citroën Traction, aux couleurs de la marque Suze. Elle sera surnommée « Vévette, la femme aux doigts d’Or » dans l’Aubisque et le Tourmalet. Durant sa longue carrière de 70 ans de scène, elle donne plus de 2.000 concerts et réalise quelque 150 disques, dont les ventes ont atteint les 32 millions d’exemplaires. Elle a aussi joué à l’Opéra pour Béjart et de grandes œuvres classiques avec des orchestres symphoniques en Italie et en Angleterre. En 1989, elle participe avec éclat aux cérémonies du Bicentenaire de la Révolution Française, en se produisant avec l’Orchestre National de Jazz dirigé pour la circonstance par Quicy Jones. Et pour son spectacle au Casino de Paris en 1990, c’est Jean-Paul Gaultier qui conçoit ses tenues de scène des plus branchées. En 1995, sort l’album "Yvette Horner et les Cash" où elle joue du rap, du rock, et même du metal. En 1997, elle se produit avec Marcel Azzola et l’Orchestre Philharmonique Européen au Palais des Congrès à Paris et en 1998, c’est le chorégraphe Maurice Béjart qui l’invite pour sa version du ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski. Ensuite, en 2001 elle se frotte au free jazz pour le Festival Sons d’Hiver. En 2005, elle publie ses mémoires intitulées "Le Biscuit dans la poche". Elle a également enregistré pour le chanteur anglais Boy George. Elle a collaboré avec de grands noms du classique, comme le pianiste Samson François, ou bien encore l’harmoniciste américain Charlie McCoy avec lequel elle a fait un album de country à Nashville. Elle aura su adapter l’accordéon à de nombreux styles de musique pour en faire l’un des plus beaux instruments. Ce qui lui plaît, c’est d’avoir ainsi mêlé divers styles musicaux. De la rumba camarguaise très festive avec Los Chicos aux chants traditionnels des Pyrénées avec Marcel Amont. Son album Double d’Or sort en 2007. En 2010, avec André Verchuren elle prend part à la tournée « la Plus Grande Guinguette du monde » en succédant à Michel Pruvot. En 2011, elle participe à l’album "Bichon" de Julien Doré et met une dernière touche à la re-sortie de son album Hors Normes - produit à compte d’auteur en 2007 - où figurent Richard Galliano, Didier Lockwood, Lio et Marcel Amont. La pochette est dessinée par Jean-Paul Gaultier, couturier l’ayant plusieurs fois habillée, dont en marinière. À 90 ans, elle sera de retour dans les bacs. Un nouvel album réalisé par Patrick Brugalières, intitulé "Yvette Hors Norme", est édité en mai 2012. « Je ne peux pas me passer de musique. Le soufflet de mon accordéon est comme un battement de mon cœur. J’ai passé ma vie à apprendre et je sais que j’apprendrai jusqu’à mon dernier souffle, en éternelle élève… La Musique, c’est le cœur qui bat. Que ce disque, qui m’est si cher, en soit le témoignage », confiera-t-elle à la sortie de cet opus. Toute sa vie, elle a fait preuve d’une détermination, d’une volonté à toute épreuve et à plus de 90 ans elle gardait encore une image intacte d’icône à la chevelure incandescente, devenue tellement « nationale » dans l’inconscient collectif français. Son parcours a été pour le moins exceptionnel ! Chaque année elle se faisait une joie de venir en vacances à Tarbes pour retrouver sa famille, ses amis et ses racines. Le 17 avril 2002, elle fut promue commandeur de l’Ordre national du Mérite. Nommée officier de l’Ordre national de la Légion d’honneur le 17 décembre 1996, elle est élevée au grade de Commandeur le 22 avril 2011 et décorée le 28 septembre. Elle est aussi citoyenne d’Honneur des villes de Tarbes, de Pau et de Nogent-sur-Marne où un square porte son nom. À Tarbes, le foyer du Théâtre des Nouveautés, réplique de celui de l'Opéra Garnier, porte le nom d’Yvette Horner, inauguré et baptisé le 1er octobre 2004. Les obsèques d'Yvette Horner, décédée le 11 juin 2018 à l'âge de 95 ans, ont eu lieu le 20 juin à la cathédrale Notre-Dame de La Sède à Tarbes, sa ville natale. Elle a été inhumée dans le caveau familial au cimetière Saint-Jean, auprès de son mari et de ses parents. Le mardi 19 juin une première cérémonie avait eu lieu en son honneur. Quelque 200 personnes avaient assisté à la messe qui s'est déroulée à l'église Saint-Roch de Paris, parmi lesquelles l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, le couturier Jean-Paul Gaultier, les chanteurs Nicoletta et Michel Orso, le biographe Fabien Lecoeuvre mais aussi Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. « Elle n'était pas malade. Elle est morte des suites d'une vie bien remplie » a déclaré son agent Jean-Pierre Brun, qui s'est dit certain qu'elle allait désormais "faire valser les anges au grand bal dans les nuages".HUGO Victor (1802-1885)
Poète, dramaturge, écrivain, romancier, académicien, venu en cure thermale en 1843 à Cauterets et séjournant une nuit en pays Toy
 Victor HUGO, né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris, à l’âge de 83 ans. Il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de langue française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a joué un rôle majeur dans l'histoire du XIXe siècle. En 1833, il rencontre la comédienne Juliette Drouet, qui devient sa maîtresse. Tous les ans, Hugo accomplit un séjour d'un mois dans une région française ou un pays d'Europe, en compagnie de son amante Juliette Drouet. De chacune de ses escapades il rapporte dessins, peintures et notes et envoie des courriers aux êtres chers : à sa femme Adèle, sa fille Léopoldine, ses amis Alfred de Vigny et Louis Boulanger. Après le voyage effectué en 1840 dans la vallée du Rhin avec Juliette Drouet, à 41 ans il décide de se rendre incognito dans le Sud-Ouest et en Espagne pour une nouvelle escapade amoureuse en sa compagnie. Surmené et aspirant à une diversion, il part en diligence le 18 juillet 1843 pour les Pyrénées et doit gagner Cauterets pour suivre une cure thermale. Le 20 juillet, après 36 heures de diligence, il atteint Bordeaux où commence son journal de voyage, puis se dirige à Bayonne. Il visite Biarritz qui commence à être à la mode. Le 28 juillet, il est à Saint-Sébastien qu’il quitte le 2 août pour s’installer une semaine à Pasages, entre mer et montagne. Par Hernani et Tolosa, il gagne Pampelune. Franchissant à nouveau la frontière française, il revient à Bayonne. De là, il se rend à Pau puis s’installe pour une quinzaine de jours à Cauterets dans les Hautes-Pyrénées pour y prendre les eaux et y vivre des amours secrètes. Comme tout curiste, il fait quelques excursions et flâne dans les environs de Cauterets, au lac de Gaube, sur les bords du gave du Marcadau, puis à Gavarnie, à Luz-Saint-Sauveur ... En chemin, prenant des notes, voici ce qu’il écrit sur chacune de ses visites et excursions dans les hautes vallées de Cauterets et du pays Toy. D’abord cette lettre adressée à Louis Boulanger sur Cauterets. « Je vous écris, cher Louis, avec les plus mauvais yeux du monde. Vous écrire pourtant est une douce et vieille habitude que je ne veux pas perdre. Je ne veux pas laisser tomber une seule pierre de notre amitié. Voilà vingt ans bientôt que nous sommes frères, frères par le cœur, frères par la pensée. Nous voyons la création avec les mêmes yeux, nous voyons l’art avec le même esprit. Vous aimez Dante comme j’aime Raphaël. Nous avons traversé ensemble bien des jours de lutte et d’épreuve sans faiblir dans notre sympathie, sans reculer d’un pas dans notre dévouement. Restons donc jusqu’au dernier jour ce que nous avons été dès le premier. Ne changeons rien à ce qui a été si bon et si doux. À Paris, serrons-nous la main ; absents, écrivons-nous. J’ai besoin quand je suis loin de vous qu’une lettre vous aille dire quelque chose de ce que je vois, de ce que je pense, de ce que je sens. Cette fois elle sera plus courte, c’est-à-dire moins longue qu’à l’ordinaire. Mes yeux me forcent à ménager les vôtres. Ne vous plaignez pas, vous aurez moins de grimoire et autant d’amitié. Je viens de la mer et je suis dans la montagne. Ce n’est, pour ainsi dire, pas changer d’émotion. Les montagnes et la mer parlent au même côté de l’esprit. Si vous étiez ici (je ne puis m’empêcher de faire constamment ce rêve), quelle vie charmante nous mènerions ensemble ! quels tableaux vous remporteriez dans votre pensée pour les rendre ensuite à l’art plus beaux encore que la nature ne vous les aurait donnés ! Figurez-vous, Louis, que je me lève tous les jours à quatre heures du matin, et qu’à cette heure sombre et claire tout à la fois je m’en vais dans la montagne. Je marche le long d’un torrent, je m’enfonce dans une gorge la plus sauvage qu’il y ait, et, sous prétexte de me tremper dans de l’eau chaude et de boire du soufre, j’ai tous les jours un spectacle nouveau, inattendu et merveilleux. Hier, la nuit avait été pluvieuse, l’air était froid, les sapins mouillés étaient plus noirs qu’à l’ordinaire, les brumes montaient de toutes parts des ravins comme les fumées des fêlures d’une solfatare ; un bruit hideux et terrible sortait des ténèbres, en bas, dans le précipice, sous mes pieds ; c’était le cri de rage du torrent caché par le brouillard. Je ne sais quoi de vague, de surnaturel et d’impossible se mêlait au paysage ; tout était ténébreux et comme pensif autour de moi ; les spectres immenses des montagnes m’apparaissaient par les trous des nuées comme à travers des linceuls déchirés. Le crépuscule n’éclairait rien ; seulement, par une crevasse au-dessus de ma tête, j’apercevais au loin dans l’infini un coin du ciel bleu, pâle, glacé, lugubre et éclatant ; tout ce que je distinguais de la terre, rochers, forêts, prairies, glaciers, se mouvait pêle-mêle dans les vapeurs et semblait fuir, emporté par le vent à travers l’espace dans un gigantesque réseau de nuages. Ce matin, la nuit avait été sereine. Le ciel était étoilé ; mais quel ciel et quelles étoiles ! vous savez, cette fraîcheur, cette grâce, cette transparence mélancolique et inexprimable du matin, les étoiles claires sur le ciel blanc, une voûte de cristal semée de diamants. À cette voûte lumineuse s’appuyaient de toutes parts les énormes montagnes, noires, velues, difformes. Celles de l’orient découpaient à leur sommet sur le plus vif de l’aube leurs sapins qui ressemblaient à ces feuilles dont les pucerons ne laissent que les fibres et font une dentelle. Celles de l’occident, noires à leur base et dans presque toute leur hauteur, avaient à leur cime une clarté rose. Pas un nuage, pas une vapeur. Une vie obscure et charmante animait le flanc ténébreux des montagnes ; on y distinguait l’herbe, les fleurs, les pierres, les bruyères, dans une sorte de fourmillement doux et joyeux. Le bruit du gave n’avait plus rien d’horrible ; c’était un grand murmure mêlé à ce grand silence. Aucune pensée triste, aucune anxiété ne sortait de cet ensemble plein d’harmonie. Toute la vallée était comme une urne immense où le ciel, pendant les heures sacrées de l’aube, versait la paix des sphères et le rayonnement des constellations. Il me semble, mon ami, que ces choses-là sont plus que des paysages. C’est la nature entrevue à de certains moments mystérieux où tout semble rêver, j’ai presque dit penser, où l’arbre, le rocher, le nuage et le buisson vivent plus visiblement qu’à d’autres heures et semblent tressaillir du sourd battement de la vie universelle. Vision étrange et qui pour moi est bien près d’être une réalité, aux instants où les yeux de l’homme sont fermés, quelque chose d’inconnu apparaît dans la création. Ne le voyez-vous pas comme moi ? Ne dirait-on pas qu’aux moments du sommeil, quand la pensée cesse dans l’homme, elle commence dans la nature ? Est-ce que le calme est plus profond, le silence plus absolu, la solitude plus complète, et qu’alors le rêveur qui veille peut mieux saisir, dans ses détails subtils et merveilleux, le fait extraordinaire de la création ? ou bien y a-t-il en effet quelque révélation, quelque manifestation de la grande intelligence entrant en communication avec le grand tout, quelque attitude nouvelle de la nature ? La nature se sent-elle mieux à l’aise quand nous ne sommes pas là ? se déploie-t-elle plus librement ? Il est certain qu’en apparence du moins, il y a pour les objets que nous nommons inanimés une vie crépusculaire et une vie nocturne. Cette vie n’est peut-être que dans notre esprit ; les réalités sensibles se présentent à nous à de certaines heures sous un aspect inusité ; elles nous émeuvent ; il s’en fait un mirage au dedans de nous, et nous prenons les idées nouvelles qu’elles nous suggèrent pour une vie nouvelle qu’elles ont. Voilà les questions. Décidez. Quant à moi, je me borne à rêver. Je voue mon esprit à contempler le monde et à étudier le mystère. Je passe ma vie entre un point d’admiration et un point d’interrogation. » Cauterets, le 26 août 1843. « — La vallée est paisible, l’escarpement est silencieux. Le vent se tait. Tout à coup, à un coude de la montagne, le gave apparaît. C’est le bruit d’une mêlée, c’en est l’aspect. Les combattants hurlent de rage et l’on croit voir voler les projectiles. — On s’approche. — De larges entonnoirs forment de grandes cuves où l’eau saute et bout, couverte d’écume comme dans une marmite énorme chauffée à un feu qui ne s’éteint jamais. Des souches d’arbres monstrueuses, des racines hideuses, décharnées et difformes, roulent dans le torrent comme des carcasses d’hydres. — L’horrible est là partout. » Durant sa cure, sur son temps libre, Hugo se rend au Lac de Gaube, dont il écrit : « — Treize cents pieds. Notre vieille Notre-Dame s’y entasserait six fois sur elle-même avant que la haute balustrade de ses tours parvînt à la surface de l’eau. On y plongerait la grande pyramide, on poserait sur Chéops le Munster de Strasbourg et sur le Munster la flèche d’Anvers que c’est à peine si l’extrémité de la flèche d’Anvers surgirait au-dessus du lac comme la pointe du mât d’un vaisseau naufragé. Vallée très sauvage. Forêt de pins écrasée par une montagne écroulée. Arbres étêtés, arbres morts. Ici les années, les coups de tonnerre et les avalanches sont les seuls bûcherons. Le lac à 4 heures de l’après-midi — Une flaque d’eau la plus verte, la plus gracieuse, la plus jolie, la plus gaie, entourée de rochers hideux, mâchés, déformés, ruinés, terribles. Au fond, les neiges du Vignemale, la plus haute montagne française, font un immense Y renversé sur l’orient. Au bord, une transparence sous laquelle on voit les granits, mais qui s’enfonce rapidement. Les grandes ombres du rocher tombent sur l’escarpement occidental comme des ombres de créneaux. Au premier plan. — Une cabane où l’on boit du kirsch, une cage pleine de poules ; canards ; rocher qui fait une petite presqu’île. On y voit une espèce de tombeau en marbre blanc entouré d’une grille. Ce sont des anglais qui se sont noyés ici et dont voici l’épitaphe : " à la mémoire de William Henry Pattison, écuyer, avocat de Lincoln’s Inn, à Londres, et de Sarah Frences, son épouse, âgés l’un de 31 ans et l’autre de 26 ans, mariés depuis un mois seulement. Un accident affreux les enleva à leurs parents et à leurs amis inconsolables. Ils furent engloutis dans ce lac le 20 septembre 1832. Leurs restes transportés en Angleterre reposent à Wilham dans le comté d’Essex. " (En effet, les Pattison qui venaient de se marier (le 22 août) empruntèrent une barque le 20 septembre 1832. Malheureusement, l’embarcation chavira, emportant dans les flots le jeune couple — Ce monument fut détruit par les troupes d’occupation le jour du débarquement allié en Normandie, le 6 juin 1944, et de nos jours, plus rien ne rappelle la trace du monument Pattison, dont l’emplacement est indiqué par une croix). Eau glaciale. Qui y tombe y meurt. Depuis quatre-vingt-dix ans que le vieux pêcheur était là, il n’avait vu personne assez hardi pour s’y baigner. Il en coûte trois sous par personne pour entrer dans l’enclos du tombeau. J’y ai cueilli des cinéraires dans le granit en surplomb sur le lac. J’ai glissé et failli tomber dans l’eau. Cela eût fait une deuxième tombe. On eût pris six sous. » Hugo flâne aussi sur les bords du gave du Marcadau et note ce témoignage : « Immense éboulement. Les pierres éparses ont roulé jusque dans le gave. Elles ont encore tout le désordre de la chute. On les croirait tombées d’hier si elles n’étaient rongées de lichens. L’une d’elles, la plus grosse, est fendue par le milieu. Un pâtre rêve dans ces rochers au bruit de cette nature en tumulte. Les chèvres bêlent et pendent. Je prends une grosse sauterelle verte qui se laisse faire. Puis je la pose sur le rocher, elle reste à la place où je l’ai mise. Un lézard sort d’une fente. La sauterelle et le lézard se regardent. Le lézard s’approche. La sauterelle s’envole comme un oiseau et va tomber au loin dans les grandes herbes. Je passe le pont de bois au confluent des deux gaves du Marcadau et du Lutour. Une odeur de soufre sort du torrent. Ici il est effrayant. C’est un écroulement de neige liquide. Bruit furieux. Sur les côtés les fleurs croissent en foule ; de petits bras du torrent font sur de petits blocs des cascades microscopiques. Il y a de petits bassins tranquilles avec fond de cailloux qu’on dirait arrangés par un enfant pour son jardin. Un rayon de soleil passe à travers les nuages et fait de chaque goutte d’eau une étincelle. — Belles flaques vertes. Tous les verts. Vert-clair, vert-noir. Les granits et les marbres tachés de rose qu’on aperçoit à travers l’eau glauque veinée de lumière ressemblent à des agates gigantesques. Je suis sorti par un soleil ardent, et voici qu’un nuage gris et lourd envahit tout le ciel. Il va pleuvoir. Je me réfugie sous la porte des bains du pré. Une vieille femme qui tricote me voit entrer en grondant. Figure délabrée et hideuse misère ; visage en guenilles sous une cape en haillons. Voyant que je m’obstine à rester et que j’ai pris une chaise, elle se lève, se traîne appuyée sur deux bâtons vers un couloir obscur, et s’en va. — Je cueille dans une tente du mur extérieur une belle fleur jaune qui a la forme de la tulipe et l’odeur de l’abricot. L’orage approche. De larges et sonores gouttes de pluie tombent sur les arbres et les rochers. Un éclair. Coup de tonnerre. Un coup de tonnerre dans ces gorges n’est plus un coup de tonnerre ; c’est un coup de pistolet, mais un coup de pistolet monstrueux qui éclate dans la nuée, tombe sur le sommet le plus voisin, et rebondit de montagne en montagne avec un bruit sec, sinistre et formidable. — Voici qu’il pleut affreusement. Toute autre chose que la nuée et la pluie a disparu. C’est une sorte de nuit blafarde entrecoupée d’éclairs dans laquelle on n’entend plus que deux rugissements ; le torrent qui hurle sans cesse et le tonnerre qui gronde par instants. Je rêvais à ce double bruit, et je me disais : le torrent ressemble à la rage et le tonnerre à la colère. » Le 23 août 1843 à 3 heures. « — Après deux heures de montée, immense prairie avec deux ou trois pauvres cabanes dont les jardins ont quelque maigre salade et des enclos de marbre. À droite un torrent. Devant moi un énorme bloc de marbre blanc et une vieille souche desséchée. Autour de moi des montagnes magnifiques. Les rayons du soleil y découpent de larges scies de lumière et d’ombre. Petits lacs de neige près du ciel dans les anfractuosités. D’immenses glissements d’ardoises étincellent là-bas au soleil autrement que de l’eau, autrement que de la glace. C’est comme le dos d’un énorme dragon. Larges pans de sombre et de clair. Plans immenses et simples. Quatre montagnes emplissent l’horizon. Rien qu’une herbe courte et rare et quelques bruyères. Cela fait pourtant une gigantesque housse de verdure qui couvre les monts jusqu’à l’endroit où les cols se dressent. Le torrent coule à plat et presque paisible au fond du ravin. Aucun bruit. Aucune voix. Ciel bleu. Calme profond. Solitude absolue. Je n’ai rien vu encore de plus beau et de plus grand dans les Pyrénées. » Le 24 août 1843. « — Deux torrents forment l’Y. Sur cet Y un pont circulaire à triple articulation, en sapins jetés de rochers en rochers. Sur le premier gave quatre autres ponts aux quatre étages de la montagne formés de troncs d’arbres. Écroulement de rochers. Torrent d’eau sur un torrent de pierres. 1er pont. Sapins desséchés avec leurs branches brisées court pouvant servir de mâts de perroquet aux ours. Dans un de ces sapins qui est creux, on a fait du feu. C’est encore une assez large cheminée. Des lichens chevelus vivent sur ces squelettes. Végétation à plusieurs couches. Toutes les fleurs de la montagne. Eau verte et paisible dans une anse au-dessous de la chute avec des sapins morts qui pendent dessus. 2e pont. Deux murailles noires. La lumière s’accroche aux saillies et y fait de petites terrasses éclatantes couvertes d’herbes et de fleurs. L’eau est lumineuse, la lumière est mouillée. Entre les deux murs noirs, le gave blanc. Au fond une cascade à quatre étages. Arbres coupés par les bûcherons. Forêt. Monts immenses au-dessous. 3e pont. Autre cascade. Arc-en-ciel. La chute tombe sur un plateau, puis se rue dans le gouffre. J’y descends en me tenant aux racines des arbres jusque sur un rocher qui avance. Le pont est au-dessus de ma tête. Le rocher qui reçoit le rejaillissement de la chute est troué comme une éponge. Brume et pluie. Je remonte. Les branches pourries cassent aisément. » Puis Victor Hugo, succomba bien évidemment au charme de Gavarnie en pays Toy, dont il fit la renommée dans ses carnets et son poème inachevé « Dieu » en décrivant ainsi le cirque : « Lorsqu’on a passé le pont des Dourroucats et qu’on n’est plus qu’à un quart d’heure de Gèdre, deux montagnes s’écartent tout à coup et, de quelque façon que vous préoccupe l’approche de Gavarnie, vous découvrent une chose inattendue. Vous avez visité peut-être les Alpes, les Andes, les Cordillères ; vous avez depuis quelques semaines les Pyrénées sous les yeux ; quoi que vous ayez pu voir, ce que vous apercevez maintenant ne ressemble à rien de ce que vous avez rencontré ailleurs. Jusqu’ici vous avez vu des montagnes ; vous avez contemplé des excroissances de toutes formes, de toutes hauteurs ; vous avez exploré des croupes vertes, des pentes de gneiss, de marbre ou de schiste, des précipices, des sommets arrondis ou dentelés, des glaciers, des forêts de sapins mêlées à des nuages, des aiguilles de granit, des aiguilles de glace ; mais, je le répète, vous n’avez vu nulle part ce que vous voyez en ce moment à l’horizon. Au milieu des courbes capricieuses des montagnes hérissées d’angles obtus et d’angles aigus, apparaissent brusquement des lignes droites, simples, calmes, horizontales ou verticales, parallèles ou se coupant à angles droits, et combinées de telle sorte que de leur ensemble résulte la figure éclatante, réelle, pénétrée d’azur et de soleil, d’un objet impossible et extraordinaire. Est-ce une montagne ? Mais quelle montagne a-t-elle jamais présenté ces surfaces rectilignes, ces plans réguliers, ces parallélismes rigoureux, ces symétries étranges, cet aspect géométrique ? Est-ce une muraille ? Voici des tours en effet qui la contrebutent et l’appuient, voici des créneaux, voilà les corniches, les architraves, les assises et les pierres que le regard distingue et pourrait presque compter, voilà deux brèches taillées à vif et qui éveillent dans l’esprit des idées de sièges, de tranchées et d’assauts ; mais voilà aussi des neiges, de larges bandes de neige posées sur ces assises, sur ces créneaux, sur ces architraves et sur ces tours ; nous sommes au cœur de l’été et du midi ; ce sont donc des neiges éternelles ; or, quelle muraille, quelle architecture humaine s’est jamais élevée jusqu’au niveau effrayant des neiges éternelles ? Babel, l’effort du genre humain tout entier, s’est affaissée sur elle-même avant de l’avoir atteint. Qu’est-ce donc que cet objet inexplicable qui ne peut pas être une montagne et qui a la hauteur des montagnes, qui ne peut pas être une muraille et qui a la forme des murailles ? C’est une montagne et une muraille tout à la fois ; c’est l’édifice le plus mystérieux du plus mystérieux des architectes ; c’est le colosseum de la nature ; c’est Gavarnie. Représentez-vous cette silhouette magnifique telle qu’elle se révèle d’abord à une distance de trois lieues : une longue et sombre muraille dont toutes les saillies, toutes les rides sont marquées par des lignes de neige, dont toutes les plates-formes portent des glaciers. Vers le milieu, deux grosses tours ; l’une qui est au levant, carrée et tournant un de ses angles vers la France ; l’autre qui est au couchant, cannelée comme si c’était moins une tour qu’une gerbe de tourelles ; toutes deux couvertes de neige. À droite, deux profondes entailles, les brèches, qui découpent dans la muraille comme deux vases qu’emplissent les nuées ; enfin, toujours à droite et à l’extrémité occidentale, une sorte de rebord énorme plissé de mille gradins, qui offre à l’œil, dans des proportions monstrueuses, ce qu’on appellerait en architecture la coupe d’un amphithéâtre. Représentez-vous cela comme je le voyais : la muraille noire, les tours noires ; la neige éclatante, le ciel bleu ; une chose complète enfin, grande jusqu’à l’inouï, sereine jusqu’au sublime. C’est là une impression qui ne ressemble à aucune autre, si singulière et si puissante à la fois qu’elle efface tout le reste, et qu’on devient pour quelques instants, même quand cette vision magique a disparu dans un tournant du chemin, indifférent à tout ce qui n’est pas elle. Le paysage qui vous entoure est cependant admirable ; vous entrez dans une vallée où toutes les magnificences et toutes les grâces vous enveloppent. Des villages en deux étages, comme Tracy-le-Haut et Tracy-le-Bas, Gèdre-Dessus et Gèdre-Dessous, avec leurs pignons en escaliers et leur vieille église des Templiers, se pelotonnent et se déroulent sur le flanc de deux montagnes, le long d’un gave blanc d’écume, sous les touffes gaies et fantasques d’une végétation charmante. Tout cela est vif, ravissant, heureux, exquis ; c’est la Suisse et la Forêt-Noire qui se mêlent brusquement aux Pyrénées. Mille bruits joyeux vous arrivent comme les voix et les paroles de ce doux paysage, chants d’oiseaux, rires d’enfants, murmures du gave, frémissement des feuilles, souffles apaisés du vent. Vous ne voyez rien ; vous n’entendez rien ; à peine percevez-vous de ce gracieux ensemble quelque impression douteuse et confuse. L’apparition de Gavarnie est toujours devant vos yeux, et rayonne dans votre pensée comme ces horizons surnaturels qu’on voit quelquefois au fond des rêves. Le soir, en revenant de Gavarnie, moment admirable. De ma fenêtre : une grande montagne remplit la terre ; un grand nuage remplit le ciel. Entre le nuage et la montagne, une bande mince de ciel crépusculaire, clair, vif, limpide, et Jupiter étincelant, caillou d’or dans un ruisseau d’argent. Rien de plus mélancolique et de plus rassurant et de plus beau que ce petit point de lumière entre ces deux blocs de ténèbres. » Enfin, Victor Hugo ne manqua pas la visite de Luz-Saint-Sauveur et relata : « Luz, charmante vieille ville, — chose rare dans les Pyrénées françaises, — délicieusement située dans une profonde vallée triangulaire. Trois grands rayons de jour y entrent par les trois embrasures des trois montagnes. Quand les miquelets et les contrebandiers espagnols arrivaient d’Aragon par la brèche de Roland et par le noir et hideux sentier de Gavarnie, ils apercevaient tout à coup à l’extrémité de la gorge obscure une grande clarté, comme est la porte d’une cave à ceux qui sont dedans. Ils se hâtaient et trouvaient un gros bourg éclairé de soleil et vivant. Ce bourg, ils l’ont nommé Lumière, Luz. Le Château de Sainte-Marie. J’en ai fait quatre dessins. L’Église bâtie par les Templiers ; rare et curieuse ; forteresse autant qu’église ; enceinte crénelée, porte-donjon. J’ai tourné autour, entre l’église et le mur crénelé. Là est le cimetière, semé de grandes ardoises où des croix et des noms de montagnards creusés avec un clou s’effacent sous la pluie, la neige et les pieds des passants. Porte des cagots, dans le cimetière ; murée ; les goitreux étaient parias. Ils avaient leur porte. Basse, autant qu’on en peut juger par la ligne vague que les pierres qui la murent dessinent. Le bénitier extérieur est un charmant petit tombeau byzantin auquel adhèrent encore deux chapiteaux presque romains. On y cache la clef du cimetière, afin de faire payer les étrangers pour le voir. Car tout se paie. Inscription du tombeau ; illisible, effacée par le temps, rayée au couteau, couverte de poussière. On y distingue quelques mots espagnols. Aqui. Abris. Cependant les mots filla de... semblent indiquer le patois. J’ai à peu près déchiffré la dernière ligne, qui du reste n’a aucun sens : sub desera lo fe. Les corbeaux du mur extérieur de l’abside portent des dessins curieux et charmants. Le portail principal, qui représente Jésus entre les quatre animaux symboliques, est du plus beau roman ; ferme, robuste, puissant, sévère. Restes de peintures sur le mur figurant des mosaïques et des édifices. L’intérieur de l’église est une grange quelconque. Sous la voûte du portail de la tour d’entrée, peintures byzantines, restaurées et à demi blanchies à la chaux ; ont perdu beaucoup de leur caractère. Au haut de la voûte, le Christ, avec la couronne impériale. Au-dessous, les anges du jugement soufflant de leurs trompettes cette inscription : surgite mortvy-venyte-ad-judicium. Aux quatre coins, quelques vestiges des quatre évangélistes. Le bœuf, avec l’inscription sant-luc. L’aigle, avec sant… La moisissure a fait une nuée où le reste se perd. Le lion ailé, d’un beau style, avec l’inscription sant-marc. Dans l’ombre, une tête d’ange avec ce reste de légende : … cte mychael. » La cure à Cauterets terminée, Victor Hugo reprend le chemin du retour : Auch, Agen, Périgueux, Cognac, Saintes et Rochefort. Mais ce voyage aux Pyrénées aura une fin tragique : car c’est à Rochefort que, lisant un journal abandonné dans un café, il apprend la noyade quelques jours plus tôt à Villequier de sa fille adorée Léopoldine et de son mari. L'écrivain sera terriblement affecté par cette mort, qui lui inspirera plusieurs poèmes — Les Contemplations (1856) — notamment, « Demain, dès l'aube… ». À partir de cette date et jusqu'à son exil, Victor Hugo ne produira plus rien, ni théâtre, ni roman, ni poème. Et le journal de Voyage aux Pyrénées s’arrête (il ne sera édité que des années plus tard). La vie du poète, son inspiration ne seront plus les mêmes. Le Voyage aux Pyrénées (1843) a été écrit, au fur et à mesure, dans les lieux mêmes qu'il dépeint, mais sur des pages d'album que Hugo conservait par devers lui. Cette publication s’accompagne de croquis exécutés sur place qui complètent et éclairent le texte. Hugo enregistre ce qu’il voit, crayonne, note sur ces carnets quelques vers qui lui permettront au retour de ressusciter, en prose ou dans quelques poèmes, ses impressions de voyage. Il demande à Juliette de collaborer avec lui. Elle tient son journal de voyage. Ces pages apportent à la littérature pyrénéenne une contribution utile par ce qu’elles ont de vivant et de profondément humain. À sa parution à la fin du XIXe siècle, l'édition posthume du « Voyage vers les Pyrénées » suscite l'admiration et l'enthousiasme. Rédigé sans apprêt, comme un reportage, ce journal de voyage est aussi une chronique d'un voyage intérieur. De retour à Paris, Victor Hugo, après la catastrophe qui avait interrompu si douloureusement son voyage, ne trouva jamais le courage de reprendre et de terminer son récit, initialement destiné à être publié. Ce dernier le sera à titre posthume, en 1890, cinq ans après son décès, signe de la blessure vivace dans le cœur de Victor Hugo toute sa vie durant. C’est après le coup d'État de Louis Napoléon Bonaparte (futur Napoléon III), en 1851, que Victor Hugo sera contraint à l'exil. Déguisé, il gagnera Bruxelles en train. Mais son pamphlet Napoléon le Petit le rendra persona non grata en Belgique et l'obligera à quitter le continent... Hugo débarquera sur l'île de Jersey en août 1852. Le Voyage aux Pyrénées est un carnet de voyage, une pièce de commande pour laquelle il avait reçu une avance d’un éditeur, et pour lequel il décrivait, sur place, ce qui le frappait le plus. Atteignant Lourdes à bord de la diligence Dotézac, qui doit le mener à Cauterets pour prendre les eaux et soulager ses rhumatismes, il avait noté : « Lourdes. — Arrivée magique. Magnifique donjon du treizième siècle sur un rocher. Le gave d’un côté, la ville de l’autre. Au fond les montagnes, hautes, abruptes, coupées de tranchées profondes d’où montent les brumes, le vent, le bruit. À Lourdes commence la grande gorge des hautes Pyrénées qui s’épanouit à Vidalos, s’écarte et se divise en quatre ravins, et forme cette immense patte d’oie dont le centre est Argelès et dont les quatre ongles vont atteindre à l’occident Arbéost par la vallée d’Estrem de Salle et Aucun par le val d’Azun, au milieu Cauterets par le détroit de Pierrefitte, et au levant Barèges par le défilé de Luz. — La gorge de Lourdes à Argelès en est pour ainsi dire le manche. Comme le bras de cette main ouverte. Lourdes est la porte des Hautes-Pyrénées. En 1755 elle ressentit le contrecoup du tremblement de terre de Lisbonne. Le réseau central des Pyrénées était gardé au Moyen Âge. Chaque articulation des vallées avait son château qui apercevait les deux châteaux des deux vallées voisines, et correspondait avec eux par des feux. On en voit aujourd’hui les ruines qui ajoutent un immense intérêt au paysage ; rien de plus poignant que les ruines de l’homme mêlées aux ruines de la nature. Le donjon de Lourdes voyait les trois tourelles du château de Pau qui apercevait la tour carrée de Vidalos, laquelle pouvait communiquer par des signaux avec l’antique Castrum Emilianum bâti par les Romains et relevé par Charlemagne sur la colline de Saint-Savin, qui se rattachait à travers les montagnes à la forteresse féodale de Beaucens. Les signaux s’enfonçaient ainsi de tours en tours dans la vallée de Luz jusqu’au château Sainte-Marie, dans la vallée de Gavarnie jusqu’à la citadelle des Templiers. Les châtelains des Pyrénées comme les burgraves du Rhin s’avertissaient les uns les autres. En quelques heures les bailliages étaient sur pied, la montagne était en feu. Les paysans, chose remarquable et toute locale, ne haïssaient pas ces châteaux. Ils avaient le sentiment que ces forteresses, tout en les dominant, en les opprimant même, protégeaient la frontière. C’est le peuple des montagnes qui a donné à l’un de ces châteaux près du col d’Ossau le nom de Bon-Château qu’il garde encore : Castelloubon. » Tous ces lieux et ces endroits traversés furent pour Victor Hugo, qui disait s’appeler M. Go et portait un chapeau pour ne pas être reconnu, source d’inspiration mais aussi l’occasion de plonger dans son passé et de retrouver ses impressions d'enfance. Sylvie Blotnikas a adapté et mis en scène ce récit de voyage vers les Pyrénées que Julien Rochefort, fils de Jean Rochefort, délivre d’un souffle, en osmose avec le poète qu’il fait revivre. Pour la première fois, ce récit de voyage de Victor Hugo est adapté au théâtre. Le comédien Julien Rochefort livre de ce texte une interprétation pleine de douceur, de délicatesse, rehaussée par un subtil travail de lumière qui agit comme une évocation subliminale des paysages traversés. On se laisse aller avec délice à la lenteur du voyage en malle-poste, à cheval, à pied… Au fil de ce texte d’une beauté magistrale, empreint de profondeur philosophique mais aussi de distance comique, Hugo alterne évocations des petites gens, des horizons marins, de la montagne toujours, laissant vagabonder ses pensées, de croquis frais et pittoresques en échappées oniriques… Car si la représentation dure un peu plus d'une heure, c'est un long monologue à connaître par cœur et que Julien Rochefort rend parfaitement vivant. Hugo ayant entretenu pendant ces deux mois d’absence une correspondance avec sa femme et ses quatre enfants en utilisant la poste restante, quelques-unes de ses lettres, tendres et très touchantes, se sont tout naturellement insérées dans le fil du récit.
Victor HUGO, né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris, à l’âge de 83 ans. Il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de langue française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a joué un rôle majeur dans l'histoire du XIXe siècle. En 1833, il rencontre la comédienne Juliette Drouet, qui devient sa maîtresse. Tous les ans, Hugo accomplit un séjour d'un mois dans une région française ou un pays d'Europe, en compagnie de son amante Juliette Drouet. De chacune de ses escapades il rapporte dessins, peintures et notes et envoie des courriers aux êtres chers : à sa femme Adèle, sa fille Léopoldine, ses amis Alfred de Vigny et Louis Boulanger. Après le voyage effectué en 1840 dans la vallée du Rhin avec Juliette Drouet, à 41 ans il décide de se rendre incognito dans le Sud-Ouest et en Espagne pour une nouvelle escapade amoureuse en sa compagnie. Surmené et aspirant à une diversion, il part en diligence le 18 juillet 1843 pour les Pyrénées et doit gagner Cauterets pour suivre une cure thermale. Le 20 juillet, après 36 heures de diligence, il atteint Bordeaux où commence son journal de voyage, puis se dirige à Bayonne. Il visite Biarritz qui commence à être à la mode. Le 28 juillet, il est à Saint-Sébastien qu’il quitte le 2 août pour s’installer une semaine à Pasages, entre mer et montagne. Par Hernani et Tolosa, il gagne Pampelune. Franchissant à nouveau la frontière française, il revient à Bayonne. De là, il se rend à Pau puis s’installe pour une quinzaine de jours à Cauterets dans les Hautes-Pyrénées pour y prendre les eaux et y vivre des amours secrètes. Comme tout curiste, il fait quelques excursions et flâne dans les environs de Cauterets, au lac de Gaube, sur les bords du gave du Marcadau, puis à Gavarnie, à Luz-Saint-Sauveur ... En chemin, prenant des notes, voici ce qu’il écrit sur chacune de ses visites et excursions dans les hautes vallées de Cauterets et du pays Toy. D’abord cette lettre adressée à Louis Boulanger sur Cauterets. « Je vous écris, cher Louis, avec les plus mauvais yeux du monde. Vous écrire pourtant est une douce et vieille habitude que je ne veux pas perdre. Je ne veux pas laisser tomber une seule pierre de notre amitié. Voilà vingt ans bientôt que nous sommes frères, frères par le cœur, frères par la pensée. Nous voyons la création avec les mêmes yeux, nous voyons l’art avec le même esprit. Vous aimez Dante comme j’aime Raphaël. Nous avons traversé ensemble bien des jours de lutte et d’épreuve sans faiblir dans notre sympathie, sans reculer d’un pas dans notre dévouement. Restons donc jusqu’au dernier jour ce que nous avons été dès le premier. Ne changeons rien à ce qui a été si bon et si doux. À Paris, serrons-nous la main ; absents, écrivons-nous. J’ai besoin quand je suis loin de vous qu’une lettre vous aille dire quelque chose de ce que je vois, de ce que je pense, de ce que je sens. Cette fois elle sera plus courte, c’est-à-dire moins longue qu’à l’ordinaire. Mes yeux me forcent à ménager les vôtres. Ne vous plaignez pas, vous aurez moins de grimoire et autant d’amitié. Je viens de la mer et je suis dans la montagne. Ce n’est, pour ainsi dire, pas changer d’émotion. Les montagnes et la mer parlent au même côté de l’esprit. Si vous étiez ici (je ne puis m’empêcher de faire constamment ce rêve), quelle vie charmante nous mènerions ensemble ! quels tableaux vous remporteriez dans votre pensée pour les rendre ensuite à l’art plus beaux encore que la nature ne vous les aurait donnés ! Figurez-vous, Louis, que je me lève tous les jours à quatre heures du matin, et qu’à cette heure sombre et claire tout à la fois je m’en vais dans la montagne. Je marche le long d’un torrent, je m’enfonce dans une gorge la plus sauvage qu’il y ait, et, sous prétexte de me tremper dans de l’eau chaude et de boire du soufre, j’ai tous les jours un spectacle nouveau, inattendu et merveilleux. Hier, la nuit avait été pluvieuse, l’air était froid, les sapins mouillés étaient plus noirs qu’à l’ordinaire, les brumes montaient de toutes parts des ravins comme les fumées des fêlures d’une solfatare ; un bruit hideux et terrible sortait des ténèbres, en bas, dans le précipice, sous mes pieds ; c’était le cri de rage du torrent caché par le brouillard. Je ne sais quoi de vague, de surnaturel et d’impossible se mêlait au paysage ; tout était ténébreux et comme pensif autour de moi ; les spectres immenses des montagnes m’apparaissaient par les trous des nuées comme à travers des linceuls déchirés. Le crépuscule n’éclairait rien ; seulement, par une crevasse au-dessus de ma tête, j’apercevais au loin dans l’infini un coin du ciel bleu, pâle, glacé, lugubre et éclatant ; tout ce que je distinguais de la terre, rochers, forêts, prairies, glaciers, se mouvait pêle-mêle dans les vapeurs et semblait fuir, emporté par le vent à travers l’espace dans un gigantesque réseau de nuages. Ce matin, la nuit avait été sereine. Le ciel était étoilé ; mais quel ciel et quelles étoiles ! vous savez, cette fraîcheur, cette grâce, cette transparence mélancolique et inexprimable du matin, les étoiles claires sur le ciel blanc, une voûte de cristal semée de diamants. À cette voûte lumineuse s’appuyaient de toutes parts les énormes montagnes, noires, velues, difformes. Celles de l’orient découpaient à leur sommet sur le plus vif de l’aube leurs sapins qui ressemblaient à ces feuilles dont les pucerons ne laissent que les fibres et font une dentelle. Celles de l’occident, noires à leur base et dans presque toute leur hauteur, avaient à leur cime une clarté rose. Pas un nuage, pas une vapeur. Une vie obscure et charmante animait le flanc ténébreux des montagnes ; on y distinguait l’herbe, les fleurs, les pierres, les bruyères, dans une sorte de fourmillement doux et joyeux. Le bruit du gave n’avait plus rien d’horrible ; c’était un grand murmure mêlé à ce grand silence. Aucune pensée triste, aucune anxiété ne sortait de cet ensemble plein d’harmonie. Toute la vallée était comme une urne immense où le ciel, pendant les heures sacrées de l’aube, versait la paix des sphères et le rayonnement des constellations. Il me semble, mon ami, que ces choses-là sont plus que des paysages. C’est la nature entrevue à de certains moments mystérieux où tout semble rêver, j’ai presque dit penser, où l’arbre, le rocher, le nuage et le buisson vivent plus visiblement qu’à d’autres heures et semblent tressaillir du sourd battement de la vie universelle. Vision étrange et qui pour moi est bien près d’être une réalité, aux instants où les yeux de l’homme sont fermés, quelque chose d’inconnu apparaît dans la création. Ne le voyez-vous pas comme moi ? Ne dirait-on pas qu’aux moments du sommeil, quand la pensée cesse dans l’homme, elle commence dans la nature ? Est-ce que le calme est plus profond, le silence plus absolu, la solitude plus complète, et qu’alors le rêveur qui veille peut mieux saisir, dans ses détails subtils et merveilleux, le fait extraordinaire de la création ? ou bien y a-t-il en effet quelque révélation, quelque manifestation de la grande intelligence entrant en communication avec le grand tout, quelque attitude nouvelle de la nature ? La nature se sent-elle mieux à l’aise quand nous ne sommes pas là ? se déploie-t-elle plus librement ? Il est certain qu’en apparence du moins, il y a pour les objets que nous nommons inanimés une vie crépusculaire et une vie nocturne. Cette vie n’est peut-être que dans notre esprit ; les réalités sensibles se présentent à nous à de certaines heures sous un aspect inusité ; elles nous émeuvent ; il s’en fait un mirage au dedans de nous, et nous prenons les idées nouvelles qu’elles nous suggèrent pour une vie nouvelle qu’elles ont. Voilà les questions. Décidez. Quant à moi, je me borne à rêver. Je voue mon esprit à contempler le monde et à étudier le mystère. Je passe ma vie entre un point d’admiration et un point d’interrogation. » Cauterets, le 26 août 1843. « — La vallée est paisible, l’escarpement est silencieux. Le vent se tait. Tout à coup, à un coude de la montagne, le gave apparaît. C’est le bruit d’une mêlée, c’en est l’aspect. Les combattants hurlent de rage et l’on croit voir voler les projectiles. — On s’approche. — De larges entonnoirs forment de grandes cuves où l’eau saute et bout, couverte d’écume comme dans une marmite énorme chauffée à un feu qui ne s’éteint jamais. Des souches d’arbres monstrueuses, des racines hideuses, décharnées et difformes, roulent dans le torrent comme des carcasses d’hydres. — L’horrible est là partout. » Durant sa cure, sur son temps libre, Hugo se rend au Lac de Gaube, dont il écrit : « — Treize cents pieds. Notre vieille Notre-Dame s’y entasserait six fois sur elle-même avant que la haute balustrade de ses tours parvînt à la surface de l’eau. On y plongerait la grande pyramide, on poserait sur Chéops le Munster de Strasbourg et sur le Munster la flèche d’Anvers que c’est à peine si l’extrémité de la flèche d’Anvers surgirait au-dessus du lac comme la pointe du mât d’un vaisseau naufragé. Vallée très sauvage. Forêt de pins écrasée par une montagne écroulée. Arbres étêtés, arbres morts. Ici les années, les coups de tonnerre et les avalanches sont les seuls bûcherons. Le lac à 4 heures de l’après-midi — Une flaque d’eau la plus verte, la plus gracieuse, la plus jolie, la plus gaie, entourée de rochers hideux, mâchés, déformés, ruinés, terribles. Au fond, les neiges du Vignemale, la plus haute montagne française, font un immense Y renversé sur l’orient. Au bord, une transparence sous laquelle on voit les granits, mais qui s’enfonce rapidement. Les grandes ombres du rocher tombent sur l’escarpement occidental comme des ombres de créneaux. Au premier plan. — Une cabane où l’on boit du kirsch, une cage pleine de poules ; canards ; rocher qui fait une petite presqu’île. On y voit une espèce de tombeau en marbre blanc entouré d’une grille. Ce sont des anglais qui se sont noyés ici et dont voici l’épitaphe : " à la mémoire de William Henry Pattison, écuyer, avocat de Lincoln’s Inn, à Londres, et de Sarah Frences, son épouse, âgés l’un de 31 ans et l’autre de 26 ans, mariés depuis un mois seulement. Un accident affreux les enleva à leurs parents et à leurs amis inconsolables. Ils furent engloutis dans ce lac le 20 septembre 1832. Leurs restes transportés en Angleterre reposent à Wilham dans le comté d’Essex. " (En effet, les Pattison qui venaient de se marier (le 22 août) empruntèrent une barque le 20 septembre 1832. Malheureusement, l’embarcation chavira, emportant dans les flots le jeune couple — Ce monument fut détruit par les troupes d’occupation le jour du débarquement allié en Normandie, le 6 juin 1944, et de nos jours, plus rien ne rappelle la trace du monument Pattison, dont l’emplacement est indiqué par une croix). Eau glaciale. Qui y tombe y meurt. Depuis quatre-vingt-dix ans que le vieux pêcheur était là, il n’avait vu personne assez hardi pour s’y baigner. Il en coûte trois sous par personne pour entrer dans l’enclos du tombeau. J’y ai cueilli des cinéraires dans le granit en surplomb sur le lac. J’ai glissé et failli tomber dans l’eau. Cela eût fait une deuxième tombe. On eût pris six sous. » Hugo flâne aussi sur les bords du gave du Marcadau et note ce témoignage : « Immense éboulement. Les pierres éparses ont roulé jusque dans le gave. Elles ont encore tout le désordre de la chute. On les croirait tombées d’hier si elles n’étaient rongées de lichens. L’une d’elles, la plus grosse, est fendue par le milieu. Un pâtre rêve dans ces rochers au bruit de cette nature en tumulte. Les chèvres bêlent et pendent. Je prends une grosse sauterelle verte qui se laisse faire. Puis je la pose sur le rocher, elle reste à la place où je l’ai mise. Un lézard sort d’une fente. La sauterelle et le lézard se regardent. Le lézard s’approche. La sauterelle s’envole comme un oiseau et va tomber au loin dans les grandes herbes. Je passe le pont de bois au confluent des deux gaves du Marcadau et du Lutour. Une odeur de soufre sort du torrent. Ici il est effrayant. C’est un écroulement de neige liquide. Bruit furieux. Sur les côtés les fleurs croissent en foule ; de petits bras du torrent font sur de petits blocs des cascades microscopiques. Il y a de petits bassins tranquilles avec fond de cailloux qu’on dirait arrangés par un enfant pour son jardin. Un rayon de soleil passe à travers les nuages et fait de chaque goutte d’eau une étincelle. — Belles flaques vertes. Tous les verts. Vert-clair, vert-noir. Les granits et les marbres tachés de rose qu’on aperçoit à travers l’eau glauque veinée de lumière ressemblent à des agates gigantesques. Je suis sorti par un soleil ardent, et voici qu’un nuage gris et lourd envahit tout le ciel. Il va pleuvoir. Je me réfugie sous la porte des bains du pré. Une vieille femme qui tricote me voit entrer en grondant. Figure délabrée et hideuse misère ; visage en guenilles sous une cape en haillons. Voyant que je m’obstine à rester et que j’ai pris une chaise, elle se lève, se traîne appuyée sur deux bâtons vers un couloir obscur, et s’en va. — Je cueille dans une tente du mur extérieur une belle fleur jaune qui a la forme de la tulipe et l’odeur de l’abricot. L’orage approche. De larges et sonores gouttes de pluie tombent sur les arbres et les rochers. Un éclair. Coup de tonnerre. Un coup de tonnerre dans ces gorges n’est plus un coup de tonnerre ; c’est un coup de pistolet, mais un coup de pistolet monstrueux qui éclate dans la nuée, tombe sur le sommet le plus voisin, et rebondit de montagne en montagne avec un bruit sec, sinistre et formidable. — Voici qu’il pleut affreusement. Toute autre chose que la nuée et la pluie a disparu. C’est une sorte de nuit blafarde entrecoupée d’éclairs dans laquelle on n’entend plus que deux rugissements ; le torrent qui hurle sans cesse et le tonnerre qui gronde par instants. Je rêvais à ce double bruit, et je me disais : le torrent ressemble à la rage et le tonnerre à la colère. » Le 23 août 1843 à 3 heures. « — Après deux heures de montée, immense prairie avec deux ou trois pauvres cabanes dont les jardins ont quelque maigre salade et des enclos de marbre. À droite un torrent. Devant moi un énorme bloc de marbre blanc et une vieille souche desséchée. Autour de moi des montagnes magnifiques. Les rayons du soleil y découpent de larges scies de lumière et d’ombre. Petits lacs de neige près du ciel dans les anfractuosités. D’immenses glissements d’ardoises étincellent là-bas au soleil autrement que de l’eau, autrement que de la glace. C’est comme le dos d’un énorme dragon. Larges pans de sombre et de clair. Plans immenses et simples. Quatre montagnes emplissent l’horizon. Rien qu’une herbe courte et rare et quelques bruyères. Cela fait pourtant une gigantesque housse de verdure qui couvre les monts jusqu’à l’endroit où les cols se dressent. Le torrent coule à plat et presque paisible au fond du ravin. Aucun bruit. Aucune voix. Ciel bleu. Calme profond. Solitude absolue. Je n’ai rien vu encore de plus beau et de plus grand dans les Pyrénées. » Le 24 août 1843. « — Deux torrents forment l’Y. Sur cet Y un pont circulaire à triple articulation, en sapins jetés de rochers en rochers. Sur le premier gave quatre autres ponts aux quatre étages de la montagne formés de troncs d’arbres. Écroulement de rochers. Torrent d’eau sur un torrent de pierres. 1er pont. Sapins desséchés avec leurs branches brisées court pouvant servir de mâts de perroquet aux ours. Dans un de ces sapins qui est creux, on a fait du feu. C’est encore une assez large cheminée. Des lichens chevelus vivent sur ces squelettes. Végétation à plusieurs couches. Toutes les fleurs de la montagne. Eau verte et paisible dans une anse au-dessous de la chute avec des sapins morts qui pendent dessus. 2e pont. Deux murailles noires. La lumière s’accroche aux saillies et y fait de petites terrasses éclatantes couvertes d’herbes et de fleurs. L’eau est lumineuse, la lumière est mouillée. Entre les deux murs noirs, le gave blanc. Au fond une cascade à quatre étages. Arbres coupés par les bûcherons. Forêt. Monts immenses au-dessous. 3e pont. Autre cascade. Arc-en-ciel. La chute tombe sur un plateau, puis se rue dans le gouffre. J’y descends en me tenant aux racines des arbres jusque sur un rocher qui avance. Le pont est au-dessus de ma tête. Le rocher qui reçoit le rejaillissement de la chute est troué comme une éponge. Brume et pluie. Je remonte. Les branches pourries cassent aisément. » Puis Victor Hugo, succomba bien évidemment au charme de Gavarnie en pays Toy, dont il fit la renommée dans ses carnets et son poème inachevé « Dieu » en décrivant ainsi le cirque : « Lorsqu’on a passé le pont des Dourroucats et qu’on n’est plus qu’à un quart d’heure de Gèdre, deux montagnes s’écartent tout à coup et, de quelque façon que vous préoccupe l’approche de Gavarnie, vous découvrent une chose inattendue. Vous avez visité peut-être les Alpes, les Andes, les Cordillères ; vous avez depuis quelques semaines les Pyrénées sous les yeux ; quoi que vous ayez pu voir, ce que vous apercevez maintenant ne ressemble à rien de ce que vous avez rencontré ailleurs. Jusqu’ici vous avez vu des montagnes ; vous avez contemplé des excroissances de toutes formes, de toutes hauteurs ; vous avez exploré des croupes vertes, des pentes de gneiss, de marbre ou de schiste, des précipices, des sommets arrondis ou dentelés, des glaciers, des forêts de sapins mêlées à des nuages, des aiguilles de granit, des aiguilles de glace ; mais, je le répète, vous n’avez vu nulle part ce que vous voyez en ce moment à l’horizon. Au milieu des courbes capricieuses des montagnes hérissées d’angles obtus et d’angles aigus, apparaissent brusquement des lignes droites, simples, calmes, horizontales ou verticales, parallèles ou se coupant à angles droits, et combinées de telle sorte que de leur ensemble résulte la figure éclatante, réelle, pénétrée d’azur et de soleil, d’un objet impossible et extraordinaire. Est-ce une montagne ? Mais quelle montagne a-t-elle jamais présenté ces surfaces rectilignes, ces plans réguliers, ces parallélismes rigoureux, ces symétries étranges, cet aspect géométrique ? Est-ce une muraille ? Voici des tours en effet qui la contrebutent et l’appuient, voici des créneaux, voilà les corniches, les architraves, les assises et les pierres que le regard distingue et pourrait presque compter, voilà deux brèches taillées à vif et qui éveillent dans l’esprit des idées de sièges, de tranchées et d’assauts ; mais voilà aussi des neiges, de larges bandes de neige posées sur ces assises, sur ces créneaux, sur ces architraves et sur ces tours ; nous sommes au cœur de l’été et du midi ; ce sont donc des neiges éternelles ; or, quelle muraille, quelle architecture humaine s’est jamais élevée jusqu’au niveau effrayant des neiges éternelles ? Babel, l’effort du genre humain tout entier, s’est affaissée sur elle-même avant de l’avoir atteint. Qu’est-ce donc que cet objet inexplicable qui ne peut pas être une montagne et qui a la hauteur des montagnes, qui ne peut pas être une muraille et qui a la forme des murailles ? C’est une montagne et une muraille tout à la fois ; c’est l’édifice le plus mystérieux du plus mystérieux des architectes ; c’est le colosseum de la nature ; c’est Gavarnie. Représentez-vous cette silhouette magnifique telle qu’elle se révèle d’abord à une distance de trois lieues : une longue et sombre muraille dont toutes les saillies, toutes les rides sont marquées par des lignes de neige, dont toutes les plates-formes portent des glaciers. Vers le milieu, deux grosses tours ; l’une qui est au levant, carrée et tournant un de ses angles vers la France ; l’autre qui est au couchant, cannelée comme si c’était moins une tour qu’une gerbe de tourelles ; toutes deux couvertes de neige. À droite, deux profondes entailles, les brèches, qui découpent dans la muraille comme deux vases qu’emplissent les nuées ; enfin, toujours à droite et à l’extrémité occidentale, une sorte de rebord énorme plissé de mille gradins, qui offre à l’œil, dans des proportions monstrueuses, ce qu’on appellerait en architecture la coupe d’un amphithéâtre. Représentez-vous cela comme je le voyais : la muraille noire, les tours noires ; la neige éclatante, le ciel bleu ; une chose complète enfin, grande jusqu’à l’inouï, sereine jusqu’au sublime. C’est là une impression qui ne ressemble à aucune autre, si singulière et si puissante à la fois qu’elle efface tout le reste, et qu’on devient pour quelques instants, même quand cette vision magique a disparu dans un tournant du chemin, indifférent à tout ce qui n’est pas elle. Le paysage qui vous entoure est cependant admirable ; vous entrez dans une vallée où toutes les magnificences et toutes les grâces vous enveloppent. Des villages en deux étages, comme Tracy-le-Haut et Tracy-le-Bas, Gèdre-Dessus et Gèdre-Dessous, avec leurs pignons en escaliers et leur vieille église des Templiers, se pelotonnent et se déroulent sur le flanc de deux montagnes, le long d’un gave blanc d’écume, sous les touffes gaies et fantasques d’une végétation charmante. Tout cela est vif, ravissant, heureux, exquis ; c’est la Suisse et la Forêt-Noire qui se mêlent brusquement aux Pyrénées. Mille bruits joyeux vous arrivent comme les voix et les paroles de ce doux paysage, chants d’oiseaux, rires d’enfants, murmures du gave, frémissement des feuilles, souffles apaisés du vent. Vous ne voyez rien ; vous n’entendez rien ; à peine percevez-vous de ce gracieux ensemble quelque impression douteuse et confuse. L’apparition de Gavarnie est toujours devant vos yeux, et rayonne dans votre pensée comme ces horizons surnaturels qu’on voit quelquefois au fond des rêves. Le soir, en revenant de Gavarnie, moment admirable. De ma fenêtre : une grande montagne remplit la terre ; un grand nuage remplit le ciel. Entre le nuage et la montagne, une bande mince de ciel crépusculaire, clair, vif, limpide, et Jupiter étincelant, caillou d’or dans un ruisseau d’argent. Rien de plus mélancolique et de plus rassurant et de plus beau que ce petit point de lumière entre ces deux blocs de ténèbres. » Enfin, Victor Hugo ne manqua pas la visite de Luz-Saint-Sauveur et relata : « Luz, charmante vieille ville, — chose rare dans les Pyrénées françaises, — délicieusement située dans une profonde vallée triangulaire. Trois grands rayons de jour y entrent par les trois embrasures des trois montagnes. Quand les miquelets et les contrebandiers espagnols arrivaient d’Aragon par la brèche de Roland et par le noir et hideux sentier de Gavarnie, ils apercevaient tout à coup à l’extrémité de la gorge obscure une grande clarté, comme est la porte d’une cave à ceux qui sont dedans. Ils se hâtaient et trouvaient un gros bourg éclairé de soleil et vivant. Ce bourg, ils l’ont nommé Lumière, Luz. Le Château de Sainte-Marie. J’en ai fait quatre dessins. L’Église bâtie par les Templiers ; rare et curieuse ; forteresse autant qu’église ; enceinte crénelée, porte-donjon. J’ai tourné autour, entre l’église et le mur crénelé. Là est le cimetière, semé de grandes ardoises où des croix et des noms de montagnards creusés avec un clou s’effacent sous la pluie, la neige et les pieds des passants. Porte des cagots, dans le cimetière ; murée ; les goitreux étaient parias. Ils avaient leur porte. Basse, autant qu’on en peut juger par la ligne vague que les pierres qui la murent dessinent. Le bénitier extérieur est un charmant petit tombeau byzantin auquel adhèrent encore deux chapiteaux presque romains. On y cache la clef du cimetière, afin de faire payer les étrangers pour le voir. Car tout se paie. Inscription du tombeau ; illisible, effacée par le temps, rayée au couteau, couverte de poussière. On y distingue quelques mots espagnols. Aqui. Abris. Cependant les mots filla de... semblent indiquer le patois. J’ai à peu près déchiffré la dernière ligne, qui du reste n’a aucun sens : sub desera lo fe. Les corbeaux du mur extérieur de l’abside portent des dessins curieux et charmants. Le portail principal, qui représente Jésus entre les quatre animaux symboliques, est du plus beau roman ; ferme, robuste, puissant, sévère. Restes de peintures sur le mur figurant des mosaïques et des édifices. L’intérieur de l’église est une grange quelconque. Sous la voûte du portail de la tour d’entrée, peintures byzantines, restaurées et à demi blanchies à la chaux ; ont perdu beaucoup de leur caractère. Au haut de la voûte, le Christ, avec la couronne impériale. Au-dessous, les anges du jugement soufflant de leurs trompettes cette inscription : surgite mortvy-venyte-ad-judicium. Aux quatre coins, quelques vestiges des quatre évangélistes. Le bœuf, avec l’inscription sant-luc. L’aigle, avec sant… La moisissure a fait une nuée où le reste se perd. Le lion ailé, d’un beau style, avec l’inscription sant-marc. Dans l’ombre, une tête d’ange avec ce reste de légende : … cte mychael. » La cure à Cauterets terminée, Victor Hugo reprend le chemin du retour : Auch, Agen, Périgueux, Cognac, Saintes et Rochefort. Mais ce voyage aux Pyrénées aura une fin tragique : car c’est à Rochefort que, lisant un journal abandonné dans un café, il apprend la noyade quelques jours plus tôt à Villequier de sa fille adorée Léopoldine et de son mari. L'écrivain sera terriblement affecté par cette mort, qui lui inspirera plusieurs poèmes — Les Contemplations (1856) — notamment, « Demain, dès l'aube… ». À partir de cette date et jusqu'à son exil, Victor Hugo ne produira plus rien, ni théâtre, ni roman, ni poème. Et le journal de Voyage aux Pyrénées s’arrête (il ne sera édité que des années plus tard). La vie du poète, son inspiration ne seront plus les mêmes. Le Voyage aux Pyrénées (1843) a été écrit, au fur et à mesure, dans les lieux mêmes qu'il dépeint, mais sur des pages d'album que Hugo conservait par devers lui. Cette publication s’accompagne de croquis exécutés sur place qui complètent et éclairent le texte. Hugo enregistre ce qu’il voit, crayonne, note sur ces carnets quelques vers qui lui permettront au retour de ressusciter, en prose ou dans quelques poèmes, ses impressions de voyage. Il demande à Juliette de collaborer avec lui. Elle tient son journal de voyage. Ces pages apportent à la littérature pyrénéenne une contribution utile par ce qu’elles ont de vivant et de profondément humain. À sa parution à la fin du XIXe siècle, l'édition posthume du « Voyage vers les Pyrénées » suscite l'admiration et l'enthousiasme. Rédigé sans apprêt, comme un reportage, ce journal de voyage est aussi une chronique d'un voyage intérieur. De retour à Paris, Victor Hugo, après la catastrophe qui avait interrompu si douloureusement son voyage, ne trouva jamais le courage de reprendre et de terminer son récit, initialement destiné à être publié. Ce dernier le sera à titre posthume, en 1890, cinq ans après son décès, signe de la blessure vivace dans le cœur de Victor Hugo toute sa vie durant. C’est après le coup d'État de Louis Napoléon Bonaparte (futur Napoléon III), en 1851, que Victor Hugo sera contraint à l'exil. Déguisé, il gagnera Bruxelles en train. Mais son pamphlet Napoléon le Petit le rendra persona non grata en Belgique et l'obligera à quitter le continent... Hugo débarquera sur l'île de Jersey en août 1852. Le Voyage aux Pyrénées est un carnet de voyage, une pièce de commande pour laquelle il avait reçu une avance d’un éditeur, et pour lequel il décrivait, sur place, ce qui le frappait le plus. Atteignant Lourdes à bord de la diligence Dotézac, qui doit le mener à Cauterets pour prendre les eaux et soulager ses rhumatismes, il avait noté : « Lourdes. — Arrivée magique. Magnifique donjon du treizième siècle sur un rocher. Le gave d’un côté, la ville de l’autre. Au fond les montagnes, hautes, abruptes, coupées de tranchées profondes d’où montent les brumes, le vent, le bruit. À Lourdes commence la grande gorge des hautes Pyrénées qui s’épanouit à Vidalos, s’écarte et se divise en quatre ravins, et forme cette immense patte d’oie dont le centre est Argelès et dont les quatre ongles vont atteindre à l’occident Arbéost par la vallée d’Estrem de Salle et Aucun par le val d’Azun, au milieu Cauterets par le détroit de Pierrefitte, et au levant Barèges par le défilé de Luz. — La gorge de Lourdes à Argelès en est pour ainsi dire le manche. Comme le bras de cette main ouverte. Lourdes est la porte des Hautes-Pyrénées. En 1755 elle ressentit le contrecoup du tremblement de terre de Lisbonne. Le réseau central des Pyrénées était gardé au Moyen Âge. Chaque articulation des vallées avait son château qui apercevait les deux châteaux des deux vallées voisines, et correspondait avec eux par des feux. On en voit aujourd’hui les ruines qui ajoutent un immense intérêt au paysage ; rien de plus poignant que les ruines de l’homme mêlées aux ruines de la nature. Le donjon de Lourdes voyait les trois tourelles du château de Pau qui apercevait la tour carrée de Vidalos, laquelle pouvait communiquer par des signaux avec l’antique Castrum Emilianum bâti par les Romains et relevé par Charlemagne sur la colline de Saint-Savin, qui se rattachait à travers les montagnes à la forteresse féodale de Beaucens. Les signaux s’enfonçaient ainsi de tours en tours dans la vallée de Luz jusqu’au château Sainte-Marie, dans la vallée de Gavarnie jusqu’à la citadelle des Templiers. Les châtelains des Pyrénées comme les burgraves du Rhin s’avertissaient les uns les autres. En quelques heures les bailliages étaient sur pied, la montagne était en feu. Les paysans, chose remarquable et toute locale, ne haïssaient pas ces châteaux. Ils avaient le sentiment que ces forteresses, tout en les dominant, en les opprimant même, protégeaient la frontière. C’est le peuple des montagnes qui a donné à l’un de ces châteaux près du col d’Ossau le nom de Bon-Château qu’il garde encore : Castelloubon. » Tous ces lieux et ces endroits traversés furent pour Victor Hugo, qui disait s’appeler M. Go et portait un chapeau pour ne pas être reconnu, source d’inspiration mais aussi l’occasion de plonger dans son passé et de retrouver ses impressions d'enfance. Sylvie Blotnikas a adapté et mis en scène ce récit de voyage vers les Pyrénées que Julien Rochefort, fils de Jean Rochefort, délivre d’un souffle, en osmose avec le poète qu’il fait revivre. Pour la première fois, ce récit de voyage de Victor Hugo est adapté au théâtre. Le comédien Julien Rochefort livre de ce texte une interprétation pleine de douceur, de délicatesse, rehaussée par un subtil travail de lumière qui agit comme une évocation subliminale des paysages traversés. On se laisse aller avec délice à la lenteur du voyage en malle-poste, à cheval, à pied… Au fil de ce texte d’une beauté magistrale, empreint de profondeur philosophique mais aussi de distance comique, Hugo alterne évocations des petites gens, des horizons marins, de la montagne toujours, laissant vagabonder ses pensées, de croquis frais et pittoresques en échappées oniriques… Car si la représentation dure un peu plus d'une heure, c'est un long monologue à connaître par cœur et que Julien Rochefort rend parfaitement vivant. Hugo ayant entretenu pendant ces deux mois d’absence une correspondance avec sa femme et ses quatre enfants en utilisant la poste restante, quelques-unes de ses lettres, tendres et très touchantes, se sont tout naturellement insérées dans le fil du récit.
 Victor HUGO, né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris, à l’âge de 83 ans. Il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de langue française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a joué un rôle majeur dans l'histoire du XIXe siècle. En 1833, il rencontre la comédienne Juliette Drouet, qui devient sa maîtresse. Tous les ans, Hugo accomplit un séjour d'un mois dans une région française ou un pays d'Europe, en compagnie de son amante Juliette Drouet. De chacune de ses escapades il rapporte dessins, peintures et notes et envoie des courriers aux êtres chers : à sa femme Adèle, sa fille Léopoldine, ses amis Alfred de Vigny et Louis Boulanger. Après le voyage effectué en 1840 dans la vallée du Rhin avec Juliette Drouet, à 41 ans il décide de se rendre incognito dans le Sud-Ouest et en Espagne pour une nouvelle escapade amoureuse en sa compagnie. Surmené et aspirant à une diversion, il part en diligence le 18 juillet 1843 pour les Pyrénées et doit gagner Cauterets pour suivre une cure thermale. Le 20 juillet, après 36 heures de diligence, il atteint Bordeaux où commence son journal de voyage, puis se dirige à Bayonne. Il visite Biarritz qui commence à être à la mode. Le 28 juillet, il est à Saint-Sébastien qu’il quitte le 2 août pour s’installer une semaine à Pasages, entre mer et montagne. Par Hernani et Tolosa, il gagne Pampelune. Franchissant à nouveau la frontière française, il revient à Bayonne. De là, il se rend à Pau puis s’installe pour une quinzaine de jours à Cauterets dans les Hautes-Pyrénées pour y prendre les eaux et y vivre des amours secrètes. Comme tout curiste, il fait quelques excursions et flâne dans les environs de Cauterets, au lac de Gaube, sur les bords du gave du Marcadau, puis à Gavarnie, à Luz-Saint-Sauveur ... En chemin, prenant des notes, voici ce qu’il écrit sur chacune de ses visites et excursions dans les hautes vallées de Cauterets et du pays Toy. D’abord cette lettre adressée à Louis Boulanger sur Cauterets. « Je vous écris, cher Louis, avec les plus mauvais yeux du monde. Vous écrire pourtant est une douce et vieille habitude que je ne veux pas perdre. Je ne veux pas laisser tomber une seule pierre de notre amitié. Voilà vingt ans bientôt que nous sommes frères, frères par le cœur, frères par la pensée. Nous voyons la création avec les mêmes yeux, nous voyons l’art avec le même esprit. Vous aimez Dante comme j’aime Raphaël. Nous avons traversé ensemble bien des jours de lutte et d’épreuve sans faiblir dans notre sympathie, sans reculer d’un pas dans notre dévouement. Restons donc jusqu’au dernier jour ce que nous avons été dès le premier. Ne changeons rien à ce qui a été si bon et si doux. À Paris, serrons-nous la main ; absents, écrivons-nous. J’ai besoin quand je suis loin de vous qu’une lettre vous aille dire quelque chose de ce que je vois, de ce que je pense, de ce que je sens. Cette fois elle sera plus courte, c’est-à-dire moins longue qu’à l’ordinaire. Mes yeux me forcent à ménager les vôtres. Ne vous plaignez pas, vous aurez moins de grimoire et autant d’amitié. Je viens de la mer et je suis dans la montagne. Ce n’est, pour ainsi dire, pas changer d’émotion. Les montagnes et la mer parlent au même côté de l’esprit. Si vous étiez ici (je ne puis m’empêcher de faire constamment ce rêve), quelle vie charmante nous mènerions ensemble ! quels tableaux vous remporteriez dans votre pensée pour les rendre ensuite à l’art plus beaux encore que la nature ne vous les aurait donnés ! Figurez-vous, Louis, que je me lève tous les jours à quatre heures du matin, et qu’à cette heure sombre et claire tout à la fois je m’en vais dans la montagne. Je marche le long d’un torrent, je m’enfonce dans une gorge la plus sauvage qu’il y ait, et, sous prétexte de me tremper dans de l’eau chaude et de boire du soufre, j’ai tous les jours un spectacle nouveau, inattendu et merveilleux. Hier, la nuit avait été pluvieuse, l’air était froid, les sapins mouillés étaient plus noirs qu’à l’ordinaire, les brumes montaient de toutes parts des ravins comme les fumées des fêlures d’une solfatare ; un bruit hideux et terrible sortait des ténèbres, en bas, dans le précipice, sous mes pieds ; c’était le cri de rage du torrent caché par le brouillard. Je ne sais quoi de vague, de surnaturel et d’impossible se mêlait au paysage ; tout était ténébreux et comme pensif autour de moi ; les spectres immenses des montagnes m’apparaissaient par les trous des nuées comme à travers des linceuls déchirés. Le crépuscule n’éclairait rien ; seulement, par une crevasse au-dessus de ma tête, j’apercevais au loin dans l’infini un coin du ciel bleu, pâle, glacé, lugubre et éclatant ; tout ce que je distinguais de la terre, rochers, forêts, prairies, glaciers, se mouvait pêle-mêle dans les vapeurs et semblait fuir, emporté par le vent à travers l’espace dans un gigantesque réseau de nuages. Ce matin, la nuit avait été sereine. Le ciel était étoilé ; mais quel ciel et quelles étoiles ! vous savez, cette fraîcheur, cette grâce, cette transparence mélancolique et inexprimable du matin, les étoiles claires sur le ciel blanc, une voûte de cristal semée de diamants. À cette voûte lumineuse s’appuyaient de toutes parts les énormes montagnes, noires, velues, difformes. Celles de l’orient découpaient à leur sommet sur le plus vif de l’aube leurs sapins qui ressemblaient à ces feuilles dont les pucerons ne laissent que les fibres et font une dentelle. Celles de l’occident, noires à leur base et dans presque toute leur hauteur, avaient à leur cime une clarté rose. Pas un nuage, pas une vapeur. Une vie obscure et charmante animait le flanc ténébreux des montagnes ; on y distinguait l’herbe, les fleurs, les pierres, les bruyères, dans une sorte de fourmillement doux et joyeux. Le bruit du gave n’avait plus rien d’horrible ; c’était un grand murmure mêlé à ce grand silence. Aucune pensée triste, aucune anxiété ne sortait de cet ensemble plein d’harmonie. Toute la vallée était comme une urne immense où le ciel, pendant les heures sacrées de l’aube, versait la paix des sphères et le rayonnement des constellations. Il me semble, mon ami, que ces choses-là sont plus que des paysages. C’est la nature entrevue à de certains moments mystérieux où tout semble rêver, j’ai presque dit penser, où l’arbre, le rocher, le nuage et le buisson vivent plus visiblement qu’à d’autres heures et semblent tressaillir du sourd battement de la vie universelle. Vision étrange et qui pour moi est bien près d’être une réalité, aux instants où les yeux de l’homme sont fermés, quelque chose d’inconnu apparaît dans la création. Ne le voyez-vous pas comme moi ? Ne dirait-on pas qu’aux moments du sommeil, quand la pensée cesse dans l’homme, elle commence dans la nature ? Est-ce que le calme est plus profond, le silence plus absolu, la solitude plus complète, et qu’alors le rêveur qui veille peut mieux saisir, dans ses détails subtils et merveilleux, le fait extraordinaire de la création ? ou bien y a-t-il en effet quelque révélation, quelque manifestation de la grande intelligence entrant en communication avec le grand tout, quelque attitude nouvelle de la nature ? La nature se sent-elle mieux à l’aise quand nous ne sommes pas là ? se déploie-t-elle plus librement ? Il est certain qu’en apparence du moins, il y a pour les objets que nous nommons inanimés une vie crépusculaire et une vie nocturne. Cette vie n’est peut-être que dans notre esprit ; les réalités sensibles se présentent à nous à de certaines heures sous un aspect inusité ; elles nous émeuvent ; il s’en fait un mirage au dedans de nous, et nous prenons les idées nouvelles qu’elles nous suggèrent pour une vie nouvelle qu’elles ont. Voilà les questions. Décidez. Quant à moi, je me borne à rêver. Je voue mon esprit à contempler le monde et à étudier le mystère. Je passe ma vie entre un point d’admiration et un point d’interrogation. » Cauterets, le 26 août 1843. « — La vallée est paisible, l’escarpement est silencieux. Le vent se tait. Tout à coup, à un coude de la montagne, le gave apparaît. C’est le bruit d’une mêlée, c’en est l’aspect. Les combattants hurlent de rage et l’on croit voir voler les projectiles. — On s’approche. — De larges entonnoirs forment de grandes cuves où l’eau saute et bout, couverte d’écume comme dans une marmite énorme chauffée à un feu qui ne s’éteint jamais. Des souches d’arbres monstrueuses, des racines hideuses, décharnées et difformes, roulent dans le torrent comme des carcasses d’hydres. — L’horrible est là partout. » Durant sa cure, sur son temps libre, Hugo se rend au Lac de Gaube, dont il écrit : « — Treize cents pieds. Notre vieille Notre-Dame s’y entasserait six fois sur elle-même avant que la haute balustrade de ses tours parvînt à la surface de l’eau. On y plongerait la grande pyramide, on poserait sur Chéops le Munster de Strasbourg et sur le Munster la flèche d’Anvers que c’est à peine si l’extrémité de la flèche d’Anvers surgirait au-dessus du lac comme la pointe du mât d’un vaisseau naufragé. Vallée très sauvage. Forêt de pins écrasée par une montagne écroulée. Arbres étêtés, arbres morts. Ici les années, les coups de tonnerre et les avalanches sont les seuls bûcherons. Le lac à 4 heures de l’après-midi — Une flaque d’eau la plus verte, la plus gracieuse, la plus jolie, la plus gaie, entourée de rochers hideux, mâchés, déformés, ruinés, terribles. Au fond, les neiges du Vignemale, la plus haute montagne française, font un immense Y renversé sur l’orient. Au bord, une transparence sous laquelle on voit les granits, mais qui s’enfonce rapidement. Les grandes ombres du rocher tombent sur l’escarpement occidental comme des ombres de créneaux. Au premier plan. — Une cabane où l’on boit du kirsch, une cage pleine de poules ; canards ; rocher qui fait une petite presqu’île. On y voit une espèce de tombeau en marbre blanc entouré d’une grille. Ce sont des anglais qui se sont noyés ici et dont voici l’épitaphe : " à la mémoire de William Henry Pattison, écuyer, avocat de Lincoln’s Inn, à Londres, et de Sarah Frences, son épouse, âgés l’un de 31 ans et l’autre de 26 ans, mariés depuis un mois seulement. Un accident affreux les enleva à leurs parents et à leurs amis inconsolables. Ils furent engloutis dans ce lac le 20 septembre 1832. Leurs restes transportés en Angleterre reposent à Wilham dans le comté d’Essex. " (En effet, les Pattison qui venaient de se marier (le 22 août) empruntèrent une barque le 20 septembre 1832. Malheureusement, l’embarcation chavira, emportant dans les flots le jeune couple — Ce monument fut détruit par les troupes d’occupation le jour du débarquement allié en Normandie, le 6 juin 1944, et de nos jours, plus rien ne rappelle la trace du monument Pattison, dont l’emplacement est indiqué par une croix). Eau glaciale. Qui y tombe y meurt. Depuis quatre-vingt-dix ans que le vieux pêcheur était là, il n’avait vu personne assez hardi pour s’y baigner. Il en coûte trois sous par personne pour entrer dans l’enclos du tombeau. J’y ai cueilli des cinéraires dans le granit en surplomb sur le lac. J’ai glissé et failli tomber dans l’eau. Cela eût fait une deuxième tombe. On eût pris six sous. » Hugo flâne aussi sur les bords du gave du Marcadau et note ce témoignage : « Immense éboulement. Les pierres éparses ont roulé jusque dans le gave. Elles ont encore tout le désordre de la chute. On les croirait tombées d’hier si elles n’étaient rongées de lichens. L’une d’elles, la plus grosse, est fendue par le milieu. Un pâtre rêve dans ces rochers au bruit de cette nature en tumulte. Les chèvres bêlent et pendent. Je prends une grosse sauterelle verte qui se laisse faire. Puis je la pose sur le rocher, elle reste à la place où je l’ai mise. Un lézard sort d’une fente. La sauterelle et le lézard se regardent. Le lézard s’approche. La sauterelle s’envole comme un oiseau et va tomber au loin dans les grandes herbes. Je passe le pont de bois au confluent des deux gaves du Marcadau et du Lutour. Une odeur de soufre sort du torrent. Ici il est effrayant. C’est un écroulement de neige liquide. Bruit furieux. Sur les côtés les fleurs croissent en foule ; de petits bras du torrent font sur de petits blocs des cascades microscopiques. Il y a de petits bassins tranquilles avec fond de cailloux qu’on dirait arrangés par un enfant pour son jardin. Un rayon de soleil passe à travers les nuages et fait de chaque goutte d’eau une étincelle. — Belles flaques vertes. Tous les verts. Vert-clair, vert-noir. Les granits et les marbres tachés de rose qu’on aperçoit à travers l’eau glauque veinée de lumière ressemblent à des agates gigantesques. Je suis sorti par un soleil ardent, et voici qu’un nuage gris et lourd envahit tout le ciel. Il va pleuvoir. Je me réfugie sous la porte des bains du pré. Une vieille femme qui tricote me voit entrer en grondant. Figure délabrée et hideuse misère ; visage en guenilles sous une cape en haillons. Voyant que je m’obstine à rester et que j’ai pris une chaise, elle se lève, se traîne appuyée sur deux bâtons vers un couloir obscur, et s’en va. — Je cueille dans une tente du mur extérieur une belle fleur jaune qui a la forme de la tulipe et l’odeur de l’abricot. L’orage approche. De larges et sonores gouttes de pluie tombent sur les arbres et les rochers. Un éclair. Coup de tonnerre. Un coup de tonnerre dans ces gorges n’est plus un coup de tonnerre ; c’est un coup de pistolet, mais un coup de pistolet monstrueux qui éclate dans la nuée, tombe sur le sommet le plus voisin, et rebondit de montagne en montagne avec un bruit sec, sinistre et formidable. — Voici qu’il pleut affreusement. Toute autre chose que la nuée et la pluie a disparu. C’est une sorte de nuit blafarde entrecoupée d’éclairs dans laquelle on n’entend plus que deux rugissements ; le torrent qui hurle sans cesse et le tonnerre qui gronde par instants. Je rêvais à ce double bruit, et je me disais : le torrent ressemble à la rage et le tonnerre à la colère. » Le 23 août 1843 à 3 heures. « — Après deux heures de montée, immense prairie avec deux ou trois pauvres cabanes dont les jardins ont quelque maigre salade et des enclos de marbre. À droite un torrent. Devant moi un énorme bloc de marbre blanc et une vieille souche desséchée. Autour de moi des montagnes magnifiques. Les rayons du soleil y découpent de larges scies de lumière et d’ombre. Petits lacs de neige près du ciel dans les anfractuosités. D’immenses glissements d’ardoises étincellent là-bas au soleil autrement que de l’eau, autrement que de la glace. C’est comme le dos d’un énorme dragon. Larges pans de sombre et de clair. Plans immenses et simples. Quatre montagnes emplissent l’horizon. Rien qu’une herbe courte et rare et quelques bruyères. Cela fait pourtant une gigantesque housse de verdure qui couvre les monts jusqu’à l’endroit où les cols se dressent. Le torrent coule à plat et presque paisible au fond du ravin. Aucun bruit. Aucune voix. Ciel bleu. Calme profond. Solitude absolue. Je n’ai rien vu encore de plus beau et de plus grand dans les Pyrénées. » Le 24 août 1843. « — Deux torrents forment l’Y. Sur cet Y un pont circulaire à triple articulation, en sapins jetés de rochers en rochers. Sur le premier gave quatre autres ponts aux quatre étages de la montagne formés de troncs d’arbres. Écroulement de rochers. Torrent d’eau sur un torrent de pierres. 1er pont. Sapins desséchés avec leurs branches brisées court pouvant servir de mâts de perroquet aux ours. Dans un de ces sapins qui est creux, on a fait du feu. C’est encore une assez large cheminée. Des lichens chevelus vivent sur ces squelettes. Végétation à plusieurs couches. Toutes les fleurs de la montagne. Eau verte et paisible dans une anse au-dessous de la chute avec des sapins morts qui pendent dessus. 2e pont. Deux murailles noires. La lumière s’accroche aux saillies et y fait de petites terrasses éclatantes couvertes d’herbes et de fleurs. L’eau est lumineuse, la lumière est mouillée. Entre les deux murs noirs, le gave blanc. Au fond une cascade à quatre étages. Arbres coupés par les bûcherons. Forêt. Monts immenses au-dessous. 3e pont. Autre cascade. Arc-en-ciel. La chute tombe sur un plateau, puis se rue dans le gouffre. J’y descends en me tenant aux racines des arbres jusque sur un rocher qui avance. Le pont est au-dessus de ma tête. Le rocher qui reçoit le rejaillissement de la chute est troué comme une éponge. Brume et pluie. Je remonte. Les branches pourries cassent aisément. » Puis Victor Hugo, succomba bien évidemment au charme de Gavarnie en pays Toy, dont il fit la renommée dans ses carnets et son poème inachevé « Dieu » en décrivant ainsi le cirque : « Lorsqu’on a passé le pont des Dourroucats et qu’on n’est plus qu’à un quart d’heure de Gèdre, deux montagnes s’écartent tout à coup et, de quelque façon que vous préoccupe l’approche de Gavarnie, vous découvrent une chose inattendue. Vous avez visité peut-être les Alpes, les Andes, les Cordillères ; vous avez depuis quelques semaines les Pyrénées sous les yeux ; quoi que vous ayez pu voir, ce que vous apercevez maintenant ne ressemble à rien de ce que vous avez rencontré ailleurs. Jusqu’ici vous avez vu des montagnes ; vous avez contemplé des excroissances de toutes formes, de toutes hauteurs ; vous avez exploré des croupes vertes, des pentes de gneiss, de marbre ou de schiste, des précipices, des sommets arrondis ou dentelés, des glaciers, des forêts de sapins mêlées à des nuages, des aiguilles de granit, des aiguilles de glace ; mais, je le répète, vous n’avez vu nulle part ce que vous voyez en ce moment à l’horizon. Au milieu des courbes capricieuses des montagnes hérissées d’angles obtus et d’angles aigus, apparaissent brusquement des lignes droites, simples, calmes, horizontales ou verticales, parallèles ou se coupant à angles droits, et combinées de telle sorte que de leur ensemble résulte la figure éclatante, réelle, pénétrée d’azur et de soleil, d’un objet impossible et extraordinaire. Est-ce une montagne ? Mais quelle montagne a-t-elle jamais présenté ces surfaces rectilignes, ces plans réguliers, ces parallélismes rigoureux, ces symétries étranges, cet aspect géométrique ? Est-ce une muraille ? Voici des tours en effet qui la contrebutent et l’appuient, voici des créneaux, voilà les corniches, les architraves, les assises et les pierres que le regard distingue et pourrait presque compter, voilà deux brèches taillées à vif et qui éveillent dans l’esprit des idées de sièges, de tranchées et d’assauts ; mais voilà aussi des neiges, de larges bandes de neige posées sur ces assises, sur ces créneaux, sur ces architraves et sur ces tours ; nous sommes au cœur de l’été et du midi ; ce sont donc des neiges éternelles ; or, quelle muraille, quelle architecture humaine s’est jamais élevée jusqu’au niveau effrayant des neiges éternelles ? Babel, l’effort du genre humain tout entier, s’est affaissée sur elle-même avant de l’avoir atteint. Qu’est-ce donc que cet objet inexplicable qui ne peut pas être une montagne et qui a la hauteur des montagnes, qui ne peut pas être une muraille et qui a la forme des murailles ? C’est une montagne et une muraille tout à la fois ; c’est l’édifice le plus mystérieux du plus mystérieux des architectes ; c’est le colosseum de la nature ; c’est Gavarnie. Représentez-vous cette silhouette magnifique telle qu’elle se révèle d’abord à une distance de trois lieues : une longue et sombre muraille dont toutes les saillies, toutes les rides sont marquées par des lignes de neige, dont toutes les plates-formes portent des glaciers. Vers le milieu, deux grosses tours ; l’une qui est au levant, carrée et tournant un de ses angles vers la France ; l’autre qui est au couchant, cannelée comme si c’était moins une tour qu’une gerbe de tourelles ; toutes deux couvertes de neige. À droite, deux profondes entailles, les brèches, qui découpent dans la muraille comme deux vases qu’emplissent les nuées ; enfin, toujours à droite et à l’extrémité occidentale, une sorte de rebord énorme plissé de mille gradins, qui offre à l’œil, dans des proportions monstrueuses, ce qu’on appellerait en architecture la coupe d’un amphithéâtre. Représentez-vous cela comme je le voyais : la muraille noire, les tours noires ; la neige éclatante, le ciel bleu ; une chose complète enfin, grande jusqu’à l’inouï, sereine jusqu’au sublime. C’est là une impression qui ne ressemble à aucune autre, si singulière et si puissante à la fois qu’elle efface tout le reste, et qu’on devient pour quelques instants, même quand cette vision magique a disparu dans un tournant du chemin, indifférent à tout ce qui n’est pas elle. Le paysage qui vous entoure est cependant admirable ; vous entrez dans une vallée où toutes les magnificences et toutes les grâces vous enveloppent. Des villages en deux étages, comme Tracy-le-Haut et Tracy-le-Bas, Gèdre-Dessus et Gèdre-Dessous, avec leurs pignons en escaliers et leur vieille église des Templiers, se pelotonnent et se déroulent sur le flanc de deux montagnes, le long d’un gave blanc d’écume, sous les touffes gaies et fantasques d’une végétation charmante. Tout cela est vif, ravissant, heureux, exquis ; c’est la Suisse et la Forêt-Noire qui se mêlent brusquement aux Pyrénées. Mille bruits joyeux vous arrivent comme les voix et les paroles de ce doux paysage, chants d’oiseaux, rires d’enfants, murmures du gave, frémissement des feuilles, souffles apaisés du vent. Vous ne voyez rien ; vous n’entendez rien ; à peine percevez-vous de ce gracieux ensemble quelque impression douteuse et confuse. L’apparition de Gavarnie est toujours devant vos yeux, et rayonne dans votre pensée comme ces horizons surnaturels qu’on voit quelquefois au fond des rêves. Le soir, en revenant de Gavarnie, moment admirable. De ma fenêtre : une grande montagne remplit la terre ; un grand nuage remplit le ciel. Entre le nuage et la montagne, une bande mince de ciel crépusculaire, clair, vif, limpide, et Jupiter étincelant, caillou d’or dans un ruisseau d’argent. Rien de plus mélancolique et de plus rassurant et de plus beau que ce petit point de lumière entre ces deux blocs de ténèbres. » Enfin, Victor Hugo ne manqua pas la visite de Luz-Saint-Sauveur et relata : « Luz, charmante vieille ville, — chose rare dans les Pyrénées françaises, — délicieusement située dans une profonde vallée triangulaire. Trois grands rayons de jour y entrent par les trois embrasures des trois montagnes. Quand les miquelets et les contrebandiers espagnols arrivaient d’Aragon par la brèche de Roland et par le noir et hideux sentier de Gavarnie, ils apercevaient tout à coup à l’extrémité de la gorge obscure une grande clarté, comme est la porte d’une cave à ceux qui sont dedans. Ils se hâtaient et trouvaient un gros bourg éclairé de soleil et vivant. Ce bourg, ils l’ont nommé Lumière, Luz. Le Château de Sainte-Marie. J’en ai fait quatre dessins. L’Église bâtie par les Templiers ; rare et curieuse ; forteresse autant qu’église ; enceinte crénelée, porte-donjon. J’ai tourné autour, entre l’église et le mur crénelé. Là est le cimetière, semé de grandes ardoises où des croix et des noms de montagnards creusés avec un clou s’effacent sous la pluie, la neige et les pieds des passants. Porte des cagots, dans le cimetière ; murée ; les goitreux étaient parias. Ils avaient leur porte. Basse, autant qu’on en peut juger par la ligne vague que les pierres qui la murent dessinent. Le bénitier extérieur est un charmant petit tombeau byzantin auquel adhèrent encore deux chapiteaux presque romains. On y cache la clef du cimetière, afin de faire payer les étrangers pour le voir. Car tout se paie. Inscription du tombeau ; illisible, effacée par le temps, rayée au couteau, couverte de poussière. On y distingue quelques mots espagnols. Aqui. Abris. Cependant les mots filla de... semblent indiquer le patois. J’ai à peu près déchiffré la dernière ligne, qui du reste n’a aucun sens : sub desera lo fe. Les corbeaux du mur extérieur de l’abside portent des dessins curieux et charmants. Le portail principal, qui représente Jésus entre les quatre animaux symboliques, est du plus beau roman ; ferme, robuste, puissant, sévère. Restes de peintures sur le mur figurant des mosaïques et des édifices. L’intérieur de l’église est une grange quelconque. Sous la voûte du portail de la tour d’entrée, peintures byzantines, restaurées et à demi blanchies à la chaux ; ont perdu beaucoup de leur caractère. Au haut de la voûte, le Christ, avec la couronne impériale. Au-dessous, les anges du jugement soufflant de leurs trompettes cette inscription : surgite mortvy-venyte-ad-judicium. Aux quatre coins, quelques vestiges des quatre évangélistes. Le bœuf, avec l’inscription sant-luc. L’aigle, avec sant… La moisissure a fait une nuée où le reste se perd. Le lion ailé, d’un beau style, avec l’inscription sant-marc. Dans l’ombre, une tête d’ange avec ce reste de légende : … cte mychael. » La cure à Cauterets terminée, Victor Hugo reprend le chemin du retour : Auch, Agen, Périgueux, Cognac, Saintes et Rochefort. Mais ce voyage aux Pyrénées aura une fin tragique : car c’est à Rochefort que, lisant un journal abandonné dans un café, il apprend la noyade quelques jours plus tôt à Villequier de sa fille adorée Léopoldine et de son mari. L'écrivain sera terriblement affecté par cette mort, qui lui inspirera plusieurs poèmes — Les Contemplations (1856) — notamment, « Demain, dès l'aube… ». À partir de cette date et jusqu'à son exil, Victor Hugo ne produira plus rien, ni théâtre, ni roman, ni poème. Et le journal de Voyage aux Pyrénées s’arrête (il ne sera édité que des années plus tard). La vie du poète, son inspiration ne seront plus les mêmes. Le Voyage aux Pyrénées (1843) a été écrit, au fur et à mesure, dans les lieux mêmes qu'il dépeint, mais sur des pages d'album que Hugo conservait par devers lui. Cette publication s’accompagne de croquis exécutés sur place qui complètent et éclairent le texte. Hugo enregistre ce qu’il voit, crayonne, note sur ces carnets quelques vers qui lui permettront au retour de ressusciter, en prose ou dans quelques poèmes, ses impressions de voyage. Il demande à Juliette de collaborer avec lui. Elle tient son journal de voyage. Ces pages apportent à la littérature pyrénéenne une contribution utile par ce qu’elles ont de vivant et de profondément humain. À sa parution à la fin du XIXe siècle, l'édition posthume du « Voyage vers les Pyrénées » suscite l'admiration et l'enthousiasme. Rédigé sans apprêt, comme un reportage, ce journal de voyage est aussi une chronique d'un voyage intérieur. De retour à Paris, Victor Hugo, après la catastrophe qui avait interrompu si douloureusement son voyage, ne trouva jamais le courage de reprendre et de terminer son récit, initialement destiné à être publié. Ce dernier le sera à titre posthume, en 1890, cinq ans après son décès, signe de la blessure vivace dans le cœur de Victor Hugo toute sa vie durant. C’est après le coup d'État de Louis Napoléon Bonaparte (futur Napoléon III), en 1851, que Victor Hugo sera contraint à l'exil. Déguisé, il gagnera Bruxelles en train. Mais son pamphlet Napoléon le Petit le rendra persona non grata en Belgique et l'obligera à quitter le continent... Hugo débarquera sur l'île de Jersey en août 1852. Le Voyage aux Pyrénées est un carnet de voyage, une pièce de commande pour laquelle il avait reçu une avance d’un éditeur, et pour lequel il décrivait, sur place, ce qui le frappait le plus. Atteignant Lourdes à bord de la diligence Dotézac, qui doit le mener à Cauterets pour prendre les eaux et soulager ses rhumatismes, il avait noté : « Lourdes. — Arrivée magique. Magnifique donjon du treizième siècle sur un rocher. Le gave d’un côté, la ville de l’autre. Au fond les montagnes, hautes, abruptes, coupées de tranchées profondes d’où montent les brumes, le vent, le bruit. À Lourdes commence la grande gorge des hautes Pyrénées qui s’épanouit à Vidalos, s’écarte et se divise en quatre ravins, et forme cette immense patte d’oie dont le centre est Argelès et dont les quatre ongles vont atteindre à l’occident Arbéost par la vallée d’Estrem de Salle et Aucun par le val d’Azun, au milieu Cauterets par le détroit de Pierrefitte, et au levant Barèges par le défilé de Luz. — La gorge de Lourdes à Argelès en est pour ainsi dire le manche. Comme le bras de cette main ouverte. Lourdes est la porte des Hautes-Pyrénées. En 1755 elle ressentit le contrecoup du tremblement de terre de Lisbonne. Le réseau central des Pyrénées était gardé au Moyen Âge. Chaque articulation des vallées avait son château qui apercevait les deux châteaux des deux vallées voisines, et correspondait avec eux par des feux. On en voit aujourd’hui les ruines qui ajoutent un immense intérêt au paysage ; rien de plus poignant que les ruines de l’homme mêlées aux ruines de la nature. Le donjon de Lourdes voyait les trois tourelles du château de Pau qui apercevait la tour carrée de Vidalos, laquelle pouvait communiquer par des signaux avec l’antique Castrum Emilianum bâti par les Romains et relevé par Charlemagne sur la colline de Saint-Savin, qui se rattachait à travers les montagnes à la forteresse féodale de Beaucens. Les signaux s’enfonçaient ainsi de tours en tours dans la vallée de Luz jusqu’au château Sainte-Marie, dans la vallée de Gavarnie jusqu’à la citadelle des Templiers. Les châtelains des Pyrénées comme les burgraves du Rhin s’avertissaient les uns les autres. En quelques heures les bailliages étaient sur pied, la montagne était en feu. Les paysans, chose remarquable et toute locale, ne haïssaient pas ces châteaux. Ils avaient le sentiment que ces forteresses, tout en les dominant, en les opprimant même, protégeaient la frontière. C’est le peuple des montagnes qui a donné à l’un de ces châteaux près du col d’Ossau le nom de Bon-Château qu’il garde encore : Castelloubon. » Tous ces lieux et ces endroits traversés furent pour Victor Hugo, qui disait s’appeler M. Go et portait un chapeau pour ne pas être reconnu, source d’inspiration mais aussi l’occasion de plonger dans son passé et de retrouver ses impressions d'enfance. Sylvie Blotnikas a adapté et mis en scène ce récit de voyage vers les Pyrénées que Julien Rochefort, fils de Jean Rochefort, délivre d’un souffle, en osmose avec le poète qu’il fait revivre. Pour la première fois, ce récit de voyage de Victor Hugo est adapté au théâtre. Le comédien Julien Rochefort livre de ce texte une interprétation pleine de douceur, de délicatesse, rehaussée par un subtil travail de lumière qui agit comme une évocation subliminale des paysages traversés. On se laisse aller avec délice à la lenteur du voyage en malle-poste, à cheval, à pied… Au fil de ce texte d’une beauté magistrale, empreint de profondeur philosophique mais aussi de distance comique, Hugo alterne évocations des petites gens, des horizons marins, de la montagne toujours, laissant vagabonder ses pensées, de croquis frais et pittoresques en échappées oniriques… Car si la représentation dure un peu plus d'une heure, c'est un long monologue à connaître par cœur et que Julien Rochefort rend parfaitement vivant. Hugo ayant entretenu pendant ces deux mois d’absence une correspondance avec sa femme et ses quatre enfants en utilisant la poste restante, quelques-unes de ses lettres, tendres et très touchantes, se sont tout naturellement insérées dans le fil du récit.
Victor HUGO, né le 26 février 1802 à Besançon et mort le 22 mai 1885 à Paris, à l’âge de 83 ans. Il est considéré comme l'un des plus importants écrivains de langue française. Il est aussi une personnalité politique et un intellectuel engagé qui a joué un rôle majeur dans l'histoire du XIXe siècle. En 1833, il rencontre la comédienne Juliette Drouet, qui devient sa maîtresse. Tous les ans, Hugo accomplit un séjour d'un mois dans une région française ou un pays d'Europe, en compagnie de son amante Juliette Drouet. De chacune de ses escapades il rapporte dessins, peintures et notes et envoie des courriers aux êtres chers : à sa femme Adèle, sa fille Léopoldine, ses amis Alfred de Vigny et Louis Boulanger. Après le voyage effectué en 1840 dans la vallée du Rhin avec Juliette Drouet, à 41 ans il décide de se rendre incognito dans le Sud-Ouest et en Espagne pour une nouvelle escapade amoureuse en sa compagnie. Surmené et aspirant à une diversion, il part en diligence le 18 juillet 1843 pour les Pyrénées et doit gagner Cauterets pour suivre une cure thermale. Le 20 juillet, après 36 heures de diligence, il atteint Bordeaux où commence son journal de voyage, puis se dirige à Bayonne. Il visite Biarritz qui commence à être à la mode. Le 28 juillet, il est à Saint-Sébastien qu’il quitte le 2 août pour s’installer une semaine à Pasages, entre mer et montagne. Par Hernani et Tolosa, il gagne Pampelune. Franchissant à nouveau la frontière française, il revient à Bayonne. De là, il se rend à Pau puis s’installe pour une quinzaine de jours à Cauterets dans les Hautes-Pyrénées pour y prendre les eaux et y vivre des amours secrètes. Comme tout curiste, il fait quelques excursions et flâne dans les environs de Cauterets, au lac de Gaube, sur les bords du gave du Marcadau, puis à Gavarnie, à Luz-Saint-Sauveur ... En chemin, prenant des notes, voici ce qu’il écrit sur chacune de ses visites et excursions dans les hautes vallées de Cauterets et du pays Toy. D’abord cette lettre adressée à Louis Boulanger sur Cauterets. « Je vous écris, cher Louis, avec les plus mauvais yeux du monde. Vous écrire pourtant est une douce et vieille habitude que je ne veux pas perdre. Je ne veux pas laisser tomber une seule pierre de notre amitié. Voilà vingt ans bientôt que nous sommes frères, frères par le cœur, frères par la pensée. Nous voyons la création avec les mêmes yeux, nous voyons l’art avec le même esprit. Vous aimez Dante comme j’aime Raphaël. Nous avons traversé ensemble bien des jours de lutte et d’épreuve sans faiblir dans notre sympathie, sans reculer d’un pas dans notre dévouement. Restons donc jusqu’au dernier jour ce que nous avons été dès le premier. Ne changeons rien à ce qui a été si bon et si doux. À Paris, serrons-nous la main ; absents, écrivons-nous. J’ai besoin quand je suis loin de vous qu’une lettre vous aille dire quelque chose de ce que je vois, de ce que je pense, de ce que je sens. Cette fois elle sera plus courte, c’est-à-dire moins longue qu’à l’ordinaire. Mes yeux me forcent à ménager les vôtres. Ne vous plaignez pas, vous aurez moins de grimoire et autant d’amitié. Je viens de la mer et je suis dans la montagne. Ce n’est, pour ainsi dire, pas changer d’émotion. Les montagnes et la mer parlent au même côté de l’esprit. Si vous étiez ici (je ne puis m’empêcher de faire constamment ce rêve), quelle vie charmante nous mènerions ensemble ! quels tableaux vous remporteriez dans votre pensée pour les rendre ensuite à l’art plus beaux encore que la nature ne vous les aurait donnés ! Figurez-vous, Louis, que je me lève tous les jours à quatre heures du matin, et qu’à cette heure sombre et claire tout à la fois je m’en vais dans la montagne. Je marche le long d’un torrent, je m’enfonce dans une gorge la plus sauvage qu’il y ait, et, sous prétexte de me tremper dans de l’eau chaude et de boire du soufre, j’ai tous les jours un spectacle nouveau, inattendu et merveilleux. Hier, la nuit avait été pluvieuse, l’air était froid, les sapins mouillés étaient plus noirs qu’à l’ordinaire, les brumes montaient de toutes parts des ravins comme les fumées des fêlures d’une solfatare ; un bruit hideux et terrible sortait des ténèbres, en bas, dans le précipice, sous mes pieds ; c’était le cri de rage du torrent caché par le brouillard. Je ne sais quoi de vague, de surnaturel et d’impossible se mêlait au paysage ; tout était ténébreux et comme pensif autour de moi ; les spectres immenses des montagnes m’apparaissaient par les trous des nuées comme à travers des linceuls déchirés. Le crépuscule n’éclairait rien ; seulement, par une crevasse au-dessus de ma tête, j’apercevais au loin dans l’infini un coin du ciel bleu, pâle, glacé, lugubre et éclatant ; tout ce que je distinguais de la terre, rochers, forêts, prairies, glaciers, se mouvait pêle-mêle dans les vapeurs et semblait fuir, emporté par le vent à travers l’espace dans un gigantesque réseau de nuages. Ce matin, la nuit avait été sereine. Le ciel était étoilé ; mais quel ciel et quelles étoiles ! vous savez, cette fraîcheur, cette grâce, cette transparence mélancolique et inexprimable du matin, les étoiles claires sur le ciel blanc, une voûte de cristal semée de diamants. À cette voûte lumineuse s’appuyaient de toutes parts les énormes montagnes, noires, velues, difformes. Celles de l’orient découpaient à leur sommet sur le plus vif de l’aube leurs sapins qui ressemblaient à ces feuilles dont les pucerons ne laissent que les fibres et font une dentelle. Celles de l’occident, noires à leur base et dans presque toute leur hauteur, avaient à leur cime une clarté rose. Pas un nuage, pas une vapeur. Une vie obscure et charmante animait le flanc ténébreux des montagnes ; on y distinguait l’herbe, les fleurs, les pierres, les bruyères, dans une sorte de fourmillement doux et joyeux. Le bruit du gave n’avait plus rien d’horrible ; c’était un grand murmure mêlé à ce grand silence. Aucune pensée triste, aucune anxiété ne sortait de cet ensemble plein d’harmonie. Toute la vallée était comme une urne immense où le ciel, pendant les heures sacrées de l’aube, versait la paix des sphères et le rayonnement des constellations. Il me semble, mon ami, que ces choses-là sont plus que des paysages. C’est la nature entrevue à de certains moments mystérieux où tout semble rêver, j’ai presque dit penser, où l’arbre, le rocher, le nuage et le buisson vivent plus visiblement qu’à d’autres heures et semblent tressaillir du sourd battement de la vie universelle. Vision étrange et qui pour moi est bien près d’être une réalité, aux instants où les yeux de l’homme sont fermés, quelque chose d’inconnu apparaît dans la création. Ne le voyez-vous pas comme moi ? Ne dirait-on pas qu’aux moments du sommeil, quand la pensée cesse dans l’homme, elle commence dans la nature ? Est-ce que le calme est plus profond, le silence plus absolu, la solitude plus complète, et qu’alors le rêveur qui veille peut mieux saisir, dans ses détails subtils et merveilleux, le fait extraordinaire de la création ? ou bien y a-t-il en effet quelque révélation, quelque manifestation de la grande intelligence entrant en communication avec le grand tout, quelque attitude nouvelle de la nature ? La nature se sent-elle mieux à l’aise quand nous ne sommes pas là ? se déploie-t-elle plus librement ? Il est certain qu’en apparence du moins, il y a pour les objets que nous nommons inanimés une vie crépusculaire et une vie nocturne. Cette vie n’est peut-être que dans notre esprit ; les réalités sensibles se présentent à nous à de certaines heures sous un aspect inusité ; elles nous émeuvent ; il s’en fait un mirage au dedans de nous, et nous prenons les idées nouvelles qu’elles nous suggèrent pour une vie nouvelle qu’elles ont. Voilà les questions. Décidez. Quant à moi, je me borne à rêver. Je voue mon esprit à contempler le monde et à étudier le mystère. Je passe ma vie entre un point d’admiration et un point d’interrogation. » Cauterets, le 26 août 1843. « — La vallée est paisible, l’escarpement est silencieux. Le vent se tait. Tout à coup, à un coude de la montagne, le gave apparaît. C’est le bruit d’une mêlée, c’en est l’aspect. Les combattants hurlent de rage et l’on croit voir voler les projectiles. — On s’approche. — De larges entonnoirs forment de grandes cuves où l’eau saute et bout, couverte d’écume comme dans une marmite énorme chauffée à un feu qui ne s’éteint jamais. Des souches d’arbres monstrueuses, des racines hideuses, décharnées et difformes, roulent dans le torrent comme des carcasses d’hydres. — L’horrible est là partout. » Durant sa cure, sur son temps libre, Hugo se rend au Lac de Gaube, dont il écrit : « — Treize cents pieds. Notre vieille Notre-Dame s’y entasserait six fois sur elle-même avant que la haute balustrade de ses tours parvînt à la surface de l’eau. On y plongerait la grande pyramide, on poserait sur Chéops le Munster de Strasbourg et sur le Munster la flèche d’Anvers que c’est à peine si l’extrémité de la flèche d’Anvers surgirait au-dessus du lac comme la pointe du mât d’un vaisseau naufragé. Vallée très sauvage. Forêt de pins écrasée par une montagne écroulée. Arbres étêtés, arbres morts. Ici les années, les coups de tonnerre et les avalanches sont les seuls bûcherons. Le lac à 4 heures de l’après-midi — Une flaque d’eau la plus verte, la plus gracieuse, la plus jolie, la plus gaie, entourée de rochers hideux, mâchés, déformés, ruinés, terribles. Au fond, les neiges du Vignemale, la plus haute montagne française, font un immense Y renversé sur l’orient. Au bord, une transparence sous laquelle on voit les granits, mais qui s’enfonce rapidement. Les grandes ombres du rocher tombent sur l’escarpement occidental comme des ombres de créneaux. Au premier plan. — Une cabane où l’on boit du kirsch, une cage pleine de poules ; canards ; rocher qui fait une petite presqu’île. On y voit une espèce de tombeau en marbre blanc entouré d’une grille. Ce sont des anglais qui se sont noyés ici et dont voici l’épitaphe : " à la mémoire de William Henry Pattison, écuyer, avocat de Lincoln’s Inn, à Londres, et de Sarah Frences, son épouse, âgés l’un de 31 ans et l’autre de 26 ans, mariés depuis un mois seulement. Un accident affreux les enleva à leurs parents et à leurs amis inconsolables. Ils furent engloutis dans ce lac le 20 septembre 1832. Leurs restes transportés en Angleterre reposent à Wilham dans le comté d’Essex. " (En effet, les Pattison qui venaient de se marier (le 22 août) empruntèrent une barque le 20 septembre 1832. Malheureusement, l’embarcation chavira, emportant dans les flots le jeune couple — Ce monument fut détruit par les troupes d’occupation le jour du débarquement allié en Normandie, le 6 juin 1944, et de nos jours, plus rien ne rappelle la trace du monument Pattison, dont l’emplacement est indiqué par une croix). Eau glaciale. Qui y tombe y meurt. Depuis quatre-vingt-dix ans que le vieux pêcheur était là, il n’avait vu personne assez hardi pour s’y baigner. Il en coûte trois sous par personne pour entrer dans l’enclos du tombeau. J’y ai cueilli des cinéraires dans le granit en surplomb sur le lac. J’ai glissé et failli tomber dans l’eau. Cela eût fait une deuxième tombe. On eût pris six sous. » Hugo flâne aussi sur les bords du gave du Marcadau et note ce témoignage : « Immense éboulement. Les pierres éparses ont roulé jusque dans le gave. Elles ont encore tout le désordre de la chute. On les croirait tombées d’hier si elles n’étaient rongées de lichens. L’une d’elles, la plus grosse, est fendue par le milieu. Un pâtre rêve dans ces rochers au bruit de cette nature en tumulte. Les chèvres bêlent et pendent. Je prends une grosse sauterelle verte qui se laisse faire. Puis je la pose sur le rocher, elle reste à la place où je l’ai mise. Un lézard sort d’une fente. La sauterelle et le lézard se regardent. Le lézard s’approche. La sauterelle s’envole comme un oiseau et va tomber au loin dans les grandes herbes. Je passe le pont de bois au confluent des deux gaves du Marcadau et du Lutour. Une odeur de soufre sort du torrent. Ici il est effrayant. C’est un écroulement de neige liquide. Bruit furieux. Sur les côtés les fleurs croissent en foule ; de petits bras du torrent font sur de petits blocs des cascades microscopiques. Il y a de petits bassins tranquilles avec fond de cailloux qu’on dirait arrangés par un enfant pour son jardin. Un rayon de soleil passe à travers les nuages et fait de chaque goutte d’eau une étincelle. — Belles flaques vertes. Tous les verts. Vert-clair, vert-noir. Les granits et les marbres tachés de rose qu’on aperçoit à travers l’eau glauque veinée de lumière ressemblent à des agates gigantesques. Je suis sorti par un soleil ardent, et voici qu’un nuage gris et lourd envahit tout le ciel. Il va pleuvoir. Je me réfugie sous la porte des bains du pré. Une vieille femme qui tricote me voit entrer en grondant. Figure délabrée et hideuse misère ; visage en guenilles sous une cape en haillons. Voyant que je m’obstine à rester et que j’ai pris une chaise, elle se lève, se traîne appuyée sur deux bâtons vers un couloir obscur, et s’en va. — Je cueille dans une tente du mur extérieur une belle fleur jaune qui a la forme de la tulipe et l’odeur de l’abricot. L’orage approche. De larges et sonores gouttes de pluie tombent sur les arbres et les rochers. Un éclair. Coup de tonnerre. Un coup de tonnerre dans ces gorges n’est plus un coup de tonnerre ; c’est un coup de pistolet, mais un coup de pistolet monstrueux qui éclate dans la nuée, tombe sur le sommet le plus voisin, et rebondit de montagne en montagne avec un bruit sec, sinistre et formidable. — Voici qu’il pleut affreusement. Toute autre chose que la nuée et la pluie a disparu. C’est une sorte de nuit blafarde entrecoupée d’éclairs dans laquelle on n’entend plus que deux rugissements ; le torrent qui hurle sans cesse et le tonnerre qui gronde par instants. Je rêvais à ce double bruit, et je me disais : le torrent ressemble à la rage et le tonnerre à la colère. » Le 23 août 1843 à 3 heures. « — Après deux heures de montée, immense prairie avec deux ou trois pauvres cabanes dont les jardins ont quelque maigre salade et des enclos de marbre. À droite un torrent. Devant moi un énorme bloc de marbre blanc et une vieille souche desséchée. Autour de moi des montagnes magnifiques. Les rayons du soleil y découpent de larges scies de lumière et d’ombre. Petits lacs de neige près du ciel dans les anfractuosités. D’immenses glissements d’ardoises étincellent là-bas au soleil autrement que de l’eau, autrement que de la glace. C’est comme le dos d’un énorme dragon. Larges pans de sombre et de clair. Plans immenses et simples. Quatre montagnes emplissent l’horizon. Rien qu’une herbe courte et rare et quelques bruyères. Cela fait pourtant une gigantesque housse de verdure qui couvre les monts jusqu’à l’endroit où les cols se dressent. Le torrent coule à plat et presque paisible au fond du ravin. Aucun bruit. Aucune voix. Ciel bleu. Calme profond. Solitude absolue. Je n’ai rien vu encore de plus beau et de plus grand dans les Pyrénées. » Le 24 août 1843. « — Deux torrents forment l’Y. Sur cet Y un pont circulaire à triple articulation, en sapins jetés de rochers en rochers. Sur le premier gave quatre autres ponts aux quatre étages de la montagne formés de troncs d’arbres. Écroulement de rochers. Torrent d’eau sur un torrent de pierres. 1er pont. Sapins desséchés avec leurs branches brisées court pouvant servir de mâts de perroquet aux ours. Dans un de ces sapins qui est creux, on a fait du feu. C’est encore une assez large cheminée. Des lichens chevelus vivent sur ces squelettes. Végétation à plusieurs couches. Toutes les fleurs de la montagne. Eau verte et paisible dans une anse au-dessous de la chute avec des sapins morts qui pendent dessus. 2e pont. Deux murailles noires. La lumière s’accroche aux saillies et y fait de petites terrasses éclatantes couvertes d’herbes et de fleurs. L’eau est lumineuse, la lumière est mouillée. Entre les deux murs noirs, le gave blanc. Au fond une cascade à quatre étages. Arbres coupés par les bûcherons. Forêt. Monts immenses au-dessous. 3e pont. Autre cascade. Arc-en-ciel. La chute tombe sur un plateau, puis se rue dans le gouffre. J’y descends en me tenant aux racines des arbres jusque sur un rocher qui avance. Le pont est au-dessus de ma tête. Le rocher qui reçoit le rejaillissement de la chute est troué comme une éponge. Brume et pluie. Je remonte. Les branches pourries cassent aisément. » Puis Victor Hugo, succomba bien évidemment au charme de Gavarnie en pays Toy, dont il fit la renommée dans ses carnets et son poème inachevé « Dieu » en décrivant ainsi le cirque : « Lorsqu’on a passé le pont des Dourroucats et qu’on n’est plus qu’à un quart d’heure de Gèdre, deux montagnes s’écartent tout à coup et, de quelque façon que vous préoccupe l’approche de Gavarnie, vous découvrent une chose inattendue. Vous avez visité peut-être les Alpes, les Andes, les Cordillères ; vous avez depuis quelques semaines les Pyrénées sous les yeux ; quoi que vous ayez pu voir, ce que vous apercevez maintenant ne ressemble à rien de ce que vous avez rencontré ailleurs. Jusqu’ici vous avez vu des montagnes ; vous avez contemplé des excroissances de toutes formes, de toutes hauteurs ; vous avez exploré des croupes vertes, des pentes de gneiss, de marbre ou de schiste, des précipices, des sommets arrondis ou dentelés, des glaciers, des forêts de sapins mêlées à des nuages, des aiguilles de granit, des aiguilles de glace ; mais, je le répète, vous n’avez vu nulle part ce que vous voyez en ce moment à l’horizon. Au milieu des courbes capricieuses des montagnes hérissées d’angles obtus et d’angles aigus, apparaissent brusquement des lignes droites, simples, calmes, horizontales ou verticales, parallèles ou se coupant à angles droits, et combinées de telle sorte que de leur ensemble résulte la figure éclatante, réelle, pénétrée d’azur et de soleil, d’un objet impossible et extraordinaire. Est-ce une montagne ? Mais quelle montagne a-t-elle jamais présenté ces surfaces rectilignes, ces plans réguliers, ces parallélismes rigoureux, ces symétries étranges, cet aspect géométrique ? Est-ce une muraille ? Voici des tours en effet qui la contrebutent et l’appuient, voici des créneaux, voilà les corniches, les architraves, les assises et les pierres que le regard distingue et pourrait presque compter, voilà deux brèches taillées à vif et qui éveillent dans l’esprit des idées de sièges, de tranchées et d’assauts ; mais voilà aussi des neiges, de larges bandes de neige posées sur ces assises, sur ces créneaux, sur ces architraves et sur ces tours ; nous sommes au cœur de l’été et du midi ; ce sont donc des neiges éternelles ; or, quelle muraille, quelle architecture humaine s’est jamais élevée jusqu’au niveau effrayant des neiges éternelles ? Babel, l’effort du genre humain tout entier, s’est affaissée sur elle-même avant de l’avoir atteint. Qu’est-ce donc que cet objet inexplicable qui ne peut pas être une montagne et qui a la hauteur des montagnes, qui ne peut pas être une muraille et qui a la forme des murailles ? C’est une montagne et une muraille tout à la fois ; c’est l’édifice le plus mystérieux du plus mystérieux des architectes ; c’est le colosseum de la nature ; c’est Gavarnie. Représentez-vous cette silhouette magnifique telle qu’elle se révèle d’abord à une distance de trois lieues : une longue et sombre muraille dont toutes les saillies, toutes les rides sont marquées par des lignes de neige, dont toutes les plates-formes portent des glaciers. Vers le milieu, deux grosses tours ; l’une qui est au levant, carrée et tournant un de ses angles vers la France ; l’autre qui est au couchant, cannelée comme si c’était moins une tour qu’une gerbe de tourelles ; toutes deux couvertes de neige. À droite, deux profondes entailles, les brèches, qui découpent dans la muraille comme deux vases qu’emplissent les nuées ; enfin, toujours à droite et à l’extrémité occidentale, une sorte de rebord énorme plissé de mille gradins, qui offre à l’œil, dans des proportions monstrueuses, ce qu’on appellerait en architecture la coupe d’un amphithéâtre. Représentez-vous cela comme je le voyais : la muraille noire, les tours noires ; la neige éclatante, le ciel bleu ; une chose complète enfin, grande jusqu’à l’inouï, sereine jusqu’au sublime. C’est là une impression qui ne ressemble à aucune autre, si singulière et si puissante à la fois qu’elle efface tout le reste, et qu’on devient pour quelques instants, même quand cette vision magique a disparu dans un tournant du chemin, indifférent à tout ce qui n’est pas elle. Le paysage qui vous entoure est cependant admirable ; vous entrez dans une vallée où toutes les magnificences et toutes les grâces vous enveloppent. Des villages en deux étages, comme Tracy-le-Haut et Tracy-le-Bas, Gèdre-Dessus et Gèdre-Dessous, avec leurs pignons en escaliers et leur vieille église des Templiers, se pelotonnent et se déroulent sur le flanc de deux montagnes, le long d’un gave blanc d’écume, sous les touffes gaies et fantasques d’une végétation charmante. Tout cela est vif, ravissant, heureux, exquis ; c’est la Suisse et la Forêt-Noire qui se mêlent brusquement aux Pyrénées. Mille bruits joyeux vous arrivent comme les voix et les paroles de ce doux paysage, chants d’oiseaux, rires d’enfants, murmures du gave, frémissement des feuilles, souffles apaisés du vent. Vous ne voyez rien ; vous n’entendez rien ; à peine percevez-vous de ce gracieux ensemble quelque impression douteuse et confuse. L’apparition de Gavarnie est toujours devant vos yeux, et rayonne dans votre pensée comme ces horizons surnaturels qu’on voit quelquefois au fond des rêves. Le soir, en revenant de Gavarnie, moment admirable. De ma fenêtre : une grande montagne remplit la terre ; un grand nuage remplit le ciel. Entre le nuage et la montagne, une bande mince de ciel crépusculaire, clair, vif, limpide, et Jupiter étincelant, caillou d’or dans un ruisseau d’argent. Rien de plus mélancolique et de plus rassurant et de plus beau que ce petit point de lumière entre ces deux blocs de ténèbres. » Enfin, Victor Hugo ne manqua pas la visite de Luz-Saint-Sauveur et relata : « Luz, charmante vieille ville, — chose rare dans les Pyrénées françaises, — délicieusement située dans une profonde vallée triangulaire. Trois grands rayons de jour y entrent par les trois embrasures des trois montagnes. Quand les miquelets et les contrebandiers espagnols arrivaient d’Aragon par la brèche de Roland et par le noir et hideux sentier de Gavarnie, ils apercevaient tout à coup à l’extrémité de la gorge obscure une grande clarté, comme est la porte d’une cave à ceux qui sont dedans. Ils se hâtaient et trouvaient un gros bourg éclairé de soleil et vivant. Ce bourg, ils l’ont nommé Lumière, Luz. Le Château de Sainte-Marie. J’en ai fait quatre dessins. L’Église bâtie par les Templiers ; rare et curieuse ; forteresse autant qu’église ; enceinte crénelée, porte-donjon. J’ai tourné autour, entre l’église et le mur crénelé. Là est le cimetière, semé de grandes ardoises où des croix et des noms de montagnards creusés avec un clou s’effacent sous la pluie, la neige et les pieds des passants. Porte des cagots, dans le cimetière ; murée ; les goitreux étaient parias. Ils avaient leur porte. Basse, autant qu’on en peut juger par la ligne vague que les pierres qui la murent dessinent. Le bénitier extérieur est un charmant petit tombeau byzantin auquel adhèrent encore deux chapiteaux presque romains. On y cache la clef du cimetière, afin de faire payer les étrangers pour le voir. Car tout se paie. Inscription du tombeau ; illisible, effacée par le temps, rayée au couteau, couverte de poussière. On y distingue quelques mots espagnols. Aqui. Abris. Cependant les mots filla de... semblent indiquer le patois. J’ai à peu près déchiffré la dernière ligne, qui du reste n’a aucun sens : sub desera lo fe. Les corbeaux du mur extérieur de l’abside portent des dessins curieux et charmants. Le portail principal, qui représente Jésus entre les quatre animaux symboliques, est du plus beau roman ; ferme, robuste, puissant, sévère. Restes de peintures sur le mur figurant des mosaïques et des édifices. L’intérieur de l’église est une grange quelconque. Sous la voûte du portail de la tour d’entrée, peintures byzantines, restaurées et à demi blanchies à la chaux ; ont perdu beaucoup de leur caractère. Au haut de la voûte, le Christ, avec la couronne impériale. Au-dessous, les anges du jugement soufflant de leurs trompettes cette inscription : surgite mortvy-venyte-ad-judicium. Aux quatre coins, quelques vestiges des quatre évangélistes. Le bœuf, avec l’inscription sant-luc. L’aigle, avec sant… La moisissure a fait une nuée où le reste se perd. Le lion ailé, d’un beau style, avec l’inscription sant-marc. Dans l’ombre, une tête d’ange avec ce reste de légende : … cte mychael. » La cure à Cauterets terminée, Victor Hugo reprend le chemin du retour : Auch, Agen, Périgueux, Cognac, Saintes et Rochefort. Mais ce voyage aux Pyrénées aura une fin tragique : car c’est à Rochefort que, lisant un journal abandonné dans un café, il apprend la noyade quelques jours plus tôt à Villequier de sa fille adorée Léopoldine et de son mari. L'écrivain sera terriblement affecté par cette mort, qui lui inspirera plusieurs poèmes — Les Contemplations (1856) — notamment, « Demain, dès l'aube… ». À partir de cette date et jusqu'à son exil, Victor Hugo ne produira plus rien, ni théâtre, ni roman, ni poème. Et le journal de Voyage aux Pyrénées s’arrête (il ne sera édité que des années plus tard). La vie du poète, son inspiration ne seront plus les mêmes. Le Voyage aux Pyrénées (1843) a été écrit, au fur et à mesure, dans les lieux mêmes qu'il dépeint, mais sur des pages d'album que Hugo conservait par devers lui. Cette publication s’accompagne de croquis exécutés sur place qui complètent et éclairent le texte. Hugo enregistre ce qu’il voit, crayonne, note sur ces carnets quelques vers qui lui permettront au retour de ressusciter, en prose ou dans quelques poèmes, ses impressions de voyage. Il demande à Juliette de collaborer avec lui. Elle tient son journal de voyage. Ces pages apportent à la littérature pyrénéenne une contribution utile par ce qu’elles ont de vivant et de profondément humain. À sa parution à la fin du XIXe siècle, l'édition posthume du « Voyage vers les Pyrénées » suscite l'admiration et l'enthousiasme. Rédigé sans apprêt, comme un reportage, ce journal de voyage est aussi une chronique d'un voyage intérieur. De retour à Paris, Victor Hugo, après la catastrophe qui avait interrompu si douloureusement son voyage, ne trouva jamais le courage de reprendre et de terminer son récit, initialement destiné à être publié. Ce dernier le sera à titre posthume, en 1890, cinq ans après son décès, signe de la blessure vivace dans le cœur de Victor Hugo toute sa vie durant. C’est après le coup d'État de Louis Napoléon Bonaparte (futur Napoléon III), en 1851, que Victor Hugo sera contraint à l'exil. Déguisé, il gagnera Bruxelles en train. Mais son pamphlet Napoléon le Petit le rendra persona non grata en Belgique et l'obligera à quitter le continent... Hugo débarquera sur l'île de Jersey en août 1852. Le Voyage aux Pyrénées est un carnet de voyage, une pièce de commande pour laquelle il avait reçu une avance d’un éditeur, et pour lequel il décrivait, sur place, ce qui le frappait le plus. Atteignant Lourdes à bord de la diligence Dotézac, qui doit le mener à Cauterets pour prendre les eaux et soulager ses rhumatismes, il avait noté : « Lourdes. — Arrivée magique. Magnifique donjon du treizième siècle sur un rocher. Le gave d’un côté, la ville de l’autre. Au fond les montagnes, hautes, abruptes, coupées de tranchées profondes d’où montent les brumes, le vent, le bruit. À Lourdes commence la grande gorge des hautes Pyrénées qui s’épanouit à Vidalos, s’écarte et se divise en quatre ravins, et forme cette immense patte d’oie dont le centre est Argelès et dont les quatre ongles vont atteindre à l’occident Arbéost par la vallée d’Estrem de Salle et Aucun par le val d’Azun, au milieu Cauterets par le détroit de Pierrefitte, et au levant Barèges par le défilé de Luz. — La gorge de Lourdes à Argelès en est pour ainsi dire le manche. Comme le bras de cette main ouverte. Lourdes est la porte des Hautes-Pyrénées. En 1755 elle ressentit le contrecoup du tremblement de terre de Lisbonne. Le réseau central des Pyrénées était gardé au Moyen Âge. Chaque articulation des vallées avait son château qui apercevait les deux châteaux des deux vallées voisines, et correspondait avec eux par des feux. On en voit aujourd’hui les ruines qui ajoutent un immense intérêt au paysage ; rien de plus poignant que les ruines de l’homme mêlées aux ruines de la nature. Le donjon de Lourdes voyait les trois tourelles du château de Pau qui apercevait la tour carrée de Vidalos, laquelle pouvait communiquer par des signaux avec l’antique Castrum Emilianum bâti par les Romains et relevé par Charlemagne sur la colline de Saint-Savin, qui se rattachait à travers les montagnes à la forteresse féodale de Beaucens. Les signaux s’enfonçaient ainsi de tours en tours dans la vallée de Luz jusqu’au château Sainte-Marie, dans la vallée de Gavarnie jusqu’à la citadelle des Templiers. Les châtelains des Pyrénées comme les burgraves du Rhin s’avertissaient les uns les autres. En quelques heures les bailliages étaient sur pied, la montagne était en feu. Les paysans, chose remarquable et toute locale, ne haïssaient pas ces châteaux. Ils avaient le sentiment que ces forteresses, tout en les dominant, en les opprimant même, protégeaient la frontière. C’est le peuple des montagnes qui a donné à l’un de ces châteaux près du col d’Ossau le nom de Bon-Château qu’il garde encore : Castelloubon. » Tous ces lieux et ces endroits traversés furent pour Victor Hugo, qui disait s’appeler M. Go et portait un chapeau pour ne pas être reconnu, source d’inspiration mais aussi l’occasion de plonger dans son passé et de retrouver ses impressions d'enfance. Sylvie Blotnikas a adapté et mis en scène ce récit de voyage vers les Pyrénées que Julien Rochefort, fils de Jean Rochefort, délivre d’un souffle, en osmose avec le poète qu’il fait revivre. Pour la première fois, ce récit de voyage de Victor Hugo est adapté au théâtre. Le comédien Julien Rochefort livre de ce texte une interprétation pleine de douceur, de délicatesse, rehaussée par un subtil travail de lumière qui agit comme une évocation subliminale des paysages traversés. On se laisse aller avec délice à la lenteur du voyage en malle-poste, à cheval, à pied… Au fil de ce texte d’une beauté magistrale, empreint de profondeur philosophique mais aussi de distance comique, Hugo alterne évocations des petites gens, des horizons marins, de la montagne toujours, laissant vagabonder ses pensées, de croquis frais et pittoresques en échappées oniriques… Car si la représentation dure un peu plus d'une heure, c'est un long monologue à connaître par cœur et que Julien Rochefort rend parfaitement vivant. Hugo ayant entretenu pendant ces deux mois d’absence une correspondance avec sa femme et ses quatre enfants en utilisant la poste restante, quelques-unes de ses lettres, tendres et très touchantes, se sont tout naturellement insérées dans le fil du récit.JAMMES Francis (1868-1938)
Poète, romancier, dramaturge et critique
 Francis JAMMES, né le 2 décembre 1868 à Tournay et mort le 1er novembre 1938 à Hasparren, à l’âge de 69 ans. Il passa la majeure partie de son existence dans le Béarn et le Pays basque, principales sources de son inspiration. Il restera pour les cénacles parisiens un simple provincial. Il est vrai que ce montagnard pyrénéen retiré et solitaire ne consacre que peu de temps au parisianisme, et pourtant il tisse de nombreuses correspondances avec ses contemporains tels que Gide et Arthur Fontaine. En réalité, il a fait de multiples séjours à Paris et il séduit dans certains salons littéraires comme celui de Mme Léon Daudet, et il enchante Marcel Proust. Une de ses pièces "La Brebis égarée", avait failli être montée par Lugné-Poe, et a inspiré à Darius Milhaud un opéra qui a été créé en présence du poète. Il a plusieurs fois été invité en Belgique. Il posa plusieurs fois sa candidature à l’Académie française, en 1920 et en 1924, mais en vain. En 1880-1888, il étudie au lycée de Pau, puis ensuite à Bordeaux. Elève normalement studieux, il sera toutefois un élève médiocre et sera recalé au baccalauréat. En 1876, il s’installe avec ses parents à Saint-Palais dans le Pays basque. En 1886, il découvre Baudelaire. Le 3 décembre 1888, il perd son père alors qu’il a tout juste 20 ans. Sa mère s’installe à Orthez avec ses enfants Marguerite et Francis. En 1889-1897, il habite avec sa mère la Maison Sarrailh. Confronté à l’échec et en pleine quête de lui-même, il écrit tout simplement 89 poèmes, qu’il adresse à diverses revues. Sa mère à plusieurs reprises fera imprimer ses poésies, à compte d’auteur à Orthez, où ils habitent.1891, six sonnets édités à Orthez. 1892-1894, trois plaquettes intitulées « Vers » imprimées à Orthez. C’est à Orthez, qu’en 1889, il devient avoué chez un notaire mais ce stage sera de courte durée, sans lendemain. Il s’y ennuie assez pour envoyer à la presse littéraire ses essais poétiques, qui seront remarqués par Mallarmé et Gide. De 1895 à 1898, il va vivre une période Gide et mettra le cap pour toujours vers la vie poétique. Son principal éditeur restera longtemps « Le Mercure de France ». En 1896, il voyage avec Gide en Algérie. Et en 1897, déjà célèbre, il lance avec « Le jammisme » un vrai-faux manifeste littéraire qui le propulse à l’avant-scène de l’actualité et qui confirme qu’il n’appartient qu’à son école, genre école buissonnière (expression de Robert Mallet). En 1898, il publie son premier vrai recueil poétique, son meilleur selon certains : « De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir ». Il rencontre le poète Charles Guérin, qui viendra le visiter à Orthez et écrira pour lui plusieurs poèmes :« Ô Jammes, ta maison ressemble à ton visage... ». Mais, le miracle du « jammisme » se produit. Pour n’avoir voulu appartenir à aucune école, pour avoir résolument banni tout effet de style, pour s’être exprimé avec une simplicité qui ne prétend qu’à traduire sans transposer, ce poète de la nature, perdu au fond des Pyrénées, impose à la littérature de la fin du XIXe siècle le sceau de sa personnalité. Et son premier recueil de vers à grand tirage, « De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir », attire sur lui l’attention de tous les « assoiffés », dont Albert Samain nous a révélé l’existence. Voilà enfin un écrivain qui ne parle pas des champs en amateur, en promeneur du dimanche ou en moraliste. Il ne joue ni les Coppée trop citadins, ni les Zola trop militants, ni les Verhaeren trop visionnaires. Il habite la campagne, il possède une métairie. S’il ne met pas la main à la charrue, il sait comment on la manie. Il n’ignore aucun des secrets de la vie rurale, il peut appeler toutes les plantes, tous les oiseaux, tous les insectes par leurs noms. Les paysans sont ses amis, les animaux ses confidents. Il chasse, il pêche, il herborise, il jardine. Et il chante ce qu’il voit, ce qu’il entend, ce qu’il sent. Il ne chante que cela. Le monde pour lui est borné par la barre bleue des forêts landaises et par le mur d’argent des glaciers pyrénéens. S’il rêve, c’est pour évoquer les Antilles fleuries de tabacs roses, brodées de palmiers luisants, chamarrées d’oiseaux multicolores, les Antilles parfumées où ses grands-parents paternels ont vécu et sont morts. Jamais ses pensées ne se laissent accaparer par les fastes illusoires de la Capitale. Il redoute l’agitation, la cohue et l’énervement des grandes villes. Il ne se plaît qu’à Orthez, dans sa petite maison, dont la façade blanche, bleutée de lierre, ressemble – prétend Charles Guérin – à son visage barbu. En 1900, il rencontre aussi Paul Claudel et publie l’année suivante « Le Deuil des Primevères ». Il voyage pour défendre sa cause et soutient les poètes contre la littérature, à Bruxelles, Anvers, Bruges, Amsterdam. À la mort du propriétaire de la Maison Sarrailh en mai 1897, Francis et sa mère doivent trouver un autre logis. En 1897, ils s’installent à la Maison Chrestia, le siège actuel de l’association Francis Jammes, jusqu’au mariage de Jammes en 1907. En 1904, à trente-cinq ans, il vit mal l’échec d’une histoire d’amour, qui lui inspire le groupe de poèmes intitulé "Tristesses" publié en 1906 dans son recueil « Clairières dans le ciel ». « De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir » (1898), « Clara d’Ellébeuse » (1899), « Le Deuil des primevères » (1901), « Almaïde d’Étremont » (1901), « Le Roman du lièvre » (1903), « Pomme d’anis » (1904). En 1905, il va se convertir au catholicisme et reprendre des pratiques religieuses. À La Bastide-Clairence, le 7 juillet 1905, Paul Claudel, de retour de Chine, vient séjourner à la Maison Chrestia et sert la messe qui marque l’événement. Sa poésie devient plus religieuse et dogmatique. Début octobre 1907, à Lourdes, à l’âge de 39 ans, il se fiance à Geneviève Goedorp, une fervente admiratrice avec laquelle il avait correspondu pendant quelques semaines. Il l’épouse à Bucy-le-Long, près de Soissons, dans l’Aisne. Dans les années qui suivirent son mariage le poète séjournera alors dans l’Aisne. En 1907-1921, il s’installera à la Maison Major, chemin La Peyrère, qui aura droit à d’illustres visiteurs comme Alain-Fournier, Darius Milhaud, François Mauriac. Le couple y aura sept enfants entre 1908 et 1918. L’aînée, est prénommée Bernadette, par référence à Sainte Bernadette Soubirous de Lourdes, le quatrième, Paul, à cause de Paul Claudel. En 1912, paraissent les Géorgiques chrétiennes. Jusqu’à sa mort, sa production poétique mais aussi romanesque et dramatique demeurera importante, mais sans retrouver son public d’avant sa "conversion " en 1905. Cependant en 1917, il obtint le Grand Prix de Littérature de l’Académie française. Œuvres poétiques : Poèmes mesurés (1908), Rayons de miel (1908), Ma fille Bernadette (1910), La Brebis égarée (1910), Les Géorgiques chrétiennes (1912), Feuilles dans le vent (1913), Le Rosaire au soleil (1916), Monsieur le Curé d’Ozeron (1918), La Vierge et les Sonnets (1919), Le Poète Rustique (1920), Le Livre de Saint-Joseph (1921), Le tombeau de Jean de la Fontaine (1921). Dans la période 1921-1938, à la suite d’un héritage il s’établira à Hasparren dans le Pays basque. En 1928, il rencontre Paul Valéry. Œuvres poétiques : Les 4 livres des Quatrains (1923-1925), Cloches pour deux mariages (1924), Ma France poétique (1926), Basses-Pyrénées (1926), Lavigerie (1927), Le Rêve franciscain (1927), Diane (1928), La divine douleur (1928), L’École buissonnière (1931), Le Crucifix du poète (1935), De tout temps à jamais (1935), Le Pèlerin de Lourdes (1936), Sources (1936). Il mourra à Hasparren, le 1er novembre 1938, le jour où une de ses filles prendra le voile. Né en Bigorre, fixé dans le Béarn pendant plus de trente ans et mort dans le Pays basque, il accordera toujours à la nature la part privilégiée de ses sentiments. Son œuvre se présente comme un immense poème à la gloire de la création dans ce qu’elle a de plus pur et de moins interprété par l’homme. En France, on ne connaît au mieux de lui que ses premières œuvres, les plus libres et sensuelles. À l’étranger et spécialement en Allemagne, Autriche et Suisse alémanique ainsi qu’au Japon, en Chine, en Lettonie, en Espagne et aux États-Unis, son œuvre est encore aujourd’hui très vivante. Elle a enchanté Rainer Maria Rilke, qui en témoigne aux premières pages des « Cahiers de Malte, Laurids Brigge », Ernst Stadler, qui a traduit ses Quatorze prières, l’éditeur Kurt Wolff, qui a publié une magnifique édition illustrée de son « Roman du lièvre (1902-1903) » (Hasenroman), Kafka, qui dans son Journal avoue le bonheur éprouvé à la lecture de Jammes et beaucoup d’autres. Toute son œuvre en prose ou presque a été traduite et publiée par Jakob Hegner, de Leipzig. Lili Boulanger a mis en musique son recueil « Clairières dans le ciel », Claude Arrieu « Ah ! Quand verrai-je des îles », Marc Berthomieu « La salle à manger » et Georges Brassens un choix de strophes du poème « Rosaire » sous le titre « La Prière ».
Francis JAMMES, né le 2 décembre 1868 à Tournay et mort le 1er novembre 1938 à Hasparren, à l’âge de 69 ans. Il passa la majeure partie de son existence dans le Béarn et le Pays basque, principales sources de son inspiration. Il restera pour les cénacles parisiens un simple provincial. Il est vrai que ce montagnard pyrénéen retiré et solitaire ne consacre que peu de temps au parisianisme, et pourtant il tisse de nombreuses correspondances avec ses contemporains tels que Gide et Arthur Fontaine. En réalité, il a fait de multiples séjours à Paris et il séduit dans certains salons littéraires comme celui de Mme Léon Daudet, et il enchante Marcel Proust. Une de ses pièces "La Brebis égarée", avait failli être montée par Lugné-Poe, et a inspiré à Darius Milhaud un opéra qui a été créé en présence du poète. Il a plusieurs fois été invité en Belgique. Il posa plusieurs fois sa candidature à l’Académie française, en 1920 et en 1924, mais en vain. En 1880-1888, il étudie au lycée de Pau, puis ensuite à Bordeaux. Elève normalement studieux, il sera toutefois un élève médiocre et sera recalé au baccalauréat. En 1876, il s’installe avec ses parents à Saint-Palais dans le Pays basque. En 1886, il découvre Baudelaire. Le 3 décembre 1888, il perd son père alors qu’il a tout juste 20 ans. Sa mère s’installe à Orthez avec ses enfants Marguerite et Francis. En 1889-1897, il habite avec sa mère la Maison Sarrailh. Confronté à l’échec et en pleine quête de lui-même, il écrit tout simplement 89 poèmes, qu’il adresse à diverses revues. Sa mère à plusieurs reprises fera imprimer ses poésies, à compte d’auteur à Orthez, où ils habitent.1891, six sonnets édités à Orthez. 1892-1894, trois plaquettes intitulées « Vers » imprimées à Orthez. C’est à Orthez, qu’en 1889, il devient avoué chez un notaire mais ce stage sera de courte durée, sans lendemain. Il s’y ennuie assez pour envoyer à la presse littéraire ses essais poétiques, qui seront remarqués par Mallarmé et Gide. De 1895 à 1898, il va vivre une période Gide et mettra le cap pour toujours vers la vie poétique. Son principal éditeur restera longtemps « Le Mercure de France ». En 1896, il voyage avec Gide en Algérie. Et en 1897, déjà célèbre, il lance avec « Le jammisme » un vrai-faux manifeste littéraire qui le propulse à l’avant-scène de l’actualité et qui confirme qu’il n’appartient qu’à son école, genre école buissonnière (expression de Robert Mallet). En 1898, il publie son premier vrai recueil poétique, son meilleur selon certains : « De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir ». Il rencontre le poète Charles Guérin, qui viendra le visiter à Orthez et écrira pour lui plusieurs poèmes :« Ô Jammes, ta maison ressemble à ton visage... ». Mais, le miracle du « jammisme » se produit. Pour n’avoir voulu appartenir à aucune école, pour avoir résolument banni tout effet de style, pour s’être exprimé avec une simplicité qui ne prétend qu’à traduire sans transposer, ce poète de la nature, perdu au fond des Pyrénées, impose à la littérature de la fin du XIXe siècle le sceau de sa personnalité. Et son premier recueil de vers à grand tirage, « De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir », attire sur lui l’attention de tous les « assoiffés », dont Albert Samain nous a révélé l’existence. Voilà enfin un écrivain qui ne parle pas des champs en amateur, en promeneur du dimanche ou en moraliste. Il ne joue ni les Coppée trop citadins, ni les Zola trop militants, ni les Verhaeren trop visionnaires. Il habite la campagne, il possède une métairie. S’il ne met pas la main à la charrue, il sait comment on la manie. Il n’ignore aucun des secrets de la vie rurale, il peut appeler toutes les plantes, tous les oiseaux, tous les insectes par leurs noms. Les paysans sont ses amis, les animaux ses confidents. Il chasse, il pêche, il herborise, il jardine. Et il chante ce qu’il voit, ce qu’il entend, ce qu’il sent. Il ne chante que cela. Le monde pour lui est borné par la barre bleue des forêts landaises et par le mur d’argent des glaciers pyrénéens. S’il rêve, c’est pour évoquer les Antilles fleuries de tabacs roses, brodées de palmiers luisants, chamarrées d’oiseaux multicolores, les Antilles parfumées où ses grands-parents paternels ont vécu et sont morts. Jamais ses pensées ne se laissent accaparer par les fastes illusoires de la Capitale. Il redoute l’agitation, la cohue et l’énervement des grandes villes. Il ne se plaît qu’à Orthez, dans sa petite maison, dont la façade blanche, bleutée de lierre, ressemble – prétend Charles Guérin – à son visage barbu. En 1900, il rencontre aussi Paul Claudel et publie l’année suivante « Le Deuil des Primevères ». Il voyage pour défendre sa cause et soutient les poètes contre la littérature, à Bruxelles, Anvers, Bruges, Amsterdam. À la mort du propriétaire de la Maison Sarrailh en mai 1897, Francis et sa mère doivent trouver un autre logis. En 1897, ils s’installent à la Maison Chrestia, le siège actuel de l’association Francis Jammes, jusqu’au mariage de Jammes en 1907. En 1904, à trente-cinq ans, il vit mal l’échec d’une histoire d’amour, qui lui inspire le groupe de poèmes intitulé "Tristesses" publié en 1906 dans son recueil « Clairières dans le ciel ». « De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir » (1898), « Clara d’Ellébeuse » (1899), « Le Deuil des primevères » (1901), « Almaïde d’Étremont » (1901), « Le Roman du lièvre » (1903), « Pomme d’anis » (1904). En 1905, il va se convertir au catholicisme et reprendre des pratiques religieuses. À La Bastide-Clairence, le 7 juillet 1905, Paul Claudel, de retour de Chine, vient séjourner à la Maison Chrestia et sert la messe qui marque l’événement. Sa poésie devient plus religieuse et dogmatique. Début octobre 1907, à Lourdes, à l’âge de 39 ans, il se fiance à Geneviève Goedorp, une fervente admiratrice avec laquelle il avait correspondu pendant quelques semaines. Il l’épouse à Bucy-le-Long, près de Soissons, dans l’Aisne. Dans les années qui suivirent son mariage le poète séjournera alors dans l’Aisne. En 1907-1921, il s’installera à la Maison Major, chemin La Peyrère, qui aura droit à d’illustres visiteurs comme Alain-Fournier, Darius Milhaud, François Mauriac. Le couple y aura sept enfants entre 1908 et 1918. L’aînée, est prénommée Bernadette, par référence à Sainte Bernadette Soubirous de Lourdes, le quatrième, Paul, à cause de Paul Claudel. En 1912, paraissent les Géorgiques chrétiennes. Jusqu’à sa mort, sa production poétique mais aussi romanesque et dramatique demeurera importante, mais sans retrouver son public d’avant sa "conversion " en 1905. Cependant en 1917, il obtint le Grand Prix de Littérature de l’Académie française. Œuvres poétiques : Poèmes mesurés (1908), Rayons de miel (1908), Ma fille Bernadette (1910), La Brebis égarée (1910), Les Géorgiques chrétiennes (1912), Feuilles dans le vent (1913), Le Rosaire au soleil (1916), Monsieur le Curé d’Ozeron (1918), La Vierge et les Sonnets (1919), Le Poète Rustique (1920), Le Livre de Saint-Joseph (1921), Le tombeau de Jean de la Fontaine (1921). Dans la période 1921-1938, à la suite d’un héritage il s’établira à Hasparren dans le Pays basque. En 1928, il rencontre Paul Valéry. Œuvres poétiques : Les 4 livres des Quatrains (1923-1925), Cloches pour deux mariages (1924), Ma France poétique (1926), Basses-Pyrénées (1926), Lavigerie (1927), Le Rêve franciscain (1927), Diane (1928), La divine douleur (1928), L’École buissonnière (1931), Le Crucifix du poète (1935), De tout temps à jamais (1935), Le Pèlerin de Lourdes (1936), Sources (1936). Il mourra à Hasparren, le 1er novembre 1938, le jour où une de ses filles prendra le voile. Né en Bigorre, fixé dans le Béarn pendant plus de trente ans et mort dans le Pays basque, il accordera toujours à la nature la part privilégiée de ses sentiments. Son œuvre se présente comme un immense poème à la gloire de la création dans ce qu’elle a de plus pur et de moins interprété par l’homme. En France, on ne connaît au mieux de lui que ses premières œuvres, les plus libres et sensuelles. À l’étranger et spécialement en Allemagne, Autriche et Suisse alémanique ainsi qu’au Japon, en Chine, en Lettonie, en Espagne et aux États-Unis, son œuvre est encore aujourd’hui très vivante. Elle a enchanté Rainer Maria Rilke, qui en témoigne aux premières pages des « Cahiers de Malte, Laurids Brigge », Ernst Stadler, qui a traduit ses Quatorze prières, l’éditeur Kurt Wolff, qui a publié une magnifique édition illustrée de son « Roman du lièvre (1902-1903) » (Hasenroman), Kafka, qui dans son Journal avoue le bonheur éprouvé à la lecture de Jammes et beaucoup d’autres. Toute son œuvre en prose ou presque a été traduite et publiée par Jakob Hegner, de Leipzig. Lili Boulanger a mis en musique son recueil « Clairières dans le ciel », Claude Arrieu « Ah ! Quand verrai-je des îles », Marc Berthomieu « La salle à manger » et Georges Brassens un choix de strophes du poème « Rosaire » sous le titre « La Prière ».
 Francis JAMMES, né le 2 décembre 1868 à Tournay et mort le 1er novembre 1938 à Hasparren, à l’âge de 69 ans. Il passa la majeure partie de son existence dans le Béarn et le Pays basque, principales sources de son inspiration. Il restera pour les cénacles parisiens un simple provincial. Il est vrai que ce montagnard pyrénéen retiré et solitaire ne consacre que peu de temps au parisianisme, et pourtant il tisse de nombreuses correspondances avec ses contemporains tels que Gide et Arthur Fontaine. En réalité, il a fait de multiples séjours à Paris et il séduit dans certains salons littéraires comme celui de Mme Léon Daudet, et il enchante Marcel Proust. Une de ses pièces "La Brebis égarée", avait failli être montée par Lugné-Poe, et a inspiré à Darius Milhaud un opéra qui a été créé en présence du poète. Il a plusieurs fois été invité en Belgique. Il posa plusieurs fois sa candidature à l’Académie française, en 1920 et en 1924, mais en vain. En 1880-1888, il étudie au lycée de Pau, puis ensuite à Bordeaux. Elève normalement studieux, il sera toutefois un élève médiocre et sera recalé au baccalauréat. En 1876, il s’installe avec ses parents à Saint-Palais dans le Pays basque. En 1886, il découvre Baudelaire. Le 3 décembre 1888, il perd son père alors qu’il a tout juste 20 ans. Sa mère s’installe à Orthez avec ses enfants Marguerite et Francis. En 1889-1897, il habite avec sa mère la Maison Sarrailh. Confronté à l’échec et en pleine quête de lui-même, il écrit tout simplement 89 poèmes, qu’il adresse à diverses revues. Sa mère à plusieurs reprises fera imprimer ses poésies, à compte d’auteur à Orthez, où ils habitent.1891, six sonnets édités à Orthez. 1892-1894, trois plaquettes intitulées « Vers » imprimées à Orthez. C’est à Orthez, qu’en 1889, il devient avoué chez un notaire mais ce stage sera de courte durée, sans lendemain. Il s’y ennuie assez pour envoyer à la presse littéraire ses essais poétiques, qui seront remarqués par Mallarmé et Gide. De 1895 à 1898, il va vivre une période Gide et mettra le cap pour toujours vers la vie poétique. Son principal éditeur restera longtemps « Le Mercure de France ». En 1896, il voyage avec Gide en Algérie. Et en 1897, déjà célèbre, il lance avec « Le jammisme » un vrai-faux manifeste littéraire qui le propulse à l’avant-scène de l’actualité et qui confirme qu’il n’appartient qu’à son école, genre école buissonnière (expression de Robert Mallet). En 1898, il publie son premier vrai recueil poétique, son meilleur selon certains : « De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir ». Il rencontre le poète Charles Guérin, qui viendra le visiter à Orthez et écrira pour lui plusieurs poèmes :« Ô Jammes, ta maison ressemble à ton visage... ». Mais, le miracle du « jammisme » se produit. Pour n’avoir voulu appartenir à aucune école, pour avoir résolument banni tout effet de style, pour s’être exprimé avec une simplicité qui ne prétend qu’à traduire sans transposer, ce poète de la nature, perdu au fond des Pyrénées, impose à la littérature de la fin du XIXe siècle le sceau de sa personnalité. Et son premier recueil de vers à grand tirage, « De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir », attire sur lui l’attention de tous les « assoiffés », dont Albert Samain nous a révélé l’existence. Voilà enfin un écrivain qui ne parle pas des champs en amateur, en promeneur du dimanche ou en moraliste. Il ne joue ni les Coppée trop citadins, ni les Zola trop militants, ni les Verhaeren trop visionnaires. Il habite la campagne, il possède une métairie. S’il ne met pas la main à la charrue, il sait comment on la manie. Il n’ignore aucun des secrets de la vie rurale, il peut appeler toutes les plantes, tous les oiseaux, tous les insectes par leurs noms. Les paysans sont ses amis, les animaux ses confidents. Il chasse, il pêche, il herborise, il jardine. Et il chante ce qu’il voit, ce qu’il entend, ce qu’il sent. Il ne chante que cela. Le monde pour lui est borné par la barre bleue des forêts landaises et par le mur d’argent des glaciers pyrénéens. S’il rêve, c’est pour évoquer les Antilles fleuries de tabacs roses, brodées de palmiers luisants, chamarrées d’oiseaux multicolores, les Antilles parfumées où ses grands-parents paternels ont vécu et sont morts. Jamais ses pensées ne se laissent accaparer par les fastes illusoires de la Capitale. Il redoute l’agitation, la cohue et l’énervement des grandes villes. Il ne se plaît qu’à Orthez, dans sa petite maison, dont la façade blanche, bleutée de lierre, ressemble – prétend Charles Guérin – à son visage barbu. En 1900, il rencontre aussi Paul Claudel et publie l’année suivante « Le Deuil des Primevères ». Il voyage pour défendre sa cause et soutient les poètes contre la littérature, à Bruxelles, Anvers, Bruges, Amsterdam. À la mort du propriétaire de la Maison Sarrailh en mai 1897, Francis et sa mère doivent trouver un autre logis. En 1897, ils s’installent à la Maison Chrestia, le siège actuel de l’association Francis Jammes, jusqu’au mariage de Jammes en 1907. En 1904, à trente-cinq ans, il vit mal l’échec d’une histoire d’amour, qui lui inspire le groupe de poèmes intitulé "Tristesses" publié en 1906 dans son recueil « Clairières dans le ciel ». « De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir » (1898), « Clara d’Ellébeuse » (1899), « Le Deuil des primevères » (1901), « Almaïde d’Étremont » (1901), « Le Roman du lièvre » (1903), « Pomme d’anis » (1904). En 1905, il va se convertir au catholicisme et reprendre des pratiques religieuses. À La Bastide-Clairence, le 7 juillet 1905, Paul Claudel, de retour de Chine, vient séjourner à la Maison Chrestia et sert la messe qui marque l’événement. Sa poésie devient plus religieuse et dogmatique. Début octobre 1907, à Lourdes, à l’âge de 39 ans, il se fiance à Geneviève Goedorp, une fervente admiratrice avec laquelle il avait correspondu pendant quelques semaines. Il l’épouse à Bucy-le-Long, près de Soissons, dans l’Aisne. Dans les années qui suivirent son mariage le poète séjournera alors dans l’Aisne. En 1907-1921, il s’installera à la Maison Major, chemin La Peyrère, qui aura droit à d’illustres visiteurs comme Alain-Fournier, Darius Milhaud, François Mauriac. Le couple y aura sept enfants entre 1908 et 1918. L’aînée, est prénommée Bernadette, par référence à Sainte Bernadette Soubirous de Lourdes, le quatrième, Paul, à cause de Paul Claudel. En 1912, paraissent les Géorgiques chrétiennes. Jusqu’à sa mort, sa production poétique mais aussi romanesque et dramatique demeurera importante, mais sans retrouver son public d’avant sa "conversion " en 1905. Cependant en 1917, il obtint le Grand Prix de Littérature de l’Académie française. Œuvres poétiques : Poèmes mesurés (1908), Rayons de miel (1908), Ma fille Bernadette (1910), La Brebis égarée (1910), Les Géorgiques chrétiennes (1912), Feuilles dans le vent (1913), Le Rosaire au soleil (1916), Monsieur le Curé d’Ozeron (1918), La Vierge et les Sonnets (1919), Le Poète Rustique (1920), Le Livre de Saint-Joseph (1921), Le tombeau de Jean de la Fontaine (1921). Dans la période 1921-1938, à la suite d’un héritage il s’établira à Hasparren dans le Pays basque. En 1928, il rencontre Paul Valéry. Œuvres poétiques : Les 4 livres des Quatrains (1923-1925), Cloches pour deux mariages (1924), Ma France poétique (1926), Basses-Pyrénées (1926), Lavigerie (1927), Le Rêve franciscain (1927), Diane (1928), La divine douleur (1928), L’École buissonnière (1931), Le Crucifix du poète (1935), De tout temps à jamais (1935), Le Pèlerin de Lourdes (1936), Sources (1936). Il mourra à Hasparren, le 1er novembre 1938, le jour où une de ses filles prendra le voile. Né en Bigorre, fixé dans le Béarn pendant plus de trente ans et mort dans le Pays basque, il accordera toujours à la nature la part privilégiée de ses sentiments. Son œuvre se présente comme un immense poème à la gloire de la création dans ce qu’elle a de plus pur et de moins interprété par l’homme. En France, on ne connaît au mieux de lui que ses premières œuvres, les plus libres et sensuelles. À l’étranger et spécialement en Allemagne, Autriche et Suisse alémanique ainsi qu’au Japon, en Chine, en Lettonie, en Espagne et aux États-Unis, son œuvre est encore aujourd’hui très vivante. Elle a enchanté Rainer Maria Rilke, qui en témoigne aux premières pages des « Cahiers de Malte, Laurids Brigge », Ernst Stadler, qui a traduit ses Quatorze prières, l’éditeur Kurt Wolff, qui a publié une magnifique édition illustrée de son « Roman du lièvre (1902-1903) » (Hasenroman), Kafka, qui dans son Journal avoue le bonheur éprouvé à la lecture de Jammes et beaucoup d’autres. Toute son œuvre en prose ou presque a été traduite et publiée par Jakob Hegner, de Leipzig. Lili Boulanger a mis en musique son recueil « Clairières dans le ciel », Claude Arrieu « Ah ! Quand verrai-je des îles », Marc Berthomieu « La salle à manger » et Georges Brassens un choix de strophes du poème « Rosaire » sous le titre « La Prière ».
Francis JAMMES, né le 2 décembre 1868 à Tournay et mort le 1er novembre 1938 à Hasparren, à l’âge de 69 ans. Il passa la majeure partie de son existence dans le Béarn et le Pays basque, principales sources de son inspiration. Il restera pour les cénacles parisiens un simple provincial. Il est vrai que ce montagnard pyrénéen retiré et solitaire ne consacre que peu de temps au parisianisme, et pourtant il tisse de nombreuses correspondances avec ses contemporains tels que Gide et Arthur Fontaine. En réalité, il a fait de multiples séjours à Paris et il séduit dans certains salons littéraires comme celui de Mme Léon Daudet, et il enchante Marcel Proust. Une de ses pièces "La Brebis égarée", avait failli être montée par Lugné-Poe, et a inspiré à Darius Milhaud un opéra qui a été créé en présence du poète. Il a plusieurs fois été invité en Belgique. Il posa plusieurs fois sa candidature à l’Académie française, en 1920 et en 1924, mais en vain. En 1880-1888, il étudie au lycée de Pau, puis ensuite à Bordeaux. Elève normalement studieux, il sera toutefois un élève médiocre et sera recalé au baccalauréat. En 1876, il s’installe avec ses parents à Saint-Palais dans le Pays basque. En 1886, il découvre Baudelaire. Le 3 décembre 1888, il perd son père alors qu’il a tout juste 20 ans. Sa mère s’installe à Orthez avec ses enfants Marguerite et Francis. En 1889-1897, il habite avec sa mère la Maison Sarrailh. Confronté à l’échec et en pleine quête de lui-même, il écrit tout simplement 89 poèmes, qu’il adresse à diverses revues. Sa mère à plusieurs reprises fera imprimer ses poésies, à compte d’auteur à Orthez, où ils habitent.1891, six sonnets édités à Orthez. 1892-1894, trois plaquettes intitulées « Vers » imprimées à Orthez. C’est à Orthez, qu’en 1889, il devient avoué chez un notaire mais ce stage sera de courte durée, sans lendemain. Il s’y ennuie assez pour envoyer à la presse littéraire ses essais poétiques, qui seront remarqués par Mallarmé et Gide. De 1895 à 1898, il va vivre une période Gide et mettra le cap pour toujours vers la vie poétique. Son principal éditeur restera longtemps « Le Mercure de France ». En 1896, il voyage avec Gide en Algérie. Et en 1897, déjà célèbre, il lance avec « Le jammisme » un vrai-faux manifeste littéraire qui le propulse à l’avant-scène de l’actualité et qui confirme qu’il n’appartient qu’à son école, genre école buissonnière (expression de Robert Mallet). En 1898, il publie son premier vrai recueil poétique, son meilleur selon certains : « De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir ». Il rencontre le poète Charles Guérin, qui viendra le visiter à Orthez et écrira pour lui plusieurs poèmes :« Ô Jammes, ta maison ressemble à ton visage... ». Mais, le miracle du « jammisme » se produit. Pour n’avoir voulu appartenir à aucune école, pour avoir résolument banni tout effet de style, pour s’être exprimé avec une simplicité qui ne prétend qu’à traduire sans transposer, ce poète de la nature, perdu au fond des Pyrénées, impose à la littérature de la fin du XIXe siècle le sceau de sa personnalité. Et son premier recueil de vers à grand tirage, « De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir », attire sur lui l’attention de tous les « assoiffés », dont Albert Samain nous a révélé l’existence. Voilà enfin un écrivain qui ne parle pas des champs en amateur, en promeneur du dimanche ou en moraliste. Il ne joue ni les Coppée trop citadins, ni les Zola trop militants, ni les Verhaeren trop visionnaires. Il habite la campagne, il possède une métairie. S’il ne met pas la main à la charrue, il sait comment on la manie. Il n’ignore aucun des secrets de la vie rurale, il peut appeler toutes les plantes, tous les oiseaux, tous les insectes par leurs noms. Les paysans sont ses amis, les animaux ses confidents. Il chasse, il pêche, il herborise, il jardine. Et il chante ce qu’il voit, ce qu’il entend, ce qu’il sent. Il ne chante que cela. Le monde pour lui est borné par la barre bleue des forêts landaises et par le mur d’argent des glaciers pyrénéens. S’il rêve, c’est pour évoquer les Antilles fleuries de tabacs roses, brodées de palmiers luisants, chamarrées d’oiseaux multicolores, les Antilles parfumées où ses grands-parents paternels ont vécu et sont morts. Jamais ses pensées ne se laissent accaparer par les fastes illusoires de la Capitale. Il redoute l’agitation, la cohue et l’énervement des grandes villes. Il ne se plaît qu’à Orthez, dans sa petite maison, dont la façade blanche, bleutée de lierre, ressemble – prétend Charles Guérin – à son visage barbu. En 1900, il rencontre aussi Paul Claudel et publie l’année suivante « Le Deuil des Primevères ». Il voyage pour défendre sa cause et soutient les poètes contre la littérature, à Bruxelles, Anvers, Bruges, Amsterdam. À la mort du propriétaire de la Maison Sarrailh en mai 1897, Francis et sa mère doivent trouver un autre logis. En 1897, ils s’installent à la Maison Chrestia, le siège actuel de l’association Francis Jammes, jusqu’au mariage de Jammes en 1907. En 1904, à trente-cinq ans, il vit mal l’échec d’une histoire d’amour, qui lui inspire le groupe de poèmes intitulé "Tristesses" publié en 1906 dans son recueil « Clairières dans le ciel ». « De l’Angélus de l’aube à l’Angélus du soir » (1898), « Clara d’Ellébeuse » (1899), « Le Deuil des primevères » (1901), « Almaïde d’Étremont » (1901), « Le Roman du lièvre » (1903), « Pomme d’anis » (1904). En 1905, il va se convertir au catholicisme et reprendre des pratiques religieuses. À La Bastide-Clairence, le 7 juillet 1905, Paul Claudel, de retour de Chine, vient séjourner à la Maison Chrestia et sert la messe qui marque l’événement. Sa poésie devient plus religieuse et dogmatique. Début octobre 1907, à Lourdes, à l’âge de 39 ans, il se fiance à Geneviève Goedorp, une fervente admiratrice avec laquelle il avait correspondu pendant quelques semaines. Il l’épouse à Bucy-le-Long, près de Soissons, dans l’Aisne. Dans les années qui suivirent son mariage le poète séjournera alors dans l’Aisne. En 1907-1921, il s’installera à la Maison Major, chemin La Peyrère, qui aura droit à d’illustres visiteurs comme Alain-Fournier, Darius Milhaud, François Mauriac. Le couple y aura sept enfants entre 1908 et 1918. L’aînée, est prénommée Bernadette, par référence à Sainte Bernadette Soubirous de Lourdes, le quatrième, Paul, à cause de Paul Claudel. En 1912, paraissent les Géorgiques chrétiennes. Jusqu’à sa mort, sa production poétique mais aussi romanesque et dramatique demeurera importante, mais sans retrouver son public d’avant sa "conversion " en 1905. Cependant en 1917, il obtint le Grand Prix de Littérature de l’Académie française. Œuvres poétiques : Poèmes mesurés (1908), Rayons de miel (1908), Ma fille Bernadette (1910), La Brebis égarée (1910), Les Géorgiques chrétiennes (1912), Feuilles dans le vent (1913), Le Rosaire au soleil (1916), Monsieur le Curé d’Ozeron (1918), La Vierge et les Sonnets (1919), Le Poète Rustique (1920), Le Livre de Saint-Joseph (1921), Le tombeau de Jean de la Fontaine (1921). Dans la période 1921-1938, à la suite d’un héritage il s’établira à Hasparren dans le Pays basque. En 1928, il rencontre Paul Valéry. Œuvres poétiques : Les 4 livres des Quatrains (1923-1925), Cloches pour deux mariages (1924), Ma France poétique (1926), Basses-Pyrénées (1926), Lavigerie (1927), Le Rêve franciscain (1927), Diane (1928), La divine douleur (1928), L’École buissonnière (1931), Le Crucifix du poète (1935), De tout temps à jamais (1935), Le Pèlerin de Lourdes (1936), Sources (1936). Il mourra à Hasparren, le 1er novembre 1938, le jour où une de ses filles prendra le voile. Né en Bigorre, fixé dans le Béarn pendant plus de trente ans et mort dans le Pays basque, il accordera toujours à la nature la part privilégiée de ses sentiments. Son œuvre se présente comme un immense poème à la gloire de la création dans ce qu’elle a de plus pur et de moins interprété par l’homme. En France, on ne connaît au mieux de lui que ses premières œuvres, les plus libres et sensuelles. À l’étranger et spécialement en Allemagne, Autriche et Suisse alémanique ainsi qu’au Japon, en Chine, en Lettonie, en Espagne et aux États-Unis, son œuvre est encore aujourd’hui très vivante. Elle a enchanté Rainer Maria Rilke, qui en témoigne aux premières pages des « Cahiers de Malte, Laurids Brigge », Ernst Stadler, qui a traduit ses Quatorze prières, l’éditeur Kurt Wolff, qui a publié une magnifique édition illustrée de son « Roman du lièvre (1902-1903) » (Hasenroman), Kafka, qui dans son Journal avoue le bonheur éprouvé à la lecture de Jammes et beaucoup d’autres. Toute son œuvre en prose ou presque a été traduite et publiée par Jakob Hegner, de Leipzig. Lili Boulanger a mis en musique son recueil « Clairières dans le ciel », Claude Arrieu « Ah ! Quand verrai-je des îles », Marc Berthomieu « La salle à manger » et Georges Brassens un choix de strophes du poème « Rosaire » sous le titre « La Prière ».KADDOUCH Robert (1958-XXXX)
Pianiste, Pédagogue et Chercheur
 Robert KADDOUCH, né le 24 novembre 1958 à Casablanca, arrive dans son très jeune âge dans les Hautes-Pyrénées. Concertiste et pédagogue mondialement connu, il est l’élève de Pierre Sancan et Bruno Rigutto pour le piano, Yannis Xenakis pour la composition et Martial Solal pour l’improvisation.
Robert KADDOUCH, né le 24 novembre 1958 à Casablanca, arrive dans son très jeune âge dans les Hautes-Pyrénées. Concertiste et pédagogue mondialement connu, il est l’élève de Pierre Sancan et Bruno Rigutto pour le piano, Yannis Xenakis pour la composition et Martial Solal pour l’improvisation.
Initiateur de la méthode du même nom, il est le fondateur des Écoles Kaddouch & Music implantées à Paris et dans plusieurs villes de province. Des cours Kaddouch sont également dispensés dans certains conservatoires à l’étranger. Ces écoles accueillent des enfants de tous âges dont les plus jeunes sont des bébés. Elles forment aussi des adultes débutants, des professionnels, interprètes ou improvisateurs, concertistes ou professeurs, des enfants à haut potentiel intellectuel et des enfants différents.
La méthode Kaddouch® conçue par le concertiste et pédagogue stimule avec douceur, attention et science, la capacité d’apprendre. Sa pédagogie place l’enfant au centre de l’apprentissage, dont la musique est le langage-outil et le professeur en est le médiateur. Elle permet à l’enfant devenu l’acteur de son apprentissage, d’impliquer et d’exercer son potentiel dans une démarche créative, car pour Robert Kaddouch, apprendre c’est créer et créer c’est se construire selon son concept de Conductibilité. La Conductibilité (la communication par la création) définit une nouvelle approche de la création ainsi qu’une nouvelle approche de l’enfant et de l’apprentissage, par la création. Ce concept lui a permis de développer une méthode d’apprentissage du piano pour les tout-petits, la méthode « au piano les bébés® ». Cette approche révèle alors des mécanismes spontanés d’apprentissage ainsi que des stratégies de prise d’informations dont les principes généraux interpelleront les neuroscientifiques. Des études scientifiques, thèses et ouvrages scelleront les collaborations scientifiques (« L’enfant, la musique et la mémoire », R.Kaddouch, M.Noulhiane, éd. De Boeck), conférences à la Sorbonne, au laboratoire de psychologie du développement du Pr O.Houdé (« Musique et Intelligence », « Musique, Création et prise de décision »).
Les philosophes considèrent ce concept de Conductibilité comme une explication des « points brillants » de Bergson, un colloque à l’Université du Mirail à Toulouse développe ces rapports. S’en suit des actes de colloque « Le Pédagogue et le Philosophe, Robert Kaddouch et la Conductibilité », éd. L’Harmattan.
L’université d’Oxford invite plusieurs fois Robert Kaddouch dans les départements de musicologie et de neurobiologie « Learning is Creating » à l’auditorium Quad Garden du St John’s College, la conférence « Polyphony : Systematics and Ontogenesis » vient révéler les travaux avec l’ethnomusicologue Simha Arom (médaille d’argent CNRS). C’est la première fois dans l’histoire qu’une théorie de l’éducation musicale est exposée à l’Universié d’Oxford.
En déclinant son concept, il développe une méthode d’apprentissage des langues (KLS) présentée à Claude Hagège au Collège de France, une méthode d’éveil corporel (Musique, Intelligence et Mouvement) « Enseigner l’interprétation musicale » éd. Ressouvenances, chapitre « transfert des valeurs avec J. Challet Haas, cinétographe, ou encore l’étude des Mathématiques par la musique et son intégration dans les classes maternelles et primaires (collaboration avec l’IUFM des Pyrénées-Atlantiques). Il présente au Pr Andrew King (Oxford, St John’s College) son programme d’éducation auditive qu’il expose à l’Institut Pasteur auprès de 7 équipes de chercheurs spécialisés sur l’audition (IDA).
Il est l’auteur de nombreux ouvrages pédagogiques qui résolvent des problèmes de terrain : « Le livre de l’improvisateur », « La méthode du Mille Pattes » (essai de théorie musicale), « La notation Kaddouch, la notation des structures », « Au piano les bébés » (recueil de partitions pour les tout-petits pianistes) ou « Grandir en musique », qui présente sa méthode.
L’ouvrage-clé de sa pédagogie lui a été commandé par la prestigieuse édition américaine Rowman & Littlefield « A Pedagogy of Creation, Learning students to communicate through music ». Il est maintenant dans les bibliothèques des grandes universités, Standford, Yale, MIT, Columbia, Oxford, Cambridge …
Robert Kaddouch a donné des conférences et formations à l’Académie Royale de Musique de Stockholm, la Sibelius Academy en Finlande, l’Institut Dalcroze de Genève, l’Université d’Helsinki, l’Université de Reykjavik, l’Ambassade de France à Vienne, à l’École Normale Supérieure (ENS), à l’Institut Pasteur (IDA).
Il a enregistré plusieurs disques et albums avec Daniel Humair et Césarius Alvim, en duo avec Martial Solal (quatre diapasons), « Balade pour deux pianos », « MS1014 » ou son concert avec J-F Jenny-Clark sur France Musique, deux albums enregistrés à New York en duo avec le contrebassiste Gary Peacock « 53rd Street » et « High Line » …
Le Centre de Recherche en Pédagogie, Musique et Création (CRPMC) fondé par Robert Kaddouch à Paris, a été inauguré le 31 mai 2019, par le ministre de la Culture, Frank Riester et Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement. Les quatre présidents d’honneur sont : Michaël Levinas, Gary Peacock, Simha Arom et Martial Solal. Pour l’ensemble de son activité d’artiste, de pédagogue et de chercheur, le 12 juillet 2016 il a été fait Citoyen d’honneur de la ville de Tarbes par Gérard Trémège, maire de Tarbes. Cérémonie à laquelle étaient présents la chanteuse de jazz, Anne Ducros et l’ethnomusicologue Simha Arom. La ministre de la Culture, Madame Françoise Nyssen lui a décerné, en avril 2018, la médaille de Chevalier des Arts et des Lettres. Conférencier, professeur de piano ou encore praticien-chercheur en pédagogie, difficile de coller une étiquette à cet homme, serait-ce un humaniste du XXIème siècle ?
 Robert KADDOUCH, né le 24 novembre 1958 à Casablanca, arrive dans son très jeune âge dans les Hautes-Pyrénées. Concertiste et pédagogue mondialement connu, il est l’élève de Pierre Sancan et Bruno Rigutto pour le piano, Yannis Xenakis pour la composition et Martial Solal pour l’improvisation.
Robert KADDOUCH, né le 24 novembre 1958 à Casablanca, arrive dans son très jeune âge dans les Hautes-Pyrénées. Concertiste et pédagogue mondialement connu, il est l’élève de Pierre Sancan et Bruno Rigutto pour le piano, Yannis Xenakis pour la composition et Martial Solal pour l’improvisation.Initiateur de la méthode du même nom, il est le fondateur des Écoles Kaddouch & Music implantées à Paris et dans plusieurs villes de province. Des cours Kaddouch sont également dispensés dans certains conservatoires à l’étranger. Ces écoles accueillent des enfants de tous âges dont les plus jeunes sont des bébés. Elles forment aussi des adultes débutants, des professionnels, interprètes ou improvisateurs, concertistes ou professeurs, des enfants à haut potentiel intellectuel et des enfants différents.
La méthode Kaddouch® conçue par le concertiste et pédagogue stimule avec douceur, attention et science, la capacité d’apprendre. Sa pédagogie place l’enfant au centre de l’apprentissage, dont la musique est le langage-outil et le professeur en est le médiateur. Elle permet à l’enfant devenu l’acteur de son apprentissage, d’impliquer et d’exercer son potentiel dans une démarche créative, car pour Robert Kaddouch, apprendre c’est créer et créer c’est se construire selon son concept de Conductibilité. La Conductibilité (la communication par la création) définit une nouvelle approche de la création ainsi qu’une nouvelle approche de l’enfant et de l’apprentissage, par la création. Ce concept lui a permis de développer une méthode d’apprentissage du piano pour les tout-petits, la méthode « au piano les bébés® ». Cette approche révèle alors des mécanismes spontanés d’apprentissage ainsi que des stratégies de prise d’informations dont les principes généraux interpelleront les neuroscientifiques. Des études scientifiques, thèses et ouvrages scelleront les collaborations scientifiques (« L’enfant, la musique et la mémoire », R.Kaddouch, M.Noulhiane, éd. De Boeck), conférences à la Sorbonne, au laboratoire de psychologie du développement du Pr O.Houdé (« Musique et Intelligence », « Musique, Création et prise de décision »).
Les philosophes considèrent ce concept de Conductibilité comme une explication des « points brillants » de Bergson, un colloque à l’Université du Mirail à Toulouse développe ces rapports. S’en suit des actes de colloque « Le Pédagogue et le Philosophe, Robert Kaddouch et la Conductibilité », éd. L’Harmattan.
L’université d’Oxford invite plusieurs fois Robert Kaddouch dans les départements de musicologie et de neurobiologie « Learning is Creating » à l’auditorium Quad Garden du St John’s College, la conférence « Polyphony : Systematics and Ontogenesis » vient révéler les travaux avec l’ethnomusicologue Simha Arom (médaille d’argent CNRS). C’est la première fois dans l’histoire qu’une théorie de l’éducation musicale est exposée à l’Universié d’Oxford.
En déclinant son concept, il développe une méthode d’apprentissage des langues (KLS) présentée à Claude Hagège au Collège de France, une méthode d’éveil corporel (Musique, Intelligence et Mouvement) « Enseigner l’interprétation musicale » éd. Ressouvenances, chapitre « transfert des valeurs avec J. Challet Haas, cinétographe, ou encore l’étude des Mathématiques par la musique et son intégration dans les classes maternelles et primaires (collaboration avec l’IUFM des Pyrénées-Atlantiques). Il présente au Pr Andrew King (Oxford, St John’s College) son programme d’éducation auditive qu’il expose à l’Institut Pasteur auprès de 7 équipes de chercheurs spécialisés sur l’audition (IDA).
Il est l’auteur de nombreux ouvrages pédagogiques qui résolvent des problèmes de terrain : « Le livre de l’improvisateur », « La méthode du Mille Pattes » (essai de théorie musicale), « La notation Kaddouch, la notation des structures », « Au piano les bébés » (recueil de partitions pour les tout-petits pianistes) ou « Grandir en musique », qui présente sa méthode.
L’ouvrage-clé de sa pédagogie lui a été commandé par la prestigieuse édition américaine Rowman & Littlefield « A Pedagogy of Creation, Learning students to communicate through music ». Il est maintenant dans les bibliothèques des grandes universités, Standford, Yale, MIT, Columbia, Oxford, Cambridge …
Robert Kaddouch a donné des conférences et formations à l’Académie Royale de Musique de Stockholm, la Sibelius Academy en Finlande, l’Institut Dalcroze de Genève, l’Université d’Helsinki, l’Université de Reykjavik, l’Ambassade de France à Vienne, à l’École Normale Supérieure (ENS), à l’Institut Pasteur (IDA).
Il a enregistré plusieurs disques et albums avec Daniel Humair et Césarius Alvim, en duo avec Martial Solal (quatre diapasons), « Balade pour deux pianos », « MS1014 » ou son concert avec J-F Jenny-Clark sur France Musique, deux albums enregistrés à New York en duo avec le contrebassiste Gary Peacock « 53rd Street » et « High Line » …
Le Centre de Recherche en Pédagogie, Musique et Création (CRPMC) fondé par Robert Kaddouch à Paris, a été inauguré le 31 mai 2019, par le ministre de la Culture, Frank Riester et Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement. Les quatre présidents d’honneur sont : Michaël Levinas, Gary Peacock, Simha Arom et Martial Solal. Pour l’ensemble de son activité d’artiste, de pédagogue et de chercheur, le 12 juillet 2016 il a été fait Citoyen d’honneur de la ville de Tarbes par Gérard Trémège, maire de Tarbes. Cérémonie à laquelle étaient présents la chanteuse de jazz, Anne Ducros et l’ethnomusicologue Simha Arom. La ministre de la Culture, Madame Françoise Nyssen lui a décerné, en avril 2018, la médaille de Chevalier des Arts et des Lettres. Conférencier, professeur de piano ou encore praticien-chercheur en pédagogie, difficile de coller une étiquette à cet homme, serait-ce un humaniste du XXIème siècle ?
LABORDE Christian (1955-XXXX)
Journaliste, écrivain, poète, chroniqueur et pamphlétaire
 Christian LABORDE, né le 27 janvier 1955 à Aureilhan est devenu célèbre pour avoir vécu l’une des dernières censures littéraires en France. Depuis trente ans, il écrit un livre par an couvrant un large répertoire : roman, poésie, son engagement autour de la musique, son amour du Tour de France mais aussi son indignation contre la souffrance animale. En 1984, il publie « L’homme aux semelles de swing ». En 1987, il publie, aux Éditions Eché, « L’Os de Dionysos ». Hymne à la beauté de Laure d’Astarac, satire virulente et burlesque de l’Éducation nationale, « L’Os de Dionysos » est immédiatement censuré « au nom du peuple français » par le Tribunal de Grande Instance de Tarbes le 12 mars 1987. L’ordonnance de saisie est confirmée par un jugement de la Cour d’Appel de Pau. Les attendus sont les suivants : « trouble illicite, incitation au désordre et à la moquerie, pornographie, abus de mots baroques, danger pour la jeunesse en pleine formation physique et morale, blasphème, lubricité, paganisme ». L’auteur commente : « La censure c’est l’admission en QHS : Quartier de Haute Syntaxe ! » L’Os de Dionysos reste à ce jour le dernier ouvrage de fiction censuré en France. Le livre sera finalement réédité et deviendra une édition culte. En 1989, Régine Deforges et Jean-Jacques Pauvert rééditent « L’Os de Dionysos ». Le roman se vend à 100.000 exemplaires. La presse salue unanimement « la somptuosité verbale d’un écrivain émule des surréalistes ». Cette même année il publie aussi « Nougaro la voix royale ». En 1990, il publie, chez Régine Deforges, « Aquarium », livre buissonnier mêlant poésie, conte, charge syllabique, pamphlet et textes érotiques. Au sommaire d’Aquarium également « Les soleils de Bernard Lubat », portrait du semeur de sons d’Uzeste et Father, texte qu’il écrivit au lendemain de la mort brutale de son père. En 1991, il publie, chez Régine Deforges, « L’Archipel de Bird », son second roman. En 1992, il s’oppose au creusement du tunnel du Somport et au projet autoroutier en vallée d’Aspe, territoire de l’ours brun des Pyrénées. Il publie, chez Régine Deforges, dans la collection « Coup de gueule », « Danse avec les ours », chant d’amour à cette vallée sauvage et pamphlet dénonçant l’Europe du béton à laquelle il oppose « l’Europe fauve », celle des peuples et de l’ours. Le livre inspirera à Yves Boisset un reportage diffusé sur France2, dans le magazine « Envoyé spécial ». En 1993, il publie, aux Éditions Les Belles Lettres, « Pyrène et les vélos », hommage aux champions cyclistes gravissant les pentes d’Aubisque et du Tourmalet. Pour ce franc-tireur, les Pyrénées sont le territoire de la neige, des ours et de Fausto Coppi. En 1994, il publie, chez Albin Michel, « L’ange qui aimait la pluie », chronique sportive, hommage poétique et littéraire à Charly Gaul, vainqueur du Tour 1958. L’ouvrage obtient le Grand prix de la Littérature sportive. En 1995, il publie, chez Albin Michel, « Indianoak », roman percutant et païen et chez Stock, « Le Roi Miguel », portrait romanesque, poétique et chaleureux du champion le plus silencieux du peloton, Miguel Indurain. L’ouvrage sera traduit en espagnol et en japonais. En 1997, il publie, chez Albin Michel, un nouveau roman, « La Corde à linge », où il raconte l’histoire d’un serial voleur de petites culottes et en 1998, toujours chez Albin Michel, « Duel sur le volcan » où il ressuscite l’épique et tellurique combat que se livrèrent Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, en 1964, sur les pentes du Puy de Dôme. En 1999, il publie aux Éditions Fayard, « Flammes » son cinquième roman, une interprétation romanesque de l’affaire des feux de Séron. En 2000, il publie, aux Éditions Mazarine, « Le petit livre jaune », contenant notamment « Un abécédaire du Tour », qui sera mis en image par France Télévision. En 2001, il publie chez Fayard, « Gargantaur », son sixième roman. En 2002, il publie chez Bartillat « Collector ». En 2003, il publie chez Fayard, « Soror ». En 2004, il publie chez Bartillat « Fenêtre sur Tour ». Ce livre est un hommage aux champions du Tour, à Hinault et à Lance Amstrong. Cette même année, il réédite chez Fayard « L’Homme aux semelles de swing » et « La Voix royale », les deux livres qu’il avait, en 1984 et 1989, consacrés à Claude Nougaro. Une longue amitié, une proximité rare ont permis aux deux hommes de cheminer ensemble. En 2005, il publie « Mon seul chanteur de blues », aux Éditions de La Martinière. Malgré leur différence d’âge, les deux hommes, quand ils se rencontraient, avaient l’impression d’être des jumeaux, qui auraient eu pour parents la poésie et l’insoumission. Le même amour de la langue les réunissait. En 2006, il publie, chez Plon, « Champion ». L’auteur de « L’Os de Dionysos » défend, avec lyrisme et punch, Lance Armstrong, le septuple vainqueur du Tour, dont il est interdit, en France, de prononcer le nom et auquel il rend hommage. En 2007, il publie « Pension Karlipah » chez Plon/Jeunesse, « Le Dictionnaire amoureux du Tour de France » chez Plon, et « Chicken », aux Éditions Gascogne. En 2008, il publie « Renaud, briographie » chez Flammarion. En 2009, il publie un pamphlet « Corrida, basta ! » chez Robert Laffont. En 2010, il publie « Le Tour de France dans les Pyrénées, de 1910 à Lance Armstrong », aux Éditions le Cherche-midi et « Le soleil m’a oublié » chez Robert Laffont. En 2011, il publie « Vélociférations, je me souviens du Tour », ouvrage coédité par les Éditions Cairn et les Éditions Le Pas d’oiseau. En 2012, il publie « Diane et autres stories en short », aux Éditions Robert Laffont et « Tour de France, nostalgie », aux Éditions Hors Collection. En 2014, il publie « Claude Nougaro, le parcours du cœur battant », aux Éditions Hors Collection. En 2015, il publie « Madame Richardson », aux Éditions Robert Laffont et « Bernard Hinault, l’épopée du Blaireau » chez Mareuil Éditions et enfin « À chacun son Tour » chez Robert Laffont. En 2016, il publie un nouveau pamphlet contre l’agrobusiness « La Cause des vaches ». Le livre d’un amoureux des vaches qui s’élève contre les usines à viande et la ferme des mille vaches en Picardie. En 2017, il publie « Robic 47 », aux Éditions du Rocher, reprenant l’épopée de Jean Robic, vainqueur du Tour en 1947. En 2019, il publie « Tour de France » aux Éditions du Rocher et en 2020, « Darrigade - Le sprinteur du Tour de France » aux Éditions du Rocher. Il a collaboré à L’Idiot international de Jean-Edern Hallier, journal dans lequel il tirait « sur tout ce qui ne bouge pas ». C’est dans ce journal pamphlétaire qu’il a pris la défense de l’ours des Pyrénées, le dernier fauve d’Europe. Il est également l’un des biographes de Claude Nougaro et Renaud. Il est connu pour son engagement pour la protection de l’ours des Pyrénées aux côtés de ces deux chanteurs. Ami de Claude Nougaro, il lui a consacré quatre livres. Et avec lui, il a écrit les paroles de la chanson « Prof de lettres ». Il tient une chronique "Livres" sur France 3 Sud et est chroniqueur pour la Nouvelle République des Pyrénées. En 1985, il a reçu le Grand Prix de Littérature de l’Académie Charles Cros pour Claude Nougaro, « L’homme aux semelles de swing » aux Éditions Privat. En 2010, au départ de l’étape Pau-Col du Tourmalet, il s’est vu remettre par Bernard Hinault, quintuple vainqueur de la Grande Boucle, la médaille du Tour de France pour l’ensemble de ses livres consacrés aux géants de la route et à la Grande Boucle. En 2013, il a reçu le Prix Luis Nucéra pour son « Tour de France nostalgie », aux Éditions Hors Collection. En 2016, il fut promu vigneron d’Honneur de la Viguerie Royale du Madiran et enfin en 2017, il a reçu le Prix Jacques Lacroix de l’Académie française pour « La Cause des vaches », aux Éditions du Rocher.
Christian LABORDE, né le 27 janvier 1955 à Aureilhan est devenu célèbre pour avoir vécu l’une des dernières censures littéraires en France. Depuis trente ans, il écrit un livre par an couvrant un large répertoire : roman, poésie, son engagement autour de la musique, son amour du Tour de France mais aussi son indignation contre la souffrance animale. En 1984, il publie « L’homme aux semelles de swing ». En 1987, il publie, aux Éditions Eché, « L’Os de Dionysos ». Hymne à la beauté de Laure d’Astarac, satire virulente et burlesque de l’Éducation nationale, « L’Os de Dionysos » est immédiatement censuré « au nom du peuple français » par le Tribunal de Grande Instance de Tarbes le 12 mars 1987. L’ordonnance de saisie est confirmée par un jugement de la Cour d’Appel de Pau. Les attendus sont les suivants : « trouble illicite, incitation au désordre et à la moquerie, pornographie, abus de mots baroques, danger pour la jeunesse en pleine formation physique et morale, blasphème, lubricité, paganisme ». L’auteur commente : « La censure c’est l’admission en QHS : Quartier de Haute Syntaxe ! » L’Os de Dionysos reste à ce jour le dernier ouvrage de fiction censuré en France. Le livre sera finalement réédité et deviendra une édition culte. En 1989, Régine Deforges et Jean-Jacques Pauvert rééditent « L’Os de Dionysos ». Le roman se vend à 100.000 exemplaires. La presse salue unanimement « la somptuosité verbale d’un écrivain émule des surréalistes ». Cette même année il publie aussi « Nougaro la voix royale ». En 1990, il publie, chez Régine Deforges, « Aquarium », livre buissonnier mêlant poésie, conte, charge syllabique, pamphlet et textes érotiques. Au sommaire d’Aquarium également « Les soleils de Bernard Lubat », portrait du semeur de sons d’Uzeste et Father, texte qu’il écrivit au lendemain de la mort brutale de son père. En 1991, il publie, chez Régine Deforges, « L’Archipel de Bird », son second roman. En 1992, il s’oppose au creusement du tunnel du Somport et au projet autoroutier en vallée d’Aspe, territoire de l’ours brun des Pyrénées. Il publie, chez Régine Deforges, dans la collection « Coup de gueule », « Danse avec les ours », chant d’amour à cette vallée sauvage et pamphlet dénonçant l’Europe du béton à laquelle il oppose « l’Europe fauve », celle des peuples et de l’ours. Le livre inspirera à Yves Boisset un reportage diffusé sur France2, dans le magazine « Envoyé spécial ». En 1993, il publie, aux Éditions Les Belles Lettres, « Pyrène et les vélos », hommage aux champions cyclistes gravissant les pentes d’Aubisque et du Tourmalet. Pour ce franc-tireur, les Pyrénées sont le territoire de la neige, des ours et de Fausto Coppi. En 1994, il publie, chez Albin Michel, « L’ange qui aimait la pluie », chronique sportive, hommage poétique et littéraire à Charly Gaul, vainqueur du Tour 1958. L’ouvrage obtient le Grand prix de la Littérature sportive. En 1995, il publie, chez Albin Michel, « Indianoak », roman percutant et païen et chez Stock, « Le Roi Miguel », portrait romanesque, poétique et chaleureux du champion le plus silencieux du peloton, Miguel Indurain. L’ouvrage sera traduit en espagnol et en japonais. En 1997, il publie, chez Albin Michel, un nouveau roman, « La Corde à linge », où il raconte l’histoire d’un serial voleur de petites culottes et en 1998, toujours chez Albin Michel, « Duel sur le volcan » où il ressuscite l’épique et tellurique combat que se livrèrent Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, en 1964, sur les pentes du Puy de Dôme. En 1999, il publie aux Éditions Fayard, « Flammes » son cinquième roman, une interprétation romanesque de l’affaire des feux de Séron. En 2000, il publie, aux Éditions Mazarine, « Le petit livre jaune », contenant notamment « Un abécédaire du Tour », qui sera mis en image par France Télévision. En 2001, il publie chez Fayard, « Gargantaur », son sixième roman. En 2002, il publie chez Bartillat « Collector ». En 2003, il publie chez Fayard, « Soror ». En 2004, il publie chez Bartillat « Fenêtre sur Tour ». Ce livre est un hommage aux champions du Tour, à Hinault et à Lance Amstrong. Cette même année, il réédite chez Fayard « L’Homme aux semelles de swing » et « La Voix royale », les deux livres qu’il avait, en 1984 et 1989, consacrés à Claude Nougaro. Une longue amitié, une proximité rare ont permis aux deux hommes de cheminer ensemble. En 2005, il publie « Mon seul chanteur de blues », aux Éditions de La Martinière. Malgré leur différence d’âge, les deux hommes, quand ils se rencontraient, avaient l’impression d’être des jumeaux, qui auraient eu pour parents la poésie et l’insoumission. Le même amour de la langue les réunissait. En 2006, il publie, chez Plon, « Champion ». L’auteur de « L’Os de Dionysos » défend, avec lyrisme et punch, Lance Armstrong, le septuple vainqueur du Tour, dont il est interdit, en France, de prononcer le nom et auquel il rend hommage. En 2007, il publie « Pension Karlipah » chez Plon/Jeunesse, « Le Dictionnaire amoureux du Tour de France » chez Plon, et « Chicken », aux Éditions Gascogne. En 2008, il publie « Renaud, briographie » chez Flammarion. En 2009, il publie un pamphlet « Corrida, basta ! » chez Robert Laffont. En 2010, il publie « Le Tour de France dans les Pyrénées, de 1910 à Lance Armstrong », aux Éditions le Cherche-midi et « Le soleil m’a oublié » chez Robert Laffont. En 2011, il publie « Vélociférations, je me souviens du Tour », ouvrage coédité par les Éditions Cairn et les Éditions Le Pas d’oiseau. En 2012, il publie « Diane et autres stories en short », aux Éditions Robert Laffont et « Tour de France, nostalgie », aux Éditions Hors Collection. En 2014, il publie « Claude Nougaro, le parcours du cœur battant », aux Éditions Hors Collection. En 2015, il publie « Madame Richardson », aux Éditions Robert Laffont et « Bernard Hinault, l’épopée du Blaireau » chez Mareuil Éditions et enfin « À chacun son Tour » chez Robert Laffont. En 2016, il publie un nouveau pamphlet contre l’agrobusiness « La Cause des vaches ». Le livre d’un amoureux des vaches qui s’élève contre les usines à viande et la ferme des mille vaches en Picardie. En 2017, il publie « Robic 47 », aux Éditions du Rocher, reprenant l’épopée de Jean Robic, vainqueur du Tour en 1947. En 2019, il publie « Tour de France » aux Éditions du Rocher et en 2020, « Darrigade - Le sprinteur du Tour de France » aux Éditions du Rocher. Il a collaboré à L’Idiot international de Jean-Edern Hallier, journal dans lequel il tirait « sur tout ce qui ne bouge pas ». C’est dans ce journal pamphlétaire qu’il a pris la défense de l’ours des Pyrénées, le dernier fauve d’Europe. Il est également l’un des biographes de Claude Nougaro et Renaud. Il est connu pour son engagement pour la protection de l’ours des Pyrénées aux côtés de ces deux chanteurs. Ami de Claude Nougaro, il lui a consacré quatre livres. Et avec lui, il a écrit les paroles de la chanson « Prof de lettres ». Il tient une chronique "Livres" sur France 3 Sud et est chroniqueur pour la Nouvelle République des Pyrénées. En 1985, il a reçu le Grand Prix de Littérature de l’Académie Charles Cros pour Claude Nougaro, « L’homme aux semelles de swing » aux Éditions Privat. En 2010, au départ de l’étape Pau-Col du Tourmalet, il s’est vu remettre par Bernard Hinault, quintuple vainqueur de la Grande Boucle, la médaille du Tour de France pour l’ensemble de ses livres consacrés aux géants de la route et à la Grande Boucle. En 2013, il a reçu le Prix Luis Nucéra pour son « Tour de France nostalgie », aux Éditions Hors Collection. En 2016, il fut promu vigneron d’Honneur de la Viguerie Royale du Madiran et enfin en 2017, il a reçu le Prix Jacques Lacroix de l’Académie française pour « La Cause des vaches », aux Éditions du Rocher.
 Christian LABORDE, né le 27 janvier 1955 à Aureilhan est devenu célèbre pour avoir vécu l’une des dernières censures littéraires en France. Depuis trente ans, il écrit un livre par an couvrant un large répertoire : roman, poésie, son engagement autour de la musique, son amour du Tour de France mais aussi son indignation contre la souffrance animale. En 1984, il publie « L’homme aux semelles de swing ». En 1987, il publie, aux Éditions Eché, « L’Os de Dionysos ». Hymne à la beauté de Laure d’Astarac, satire virulente et burlesque de l’Éducation nationale, « L’Os de Dionysos » est immédiatement censuré « au nom du peuple français » par le Tribunal de Grande Instance de Tarbes le 12 mars 1987. L’ordonnance de saisie est confirmée par un jugement de la Cour d’Appel de Pau. Les attendus sont les suivants : « trouble illicite, incitation au désordre et à la moquerie, pornographie, abus de mots baroques, danger pour la jeunesse en pleine formation physique et morale, blasphème, lubricité, paganisme ». L’auteur commente : « La censure c’est l’admission en QHS : Quartier de Haute Syntaxe ! » L’Os de Dionysos reste à ce jour le dernier ouvrage de fiction censuré en France. Le livre sera finalement réédité et deviendra une édition culte. En 1989, Régine Deforges et Jean-Jacques Pauvert rééditent « L’Os de Dionysos ». Le roman se vend à 100.000 exemplaires. La presse salue unanimement « la somptuosité verbale d’un écrivain émule des surréalistes ». Cette même année il publie aussi « Nougaro la voix royale ». En 1990, il publie, chez Régine Deforges, « Aquarium », livre buissonnier mêlant poésie, conte, charge syllabique, pamphlet et textes érotiques. Au sommaire d’Aquarium également « Les soleils de Bernard Lubat », portrait du semeur de sons d’Uzeste et Father, texte qu’il écrivit au lendemain de la mort brutale de son père. En 1991, il publie, chez Régine Deforges, « L’Archipel de Bird », son second roman. En 1992, il s’oppose au creusement du tunnel du Somport et au projet autoroutier en vallée d’Aspe, territoire de l’ours brun des Pyrénées. Il publie, chez Régine Deforges, dans la collection « Coup de gueule », « Danse avec les ours », chant d’amour à cette vallée sauvage et pamphlet dénonçant l’Europe du béton à laquelle il oppose « l’Europe fauve », celle des peuples et de l’ours. Le livre inspirera à Yves Boisset un reportage diffusé sur France2, dans le magazine « Envoyé spécial ». En 1993, il publie, aux Éditions Les Belles Lettres, « Pyrène et les vélos », hommage aux champions cyclistes gravissant les pentes d’Aubisque et du Tourmalet. Pour ce franc-tireur, les Pyrénées sont le territoire de la neige, des ours et de Fausto Coppi. En 1994, il publie, chez Albin Michel, « L’ange qui aimait la pluie », chronique sportive, hommage poétique et littéraire à Charly Gaul, vainqueur du Tour 1958. L’ouvrage obtient le Grand prix de la Littérature sportive. En 1995, il publie, chez Albin Michel, « Indianoak », roman percutant et païen et chez Stock, « Le Roi Miguel », portrait romanesque, poétique et chaleureux du champion le plus silencieux du peloton, Miguel Indurain. L’ouvrage sera traduit en espagnol et en japonais. En 1997, il publie, chez Albin Michel, un nouveau roman, « La Corde à linge », où il raconte l’histoire d’un serial voleur de petites culottes et en 1998, toujours chez Albin Michel, « Duel sur le volcan » où il ressuscite l’épique et tellurique combat que se livrèrent Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, en 1964, sur les pentes du Puy de Dôme. En 1999, il publie aux Éditions Fayard, « Flammes » son cinquième roman, une interprétation romanesque de l’affaire des feux de Séron. En 2000, il publie, aux Éditions Mazarine, « Le petit livre jaune », contenant notamment « Un abécédaire du Tour », qui sera mis en image par France Télévision. En 2001, il publie chez Fayard, « Gargantaur », son sixième roman. En 2002, il publie chez Bartillat « Collector ». En 2003, il publie chez Fayard, « Soror ». En 2004, il publie chez Bartillat « Fenêtre sur Tour ». Ce livre est un hommage aux champions du Tour, à Hinault et à Lance Amstrong. Cette même année, il réédite chez Fayard « L’Homme aux semelles de swing » et « La Voix royale », les deux livres qu’il avait, en 1984 et 1989, consacrés à Claude Nougaro. Une longue amitié, une proximité rare ont permis aux deux hommes de cheminer ensemble. En 2005, il publie « Mon seul chanteur de blues », aux Éditions de La Martinière. Malgré leur différence d’âge, les deux hommes, quand ils se rencontraient, avaient l’impression d’être des jumeaux, qui auraient eu pour parents la poésie et l’insoumission. Le même amour de la langue les réunissait. En 2006, il publie, chez Plon, « Champion ». L’auteur de « L’Os de Dionysos » défend, avec lyrisme et punch, Lance Armstrong, le septuple vainqueur du Tour, dont il est interdit, en France, de prononcer le nom et auquel il rend hommage. En 2007, il publie « Pension Karlipah » chez Plon/Jeunesse, « Le Dictionnaire amoureux du Tour de France » chez Plon, et « Chicken », aux Éditions Gascogne. En 2008, il publie « Renaud, briographie » chez Flammarion. En 2009, il publie un pamphlet « Corrida, basta ! » chez Robert Laffont. En 2010, il publie « Le Tour de France dans les Pyrénées, de 1910 à Lance Armstrong », aux Éditions le Cherche-midi et « Le soleil m’a oublié » chez Robert Laffont. En 2011, il publie « Vélociférations, je me souviens du Tour », ouvrage coédité par les Éditions Cairn et les Éditions Le Pas d’oiseau. En 2012, il publie « Diane et autres stories en short », aux Éditions Robert Laffont et « Tour de France, nostalgie », aux Éditions Hors Collection. En 2014, il publie « Claude Nougaro, le parcours du cœur battant », aux Éditions Hors Collection. En 2015, il publie « Madame Richardson », aux Éditions Robert Laffont et « Bernard Hinault, l’épopée du Blaireau » chez Mareuil Éditions et enfin « À chacun son Tour » chez Robert Laffont. En 2016, il publie un nouveau pamphlet contre l’agrobusiness « La Cause des vaches ». Le livre d’un amoureux des vaches qui s’élève contre les usines à viande et la ferme des mille vaches en Picardie. En 2017, il publie « Robic 47 », aux Éditions du Rocher, reprenant l’épopée de Jean Robic, vainqueur du Tour en 1947. En 2019, il publie « Tour de France » aux Éditions du Rocher et en 2020, « Darrigade - Le sprinteur du Tour de France » aux Éditions du Rocher. Il a collaboré à L’Idiot international de Jean-Edern Hallier, journal dans lequel il tirait « sur tout ce qui ne bouge pas ». C’est dans ce journal pamphlétaire qu’il a pris la défense de l’ours des Pyrénées, le dernier fauve d’Europe. Il est également l’un des biographes de Claude Nougaro et Renaud. Il est connu pour son engagement pour la protection de l’ours des Pyrénées aux côtés de ces deux chanteurs. Ami de Claude Nougaro, il lui a consacré quatre livres. Et avec lui, il a écrit les paroles de la chanson « Prof de lettres ». Il tient une chronique "Livres" sur France 3 Sud et est chroniqueur pour la Nouvelle République des Pyrénées. En 1985, il a reçu le Grand Prix de Littérature de l’Académie Charles Cros pour Claude Nougaro, « L’homme aux semelles de swing » aux Éditions Privat. En 2010, au départ de l’étape Pau-Col du Tourmalet, il s’est vu remettre par Bernard Hinault, quintuple vainqueur de la Grande Boucle, la médaille du Tour de France pour l’ensemble de ses livres consacrés aux géants de la route et à la Grande Boucle. En 2013, il a reçu le Prix Luis Nucéra pour son « Tour de France nostalgie », aux Éditions Hors Collection. En 2016, il fut promu vigneron d’Honneur de la Viguerie Royale du Madiran et enfin en 2017, il a reçu le Prix Jacques Lacroix de l’Académie française pour « La Cause des vaches », aux Éditions du Rocher.
Christian LABORDE, né le 27 janvier 1955 à Aureilhan est devenu célèbre pour avoir vécu l’une des dernières censures littéraires en France. Depuis trente ans, il écrit un livre par an couvrant un large répertoire : roman, poésie, son engagement autour de la musique, son amour du Tour de France mais aussi son indignation contre la souffrance animale. En 1984, il publie « L’homme aux semelles de swing ». En 1987, il publie, aux Éditions Eché, « L’Os de Dionysos ». Hymne à la beauté de Laure d’Astarac, satire virulente et burlesque de l’Éducation nationale, « L’Os de Dionysos » est immédiatement censuré « au nom du peuple français » par le Tribunal de Grande Instance de Tarbes le 12 mars 1987. L’ordonnance de saisie est confirmée par un jugement de la Cour d’Appel de Pau. Les attendus sont les suivants : « trouble illicite, incitation au désordre et à la moquerie, pornographie, abus de mots baroques, danger pour la jeunesse en pleine formation physique et morale, blasphème, lubricité, paganisme ». L’auteur commente : « La censure c’est l’admission en QHS : Quartier de Haute Syntaxe ! » L’Os de Dionysos reste à ce jour le dernier ouvrage de fiction censuré en France. Le livre sera finalement réédité et deviendra une édition culte. En 1989, Régine Deforges et Jean-Jacques Pauvert rééditent « L’Os de Dionysos ». Le roman se vend à 100.000 exemplaires. La presse salue unanimement « la somptuosité verbale d’un écrivain émule des surréalistes ». Cette même année il publie aussi « Nougaro la voix royale ». En 1990, il publie, chez Régine Deforges, « Aquarium », livre buissonnier mêlant poésie, conte, charge syllabique, pamphlet et textes érotiques. Au sommaire d’Aquarium également « Les soleils de Bernard Lubat », portrait du semeur de sons d’Uzeste et Father, texte qu’il écrivit au lendemain de la mort brutale de son père. En 1991, il publie, chez Régine Deforges, « L’Archipel de Bird », son second roman. En 1992, il s’oppose au creusement du tunnel du Somport et au projet autoroutier en vallée d’Aspe, territoire de l’ours brun des Pyrénées. Il publie, chez Régine Deforges, dans la collection « Coup de gueule », « Danse avec les ours », chant d’amour à cette vallée sauvage et pamphlet dénonçant l’Europe du béton à laquelle il oppose « l’Europe fauve », celle des peuples et de l’ours. Le livre inspirera à Yves Boisset un reportage diffusé sur France2, dans le magazine « Envoyé spécial ». En 1993, il publie, aux Éditions Les Belles Lettres, « Pyrène et les vélos », hommage aux champions cyclistes gravissant les pentes d’Aubisque et du Tourmalet. Pour ce franc-tireur, les Pyrénées sont le territoire de la neige, des ours et de Fausto Coppi. En 1994, il publie, chez Albin Michel, « L’ange qui aimait la pluie », chronique sportive, hommage poétique et littéraire à Charly Gaul, vainqueur du Tour 1958. L’ouvrage obtient le Grand prix de la Littérature sportive. En 1995, il publie, chez Albin Michel, « Indianoak », roman percutant et païen et chez Stock, « Le Roi Miguel », portrait romanesque, poétique et chaleureux du champion le plus silencieux du peloton, Miguel Indurain. L’ouvrage sera traduit en espagnol et en japonais. En 1997, il publie, chez Albin Michel, un nouveau roman, « La Corde à linge », où il raconte l’histoire d’un serial voleur de petites culottes et en 1998, toujours chez Albin Michel, « Duel sur le volcan » où il ressuscite l’épique et tellurique combat que se livrèrent Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, en 1964, sur les pentes du Puy de Dôme. En 1999, il publie aux Éditions Fayard, « Flammes » son cinquième roman, une interprétation romanesque de l’affaire des feux de Séron. En 2000, il publie, aux Éditions Mazarine, « Le petit livre jaune », contenant notamment « Un abécédaire du Tour », qui sera mis en image par France Télévision. En 2001, il publie chez Fayard, « Gargantaur », son sixième roman. En 2002, il publie chez Bartillat « Collector ». En 2003, il publie chez Fayard, « Soror ». En 2004, il publie chez Bartillat « Fenêtre sur Tour ». Ce livre est un hommage aux champions du Tour, à Hinault et à Lance Amstrong. Cette même année, il réédite chez Fayard « L’Homme aux semelles de swing » et « La Voix royale », les deux livres qu’il avait, en 1984 et 1989, consacrés à Claude Nougaro. Une longue amitié, une proximité rare ont permis aux deux hommes de cheminer ensemble. En 2005, il publie « Mon seul chanteur de blues », aux Éditions de La Martinière. Malgré leur différence d’âge, les deux hommes, quand ils se rencontraient, avaient l’impression d’être des jumeaux, qui auraient eu pour parents la poésie et l’insoumission. Le même amour de la langue les réunissait. En 2006, il publie, chez Plon, « Champion ». L’auteur de « L’Os de Dionysos » défend, avec lyrisme et punch, Lance Armstrong, le septuple vainqueur du Tour, dont il est interdit, en France, de prononcer le nom et auquel il rend hommage. En 2007, il publie « Pension Karlipah » chez Plon/Jeunesse, « Le Dictionnaire amoureux du Tour de France » chez Plon, et « Chicken », aux Éditions Gascogne. En 2008, il publie « Renaud, briographie » chez Flammarion. En 2009, il publie un pamphlet « Corrida, basta ! » chez Robert Laffont. En 2010, il publie « Le Tour de France dans les Pyrénées, de 1910 à Lance Armstrong », aux Éditions le Cherche-midi et « Le soleil m’a oublié » chez Robert Laffont. En 2011, il publie « Vélociférations, je me souviens du Tour », ouvrage coédité par les Éditions Cairn et les Éditions Le Pas d’oiseau. En 2012, il publie « Diane et autres stories en short », aux Éditions Robert Laffont et « Tour de France, nostalgie », aux Éditions Hors Collection. En 2014, il publie « Claude Nougaro, le parcours du cœur battant », aux Éditions Hors Collection. En 2015, il publie « Madame Richardson », aux Éditions Robert Laffont et « Bernard Hinault, l’épopée du Blaireau » chez Mareuil Éditions et enfin « À chacun son Tour » chez Robert Laffont. En 2016, il publie un nouveau pamphlet contre l’agrobusiness « La Cause des vaches ». Le livre d’un amoureux des vaches qui s’élève contre les usines à viande et la ferme des mille vaches en Picardie. En 2017, il publie « Robic 47 », aux Éditions du Rocher, reprenant l’épopée de Jean Robic, vainqueur du Tour en 1947. En 2019, il publie « Tour de France » aux Éditions du Rocher et en 2020, « Darrigade - Le sprinteur du Tour de France » aux Éditions du Rocher. Il a collaboré à L’Idiot international de Jean-Edern Hallier, journal dans lequel il tirait « sur tout ce qui ne bouge pas ». C’est dans ce journal pamphlétaire qu’il a pris la défense de l’ours des Pyrénées, le dernier fauve d’Europe. Il est également l’un des biographes de Claude Nougaro et Renaud. Il est connu pour son engagement pour la protection de l’ours des Pyrénées aux côtés de ces deux chanteurs. Ami de Claude Nougaro, il lui a consacré quatre livres. Et avec lui, il a écrit les paroles de la chanson « Prof de lettres ». Il tient une chronique "Livres" sur France 3 Sud et est chroniqueur pour la Nouvelle République des Pyrénées. En 1985, il a reçu le Grand Prix de Littérature de l’Académie Charles Cros pour Claude Nougaro, « L’homme aux semelles de swing » aux Éditions Privat. En 2010, au départ de l’étape Pau-Col du Tourmalet, il s’est vu remettre par Bernard Hinault, quintuple vainqueur de la Grande Boucle, la médaille du Tour de France pour l’ensemble de ses livres consacrés aux géants de la route et à la Grande Boucle. En 2013, il a reçu le Prix Luis Nucéra pour son « Tour de France nostalgie », aux Éditions Hors Collection. En 2016, il fut promu vigneron d’Honneur de la Viguerie Royale du Madiran et enfin en 2017, il a reçu le Prix Jacques Lacroix de l’Académie française pour « La Cause des vaches », aux Éditions du Rocher.LACRAMPE André (1941-2015)
Archevêque de Besançon
 André LACRAMPE, né le 17 décembre 1941 à Agos-Vidalos et mort le 15 mai 2015, à l’âge de 73 ans. Fils d’agriculteurs, il fut un évêque catholique, archevêque de Besançon de 2003 à 2013. Il entra au Grand séminaire de Dax dans les Landes, puis poursuivit sa formation au séminaire du Prado à Limonest près de Lyon et à la faculté de théologie et des sciences religieuses de l’université catholique de Lyon, où il passera une licence de théologie. Ordonné prêtre à Lourdes le 31 décembre 1967, à l’âge de 26 ans, pour le diocèse de Tarbes, il sera aumônier de collèges et lycées et aumônier fédéral de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), dans son diocèse de 1968 à 1975. De 1975 à 1979, il sera aumônier national de la Jeunesse ouvrière chrétienne. Ensuite il sera nommé vicaire épiscopal et curé de la cathédrale de Tarbes entre 1979 et 1983, où il aura l’occasion de recevoir le pape Jean-Paul II. Le 13 juillet 1983, il fut nommé par le Pape Jean-Paul II, évêque auxiliaire de Mgr Ménager, archevêque de Reims et consacré évêque le 16 octobre 1983 en la basilique Saint Pie X de Lourdes, en poste à Charleville-Mézières de 1983 à 1988. Âgé de 42 ans lors de sa consécration, il était alors le plus jeune évêque de France. Le 18 novembre 1988, il fut nommé évêque prélat de la Mission de France, succédant au cardinal Decourtray, poste qu’il occupera jusqu’en 1995. Il fut ensuite évêque d’Ajaccio de 1995 à 2003. Le 13 juin 2003, Jean-Paul II le nomma archevêque de Besançon. Au niveau national, au sein de la Conférence des évêques de France, il fut membre du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles et il fut notamment président du Comité France-Amérique latine (1987-1993), président du Comité socio-économique et politique (1995-1999) et président du Conseil National pour la solidarité (2001-2006). Le 25 avril 2013, il créera la surprise en présentant, au pape François sa démission, pour raisons de santé, quatre ans avant l’âge officiel de la retraite fixée à 75 ans pour les évêques. « Avec l’âge, la durée du ministère, la santé qui évolue, l’avis du médecin et de mon conseiller spirituel, j’ai été amené à prendre sagement les décisions qui s’imposent pour mon bien personnel et celui du diocèse », expliqua-t-il alors. Et le 27 octobre 2013, il se retirera et renouera avec ses racines, en s’installant à Lourdes. Toujours fidèle à sa vocation, il choisira d’habiter à la Cité Saint-Pierre du Secours catholique, qui accueille les pèlerins les plus démunis. « L’Église renaît quand les chrétiens, malgré l’indifférence religieuse et le matérialisme ambiant, s’engagent au service des plus démunis », écrivait-il encore dans son dernier ouvrage. Son accent des Pyrénées, que trente années d’épiscopat à travers toute la France n’avaient pu lui faire perdre, sa faconde, sa gentillesse, et sa proximité laisse l’image d’un « Père-évêque », proche des fidèles, attentif aux laïcs et, pour reprendre l’image chère au pape François, un évêque au milieu de son peuple plutôt que devant : « Pour moi qui suis rural l’image du Pasteur, des brebis, garde toute sa richesse, sa poésie, sa charge affective, son enseignement », confiait-il dans un petit livre. Son attention aux plus démunis était comme un fil rouge qui peut résumer sa vie de chrétien, de prêtre et d’évêque. En Corse, ses trajets pour sillonner l’île au volant de sa petite voiture et visiter tous les villages l’avaient rendu particulièrement populaire. Il s’était aussi intéressé au rôle des confréries, encore très vivantes, qu’il avait tenu à renouveler et mieux encadrer. Comme évêque d’Ajaccio mais aussi de Besançon, il avait toujours promu l’implication des laïcs. Passionné du monde et de l’actualité, – et aussi du Tour de France qu’il suivait chaque année –, il n’hésitait pas à prendre des positions pour encourager les chrétiens à s’engager en politique, ou pour déplorer la fermeture d’usines ou les effets de la crise économique. Homme de la terre, proche du monde rural et ouvrier, il resta très attaché à ses montagnes des Pyrénées et il était très apprécié dans le Pays de Lourdes et dans le Lavedan, dont il avait conservé son accent rocailleux. L’été, il passait de 15 jours à 1 mois dans la bergerie de son frère, au Cambasque à Cauterets. Et chaque année, sauf cas de force majeure, il se retrouvait avec les montagnards pour le traditionnel pèlerinage de la Grande Fache. Il avait une attention particulière pour son village et ses concitoyens, toujours accessible et demandeur des nouvelles de la paroisse et des familles. Il avait été très affecté par le décès, en décembre 2014, de son ami d’enfance Jacques Chancel alors qu’il se trouvait en Nouvelle-Calédonie. Le 1er février 2015, il célébra en l’abbatiale de Saint-Savin une messe de bout de mois à l’intention de Jacques Chancel, qui lui avait remis les insignes d’officier de la Légion d’honneur, dans la salle des fêtes d’Agos-Vidalos, en novembre 2009. Même à la retraite, il ne cessa d’aider dans les paroisses du département. Il remplaçait des prêtres dans les petites paroisses en montagne. Il fut un homme de foi, qui aura parcouru de nombreux pays et villes, sans jamais oublier ses racines. Il avait été fait chevalier de la Légion d’honneur en 1997, promu officier en 2009, puis chevalier de l’Ordre des Palmes académiques en 2013. Il avait écrit et publié plusieurs ouvrages de référence et notamment « Évêque aux semelles de vents, des Pyrénées à la Corse » en 1995 aux éditions du Cerf, « Regards sur la Corse » en 2000, « Marche avec ton Dieu » en 2004 chez Mediapaul », « Cauterets : aux couleurs de l’été » en 2007, « Ambitions pour notre Église » en 2011 chez Nouvelle Cité et le dernier datant de 2013, livre de souvenir intitulé « Entretien des Pyrénées à la Franche-Comté : 30 ans d’épiscopat ». Homme chaleureux on retiendra aussi sa grande passion pour le rugby, cultivée aussi bien à Tarbes qu’à Charleville-Mézières, et pour le cyclisme en général et le Tour de France en particulier. Il suivit quelques étapes sur la route du Tour dans la voiture de son ami Jacques Chancel. Il a été inhumé le vendredi 22 mai 2015 en la crypte de la cathédrale Saint-Jean de Besançon, la ville de son dernier ministère. Le 8 mai 2016, Monseigneur Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes, est venu bénir à Agos-Vidalos, la plaque souvenir de Mgr Lacrampe, archevêque de Besançon.
André LACRAMPE, né le 17 décembre 1941 à Agos-Vidalos et mort le 15 mai 2015, à l’âge de 73 ans. Fils d’agriculteurs, il fut un évêque catholique, archevêque de Besançon de 2003 à 2013. Il entra au Grand séminaire de Dax dans les Landes, puis poursuivit sa formation au séminaire du Prado à Limonest près de Lyon et à la faculté de théologie et des sciences religieuses de l’université catholique de Lyon, où il passera une licence de théologie. Ordonné prêtre à Lourdes le 31 décembre 1967, à l’âge de 26 ans, pour le diocèse de Tarbes, il sera aumônier de collèges et lycées et aumônier fédéral de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), dans son diocèse de 1968 à 1975. De 1975 à 1979, il sera aumônier national de la Jeunesse ouvrière chrétienne. Ensuite il sera nommé vicaire épiscopal et curé de la cathédrale de Tarbes entre 1979 et 1983, où il aura l’occasion de recevoir le pape Jean-Paul II. Le 13 juillet 1983, il fut nommé par le Pape Jean-Paul II, évêque auxiliaire de Mgr Ménager, archevêque de Reims et consacré évêque le 16 octobre 1983 en la basilique Saint Pie X de Lourdes, en poste à Charleville-Mézières de 1983 à 1988. Âgé de 42 ans lors de sa consécration, il était alors le plus jeune évêque de France. Le 18 novembre 1988, il fut nommé évêque prélat de la Mission de France, succédant au cardinal Decourtray, poste qu’il occupera jusqu’en 1995. Il fut ensuite évêque d’Ajaccio de 1995 à 2003. Le 13 juin 2003, Jean-Paul II le nomma archevêque de Besançon. Au niveau national, au sein de la Conférence des évêques de France, il fut membre du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles et il fut notamment président du Comité France-Amérique latine (1987-1993), président du Comité socio-économique et politique (1995-1999) et président du Conseil National pour la solidarité (2001-2006). Le 25 avril 2013, il créera la surprise en présentant, au pape François sa démission, pour raisons de santé, quatre ans avant l’âge officiel de la retraite fixée à 75 ans pour les évêques. « Avec l’âge, la durée du ministère, la santé qui évolue, l’avis du médecin et de mon conseiller spirituel, j’ai été amené à prendre sagement les décisions qui s’imposent pour mon bien personnel et celui du diocèse », expliqua-t-il alors. Et le 27 octobre 2013, il se retirera et renouera avec ses racines, en s’installant à Lourdes. Toujours fidèle à sa vocation, il choisira d’habiter à la Cité Saint-Pierre du Secours catholique, qui accueille les pèlerins les plus démunis. « L’Église renaît quand les chrétiens, malgré l’indifférence religieuse et le matérialisme ambiant, s’engagent au service des plus démunis », écrivait-il encore dans son dernier ouvrage. Son accent des Pyrénées, que trente années d’épiscopat à travers toute la France n’avaient pu lui faire perdre, sa faconde, sa gentillesse, et sa proximité laisse l’image d’un « Père-évêque », proche des fidèles, attentif aux laïcs et, pour reprendre l’image chère au pape François, un évêque au milieu de son peuple plutôt que devant : « Pour moi qui suis rural l’image du Pasteur, des brebis, garde toute sa richesse, sa poésie, sa charge affective, son enseignement », confiait-il dans un petit livre. Son attention aux plus démunis était comme un fil rouge qui peut résumer sa vie de chrétien, de prêtre et d’évêque. En Corse, ses trajets pour sillonner l’île au volant de sa petite voiture et visiter tous les villages l’avaient rendu particulièrement populaire. Il s’était aussi intéressé au rôle des confréries, encore très vivantes, qu’il avait tenu à renouveler et mieux encadrer. Comme évêque d’Ajaccio mais aussi de Besançon, il avait toujours promu l’implication des laïcs. Passionné du monde et de l’actualité, – et aussi du Tour de France qu’il suivait chaque année –, il n’hésitait pas à prendre des positions pour encourager les chrétiens à s’engager en politique, ou pour déplorer la fermeture d’usines ou les effets de la crise économique. Homme de la terre, proche du monde rural et ouvrier, il resta très attaché à ses montagnes des Pyrénées et il était très apprécié dans le Pays de Lourdes et dans le Lavedan, dont il avait conservé son accent rocailleux. L’été, il passait de 15 jours à 1 mois dans la bergerie de son frère, au Cambasque à Cauterets. Et chaque année, sauf cas de force majeure, il se retrouvait avec les montagnards pour le traditionnel pèlerinage de la Grande Fache. Il avait une attention particulière pour son village et ses concitoyens, toujours accessible et demandeur des nouvelles de la paroisse et des familles. Il avait été très affecté par le décès, en décembre 2014, de son ami d’enfance Jacques Chancel alors qu’il se trouvait en Nouvelle-Calédonie. Le 1er février 2015, il célébra en l’abbatiale de Saint-Savin une messe de bout de mois à l’intention de Jacques Chancel, qui lui avait remis les insignes d’officier de la Légion d’honneur, dans la salle des fêtes d’Agos-Vidalos, en novembre 2009. Même à la retraite, il ne cessa d’aider dans les paroisses du département. Il remplaçait des prêtres dans les petites paroisses en montagne. Il fut un homme de foi, qui aura parcouru de nombreux pays et villes, sans jamais oublier ses racines. Il avait été fait chevalier de la Légion d’honneur en 1997, promu officier en 2009, puis chevalier de l’Ordre des Palmes académiques en 2013. Il avait écrit et publié plusieurs ouvrages de référence et notamment « Évêque aux semelles de vents, des Pyrénées à la Corse » en 1995 aux éditions du Cerf, « Regards sur la Corse » en 2000, « Marche avec ton Dieu » en 2004 chez Mediapaul », « Cauterets : aux couleurs de l’été » en 2007, « Ambitions pour notre Église » en 2011 chez Nouvelle Cité et le dernier datant de 2013, livre de souvenir intitulé « Entretien des Pyrénées à la Franche-Comté : 30 ans d’épiscopat ». Homme chaleureux on retiendra aussi sa grande passion pour le rugby, cultivée aussi bien à Tarbes qu’à Charleville-Mézières, et pour le cyclisme en général et le Tour de France en particulier. Il suivit quelques étapes sur la route du Tour dans la voiture de son ami Jacques Chancel. Il a été inhumé le vendredi 22 mai 2015 en la crypte de la cathédrale Saint-Jean de Besançon, la ville de son dernier ministère. Le 8 mai 2016, Monseigneur Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes, est venu bénir à Agos-Vidalos, la plaque souvenir de Mgr Lacrampe, archevêque de Besançon.
 André LACRAMPE, né le 17 décembre 1941 à Agos-Vidalos et mort le 15 mai 2015, à l’âge de 73 ans. Fils d’agriculteurs, il fut un évêque catholique, archevêque de Besançon de 2003 à 2013. Il entra au Grand séminaire de Dax dans les Landes, puis poursuivit sa formation au séminaire du Prado à Limonest près de Lyon et à la faculté de théologie et des sciences religieuses de l’université catholique de Lyon, où il passera une licence de théologie. Ordonné prêtre à Lourdes le 31 décembre 1967, à l’âge de 26 ans, pour le diocèse de Tarbes, il sera aumônier de collèges et lycées et aumônier fédéral de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), dans son diocèse de 1968 à 1975. De 1975 à 1979, il sera aumônier national de la Jeunesse ouvrière chrétienne. Ensuite il sera nommé vicaire épiscopal et curé de la cathédrale de Tarbes entre 1979 et 1983, où il aura l’occasion de recevoir le pape Jean-Paul II. Le 13 juillet 1983, il fut nommé par le Pape Jean-Paul II, évêque auxiliaire de Mgr Ménager, archevêque de Reims et consacré évêque le 16 octobre 1983 en la basilique Saint Pie X de Lourdes, en poste à Charleville-Mézières de 1983 à 1988. Âgé de 42 ans lors de sa consécration, il était alors le plus jeune évêque de France. Le 18 novembre 1988, il fut nommé évêque prélat de la Mission de France, succédant au cardinal Decourtray, poste qu’il occupera jusqu’en 1995. Il fut ensuite évêque d’Ajaccio de 1995 à 2003. Le 13 juin 2003, Jean-Paul II le nomma archevêque de Besançon. Au niveau national, au sein de la Conférence des évêques de France, il fut membre du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles et il fut notamment président du Comité France-Amérique latine (1987-1993), président du Comité socio-économique et politique (1995-1999) et président du Conseil National pour la solidarité (2001-2006). Le 25 avril 2013, il créera la surprise en présentant, au pape François sa démission, pour raisons de santé, quatre ans avant l’âge officiel de la retraite fixée à 75 ans pour les évêques. « Avec l’âge, la durée du ministère, la santé qui évolue, l’avis du médecin et de mon conseiller spirituel, j’ai été amené à prendre sagement les décisions qui s’imposent pour mon bien personnel et celui du diocèse », expliqua-t-il alors. Et le 27 octobre 2013, il se retirera et renouera avec ses racines, en s’installant à Lourdes. Toujours fidèle à sa vocation, il choisira d’habiter à la Cité Saint-Pierre du Secours catholique, qui accueille les pèlerins les plus démunis. « L’Église renaît quand les chrétiens, malgré l’indifférence religieuse et le matérialisme ambiant, s’engagent au service des plus démunis », écrivait-il encore dans son dernier ouvrage. Son accent des Pyrénées, que trente années d’épiscopat à travers toute la France n’avaient pu lui faire perdre, sa faconde, sa gentillesse, et sa proximité laisse l’image d’un « Père-évêque », proche des fidèles, attentif aux laïcs et, pour reprendre l’image chère au pape François, un évêque au milieu de son peuple plutôt que devant : « Pour moi qui suis rural l’image du Pasteur, des brebis, garde toute sa richesse, sa poésie, sa charge affective, son enseignement », confiait-il dans un petit livre. Son attention aux plus démunis était comme un fil rouge qui peut résumer sa vie de chrétien, de prêtre et d’évêque. En Corse, ses trajets pour sillonner l’île au volant de sa petite voiture et visiter tous les villages l’avaient rendu particulièrement populaire. Il s’était aussi intéressé au rôle des confréries, encore très vivantes, qu’il avait tenu à renouveler et mieux encadrer. Comme évêque d’Ajaccio mais aussi de Besançon, il avait toujours promu l’implication des laïcs. Passionné du monde et de l’actualité, – et aussi du Tour de France qu’il suivait chaque année –, il n’hésitait pas à prendre des positions pour encourager les chrétiens à s’engager en politique, ou pour déplorer la fermeture d’usines ou les effets de la crise économique. Homme de la terre, proche du monde rural et ouvrier, il resta très attaché à ses montagnes des Pyrénées et il était très apprécié dans le Pays de Lourdes et dans le Lavedan, dont il avait conservé son accent rocailleux. L’été, il passait de 15 jours à 1 mois dans la bergerie de son frère, au Cambasque à Cauterets. Et chaque année, sauf cas de force majeure, il se retrouvait avec les montagnards pour le traditionnel pèlerinage de la Grande Fache. Il avait une attention particulière pour son village et ses concitoyens, toujours accessible et demandeur des nouvelles de la paroisse et des familles. Il avait été très affecté par le décès, en décembre 2014, de son ami d’enfance Jacques Chancel alors qu’il se trouvait en Nouvelle-Calédonie. Le 1er février 2015, il célébra en l’abbatiale de Saint-Savin une messe de bout de mois à l’intention de Jacques Chancel, qui lui avait remis les insignes d’officier de la Légion d’honneur, dans la salle des fêtes d’Agos-Vidalos, en novembre 2009. Même à la retraite, il ne cessa d’aider dans les paroisses du département. Il remplaçait des prêtres dans les petites paroisses en montagne. Il fut un homme de foi, qui aura parcouru de nombreux pays et villes, sans jamais oublier ses racines. Il avait été fait chevalier de la Légion d’honneur en 1997, promu officier en 2009, puis chevalier de l’Ordre des Palmes académiques en 2013. Il avait écrit et publié plusieurs ouvrages de référence et notamment « Évêque aux semelles de vents, des Pyrénées à la Corse » en 1995 aux éditions du Cerf, « Regards sur la Corse » en 2000, « Marche avec ton Dieu » en 2004 chez Mediapaul », « Cauterets : aux couleurs de l’été » en 2007, « Ambitions pour notre Église » en 2011 chez Nouvelle Cité et le dernier datant de 2013, livre de souvenir intitulé « Entretien des Pyrénées à la Franche-Comté : 30 ans d’épiscopat ». Homme chaleureux on retiendra aussi sa grande passion pour le rugby, cultivée aussi bien à Tarbes qu’à Charleville-Mézières, et pour le cyclisme en général et le Tour de France en particulier. Il suivit quelques étapes sur la route du Tour dans la voiture de son ami Jacques Chancel. Il a été inhumé le vendredi 22 mai 2015 en la crypte de la cathédrale Saint-Jean de Besançon, la ville de son dernier ministère. Le 8 mai 2016, Monseigneur Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes, est venu bénir à Agos-Vidalos, la plaque souvenir de Mgr Lacrampe, archevêque de Besançon.
André LACRAMPE, né le 17 décembre 1941 à Agos-Vidalos et mort le 15 mai 2015, à l’âge de 73 ans. Fils d’agriculteurs, il fut un évêque catholique, archevêque de Besançon de 2003 à 2013. Il entra au Grand séminaire de Dax dans les Landes, puis poursuivit sa formation au séminaire du Prado à Limonest près de Lyon et à la faculté de théologie et des sciences religieuses de l’université catholique de Lyon, où il passera une licence de théologie. Ordonné prêtre à Lourdes le 31 décembre 1967, à l’âge de 26 ans, pour le diocèse de Tarbes, il sera aumônier de collèges et lycées et aumônier fédéral de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), dans son diocèse de 1968 à 1975. De 1975 à 1979, il sera aumônier national de la Jeunesse ouvrière chrétienne. Ensuite il sera nommé vicaire épiscopal et curé de la cathédrale de Tarbes entre 1979 et 1983, où il aura l’occasion de recevoir le pape Jean-Paul II. Le 13 juillet 1983, il fut nommé par le Pape Jean-Paul II, évêque auxiliaire de Mgr Ménager, archevêque de Reims et consacré évêque le 16 octobre 1983 en la basilique Saint Pie X de Lourdes, en poste à Charleville-Mézières de 1983 à 1988. Âgé de 42 ans lors de sa consécration, il était alors le plus jeune évêque de France. Le 18 novembre 1988, il fut nommé évêque prélat de la Mission de France, succédant au cardinal Decourtray, poste qu’il occupera jusqu’en 1995. Il fut ensuite évêque d’Ajaccio de 1995 à 2003. Le 13 juin 2003, Jean-Paul II le nomma archevêque de Besançon. Au niveau national, au sein de la Conférence des évêques de France, il fut membre du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles et il fut notamment président du Comité France-Amérique latine (1987-1993), président du Comité socio-économique et politique (1995-1999) et président du Conseil National pour la solidarité (2001-2006). Le 25 avril 2013, il créera la surprise en présentant, au pape François sa démission, pour raisons de santé, quatre ans avant l’âge officiel de la retraite fixée à 75 ans pour les évêques. « Avec l’âge, la durée du ministère, la santé qui évolue, l’avis du médecin et de mon conseiller spirituel, j’ai été amené à prendre sagement les décisions qui s’imposent pour mon bien personnel et celui du diocèse », expliqua-t-il alors. Et le 27 octobre 2013, il se retirera et renouera avec ses racines, en s’installant à Lourdes. Toujours fidèle à sa vocation, il choisira d’habiter à la Cité Saint-Pierre du Secours catholique, qui accueille les pèlerins les plus démunis. « L’Église renaît quand les chrétiens, malgré l’indifférence religieuse et le matérialisme ambiant, s’engagent au service des plus démunis », écrivait-il encore dans son dernier ouvrage. Son accent des Pyrénées, que trente années d’épiscopat à travers toute la France n’avaient pu lui faire perdre, sa faconde, sa gentillesse, et sa proximité laisse l’image d’un « Père-évêque », proche des fidèles, attentif aux laïcs et, pour reprendre l’image chère au pape François, un évêque au milieu de son peuple plutôt que devant : « Pour moi qui suis rural l’image du Pasteur, des brebis, garde toute sa richesse, sa poésie, sa charge affective, son enseignement », confiait-il dans un petit livre. Son attention aux plus démunis était comme un fil rouge qui peut résumer sa vie de chrétien, de prêtre et d’évêque. En Corse, ses trajets pour sillonner l’île au volant de sa petite voiture et visiter tous les villages l’avaient rendu particulièrement populaire. Il s’était aussi intéressé au rôle des confréries, encore très vivantes, qu’il avait tenu à renouveler et mieux encadrer. Comme évêque d’Ajaccio mais aussi de Besançon, il avait toujours promu l’implication des laïcs. Passionné du monde et de l’actualité, – et aussi du Tour de France qu’il suivait chaque année –, il n’hésitait pas à prendre des positions pour encourager les chrétiens à s’engager en politique, ou pour déplorer la fermeture d’usines ou les effets de la crise économique. Homme de la terre, proche du monde rural et ouvrier, il resta très attaché à ses montagnes des Pyrénées et il était très apprécié dans le Pays de Lourdes et dans le Lavedan, dont il avait conservé son accent rocailleux. L’été, il passait de 15 jours à 1 mois dans la bergerie de son frère, au Cambasque à Cauterets. Et chaque année, sauf cas de force majeure, il se retrouvait avec les montagnards pour le traditionnel pèlerinage de la Grande Fache. Il avait une attention particulière pour son village et ses concitoyens, toujours accessible et demandeur des nouvelles de la paroisse et des familles. Il avait été très affecté par le décès, en décembre 2014, de son ami d’enfance Jacques Chancel alors qu’il se trouvait en Nouvelle-Calédonie. Le 1er février 2015, il célébra en l’abbatiale de Saint-Savin une messe de bout de mois à l’intention de Jacques Chancel, qui lui avait remis les insignes d’officier de la Légion d’honneur, dans la salle des fêtes d’Agos-Vidalos, en novembre 2009. Même à la retraite, il ne cessa d’aider dans les paroisses du département. Il remplaçait des prêtres dans les petites paroisses en montagne. Il fut un homme de foi, qui aura parcouru de nombreux pays et villes, sans jamais oublier ses racines. Il avait été fait chevalier de la Légion d’honneur en 1997, promu officier en 2009, puis chevalier de l’Ordre des Palmes académiques en 2013. Il avait écrit et publié plusieurs ouvrages de référence et notamment « Évêque aux semelles de vents, des Pyrénées à la Corse » en 1995 aux éditions du Cerf, « Regards sur la Corse » en 2000, « Marche avec ton Dieu » en 2004 chez Mediapaul », « Cauterets : aux couleurs de l’été » en 2007, « Ambitions pour notre Église » en 2011 chez Nouvelle Cité et le dernier datant de 2013, livre de souvenir intitulé « Entretien des Pyrénées à la Franche-Comté : 30 ans d’épiscopat ». Homme chaleureux on retiendra aussi sa grande passion pour le rugby, cultivée aussi bien à Tarbes qu’à Charleville-Mézières, et pour le cyclisme en général et le Tour de France en particulier. Il suivit quelques étapes sur la route du Tour dans la voiture de son ami Jacques Chancel. Il a été inhumé le vendredi 22 mai 2015 en la crypte de la cathédrale Saint-Jean de Besançon, la ville de son dernier ministère. Le 8 mai 2016, Monseigneur Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes, est venu bénir à Agos-Vidalos, la plaque souvenir de Mgr Lacrampe, archevêque de Besançon.LANNE Michel (1984-XXXX)
Athlète coureur d'ultra-trail vice-champion du monde de skyrunning
 Michel LANNE, né le 26 octobre 1984 à Tarbes, gendarme-secouriste au PGHM d'Annecy et membre du Team Salomon, est spécialiste de l’ultra-trail. Il pratique l’escalade, le ski de randonnée et le ski alpin. C'est en 2010 qu'il se lance concrètement dans le trail après avoir reçu ses diplômes de guide de haute montagne et de moniteur national de ski alpin. Sa première compétition fut la Via Lattea trail à Sauze d’Oulx en italie, qu'il remporta. En 2011, il remporte les trails suivants : Snow Trail des Ecrins, Trail de Galnum, Trail du Galibier, Trail Aiguilles Rouges et le Trail Sainte Victoire (TSV). En 2012, il termine quatrième au Marathon de Zegama Aizkorri et remporte les trails suivants : Nocture de Serre Che, Ultra tour du Mole, Via Lattea Trail, Trail Drome Lafuma, Trail Blanc Serre Chevalier, Hong Kong Oxfam Trailwalker et Andorra Ultra Trail. En 2013, il finit deuxième du Trail du Ventoux, et remporte le Trail de la Galinette, Snow Trail Ubaye Salomon et le Trail Sainte Victoire. En 2013, il a notamment remporté le marathon du Mont-Blanc et ses 80 km et 6000 mD+. 2014 est l’une de ses plus belles années car il devient le vice-champion du monde Skyrunning 2014, derrière l'Espagnol Kilian Jornet. Cette même année, il finit 6ème et 1er Français au marathon de Zegama avec ses 42 km pour 5472 mD+. En avril 2015, il termine 3ème du Buffalo Stampede Skymarathon, au cœur de l'Australie avec ses 41,4 km, 2934 mD+ et 1941 mD-, derrière Blake Hose et David Byrne. En juillet 2015 il remporte le Trophée du Grand Vignemale et le marathon des Gabizos, puis le 22 août le marathon du Montcalm. Il remporte aussi le Trail Ubaye Salomon (Barcelonette) sur 42 km en 3h52'4". En 2015, il est le grand champion pour l’épreuve du 42 km du Mont-Blanc en 4h10'4" avec 2730 mD+. Il est vainqueur en 2016 de la CCC (Courmayeur Champex Chamonix) avec ses 101 km et 6100 mD+ qui emprunte de Courmayeur à Chamonix, une bonne partie du sentier international de Grande Randonnée du Tour du Mont-Blanc. Le 8 juillet 2017, il s’impose en Corse en remportant le 69 km et 4000 mD+ du Restonica trail. Le 30 août 2017, il remporte en 14h33'09" la TDS (sur les Traces des Ducs de Savoie) et ses 119 km et 7200 mD+ entre Courmayeur et Chamonix. En mai 2019, il s’impose en 8h40'37'' sur les 82.80 km de la Salomon Gore-Tex Maxi-Race 2019, autour du lac d’Annecy. En juillet 2019, il gagne sur 64.40 km le Trail du Tour des Fiz 2019 - Tour des 8 refuges en 7h31'04''. Daniel son père, né à Arrens-Marsous, secouriste dans le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) de Pierrefitte-Nestalas et aussi guide de haute montagne et moniteur national de ski alpin a transmis sa grande passion pour les sports de montagne et le trail en particulier à son fils, qui devenu adulte enchaîne les victoires et se construit un joli palmarès. Il est actuellement l'un des meilleurs ultra-trailers mondiaux ayant déjà réalisé de nombreux exploits. Chez les Lanne, en Val d’Azun, on ne compte plus les titres de champions de Michel, Daniel, Jean-Jacques et Philippe. Son frère Didier, sergent-chef dans l’Armée de l’air, est devenu le météorologue des équipes de France hommes et femmes de biathlon. C'est ainsi qu'il s'était retrouvé aux JO de Sotchi pour faire les prévisions du biathlon, du ski de fond, du combiné et du saut à ski en leur fournissant les données météorologiques des sites où avaient lieu les compétitions. Et c'est Martin Fourcade qui l'avait présenté au staff. La montagne préférée de Michel, Le Balaïtous (3144m), l'un des grands sommets pyrénéens, qui ne se laisse pas gravir si facilement et offre un point de vue immense, aussi bien vers la France que vers l'Espagne.
Michel LANNE, né le 26 octobre 1984 à Tarbes, gendarme-secouriste au PGHM d'Annecy et membre du Team Salomon, est spécialiste de l’ultra-trail. Il pratique l’escalade, le ski de randonnée et le ski alpin. C'est en 2010 qu'il se lance concrètement dans le trail après avoir reçu ses diplômes de guide de haute montagne et de moniteur national de ski alpin. Sa première compétition fut la Via Lattea trail à Sauze d’Oulx en italie, qu'il remporta. En 2011, il remporte les trails suivants : Snow Trail des Ecrins, Trail de Galnum, Trail du Galibier, Trail Aiguilles Rouges et le Trail Sainte Victoire (TSV). En 2012, il termine quatrième au Marathon de Zegama Aizkorri et remporte les trails suivants : Nocture de Serre Che, Ultra tour du Mole, Via Lattea Trail, Trail Drome Lafuma, Trail Blanc Serre Chevalier, Hong Kong Oxfam Trailwalker et Andorra Ultra Trail. En 2013, il finit deuxième du Trail du Ventoux, et remporte le Trail de la Galinette, Snow Trail Ubaye Salomon et le Trail Sainte Victoire. En 2013, il a notamment remporté le marathon du Mont-Blanc et ses 80 km et 6000 mD+. 2014 est l’une de ses plus belles années car il devient le vice-champion du monde Skyrunning 2014, derrière l'Espagnol Kilian Jornet. Cette même année, il finit 6ème et 1er Français au marathon de Zegama avec ses 42 km pour 5472 mD+. En avril 2015, il termine 3ème du Buffalo Stampede Skymarathon, au cœur de l'Australie avec ses 41,4 km, 2934 mD+ et 1941 mD-, derrière Blake Hose et David Byrne. En juillet 2015 il remporte le Trophée du Grand Vignemale et le marathon des Gabizos, puis le 22 août le marathon du Montcalm. Il remporte aussi le Trail Ubaye Salomon (Barcelonette) sur 42 km en 3h52'4". En 2015, il est le grand champion pour l’épreuve du 42 km du Mont-Blanc en 4h10'4" avec 2730 mD+. Il est vainqueur en 2016 de la CCC (Courmayeur Champex Chamonix) avec ses 101 km et 6100 mD+ qui emprunte de Courmayeur à Chamonix, une bonne partie du sentier international de Grande Randonnée du Tour du Mont-Blanc. Le 8 juillet 2017, il s’impose en Corse en remportant le 69 km et 4000 mD+ du Restonica trail. Le 30 août 2017, il remporte en 14h33'09" la TDS (sur les Traces des Ducs de Savoie) et ses 119 km et 7200 mD+ entre Courmayeur et Chamonix. En mai 2019, il s’impose en 8h40'37'' sur les 82.80 km de la Salomon Gore-Tex Maxi-Race 2019, autour du lac d’Annecy. En juillet 2019, il gagne sur 64.40 km le Trail du Tour des Fiz 2019 - Tour des 8 refuges en 7h31'04''. Daniel son père, né à Arrens-Marsous, secouriste dans le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) de Pierrefitte-Nestalas et aussi guide de haute montagne et moniteur national de ski alpin a transmis sa grande passion pour les sports de montagne et le trail en particulier à son fils, qui devenu adulte enchaîne les victoires et se construit un joli palmarès. Il est actuellement l'un des meilleurs ultra-trailers mondiaux ayant déjà réalisé de nombreux exploits. Chez les Lanne, en Val d’Azun, on ne compte plus les titres de champions de Michel, Daniel, Jean-Jacques et Philippe. Son frère Didier, sergent-chef dans l’Armée de l’air, est devenu le météorologue des équipes de France hommes et femmes de biathlon. C'est ainsi qu'il s'était retrouvé aux JO de Sotchi pour faire les prévisions du biathlon, du ski de fond, du combiné et du saut à ski en leur fournissant les données météorologiques des sites où avaient lieu les compétitions. Et c'est Martin Fourcade qui l'avait présenté au staff. La montagne préférée de Michel, Le Balaïtous (3144m), l'un des grands sommets pyrénéens, qui ne se laisse pas gravir si facilement et offre un point de vue immense, aussi bien vers la France que vers l'Espagne.
 Michel LANNE, né le 26 octobre 1984 à Tarbes, gendarme-secouriste au PGHM d'Annecy et membre du Team Salomon, est spécialiste de l’ultra-trail. Il pratique l’escalade, le ski de randonnée et le ski alpin. C'est en 2010 qu'il se lance concrètement dans le trail après avoir reçu ses diplômes de guide de haute montagne et de moniteur national de ski alpin. Sa première compétition fut la Via Lattea trail à Sauze d’Oulx en italie, qu'il remporta. En 2011, il remporte les trails suivants : Snow Trail des Ecrins, Trail de Galnum, Trail du Galibier, Trail Aiguilles Rouges et le Trail Sainte Victoire (TSV). En 2012, il termine quatrième au Marathon de Zegama Aizkorri et remporte les trails suivants : Nocture de Serre Che, Ultra tour du Mole, Via Lattea Trail, Trail Drome Lafuma, Trail Blanc Serre Chevalier, Hong Kong Oxfam Trailwalker et Andorra Ultra Trail. En 2013, il finit deuxième du Trail du Ventoux, et remporte le Trail de la Galinette, Snow Trail Ubaye Salomon et le Trail Sainte Victoire. En 2013, il a notamment remporté le marathon du Mont-Blanc et ses 80 km et 6000 mD+. 2014 est l’une de ses plus belles années car il devient le vice-champion du monde Skyrunning 2014, derrière l'Espagnol Kilian Jornet. Cette même année, il finit 6ème et 1er Français au marathon de Zegama avec ses 42 km pour 5472 mD+. En avril 2015, il termine 3ème du Buffalo Stampede Skymarathon, au cœur de l'Australie avec ses 41,4 km, 2934 mD+ et 1941 mD-, derrière Blake Hose et David Byrne. En juillet 2015 il remporte le Trophée du Grand Vignemale et le marathon des Gabizos, puis le 22 août le marathon du Montcalm. Il remporte aussi le Trail Ubaye Salomon (Barcelonette) sur 42 km en 3h52'4". En 2015, il est le grand champion pour l’épreuve du 42 km du Mont-Blanc en 4h10'4" avec 2730 mD+. Il est vainqueur en 2016 de la CCC (Courmayeur Champex Chamonix) avec ses 101 km et 6100 mD+ qui emprunte de Courmayeur à Chamonix, une bonne partie du sentier international de Grande Randonnée du Tour du Mont-Blanc. Le 8 juillet 2017, il s’impose en Corse en remportant le 69 km et 4000 mD+ du Restonica trail. Le 30 août 2017, il remporte en 14h33'09" la TDS (sur les Traces des Ducs de Savoie) et ses 119 km et 7200 mD+ entre Courmayeur et Chamonix. En mai 2019, il s’impose en 8h40'37'' sur les 82.80 km de la Salomon Gore-Tex Maxi-Race 2019, autour du lac d’Annecy. En juillet 2019, il gagne sur 64.40 km le Trail du Tour des Fiz 2019 - Tour des 8 refuges en 7h31'04''. Daniel son père, né à Arrens-Marsous, secouriste dans le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) de Pierrefitte-Nestalas et aussi guide de haute montagne et moniteur national de ski alpin a transmis sa grande passion pour les sports de montagne et le trail en particulier à son fils, qui devenu adulte enchaîne les victoires et se construit un joli palmarès. Il est actuellement l'un des meilleurs ultra-trailers mondiaux ayant déjà réalisé de nombreux exploits. Chez les Lanne, en Val d’Azun, on ne compte plus les titres de champions de Michel, Daniel, Jean-Jacques et Philippe. Son frère Didier, sergent-chef dans l’Armée de l’air, est devenu le météorologue des équipes de France hommes et femmes de biathlon. C'est ainsi qu'il s'était retrouvé aux JO de Sotchi pour faire les prévisions du biathlon, du ski de fond, du combiné et du saut à ski en leur fournissant les données météorologiques des sites où avaient lieu les compétitions. Et c'est Martin Fourcade qui l'avait présenté au staff. La montagne préférée de Michel, Le Balaïtous (3144m), l'un des grands sommets pyrénéens, qui ne se laisse pas gravir si facilement et offre un point de vue immense, aussi bien vers la France que vers l'Espagne.
Michel LANNE, né le 26 octobre 1984 à Tarbes, gendarme-secouriste au PGHM d'Annecy et membre du Team Salomon, est spécialiste de l’ultra-trail. Il pratique l’escalade, le ski de randonnée et le ski alpin. C'est en 2010 qu'il se lance concrètement dans le trail après avoir reçu ses diplômes de guide de haute montagne et de moniteur national de ski alpin. Sa première compétition fut la Via Lattea trail à Sauze d’Oulx en italie, qu'il remporta. En 2011, il remporte les trails suivants : Snow Trail des Ecrins, Trail de Galnum, Trail du Galibier, Trail Aiguilles Rouges et le Trail Sainte Victoire (TSV). En 2012, il termine quatrième au Marathon de Zegama Aizkorri et remporte les trails suivants : Nocture de Serre Che, Ultra tour du Mole, Via Lattea Trail, Trail Drome Lafuma, Trail Blanc Serre Chevalier, Hong Kong Oxfam Trailwalker et Andorra Ultra Trail. En 2013, il finit deuxième du Trail du Ventoux, et remporte le Trail de la Galinette, Snow Trail Ubaye Salomon et le Trail Sainte Victoire. En 2013, il a notamment remporté le marathon du Mont-Blanc et ses 80 km et 6000 mD+. 2014 est l’une de ses plus belles années car il devient le vice-champion du monde Skyrunning 2014, derrière l'Espagnol Kilian Jornet. Cette même année, il finit 6ème et 1er Français au marathon de Zegama avec ses 42 km pour 5472 mD+. En avril 2015, il termine 3ème du Buffalo Stampede Skymarathon, au cœur de l'Australie avec ses 41,4 km, 2934 mD+ et 1941 mD-, derrière Blake Hose et David Byrne. En juillet 2015 il remporte le Trophée du Grand Vignemale et le marathon des Gabizos, puis le 22 août le marathon du Montcalm. Il remporte aussi le Trail Ubaye Salomon (Barcelonette) sur 42 km en 3h52'4". En 2015, il est le grand champion pour l’épreuve du 42 km du Mont-Blanc en 4h10'4" avec 2730 mD+. Il est vainqueur en 2016 de la CCC (Courmayeur Champex Chamonix) avec ses 101 km et 6100 mD+ qui emprunte de Courmayeur à Chamonix, une bonne partie du sentier international de Grande Randonnée du Tour du Mont-Blanc. Le 8 juillet 2017, il s’impose en Corse en remportant le 69 km et 4000 mD+ du Restonica trail. Le 30 août 2017, il remporte en 14h33'09" la TDS (sur les Traces des Ducs de Savoie) et ses 119 km et 7200 mD+ entre Courmayeur et Chamonix. En mai 2019, il s’impose en 8h40'37'' sur les 82.80 km de la Salomon Gore-Tex Maxi-Race 2019, autour du lac d’Annecy. En juillet 2019, il gagne sur 64.40 km le Trail du Tour des Fiz 2019 - Tour des 8 refuges en 7h31'04''. Daniel son père, né à Arrens-Marsous, secouriste dans le Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) de Pierrefitte-Nestalas et aussi guide de haute montagne et moniteur national de ski alpin a transmis sa grande passion pour les sports de montagne et le trail en particulier à son fils, qui devenu adulte enchaîne les victoires et se construit un joli palmarès. Il est actuellement l'un des meilleurs ultra-trailers mondiaux ayant déjà réalisé de nombreux exploits. Chez les Lanne, en Val d’Azun, on ne compte plus les titres de champions de Michel, Daniel, Jean-Jacques et Philippe. Son frère Didier, sergent-chef dans l’Armée de l’air, est devenu le météorologue des équipes de France hommes et femmes de biathlon. C'est ainsi qu'il s'était retrouvé aux JO de Sotchi pour faire les prévisions du biathlon, du ski de fond, du combiné et du saut à ski en leur fournissant les données météorologiques des sites où avaient lieu les compétitions. Et c'est Martin Fourcade qui l'avait présenté au staff. La montagne préférée de Michel, Le Balaïtous (3144m), l'un des grands sommets pyrénéens, qui ne se laisse pas gravir si facilement et offre un point de vue immense, aussi bien vers la France que vers l'Espagne.LAPASSET Bernard (1947-2023)
Dirigeant du monde sportif, président d’honneur du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques 2024
 Bernard LAPASSET, né le 20 octobre 1947 à Tarbes, sur les terres de l’ovalie française, est un haut dirigeant du monde sportif. Licencié en droit et sorti major de l’école des douanes en 1969, il sera directeur interrégional honoraire des douanes et droits indirects. Il est marié et père de trois enfants. Comme joueur au poste de deuxième ligne de rugby à XV, il est champion de France juniors Reichel avec l’US Agenais en 1967 dans la catégorie des moins de 20 ans, puis en 1983 champion de France corporatif avec l’US Douanes de Paris. Président du Comité régional de rugby en Île-de-France de 1988 à 1991. Secrétaire général de la Fédération française de rugby à XV en 1991, il est élu président en décembre 1991 jusqu’à mai 2008, en remplacement d’Albert Ferrasse dont il avait été "la petite main", lui écrivant ses discours. En 2004, il est élu président du Comité d’organisation de la Coupe du monde de rugby à XV en France. En 2007, il décroche l’organisation en France de la Coupe du monde de rugby. De 1995 à 1996 puis à nouveau de 2008 à 2016, il est élu président de l’International Rugby Board (IRB), organisme qui gère le rugby au niveau mondial et compte 118 pays membres. En 2014, sous sa présidence l’IRB deviendra le World Rugby. Président du Comité de candidature du rugby à 7 aux Jeux olympiques, il fait entrer en octobre 2009 le rugby à 7 au programme olympique d’été de Rio en 2016 et de Tokyo en 2020. De 1992 à 2009, il est vice-président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). À l’origine de la candidature de Paris aux Jeux olympiques de 2024, il a été co-président du Comité de candidature Paris 2024, candidat à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’été en 2024. Paris étant en concurrence avec Rome, Budapest et Los Angeles. Candidature qu’il a portée jusqu’au succès final, en septembre 2017. Après l’obtention des Jeux par Paris, il laisse au palois Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë, le soin de diriger seul le Comité d’organisation des JO 2024. Il en devient le président d’honneur. Nommé officier de la Légion d’honneur en 2006, il a été élevé au rang de commandeur en 2016 par François Hollande à l’Élysée. Il avait par ailleurs été décoré de l’ordre du Mérite néo-zélandais en 2006. Le 3 novembre 2019, World Rugby lui remet le Trophée Vernon Pugh, une des plus prestigieuses récompenses, pour service distingué. Très attaché à ses racines bigourdanes, ce provincial expatrié repart toujours chez lui, à Louit près de Tarbes, un village de 185 habitants, presque à mi-chemin de Lizos, où est né son père douanier comme lui, et de Mascaras la commune de sa mère. Ses grands-parents étaient agriculteurs. Premier adjoint au maire, il habite la rue principale, baptisée rue de l’Ovalie à son initiative. Sa maison est une ferme achetée en ruine et qu’il a retapée avec son bureau installé dans l’ancien grenier à foin. « Ce pays chaleureux est mon refuge » dit-il toujours. Il grimpe le Tourmalet à vélo, chasse la palombe et cueille les champignons, ses "passions rurales". Grâce à son métier il a eu le privilège de rencontrer Salvador Dalí chez lui à Port Lligat, qui lui avait dédicacé un livre en le dessinant en Don Quichotte et en 1995 à Johannesbourg, il remit le trophée de la Coupe du monde de rugby à Nelson Mandela. Deux rencontres prestigieuses, qui ont marqué sa vie professionnelle et sportive. En décembre 2013, il assista aux obsèques de Nelson Mandela en compagnie de Morne du Plessis, François Pienaar et Jean de Villiers, des joueurs qui avaient marqué la sélection sud-africaine de rugby. Ancien douanier, habile diplomate du sport international, qui parle parfaitement l’anglais et l’espagnol, homme de pouvoir adoubé par les politiques, son bilan est implacable : cinq mandats à la FFR, deux à la tête de World Rugby, l’organisation de la Coupe du monde 2007 en France, l’introduction du rugby à 7 au programme olympique, l’organisation des Jeux olympiques de 2024 à Paris. Chantre de la professionnalisation du rugby qu’il a impulsée en France, il s’efforça d’élargir l’audience et la pratique de l’ovalie à travers le monde. Grand dirigeant du monde sportif français, il tourna la dernière page de son extraordinaire aventure rugbystique en 2016, longue de plus de 50 ans, en forme d’apothéose, pour se consacrer désormais à fond à la candidature de Paris pour les Jeux olympiques de 2024. L’aboutissement d’une carrière passée sur les terrains et dans les instances mondiales. Mais si à plus de 70 ans, il disait vouloir prendre du recul, il resta hyper actif au sein du comité d’organisation des Jeux de 2024, comme le principal artisan du succès de la capitale tricolore. Au-delà des hautes fonctions qu’il a assumées, il sut toujours rester un homme simple, amoureux de ses chères Pyrénées, des montagnes, des traditions et des chants bigourdans. Son ambition de toujours, c’était de revenir vivre à Louit, au plus grand bonheur de sa famille, de son épouse Jackie. Il est décédé le mardi 2 mai 2023, à l'âge de 75 ans, des suites d'une longue maladie. Ses obsèques ont été célébrées le mardi 9 mai 2023 à la cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède de Tarbes. Il a été inhumé au cimetière de Louit, son village natal des Hautes-Pyrénées.
Bernard LAPASSET, né le 20 octobre 1947 à Tarbes, sur les terres de l’ovalie française, est un haut dirigeant du monde sportif. Licencié en droit et sorti major de l’école des douanes en 1969, il sera directeur interrégional honoraire des douanes et droits indirects. Il est marié et père de trois enfants. Comme joueur au poste de deuxième ligne de rugby à XV, il est champion de France juniors Reichel avec l’US Agenais en 1967 dans la catégorie des moins de 20 ans, puis en 1983 champion de France corporatif avec l’US Douanes de Paris. Président du Comité régional de rugby en Île-de-France de 1988 à 1991. Secrétaire général de la Fédération française de rugby à XV en 1991, il est élu président en décembre 1991 jusqu’à mai 2008, en remplacement d’Albert Ferrasse dont il avait été "la petite main", lui écrivant ses discours. En 2004, il est élu président du Comité d’organisation de la Coupe du monde de rugby à XV en France. En 2007, il décroche l’organisation en France de la Coupe du monde de rugby. De 1995 à 1996 puis à nouveau de 2008 à 2016, il est élu président de l’International Rugby Board (IRB), organisme qui gère le rugby au niveau mondial et compte 118 pays membres. En 2014, sous sa présidence l’IRB deviendra le World Rugby. Président du Comité de candidature du rugby à 7 aux Jeux olympiques, il fait entrer en octobre 2009 le rugby à 7 au programme olympique d’été de Rio en 2016 et de Tokyo en 2020. De 1992 à 2009, il est vice-président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). À l’origine de la candidature de Paris aux Jeux olympiques de 2024, il a été co-président du Comité de candidature Paris 2024, candidat à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’été en 2024. Paris étant en concurrence avec Rome, Budapest et Los Angeles. Candidature qu’il a portée jusqu’au succès final, en septembre 2017. Après l’obtention des Jeux par Paris, il laisse au palois Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë, le soin de diriger seul le Comité d’organisation des JO 2024. Il en devient le président d’honneur. Nommé officier de la Légion d’honneur en 2006, il a été élevé au rang de commandeur en 2016 par François Hollande à l’Élysée. Il avait par ailleurs été décoré de l’ordre du Mérite néo-zélandais en 2006. Le 3 novembre 2019, World Rugby lui remet le Trophée Vernon Pugh, une des plus prestigieuses récompenses, pour service distingué. Très attaché à ses racines bigourdanes, ce provincial expatrié repart toujours chez lui, à Louit près de Tarbes, un village de 185 habitants, presque à mi-chemin de Lizos, où est né son père douanier comme lui, et de Mascaras la commune de sa mère. Ses grands-parents étaient agriculteurs. Premier adjoint au maire, il habite la rue principale, baptisée rue de l’Ovalie à son initiative. Sa maison est une ferme achetée en ruine et qu’il a retapée avec son bureau installé dans l’ancien grenier à foin. « Ce pays chaleureux est mon refuge » dit-il toujours. Il grimpe le Tourmalet à vélo, chasse la palombe et cueille les champignons, ses "passions rurales". Grâce à son métier il a eu le privilège de rencontrer Salvador Dalí chez lui à Port Lligat, qui lui avait dédicacé un livre en le dessinant en Don Quichotte et en 1995 à Johannesbourg, il remit le trophée de la Coupe du monde de rugby à Nelson Mandela. Deux rencontres prestigieuses, qui ont marqué sa vie professionnelle et sportive. En décembre 2013, il assista aux obsèques de Nelson Mandela en compagnie de Morne du Plessis, François Pienaar et Jean de Villiers, des joueurs qui avaient marqué la sélection sud-africaine de rugby. Ancien douanier, habile diplomate du sport international, qui parle parfaitement l’anglais et l’espagnol, homme de pouvoir adoubé par les politiques, son bilan est implacable : cinq mandats à la FFR, deux à la tête de World Rugby, l’organisation de la Coupe du monde 2007 en France, l’introduction du rugby à 7 au programme olympique, l’organisation des Jeux olympiques de 2024 à Paris. Chantre de la professionnalisation du rugby qu’il a impulsée en France, il s’efforça d’élargir l’audience et la pratique de l’ovalie à travers le monde. Grand dirigeant du monde sportif français, il tourna la dernière page de son extraordinaire aventure rugbystique en 2016, longue de plus de 50 ans, en forme d’apothéose, pour se consacrer désormais à fond à la candidature de Paris pour les Jeux olympiques de 2024. L’aboutissement d’une carrière passée sur les terrains et dans les instances mondiales. Mais si à plus de 70 ans, il disait vouloir prendre du recul, il resta hyper actif au sein du comité d’organisation des Jeux de 2024, comme le principal artisan du succès de la capitale tricolore. Au-delà des hautes fonctions qu’il a assumées, il sut toujours rester un homme simple, amoureux de ses chères Pyrénées, des montagnes, des traditions et des chants bigourdans. Son ambition de toujours, c’était de revenir vivre à Louit, au plus grand bonheur de sa famille, de son épouse Jackie. Il est décédé le mardi 2 mai 2023, à l'âge de 75 ans, des suites d'une longue maladie. Ses obsèques ont été célébrées le mardi 9 mai 2023 à la cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède de Tarbes. Il a été inhumé au cimetière de Louit, son village natal des Hautes-Pyrénées.
 Bernard LAPASSET, né le 20 octobre 1947 à Tarbes, sur les terres de l’ovalie française, est un haut dirigeant du monde sportif. Licencié en droit et sorti major de l’école des douanes en 1969, il sera directeur interrégional honoraire des douanes et droits indirects. Il est marié et père de trois enfants. Comme joueur au poste de deuxième ligne de rugby à XV, il est champion de France juniors Reichel avec l’US Agenais en 1967 dans la catégorie des moins de 20 ans, puis en 1983 champion de France corporatif avec l’US Douanes de Paris. Président du Comité régional de rugby en Île-de-France de 1988 à 1991. Secrétaire général de la Fédération française de rugby à XV en 1991, il est élu président en décembre 1991 jusqu’à mai 2008, en remplacement d’Albert Ferrasse dont il avait été "la petite main", lui écrivant ses discours. En 2004, il est élu président du Comité d’organisation de la Coupe du monde de rugby à XV en France. En 2007, il décroche l’organisation en France de la Coupe du monde de rugby. De 1995 à 1996 puis à nouveau de 2008 à 2016, il est élu président de l’International Rugby Board (IRB), organisme qui gère le rugby au niveau mondial et compte 118 pays membres. En 2014, sous sa présidence l’IRB deviendra le World Rugby. Président du Comité de candidature du rugby à 7 aux Jeux olympiques, il fait entrer en octobre 2009 le rugby à 7 au programme olympique d’été de Rio en 2016 et de Tokyo en 2020. De 1992 à 2009, il est vice-président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). À l’origine de la candidature de Paris aux Jeux olympiques de 2024, il a été co-président du Comité de candidature Paris 2024, candidat à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’été en 2024. Paris étant en concurrence avec Rome, Budapest et Los Angeles. Candidature qu’il a portée jusqu’au succès final, en septembre 2017. Après l’obtention des Jeux par Paris, il laisse au palois Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë, le soin de diriger seul le Comité d’organisation des JO 2024. Il en devient le président d’honneur. Nommé officier de la Légion d’honneur en 2006, il a été élevé au rang de commandeur en 2016 par François Hollande à l’Élysée. Il avait par ailleurs été décoré de l’ordre du Mérite néo-zélandais en 2006. Le 3 novembre 2019, World Rugby lui remet le Trophée Vernon Pugh, une des plus prestigieuses récompenses, pour service distingué. Très attaché à ses racines bigourdanes, ce provincial expatrié repart toujours chez lui, à Louit près de Tarbes, un village de 185 habitants, presque à mi-chemin de Lizos, où est né son père douanier comme lui, et de Mascaras la commune de sa mère. Ses grands-parents étaient agriculteurs. Premier adjoint au maire, il habite la rue principale, baptisée rue de l’Ovalie à son initiative. Sa maison est une ferme achetée en ruine et qu’il a retapée avec son bureau installé dans l’ancien grenier à foin. « Ce pays chaleureux est mon refuge » dit-il toujours. Il grimpe le Tourmalet à vélo, chasse la palombe et cueille les champignons, ses "passions rurales". Grâce à son métier il a eu le privilège de rencontrer Salvador Dalí chez lui à Port Lligat, qui lui avait dédicacé un livre en le dessinant en Don Quichotte et en 1995 à Johannesbourg, il remit le trophée de la Coupe du monde de rugby à Nelson Mandela. Deux rencontres prestigieuses, qui ont marqué sa vie professionnelle et sportive. En décembre 2013, il assista aux obsèques de Nelson Mandela en compagnie de Morne du Plessis, François Pienaar et Jean de Villiers, des joueurs qui avaient marqué la sélection sud-africaine de rugby. Ancien douanier, habile diplomate du sport international, qui parle parfaitement l’anglais et l’espagnol, homme de pouvoir adoubé par les politiques, son bilan est implacable : cinq mandats à la FFR, deux à la tête de World Rugby, l’organisation de la Coupe du monde 2007 en France, l’introduction du rugby à 7 au programme olympique, l’organisation des Jeux olympiques de 2024 à Paris. Chantre de la professionnalisation du rugby qu’il a impulsée en France, il s’efforça d’élargir l’audience et la pratique de l’ovalie à travers le monde. Grand dirigeant du monde sportif français, il tourna la dernière page de son extraordinaire aventure rugbystique en 2016, longue de plus de 50 ans, en forme d’apothéose, pour se consacrer désormais à fond à la candidature de Paris pour les Jeux olympiques de 2024. L’aboutissement d’une carrière passée sur les terrains et dans les instances mondiales. Mais si à plus de 70 ans, il disait vouloir prendre du recul, il resta hyper actif au sein du comité d’organisation des Jeux de 2024, comme le principal artisan du succès de la capitale tricolore. Au-delà des hautes fonctions qu’il a assumées, il sut toujours rester un homme simple, amoureux de ses chères Pyrénées, des montagnes, des traditions et des chants bigourdans. Son ambition de toujours, c’était de revenir vivre à Louit, au plus grand bonheur de sa famille, de son épouse Jackie. Il est décédé le mardi 2 mai 2023, à l'âge de 75 ans, des suites d'une longue maladie. Ses obsèques ont été célébrées le mardi 9 mai 2023 à la cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède de Tarbes. Il a été inhumé au cimetière de Louit, son village natal des Hautes-Pyrénées.
Bernard LAPASSET, né le 20 octobre 1947 à Tarbes, sur les terres de l’ovalie française, est un haut dirigeant du monde sportif. Licencié en droit et sorti major de l’école des douanes en 1969, il sera directeur interrégional honoraire des douanes et droits indirects. Il est marié et père de trois enfants. Comme joueur au poste de deuxième ligne de rugby à XV, il est champion de France juniors Reichel avec l’US Agenais en 1967 dans la catégorie des moins de 20 ans, puis en 1983 champion de France corporatif avec l’US Douanes de Paris. Président du Comité régional de rugby en Île-de-France de 1988 à 1991. Secrétaire général de la Fédération française de rugby à XV en 1991, il est élu président en décembre 1991 jusqu’à mai 2008, en remplacement d’Albert Ferrasse dont il avait été "la petite main", lui écrivant ses discours. En 2004, il est élu président du Comité d’organisation de la Coupe du monde de rugby à XV en France. En 2007, il décroche l’organisation en France de la Coupe du monde de rugby. De 1995 à 1996 puis à nouveau de 2008 à 2016, il est élu président de l’International Rugby Board (IRB), organisme qui gère le rugby au niveau mondial et compte 118 pays membres. En 2014, sous sa présidence l’IRB deviendra le World Rugby. Président du Comité de candidature du rugby à 7 aux Jeux olympiques, il fait entrer en octobre 2009 le rugby à 7 au programme olympique d’été de Rio en 2016 et de Tokyo en 2020. De 1992 à 2009, il est vice-président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF). À l’origine de la candidature de Paris aux Jeux olympiques de 2024, il a été co-président du Comité de candidature Paris 2024, candidat à l’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’été en 2024. Paris étant en concurrence avec Rome, Budapest et Los Angeles. Candidature qu’il a portée jusqu’au succès final, en septembre 2017. Après l’obtention des Jeux par Paris, il laisse au palois Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë, le soin de diriger seul le Comité d’organisation des JO 2024. Il en devient le président d’honneur. Nommé officier de la Légion d’honneur en 2006, il a été élevé au rang de commandeur en 2016 par François Hollande à l’Élysée. Il avait par ailleurs été décoré de l’ordre du Mérite néo-zélandais en 2006. Le 3 novembre 2019, World Rugby lui remet le Trophée Vernon Pugh, une des plus prestigieuses récompenses, pour service distingué. Très attaché à ses racines bigourdanes, ce provincial expatrié repart toujours chez lui, à Louit près de Tarbes, un village de 185 habitants, presque à mi-chemin de Lizos, où est né son père douanier comme lui, et de Mascaras la commune de sa mère. Ses grands-parents étaient agriculteurs. Premier adjoint au maire, il habite la rue principale, baptisée rue de l’Ovalie à son initiative. Sa maison est une ferme achetée en ruine et qu’il a retapée avec son bureau installé dans l’ancien grenier à foin. « Ce pays chaleureux est mon refuge » dit-il toujours. Il grimpe le Tourmalet à vélo, chasse la palombe et cueille les champignons, ses "passions rurales". Grâce à son métier il a eu le privilège de rencontrer Salvador Dalí chez lui à Port Lligat, qui lui avait dédicacé un livre en le dessinant en Don Quichotte et en 1995 à Johannesbourg, il remit le trophée de la Coupe du monde de rugby à Nelson Mandela. Deux rencontres prestigieuses, qui ont marqué sa vie professionnelle et sportive. En décembre 2013, il assista aux obsèques de Nelson Mandela en compagnie de Morne du Plessis, François Pienaar et Jean de Villiers, des joueurs qui avaient marqué la sélection sud-africaine de rugby. Ancien douanier, habile diplomate du sport international, qui parle parfaitement l’anglais et l’espagnol, homme de pouvoir adoubé par les politiques, son bilan est implacable : cinq mandats à la FFR, deux à la tête de World Rugby, l’organisation de la Coupe du monde 2007 en France, l’introduction du rugby à 7 au programme olympique, l’organisation des Jeux olympiques de 2024 à Paris. Chantre de la professionnalisation du rugby qu’il a impulsée en France, il s’efforça d’élargir l’audience et la pratique de l’ovalie à travers le monde. Grand dirigeant du monde sportif français, il tourna la dernière page de son extraordinaire aventure rugbystique en 2016, longue de plus de 50 ans, en forme d’apothéose, pour se consacrer désormais à fond à la candidature de Paris pour les Jeux olympiques de 2024. L’aboutissement d’une carrière passée sur les terrains et dans les instances mondiales. Mais si à plus de 70 ans, il disait vouloir prendre du recul, il resta hyper actif au sein du comité d’organisation des Jeux de 2024, comme le principal artisan du succès de la capitale tricolore. Au-delà des hautes fonctions qu’il a assumées, il sut toujours rester un homme simple, amoureux de ses chères Pyrénées, des montagnes, des traditions et des chants bigourdans. Son ambition de toujours, c’était de revenir vivre à Louit, au plus grand bonheur de sa famille, de son épouse Jackie. Il est décédé le mardi 2 mai 2023, à l'âge de 75 ans, des suites d'une longue maladie. Ses obsèques ont été célébrées le mardi 9 mai 2023 à la cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède de Tarbes. Il a été inhumé au cimetière de Louit, son village natal des Hautes-Pyrénées.LARENG Louis (1923-2019)
Professeur agrégé de médecine spécialisé en anesthésie-réanimation, fondateur du Samu et de la télémédecine
 Louis LARENG, né le 8 avril 1923 à Ayzac-Ost et décédé le 3 novembre 2019 à Toulouse, fut l'un des grands visionnaires de la médecine du XXème siècle. Il est le créateur en 1968 du premier service d’aide médicale d’urgence (SAMU) de France à Toulouse. À la mort de sa mère (il a deux ans) malade de la tuberculose, il est élevé par sa tante, préparatrice en pharmacie à Argelès-Gazost et qui va lui faire prendre goût à la médecine et jouer un rôle déterminant dans sa vocation. Éduqué dans la foi catholique, il aurait pu, comme d’autres garçons de milieu modeste, suivre l’enseignement du petit séminaire de Saint-Pé-de-Bigorre pour enfiler la soutane. Mais son maître d’école, l’arrache à l’Église et obtient la bourse départementale qui lui permet, une fois passé son certificat d’études, d’être admis au lycée Théophile Gautier de Tarbes. Et voilà comment il va se retrouver ensuite en faculté de médecine, à Toulouse. Sa tante l’aurait bien vu revenir au village et devenir médecin de famille à Argelès-Gazost, mais ayant été reçu à l’internat, s’ouvre alors pour lui une carrière universitaire toute tracée : assistant, chef de clinique, agrégé, professeur. Il se spécialise dans la réanimation et l’anesthésie. Au début des années 1960, pour faire face à une épidémie annoncée de poliomyélite, l’État avait décidé de former de jeunes médecins aux techniques de réanimation respiratoire. Il devient le responsable du centre de réanimation hospitalier de Toulouse. Mais l’épidémie n’a pas lieu et le centre n’accueille aucun patient. Qu’à cela ne tienne, le jeune anesthésiste a une idée originale : reconvertir le centre au profit des accidentés de la route dont le nombre croît au fur et à mesure que les ménages s’équipent en automobiles. Mais les praticiens refusent de sortir des murs, car il y avait aussi une loi qui interdisait aux médecins des hôpitaux de sortir de leurs murs. Et certains pensaient qu'il était dangereux pour les médecins de se rendre sur les lieux d'accidents. Alors face à l’opposition des mandarins, il brave les interdictions et contourne les obstacles. Peu importe les sanctions auxquelles il s’expose. Il a prêté serment et il veut sauver des vies quoi qu’il lui en coûte. Il a le soutien d’une partie du personnel, des infirmiers, des brancardiers, qui l’aident à préparer le matériel médical d’urgence et du concierge de l’hôpital qui l’accompagnait à toute heure du jour ou de la nuit. Tout cela se faisait en cachette, à Toulouse. "Je couchais à la police et je partais sur l’accident dans le panier à salade". Son entêtement finit par payer. Non seulement il n’est pas sanctionné alors même qu’il avait fini par être convoqué par le conseil de discipline - en sauvant la vie du fils d’un grand "ponte" accidenté en rentrant de boîte de nuit, il achève de convaincre ses pairs de l’utilité de son combat - mais surtout il obtient enfin l’autorisation d’expérimenter officiellement son projet. Et c’est dans la Ville rose que naît véritablement l’hôpital hors les murs en ce milieu des années 1960. À l’été 1968, le conseil d’administration du CHU de Toulouse crée officiellement le premier service d’aide médicale d’urgence (SAMU) de France. L’année suivante, une circulaire sanctionne la naissance de ce "service d’intérêt général". Auprès de Simone Veil, alors ministre de la Santé, il plaide pour réorganiser partout le transport sanitaire. En 1978, il obtient du secrétaire d’État aux postes et télécommunications que le "15" soit attribué aux urgences médicales. En 1952, dans la petite chapelle de Quint, il épouse Marie-Blanche, étudiante en médecine, qui mènera une brillante carrière de professeure en bactériologie. Le couple aura trois enfants. Professeur agrégé de médecine, spécialiste en « anesthésie réanimation » au CHU de Toulouse, homme politique français, il est le fondateur du service d’aide médicale d’urgence (SAMU). Le premier SAMU officiel, qui va s’occuper de l’intervention préhospitalière des unités mobiles hospitalières (UMH), fut créé le 16 juillet 1968 à Toulouse par le Pr Louis Lareng (président-fondateur en 1972), afin de coordonner les efforts médicaux entre les équipes préhospitalières (SMUR) et les services d’urgence hospitaliers. L’idée-force du SAMU était de transporter l’hôpital au pied du platane. « On y trouvait la police, les pompiers, mais pas l’hôpital », dira-t-il. Et surtout un autre élément fondamental, c’est la régulation. Au bout du fil, c’est un médecin qui décide quel type de secours il faut envoyer, en fonction de la gravité de l’accident et des moyens disponibles. Comme député, en 1986, il réussit à faire passer « l’amendement Lareng », qui fut adopté à l’unanimité, généralisant les SAMU dans toute la France et ce malgré l’opposition farouche du corps médical et l’hostilité du gouvernement. Il se souvient des "ambulances brûlant place de la Concorde" face à l’Assemblée nationale, lorsqu’il tente de faire voter sa loi. Mais sa ténacité, sa détermination furent enfin récompensées. Lors de la promotion du 14 juillet 2016, il a été nommé Grand officier de la Légion d’honneur par le Président de la République sur proposition du Premier ministre. Commandeur des Palmes académiques en 1976, officier de l’Ordre national du mérite en 1981, puis commandeur dans l’Ordre national de la Légion d’honneur en 1993, médaille échelon Grand Or de la Protection civile, Grand Prix en Health Information Technologies, il fut le premier professeur d’anesthésie-réanimation nommé en France tout en étant parallèlement médecin à Purpan. Dès 1955, il eut donc l’idée d’amener "le médecin au pied de l’arbre" pour sauver des vies en réduisant le temps nécessaire à la prise en charge médicale des personnes en détresse. Homme politique engagé à gauche, il sera conseiller municipal d’Ayzac-Ost dès 1951 puis maire de 1965 à 1977, conseiller municipal de Toulouse de 1983 à 1995, député PS de la 3e circonscription de la Haute-Garonne de 1981 à 1986, conseiller régional PS de Midi-Pyrénées de 1986 à 1992, délégué au district du Grand Toulouse de 1992 à 1995. De 1970 à 1976, il fut aussi président de l’université Toulouse III Paul-Sabatier. Il est aussi président de la Société Européenne de TéléMédecine et e-S@nté, et membre du comité exécutif de la société internationale de télémédecine. C’est en 1989 qu’il créé l’Institut européen de télémédecine, dont il est encore le président. Et c’est au Canada qu’il a découvert la télémédecine, où elle s'était développée pour que toute la population, répartie dans les grands espaces faiblement peuplés, puisse avoir accès aux soins. L’intérêt étant qu’on puisse discuter du cas d’un malade du fin fond des Pyrénées entre son généraliste, son radiologue et le chirurgien du CHU, sans que personne ne se déplace. "On peut soigner à distance en amenant le conseil médical, l’expertise en des lieux où il manque de médecins ou en remplaçant le médecin par un robot". « La télémédecine n’est pas un outil, c’est un acte médical à distance ». Aujourd’hui dans la lutte contre les déserts médicaux et un accès aux soins à tous figurent en bonne place la télémédecine et la téléconsultation. Sans doute une nouvelle page de la médecine qui est en train de se tourner, et dont il est un des pionniers. En 1991, il sera président de la Fédération nationale de protection civile. Depuis 2012, il existe le Prix Louis Lareng. Il a été créé au Luxembourg et récompense l’ensemble de la carrière du professeur. Ce prix sera attribué par la suite à des personnes ayant œuvré dans le domaine de la télémédecine et de la e-santé. Le bâtiment-forum de l’Université de Rangueil porte son nom ainsi que le nouveau bâtiment de l’hôpital Purpan qui regroupe tous les services du SAMU. Grande figure de la médecine toulousaine, grand visionnaire, travailleur infatigable et citoyen engagé, il a consacré sa vie à organiser les secours pour ses concitoyens et à défendre l’égalité des chances devant l’accès aux soins. Il est décrit comme un homme passionné et chaleureux, proche de chacun, avec un accent entre mille reconnaissable dont les « r » roulent comme les torrents de ses Pyrénées et profondément attaché à sa terre natale. Homme fidèle à ses racines, à ses convictions, il restera un des grands hommes de Toulouse, au service de la Médecine et des valeurs de la République française, et qui aura mené une carrière professionnelle exceptionnelle. À 95 ans, toujours aussi passionné par le monde médical, il avait été nommé président d'honneur de l'Observatoire régional de l'innovation et des usages du numérique en santé. Décédé le dimanche 3 novembre 2019 à l’âge de 96 ans, Louis Lareng a été inhumé le 7 novembre dans l’intimité à Ayzac-Ost, son village natal des Hautes-Pyrénées.
Louis LARENG, né le 8 avril 1923 à Ayzac-Ost et décédé le 3 novembre 2019 à Toulouse, fut l'un des grands visionnaires de la médecine du XXème siècle. Il est le créateur en 1968 du premier service d’aide médicale d’urgence (SAMU) de France à Toulouse. À la mort de sa mère (il a deux ans) malade de la tuberculose, il est élevé par sa tante, préparatrice en pharmacie à Argelès-Gazost et qui va lui faire prendre goût à la médecine et jouer un rôle déterminant dans sa vocation. Éduqué dans la foi catholique, il aurait pu, comme d’autres garçons de milieu modeste, suivre l’enseignement du petit séminaire de Saint-Pé-de-Bigorre pour enfiler la soutane. Mais son maître d’école, l’arrache à l’Église et obtient la bourse départementale qui lui permet, une fois passé son certificat d’études, d’être admis au lycée Théophile Gautier de Tarbes. Et voilà comment il va se retrouver ensuite en faculté de médecine, à Toulouse. Sa tante l’aurait bien vu revenir au village et devenir médecin de famille à Argelès-Gazost, mais ayant été reçu à l’internat, s’ouvre alors pour lui une carrière universitaire toute tracée : assistant, chef de clinique, agrégé, professeur. Il se spécialise dans la réanimation et l’anesthésie. Au début des années 1960, pour faire face à une épidémie annoncée de poliomyélite, l’État avait décidé de former de jeunes médecins aux techniques de réanimation respiratoire. Il devient le responsable du centre de réanimation hospitalier de Toulouse. Mais l’épidémie n’a pas lieu et le centre n’accueille aucun patient. Qu’à cela ne tienne, le jeune anesthésiste a une idée originale : reconvertir le centre au profit des accidentés de la route dont le nombre croît au fur et à mesure que les ménages s’équipent en automobiles. Mais les praticiens refusent de sortir des murs, car il y avait aussi une loi qui interdisait aux médecins des hôpitaux de sortir de leurs murs. Et certains pensaient qu'il était dangereux pour les médecins de se rendre sur les lieux d'accidents. Alors face à l’opposition des mandarins, il brave les interdictions et contourne les obstacles. Peu importe les sanctions auxquelles il s’expose. Il a prêté serment et il veut sauver des vies quoi qu’il lui en coûte. Il a le soutien d’une partie du personnel, des infirmiers, des brancardiers, qui l’aident à préparer le matériel médical d’urgence et du concierge de l’hôpital qui l’accompagnait à toute heure du jour ou de la nuit. Tout cela se faisait en cachette, à Toulouse. "Je couchais à la police et je partais sur l’accident dans le panier à salade". Son entêtement finit par payer. Non seulement il n’est pas sanctionné alors même qu’il avait fini par être convoqué par le conseil de discipline - en sauvant la vie du fils d’un grand "ponte" accidenté en rentrant de boîte de nuit, il achève de convaincre ses pairs de l’utilité de son combat - mais surtout il obtient enfin l’autorisation d’expérimenter officiellement son projet. Et c’est dans la Ville rose que naît véritablement l’hôpital hors les murs en ce milieu des années 1960. À l’été 1968, le conseil d’administration du CHU de Toulouse crée officiellement le premier service d’aide médicale d’urgence (SAMU) de France. L’année suivante, une circulaire sanctionne la naissance de ce "service d’intérêt général". Auprès de Simone Veil, alors ministre de la Santé, il plaide pour réorganiser partout le transport sanitaire. En 1978, il obtient du secrétaire d’État aux postes et télécommunications que le "15" soit attribué aux urgences médicales. En 1952, dans la petite chapelle de Quint, il épouse Marie-Blanche, étudiante en médecine, qui mènera une brillante carrière de professeure en bactériologie. Le couple aura trois enfants. Professeur agrégé de médecine, spécialiste en « anesthésie réanimation » au CHU de Toulouse, homme politique français, il est le fondateur du service d’aide médicale d’urgence (SAMU). Le premier SAMU officiel, qui va s’occuper de l’intervention préhospitalière des unités mobiles hospitalières (UMH), fut créé le 16 juillet 1968 à Toulouse par le Pr Louis Lareng (président-fondateur en 1972), afin de coordonner les efforts médicaux entre les équipes préhospitalières (SMUR) et les services d’urgence hospitaliers. L’idée-force du SAMU était de transporter l’hôpital au pied du platane. « On y trouvait la police, les pompiers, mais pas l’hôpital », dira-t-il. Et surtout un autre élément fondamental, c’est la régulation. Au bout du fil, c’est un médecin qui décide quel type de secours il faut envoyer, en fonction de la gravité de l’accident et des moyens disponibles. Comme député, en 1986, il réussit à faire passer « l’amendement Lareng », qui fut adopté à l’unanimité, généralisant les SAMU dans toute la France et ce malgré l’opposition farouche du corps médical et l’hostilité du gouvernement. Il se souvient des "ambulances brûlant place de la Concorde" face à l’Assemblée nationale, lorsqu’il tente de faire voter sa loi. Mais sa ténacité, sa détermination furent enfin récompensées. Lors de la promotion du 14 juillet 2016, il a été nommé Grand officier de la Légion d’honneur par le Président de la République sur proposition du Premier ministre. Commandeur des Palmes académiques en 1976, officier de l’Ordre national du mérite en 1981, puis commandeur dans l’Ordre national de la Légion d’honneur en 1993, médaille échelon Grand Or de la Protection civile, Grand Prix en Health Information Technologies, il fut le premier professeur d’anesthésie-réanimation nommé en France tout en étant parallèlement médecin à Purpan. Dès 1955, il eut donc l’idée d’amener "le médecin au pied de l’arbre" pour sauver des vies en réduisant le temps nécessaire à la prise en charge médicale des personnes en détresse. Homme politique engagé à gauche, il sera conseiller municipal d’Ayzac-Ost dès 1951 puis maire de 1965 à 1977, conseiller municipal de Toulouse de 1983 à 1995, député PS de la 3e circonscription de la Haute-Garonne de 1981 à 1986, conseiller régional PS de Midi-Pyrénées de 1986 à 1992, délégué au district du Grand Toulouse de 1992 à 1995. De 1970 à 1976, il fut aussi président de l’université Toulouse III Paul-Sabatier. Il est aussi président de la Société Européenne de TéléMédecine et e-S@nté, et membre du comité exécutif de la société internationale de télémédecine. C’est en 1989 qu’il créé l’Institut européen de télémédecine, dont il est encore le président. Et c’est au Canada qu’il a découvert la télémédecine, où elle s'était développée pour que toute la population, répartie dans les grands espaces faiblement peuplés, puisse avoir accès aux soins. L’intérêt étant qu’on puisse discuter du cas d’un malade du fin fond des Pyrénées entre son généraliste, son radiologue et le chirurgien du CHU, sans que personne ne se déplace. "On peut soigner à distance en amenant le conseil médical, l’expertise en des lieux où il manque de médecins ou en remplaçant le médecin par un robot". « La télémédecine n’est pas un outil, c’est un acte médical à distance ». Aujourd’hui dans la lutte contre les déserts médicaux et un accès aux soins à tous figurent en bonne place la télémédecine et la téléconsultation. Sans doute une nouvelle page de la médecine qui est en train de se tourner, et dont il est un des pionniers. En 1991, il sera président de la Fédération nationale de protection civile. Depuis 2012, il existe le Prix Louis Lareng. Il a été créé au Luxembourg et récompense l’ensemble de la carrière du professeur. Ce prix sera attribué par la suite à des personnes ayant œuvré dans le domaine de la télémédecine et de la e-santé. Le bâtiment-forum de l’Université de Rangueil porte son nom ainsi que le nouveau bâtiment de l’hôpital Purpan qui regroupe tous les services du SAMU. Grande figure de la médecine toulousaine, grand visionnaire, travailleur infatigable et citoyen engagé, il a consacré sa vie à organiser les secours pour ses concitoyens et à défendre l’égalité des chances devant l’accès aux soins. Il est décrit comme un homme passionné et chaleureux, proche de chacun, avec un accent entre mille reconnaissable dont les « r » roulent comme les torrents de ses Pyrénées et profondément attaché à sa terre natale. Homme fidèle à ses racines, à ses convictions, il restera un des grands hommes de Toulouse, au service de la Médecine et des valeurs de la République française, et qui aura mené une carrière professionnelle exceptionnelle. À 95 ans, toujours aussi passionné par le monde médical, il avait été nommé président d'honneur de l'Observatoire régional de l'innovation et des usages du numérique en santé. Décédé le dimanche 3 novembre 2019 à l’âge de 96 ans, Louis Lareng a été inhumé le 7 novembre dans l’intimité à Ayzac-Ost, son village natal des Hautes-Pyrénées.
 Louis LARENG, né le 8 avril 1923 à Ayzac-Ost et décédé le 3 novembre 2019 à Toulouse, fut l'un des grands visionnaires de la médecine du XXème siècle. Il est le créateur en 1968 du premier service d’aide médicale d’urgence (SAMU) de France à Toulouse. À la mort de sa mère (il a deux ans) malade de la tuberculose, il est élevé par sa tante, préparatrice en pharmacie à Argelès-Gazost et qui va lui faire prendre goût à la médecine et jouer un rôle déterminant dans sa vocation. Éduqué dans la foi catholique, il aurait pu, comme d’autres garçons de milieu modeste, suivre l’enseignement du petit séminaire de Saint-Pé-de-Bigorre pour enfiler la soutane. Mais son maître d’école, l’arrache à l’Église et obtient la bourse départementale qui lui permet, une fois passé son certificat d’études, d’être admis au lycée Théophile Gautier de Tarbes. Et voilà comment il va se retrouver ensuite en faculté de médecine, à Toulouse. Sa tante l’aurait bien vu revenir au village et devenir médecin de famille à Argelès-Gazost, mais ayant été reçu à l’internat, s’ouvre alors pour lui une carrière universitaire toute tracée : assistant, chef de clinique, agrégé, professeur. Il se spécialise dans la réanimation et l’anesthésie. Au début des années 1960, pour faire face à une épidémie annoncée de poliomyélite, l’État avait décidé de former de jeunes médecins aux techniques de réanimation respiratoire. Il devient le responsable du centre de réanimation hospitalier de Toulouse. Mais l’épidémie n’a pas lieu et le centre n’accueille aucun patient. Qu’à cela ne tienne, le jeune anesthésiste a une idée originale : reconvertir le centre au profit des accidentés de la route dont le nombre croît au fur et à mesure que les ménages s’équipent en automobiles. Mais les praticiens refusent de sortir des murs, car il y avait aussi une loi qui interdisait aux médecins des hôpitaux de sortir de leurs murs. Et certains pensaient qu'il était dangereux pour les médecins de se rendre sur les lieux d'accidents. Alors face à l’opposition des mandarins, il brave les interdictions et contourne les obstacles. Peu importe les sanctions auxquelles il s’expose. Il a prêté serment et il veut sauver des vies quoi qu’il lui en coûte. Il a le soutien d’une partie du personnel, des infirmiers, des brancardiers, qui l’aident à préparer le matériel médical d’urgence et du concierge de l’hôpital qui l’accompagnait à toute heure du jour ou de la nuit. Tout cela se faisait en cachette, à Toulouse. "Je couchais à la police et je partais sur l’accident dans le panier à salade". Son entêtement finit par payer. Non seulement il n’est pas sanctionné alors même qu’il avait fini par être convoqué par le conseil de discipline - en sauvant la vie du fils d’un grand "ponte" accidenté en rentrant de boîte de nuit, il achève de convaincre ses pairs de l’utilité de son combat - mais surtout il obtient enfin l’autorisation d’expérimenter officiellement son projet. Et c’est dans la Ville rose que naît véritablement l’hôpital hors les murs en ce milieu des années 1960. À l’été 1968, le conseil d’administration du CHU de Toulouse crée officiellement le premier service d’aide médicale d’urgence (SAMU) de France. L’année suivante, une circulaire sanctionne la naissance de ce "service d’intérêt général". Auprès de Simone Veil, alors ministre de la Santé, il plaide pour réorganiser partout le transport sanitaire. En 1978, il obtient du secrétaire d’État aux postes et télécommunications que le "15" soit attribué aux urgences médicales. En 1952, dans la petite chapelle de Quint, il épouse Marie-Blanche, étudiante en médecine, qui mènera une brillante carrière de professeure en bactériologie. Le couple aura trois enfants. Professeur agrégé de médecine, spécialiste en « anesthésie réanimation » au CHU de Toulouse, homme politique français, il est le fondateur du service d’aide médicale d’urgence (SAMU). Le premier SAMU officiel, qui va s’occuper de l’intervention préhospitalière des unités mobiles hospitalières (UMH), fut créé le 16 juillet 1968 à Toulouse par le Pr Louis Lareng (président-fondateur en 1972), afin de coordonner les efforts médicaux entre les équipes préhospitalières (SMUR) et les services d’urgence hospitaliers. L’idée-force du SAMU était de transporter l’hôpital au pied du platane. « On y trouvait la police, les pompiers, mais pas l’hôpital », dira-t-il. Et surtout un autre élément fondamental, c’est la régulation. Au bout du fil, c’est un médecin qui décide quel type de secours il faut envoyer, en fonction de la gravité de l’accident et des moyens disponibles. Comme député, en 1986, il réussit à faire passer « l’amendement Lareng », qui fut adopté à l’unanimité, généralisant les SAMU dans toute la France et ce malgré l’opposition farouche du corps médical et l’hostilité du gouvernement. Il se souvient des "ambulances brûlant place de la Concorde" face à l’Assemblée nationale, lorsqu’il tente de faire voter sa loi. Mais sa ténacité, sa détermination furent enfin récompensées. Lors de la promotion du 14 juillet 2016, il a été nommé Grand officier de la Légion d’honneur par le Président de la République sur proposition du Premier ministre. Commandeur des Palmes académiques en 1976, officier de l’Ordre national du mérite en 1981, puis commandeur dans l’Ordre national de la Légion d’honneur en 1993, médaille échelon Grand Or de la Protection civile, Grand Prix en Health Information Technologies, il fut le premier professeur d’anesthésie-réanimation nommé en France tout en étant parallèlement médecin à Purpan. Dès 1955, il eut donc l’idée d’amener "le médecin au pied de l’arbre" pour sauver des vies en réduisant le temps nécessaire à la prise en charge médicale des personnes en détresse. Homme politique engagé à gauche, il sera conseiller municipal d’Ayzac-Ost dès 1951 puis maire de 1965 à 1977, conseiller municipal de Toulouse de 1983 à 1995, député PS de la 3e circonscription de la Haute-Garonne de 1981 à 1986, conseiller régional PS de Midi-Pyrénées de 1986 à 1992, délégué au district du Grand Toulouse de 1992 à 1995. De 1970 à 1976, il fut aussi président de l’université Toulouse III Paul-Sabatier. Il est aussi président de la Société Européenne de TéléMédecine et e-S@nté, et membre du comité exécutif de la société internationale de télémédecine. C’est en 1989 qu’il créé l’Institut européen de télémédecine, dont il est encore le président. Et c’est au Canada qu’il a découvert la télémédecine, où elle s'était développée pour que toute la population, répartie dans les grands espaces faiblement peuplés, puisse avoir accès aux soins. L’intérêt étant qu’on puisse discuter du cas d’un malade du fin fond des Pyrénées entre son généraliste, son radiologue et le chirurgien du CHU, sans que personne ne se déplace. "On peut soigner à distance en amenant le conseil médical, l’expertise en des lieux où il manque de médecins ou en remplaçant le médecin par un robot". « La télémédecine n’est pas un outil, c’est un acte médical à distance ». Aujourd’hui dans la lutte contre les déserts médicaux et un accès aux soins à tous figurent en bonne place la télémédecine et la téléconsultation. Sans doute une nouvelle page de la médecine qui est en train de se tourner, et dont il est un des pionniers. En 1991, il sera président de la Fédération nationale de protection civile. Depuis 2012, il existe le Prix Louis Lareng. Il a été créé au Luxembourg et récompense l’ensemble de la carrière du professeur. Ce prix sera attribué par la suite à des personnes ayant œuvré dans le domaine de la télémédecine et de la e-santé. Le bâtiment-forum de l’Université de Rangueil porte son nom ainsi que le nouveau bâtiment de l’hôpital Purpan qui regroupe tous les services du SAMU. Grande figure de la médecine toulousaine, grand visionnaire, travailleur infatigable et citoyen engagé, il a consacré sa vie à organiser les secours pour ses concitoyens et à défendre l’égalité des chances devant l’accès aux soins. Il est décrit comme un homme passionné et chaleureux, proche de chacun, avec un accent entre mille reconnaissable dont les « r » roulent comme les torrents de ses Pyrénées et profondément attaché à sa terre natale. Homme fidèle à ses racines, à ses convictions, il restera un des grands hommes de Toulouse, au service de la Médecine et des valeurs de la République française, et qui aura mené une carrière professionnelle exceptionnelle. À 95 ans, toujours aussi passionné par le monde médical, il avait été nommé président d'honneur de l'Observatoire régional de l'innovation et des usages du numérique en santé. Décédé le dimanche 3 novembre 2019 à l’âge de 96 ans, Louis Lareng a été inhumé le 7 novembre dans l’intimité à Ayzac-Ost, son village natal des Hautes-Pyrénées.
Louis LARENG, né le 8 avril 1923 à Ayzac-Ost et décédé le 3 novembre 2019 à Toulouse, fut l'un des grands visionnaires de la médecine du XXème siècle. Il est le créateur en 1968 du premier service d’aide médicale d’urgence (SAMU) de France à Toulouse. À la mort de sa mère (il a deux ans) malade de la tuberculose, il est élevé par sa tante, préparatrice en pharmacie à Argelès-Gazost et qui va lui faire prendre goût à la médecine et jouer un rôle déterminant dans sa vocation. Éduqué dans la foi catholique, il aurait pu, comme d’autres garçons de milieu modeste, suivre l’enseignement du petit séminaire de Saint-Pé-de-Bigorre pour enfiler la soutane. Mais son maître d’école, l’arrache à l’Église et obtient la bourse départementale qui lui permet, une fois passé son certificat d’études, d’être admis au lycée Théophile Gautier de Tarbes. Et voilà comment il va se retrouver ensuite en faculté de médecine, à Toulouse. Sa tante l’aurait bien vu revenir au village et devenir médecin de famille à Argelès-Gazost, mais ayant été reçu à l’internat, s’ouvre alors pour lui une carrière universitaire toute tracée : assistant, chef de clinique, agrégé, professeur. Il se spécialise dans la réanimation et l’anesthésie. Au début des années 1960, pour faire face à une épidémie annoncée de poliomyélite, l’État avait décidé de former de jeunes médecins aux techniques de réanimation respiratoire. Il devient le responsable du centre de réanimation hospitalier de Toulouse. Mais l’épidémie n’a pas lieu et le centre n’accueille aucun patient. Qu’à cela ne tienne, le jeune anesthésiste a une idée originale : reconvertir le centre au profit des accidentés de la route dont le nombre croît au fur et à mesure que les ménages s’équipent en automobiles. Mais les praticiens refusent de sortir des murs, car il y avait aussi une loi qui interdisait aux médecins des hôpitaux de sortir de leurs murs. Et certains pensaient qu'il était dangereux pour les médecins de se rendre sur les lieux d'accidents. Alors face à l’opposition des mandarins, il brave les interdictions et contourne les obstacles. Peu importe les sanctions auxquelles il s’expose. Il a prêté serment et il veut sauver des vies quoi qu’il lui en coûte. Il a le soutien d’une partie du personnel, des infirmiers, des brancardiers, qui l’aident à préparer le matériel médical d’urgence et du concierge de l’hôpital qui l’accompagnait à toute heure du jour ou de la nuit. Tout cela se faisait en cachette, à Toulouse. "Je couchais à la police et je partais sur l’accident dans le panier à salade". Son entêtement finit par payer. Non seulement il n’est pas sanctionné alors même qu’il avait fini par être convoqué par le conseil de discipline - en sauvant la vie du fils d’un grand "ponte" accidenté en rentrant de boîte de nuit, il achève de convaincre ses pairs de l’utilité de son combat - mais surtout il obtient enfin l’autorisation d’expérimenter officiellement son projet. Et c’est dans la Ville rose que naît véritablement l’hôpital hors les murs en ce milieu des années 1960. À l’été 1968, le conseil d’administration du CHU de Toulouse crée officiellement le premier service d’aide médicale d’urgence (SAMU) de France. L’année suivante, une circulaire sanctionne la naissance de ce "service d’intérêt général". Auprès de Simone Veil, alors ministre de la Santé, il plaide pour réorganiser partout le transport sanitaire. En 1978, il obtient du secrétaire d’État aux postes et télécommunications que le "15" soit attribué aux urgences médicales. En 1952, dans la petite chapelle de Quint, il épouse Marie-Blanche, étudiante en médecine, qui mènera une brillante carrière de professeure en bactériologie. Le couple aura trois enfants. Professeur agrégé de médecine, spécialiste en « anesthésie réanimation » au CHU de Toulouse, homme politique français, il est le fondateur du service d’aide médicale d’urgence (SAMU). Le premier SAMU officiel, qui va s’occuper de l’intervention préhospitalière des unités mobiles hospitalières (UMH), fut créé le 16 juillet 1968 à Toulouse par le Pr Louis Lareng (président-fondateur en 1972), afin de coordonner les efforts médicaux entre les équipes préhospitalières (SMUR) et les services d’urgence hospitaliers. L’idée-force du SAMU était de transporter l’hôpital au pied du platane. « On y trouvait la police, les pompiers, mais pas l’hôpital », dira-t-il. Et surtout un autre élément fondamental, c’est la régulation. Au bout du fil, c’est un médecin qui décide quel type de secours il faut envoyer, en fonction de la gravité de l’accident et des moyens disponibles. Comme député, en 1986, il réussit à faire passer « l’amendement Lareng », qui fut adopté à l’unanimité, généralisant les SAMU dans toute la France et ce malgré l’opposition farouche du corps médical et l’hostilité du gouvernement. Il se souvient des "ambulances brûlant place de la Concorde" face à l’Assemblée nationale, lorsqu’il tente de faire voter sa loi. Mais sa ténacité, sa détermination furent enfin récompensées. Lors de la promotion du 14 juillet 2016, il a été nommé Grand officier de la Légion d’honneur par le Président de la République sur proposition du Premier ministre. Commandeur des Palmes académiques en 1976, officier de l’Ordre national du mérite en 1981, puis commandeur dans l’Ordre national de la Légion d’honneur en 1993, médaille échelon Grand Or de la Protection civile, Grand Prix en Health Information Technologies, il fut le premier professeur d’anesthésie-réanimation nommé en France tout en étant parallèlement médecin à Purpan. Dès 1955, il eut donc l’idée d’amener "le médecin au pied de l’arbre" pour sauver des vies en réduisant le temps nécessaire à la prise en charge médicale des personnes en détresse. Homme politique engagé à gauche, il sera conseiller municipal d’Ayzac-Ost dès 1951 puis maire de 1965 à 1977, conseiller municipal de Toulouse de 1983 à 1995, député PS de la 3e circonscription de la Haute-Garonne de 1981 à 1986, conseiller régional PS de Midi-Pyrénées de 1986 à 1992, délégué au district du Grand Toulouse de 1992 à 1995. De 1970 à 1976, il fut aussi président de l’université Toulouse III Paul-Sabatier. Il est aussi président de la Société Européenne de TéléMédecine et e-S@nté, et membre du comité exécutif de la société internationale de télémédecine. C’est en 1989 qu’il créé l’Institut européen de télémédecine, dont il est encore le président. Et c’est au Canada qu’il a découvert la télémédecine, où elle s'était développée pour que toute la population, répartie dans les grands espaces faiblement peuplés, puisse avoir accès aux soins. L’intérêt étant qu’on puisse discuter du cas d’un malade du fin fond des Pyrénées entre son généraliste, son radiologue et le chirurgien du CHU, sans que personne ne se déplace. "On peut soigner à distance en amenant le conseil médical, l’expertise en des lieux où il manque de médecins ou en remplaçant le médecin par un robot". « La télémédecine n’est pas un outil, c’est un acte médical à distance ». Aujourd’hui dans la lutte contre les déserts médicaux et un accès aux soins à tous figurent en bonne place la télémédecine et la téléconsultation. Sans doute une nouvelle page de la médecine qui est en train de se tourner, et dont il est un des pionniers. En 1991, il sera président de la Fédération nationale de protection civile. Depuis 2012, il existe le Prix Louis Lareng. Il a été créé au Luxembourg et récompense l’ensemble de la carrière du professeur. Ce prix sera attribué par la suite à des personnes ayant œuvré dans le domaine de la télémédecine et de la e-santé. Le bâtiment-forum de l’Université de Rangueil porte son nom ainsi que le nouveau bâtiment de l’hôpital Purpan qui regroupe tous les services du SAMU. Grande figure de la médecine toulousaine, grand visionnaire, travailleur infatigable et citoyen engagé, il a consacré sa vie à organiser les secours pour ses concitoyens et à défendre l’égalité des chances devant l’accès aux soins. Il est décrit comme un homme passionné et chaleureux, proche de chacun, avec un accent entre mille reconnaissable dont les « r » roulent comme les torrents de ses Pyrénées et profondément attaché à sa terre natale. Homme fidèle à ses racines, à ses convictions, il restera un des grands hommes de Toulouse, au service de la Médecine et des valeurs de la République française, et qui aura mené une carrière professionnelle exceptionnelle. À 95 ans, toujours aussi passionné par le monde médical, il avait été nommé président d'honneur de l'Observatoire régional de l'innovation et des usages du numérique en santé. Décédé le dimanche 3 novembre 2019 à l’âge de 96 ans, Louis Lareng a été inhumé le 7 novembre dans l’intimité à Ayzac-Ost, son village natal des Hautes-Pyrénées.LARREY Dominique-Jean (1766-1842)
Chirurgien en chef de la Grande Armée, Baron d’Empire
 Dominique-Jean LARREY, né le 8 juillet 1766 à Beaudéan sur les bords de l’Adour, sous le règne de Louis XV et mort à Lyon le 25 juillet 1842, à l’âge de 76 ans, est le fils de Jean Larrey, maître cordonnier. Sans doute qu’il fut le personnage le plus célèbre des Hautes-Pyrénées et la figure médicale la plus célèbre du Premier Empire. Orphelin de père à treize ans, il étudie la médecine à l’Hôpital Saint-Joseph de la Grave de Toulouse, auprès de son oncle, Alexis Larrey, fondateur du premier hôpital militaire de cette ville et correspondant de l’Académie Royale de Chirurgie. Après six années d’apprentissage, il vient à Paris pour y étudier la médecine auprès de Pierre Joseph Desault, chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu. Il débute sa carrière en 1787, comme chirurgien de la marine royale sur la frégate « La Vigilante » en mer d’Irlande. De retour à Paris dès l’année suivante, il reprend ses études à l’Hôtel-Dieu avec Desault et Sabatier, chirurgien en chef des Invalides. Il est reçu premier au concours d’aide-major de l’Hôpital des Invalides. En 1792, il reçoit sa première affectation comme chirurgien aide-major dans l’armée du Rhin, sous les ordres du général Houchard. Première étape d’une carrière qui le conduisit sur tous les champs de bataille d’Europe, de l’Espagne à la Russie, et même dans les déserts d’Égypte et de Syrie. Il fera toutes les campagnes de Napoléon. Il reçoit le baptême du feu à la bataille de Spire, en septembre 1792, qui lui permet d’appliquer les principes de la chirurgie navale. Il brave l’interdiction imposée aux officiers de santé, sur terre, de se tenir à moins d’une lieue des combats et à attendre leur fin pour secourir les blessés. Il observe à la lorgnette, la rapidité avec laquelle les batteries d’artillerie à cheval se déplacent et imagine les "ambulances volantes" à laquelle son nom sera désormais attaché, capables de suivre les combattants et de les secourir jusqu’au cœur de la bataille. En 1794, à 28 ans, il présente son programme "d’ambulances volantes" qui est adopté par le conseil de santé, avant d’aller rejoindre à Toulon son affectation comme chirurgien en chef de l’Armée de Corse. Républicain affirmé, il est séduit par le dynamisme et l’autorité du jeune général Bonaparte. En 1794, il épouse Marie-Elisabeth Laville-Leroux, peintre et élève de David. Une union sans nuage qui durera jusqu’au décès en juillet 1842, à 48 heures d’intervalle, de Dominique à Lyon et d’Elisabeth à Paris. En 1795, il fait un bref retour au Val de Grâce, sous la direction de J.F. Coste, et devient en 1796 le premier professeur titulaire de la chaire d’anatomie et de chirurgie militaire à l’École de santé du Val-de-Grâce. Dans ses fonctions, il inventa, entre autres, la ligature des vaisseaux sanguins. Pendant la campagne de Syrie (février à mai 1799), on l’avait surnommé "la Providence du soldat". Bonaparte ayant apprécié au combat les qualités de son jeune chirurgien, le nomma chirurgien en chef de la Garde des Consuls (1802) et de l’Hôpital de la Garde le "Gros Caillou", où il restera pendant quatre ans. En mai 1803, il soutient sa thèse de doctorat de médecine, conformément aux nouvelles dispositions de la réorganisation du monde médical sous le titre : "Dissertation sur les amputations des membres à la suite des coups de feu", sujet dont il avait, à l’évidence la plus grande expérience européenne. Il devint ainsi le premier "docteur en chirurgie". Nommé ensuite inspecteur général du service de santé des armées (1805) et chirurgien en chef de la Garde impériale (1805), baron d’Empire (1809) sur le champ de la bataille de Wagram, inspecteur général du service de santé militaire (1810) et enfin chirurgien en chef de la Grande Armée (12 février 1812). En 1813, il prendra la défense des conscrits blessés à la main et accusés de se mutiler volontairement, ce qui lui valut une haine farouche de Soult. Père de la médecine d’urgence, il suivit Napoléon Bonaparte dans toutes ses campagnes. Il fut un précurseur en matière de secours aux blessés sur les champs de bataille, pratiquant les soins sur le terrain le plus tôt possible, grâce à des ambulances chirurgicales volantes, qui sont les ancêtres du Samu. En 1804, à 38 ans, il fut promu officier de la Légion d’honneur, décoré en l’Église des Invalides par Bonaparte premier Consul, qui deviendra quelques mois plus tard Napoléon 1er, qui lui dit : « C’est une récompense bien méritée ». En 1807, lors de la bataille d’Eylau, Napoléon, passant près de son ambulance, lui conféra, sur le champ, la croix de Commandeur de la Légion d’honneur. Blessé après la bataille de Waterloo, prisonnier des Prussiens, il allait être exécuté quand le médecin qui lui bandait les yeux le reconnut. Conduit alors auprès du général prussien, Gebhard Leberecht von Blücher, il fut relâché sur ordre de celui-ci, dont il avait soigné le fils. En disgrâce sous la Restauration (1814-1830), il reprendra du service sous la Monarchie de Juillet (1830-1848). Il verra son travail et ses talents récompensés par plusieurs distinctions : présidence de la Société de médecine de Paris en 1806, nomination parmi la « première promotion » de membres de l’Académie Royale de médecine, par ordonnance de Louis XVIII en 1820. En 1829, il fut élu membre de l’Institut de France, succédant à Pelletan, à l’Académie des sciences. En 1842, tombé malade en Algérie, huit jours plus tard, le 25 juillet 1842, il succomba à Lyon. Son corps, transporté à Paris, fut inhumé le 6 août au cimetière du Père-Lachaise (37e division). Plusieurs discours furent prononcés sur sa tombe. Gilbert Breschet, membre de l’Académie des sciences, énuméra ses travaux scientifiques en chirurgie, en médecine, en hygiène publique. Sur sa tombe, un extrait du testament de Napoléon 1er tient lieu d’épitaphe : « À Larrey, l’homme le plus vertueux que j’aie connu ». Le 15 décembre 1992, ses restes furent transférés de sa tombe du cimetière du Père-Lachaise à l’avant dernière place disponible dans le caveau des Gouverneurs de la cathédrale Saint-Louis des Invalides, et une petite urne contenant un morceau d’intestin fut déposée dans une vitrine de la salle de la bibliothèque de l’Académie nationale de médecine. Le Val-de-Grâce fit élever à Larrey une statue en bronze, sculptée par Pierre-Jean David d’Angers, dont l’inauguration eu lieu le 8 août 1850. Il existe deux autres statues : une statue en marbre blanc, majestueuse et monumentale, magnifiant le médecin humanitaire, sculptée par Pierre-Alfred Robinet, qui siège dans le hall d’entrée de l’Académie de médecine à Paris, rue Bonaparte, et qui fut inaugurée en 1856 et une autre en bronze à Tarbes, inaugurée le 15 août 1864, sculptée par Jacques-Joseph Emile Badiou de la Latronchère, glorifiant l’enfant du pays. Son nom est également inscrit sur la 30e colonne (pilier Sud) de l’arc de triomphe de l’Étoile et il existe une rue Larrey à Paris, dans le 5e arrondissement. Il est aussi connu pour des recherches anatomiques. C’est ainsi qu’un orifice diaphragmatique est appelé "Fente de Larrey". Il est considéré par beaucoup comme le fondateur de la chirurgie moderne. Opérant à une époque où l’anesthésie n’existait pas, il était capable d’amputer un membre en moins d’une minute. Lors de la bataille de la Sierra Negra, il amputa en une journée quelque 200 blessés. Comme il participa à la plupart des campagnes de Napoléon, il mit en œuvre la prise en charge rapide des blessés, et inventa ces "ambulances volantes" tirées par des chevaux qui pouvaient manœuvrer rapidement à travers le champ de bataille, récupérer les blessés sous le feu ennemi et les conduire dans les hôpitaux de campagne situés juste en dehors des zones de combat. Soucieux de soigner tous les blessés, y compris ennemis, il gagna aussi l’affection des soldats et même des ennemis. En 1815, à Waterloo, l’Anglais Wellington fit interrompre le tir de ses batteries quand il aperçut le baron Larrey penché sur les blessés : « Je salue l’honneur et la loyauté qui passent ! » s’exclama-t-il. Larrey a appartenu à la franc-maçonnerie, dont il avait été initié dès l’âge de 19 ans. Napoléon 1er le dissuada de le suivre à l’île d’Elbe, mais le docteur anglais Archibald Arnott entendit le moribond de Sainte-Hélène déclarer : « J’ai conçu pour lui une estime qui ne s’est jamais démentie. Si l’armée élève une colonne à la reconnaissance, elle doit l’ériger à Larrey ». Sa maison natale, qui existe toujours dans la rue principale du village de Beaudéan, est devenue un musée. Dominique-Jean Larrey est le père du baron Félix Hippolyte Larrey, né le 18 septembre 1808 à Paris et mort le 8 octobre 1895 à Bièvres, à l’âge de 87 ans. Élève brillant, celui-ci fit ses études aux lycées Saint-Louis et Louis-le-Grand et sa carrière scientifique fut jalonnée de titres hospitaliers et universitaires : professeur agrégé de la Faculté de Médecine de Paris (1837) professeur de pathologie chirurgicale au Val-de-Grâce (1841), chirurgien ordinaire de l’Empereur Napoléon III (1851), membre de l’Académie impériale de médecine (1852), chirurgien en chef au Val-de-grâce (1854), médecin-inspecteur au Conseil de Santé et président de la Société de chirurgie (1858), médecin en chef de l'Armée d'Italie (1859), président de l’Académie impériale de médecine (1863), membre libre de l’Académie des sciences (1867), président du Conseil de Santé (1868), chirurgien en chef de l’Armée du Rhin (1870-71), Grand officier de la Légion d'honneur (1871). En 1872, atteint par la limite d’âge, il prend sa retraite. En plus d’être médecin militaire il fut aussi homme politique français. En 1860, il fut conseiller général de Bagnères-de-Bigorre. Et à sa retraite, entre 1877 et 1881, il fut aussi député des Hautes-Pyrénées. C’est à ce poste qu’il donna la majeure partie de son action effective dans l’intérêt du Service de Santé des armées. Le 18 octobre 1895, il fut inhumé au Père Lachaise, après une cérémonie dans la cour d’honneur du Val-de-Grâce. Et avec lui disparut une des personnalités les plus connues et une des figures les plus sympathiques du monde médical français. Son nom fut donné à l’hôpital militaire de Toulouse. Sa statue s’élève dans les jardins du Val-de-Grâce.
Dominique-Jean LARREY, né le 8 juillet 1766 à Beaudéan sur les bords de l’Adour, sous le règne de Louis XV et mort à Lyon le 25 juillet 1842, à l’âge de 76 ans, est le fils de Jean Larrey, maître cordonnier. Sans doute qu’il fut le personnage le plus célèbre des Hautes-Pyrénées et la figure médicale la plus célèbre du Premier Empire. Orphelin de père à treize ans, il étudie la médecine à l’Hôpital Saint-Joseph de la Grave de Toulouse, auprès de son oncle, Alexis Larrey, fondateur du premier hôpital militaire de cette ville et correspondant de l’Académie Royale de Chirurgie. Après six années d’apprentissage, il vient à Paris pour y étudier la médecine auprès de Pierre Joseph Desault, chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu. Il débute sa carrière en 1787, comme chirurgien de la marine royale sur la frégate « La Vigilante » en mer d’Irlande. De retour à Paris dès l’année suivante, il reprend ses études à l’Hôtel-Dieu avec Desault et Sabatier, chirurgien en chef des Invalides. Il est reçu premier au concours d’aide-major de l’Hôpital des Invalides. En 1792, il reçoit sa première affectation comme chirurgien aide-major dans l’armée du Rhin, sous les ordres du général Houchard. Première étape d’une carrière qui le conduisit sur tous les champs de bataille d’Europe, de l’Espagne à la Russie, et même dans les déserts d’Égypte et de Syrie. Il fera toutes les campagnes de Napoléon. Il reçoit le baptême du feu à la bataille de Spire, en septembre 1792, qui lui permet d’appliquer les principes de la chirurgie navale. Il brave l’interdiction imposée aux officiers de santé, sur terre, de se tenir à moins d’une lieue des combats et à attendre leur fin pour secourir les blessés. Il observe à la lorgnette, la rapidité avec laquelle les batteries d’artillerie à cheval se déplacent et imagine les "ambulances volantes" à laquelle son nom sera désormais attaché, capables de suivre les combattants et de les secourir jusqu’au cœur de la bataille. En 1794, à 28 ans, il présente son programme "d’ambulances volantes" qui est adopté par le conseil de santé, avant d’aller rejoindre à Toulon son affectation comme chirurgien en chef de l’Armée de Corse. Républicain affirmé, il est séduit par le dynamisme et l’autorité du jeune général Bonaparte. En 1794, il épouse Marie-Elisabeth Laville-Leroux, peintre et élève de David. Une union sans nuage qui durera jusqu’au décès en juillet 1842, à 48 heures d’intervalle, de Dominique à Lyon et d’Elisabeth à Paris. En 1795, il fait un bref retour au Val de Grâce, sous la direction de J.F. Coste, et devient en 1796 le premier professeur titulaire de la chaire d’anatomie et de chirurgie militaire à l’École de santé du Val-de-Grâce. Dans ses fonctions, il inventa, entre autres, la ligature des vaisseaux sanguins. Pendant la campagne de Syrie (février à mai 1799), on l’avait surnommé "la Providence du soldat". Bonaparte ayant apprécié au combat les qualités de son jeune chirurgien, le nomma chirurgien en chef de la Garde des Consuls (1802) et de l’Hôpital de la Garde le "Gros Caillou", où il restera pendant quatre ans. En mai 1803, il soutient sa thèse de doctorat de médecine, conformément aux nouvelles dispositions de la réorganisation du monde médical sous le titre : "Dissertation sur les amputations des membres à la suite des coups de feu", sujet dont il avait, à l’évidence la plus grande expérience européenne. Il devint ainsi le premier "docteur en chirurgie". Nommé ensuite inspecteur général du service de santé des armées (1805) et chirurgien en chef de la Garde impériale (1805), baron d’Empire (1809) sur le champ de la bataille de Wagram, inspecteur général du service de santé militaire (1810) et enfin chirurgien en chef de la Grande Armée (12 février 1812). En 1813, il prendra la défense des conscrits blessés à la main et accusés de se mutiler volontairement, ce qui lui valut une haine farouche de Soult. Père de la médecine d’urgence, il suivit Napoléon Bonaparte dans toutes ses campagnes. Il fut un précurseur en matière de secours aux blessés sur les champs de bataille, pratiquant les soins sur le terrain le plus tôt possible, grâce à des ambulances chirurgicales volantes, qui sont les ancêtres du Samu. En 1804, à 38 ans, il fut promu officier de la Légion d’honneur, décoré en l’Église des Invalides par Bonaparte premier Consul, qui deviendra quelques mois plus tard Napoléon 1er, qui lui dit : « C’est une récompense bien méritée ». En 1807, lors de la bataille d’Eylau, Napoléon, passant près de son ambulance, lui conféra, sur le champ, la croix de Commandeur de la Légion d’honneur. Blessé après la bataille de Waterloo, prisonnier des Prussiens, il allait être exécuté quand le médecin qui lui bandait les yeux le reconnut. Conduit alors auprès du général prussien, Gebhard Leberecht von Blücher, il fut relâché sur ordre de celui-ci, dont il avait soigné le fils. En disgrâce sous la Restauration (1814-1830), il reprendra du service sous la Monarchie de Juillet (1830-1848). Il verra son travail et ses talents récompensés par plusieurs distinctions : présidence de la Société de médecine de Paris en 1806, nomination parmi la « première promotion » de membres de l’Académie Royale de médecine, par ordonnance de Louis XVIII en 1820. En 1829, il fut élu membre de l’Institut de France, succédant à Pelletan, à l’Académie des sciences. En 1842, tombé malade en Algérie, huit jours plus tard, le 25 juillet 1842, il succomba à Lyon. Son corps, transporté à Paris, fut inhumé le 6 août au cimetière du Père-Lachaise (37e division). Plusieurs discours furent prononcés sur sa tombe. Gilbert Breschet, membre de l’Académie des sciences, énuméra ses travaux scientifiques en chirurgie, en médecine, en hygiène publique. Sur sa tombe, un extrait du testament de Napoléon 1er tient lieu d’épitaphe : « À Larrey, l’homme le plus vertueux que j’aie connu ». Le 15 décembre 1992, ses restes furent transférés de sa tombe du cimetière du Père-Lachaise à l’avant dernière place disponible dans le caveau des Gouverneurs de la cathédrale Saint-Louis des Invalides, et une petite urne contenant un morceau d’intestin fut déposée dans une vitrine de la salle de la bibliothèque de l’Académie nationale de médecine. Le Val-de-Grâce fit élever à Larrey une statue en bronze, sculptée par Pierre-Jean David d’Angers, dont l’inauguration eu lieu le 8 août 1850. Il existe deux autres statues : une statue en marbre blanc, majestueuse et monumentale, magnifiant le médecin humanitaire, sculptée par Pierre-Alfred Robinet, qui siège dans le hall d’entrée de l’Académie de médecine à Paris, rue Bonaparte, et qui fut inaugurée en 1856 et une autre en bronze à Tarbes, inaugurée le 15 août 1864, sculptée par Jacques-Joseph Emile Badiou de la Latronchère, glorifiant l’enfant du pays. Son nom est également inscrit sur la 30e colonne (pilier Sud) de l’arc de triomphe de l’Étoile et il existe une rue Larrey à Paris, dans le 5e arrondissement. Il est aussi connu pour des recherches anatomiques. C’est ainsi qu’un orifice diaphragmatique est appelé "Fente de Larrey". Il est considéré par beaucoup comme le fondateur de la chirurgie moderne. Opérant à une époque où l’anesthésie n’existait pas, il était capable d’amputer un membre en moins d’une minute. Lors de la bataille de la Sierra Negra, il amputa en une journée quelque 200 blessés. Comme il participa à la plupart des campagnes de Napoléon, il mit en œuvre la prise en charge rapide des blessés, et inventa ces "ambulances volantes" tirées par des chevaux qui pouvaient manœuvrer rapidement à travers le champ de bataille, récupérer les blessés sous le feu ennemi et les conduire dans les hôpitaux de campagne situés juste en dehors des zones de combat. Soucieux de soigner tous les blessés, y compris ennemis, il gagna aussi l’affection des soldats et même des ennemis. En 1815, à Waterloo, l’Anglais Wellington fit interrompre le tir de ses batteries quand il aperçut le baron Larrey penché sur les blessés : « Je salue l’honneur et la loyauté qui passent ! » s’exclama-t-il. Larrey a appartenu à la franc-maçonnerie, dont il avait été initié dès l’âge de 19 ans. Napoléon 1er le dissuada de le suivre à l’île d’Elbe, mais le docteur anglais Archibald Arnott entendit le moribond de Sainte-Hélène déclarer : « J’ai conçu pour lui une estime qui ne s’est jamais démentie. Si l’armée élève une colonne à la reconnaissance, elle doit l’ériger à Larrey ». Sa maison natale, qui existe toujours dans la rue principale du village de Beaudéan, est devenue un musée. Dominique-Jean Larrey est le père du baron Félix Hippolyte Larrey, né le 18 septembre 1808 à Paris et mort le 8 octobre 1895 à Bièvres, à l’âge de 87 ans. Élève brillant, celui-ci fit ses études aux lycées Saint-Louis et Louis-le-Grand et sa carrière scientifique fut jalonnée de titres hospitaliers et universitaires : professeur agrégé de la Faculté de Médecine de Paris (1837) professeur de pathologie chirurgicale au Val-de-Grâce (1841), chirurgien ordinaire de l’Empereur Napoléon III (1851), membre de l’Académie impériale de médecine (1852), chirurgien en chef au Val-de-grâce (1854), médecin-inspecteur au Conseil de Santé et président de la Société de chirurgie (1858), médecin en chef de l'Armée d'Italie (1859), président de l’Académie impériale de médecine (1863), membre libre de l’Académie des sciences (1867), président du Conseil de Santé (1868), chirurgien en chef de l’Armée du Rhin (1870-71), Grand officier de la Légion d'honneur (1871). En 1872, atteint par la limite d’âge, il prend sa retraite. En plus d’être médecin militaire il fut aussi homme politique français. En 1860, il fut conseiller général de Bagnères-de-Bigorre. Et à sa retraite, entre 1877 et 1881, il fut aussi député des Hautes-Pyrénées. C’est à ce poste qu’il donna la majeure partie de son action effective dans l’intérêt du Service de Santé des armées. Le 18 octobre 1895, il fut inhumé au Père Lachaise, après une cérémonie dans la cour d’honneur du Val-de-Grâce. Et avec lui disparut une des personnalités les plus connues et une des figures les plus sympathiques du monde médical français. Son nom fut donné à l’hôpital militaire de Toulouse. Sa statue s’élève dans les jardins du Val-de-Grâce.
 Dominique-Jean LARREY, né le 8 juillet 1766 à Beaudéan sur les bords de l’Adour, sous le règne de Louis XV et mort à Lyon le 25 juillet 1842, à l’âge de 76 ans, est le fils de Jean Larrey, maître cordonnier. Sans doute qu’il fut le personnage le plus célèbre des Hautes-Pyrénées et la figure médicale la plus célèbre du Premier Empire. Orphelin de père à treize ans, il étudie la médecine à l’Hôpital Saint-Joseph de la Grave de Toulouse, auprès de son oncle, Alexis Larrey, fondateur du premier hôpital militaire de cette ville et correspondant de l’Académie Royale de Chirurgie. Après six années d’apprentissage, il vient à Paris pour y étudier la médecine auprès de Pierre Joseph Desault, chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu. Il débute sa carrière en 1787, comme chirurgien de la marine royale sur la frégate « La Vigilante » en mer d’Irlande. De retour à Paris dès l’année suivante, il reprend ses études à l’Hôtel-Dieu avec Desault et Sabatier, chirurgien en chef des Invalides. Il est reçu premier au concours d’aide-major de l’Hôpital des Invalides. En 1792, il reçoit sa première affectation comme chirurgien aide-major dans l’armée du Rhin, sous les ordres du général Houchard. Première étape d’une carrière qui le conduisit sur tous les champs de bataille d’Europe, de l’Espagne à la Russie, et même dans les déserts d’Égypte et de Syrie. Il fera toutes les campagnes de Napoléon. Il reçoit le baptême du feu à la bataille de Spire, en septembre 1792, qui lui permet d’appliquer les principes de la chirurgie navale. Il brave l’interdiction imposée aux officiers de santé, sur terre, de se tenir à moins d’une lieue des combats et à attendre leur fin pour secourir les blessés. Il observe à la lorgnette, la rapidité avec laquelle les batteries d’artillerie à cheval se déplacent et imagine les "ambulances volantes" à laquelle son nom sera désormais attaché, capables de suivre les combattants et de les secourir jusqu’au cœur de la bataille. En 1794, à 28 ans, il présente son programme "d’ambulances volantes" qui est adopté par le conseil de santé, avant d’aller rejoindre à Toulon son affectation comme chirurgien en chef de l’Armée de Corse. Républicain affirmé, il est séduit par le dynamisme et l’autorité du jeune général Bonaparte. En 1794, il épouse Marie-Elisabeth Laville-Leroux, peintre et élève de David. Une union sans nuage qui durera jusqu’au décès en juillet 1842, à 48 heures d’intervalle, de Dominique à Lyon et d’Elisabeth à Paris. En 1795, il fait un bref retour au Val de Grâce, sous la direction de J.F. Coste, et devient en 1796 le premier professeur titulaire de la chaire d’anatomie et de chirurgie militaire à l’École de santé du Val-de-Grâce. Dans ses fonctions, il inventa, entre autres, la ligature des vaisseaux sanguins. Pendant la campagne de Syrie (février à mai 1799), on l’avait surnommé "la Providence du soldat". Bonaparte ayant apprécié au combat les qualités de son jeune chirurgien, le nomma chirurgien en chef de la Garde des Consuls (1802) et de l’Hôpital de la Garde le "Gros Caillou", où il restera pendant quatre ans. En mai 1803, il soutient sa thèse de doctorat de médecine, conformément aux nouvelles dispositions de la réorganisation du monde médical sous le titre : "Dissertation sur les amputations des membres à la suite des coups de feu", sujet dont il avait, à l’évidence la plus grande expérience européenne. Il devint ainsi le premier "docteur en chirurgie". Nommé ensuite inspecteur général du service de santé des armées (1805) et chirurgien en chef de la Garde impériale (1805), baron d’Empire (1809) sur le champ de la bataille de Wagram, inspecteur général du service de santé militaire (1810) et enfin chirurgien en chef de la Grande Armée (12 février 1812). En 1813, il prendra la défense des conscrits blessés à la main et accusés de se mutiler volontairement, ce qui lui valut une haine farouche de Soult. Père de la médecine d’urgence, il suivit Napoléon Bonaparte dans toutes ses campagnes. Il fut un précurseur en matière de secours aux blessés sur les champs de bataille, pratiquant les soins sur le terrain le plus tôt possible, grâce à des ambulances chirurgicales volantes, qui sont les ancêtres du Samu. En 1804, à 38 ans, il fut promu officier de la Légion d’honneur, décoré en l’Église des Invalides par Bonaparte premier Consul, qui deviendra quelques mois plus tard Napoléon 1er, qui lui dit : « C’est une récompense bien méritée ». En 1807, lors de la bataille d’Eylau, Napoléon, passant près de son ambulance, lui conféra, sur le champ, la croix de Commandeur de la Légion d’honneur. Blessé après la bataille de Waterloo, prisonnier des Prussiens, il allait être exécuté quand le médecin qui lui bandait les yeux le reconnut. Conduit alors auprès du général prussien, Gebhard Leberecht von Blücher, il fut relâché sur ordre de celui-ci, dont il avait soigné le fils. En disgrâce sous la Restauration (1814-1830), il reprendra du service sous la Monarchie de Juillet (1830-1848). Il verra son travail et ses talents récompensés par plusieurs distinctions : présidence de la Société de médecine de Paris en 1806, nomination parmi la « première promotion » de membres de l’Académie Royale de médecine, par ordonnance de Louis XVIII en 1820. En 1829, il fut élu membre de l’Institut de France, succédant à Pelletan, à l’Académie des sciences. En 1842, tombé malade en Algérie, huit jours plus tard, le 25 juillet 1842, il succomba à Lyon. Son corps, transporté à Paris, fut inhumé le 6 août au cimetière du Père-Lachaise (37e division). Plusieurs discours furent prononcés sur sa tombe. Gilbert Breschet, membre de l’Académie des sciences, énuméra ses travaux scientifiques en chirurgie, en médecine, en hygiène publique. Sur sa tombe, un extrait du testament de Napoléon 1er tient lieu d’épitaphe : « À Larrey, l’homme le plus vertueux que j’aie connu ». Le 15 décembre 1992, ses restes furent transférés de sa tombe du cimetière du Père-Lachaise à l’avant dernière place disponible dans le caveau des Gouverneurs de la cathédrale Saint-Louis des Invalides, et une petite urne contenant un morceau d’intestin fut déposée dans une vitrine de la salle de la bibliothèque de l’Académie nationale de médecine. Le Val-de-Grâce fit élever à Larrey une statue en bronze, sculptée par Pierre-Jean David d’Angers, dont l’inauguration eu lieu le 8 août 1850. Il existe deux autres statues : une statue en marbre blanc, majestueuse et monumentale, magnifiant le médecin humanitaire, sculptée par Pierre-Alfred Robinet, qui siège dans le hall d’entrée de l’Académie de médecine à Paris, rue Bonaparte, et qui fut inaugurée en 1856 et une autre en bronze à Tarbes, inaugurée le 15 août 1864, sculptée par Jacques-Joseph Emile Badiou de la Latronchère, glorifiant l’enfant du pays. Son nom est également inscrit sur la 30e colonne (pilier Sud) de l’arc de triomphe de l’Étoile et il existe une rue Larrey à Paris, dans le 5e arrondissement. Il est aussi connu pour des recherches anatomiques. C’est ainsi qu’un orifice diaphragmatique est appelé "Fente de Larrey". Il est considéré par beaucoup comme le fondateur de la chirurgie moderne. Opérant à une époque où l’anesthésie n’existait pas, il était capable d’amputer un membre en moins d’une minute. Lors de la bataille de la Sierra Negra, il amputa en une journée quelque 200 blessés. Comme il participa à la plupart des campagnes de Napoléon, il mit en œuvre la prise en charge rapide des blessés, et inventa ces "ambulances volantes" tirées par des chevaux qui pouvaient manœuvrer rapidement à travers le champ de bataille, récupérer les blessés sous le feu ennemi et les conduire dans les hôpitaux de campagne situés juste en dehors des zones de combat. Soucieux de soigner tous les blessés, y compris ennemis, il gagna aussi l’affection des soldats et même des ennemis. En 1815, à Waterloo, l’Anglais Wellington fit interrompre le tir de ses batteries quand il aperçut le baron Larrey penché sur les blessés : « Je salue l’honneur et la loyauté qui passent ! » s’exclama-t-il. Larrey a appartenu à la franc-maçonnerie, dont il avait été initié dès l’âge de 19 ans. Napoléon 1er le dissuada de le suivre à l’île d’Elbe, mais le docteur anglais Archibald Arnott entendit le moribond de Sainte-Hélène déclarer : « J’ai conçu pour lui une estime qui ne s’est jamais démentie. Si l’armée élève une colonne à la reconnaissance, elle doit l’ériger à Larrey ». Sa maison natale, qui existe toujours dans la rue principale du village de Beaudéan, est devenue un musée. Dominique-Jean Larrey est le père du baron Félix Hippolyte Larrey, né le 18 septembre 1808 à Paris et mort le 8 octobre 1895 à Bièvres, à l’âge de 87 ans. Élève brillant, celui-ci fit ses études aux lycées Saint-Louis et Louis-le-Grand et sa carrière scientifique fut jalonnée de titres hospitaliers et universitaires : professeur agrégé de la Faculté de Médecine de Paris (1837) professeur de pathologie chirurgicale au Val-de-Grâce (1841), chirurgien ordinaire de l’Empereur Napoléon III (1851), membre de l’Académie impériale de médecine (1852), chirurgien en chef au Val-de-grâce (1854), médecin-inspecteur au Conseil de Santé et président de la Société de chirurgie (1858), médecin en chef de l'Armée d'Italie (1859), président de l’Académie impériale de médecine (1863), membre libre de l’Académie des sciences (1867), président du Conseil de Santé (1868), chirurgien en chef de l’Armée du Rhin (1870-71), Grand officier de la Légion d'honneur (1871). En 1872, atteint par la limite d’âge, il prend sa retraite. En plus d’être médecin militaire il fut aussi homme politique français. En 1860, il fut conseiller général de Bagnères-de-Bigorre. Et à sa retraite, entre 1877 et 1881, il fut aussi député des Hautes-Pyrénées. C’est à ce poste qu’il donna la majeure partie de son action effective dans l’intérêt du Service de Santé des armées. Le 18 octobre 1895, il fut inhumé au Père Lachaise, après une cérémonie dans la cour d’honneur du Val-de-Grâce. Et avec lui disparut une des personnalités les plus connues et une des figures les plus sympathiques du monde médical français. Son nom fut donné à l’hôpital militaire de Toulouse. Sa statue s’élève dans les jardins du Val-de-Grâce.
Dominique-Jean LARREY, né le 8 juillet 1766 à Beaudéan sur les bords de l’Adour, sous le règne de Louis XV et mort à Lyon le 25 juillet 1842, à l’âge de 76 ans, est le fils de Jean Larrey, maître cordonnier. Sans doute qu’il fut le personnage le plus célèbre des Hautes-Pyrénées et la figure médicale la plus célèbre du Premier Empire. Orphelin de père à treize ans, il étudie la médecine à l’Hôpital Saint-Joseph de la Grave de Toulouse, auprès de son oncle, Alexis Larrey, fondateur du premier hôpital militaire de cette ville et correspondant de l’Académie Royale de Chirurgie. Après six années d’apprentissage, il vient à Paris pour y étudier la médecine auprès de Pierre Joseph Desault, chirurgien en chef de l’Hôtel-Dieu. Il débute sa carrière en 1787, comme chirurgien de la marine royale sur la frégate « La Vigilante » en mer d’Irlande. De retour à Paris dès l’année suivante, il reprend ses études à l’Hôtel-Dieu avec Desault et Sabatier, chirurgien en chef des Invalides. Il est reçu premier au concours d’aide-major de l’Hôpital des Invalides. En 1792, il reçoit sa première affectation comme chirurgien aide-major dans l’armée du Rhin, sous les ordres du général Houchard. Première étape d’une carrière qui le conduisit sur tous les champs de bataille d’Europe, de l’Espagne à la Russie, et même dans les déserts d’Égypte et de Syrie. Il fera toutes les campagnes de Napoléon. Il reçoit le baptême du feu à la bataille de Spire, en septembre 1792, qui lui permet d’appliquer les principes de la chirurgie navale. Il brave l’interdiction imposée aux officiers de santé, sur terre, de se tenir à moins d’une lieue des combats et à attendre leur fin pour secourir les blessés. Il observe à la lorgnette, la rapidité avec laquelle les batteries d’artillerie à cheval se déplacent et imagine les "ambulances volantes" à laquelle son nom sera désormais attaché, capables de suivre les combattants et de les secourir jusqu’au cœur de la bataille. En 1794, à 28 ans, il présente son programme "d’ambulances volantes" qui est adopté par le conseil de santé, avant d’aller rejoindre à Toulon son affectation comme chirurgien en chef de l’Armée de Corse. Républicain affirmé, il est séduit par le dynamisme et l’autorité du jeune général Bonaparte. En 1794, il épouse Marie-Elisabeth Laville-Leroux, peintre et élève de David. Une union sans nuage qui durera jusqu’au décès en juillet 1842, à 48 heures d’intervalle, de Dominique à Lyon et d’Elisabeth à Paris. En 1795, il fait un bref retour au Val de Grâce, sous la direction de J.F. Coste, et devient en 1796 le premier professeur titulaire de la chaire d’anatomie et de chirurgie militaire à l’École de santé du Val-de-Grâce. Dans ses fonctions, il inventa, entre autres, la ligature des vaisseaux sanguins. Pendant la campagne de Syrie (février à mai 1799), on l’avait surnommé "la Providence du soldat". Bonaparte ayant apprécié au combat les qualités de son jeune chirurgien, le nomma chirurgien en chef de la Garde des Consuls (1802) et de l’Hôpital de la Garde le "Gros Caillou", où il restera pendant quatre ans. En mai 1803, il soutient sa thèse de doctorat de médecine, conformément aux nouvelles dispositions de la réorganisation du monde médical sous le titre : "Dissertation sur les amputations des membres à la suite des coups de feu", sujet dont il avait, à l’évidence la plus grande expérience européenne. Il devint ainsi le premier "docteur en chirurgie". Nommé ensuite inspecteur général du service de santé des armées (1805) et chirurgien en chef de la Garde impériale (1805), baron d’Empire (1809) sur le champ de la bataille de Wagram, inspecteur général du service de santé militaire (1810) et enfin chirurgien en chef de la Grande Armée (12 février 1812). En 1813, il prendra la défense des conscrits blessés à la main et accusés de se mutiler volontairement, ce qui lui valut une haine farouche de Soult. Père de la médecine d’urgence, il suivit Napoléon Bonaparte dans toutes ses campagnes. Il fut un précurseur en matière de secours aux blessés sur les champs de bataille, pratiquant les soins sur le terrain le plus tôt possible, grâce à des ambulances chirurgicales volantes, qui sont les ancêtres du Samu. En 1804, à 38 ans, il fut promu officier de la Légion d’honneur, décoré en l’Église des Invalides par Bonaparte premier Consul, qui deviendra quelques mois plus tard Napoléon 1er, qui lui dit : « C’est une récompense bien méritée ». En 1807, lors de la bataille d’Eylau, Napoléon, passant près de son ambulance, lui conféra, sur le champ, la croix de Commandeur de la Légion d’honneur. Blessé après la bataille de Waterloo, prisonnier des Prussiens, il allait être exécuté quand le médecin qui lui bandait les yeux le reconnut. Conduit alors auprès du général prussien, Gebhard Leberecht von Blücher, il fut relâché sur ordre de celui-ci, dont il avait soigné le fils. En disgrâce sous la Restauration (1814-1830), il reprendra du service sous la Monarchie de Juillet (1830-1848). Il verra son travail et ses talents récompensés par plusieurs distinctions : présidence de la Société de médecine de Paris en 1806, nomination parmi la « première promotion » de membres de l’Académie Royale de médecine, par ordonnance de Louis XVIII en 1820. En 1829, il fut élu membre de l’Institut de France, succédant à Pelletan, à l’Académie des sciences. En 1842, tombé malade en Algérie, huit jours plus tard, le 25 juillet 1842, il succomba à Lyon. Son corps, transporté à Paris, fut inhumé le 6 août au cimetière du Père-Lachaise (37e division). Plusieurs discours furent prononcés sur sa tombe. Gilbert Breschet, membre de l’Académie des sciences, énuméra ses travaux scientifiques en chirurgie, en médecine, en hygiène publique. Sur sa tombe, un extrait du testament de Napoléon 1er tient lieu d’épitaphe : « À Larrey, l’homme le plus vertueux que j’aie connu ». Le 15 décembre 1992, ses restes furent transférés de sa tombe du cimetière du Père-Lachaise à l’avant dernière place disponible dans le caveau des Gouverneurs de la cathédrale Saint-Louis des Invalides, et une petite urne contenant un morceau d’intestin fut déposée dans une vitrine de la salle de la bibliothèque de l’Académie nationale de médecine. Le Val-de-Grâce fit élever à Larrey une statue en bronze, sculptée par Pierre-Jean David d’Angers, dont l’inauguration eu lieu le 8 août 1850. Il existe deux autres statues : une statue en marbre blanc, majestueuse et monumentale, magnifiant le médecin humanitaire, sculptée par Pierre-Alfred Robinet, qui siège dans le hall d’entrée de l’Académie de médecine à Paris, rue Bonaparte, et qui fut inaugurée en 1856 et une autre en bronze à Tarbes, inaugurée le 15 août 1864, sculptée par Jacques-Joseph Emile Badiou de la Latronchère, glorifiant l’enfant du pays. Son nom est également inscrit sur la 30e colonne (pilier Sud) de l’arc de triomphe de l’Étoile et il existe une rue Larrey à Paris, dans le 5e arrondissement. Il est aussi connu pour des recherches anatomiques. C’est ainsi qu’un orifice diaphragmatique est appelé "Fente de Larrey". Il est considéré par beaucoup comme le fondateur de la chirurgie moderne. Opérant à une époque où l’anesthésie n’existait pas, il était capable d’amputer un membre en moins d’une minute. Lors de la bataille de la Sierra Negra, il amputa en une journée quelque 200 blessés. Comme il participa à la plupart des campagnes de Napoléon, il mit en œuvre la prise en charge rapide des blessés, et inventa ces "ambulances volantes" tirées par des chevaux qui pouvaient manœuvrer rapidement à travers le champ de bataille, récupérer les blessés sous le feu ennemi et les conduire dans les hôpitaux de campagne situés juste en dehors des zones de combat. Soucieux de soigner tous les blessés, y compris ennemis, il gagna aussi l’affection des soldats et même des ennemis. En 1815, à Waterloo, l’Anglais Wellington fit interrompre le tir de ses batteries quand il aperçut le baron Larrey penché sur les blessés : « Je salue l’honneur et la loyauté qui passent ! » s’exclama-t-il. Larrey a appartenu à la franc-maçonnerie, dont il avait été initié dès l’âge de 19 ans. Napoléon 1er le dissuada de le suivre à l’île d’Elbe, mais le docteur anglais Archibald Arnott entendit le moribond de Sainte-Hélène déclarer : « J’ai conçu pour lui une estime qui ne s’est jamais démentie. Si l’armée élève une colonne à la reconnaissance, elle doit l’ériger à Larrey ». Sa maison natale, qui existe toujours dans la rue principale du village de Beaudéan, est devenue un musée. Dominique-Jean Larrey est le père du baron Félix Hippolyte Larrey, né le 18 septembre 1808 à Paris et mort le 8 octobre 1895 à Bièvres, à l’âge de 87 ans. Élève brillant, celui-ci fit ses études aux lycées Saint-Louis et Louis-le-Grand et sa carrière scientifique fut jalonnée de titres hospitaliers et universitaires : professeur agrégé de la Faculté de Médecine de Paris (1837) professeur de pathologie chirurgicale au Val-de-Grâce (1841), chirurgien ordinaire de l’Empereur Napoléon III (1851), membre de l’Académie impériale de médecine (1852), chirurgien en chef au Val-de-grâce (1854), médecin-inspecteur au Conseil de Santé et président de la Société de chirurgie (1858), médecin en chef de l'Armée d'Italie (1859), président de l’Académie impériale de médecine (1863), membre libre de l’Académie des sciences (1867), président du Conseil de Santé (1868), chirurgien en chef de l’Armée du Rhin (1870-71), Grand officier de la Légion d'honneur (1871). En 1872, atteint par la limite d’âge, il prend sa retraite. En plus d’être médecin militaire il fut aussi homme politique français. En 1860, il fut conseiller général de Bagnères-de-Bigorre. Et à sa retraite, entre 1877 et 1881, il fut aussi député des Hautes-Pyrénées. C’est à ce poste qu’il donna la majeure partie de son action effective dans l’intérêt du Service de Santé des armées. Le 18 octobre 1895, il fut inhumé au Père Lachaise, après une cérémonie dans la cour d’honneur du Val-de-Grâce. Et avec lui disparut une des personnalités les plus connues et une des figures les plus sympathiques du monde médical français. Son nom fut donné à l’hôpital militaire de Toulouse. Sa statue s’élève dans les jardins du Val-de-Grâce.LARRIEU Jean-Marie et Arnaud (1965-XXXX) (1966-XXXX)
Cinéastes, réalisateurs-scénaristes
 Jean-Marie LARRIEU et Arnaud LARRIEU, nés respectivement le 8 avril 1965 et le 31 mars 1966 à Lourdes sont cinéastes. C'est leur grand-père, originaire des Hautes-Pyrénées et cinéaste amateur, qui leur transmet la passion du cinéma et de la montagne. Adolescents, ils filment à leur tour en super-8, avant de tenter sans succès, le concours de la FEMIS, puis de suivre des études de littérature et de philosophie. À partir du milieu des années 80, ils débutent par la réalisation à quatre mains de courts-métrages qui font le tour des festivals - citons « Court Voyage » en 1987, « Temps Couvert » en 1988, « Les Baigneurs » en 1991 », « Ce Jour-là » en 1992 ou « Bernard ou les apparitions » en 1993. Ils mettront deux ans à peaufiner le scénario de leur premier long-métrage, « Fin d'été » sorti en 1999, l'histoire des retrouvailles entre un ingénieur et son père ancien soixante-huitard. Il leur vaut une reconnaissance auprès des critiques. En 2000, ils dirigent Mathieu Amalric dans « La Brèche de Roland ». Récit d'une randonnée en famille qui tourne au règlement de comptes, ce moyen-métrage au charme décalé est très remarqué à la Quinzaine des Réalisateurs. En 2003, le comédien est à l'affiche de « Un homme, un vrai », leur deuxième long-métrage aux côtés d'Hélène Fillières, que les cinéastes avaient déjà dirigée dans le court-métrage « Madonna à Lourdes » en 2001. Rythmée par les chansons de Katerine, cette comédie dans laquelle les frères décrivent l'évolution d'un couple sur plusieurs années, en multipliant les ruptures de ton, suscite l'enthousiasme de la critique. Leur idée ayant toujours été de filmer des corps dans le paysage ou des corps comme des paysages, déclaraient-ils alors à Libération. Ils partent ensuite dans les Alpes tourner « Peindre ou faire l'amour » avec Daniel Auteuil, Sabine Azéma, Amira Casar et Sergi Lopez. Ce film sur l'échangisme est présenté en compétition officielle au Festival de Cannes en 2005. Trois ans plus tard, en 2008, ils reviennent sur leur territoire de prédilection pour leur film « Le Voyage aux Pyrénées » plein d'imprévus et de fantaisies, en compagnie de Sabine Azéma et Jean-Pierre Darroussin. Le film est présenté à la Quinzaine des réalisateurs, lors de la 40e édition du Festival de Cannes 2008. En 2010, ils retrouvent Mathieu Amalric pour le film suivant, adapté d'un livre de Dominique Noguez, « Les Derniers Jours du monde ». En 2014, « L'Amour est un crime parfait », adapté d'un roman de Philippe Djian, sort sur les écrans avec Mathieu Amalric dans le rôle principal. Le 25 novembre 2015, « Vingt et une nuits avec Pattie » réunit pour la première fois sur grand écran, Isabelle Carré et Karin Viard. Une comédie policière savoureuse saupoudrée de merveilleux. Il a valu à Karin Viard (à l'affiche aux côtés d'Isabelle Carré, Sergi Lopez, André Dussolier) une nomination pour le César du meilleur second rôle féminin 2016. Pour le meilleur scénario de ce film « Vingt et une nuits avec Pattie », les frères ont obtenu le Prix du jury au Festival de Saint-Sébastien 2015 et une nomination pour le Prix Lumières 2016. Plus récemment ils furent les invités d’honneur des 35e Rencontres Cinéma de Gindou, qui se déroulèrent en août 2019 à Bouriane dans le Lot.
Jean-Marie LARRIEU et Arnaud LARRIEU, nés respectivement le 8 avril 1965 et le 31 mars 1966 à Lourdes sont cinéastes. C'est leur grand-père, originaire des Hautes-Pyrénées et cinéaste amateur, qui leur transmet la passion du cinéma et de la montagne. Adolescents, ils filment à leur tour en super-8, avant de tenter sans succès, le concours de la FEMIS, puis de suivre des études de littérature et de philosophie. À partir du milieu des années 80, ils débutent par la réalisation à quatre mains de courts-métrages qui font le tour des festivals - citons « Court Voyage » en 1987, « Temps Couvert » en 1988, « Les Baigneurs » en 1991 », « Ce Jour-là » en 1992 ou « Bernard ou les apparitions » en 1993. Ils mettront deux ans à peaufiner le scénario de leur premier long-métrage, « Fin d'été » sorti en 1999, l'histoire des retrouvailles entre un ingénieur et son père ancien soixante-huitard. Il leur vaut une reconnaissance auprès des critiques. En 2000, ils dirigent Mathieu Amalric dans « La Brèche de Roland ». Récit d'une randonnée en famille qui tourne au règlement de comptes, ce moyen-métrage au charme décalé est très remarqué à la Quinzaine des Réalisateurs. En 2003, le comédien est à l'affiche de « Un homme, un vrai », leur deuxième long-métrage aux côtés d'Hélène Fillières, que les cinéastes avaient déjà dirigée dans le court-métrage « Madonna à Lourdes » en 2001. Rythmée par les chansons de Katerine, cette comédie dans laquelle les frères décrivent l'évolution d'un couple sur plusieurs années, en multipliant les ruptures de ton, suscite l'enthousiasme de la critique. Leur idée ayant toujours été de filmer des corps dans le paysage ou des corps comme des paysages, déclaraient-ils alors à Libération. Ils partent ensuite dans les Alpes tourner « Peindre ou faire l'amour » avec Daniel Auteuil, Sabine Azéma, Amira Casar et Sergi Lopez. Ce film sur l'échangisme est présenté en compétition officielle au Festival de Cannes en 2005. Trois ans plus tard, en 2008, ils reviennent sur leur territoire de prédilection pour leur film « Le Voyage aux Pyrénées » plein d'imprévus et de fantaisies, en compagnie de Sabine Azéma et Jean-Pierre Darroussin. Le film est présenté à la Quinzaine des réalisateurs, lors de la 40e édition du Festival de Cannes 2008. En 2010, ils retrouvent Mathieu Amalric pour le film suivant, adapté d'un livre de Dominique Noguez, « Les Derniers Jours du monde ». En 2014, « L'Amour est un crime parfait », adapté d'un roman de Philippe Djian, sort sur les écrans avec Mathieu Amalric dans le rôle principal. Le 25 novembre 2015, « Vingt et une nuits avec Pattie » réunit pour la première fois sur grand écran, Isabelle Carré et Karin Viard. Une comédie policière savoureuse saupoudrée de merveilleux. Il a valu à Karin Viard (à l'affiche aux côtés d'Isabelle Carré, Sergi Lopez, André Dussolier) une nomination pour le César du meilleur second rôle féminin 2016. Pour le meilleur scénario de ce film « Vingt et une nuits avec Pattie », les frères ont obtenu le Prix du jury au Festival de Saint-Sébastien 2015 et une nomination pour le Prix Lumières 2016. Plus récemment ils furent les invités d’honneur des 35e Rencontres Cinéma de Gindou, qui se déroulèrent en août 2019 à Bouriane dans le Lot.
 Jean-Marie LARRIEU et Arnaud LARRIEU, nés respectivement le 8 avril 1965 et le 31 mars 1966 à Lourdes sont cinéastes. C'est leur grand-père, originaire des Hautes-Pyrénées et cinéaste amateur, qui leur transmet la passion du cinéma et de la montagne. Adolescents, ils filment à leur tour en super-8, avant de tenter sans succès, le concours de la FEMIS, puis de suivre des études de littérature et de philosophie. À partir du milieu des années 80, ils débutent par la réalisation à quatre mains de courts-métrages qui font le tour des festivals - citons « Court Voyage » en 1987, « Temps Couvert » en 1988, « Les Baigneurs » en 1991 », « Ce Jour-là » en 1992 ou « Bernard ou les apparitions » en 1993. Ils mettront deux ans à peaufiner le scénario de leur premier long-métrage, « Fin d'été » sorti en 1999, l'histoire des retrouvailles entre un ingénieur et son père ancien soixante-huitard. Il leur vaut une reconnaissance auprès des critiques. En 2000, ils dirigent Mathieu Amalric dans « La Brèche de Roland ». Récit d'une randonnée en famille qui tourne au règlement de comptes, ce moyen-métrage au charme décalé est très remarqué à la Quinzaine des Réalisateurs. En 2003, le comédien est à l'affiche de « Un homme, un vrai », leur deuxième long-métrage aux côtés d'Hélène Fillières, que les cinéastes avaient déjà dirigée dans le court-métrage « Madonna à Lourdes » en 2001. Rythmée par les chansons de Katerine, cette comédie dans laquelle les frères décrivent l'évolution d'un couple sur plusieurs années, en multipliant les ruptures de ton, suscite l'enthousiasme de la critique. Leur idée ayant toujours été de filmer des corps dans le paysage ou des corps comme des paysages, déclaraient-ils alors à Libération. Ils partent ensuite dans les Alpes tourner « Peindre ou faire l'amour » avec Daniel Auteuil, Sabine Azéma, Amira Casar et Sergi Lopez. Ce film sur l'échangisme est présenté en compétition officielle au Festival de Cannes en 2005. Trois ans plus tard, en 2008, ils reviennent sur leur territoire de prédilection pour leur film « Le Voyage aux Pyrénées » plein d'imprévus et de fantaisies, en compagnie de Sabine Azéma et Jean-Pierre Darroussin. Le film est présenté à la Quinzaine des réalisateurs, lors de la 40e édition du Festival de Cannes 2008. En 2010, ils retrouvent Mathieu Amalric pour le film suivant, adapté d'un livre de Dominique Noguez, « Les Derniers Jours du monde ». En 2014, « L'Amour est un crime parfait », adapté d'un roman de Philippe Djian, sort sur les écrans avec Mathieu Amalric dans le rôle principal. Le 25 novembre 2015, « Vingt et une nuits avec Pattie » réunit pour la première fois sur grand écran, Isabelle Carré et Karin Viard. Une comédie policière savoureuse saupoudrée de merveilleux. Il a valu à Karin Viard (à l'affiche aux côtés d'Isabelle Carré, Sergi Lopez, André Dussolier) une nomination pour le César du meilleur second rôle féminin 2016. Pour le meilleur scénario de ce film « Vingt et une nuits avec Pattie », les frères ont obtenu le Prix du jury au Festival de Saint-Sébastien 2015 et une nomination pour le Prix Lumières 2016. Plus récemment ils furent les invités d’honneur des 35e Rencontres Cinéma de Gindou, qui se déroulèrent en août 2019 à Bouriane dans le Lot.
Jean-Marie LARRIEU et Arnaud LARRIEU, nés respectivement le 8 avril 1965 et le 31 mars 1966 à Lourdes sont cinéastes. C'est leur grand-père, originaire des Hautes-Pyrénées et cinéaste amateur, qui leur transmet la passion du cinéma et de la montagne. Adolescents, ils filment à leur tour en super-8, avant de tenter sans succès, le concours de la FEMIS, puis de suivre des études de littérature et de philosophie. À partir du milieu des années 80, ils débutent par la réalisation à quatre mains de courts-métrages qui font le tour des festivals - citons « Court Voyage » en 1987, « Temps Couvert » en 1988, « Les Baigneurs » en 1991 », « Ce Jour-là » en 1992 ou « Bernard ou les apparitions » en 1993. Ils mettront deux ans à peaufiner le scénario de leur premier long-métrage, « Fin d'été » sorti en 1999, l'histoire des retrouvailles entre un ingénieur et son père ancien soixante-huitard. Il leur vaut une reconnaissance auprès des critiques. En 2000, ils dirigent Mathieu Amalric dans « La Brèche de Roland ». Récit d'une randonnée en famille qui tourne au règlement de comptes, ce moyen-métrage au charme décalé est très remarqué à la Quinzaine des Réalisateurs. En 2003, le comédien est à l'affiche de « Un homme, un vrai », leur deuxième long-métrage aux côtés d'Hélène Fillières, que les cinéastes avaient déjà dirigée dans le court-métrage « Madonna à Lourdes » en 2001. Rythmée par les chansons de Katerine, cette comédie dans laquelle les frères décrivent l'évolution d'un couple sur plusieurs années, en multipliant les ruptures de ton, suscite l'enthousiasme de la critique. Leur idée ayant toujours été de filmer des corps dans le paysage ou des corps comme des paysages, déclaraient-ils alors à Libération. Ils partent ensuite dans les Alpes tourner « Peindre ou faire l'amour » avec Daniel Auteuil, Sabine Azéma, Amira Casar et Sergi Lopez. Ce film sur l'échangisme est présenté en compétition officielle au Festival de Cannes en 2005. Trois ans plus tard, en 2008, ils reviennent sur leur territoire de prédilection pour leur film « Le Voyage aux Pyrénées » plein d'imprévus et de fantaisies, en compagnie de Sabine Azéma et Jean-Pierre Darroussin. Le film est présenté à la Quinzaine des réalisateurs, lors de la 40e édition du Festival de Cannes 2008. En 2010, ils retrouvent Mathieu Amalric pour le film suivant, adapté d'un livre de Dominique Noguez, « Les Derniers Jours du monde ». En 2014, « L'Amour est un crime parfait », adapté d'un roman de Philippe Djian, sort sur les écrans avec Mathieu Amalric dans le rôle principal. Le 25 novembre 2015, « Vingt et une nuits avec Pattie » réunit pour la première fois sur grand écran, Isabelle Carré et Karin Viard. Une comédie policière savoureuse saupoudrée de merveilleux. Il a valu à Karin Viard (à l'affiche aux côtés d'Isabelle Carré, Sergi Lopez, André Dussolier) une nomination pour le César du meilleur second rôle féminin 2016. Pour le meilleur scénario de ce film « Vingt et une nuits avec Pattie », les frères ont obtenu le Prix du jury au Festival de Saint-Sébastien 2015 et une nomination pour le Prix Lumières 2016. Plus récemment ils furent les invités d’honneur des 35e Rencontres Cinéma de Gindou, qui se déroulèrent en août 2019 à Bouriane dans le Lot.LATÉCOÈRE Pierre-Georges (1883-1943)
Grande figure de l’aviation, fondateur de La Ligne et pionnier du transport aérien
 Pierre-Georges LATÉCOÈRE, né le 25 août 1883 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 10 août 1943 à Paris, à l’âge de 59 ans, est le créateur de la Ligne, cette route aérienne qui relia la France à ses Colonies et à l’Amérique du Sud. Il fait de brillantes études au collège de Bagnères-de-Bigorre et au lycée Louis-le-Grand à Paris, puis il est reçu à l’École centrale des Arts et Manufactures. En 1905, à la mort de son père, l’ingénieur Gabriel Latécoère, il hérite d’une partie de la florissante entreprise familiale. Dès sa sortie, en 1906, comme ingénieur de l’École centrale, il développe la scierie de Bagnères-de-Bigorre et ajoute à l’industrie du bois celle de la construction ferroviaire pour la Compagnie des Chemins de Fer du Midi (matériel roulant pour les tramways et plus tard, dès 1911, de wagons de marchandises). En 1912, il crée l’usine du Pont des Demoiselles à Toulouse. En 1914, il s’engage dans l’artillerie. Réformé à cause de sa forte myopie, son général estimant qu’il rendra plus de service à son pays à la tête d’une industrie que derrière un canon. Il fabrique alors à Toulouse, des obus de gros calibre et à Bagnères-de-Bigorre des cuisines roulantes étudiées pour les tranchées et qui permettaient de confectionner sur place des repas chauds. Mordu par le démon de l’air, il va ajouter une nouvelle branche à son activité : la construction d’avions. Il obtient le 29 octobre 1917, du ministère des Armées la commande de 1000 avions de reconnaissance biplace Salmson 2 A2, dotés de moteurs de la même marque, et en livrera 800 avant l’Armistice. En 1917, il crée à Montaudran, près de Toulouse, en 7 mois, une usine et un terrain d’aviation. Le premier avion sort des ateliers le 5 mai 1918. Bientôt, l’usine toute entière est capable d’assembler cent cinquante avions par mois, puis à une cadence de 6 par jour. Pour gérer ces fabrications l’Administration militaire lui procure deux remarquables adjoints : Émile Dewoitine et Marcel Moine. C’est au cours de l’un des vols de réception auxquels il participait, qu’il conçut, le 25 mai 1918, l’établissement d’une Ligne France, Colonies d’Afrique et Brésil. Le 25 décembre 1918, un mois et demi après l’Armistice, à bord d’un Salmson 2 A2 biplan, piloté par René Cornemont, il franchissait pour la première fois les Pyrénées, effectuant le trajet de Toulouse-Montaudran à Barcelone en deux heures vingt. Vol d’essai qui vaudra acte de naissance de la Ligne. Le 25 février 1919, deux avions Salmson emportant, l’un Pierre-Georges Latécoère avec Junquet, l’autre Beppo de Massimi, avec Lemaître, partaient prolonger la Ligne jusqu’à Alicante. Le 19 mars 1919, avec le pilote Lemaître il franchit la distance de Toulouse à Rabat avec escales à Barcelone, Alicante et Malaga. Il porte au Maréchal Lyautey, qui le reçut sur le champ d’aviation, le Journal "Le Temps" acheté le matin à Toulouse et un bouquet de violettes fraîches à la Maréchale. L’appui du Maréchal, convaincu de la valeur de l’entreprise permit d’obtenir enfin l’aide gouvernementale et de fonder les lignes aériennes Latécoère. La ligne Toulouse-Rabat est mise en exploitation deux fois par semaine à partir du 1er octobre 1919, qui sera prolongée sur Casablanca en juillet 1920. Elle deviendra quotidienne en septembre 1922. Les Lignes Aériennes Latécoère se prolongèrent jusqu’à Dakar le 5 mai 1923, et un service postal régulier entre Toulouse et Dakar fonctionna à partir du 31 mai 1925. À 42 ans, le 23 août 1925, il fût nommé commandeur de la Légion d’honneur. Il continua, à Montaudran, la fabrication d’avions qui battirent des records mondiaux. Les 10 et 11 octobre 1927, les pilotes Jean Mermoz et Elisée Négrin effectuèrent la première liaison directe et sans escale entre Toulouse et Saint-Louis-du-Sénégal sur un Latécoère 26 (4470 km en 23 h 30). Et le 9 mai 1930, Mermoz sur l’hydravion Laté 28-3 "comte de la vaulx", effectua la première liaison postale aérienne Saint-Louis du Sénégal pour se poser en Amérique à Natal (Brésil) à travers l’Atlantique Sud. Le vol dura 21 heures et 10 minutes. Puis il construit des hydravions de gros tonnage. Le premier sera le "Lieutenant de Vaisseau Paris" de 42 tonnes. Il crée, en 1930, une base d’hydravions à Biscarrosse dans les Landes, suite aux nouvelles réglementations de l’État qui obligent les compagnies aériennes à utiliser ce type d’appareil pour les transports transocéaniques. Le 11 juillet 1931, il épouse Mademoiselle Granel qui lui donnera un fils, Pierre-Jean Latécoère. En 1937, il fait construire à Anglet, une importante usine pour la fabrication d’hydravions. En 1939, il vend à la Société des Ateliers d’Aviation Bréguet ses usines de Montaudran et d’Anglet et sa base de Biscarrosse. La Société Industrielle d’Aviation Latécoère (SIDAL) créée en 1922, construit en 1940, rue de Périole à Toulouse, une nouvelle usine d’où sortira en collaboration avec son Directeur Marcel Moine, le plus grand hydravion transatlantique du monde, le Laté 631 de 75 tonnes. Un exemplaire fut saisi par l’armée allemande puis détruit par les bombardements alliés alors qu’un deuxième était camouflé dans la banlieue toulousaine par les employés des usines. Il décèdera à Paris deux semaines avant ses 60 ans, le 10 août 1943. Il avait continué jusqu’au bout à étudier les hydravions, question qui le passionnait. Il reste une grande figure de l’aviation et de l’industrie aéronautique françaises. Le groupe Latécoère existe toujours, il fabrique des pièces pour les avionneurs. Ce sous-traitant de premier rang travaille aussi bien pour Airbus que pour Boeing ou Dassault, employant plus de 4300 personnes à travers le monde. Rue de Périole, dans le quartier de la Roseraie à Toulouse, c’est une mutation conséquente qui attend le site historique de l’entreprise Latécoère, équipementier aéronautique installé là depuis 1940. En effet, le site va faire l’objet d’une vaste transformation. En 2023, s’élèvera le futur siège social de Latécoère, qui se trouvera à proximité immédiate du métro Roseraie à Toulouse. Il s’agira d’un bâtiment de 13 000 m². Par ailleurs Latécoère a inauguré en 2018, son « usine du futur » dans le quartier de Toulouse-Montredon. Les travaux ont duré 8 mois pour achever une usine de 6 000 m². Cette usine connectée et automatisée va permettre au groupe de s’inscrire dans l’avenir de l’aéronautique. Le choix de Latécoère de rester implanté à Toulouse permet à la ville rose de conforter son statut de capitale mondiale de l’aéronautique.
Pierre-Georges LATÉCOÈRE, né le 25 août 1883 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 10 août 1943 à Paris, à l’âge de 59 ans, est le créateur de la Ligne, cette route aérienne qui relia la France à ses Colonies et à l’Amérique du Sud. Il fait de brillantes études au collège de Bagnères-de-Bigorre et au lycée Louis-le-Grand à Paris, puis il est reçu à l’École centrale des Arts et Manufactures. En 1905, à la mort de son père, l’ingénieur Gabriel Latécoère, il hérite d’une partie de la florissante entreprise familiale. Dès sa sortie, en 1906, comme ingénieur de l’École centrale, il développe la scierie de Bagnères-de-Bigorre et ajoute à l’industrie du bois celle de la construction ferroviaire pour la Compagnie des Chemins de Fer du Midi (matériel roulant pour les tramways et plus tard, dès 1911, de wagons de marchandises). En 1912, il crée l’usine du Pont des Demoiselles à Toulouse. En 1914, il s’engage dans l’artillerie. Réformé à cause de sa forte myopie, son général estimant qu’il rendra plus de service à son pays à la tête d’une industrie que derrière un canon. Il fabrique alors à Toulouse, des obus de gros calibre et à Bagnères-de-Bigorre des cuisines roulantes étudiées pour les tranchées et qui permettaient de confectionner sur place des repas chauds. Mordu par le démon de l’air, il va ajouter une nouvelle branche à son activité : la construction d’avions. Il obtient le 29 octobre 1917, du ministère des Armées la commande de 1000 avions de reconnaissance biplace Salmson 2 A2, dotés de moteurs de la même marque, et en livrera 800 avant l’Armistice. En 1917, il crée à Montaudran, près de Toulouse, en 7 mois, une usine et un terrain d’aviation. Le premier avion sort des ateliers le 5 mai 1918. Bientôt, l’usine toute entière est capable d’assembler cent cinquante avions par mois, puis à une cadence de 6 par jour. Pour gérer ces fabrications l’Administration militaire lui procure deux remarquables adjoints : Émile Dewoitine et Marcel Moine. C’est au cours de l’un des vols de réception auxquels il participait, qu’il conçut, le 25 mai 1918, l’établissement d’une Ligne France, Colonies d’Afrique et Brésil. Le 25 décembre 1918, un mois et demi après l’Armistice, à bord d’un Salmson 2 A2 biplan, piloté par René Cornemont, il franchissait pour la première fois les Pyrénées, effectuant le trajet de Toulouse-Montaudran à Barcelone en deux heures vingt. Vol d’essai qui vaudra acte de naissance de la Ligne. Le 25 février 1919, deux avions Salmson emportant, l’un Pierre-Georges Latécoère avec Junquet, l’autre Beppo de Massimi, avec Lemaître, partaient prolonger la Ligne jusqu’à Alicante. Le 19 mars 1919, avec le pilote Lemaître il franchit la distance de Toulouse à Rabat avec escales à Barcelone, Alicante et Malaga. Il porte au Maréchal Lyautey, qui le reçut sur le champ d’aviation, le Journal "Le Temps" acheté le matin à Toulouse et un bouquet de violettes fraîches à la Maréchale. L’appui du Maréchal, convaincu de la valeur de l’entreprise permit d’obtenir enfin l’aide gouvernementale et de fonder les lignes aériennes Latécoère. La ligne Toulouse-Rabat est mise en exploitation deux fois par semaine à partir du 1er octobre 1919, qui sera prolongée sur Casablanca en juillet 1920. Elle deviendra quotidienne en septembre 1922. Les Lignes Aériennes Latécoère se prolongèrent jusqu’à Dakar le 5 mai 1923, et un service postal régulier entre Toulouse et Dakar fonctionna à partir du 31 mai 1925. À 42 ans, le 23 août 1925, il fût nommé commandeur de la Légion d’honneur. Il continua, à Montaudran, la fabrication d’avions qui battirent des records mondiaux. Les 10 et 11 octobre 1927, les pilotes Jean Mermoz et Elisée Négrin effectuèrent la première liaison directe et sans escale entre Toulouse et Saint-Louis-du-Sénégal sur un Latécoère 26 (4470 km en 23 h 30). Et le 9 mai 1930, Mermoz sur l’hydravion Laté 28-3 "comte de la vaulx", effectua la première liaison postale aérienne Saint-Louis du Sénégal pour se poser en Amérique à Natal (Brésil) à travers l’Atlantique Sud. Le vol dura 21 heures et 10 minutes. Puis il construit des hydravions de gros tonnage. Le premier sera le "Lieutenant de Vaisseau Paris" de 42 tonnes. Il crée, en 1930, une base d’hydravions à Biscarrosse dans les Landes, suite aux nouvelles réglementations de l’État qui obligent les compagnies aériennes à utiliser ce type d’appareil pour les transports transocéaniques. Le 11 juillet 1931, il épouse Mademoiselle Granel qui lui donnera un fils, Pierre-Jean Latécoère. En 1937, il fait construire à Anglet, une importante usine pour la fabrication d’hydravions. En 1939, il vend à la Société des Ateliers d’Aviation Bréguet ses usines de Montaudran et d’Anglet et sa base de Biscarrosse. La Société Industrielle d’Aviation Latécoère (SIDAL) créée en 1922, construit en 1940, rue de Périole à Toulouse, une nouvelle usine d’où sortira en collaboration avec son Directeur Marcel Moine, le plus grand hydravion transatlantique du monde, le Laté 631 de 75 tonnes. Un exemplaire fut saisi par l’armée allemande puis détruit par les bombardements alliés alors qu’un deuxième était camouflé dans la banlieue toulousaine par les employés des usines. Il décèdera à Paris deux semaines avant ses 60 ans, le 10 août 1943. Il avait continué jusqu’au bout à étudier les hydravions, question qui le passionnait. Il reste une grande figure de l’aviation et de l’industrie aéronautique françaises. Le groupe Latécoère existe toujours, il fabrique des pièces pour les avionneurs. Ce sous-traitant de premier rang travaille aussi bien pour Airbus que pour Boeing ou Dassault, employant plus de 4300 personnes à travers le monde. Rue de Périole, dans le quartier de la Roseraie à Toulouse, c’est une mutation conséquente qui attend le site historique de l’entreprise Latécoère, équipementier aéronautique installé là depuis 1940. En effet, le site va faire l’objet d’une vaste transformation. En 2023, s’élèvera le futur siège social de Latécoère, qui se trouvera à proximité immédiate du métro Roseraie à Toulouse. Il s’agira d’un bâtiment de 13 000 m². Par ailleurs Latécoère a inauguré en 2018, son « usine du futur » dans le quartier de Toulouse-Montredon. Les travaux ont duré 8 mois pour achever une usine de 6 000 m². Cette usine connectée et automatisée va permettre au groupe de s’inscrire dans l’avenir de l’aéronautique. Le choix de Latécoère de rester implanté à Toulouse permet à la ville rose de conforter son statut de capitale mondiale de l’aéronautique.
 Pierre-Georges LATÉCOÈRE, né le 25 août 1883 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 10 août 1943 à Paris, à l’âge de 59 ans, est le créateur de la Ligne, cette route aérienne qui relia la France à ses Colonies et à l’Amérique du Sud. Il fait de brillantes études au collège de Bagnères-de-Bigorre et au lycée Louis-le-Grand à Paris, puis il est reçu à l’École centrale des Arts et Manufactures. En 1905, à la mort de son père, l’ingénieur Gabriel Latécoère, il hérite d’une partie de la florissante entreprise familiale. Dès sa sortie, en 1906, comme ingénieur de l’École centrale, il développe la scierie de Bagnères-de-Bigorre et ajoute à l’industrie du bois celle de la construction ferroviaire pour la Compagnie des Chemins de Fer du Midi (matériel roulant pour les tramways et plus tard, dès 1911, de wagons de marchandises). En 1912, il crée l’usine du Pont des Demoiselles à Toulouse. En 1914, il s’engage dans l’artillerie. Réformé à cause de sa forte myopie, son général estimant qu’il rendra plus de service à son pays à la tête d’une industrie que derrière un canon. Il fabrique alors à Toulouse, des obus de gros calibre et à Bagnères-de-Bigorre des cuisines roulantes étudiées pour les tranchées et qui permettaient de confectionner sur place des repas chauds. Mordu par le démon de l’air, il va ajouter une nouvelle branche à son activité : la construction d’avions. Il obtient le 29 octobre 1917, du ministère des Armées la commande de 1000 avions de reconnaissance biplace Salmson 2 A2, dotés de moteurs de la même marque, et en livrera 800 avant l’Armistice. En 1917, il crée à Montaudran, près de Toulouse, en 7 mois, une usine et un terrain d’aviation. Le premier avion sort des ateliers le 5 mai 1918. Bientôt, l’usine toute entière est capable d’assembler cent cinquante avions par mois, puis à une cadence de 6 par jour. Pour gérer ces fabrications l’Administration militaire lui procure deux remarquables adjoints : Émile Dewoitine et Marcel Moine. C’est au cours de l’un des vols de réception auxquels il participait, qu’il conçut, le 25 mai 1918, l’établissement d’une Ligne France, Colonies d’Afrique et Brésil. Le 25 décembre 1918, un mois et demi après l’Armistice, à bord d’un Salmson 2 A2 biplan, piloté par René Cornemont, il franchissait pour la première fois les Pyrénées, effectuant le trajet de Toulouse-Montaudran à Barcelone en deux heures vingt. Vol d’essai qui vaudra acte de naissance de la Ligne. Le 25 février 1919, deux avions Salmson emportant, l’un Pierre-Georges Latécoère avec Junquet, l’autre Beppo de Massimi, avec Lemaître, partaient prolonger la Ligne jusqu’à Alicante. Le 19 mars 1919, avec le pilote Lemaître il franchit la distance de Toulouse à Rabat avec escales à Barcelone, Alicante et Malaga. Il porte au Maréchal Lyautey, qui le reçut sur le champ d’aviation, le Journal "Le Temps" acheté le matin à Toulouse et un bouquet de violettes fraîches à la Maréchale. L’appui du Maréchal, convaincu de la valeur de l’entreprise permit d’obtenir enfin l’aide gouvernementale et de fonder les lignes aériennes Latécoère. La ligne Toulouse-Rabat est mise en exploitation deux fois par semaine à partir du 1er octobre 1919, qui sera prolongée sur Casablanca en juillet 1920. Elle deviendra quotidienne en septembre 1922. Les Lignes Aériennes Latécoère se prolongèrent jusqu’à Dakar le 5 mai 1923, et un service postal régulier entre Toulouse et Dakar fonctionna à partir du 31 mai 1925. À 42 ans, le 23 août 1925, il fût nommé commandeur de la Légion d’honneur. Il continua, à Montaudran, la fabrication d’avions qui battirent des records mondiaux. Les 10 et 11 octobre 1927, les pilotes Jean Mermoz et Elisée Négrin effectuèrent la première liaison directe et sans escale entre Toulouse et Saint-Louis-du-Sénégal sur un Latécoère 26 (4470 km en 23 h 30). Et le 9 mai 1930, Mermoz sur l’hydravion Laté 28-3 "comte de la vaulx", effectua la première liaison postale aérienne Saint-Louis du Sénégal pour se poser en Amérique à Natal (Brésil) à travers l’Atlantique Sud. Le vol dura 21 heures et 10 minutes. Puis il construit des hydravions de gros tonnage. Le premier sera le "Lieutenant de Vaisseau Paris" de 42 tonnes. Il crée, en 1930, une base d’hydravions à Biscarrosse dans les Landes, suite aux nouvelles réglementations de l’État qui obligent les compagnies aériennes à utiliser ce type d’appareil pour les transports transocéaniques. Le 11 juillet 1931, il épouse Mademoiselle Granel qui lui donnera un fils, Pierre-Jean Latécoère. En 1937, il fait construire à Anglet, une importante usine pour la fabrication d’hydravions. En 1939, il vend à la Société des Ateliers d’Aviation Bréguet ses usines de Montaudran et d’Anglet et sa base de Biscarrosse. La Société Industrielle d’Aviation Latécoère (SIDAL) créée en 1922, construit en 1940, rue de Périole à Toulouse, une nouvelle usine d’où sortira en collaboration avec son Directeur Marcel Moine, le plus grand hydravion transatlantique du monde, le Laté 631 de 75 tonnes. Un exemplaire fut saisi par l’armée allemande puis détruit par les bombardements alliés alors qu’un deuxième était camouflé dans la banlieue toulousaine par les employés des usines. Il décèdera à Paris deux semaines avant ses 60 ans, le 10 août 1943. Il avait continué jusqu’au bout à étudier les hydravions, question qui le passionnait. Il reste une grande figure de l’aviation et de l’industrie aéronautique françaises. Le groupe Latécoère existe toujours, il fabrique des pièces pour les avionneurs. Ce sous-traitant de premier rang travaille aussi bien pour Airbus que pour Boeing ou Dassault, employant plus de 4300 personnes à travers le monde. Rue de Périole, dans le quartier de la Roseraie à Toulouse, c’est une mutation conséquente qui attend le site historique de l’entreprise Latécoère, équipementier aéronautique installé là depuis 1940. En effet, le site va faire l’objet d’une vaste transformation. En 2023, s’élèvera le futur siège social de Latécoère, qui se trouvera à proximité immédiate du métro Roseraie à Toulouse. Il s’agira d’un bâtiment de 13 000 m². Par ailleurs Latécoère a inauguré en 2018, son « usine du futur » dans le quartier de Toulouse-Montredon. Les travaux ont duré 8 mois pour achever une usine de 6 000 m². Cette usine connectée et automatisée va permettre au groupe de s’inscrire dans l’avenir de l’aéronautique. Le choix de Latécoère de rester implanté à Toulouse permet à la ville rose de conforter son statut de capitale mondiale de l’aéronautique.
Pierre-Georges LATÉCOÈRE, né le 25 août 1883 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 10 août 1943 à Paris, à l’âge de 59 ans, est le créateur de la Ligne, cette route aérienne qui relia la France à ses Colonies et à l’Amérique du Sud. Il fait de brillantes études au collège de Bagnères-de-Bigorre et au lycée Louis-le-Grand à Paris, puis il est reçu à l’École centrale des Arts et Manufactures. En 1905, à la mort de son père, l’ingénieur Gabriel Latécoère, il hérite d’une partie de la florissante entreprise familiale. Dès sa sortie, en 1906, comme ingénieur de l’École centrale, il développe la scierie de Bagnères-de-Bigorre et ajoute à l’industrie du bois celle de la construction ferroviaire pour la Compagnie des Chemins de Fer du Midi (matériel roulant pour les tramways et plus tard, dès 1911, de wagons de marchandises). En 1912, il crée l’usine du Pont des Demoiselles à Toulouse. En 1914, il s’engage dans l’artillerie. Réformé à cause de sa forte myopie, son général estimant qu’il rendra plus de service à son pays à la tête d’une industrie que derrière un canon. Il fabrique alors à Toulouse, des obus de gros calibre et à Bagnères-de-Bigorre des cuisines roulantes étudiées pour les tranchées et qui permettaient de confectionner sur place des repas chauds. Mordu par le démon de l’air, il va ajouter une nouvelle branche à son activité : la construction d’avions. Il obtient le 29 octobre 1917, du ministère des Armées la commande de 1000 avions de reconnaissance biplace Salmson 2 A2, dotés de moteurs de la même marque, et en livrera 800 avant l’Armistice. En 1917, il crée à Montaudran, près de Toulouse, en 7 mois, une usine et un terrain d’aviation. Le premier avion sort des ateliers le 5 mai 1918. Bientôt, l’usine toute entière est capable d’assembler cent cinquante avions par mois, puis à une cadence de 6 par jour. Pour gérer ces fabrications l’Administration militaire lui procure deux remarquables adjoints : Émile Dewoitine et Marcel Moine. C’est au cours de l’un des vols de réception auxquels il participait, qu’il conçut, le 25 mai 1918, l’établissement d’une Ligne France, Colonies d’Afrique et Brésil. Le 25 décembre 1918, un mois et demi après l’Armistice, à bord d’un Salmson 2 A2 biplan, piloté par René Cornemont, il franchissait pour la première fois les Pyrénées, effectuant le trajet de Toulouse-Montaudran à Barcelone en deux heures vingt. Vol d’essai qui vaudra acte de naissance de la Ligne. Le 25 février 1919, deux avions Salmson emportant, l’un Pierre-Georges Latécoère avec Junquet, l’autre Beppo de Massimi, avec Lemaître, partaient prolonger la Ligne jusqu’à Alicante. Le 19 mars 1919, avec le pilote Lemaître il franchit la distance de Toulouse à Rabat avec escales à Barcelone, Alicante et Malaga. Il porte au Maréchal Lyautey, qui le reçut sur le champ d’aviation, le Journal "Le Temps" acheté le matin à Toulouse et un bouquet de violettes fraîches à la Maréchale. L’appui du Maréchal, convaincu de la valeur de l’entreprise permit d’obtenir enfin l’aide gouvernementale et de fonder les lignes aériennes Latécoère. La ligne Toulouse-Rabat est mise en exploitation deux fois par semaine à partir du 1er octobre 1919, qui sera prolongée sur Casablanca en juillet 1920. Elle deviendra quotidienne en septembre 1922. Les Lignes Aériennes Latécoère se prolongèrent jusqu’à Dakar le 5 mai 1923, et un service postal régulier entre Toulouse et Dakar fonctionna à partir du 31 mai 1925. À 42 ans, le 23 août 1925, il fût nommé commandeur de la Légion d’honneur. Il continua, à Montaudran, la fabrication d’avions qui battirent des records mondiaux. Les 10 et 11 octobre 1927, les pilotes Jean Mermoz et Elisée Négrin effectuèrent la première liaison directe et sans escale entre Toulouse et Saint-Louis-du-Sénégal sur un Latécoère 26 (4470 km en 23 h 30). Et le 9 mai 1930, Mermoz sur l’hydravion Laté 28-3 "comte de la vaulx", effectua la première liaison postale aérienne Saint-Louis du Sénégal pour se poser en Amérique à Natal (Brésil) à travers l’Atlantique Sud. Le vol dura 21 heures et 10 minutes. Puis il construit des hydravions de gros tonnage. Le premier sera le "Lieutenant de Vaisseau Paris" de 42 tonnes. Il crée, en 1930, une base d’hydravions à Biscarrosse dans les Landes, suite aux nouvelles réglementations de l’État qui obligent les compagnies aériennes à utiliser ce type d’appareil pour les transports transocéaniques. Le 11 juillet 1931, il épouse Mademoiselle Granel qui lui donnera un fils, Pierre-Jean Latécoère. En 1937, il fait construire à Anglet, une importante usine pour la fabrication d’hydravions. En 1939, il vend à la Société des Ateliers d’Aviation Bréguet ses usines de Montaudran et d’Anglet et sa base de Biscarrosse. La Société Industrielle d’Aviation Latécoère (SIDAL) créée en 1922, construit en 1940, rue de Périole à Toulouse, une nouvelle usine d’où sortira en collaboration avec son Directeur Marcel Moine, le plus grand hydravion transatlantique du monde, le Laté 631 de 75 tonnes. Un exemplaire fut saisi par l’armée allemande puis détruit par les bombardements alliés alors qu’un deuxième était camouflé dans la banlieue toulousaine par les employés des usines. Il décèdera à Paris deux semaines avant ses 60 ans, le 10 août 1943. Il avait continué jusqu’au bout à étudier les hydravions, question qui le passionnait. Il reste une grande figure de l’aviation et de l’industrie aéronautique françaises. Le groupe Latécoère existe toujours, il fabrique des pièces pour les avionneurs. Ce sous-traitant de premier rang travaille aussi bien pour Airbus que pour Boeing ou Dassault, employant plus de 4300 personnes à travers le monde. Rue de Périole, dans le quartier de la Roseraie à Toulouse, c’est une mutation conséquente qui attend le site historique de l’entreprise Latécoère, équipementier aéronautique installé là depuis 1940. En effet, le site va faire l’objet d’une vaste transformation. En 2023, s’élèvera le futur siège social de Latécoère, qui se trouvera à proximité immédiate du métro Roseraie à Toulouse. Il s’agira d’un bâtiment de 13 000 m². Par ailleurs Latécoère a inauguré en 2018, son « usine du futur » dans le quartier de Toulouse-Montredon. Les travaux ont duré 8 mois pour achever une usine de 6 000 m². Cette usine connectée et automatisée va permettre au groupe de s’inscrire dans l’avenir de l’aéronautique. Le choix de Latécoère de rester implanté à Toulouse permet à la ville rose de conforter son statut de capitale mondiale de l’aéronautique.LAURENS Pierre (1931-XXXX)
Docteur d’État, professeur émérite de l’université Paris-Sorbonne, membre de l'Institut de France
 Pierre LAURENS, né à Tarbes le 26 mars 1931, est un universitaire et latiniste français. Professeur émérite des universités, il a été élu à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en 2014, au fauteuil d’André Crépin. Pierre Laurens est agrégé de lettres classiques en 1955, professeur au lycée de Saint-Lô (1957-1961) et Junior fellow au Center for Hellenic Studies de l’université Harvard en 1965, il est maître de conférences puis professeur à l'université de Poitiers et à l'université Paris1 Panthéon-Sorbonne, où il a occupé la chaire de littérature latine du Moyen Âge et de la Renaissance. Docteur ès lettres en 1979, il est directeur de l’Institut de latin de l’université de Poitiers (1967-1988), directeur de la section de Littérature néo-latine au Centre d’Études supérieures de la Renaissance (1979-1988) et directeur du Groupement de Recherche « Édition et étude des textes latins humanistiques » au Centre national de la recherche scientifique, il est également membre des Conseils d’administration de l’université de Poitiers (1982-1988), de l’université de Paris-Sorbonne (1993-1999) et de l’Association Guillaume-Budé (depuis 2000), du Comité Scientifique de l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (1997-2000) et du Conseil scientifique international de restauration de la Galerie des Glaces (2005-2007). Grand historien de la littérature, les domaines d’études de Pierre Laurens sont la philologie et la littérature latine de l’Antiquité classique à la Renaissance, la poésie et la poétique grecque, latine et néo-latine, la littérature humaniste des XIVe-XVIIe siècles (Alberti, Marsile Ficin, Érasme…), les rhétoriques de la pointe (Baltasar Gracián, Emanuele Tesauro) et la réception de la tradition classique du Moyen Âge à l’époque moderne. Professeur invité dans plusieurs universités d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie, il est membre de la Société des Études latines, de la Société internationale des Études néo-latines, membre fondateur et président de la Société Française des Études néolatines (1996 à 2000), membre de la Société internationale d’Histoire de la Rhétorique (membre du Conseil de 1985 à 1989) et de la Society for Emblem Studies (1993-2003), il est pareillement membre correspondant de l’Académie pontanienne. Directeur des Cahiers de l’Humanisme et membre du Comité de rédaction d’Albertiana, de la Revue de Philologie, de Fontes et des Studi umanistici, il est l’auteur et traducteur de nombreux ouvrages dont ‘Anthologie Grecque’ (1974 et 2011), ‘le Commentaire sur le Banquet de Platon de Marsile Ficin’ (2002), ‘l’Africa de Pétrarque’ (2006). Parmi ses autres ouvrages les plus célèbres, on peut citer ‘Musæ reduces. La poésie latine dans l’Europe de la Renaissance’ (1974), ‘L’abeille dans l’ambre. Célébration de l’épigramme de l’époque alexandrine à la Renaissance’ (1989, 2012), « ‘Anthologie de la poésie lyrique latine de la Renaissance’ (2004), ‘Anthologie de l’épigramme’ (2007), ‘La dernière Muse latine, Douze lectures poétiques, de Claudien à la génération baroque’ (2008), ‘L’âge de l’inscription’ (2010), ‘Histoire critique de la littérature latine. De Virgile à Huysmans’ (2014), ou encore son dernier livre en date ‘Le sentiment de la langue. Voyage en pays latin’ (2021). La cérémonie de remise de son épée d’académicien en Sorbonne s’est tenue en 2014 dans le cadre solennel du Grand Salon, en présence de nombreuses personnalités parmi lesquelles Michel Zink, secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et Michèle Gendreau-Massaloux, ancienne rectrice de Paris. Comme le veut la tradition, cette célébration fut l’occasion de rappeler la richesse de la carrière de Pierre Laurens, qui lui vaut l’honneur de pouvoir porter l’épée.
Pierre LAURENS, né à Tarbes le 26 mars 1931, est un universitaire et latiniste français. Professeur émérite des universités, il a été élu à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en 2014, au fauteuil d’André Crépin. Pierre Laurens est agrégé de lettres classiques en 1955, professeur au lycée de Saint-Lô (1957-1961) et Junior fellow au Center for Hellenic Studies de l’université Harvard en 1965, il est maître de conférences puis professeur à l'université de Poitiers et à l'université Paris1 Panthéon-Sorbonne, où il a occupé la chaire de littérature latine du Moyen Âge et de la Renaissance. Docteur ès lettres en 1979, il est directeur de l’Institut de latin de l’université de Poitiers (1967-1988), directeur de la section de Littérature néo-latine au Centre d’Études supérieures de la Renaissance (1979-1988) et directeur du Groupement de Recherche « Édition et étude des textes latins humanistiques » au Centre national de la recherche scientifique, il est également membre des Conseils d’administration de l’université de Poitiers (1982-1988), de l’université de Paris-Sorbonne (1993-1999) et de l’Association Guillaume-Budé (depuis 2000), du Comité Scientifique de l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (1997-2000) et du Conseil scientifique international de restauration de la Galerie des Glaces (2005-2007). Grand historien de la littérature, les domaines d’études de Pierre Laurens sont la philologie et la littérature latine de l’Antiquité classique à la Renaissance, la poésie et la poétique grecque, latine et néo-latine, la littérature humaniste des XIVe-XVIIe siècles (Alberti, Marsile Ficin, Érasme…), les rhétoriques de la pointe (Baltasar Gracián, Emanuele Tesauro) et la réception de la tradition classique du Moyen Âge à l’époque moderne. Professeur invité dans plusieurs universités d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie, il est membre de la Société des Études latines, de la Société internationale des Études néo-latines, membre fondateur et président de la Société Française des Études néolatines (1996 à 2000), membre de la Société internationale d’Histoire de la Rhétorique (membre du Conseil de 1985 à 1989) et de la Society for Emblem Studies (1993-2003), il est pareillement membre correspondant de l’Académie pontanienne. Directeur des Cahiers de l’Humanisme et membre du Comité de rédaction d’Albertiana, de la Revue de Philologie, de Fontes et des Studi umanistici, il est l’auteur et traducteur de nombreux ouvrages dont ‘Anthologie Grecque’ (1974 et 2011), ‘le Commentaire sur le Banquet de Platon de Marsile Ficin’ (2002), ‘l’Africa de Pétrarque’ (2006). Parmi ses autres ouvrages les plus célèbres, on peut citer ‘Musæ reduces. La poésie latine dans l’Europe de la Renaissance’ (1974), ‘L’abeille dans l’ambre. Célébration de l’épigramme de l’époque alexandrine à la Renaissance’ (1989, 2012), « ‘Anthologie de la poésie lyrique latine de la Renaissance’ (2004), ‘Anthologie de l’épigramme’ (2007), ‘La dernière Muse latine, Douze lectures poétiques, de Claudien à la génération baroque’ (2008), ‘L’âge de l’inscription’ (2010), ‘Histoire critique de la littérature latine. De Virgile à Huysmans’ (2014), ou encore son dernier livre en date ‘Le sentiment de la langue. Voyage en pays latin’ (2021). La cérémonie de remise de son épée d’académicien en Sorbonne s’est tenue en 2014 dans le cadre solennel du Grand Salon, en présence de nombreuses personnalités parmi lesquelles Michel Zink, secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et Michèle Gendreau-Massaloux, ancienne rectrice de Paris. Comme le veut la tradition, cette célébration fut l’occasion de rappeler la richesse de la carrière de Pierre Laurens, qui lui vaut l’honneur de pouvoir porter l’épée.
 Pierre LAURENS, né à Tarbes le 26 mars 1931, est un universitaire et latiniste français. Professeur émérite des universités, il a été élu à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en 2014, au fauteuil d’André Crépin. Pierre Laurens est agrégé de lettres classiques en 1955, professeur au lycée de Saint-Lô (1957-1961) et Junior fellow au Center for Hellenic Studies de l’université Harvard en 1965, il est maître de conférences puis professeur à l'université de Poitiers et à l'université Paris1 Panthéon-Sorbonne, où il a occupé la chaire de littérature latine du Moyen Âge et de la Renaissance. Docteur ès lettres en 1979, il est directeur de l’Institut de latin de l’université de Poitiers (1967-1988), directeur de la section de Littérature néo-latine au Centre d’Études supérieures de la Renaissance (1979-1988) et directeur du Groupement de Recherche « Édition et étude des textes latins humanistiques » au Centre national de la recherche scientifique, il est également membre des Conseils d’administration de l’université de Poitiers (1982-1988), de l’université de Paris-Sorbonne (1993-1999) et de l’Association Guillaume-Budé (depuis 2000), du Comité Scientifique de l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (1997-2000) et du Conseil scientifique international de restauration de la Galerie des Glaces (2005-2007). Grand historien de la littérature, les domaines d’études de Pierre Laurens sont la philologie et la littérature latine de l’Antiquité classique à la Renaissance, la poésie et la poétique grecque, latine et néo-latine, la littérature humaniste des XIVe-XVIIe siècles (Alberti, Marsile Ficin, Érasme…), les rhétoriques de la pointe (Baltasar Gracián, Emanuele Tesauro) et la réception de la tradition classique du Moyen Âge à l’époque moderne. Professeur invité dans plusieurs universités d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie, il est membre de la Société des Études latines, de la Société internationale des Études néo-latines, membre fondateur et président de la Société Française des Études néolatines (1996 à 2000), membre de la Société internationale d’Histoire de la Rhétorique (membre du Conseil de 1985 à 1989) et de la Society for Emblem Studies (1993-2003), il est pareillement membre correspondant de l’Académie pontanienne. Directeur des Cahiers de l’Humanisme et membre du Comité de rédaction d’Albertiana, de la Revue de Philologie, de Fontes et des Studi umanistici, il est l’auteur et traducteur de nombreux ouvrages dont ‘Anthologie Grecque’ (1974 et 2011), ‘le Commentaire sur le Banquet de Platon de Marsile Ficin’ (2002), ‘l’Africa de Pétrarque’ (2006). Parmi ses autres ouvrages les plus célèbres, on peut citer ‘Musæ reduces. La poésie latine dans l’Europe de la Renaissance’ (1974), ‘L’abeille dans l’ambre. Célébration de l’épigramme de l’époque alexandrine à la Renaissance’ (1989, 2012), « ‘Anthologie de la poésie lyrique latine de la Renaissance’ (2004), ‘Anthologie de l’épigramme’ (2007), ‘La dernière Muse latine, Douze lectures poétiques, de Claudien à la génération baroque’ (2008), ‘L’âge de l’inscription’ (2010), ‘Histoire critique de la littérature latine. De Virgile à Huysmans’ (2014), ou encore son dernier livre en date ‘Le sentiment de la langue. Voyage en pays latin’ (2021). La cérémonie de remise de son épée d’académicien en Sorbonne s’est tenue en 2014 dans le cadre solennel du Grand Salon, en présence de nombreuses personnalités parmi lesquelles Michel Zink, secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et Michèle Gendreau-Massaloux, ancienne rectrice de Paris. Comme le veut la tradition, cette célébration fut l’occasion de rappeler la richesse de la carrière de Pierre Laurens, qui lui vaut l’honneur de pouvoir porter l’épée.
Pierre LAURENS, né à Tarbes le 26 mars 1931, est un universitaire et latiniste français. Professeur émérite des universités, il a été élu à l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres en 2014, au fauteuil d’André Crépin. Pierre Laurens est agrégé de lettres classiques en 1955, professeur au lycée de Saint-Lô (1957-1961) et Junior fellow au Center for Hellenic Studies de l’université Harvard en 1965, il est maître de conférences puis professeur à l'université de Poitiers et à l'université Paris1 Panthéon-Sorbonne, où il a occupé la chaire de littérature latine du Moyen Âge et de la Renaissance. Docteur ès lettres en 1979, il est directeur de l’Institut de latin de l’université de Poitiers (1967-1988), directeur de la section de Littérature néo-latine au Centre d’Études supérieures de la Renaissance (1979-1988) et directeur du Groupement de Recherche « Édition et étude des textes latins humanistiques » au Centre national de la recherche scientifique, il est également membre des Conseils d’administration de l’université de Poitiers (1982-1988), de l’université de Paris-Sorbonne (1993-1999) et de l’Association Guillaume-Budé (depuis 2000), du Comité Scientifique de l’Institut de Recherche et d’Histoire des Textes (1997-2000) et du Conseil scientifique international de restauration de la Galerie des Glaces (2005-2007). Grand historien de la littérature, les domaines d’études de Pierre Laurens sont la philologie et la littérature latine de l’Antiquité classique à la Renaissance, la poésie et la poétique grecque, latine et néo-latine, la littérature humaniste des XIVe-XVIIe siècles (Alberti, Marsile Ficin, Érasme…), les rhétoriques de la pointe (Baltasar Gracián, Emanuele Tesauro) et la réception de la tradition classique du Moyen Âge à l’époque moderne. Professeur invité dans plusieurs universités d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie, il est membre de la Société des Études latines, de la Société internationale des Études néo-latines, membre fondateur et président de la Société Française des Études néolatines (1996 à 2000), membre de la Société internationale d’Histoire de la Rhétorique (membre du Conseil de 1985 à 1989) et de la Society for Emblem Studies (1993-2003), il est pareillement membre correspondant de l’Académie pontanienne. Directeur des Cahiers de l’Humanisme et membre du Comité de rédaction d’Albertiana, de la Revue de Philologie, de Fontes et des Studi umanistici, il est l’auteur et traducteur de nombreux ouvrages dont ‘Anthologie Grecque’ (1974 et 2011), ‘le Commentaire sur le Banquet de Platon de Marsile Ficin’ (2002), ‘l’Africa de Pétrarque’ (2006). Parmi ses autres ouvrages les plus célèbres, on peut citer ‘Musæ reduces. La poésie latine dans l’Europe de la Renaissance’ (1974), ‘L’abeille dans l’ambre. Célébration de l’épigramme de l’époque alexandrine à la Renaissance’ (1989, 2012), « ‘Anthologie de la poésie lyrique latine de la Renaissance’ (2004), ‘Anthologie de l’épigramme’ (2007), ‘La dernière Muse latine, Douze lectures poétiques, de Claudien à la génération baroque’ (2008), ‘L’âge de l’inscription’ (2010), ‘Histoire critique de la littérature latine. De Virgile à Huysmans’ (2014), ou encore son dernier livre en date ‘Le sentiment de la langue. Voyage en pays latin’ (2021). La cérémonie de remise de son épée d’académicien en Sorbonne s’est tenue en 2014 dans le cadre solennel du Grand Salon, en présence de nombreuses personnalités parmi lesquelles Michel Zink, secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et Michèle Gendreau-Massaloux, ancienne rectrice de Paris. Comme le veut la tradition, cette célébration fut l’occasion de rappeler la richesse de la carrière de Pierre Laurens, qui lui vaut l’honneur de pouvoir porter l’épée.LAUTRÉAMONT (1846-1870)
Écrivain et poète
 Comte de LAUTRÉAMONT, Isidore Lucien Ducasse de son vrai nom, né le 4 avril 1846 à Montevideo et mort le 24 novembre 1870 à Paris, à l’âge de 24 ans, est le fils de François Ducasse, né à Bazet, instituteur et secrétaire de mairie à Sarniguet et de Jacquette-Célestine Davezac, née à Sarniguet. Vers 1840, François Ducasse émigre à Montevideo, en Uruguay. Homme d'une grande culture, il entre comme commis-chancelier au Consulat-général de France. En 1846, il épouse à Montevideo Jacquette Davezac. Celle-ci est déjà enceinte d’Isidore. Le 4 avril, naît à Montevideo Isidore Lucien Ducasse. Le 16 novembre 1847, Isidore est baptisé à la cathédrale de Montevideo. Le 9 décembre meurt sa mère. On a supposé qu’elle se serait suicidée. Orphelin de mère, il est élevé par son père qui travaille au Consulat français de l’Uruguay. Le 28 juin 1856, François Ducasse est nommé chancelier de première classe au consulat de Montevideo. Isidore est confié à l’âge de 13 ans à un ami de la famille, Jean Dazet, un avoué tarbais, et déménage à Tarbes où il suivra ses études secondaires. En octobre 1959, à 13 ans et demi, Isidore entre comme interne en classe de sixième au lycée impérial de Tarbes (actuel lycée Théophile-Gautier). Jean Dazet est l’un de ses tuteurs. C’est à cette période qu’il nouera des amitiés fortes (Paul Lespès, Georges Minvielle et Georges Dazet, le fils de Jean, futur avocat et théoricien du parti socialiste de Jules Guesde, condisciple d’Isidore et premier dédicataire de « Poésies », qui auront chacun leur place dans Les Chants de Maldoror). En 1861, Isidore est en cinquième et l’année suivante en quatrième, quand il obtient un premier accessit d’excellence. Il passe ses vacances scolaires à Bazet. En 1863, on perd sa trace pour cette année scolaire. On suppose qu’il a suivi des études dans un collège privé pour rattraper son retard scolaire. Le 16 avril, il écrit sur un exemplaire de l’lliade d’Homère, traduit en espagnol par José Gómez Hermosilla. Le 17 octobre, Isidore entre au lycée impérial de Pau (qui deviendra le lycée Louis-Barthou), comme interne, en classe de Rhétorique. En 1864, année de Rhétorique, les résultats d’Isidore Ducasse sont très modestes. En octobre, il entre en classe de philosophie. En 1865, il a passé et obtenu son baccalauréat ès lettres avec la mention passable. Il s’est inscrit, la même année, en classe de mathématiques élémentaires. En 1866, il obtiendra son baccalauréat ès sciences. En 1867, après un court séjour à Montevideo, il arrive à Paris et s’installe à l’hôtel L’Union des Nations au 23, rue Notre-Dame-des Victoires, où il se consacre totalement, entretenu par l’argent que lui verse mensuellement son père, à l’écriture des Chants de Maldoror et de deux fascicules de poésies. Il entame des études supérieures dont la nature reste inconnue (concours d’entrée à l’École polytechnique, a-t-on souvent écrit). En août 1868, le premier des Chants de Maldoror est imprimé à compte d’auteur chez l’imprimeur Balitout, Questroy et Cie. Le 9 novembre, il écrit à un critique en lui envoyant le Chant premier et le 10 novembre, il écrit à Victor Hugo en lui adressant sa plaquette. En janvier 1869, la Revue populaire de Paris de Louise Bader publie une publicité pour Les Chants de Maldoror et fin janvier, seconde édition, à Bordeaux, du premier chant des Chants de Maldoror dans le recueil collectif d’Évariste Carrance, intitulé Parfums de l’âme. Durant l’été 1869, le manuscrit des six Chants de Maldoror est envoyé à Bruxelles pour être imprimé et sera signé « Comte de Lautréamont » par Albert Lacroix mais sans référence d'éditeur. L'ouvrage ne sera pas diffusé mais Ducasse et Lacroix restèrent en contact. En octobre, il habite au 32, rue du Faubourg-Montmartre et en mars 1870, il déménage au 15, rue Vivienne. Le 9 avril, dépôt légal de Poésies I et le 14 juin, celui de Poésies II. Le même accueil fut réservé à ses fragments en prose (Poésies, 1870), rédigés peu de temps avant sa mort, qui passèrent inaperçus. Le 24 novembre 1870, alors que le Second Empire s’effondre, il meurt au 7, rue du Faubourg-Montmartre et est enterré le lendemain au cimetière du Nord (cimetière de Montmartre), après un service religieux à l’église Notre-Dame-de-Lorette. Sur son acte de décès, est écrit : « Sans autres renseignements ». Selon ses biographes, il serait mort phtisique. En 1887, son père François décèdera à son tour à Montevideo. Plus connu par son pseudonyme de comte de Lautréamont, qu'il emprunta très probablement au Latréaumont (1838) d'Eugène Sue, Isidore Ducasse restera un poète franco-uruguayen, auteur des Chants de Maldoror et de deux fascicules, Poésies I et Poésies II. Pour résumer nous dirons que sa vie fut brève. Jusqu'en 1860, on ne sait ce qu'il advient de lui. On pense qu’il commença ses études chez les jésuites. Né en Amérique du Sud, il est étranger dans le pays où, adolescent, il vient faire ses études, la France. Peut-être est-il envoyé en France pour préparer le concours d’entrée à l’École polytechnique ? On le retrouve élève au lycée impérial de Tarbes (1860-1862), puis en 1963 au lycée de Pau. Renonçant au concours d’entrée à l'École polytechnique pour des raisons mystérieuses, en 1867, il vint se fixer définitivement à Paris pour faire des études et suivre sa vocation d’écrivain, très affirmée dès le plus jeune âge. De ce séjour à Paris, nulle trace, si ce n'est celle des différents hôtels qu'il habite. À peine son œuvre est-elle publiée, qu’il meurt brusquement, à 24 ans, quasiment inconnu de son vivant, en plein siège de Paris, de la guerre franco-prussienne, sans avoir connu la gloire à laquelle il aspirait. Les causes de sa mort ne sont pas connues et sont mystérieuses. Lautréamont ne laissa qu'un livre unique, les Chants de Maldoror, deux fascicules intitulés Poésies, qui sont bien davantage une « préface à un livre futur », et quelques lettres à son éditeur. Les Chants de Maldoror (1869) ne connurent pas l'accueil du public du vivant de l'auteur, car, selon les propres termes de Lautréamont, « une fois qu'il fut imprimé, l'éditeur a refusé de le faire paraître, parce que la vie y était peinte sous des couleurs trop amères et qu'il craignait le procureur général ». Ils ne sont redécouverts que dans les années 1885, notamment par Léon Bloy. L’audace de son œuvre, qui lui vaut d’être étouffée à sa première parution, fait de lui une figure de l’avant-garde. Le mystère qui entoure sa vie, dont nous ne connaissons que quelques éléments, contribue à forger sa légende. Lautréamont est entré dans l’histoire littéraire grâce à la célébrité progressivement conquise de ses Chants de Maldoror, notamment auprès des poètes surréalistes après la guerre de 1914-1918. Il faudra attendre 1917 pour que les fondateurs du surréalisme, Philippe Soupault et André Breton, redécouvrent l’œuvre de Lautréamont. Des surréalistes, dont il sera le maître à penser, le maître à vivre. Ses écrits tombés dans l’oubli pendant des années seront connus et célébrés dans les années 1920. Les Chants de Maldoror se présentent sous la forme de six chants, composés de strophes qui semblent à première vue n'avoir aucun lien les unes avec les autres. À l'intérieur de chacune de ces strophes, les digressions ne manquent pas pour dérouter le lecteur et lui faire accroire qu'il s'agit bien d'un « génie malade ». C’est un très long poème en prose, empli de rage, de sauvagerie mais aussi de précisions littéraires et scientifiques. Au fil des pages, Ducasse raconte en termes outrés et sanglants sa haine des hommes, son amour de la mort et de la nature, donne la parole à des animaux et des chimères, préfigure le cut-up en recopiant des pages de manuels de biologie de son époque (dont une émouvante description du vol de la cigogne), se bat en duel, voue aux gémonies le Tout-Puissant, raconte le Paris des pauvres et des malades et affirme que “Depuis Racine, la poésie n’a pas progressé d’un millimètre.” Réédités en 1874 puis en 1890, les Chants de Maldoror donnèrent prise aux jugements les plus arbitraires (on prétendit notamment que Ducasse était atteint de folie), avant d’être remarqués par les symbolistes puis exaltés par les surréalistes. Louant cette littérature de la révolte, Breton écrivit : « C’est au comte de Lautréamont qu’incombe peut-être la plus grande part de l’état de choses poétique actuel : entendez la révolution surréaliste. » De son côté, Gracq voyait dans les Chants de Maldoror un « torrent d’aveux corrosifs alimenté par trois siècles de mauvaise conscience littéraire », estimant que cette œuvre était venue « à point nommé pour corriger dans notre littérature un déséquilibre des plus graves ». De fait, on y trouve, pour la première fois dans la littérature française, une critique lucide du langage poétique. Célébré dès le premier chant, le thème du « mal » libère d’étranges forces obscures et salvatrices (celles de l’inconscient) que les chants II et IV amplifient de résonances ténébreuses. Or, parallèlement à cette glorification du mal, Lautréamont déploie un art de l’ironie sans précédent dans l’histoire des lettres, se livrant à un détournement en règle des traditions du récit populaire français et du roman noir gothique, apparu en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Cette révolte blasphématoire se traduit sur le plan poétique par une sacralisation des fantasmes (spécialement perceptible dans le bestiaire du chant V). Quant aux Poésies, elles proposent une nouvelle manière de traiter la forme littéraire, renouvelant notamment le genre de la maxime, sous l’apparence d’un style désinvolte. Emporté par le flot quasi « automatique » de son débit verbal, Lautréamont s’y révèle un exceptionnel créateur de métaphores. L’exemple le plus caractéristique de cette capacité à concevoir de nouvelles images se trouve dans la série des « Beau comme ! … » des chants V et VI, où l’auteur supprime un des deux termes de la comparaison, atteignant à la quintessence de l’effet poétique recherché par les surréalistes. Ici, comme dans les Chants de Maldoror, le lecteur, sollicité par l’apostrophe et l’incantation, est prié d’accompagner l’écrivain jusqu’aux limites extrêmes de sa création : ainsi peut-il s’effacer (« La poésie personnelle a fait son temps ») et, à l’instar de son héros Maldoror, échapper à l’humanité pour servir « les délires de la cruauté ». Écrivain français, il fut considéré par les surréalistes comme un précurseur de la révolution littéraire du XXe siècle. Car son œuvre ne fut connue qu'au vingtième siècle : il fallut attendre les surréalistes, puis des critiques comme Bachelard, Sollers et Kristeva pour que l'esthétique exacerbée et que l'ironie de Lautréamont trouvent ses lecteurs. En signant sous l’énigmatique pseudonyme de “Comte de Lautréamont” six chants enhardis et féroces, il changea le visage de la poésie française pour de longues décennies. Un destin hors du commun qui se termina à l’âge de 24 ans. En 1977, le Tarbais Jean-Jacques Lefrère, dans « Le Visage de Lautréamont », publie une photographie qu’il affirme être celle d’lsidore Ducasse, dit comte de Lautréamont, auteur des Chants de Maldoror et des Poésies. Un lycée professionnel des métiers ainsi qu’une rue de Tarbes portent aujourd’hui son nom.
Comte de LAUTRÉAMONT, Isidore Lucien Ducasse de son vrai nom, né le 4 avril 1846 à Montevideo et mort le 24 novembre 1870 à Paris, à l’âge de 24 ans, est le fils de François Ducasse, né à Bazet, instituteur et secrétaire de mairie à Sarniguet et de Jacquette-Célestine Davezac, née à Sarniguet. Vers 1840, François Ducasse émigre à Montevideo, en Uruguay. Homme d'une grande culture, il entre comme commis-chancelier au Consulat-général de France. En 1846, il épouse à Montevideo Jacquette Davezac. Celle-ci est déjà enceinte d’Isidore. Le 4 avril, naît à Montevideo Isidore Lucien Ducasse. Le 16 novembre 1847, Isidore est baptisé à la cathédrale de Montevideo. Le 9 décembre meurt sa mère. On a supposé qu’elle se serait suicidée. Orphelin de mère, il est élevé par son père qui travaille au Consulat français de l’Uruguay. Le 28 juin 1856, François Ducasse est nommé chancelier de première classe au consulat de Montevideo. Isidore est confié à l’âge de 13 ans à un ami de la famille, Jean Dazet, un avoué tarbais, et déménage à Tarbes où il suivra ses études secondaires. En octobre 1959, à 13 ans et demi, Isidore entre comme interne en classe de sixième au lycée impérial de Tarbes (actuel lycée Théophile-Gautier). Jean Dazet est l’un de ses tuteurs. C’est à cette période qu’il nouera des amitiés fortes (Paul Lespès, Georges Minvielle et Georges Dazet, le fils de Jean, futur avocat et théoricien du parti socialiste de Jules Guesde, condisciple d’Isidore et premier dédicataire de « Poésies », qui auront chacun leur place dans Les Chants de Maldoror). En 1861, Isidore est en cinquième et l’année suivante en quatrième, quand il obtient un premier accessit d’excellence. Il passe ses vacances scolaires à Bazet. En 1863, on perd sa trace pour cette année scolaire. On suppose qu’il a suivi des études dans un collège privé pour rattraper son retard scolaire. Le 16 avril, il écrit sur un exemplaire de l’lliade d’Homère, traduit en espagnol par José Gómez Hermosilla. Le 17 octobre, Isidore entre au lycée impérial de Pau (qui deviendra le lycée Louis-Barthou), comme interne, en classe de Rhétorique. En 1864, année de Rhétorique, les résultats d’Isidore Ducasse sont très modestes. En octobre, il entre en classe de philosophie. En 1865, il a passé et obtenu son baccalauréat ès lettres avec la mention passable. Il s’est inscrit, la même année, en classe de mathématiques élémentaires. En 1866, il obtiendra son baccalauréat ès sciences. En 1867, après un court séjour à Montevideo, il arrive à Paris et s’installe à l’hôtel L’Union des Nations au 23, rue Notre-Dame-des Victoires, où il se consacre totalement, entretenu par l’argent que lui verse mensuellement son père, à l’écriture des Chants de Maldoror et de deux fascicules de poésies. Il entame des études supérieures dont la nature reste inconnue (concours d’entrée à l’École polytechnique, a-t-on souvent écrit). En août 1868, le premier des Chants de Maldoror est imprimé à compte d’auteur chez l’imprimeur Balitout, Questroy et Cie. Le 9 novembre, il écrit à un critique en lui envoyant le Chant premier et le 10 novembre, il écrit à Victor Hugo en lui adressant sa plaquette. En janvier 1869, la Revue populaire de Paris de Louise Bader publie une publicité pour Les Chants de Maldoror et fin janvier, seconde édition, à Bordeaux, du premier chant des Chants de Maldoror dans le recueil collectif d’Évariste Carrance, intitulé Parfums de l’âme. Durant l’été 1869, le manuscrit des six Chants de Maldoror est envoyé à Bruxelles pour être imprimé et sera signé « Comte de Lautréamont » par Albert Lacroix mais sans référence d'éditeur. L'ouvrage ne sera pas diffusé mais Ducasse et Lacroix restèrent en contact. En octobre, il habite au 32, rue du Faubourg-Montmartre et en mars 1870, il déménage au 15, rue Vivienne. Le 9 avril, dépôt légal de Poésies I et le 14 juin, celui de Poésies II. Le même accueil fut réservé à ses fragments en prose (Poésies, 1870), rédigés peu de temps avant sa mort, qui passèrent inaperçus. Le 24 novembre 1870, alors que le Second Empire s’effondre, il meurt au 7, rue du Faubourg-Montmartre et est enterré le lendemain au cimetière du Nord (cimetière de Montmartre), après un service religieux à l’église Notre-Dame-de-Lorette. Sur son acte de décès, est écrit : « Sans autres renseignements ». Selon ses biographes, il serait mort phtisique. En 1887, son père François décèdera à son tour à Montevideo. Plus connu par son pseudonyme de comte de Lautréamont, qu'il emprunta très probablement au Latréaumont (1838) d'Eugène Sue, Isidore Ducasse restera un poète franco-uruguayen, auteur des Chants de Maldoror et de deux fascicules, Poésies I et Poésies II. Pour résumer nous dirons que sa vie fut brève. Jusqu'en 1860, on ne sait ce qu'il advient de lui. On pense qu’il commença ses études chez les jésuites. Né en Amérique du Sud, il est étranger dans le pays où, adolescent, il vient faire ses études, la France. Peut-être est-il envoyé en France pour préparer le concours d’entrée à l’École polytechnique ? On le retrouve élève au lycée impérial de Tarbes (1860-1862), puis en 1963 au lycée de Pau. Renonçant au concours d’entrée à l'École polytechnique pour des raisons mystérieuses, en 1867, il vint se fixer définitivement à Paris pour faire des études et suivre sa vocation d’écrivain, très affirmée dès le plus jeune âge. De ce séjour à Paris, nulle trace, si ce n'est celle des différents hôtels qu'il habite. À peine son œuvre est-elle publiée, qu’il meurt brusquement, à 24 ans, quasiment inconnu de son vivant, en plein siège de Paris, de la guerre franco-prussienne, sans avoir connu la gloire à laquelle il aspirait. Les causes de sa mort ne sont pas connues et sont mystérieuses. Lautréamont ne laissa qu'un livre unique, les Chants de Maldoror, deux fascicules intitulés Poésies, qui sont bien davantage une « préface à un livre futur », et quelques lettres à son éditeur. Les Chants de Maldoror (1869) ne connurent pas l'accueil du public du vivant de l'auteur, car, selon les propres termes de Lautréamont, « une fois qu'il fut imprimé, l'éditeur a refusé de le faire paraître, parce que la vie y était peinte sous des couleurs trop amères et qu'il craignait le procureur général ». Ils ne sont redécouverts que dans les années 1885, notamment par Léon Bloy. L’audace de son œuvre, qui lui vaut d’être étouffée à sa première parution, fait de lui une figure de l’avant-garde. Le mystère qui entoure sa vie, dont nous ne connaissons que quelques éléments, contribue à forger sa légende. Lautréamont est entré dans l’histoire littéraire grâce à la célébrité progressivement conquise de ses Chants de Maldoror, notamment auprès des poètes surréalistes après la guerre de 1914-1918. Il faudra attendre 1917 pour que les fondateurs du surréalisme, Philippe Soupault et André Breton, redécouvrent l’œuvre de Lautréamont. Des surréalistes, dont il sera le maître à penser, le maître à vivre. Ses écrits tombés dans l’oubli pendant des années seront connus et célébrés dans les années 1920. Les Chants de Maldoror se présentent sous la forme de six chants, composés de strophes qui semblent à première vue n'avoir aucun lien les unes avec les autres. À l'intérieur de chacune de ces strophes, les digressions ne manquent pas pour dérouter le lecteur et lui faire accroire qu'il s'agit bien d'un « génie malade ». C’est un très long poème en prose, empli de rage, de sauvagerie mais aussi de précisions littéraires et scientifiques. Au fil des pages, Ducasse raconte en termes outrés et sanglants sa haine des hommes, son amour de la mort et de la nature, donne la parole à des animaux et des chimères, préfigure le cut-up en recopiant des pages de manuels de biologie de son époque (dont une émouvante description du vol de la cigogne), se bat en duel, voue aux gémonies le Tout-Puissant, raconte le Paris des pauvres et des malades et affirme que “Depuis Racine, la poésie n’a pas progressé d’un millimètre.” Réédités en 1874 puis en 1890, les Chants de Maldoror donnèrent prise aux jugements les plus arbitraires (on prétendit notamment que Ducasse était atteint de folie), avant d’être remarqués par les symbolistes puis exaltés par les surréalistes. Louant cette littérature de la révolte, Breton écrivit : « C’est au comte de Lautréamont qu’incombe peut-être la plus grande part de l’état de choses poétique actuel : entendez la révolution surréaliste. » De son côté, Gracq voyait dans les Chants de Maldoror un « torrent d’aveux corrosifs alimenté par trois siècles de mauvaise conscience littéraire », estimant que cette œuvre était venue « à point nommé pour corriger dans notre littérature un déséquilibre des plus graves ». De fait, on y trouve, pour la première fois dans la littérature française, une critique lucide du langage poétique. Célébré dès le premier chant, le thème du « mal » libère d’étranges forces obscures et salvatrices (celles de l’inconscient) que les chants II et IV amplifient de résonances ténébreuses. Or, parallèlement à cette glorification du mal, Lautréamont déploie un art de l’ironie sans précédent dans l’histoire des lettres, se livrant à un détournement en règle des traditions du récit populaire français et du roman noir gothique, apparu en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Cette révolte blasphématoire se traduit sur le plan poétique par une sacralisation des fantasmes (spécialement perceptible dans le bestiaire du chant V). Quant aux Poésies, elles proposent une nouvelle manière de traiter la forme littéraire, renouvelant notamment le genre de la maxime, sous l’apparence d’un style désinvolte. Emporté par le flot quasi « automatique » de son débit verbal, Lautréamont s’y révèle un exceptionnel créateur de métaphores. L’exemple le plus caractéristique de cette capacité à concevoir de nouvelles images se trouve dans la série des « Beau comme ! … » des chants V et VI, où l’auteur supprime un des deux termes de la comparaison, atteignant à la quintessence de l’effet poétique recherché par les surréalistes. Ici, comme dans les Chants de Maldoror, le lecteur, sollicité par l’apostrophe et l’incantation, est prié d’accompagner l’écrivain jusqu’aux limites extrêmes de sa création : ainsi peut-il s’effacer (« La poésie personnelle a fait son temps ») et, à l’instar de son héros Maldoror, échapper à l’humanité pour servir « les délires de la cruauté ». Écrivain français, il fut considéré par les surréalistes comme un précurseur de la révolution littéraire du XXe siècle. Car son œuvre ne fut connue qu'au vingtième siècle : il fallut attendre les surréalistes, puis des critiques comme Bachelard, Sollers et Kristeva pour que l'esthétique exacerbée et que l'ironie de Lautréamont trouvent ses lecteurs. En signant sous l’énigmatique pseudonyme de “Comte de Lautréamont” six chants enhardis et féroces, il changea le visage de la poésie française pour de longues décennies. Un destin hors du commun qui se termina à l’âge de 24 ans. En 1977, le Tarbais Jean-Jacques Lefrère, dans « Le Visage de Lautréamont », publie une photographie qu’il affirme être celle d’lsidore Ducasse, dit comte de Lautréamont, auteur des Chants de Maldoror et des Poésies. Un lycée professionnel des métiers ainsi qu’une rue de Tarbes portent aujourd’hui son nom.
 Comte de LAUTRÉAMONT, Isidore Lucien Ducasse de son vrai nom, né le 4 avril 1846 à Montevideo et mort le 24 novembre 1870 à Paris, à l’âge de 24 ans, est le fils de François Ducasse, né à Bazet, instituteur et secrétaire de mairie à Sarniguet et de Jacquette-Célestine Davezac, née à Sarniguet. Vers 1840, François Ducasse émigre à Montevideo, en Uruguay. Homme d'une grande culture, il entre comme commis-chancelier au Consulat-général de France. En 1846, il épouse à Montevideo Jacquette Davezac. Celle-ci est déjà enceinte d’Isidore. Le 4 avril, naît à Montevideo Isidore Lucien Ducasse. Le 16 novembre 1847, Isidore est baptisé à la cathédrale de Montevideo. Le 9 décembre meurt sa mère. On a supposé qu’elle se serait suicidée. Orphelin de mère, il est élevé par son père qui travaille au Consulat français de l’Uruguay. Le 28 juin 1856, François Ducasse est nommé chancelier de première classe au consulat de Montevideo. Isidore est confié à l’âge de 13 ans à un ami de la famille, Jean Dazet, un avoué tarbais, et déménage à Tarbes où il suivra ses études secondaires. En octobre 1959, à 13 ans et demi, Isidore entre comme interne en classe de sixième au lycée impérial de Tarbes (actuel lycée Théophile-Gautier). Jean Dazet est l’un de ses tuteurs. C’est à cette période qu’il nouera des amitiés fortes (Paul Lespès, Georges Minvielle et Georges Dazet, le fils de Jean, futur avocat et théoricien du parti socialiste de Jules Guesde, condisciple d’Isidore et premier dédicataire de « Poésies », qui auront chacun leur place dans Les Chants de Maldoror). En 1861, Isidore est en cinquième et l’année suivante en quatrième, quand il obtient un premier accessit d’excellence. Il passe ses vacances scolaires à Bazet. En 1863, on perd sa trace pour cette année scolaire. On suppose qu’il a suivi des études dans un collège privé pour rattraper son retard scolaire. Le 16 avril, il écrit sur un exemplaire de l’lliade d’Homère, traduit en espagnol par José Gómez Hermosilla. Le 17 octobre, Isidore entre au lycée impérial de Pau (qui deviendra le lycée Louis-Barthou), comme interne, en classe de Rhétorique. En 1864, année de Rhétorique, les résultats d’Isidore Ducasse sont très modestes. En octobre, il entre en classe de philosophie. En 1865, il a passé et obtenu son baccalauréat ès lettres avec la mention passable. Il s’est inscrit, la même année, en classe de mathématiques élémentaires. En 1866, il obtiendra son baccalauréat ès sciences. En 1867, après un court séjour à Montevideo, il arrive à Paris et s’installe à l’hôtel L’Union des Nations au 23, rue Notre-Dame-des Victoires, où il se consacre totalement, entretenu par l’argent que lui verse mensuellement son père, à l’écriture des Chants de Maldoror et de deux fascicules de poésies. Il entame des études supérieures dont la nature reste inconnue (concours d’entrée à l’École polytechnique, a-t-on souvent écrit). En août 1868, le premier des Chants de Maldoror est imprimé à compte d’auteur chez l’imprimeur Balitout, Questroy et Cie. Le 9 novembre, il écrit à un critique en lui envoyant le Chant premier et le 10 novembre, il écrit à Victor Hugo en lui adressant sa plaquette. En janvier 1869, la Revue populaire de Paris de Louise Bader publie une publicité pour Les Chants de Maldoror et fin janvier, seconde édition, à Bordeaux, du premier chant des Chants de Maldoror dans le recueil collectif d’Évariste Carrance, intitulé Parfums de l’âme. Durant l’été 1869, le manuscrit des six Chants de Maldoror est envoyé à Bruxelles pour être imprimé et sera signé « Comte de Lautréamont » par Albert Lacroix mais sans référence d'éditeur. L'ouvrage ne sera pas diffusé mais Ducasse et Lacroix restèrent en contact. En octobre, il habite au 32, rue du Faubourg-Montmartre et en mars 1870, il déménage au 15, rue Vivienne. Le 9 avril, dépôt légal de Poésies I et le 14 juin, celui de Poésies II. Le même accueil fut réservé à ses fragments en prose (Poésies, 1870), rédigés peu de temps avant sa mort, qui passèrent inaperçus. Le 24 novembre 1870, alors que le Second Empire s’effondre, il meurt au 7, rue du Faubourg-Montmartre et est enterré le lendemain au cimetière du Nord (cimetière de Montmartre), après un service religieux à l’église Notre-Dame-de-Lorette. Sur son acte de décès, est écrit : « Sans autres renseignements ». Selon ses biographes, il serait mort phtisique. En 1887, son père François décèdera à son tour à Montevideo. Plus connu par son pseudonyme de comte de Lautréamont, qu'il emprunta très probablement au Latréaumont (1838) d'Eugène Sue, Isidore Ducasse restera un poète franco-uruguayen, auteur des Chants de Maldoror et de deux fascicules, Poésies I et Poésies II. Pour résumer nous dirons que sa vie fut brève. Jusqu'en 1860, on ne sait ce qu'il advient de lui. On pense qu’il commença ses études chez les jésuites. Né en Amérique du Sud, il est étranger dans le pays où, adolescent, il vient faire ses études, la France. Peut-être est-il envoyé en France pour préparer le concours d’entrée à l’École polytechnique ? On le retrouve élève au lycée impérial de Tarbes (1860-1862), puis en 1963 au lycée de Pau. Renonçant au concours d’entrée à l'École polytechnique pour des raisons mystérieuses, en 1867, il vint se fixer définitivement à Paris pour faire des études et suivre sa vocation d’écrivain, très affirmée dès le plus jeune âge. De ce séjour à Paris, nulle trace, si ce n'est celle des différents hôtels qu'il habite. À peine son œuvre est-elle publiée, qu’il meurt brusquement, à 24 ans, quasiment inconnu de son vivant, en plein siège de Paris, de la guerre franco-prussienne, sans avoir connu la gloire à laquelle il aspirait. Les causes de sa mort ne sont pas connues et sont mystérieuses. Lautréamont ne laissa qu'un livre unique, les Chants de Maldoror, deux fascicules intitulés Poésies, qui sont bien davantage une « préface à un livre futur », et quelques lettres à son éditeur. Les Chants de Maldoror (1869) ne connurent pas l'accueil du public du vivant de l'auteur, car, selon les propres termes de Lautréamont, « une fois qu'il fut imprimé, l'éditeur a refusé de le faire paraître, parce que la vie y était peinte sous des couleurs trop amères et qu'il craignait le procureur général ». Ils ne sont redécouverts que dans les années 1885, notamment par Léon Bloy. L’audace de son œuvre, qui lui vaut d’être étouffée à sa première parution, fait de lui une figure de l’avant-garde. Le mystère qui entoure sa vie, dont nous ne connaissons que quelques éléments, contribue à forger sa légende. Lautréamont est entré dans l’histoire littéraire grâce à la célébrité progressivement conquise de ses Chants de Maldoror, notamment auprès des poètes surréalistes après la guerre de 1914-1918. Il faudra attendre 1917 pour que les fondateurs du surréalisme, Philippe Soupault et André Breton, redécouvrent l’œuvre de Lautréamont. Des surréalistes, dont il sera le maître à penser, le maître à vivre. Ses écrits tombés dans l’oubli pendant des années seront connus et célébrés dans les années 1920. Les Chants de Maldoror se présentent sous la forme de six chants, composés de strophes qui semblent à première vue n'avoir aucun lien les unes avec les autres. À l'intérieur de chacune de ces strophes, les digressions ne manquent pas pour dérouter le lecteur et lui faire accroire qu'il s'agit bien d'un « génie malade ». C’est un très long poème en prose, empli de rage, de sauvagerie mais aussi de précisions littéraires et scientifiques. Au fil des pages, Ducasse raconte en termes outrés et sanglants sa haine des hommes, son amour de la mort et de la nature, donne la parole à des animaux et des chimères, préfigure le cut-up en recopiant des pages de manuels de biologie de son époque (dont une émouvante description du vol de la cigogne), se bat en duel, voue aux gémonies le Tout-Puissant, raconte le Paris des pauvres et des malades et affirme que “Depuis Racine, la poésie n’a pas progressé d’un millimètre.” Réédités en 1874 puis en 1890, les Chants de Maldoror donnèrent prise aux jugements les plus arbitraires (on prétendit notamment que Ducasse était atteint de folie), avant d’être remarqués par les symbolistes puis exaltés par les surréalistes. Louant cette littérature de la révolte, Breton écrivit : « C’est au comte de Lautréamont qu’incombe peut-être la plus grande part de l’état de choses poétique actuel : entendez la révolution surréaliste. » De son côté, Gracq voyait dans les Chants de Maldoror un « torrent d’aveux corrosifs alimenté par trois siècles de mauvaise conscience littéraire », estimant que cette œuvre était venue « à point nommé pour corriger dans notre littérature un déséquilibre des plus graves ». De fait, on y trouve, pour la première fois dans la littérature française, une critique lucide du langage poétique. Célébré dès le premier chant, le thème du « mal » libère d’étranges forces obscures et salvatrices (celles de l’inconscient) que les chants II et IV amplifient de résonances ténébreuses. Or, parallèlement à cette glorification du mal, Lautréamont déploie un art de l’ironie sans précédent dans l’histoire des lettres, se livrant à un détournement en règle des traditions du récit populaire français et du roman noir gothique, apparu en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Cette révolte blasphématoire se traduit sur le plan poétique par une sacralisation des fantasmes (spécialement perceptible dans le bestiaire du chant V). Quant aux Poésies, elles proposent une nouvelle manière de traiter la forme littéraire, renouvelant notamment le genre de la maxime, sous l’apparence d’un style désinvolte. Emporté par le flot quasi « automatique » de son débit verbal, Lautréamont s’y révèle un exceptionnel créateur de métaphores. L’exemple le plus caractéristique de cette capacité à concevoir de nouvelles images se trouve dans la série des « Beau comme ! … » des chants V et VI, où l’auteur supprime un des deux termes de la comparaison, atteignant à la quintessence de l’effet poétique recherché par les surréalistes. Ici, comme dans les Chants de Maldoror, le lecteur, sollicité par l’apostrophe et l’incantation, est prié d’accompagner l’écrivain jusqu’aux limites extrêmes de sa création : ainsi peut-il s’effacer (« La poésie personnelle a fait son temps ») et, à l’instar de son héros Maldoror, échapper à l’humanité pour servir « les délires de la cruauté ». Écrivain français, il fut considéré par les surréalistes comme un précurseur de la révolution littéraire du XXe siècle. Car son œuvre ne fut connue qu'au vingtième siècle : il fallut attendre les surréalistes, puis des critiques comme Bachelard, Sollers et Kristeva pour que l'esthétique exacerbée et que l'ironie de Lautréamont trouvent ses lecteurs. En signant sous l’énigmatique pseudonyme de “Comte de Lautréamont” six chants enhardis et féroces, il changea le visage de la poésie française pour de longues décennies. Un destin hors du commun qui se termina à l’âge de 24 ans. En 1977, le Tarbais Jean-Jacques Lefrère, dans « Le Visage de Lautréamont », publie une photographie qu’il affirme être celle d’lsidore Ducasse, dit comte de Lautréamont, auteur des Chants de Maldoror et des Poésies. Un lycée professionnel des métiers ainsi qu’une rue de Tarbes portent aujourd’hui son nom.
Comte de LAUTRÉAMONT, Isidore Lucien Ducasse de son vrai nom, né le 4 avril 1846 à Montevideo et mort le 24 novembre 1870 à Paris, à l’âge de 24 ans, est le fils de François Ducasse, né à Bazet, instituteur et secrétaire de mairie à Sarniguet et de Jacquette-Célestine Davezac, née à Sarniguet. Vers 1840, François Ducasse émigre à Montevideo, en Uruguay. Homme d'une grande culture, il entre comme commis-chancelier au Consulat-général de France. En 1846, il épouse à Montevideo Jacquette Davezac. Celle-ci est déjà enceinte d’Isidore. Le 4 avril, naît à Montevideo Isidore Lucien Ducasse. Le 16 novembre 1847, Isidore est baptisé à la cathédrale de Montevideo. Le 9 décembre meurt sa mère. On a supposé qu’elle se serait suicidée. Orphelin de mère, il est élevé par son père qui travaille au Consulat français de l’Uruguay. Le 28 juin 1856, François Ducasse est nommé chancelier de première classe au consulat de Montevideo. Isidore est confié à l’âge de 13 ans à un ami de la famille, Jean Dazet, un avoué tarbais, et déménage à Tarbes où il suivra ses études secondaires. En octobre 1959, à 13 ans et demi, Isidore entre comme interne en classe de sixième au lycée impérial de Tarbes (actuel lycée Théophile-Gautier). Jean Dazet est l’un de ses tuteurs. C’est à cette période qu’il nouera des amitiés fortes (Paul Lespès, Georges Minvielle et Georges Dazet, le fils de Jean, futur avocat et théoricien du parti socialiste de Jules Guesde, condisciple d’Isidore et premier dédicataire de « Poésies », qui auront chacun leur place dans Les Chants de Maldoror). En 1861, Isidore est en cinquième et l’année suivante en quatrième, quand il obtient un premier accessit d’excellence. Il passe ses vacances scolaires à Bazet. En 1863, on perd sa trace pour cette année scolaire. On suppose qu’il a suivi des études dans un collège privé pour rattraper son retard scolaire. Le 16 avril, il écrit sur un exemplaire de l’lliade d’Homère, traduit en espagnol par José Gómez Hermosilla. Le 17 octobre, Isidore entre au lycée impérial de Pau (qui deviendra le lycée Louis-Barthou), comme interne, en classe de Rhétorique. En 1864, année de Rhétorique, les résultats d’Isidore Ducasse sont très modestes. En octobre, il entre en classe de philosophie. En 1865, il a passé et obtenu son baccalauréat ès lettres avec la mention passable. Il s’est inscrit, la même année, en classe de mathématiques élémentaires. En 1866, il obtiendra son baccalauréat ès sciences. En 1867, après un court séjour à Montevideo, il arrive à Paris et s’installe à l’hôtel L’Union des Nations au 23, rue Notre-Dame-des Victoires, où il se consacre totalement, entretenu par l’argent que lui verse mensuellement son père, à l’écriture des Chants de Maldoror et de deux fascicules de poésies. Il entame des études supérieures dont la nature reste inconnue (concours d’entrée à l’École polytechnique, a-t-on souvent écrit). En août 1868, le premier des Chants de Maldoror est imprimé à compte d’auteur chez l’imprimeur Balitout, Questroy et Cie. Le 9 novembre, il écrit à un critique en lui envoyant le Chant premier et le 10 novembre, il écrit à Victor Hugo en lui adressant sa plaquette. En janvier 1869, la Revue populaire de Paris de Louise Bader publie une publicité pour Les Chants de Maldoror et fin janvier, seconde édition, à Bordeaux, du premier chant des Chants de Maldoror dans le recueil collectif d’Évariste Carrance, intitulé Parfums de l’âme. Durant l’été 1869, le manuscrit des six Chants de Maldoror est envoyé à Bruxelles pour être imprimé et sera signé « Comte de Lautréamont » par Albert Lacroix mais sans référence d'éditeur. L'ouvrage ne sera pas diffusé mais Ducasse et Lacroix restèrent en contact. En octobre, il habite au 32, rue du Faubourg-Montmartre et en mars 1870, il déménage au 15, rue Vivienne. Le 9 avril, dépôt légal de Poésies I et le 14 juin, celui de Poésies II. Le même accueil fut réservé à ses fragments en prose (Poésies, 1870), rédigés peu de temps avant sa mort, qui passèrent inaperçus. Le 24 novembre 1870, alors que le Second Empire s’effondre, il meurt au 7, rue du Faubourg-Montmartre et est enterré le lendemain au cimetière du Nord (cimetière de Montmartre), après un service religieux à l’église Notre-Dame-de-Lorette. Sur son acte de décès, est écrit : « Sans autres renseignements ». Selon ses biographes, il serait mort phtisique. En 1887, son père François décèdera à son tour à Montevideo. Plus connu par son pseudonyme de comte de Lautréamont, qu'il emprunta très probablement au Latréaumont (1838) d'Eugène Sue, Isidore Ducasse restera un poète franco-uruguayen, auteur des Chants de Maldoror et de deux fascicules, Poésies I et Poésies II. Pour résumer nous dirons que sa vie fut brève. Jusqu'en 1860, on ne sait ce qu'il advient de lui. On pense qu’il commença ses études chez les jésuites. Né en Amérique du Sud, il est étranger dans le pays où, adolescent, il vient faire ses études, la France. Peut-être est-il envoyé en France pour préparer le concours d’entrée à l’École polytechnique ? On le retrouve élève au lycée impérial de Tarbes (1860-1862), puis en 1963 au lycée de Pau. Renonçant au concours d’entrée à l'École polytechnique pour des raisons mystérieuses, en 1867, il vint se fixer définitivement à Paris pour faire des études et suivre sa vocation d’écrivain, très affirmée dès le plus jeune âge. De ce séjour à Paris, nulle trace, si ce n'est celle des différents hôtels qu'il habite. À peine son œuvre est-elle publiée, qu’il meurt brusquement, à 24 ans, quasiment inconnu de son vivant, en plein siège de Paris, de la guerre franco-prussienne, sans avoir connu la gloire à laquelle il aspirait. Les causes de sa mort ne sont pas connues et sont mystérieuses. Lautréamont ne laissa qu'un livre unique, les Chants de Maldoror, deux fascicules intitulés Poésies, qui sont bien davantage une « préface à un livre futur », et quelques lettres à son éditeur. Les Chants de Maldoror (1869) ne connurent pas l'accueil du public du vivant de l'auteur, car, selon les propres termes de Lautréamont, « une fois qu'il fut imprimé, l'éditeur a refusé de le faire paraître, parce que la vie y était peinte sous des couleurs trop amères et qu'il craignait le procureur général ». Ils ne sont redécouverts que dans les années 1885, notamment par Léon Bloy. L’audace de son œuvre, qui lui vaut d’être étouffée à sa première parution, fait de lui une figure de l’avant-garde. Le mystère qui entoure sa vie, dont nous ne connaissons que quelques éléments, contribue à forger sa légende. Lautréamont est entré dans l’histoire littéraire grâce à la célébrité progressivement conquise de ses Chants de Maldoror, notamment auprès des poètes surréalistes après la guerre de 1914-1918. Il faudra attendre 1917 pour que les fondateurs du surréalisme, Philippe Soupault et André Breton, redécouvrent l’œuvre de Lautréamont. Des surréalistes, dont il sera le maître à penser, le maître à vivre. Ses écrits tombés dans l’oubli pendant des années seront connus et célébrés dans les années 1920. Les Chants de Maldoror se présentent sous la forme de six chants, composés de strophes qui semblent à première vue n'avoir aucun lien les unes avec les autres. À l'intérieur de chacune de ces strophes, les digressions ne manquent pas pour dérouter le lecteur et lui faire accroire qu'il s'agit bien d'un « génie malade ». C’est un très long poème en prose, empli de rage, de sauvagerie mais aussi de précisions littéraires et scientifiques. Au fil des pages, Ducasse raconte en termes outrés et sanglants sa haine des hommes, son amour de la mort et de la nature, donne la parole à des animaux et des chimères, préfigure le cut-up en recopiant des pages de manuels de biologie de son époque (dont une émouvante description du vol de la cigogne), se bat en duel, voue aux gémonies le Tout-Puissant, raconte le Paris des pauvres et des malades et affirme que “Depuis Racine, la poésie n’a pas progressé d’un millimètre.” Réédités en 1874 puis en 1890, les Chants de Maldoror donnèrent prise aux jugements les plus arbitraires (on prétendit notamment que Ducasse était atteint de folie), avant d’être remarqués par les symbolistes puis exaltés par les surréalistes. Louant cette littérature de la révolte, Breton écrivit : « C’est au comte de Lautréamont qu’incombe peut-être la plus grande part de l’état de choses poétique actuel : entendez la révolution surréaliste. » De son côté, Gracq voyait dans les Chants de Maldoror un « torrent d’aveux corrosifs alimenté par trois siècles de mauvaise conscience littéraire », estimant que cette œuvre était venue « à point nommé pour corriger dans notre littérature un déséquilibre des plus graves ». De fait, on y trouve, pour la première fois dans la littérature française, une critique lucide du langage poétique. Célébré dès le premier chant, le thème du « mal » libère d’étranges forces obscures et salvatrices (celles de l’inconscient) que les chants II et IV amplifient de résonances ténébreuses. Or, parallèlement à cette glorification du mal, Lautréamont déploie un art de l’ironie sans précédent dans l’histoire des lettres, se livrant à un détournement en règle des traditions du récit populaire français et du roman noir gothique, apparu en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Cette révolte blasphématoire se traduit sur le plan poétique par une sacralisation des fantasmes (spécialement perceptible dans le bestiaire du chant V). Quant aux Poésies, elles proposent une nouvelle manière de traiter la forme littéraire, renouvelant notamment le genre de la maxime, sous l’apparence d’un style désinvolte. Emporté par le flot quasi « automatique » de son débit verbal, Lautréamont s’y révèle un exceptionnel créateur de métaphores. L’exemple le plus caractéristique de cette capacité à concevoir de nouvelles images se trouve dans la série des « Beau comme ! … » des chants V et VI, où l’auteur supprime un des deux termes de la comparaison, atteignant à la quintessence de l’effet poétique recherché par les surréalistes. Ici, comme dans les Chants de Maldoror, le lecteur, sollicité par l’apostrophe et l’incantation, est prié d’accompagner l’écrivain jusqu’aux limites extrêmes de sa création : ainsi peut-il s’effacer (« La poésie personnelle a fait son temps ») et, à l’instar de son héros Maldoror, échapper à l’humanité pour servir « les délires de la cruauté ». Écrivain français, il fut considéré par les surréalistes comme un précurseur de la révolution littéraire du XXe siècle. Car son œuvre ne fut connue qu'au vingtième siècle : il fallut attendre les surréalistes, puis des critiques comme Bachelard, Sollers et Kristeva pour que l'esthétique exacerbée et que l'ironie de Lautréamont trouvent ses lecteurs. En signant sous l’énigmatique pseudonyme de “Comte de Lautréamont” six chants enhardis et féroces, il changea le visage de la poésie française pour de longues décennies. Un destin hors du commun qui se termina à l’âge de 24 ans. En 1977, le Tarbais Jean-Jacques Lefrère, dans « Le Visage de Lautréamont », publie une photographie qu’il affirme être celle d’lsidore Ducasse, dit comte de Lautréamont, auteur des Chants de Maldoror et des Poésies. Un lycée professionnel des métiers ainsi qu’une rue de Tarbes portent aujourd’hui son nom.LECHÊNE Jean-Louis (1947-XXXX)
Alpiniste, guide de haute montagne et moniteur de ski à la station de Cauterets
 Jean-Louis LECHÊNE, né en 1947 à Hautmont dans le département du Nord. Il est connu pour son engagement dans le pyrénéisme. Après une enfance difficile, il est séparé de sa famille dès l'âge de 9 ans. Bénéficiaire, grâce à ses bonnes notes, d'un séjour dans un camp de la Soureilhade à Cauterets, il y découvre la montagne en 1961, à l’âge de 14 ans. Et c’est quand il est venu pour la première fois à Cauterets, à l’occasion d’un stage de montagne, qu’il a été initié à la randonnée par Jean Begbeder, l’évangéliste grand coureur de montagne malgré sa cécité, qui organisait ces camps de montagne. À 16 ans, s'installant définitivement à Cauterets, il devient maçon, l'un des rares métiers pratiqués dans les villages des Pyrénées, à une époque où les stations de ski se construisaient à peine. À ce titre, il participe à la construction des refuges du Marcadau et des Oulettes. Sous le parrainage d'Etienne Florence, ancien champion de France de ski de fond, il apprend le métier de guide, et obtient son diplôme à l'ENSA de Chamonix en 1971, puis son diplôme de moniteur de ski en 1976. En 1970, il participa au sauvetage de Bernard Baudéan, "Le miraculé d'Ansabère". S'impliquant dans le mouvement pyrénéiste, il rejoint le GPHM (Groupe Pyrénéiste de Haute-Montagne), fondé par Robert Ollivier, dont il deviendra le dernier président. En 1987, il créé l'école de ski Snow-Fun qu'il dirigera jusqu'en 2005. Il réalise de nombreuses premières dans les Pyrénées, notamment au pic de Monné et dans le massif du Vignemale (3298m), plus haut sommet des Pyrénées françaises, dont il est devenu un grand spécialiste, gravissant plus de 300 fois le sommet par sa face Nord. En particulier, il a donné son nom à une goulotte de glace dans la face Nord du Petit Vignemale (goulotte Lechêne), ainsi qu'à un éperon au Cap d'Aou en Vallée d'Aure (éperon Lechêne). Il est la doublure de Kirk Douglas dans le film Veraz, de Xavier Castano, sorti en 1991 (rubrique « cinéma » du site). « J’avais équipé une cheminée le long de la route des Especières sur une dizaine de mètres que le personnage Kirk Douglas devait gravir avant de se jeter dans le vide face au braconnage. J’ai eu la chance de côtoyer Kirk pendant plusieurs semaines et de goûter à l’ambiance d’un tournage. J’ai pu me rendre compte que ce gars savait tout faire. Sauf escalader. » Jean-Louis a souvent accompagné des équipes de tournage comme en 2012, celle « Des Racines et des Ailes » dans le Cirque de Gavarnie. Ses principales ascensions : le 17 mars 1967, la première ascension hivernale de l'Éperon Nord-Ouest du Petit Vignemale avec J. Poudré ; le 17 juin 1967, la première ascension du pilier Nord de l'arête de Gaube au Vignemale avec J. Sebben et au mois de mai 1975, la première ascension de la goulotte Lechêne au Petit Vignemale avec Christian Santoul. Avec son look de grand chef indien, été comme hiver, il accompagne des gens en montagne dans la vallée de Cauterets et dans les Pyrénées et leurs sommets mythiques comme le Vignemale, le Néouvielle, l’Ossau, le Mont Perdu ou le Balaïtous, les Alpes ou même à l’étranger s’ils veulent faire du canyoning aux Baléares ou à la Sierra de Guara en Espagne, par exemple. En 1976, dans Radioscopie, Jacques Chancel s'entretient avec Jean-Louis Lechêne sur comment lui était venu le goût de la montagne, son enfance difficile, la ville de Cauterets, où il vit toujours... Jean-Louis Lechêne est une grande figure de Cauterets et un alpiniste hors pair. En plus des voies d’escalade, il a ouvert aussi de nombreux canyons dans les Hautes-Pyrénées, dans les secteurs de Gavarnie et Cauterets. « Je propose la découverte de tous les types de canyons : aquatiques verticaux, riches en végétation… avec un critère constant : être loin de la foule et proche de la nature… », indique-t-il. « Quand j'observe certains glaciers, ça fait mal au cœur de voir qu'ils n'ont plus d'appuis ». Même les « séracs », dans le jargon des montagnards, ces blocs de glace de grande taille formés par la fracturation et premières couches du glacier, disparaissent. Rien ne va plus, considère Jean-Louis Lechêne. Le guide de haute montagne voit les glaciers fondre les uns après les autres sans pouvoir influer sur le cours des choses. « Ça modifie le paysage, ajoute-t-il. L'aspect minéral est toujours visible mais l'aspect glaciaire a disparu. C'est un peu comparable à la vulcanologie. » Installé à Cauterets, il initie toute l’année aux grandes voies dans les massifs pyrénéens, à l’escalade de glace comme à la randonnée, au canyoning comme au ski ou aux raquettes pour faire découvrir à ses clients nos magnifiques montagnes des Pyrénées, qui en 1963 avaient conquis son cœur de jeune ado !
Jean-Louis LECHÊNE, né en 1947 à Hautmont dans le département du Nord. Il est connu pour son engagement dans le pyrénéisme. Après une enfance difficile, il est séparé de sa famille dès l'âge de 9 ans. Bénéficiaire, grâce à ses bonnes notes, d'un séjour dans un camp de la Soureilhade à Cauterets, il y découvre la montagne en 1961, à l’âge de 14 ans. Et c’est quand il est venu pour la première fois à Cauterets, à l’occasion d’un stage de montagne, qu’il a été initié à la randonnée par Jean Begbeder, l’évangéliste grand coureur de montagne malgré sa cécité, qui organisait ces camps de montagne. À 16 ans, s'installant définitivement à Cauterets, il devient maçon, l'un des rares métiers pratiqués dans les villages des Pyrénées, à une époque où les stations de ski se construisaient à peine. À ce titre, il participe à la construction des refuges du Marcadau et des Oulettes. Sous le parrainage d'Etienne Florence, ancien champion de France de ski de fond, il apprend le métier de guide, et obtient son diplôme à l'ENSA de Chamonix en 1971, puis son diplôme de moniteur de ski en 1976. En 1970, il participa au sauvetage de Bernard Baudéan, "Le miraculé d'Ansabère". S'impliquant dans le mouvement pyrénéiste, il rejoint le GPHM (Groupe Pyrénéiste de Haute-Montagne), fondé par Robert Ollivier, dont il deviendra le dernier président. En 1987, il créé l'école de ski Snow-Fun qu'il dirigera jusqu'en 2005. Il réalise de nombreuses premières dans les Pyrénées, notamment au pic de Monné et dans le massif du Vignemale (3298m), plus haut sommet des Pyrénées françaises, dont il est devenu un grand spécialiste, gravissant plus de 300 fois le sommet par sa face Nord. En particulier, il a donné son nom à une goulotte de glace dans la face Nord du Petit Vignemale (goulotte Lechêne), ainsi qu'à un éperon au Cap d'Aou en Vallée d'Aure (éperon Lechêne). Il est la doublure de Kirk Douglas dans le film Veraz, de Xavier Castano, sorti en 1991 (rubrique « cinéma » du site). « J’avais équipé une cheminée le long de la route des Especières sur une dizaine de mètres que le personnage Kirk Douglas devait gravir avant de se jeter dans le vide face au braconnage. J’ai eu la chance de côtoyer Kirk pendant plusieurs semaines et de goûter à l’ambiance d’un tournage. J’ai pu me rendre compte que ce gars savait tout faire. Sauf escalader. » Jean-Louis a souvent accompagné des équipes de tournage comme en 2012, celle « Des Racines et des Ailes » dans le Cirque de Gavarnie. Ses principales ascensions : le 17 mars 1967, la première ascension hivernale de l'Éperon Nord-Ouest du Petit Vignemale avec J. Poudré ; le 17 juin 1967, la première ascension du pilier Nord de l'arête de Gaube au Vignemale avec J. Sebben et au mois de mai 1975, la première ascension de la goulotte Lechêne au Petit Vignemale avec Christian Santoul. Avec son look de grand chef indien, été comme hiver, il accompagne des gens en montagne dans la vallée de Cauterets et dans les Pyrénées et leurs sommets mythiques comme le Vignemale, le Néouvielle, l’Ossau, le Mont Perdu ou le Balaïtous, les Alpes ou même à l’étranger s’ils veulent faire du canyoning aux Baléares ou à la Sierra de Guara en Espagne, par exemple. En 1976, dans Radioscopie, Jacques Chancel s'entretient avec Jean-Louis Lechêne sur comment lui était venu le goût de la montagne, son enfance difficile, la ville de Cauterets, où il vit toujours... Jean-Louis Lechêne est une grande figure de Cauterets et un alpiniste hors pair. En plus des voies d’escalade, il a ouvert aussi de nombreux canyons dans les Hautes-Pyrénées, dans les secteurs de Gavarnie et Cauterets. « Je propose la découverte de tous les types de canyons : aquatiques verticaux, riches en végétation… avec un critère constant : être loin de la foule et proche de la nature… », indique-t-il. « Quand j'observe certains glaciers, ça fait mal au cœur de voir qu'ils n'ont plus d'appuis ». Même les « séracs », dans le jargon des montagnards, ces blocs de glace de grande taille formés par la fracturation et premières couches du glacier, disparaissent. Rien ne va plus, considère Jean-Louis Lechêne. Le guide de haute montagne voit les glaciers fondre les uns après les autres sans pouvoir influer sur le cours des choses. « Ça modifie le paysage, ajoute-t-il. L'aspect minéral est toujours visible mais l'aspect glaciaire a disparu. C'est un peu comparable à la vulcanologie. » Installé à Cauterets, il initie toute l’année aux grandes voies dans les massifs pyrénéens, à l’escalade de glace comme à la randonnée, au canyoning comme au ski ou aux raquettes pour faire découvrir à ses clients nos magnifiques montagnes des Pyrénées, qui en 1963 avaient conquis son cœur de jeune ado !
 Jean-Louis LECHÊNE, né en 1947 à Hautmont dans le département du Nord. Il est connu pour son engagement dans le pyrénéisme. Après une enfance difficile, il est séparé de sa famille dès l'âge de 9 ans. Bénéficiaire, grâce à ses bonnes notes, d'un séjour dans un camp de la Soureilhade à Cauterets, il y découvre la montagne en 1961, à l’âge de 14 ans. Et c’est quand il est venu pour la première fois à Cauterets, à l’occasion d’un stage de montagne, qu’il a été initié à la randonnée par Jean Begbeder, l’évangéliste grand coureur de montagne malgré sa cécité, qui organisait ces camps de montagne. À 16 ans, s'installant définitivement à Cauterets, il devient maçon, l'un des rares métiers pratiqués dans les villages des Pyrénées, à une époque où les stations de ski se construisaient à peine. À ce titre, il participe à la construction des refuges du Marcadau et des Oulettes. Sous le parrainage d'Etienne Florence, ancien champion de France de ski de fond, il apprend le métier de guide, et obtient son diplôme à l'ENSA de Chamonix en 1971, puis son diplôme de moniteur de ski en 1976. En 1970, il participa au sauvetage de Bernard Baudéan, "Le miraculé d'Ansabère". S'impliquant dans le mouvement pyrénéiste, il rejoint le GPHM (Groupe Pyrénéiste de Haute-Montagne), fondé par Robert Ollivier, dont il deviendra le dernier président. En 1987, il créé l'école de ski Snow-Fun qu'il dirigera jusqu'en 2005. Il réalise de nombreuses premières dans les Pyrénées, notamment au pic de Monné et dans le massif du Vignemale (3298m), plus haut sommet des Pyrénées françaises, dont il est devenu un grand spécialiste, gravissant plus de 300 fois le sommet par sa face Nord. En particulier, il a donné son nom à une goulotte de glace dans la face Nord du Petit Vignemale (goulotte Lechêne), ainsi qu'à un éperon au Cap d'Aou en Vallée d'Aure (éperon Lechêne). Il est la doublure de Kirk Douglas dans le film Veraz, de Xavier Castano, sorti en 1991 (rubrique « cinéma » du site). « J’avais équipé une cheminée le long de la route des Especières sur une dizaine de mètres que le personnage Kirk Douglas devait gravir avant de se jeter dans le vide face au braconnage. J’ai eu la chance de côtoyer Kirk pendant plusieurs semaines et de goûter à l’ambiance d’un tournage. J’ai pu me rendre compte que ce gars savait tout faire. Sauf escalader. » Jean-Louis a souvent accompagné des équipes de tournage comme en 2012, celle « Des Racines et des Ailes » dans le Cirque de Gavarnie. Ses principales ascensions : le 17 mars 1967, la première ascension hivernale de l'Éperon Nord-Ouest du Petit Vignemale avec J. Poudré ; le 17 juin 1967, la première ascension du pilier Nord de l'arête de Gaube au Vignemale avec J. Sebben et au mois de mai 1975, la première ascension de la goulotte Lechêne au Petit Vignemale avec Christian Santoul. Avec son look de grand chef indien, été comme hiver, il accompagne des gens en montagne dans la vallée de Cauterets et dans les Pyrénées et leurs sommets mythiques comme le Vignemale, le Néouvielle, l’Ossau, le Mont Perdu ou le Balaïtous, les Alpes ou même à l’étranger s’ils veulent faire du canyoning aux Baléares ou à la Sierra de Guara en Espagne, par exemple. En 1976, dans Radioscopie, Jacques Chancel s'entretient avec Jean-Louis Lechêne sur comment lui était venu le goût de la montagne, son enfance difficile, la ville de Cauterets, où il vit toujours... Jean-Louis Lechêne est une grande figure de Cauterets et un alpiniste hors pair. En plus des voies d’escalade, il a ouvert aussi de nombreux canyons dans les Hautes-Pyrénées, dans les secteurs de Gavarnie et Cauterets. « Je propose la découverte de tous les types de canyons : aquatiques verticaux, riches en végétation… avec un critère constant : être loin de la foule et proche de la nature… », indique-t-il. « Quand j'observe certains glaciers, ça fait mal au cœur de voir qu'ils n'ont plus d'appuis ». Même les « séracs », dans le jargon des montagnards, ces blocs de glace de grande taille formés par la fracturation et premières couches du glacier, disparaissent. Rien ne va plus, considère Jean-Louis Lechêne. Le guide de haute montagne voit les glaciers fondre les uns après les autres sans pouvoir influer sur le cours des choses. « Ça modifie le paysage, ajoute-t-il. L'aspect minéral est toujours visible mais l'aspect glaciaire a disparu. C'est un peu comparable à la vulcanologie. » Installé à Cauterets, il initie toute l’année aux grandes voies dans les massifs pyrénéens, à l’escalade de glace comme à la randonnée, au canyoning comme au ski ou aux raquettes pour faire découvrir à ses clients nos magnifiques montagnes des Pyrénées, qui en 1963 avaient conquis son cœur de jeune ado !
Jean-Louis LECHÊNE, né en 1947 à Hautmont dans le département du Nord. Il est connu pour son engagement dans le pyrénéisme. Après une enfance difficile, il est séparé de sa famille dès l'âge de 9 ans. Bénéficiaire, grâce à ses bonnes notes, d'un séjour dans un camp de la Soureilhade à Cauterets, il y découvre la montagne en 1961, à l’âge de 14 ans. Et c’est quand il est venu pour la première fois à Cauterets, à l’occasion d’un stage de montagne, qu’il a été initié à la randonnée par Jean Begbeder, l’évangéliste grand coureur de montagne malgré sa cécité, qui organisait ces camps de montagne. À 16 ans, s'installant définitivement à Cauterets, il devient maçon, l'un des rares métiers pratiqués dans les villages des Pyrénées, à une époque où les stations de ski se construisaient à peine. À ce titre, il participe à la construction des refuges du Marcadau et des Oulettes. Sous le parrainage d'Etienne Florence, ancien champion de France de ski de fond, il apprend le métier de guide, et obtient son diplôme à l'ENSA de Chamonix en 1971, puis son diplôme de moniteur de ski en 1976. En 1970, il participa au sauvetage de Bernard Baudéan, "Le miraculé d'Ansabère". S'impliquant dans le mouvement pyrénéiste, il rejoint le GPHM (Groupe Pyrénéiste de Haute-Montagne), fondé par Robert Ollivier, dont il deviendra le dernier président. En 1987, il créé l'école de ski Snow-Fun qu'il dirigera jusqu'en 2005. Il réalise de nombreuses premières dans les Pyrénées, notamment au pic de Monné et dans le massif du Vignemale (3298m), plus haut sommet des Pyrénées françaises, dont il est devenu un grand spécialiste, gravissant plus de 300 fois le sommet par sa face Nord. En particulier, il a donné son nom à une goulotte de glace dans la face Nord du Petit Vignemale (goulotte Lechêne), ainsi qu'à un éperon au Cap d'Aou en Vallée d'Aure (éperon Lechêne). Il est la doublure de Kirk Douglas dans le film Veraz, de Xavier Castano, sorti en 1991 (rubrique « cinéma » du site). « J’avais équipé une cheminée le long de la route des Especières sur une dizaine de mètres que le personnage Kirk Douglas devait gravir avant de se jeter dans le vide face au braconnage. J’ai eu la chance de côtoyer Kirk pendant plusieurs semaines et de goûter à l’ambiance d’un tournage. J’ai pu me rendre compte que ce gars savait tout faire. Sauf escalader. » Jean-Louis a souvent accompagné des équipes de tournage comme en 2012, celle « Des Racines et des Ailes » dans le Cirque de Gavarnie. Ses principales ascensions : le 17 mars 1967, la première ascension hivernale de l'Éperon Nord-Ouest du Petit Vignemale avec J. Poudré ; le 17 juin 1967, la première ascension du pilier Nord de l'arête de Gaube au Vignemale avec J. Sebben et au mois de mai 1975, la première ascension de la goulotte Lechêne au Petit Vignemale avec Christian Santoul. Avec son look de grand chef indien, été comme hiver, il accompagne des gens en montagne dans la vallée de Cauterets et dans les Pyrénées et leurs sommets mythiques comme le Vignemale, le Néouvielle, l’Ossau, le Mont Perdu ou le Balaïtous, les Alpes ou même à l’étranger s’ils veulent faire du canyoning aux Baléares ou à la Sierra de Guara en Espagne, par exemple. En 1976, dans Radioscopie, Jacques Chancel s'entretient avec Jean-Louis Lechêne sur comment lui était venu le goût de la montagne, son enfance difficile, la ville de Cauterets, où il vit toujours... Jean-Louis Lechêne est une grande figure de Cauterets et un alpiniste hors pair. En plus des voies d’escalade, il a ouvert aussi de nombreux canyons dans les Hautes-Pyrénées, dans les secteurs de Gavarnie et Cauterets. « Je propose la découverte de tous les types de canyons : aquatiques verticaux, riches en végétation… avec un critère constant : être loin de la foule et proche de la nature… », indique-t-il. « Quand j'observe certains glaciers, ça fait mal au cœur de voir qu'ils n'ont plus d'appuis ». Même les « séracs », dans le jargon des montagnards, ces blocs de glace de grande taille formés par la fracturation et premières couches du glacier, disparaissent. Rien ne va plus, considère Jean-Louis Lechêne. Le guide de haute montagne voit les glaciers fondre les uns après les autres sans pouvoir influer sur le cours des choses. « Ça modifie le paysage, ajoute-t-il. L'aspect minéral est toujours visible mais l'aspect glaciaire a disparu. C'est un peu comparable à la vulcanologie. » Installé à Cauterets, il initie toute l’année aux grandes voies dans les massifs pyrénéens, à l’escalade de glace comme à la randonnée, au canyoning comme au ski ou aux raquettes pour faire découvrir à ses clients nos magnifiques montagnes des Pyrénées, qui en 1963 avaient conquis son cœur de jeune ado !LEDORMEUR Georges (1867-1952)
Grand pyrénéiste auteur du Guide Ledormeur – Les Pyrénées Centrales du Val d'Aran à la Vallée d'Aspe, Tarbais d’adoption
 Georges LEDORMEUR, né le 12 septembre 1867 à Rouen en Normandie et mort le 22 mai 1952, à l’âge de 84 ans. Il est le cadet d'une famille de quatre enfants dont les parents étaient marchands de papier dans la rue de la Grosse Horloge. En 1875, la famille part s'installer à La Flèche dans la Sarthe puis à Bordeaux en Gironde. À treize ans, il commence son apprentissage par la typographie puis s'oriente vers une autre profession comme employé de bourse. Le 24 février 1894, à l’âge de 26 ans, Georges Ledormeur découvre les Pyrénées, quand il arrive à Tarbes pour un séjour chez son frère, artilleur dans l'infanterie de cette même ville. Dans la limpidité d’une belle journée d’hiver, il découvre alors toute la chaîne enneigée qui étincelle au soleil. Immédiatement et irrémédiablement conquis, c’est le coup de foudre et il ne quittera plus Tarbes, où se déroulera désormais toute sa carrière professionnelle ainsi que sa retraite active. Il se met rapidement aux excursions, timidement d’abord comme un complément de ses randonnées à bicyclette, puis de manière plus hardie et continue, à tel point que l’on pourrait dire de lui, qu’il fut un pyrénéiste à temps complet, les cinquante-deux fins de semaine de l’année étant presque toutes occupées par la montagne. Il va supprimer le sommeil et marcher une bonne partie de la nuit du samedi au dimanche pour effectuer ses approches, d’où le surnom affectueux que lui donnèrent ses amis de « marchoucrève ». Il atteint d’abord Le Monné, Le Lhéris, L'Alian, Le Pibeste. Lors d'une excursion au Pic du Midi de Bigorre en septembre 1899, la rencontre au sommet de Georges le Normand et du Jurassien le Docteur Robach, amoureux comme lui des grands espaces, scellera une longue amitié. Au tout début du vingtième siècle, en 1901, il fonde la Société des excursionnistes tarbais (SET). En 1904, il crée avec onze membres la section de Tarbes du Club Alpin Français, dont il fut le premier secrétaire. Il est le plus actif et le plus fervent des fondateurs de ces deux jeunes sociétés. Dans sa carrière de pyrénéiste, il a réalisé l'ascension de plus de 1500 sommets, dont 120 de plus de 3000 mètres. Attiré par le ski, un bon moyen de parcourir la montagne en toute saison, il réussit, le 10 mars 1907, la première traversée à ski du col du Tourmalet. Il rentre en 1915 aux Chemins de Fer du Midi en tant que de dessinateur-architecte. C'est avec un Kodak 9×9 en bois, avec pied amovible, qu'il réalisera près de 7000 clichés en noir et blanc, pour garder le souvenir de ses excursions en montagne. Il ne veut voir dans tout cela que le moyen de retrouver son itinéraire. En 1926, la section du CAF de Tarbes, par les efforts soutenus de son concepteur, Georges Ledormeur, fit construire selon ses plans, dans la zone de Labassa, sur la piste du Balaïtous, son sommet fétiche, le refuge qui porte son nom. Un édifice de type ogival sur les modèles de Tuquerouye et de Baysselance. À partir de 1928, Georges Ledormeur met à profit son excellente connaissance des sommets et massifs pour publier son Guide des Pyrénées Centrales, qui fit l'objet de six rééditions, dont la dernière en 1950, deux ans avant sa disparition : le « Guide Ledormeur - Les Pyrénées Centrales du Val d'Aran à la Vallée d'Aspe » et réinvestit ses talents de dessinateur dans la Carte des Pyrénées Centrales au 1/80 000e. En 1947, alors âgé de 80 ans, la 5e édition du guide, abondamment enrichie, comptera 580 ascensions, 60 cartes-itinéraires, 90 excursions. Ayant à cœur de faire partager son amour de la montagne, c'est naturellement qu'il collabore à de nombreuses revues sportives et divers journaux régionaux. Durant sa vie, il a écrit de nombreux articles et chroniques sur les Pyrénées parus dans le « Bulletin pyrénéen », puis « Pyrénées », « La Dépêche du Midi », « La revue du CAF » « La Montagne » devenue désormais « La Montagne et Alpinisme », « La Nouvelle République des Pyrénées ». On trouve sa signature dès le numéro 27 de mars 1902, avec un article sur les grottes de Bétharram et, dès lors, les écrits vont se suivre avec régularité jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, dès le numéro 1 de « Pyrénées », Georges qui faisait partie du comité de rédaction de l’époque, approvisionnait la rubrique « montagne » du contenu rédactionnel de la revue, et ce, jusqu’à son décès. Il anime par ailleurs des conférences avec projection de ses clichés à Tarbes, Lourdes, Pau, Toulouse et Perpignan. Et, devant un auditoire de plus de huit cents parisiens rassemblés dans l'Institut océanographique, il révèle toutes les merveilles des Pyrénées. Il dessine de nombreuses tables d'orientation comme à Argelès-Gazost, sur la terrasse du Syndicat d'initiative et au château d'Ourout, au sommet du Cabaliros (dessin exécuté après maintes difficultés dues au temps incertain en montagne. Sa patience et sa ténacité lui firent mener à bien ce travail délicat) et à Tarbes au troisième étage de l'hôtel Moderne. C'est en souvenir de cette belle journée de février 1894, où la montagne s'offrit à lui dans sa majestueuse splendeur enneigée, qu'il dessine sur le parapet du Pont de l'Adour à Tarbes, la direction de quatorze pics de la chaîne des Pyrénées. Aujourd'hui, on peut encore suivre les tracés indiquant ces différents sommets. Ajoutons à cela qu’il était également artiste, et a laissé des dessins et des aquarelles. Georges Ledormeur s'est éteint le 22 mai 1952, jour de l'Ascension. Il repose au petit cimetière de Gavarnie, dans le carré des pyrénéistes célèbres, près de l'Abbé Gaurier, Célestin Passet, François Bernat-Salles, Jean Arlaud. Ses archives sont déposées au Musée Pyrénéen de Lourdes, aux archives départementales de Tarbes et au siège du Club Alpin de Tarbes. Afin que perdure sa mémoire, des rues d'Aureilhan, Lourdes, Pierrefitte-Nestalas, Séméac, Tarbes, et Toulouse portent son nom. En 2002, cinquante ans après cette disparition, une réédition du guide fut mise en vente, et un site Internet était créé par sa petite fille pour entretenir le souvenir du célèbre montagnard tarbais, et faire découvrir à ceux qui ne le connaîtraient pas cet homme hors du commun. Un pyrénéiste qui aura fortement marqué l'histoire de nos montagnes pyrénéennes. Et ce fut la rencontre entre un passionné des Pyrénées, un éditeur et la famille Ledormeur (son fils Charles, et sa petite-fille Denise Doubrère), qui est à l'origine de la réédition à 400 exemplaires numérotés de la première édition mythique de 1928, pour le cinquantenaire de la disparition de Georges Ledormeur.
Georges LEDORMEUR, né le 12 septembre 1867 à Rouen en Normandie et mort le 22 mai 1952, à l’âge de 84 ans. Il est le cadet d'une famille de quatre enfants dont les parents étaient marchands de papier dans la rue de la Grosse Horloge. En 1875, la famille part s'installer à La Flèche dans la Sarthe puis à Bordeaux en Gironde. À treize ans, il commence son apprentissage par la typographie puis s'oriente vers une autre profession comme employé de bourse. Le 24 février 1894, à l’âge de 26 ans, Georges Ledormeur découvre les Pyrénées, quand il arrive à Tarbes pour un séjour chez son frère, artilleur dans l'infanterie de cette même ville. Dans la limpidité d’une belle journée d’hiver, il découvre alors toute la chaîne enneigée qui étincelle au soleil. Immédiatement et irrémédiablement conquis, c’est le coup de foudre et il ne quittera plus Tarbes, où se déroulera désormais toute sa carrière professionnelle ainsi que sa retraite active. Il se met rapidement aux excursions, timidement d’abord comme un complément de ses randonnées à bicyclette, puis de manière plus hardie et continue, à tel point que l’on pourrait dire de lui, qu’il fut un pyrénéiste à temps complet, les cinquante-deux fins de semaine de l’année étant presque toutes occupées par la montagne. Il va supprimer le sommeil et marcher une bonne partie de la nuit du samedi au dimanche pour effectuer ses approches, d’où le surnom affectueux que lui donnèrent ses amis de « marchoucrève ». Il atteint d’abord Le Monné, Le Lhéris, L'Alian, Le Pibeste. Lors d'une excursion au Pic du Midi de Bigorre en septembre 1899, la rencontre au sommet de Georges le Normand et du Jurassien le Docteur Robach, amoureux comme lui des grands espaces, scellera une longue amitié. Au tout début du vingtième siècle, en 1901, il fonde la Société des excursionnistes tarbais (SET). En 1904, il crée avec onze membres la section de Tarbes du Club Alpin Français, dont il fut le premier secrétaire. Il est le plus actif et le plus fervent des fondateurs de ces deux jeunes sociétés. Dans sa carrière de pyrénéiste, il a réalisé l'ascension de plus de 1500 sommets, dont 120 de plus de 3000 mètres. Attiré par le ski, un bon moyen de parcourir la montagne en toute saison, il réussit, le 10 mars 1907, la première traversée à ski du col du Tourmalet. Il rentre en 1915 aux Chemins de Fer du Midi en tant que de dessinateur-architecte. C'est avec un Kodak 9×9 en bois, avec pied amovible, qu'il réalisera près de 7000 clichés en noir et blanc, pour garder le souvenir de ses excursions en montagne. Il ne veut voir dans tout cela que le moyen de retrouver son itinéraire. En 1926, la section du CAF de Tarbes, par les efforts soutenus de son concepteur, Georges Ledormeur, fit construire selon ses plans, dans la zone de Labassa, sur la piste du Balaïtous, son sommet fétiche, le refuge qui porte son nom. Un édifice de type ogival sur les modèles de Tuquerouye et de Baysselance. À partir de 1928, Georges Ledormeur met à profit son excellente connaissance des sommets et massifs pour publier son Guide des Pyrénées Centrales, qui fit l'objet de six rééditions, dont la dernière en 1950, deux ans avant sa disparition : le « Guide Ledormeur - Les Pyrénées Centrales du Val d'Aran à la Vallée d'Aspe » et réinvestit ses talents de dessinateur dans la Carte des Pyrénées Centrales au 1/80 000e. En 1947, alors âgé de 80 ans, la 5e édition du guide, abondamment enrichie, comptera 580 ascensions, 60 cartes-itinéraires, 90 excursions. Ayant à cœur de faire partager son amour de la montagne, c'est naturellement qu'il collabore à de nombreuses revues sportives et divers journaux régionaux. Durant sa vie, il a écrit de nombreux articles et chroniques sur les Pyrénées parus dans le « Bulletin pyrénéen », puis « Pyrénées », « La Dépêche du Midi », « La revue du CAF » « La Montagne » devenue désormais « La Montagne et Alpinisme », « La Nouvelle République des Pyrénées ». On trouve sa signature dès le numéro 27 de mars 1902, avec un article sur les grottes de Bétharram et, dès lors, les écrits vont se suivre avec régularité jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, dès le numéro 1 de « Pyrénées », Georges qui faisait partie du comité de rédaction de l’époque, approvisionnait la rubrique « montagne » du contenu rédactionnel de la revue, et ce, jusqu’à son décès. Il anime par ailleurs des conférences avec projection de ses clichés à Tarbes, Lourdes, Pau, Toulouse et Perpignan. Et, devant un auditoire de plus de huit cents parisiens rassemblés dans l'Institut océanographique, il révèle toutes les merveilles des Pyrénées. Il dessine de nombreuses tables d'orientation comme à Argelès-Gazost, sur la terrasse du Syndicat d'initiative et au château d'Ourout, au sommet du Cabaliros (dessin exécuté après maintes difficultés dues au temps incertain en montagne. Sa patience et sa ténacité lui firent mener à bien ce travail délicat) et à Tarbes au troisième étage de l'hôtel Moderne. C'est en souvenir de cette belle journée de février 1894, où la montagne s'offrit à lui dans sa majestueuse splendeur enneigée, qu'il dessine sur le parapet du Pont de l'Adour à Tarbes, la direction de quatorze pics de la chaîne des Pyrénées. Aujourd'hui, on peut encore suivre les tracés indiquant ces différents sommets. Ajoutons à cela qu’il était également artiste, et a laissé des dessins et des aquarelles. Georges Ledormeur s'est éteint le 22 mai 1952, jour de l'Ascension. Il repose au petit cimetière de Gavarnie, dans le carré des pyrénéistes célèbres, près de l'Abbé Gaurier, Célestin Passet, François Bernat-Salles, Jean Arlaud. Ses archives sont déposées au Musée Pyrénéen de Lourdes, aux archives départementales de Tarbes et au siège du Club Alpin de Tarbes. Afin que perdure sa mémoire, des rues d'Aureilhan, Lourdes, Pierrefitte-Nestalas, Séméac, Tarbes, et Toulouse portent son nom. En 2002, cinquante ans après cette disparition, une réédition du guide fut mise en vente, et un site Internet était créé par sa petite fille pour entretenir le souvenir du célèbre montagnard tarbais, et faire découvrir à ceux qui ne le connaîtraient pas cet homme hors du commun. Un pyrénéiste qui aura fortement marqué l'histoire de nos montagnes pyrénéennes. Et ce fut la rencontre entre un passionné des Pyrénées, un éditeur et la famille Ledormeur (son fils Charles, et sa petite-fille Denise Doubrère), qui est à l'origine de la réédition à 400 exemplaires numérotés de la première édition mythique de 1928, pour le cinquantenaire de la disparition de Georges Ledormeur.
 Georges LEDORMEUR, né le 12 septembre 1867 à Rouen en Normandie et mort le 22 mai 1952, à l’âge de 84 ans. Il est le cadet d'une famille de quatre enfants dont les parents étaient marchands de papier dans la rue de la Grosse Horloge. En 1875, la famille part s'installer à La Flèche dans la Sarthe puis à Bordeaux en Gironde. À treize ans, il commence son apprentissage par la typographie puis s'oriente vers une autre profession comme employé de bourse. Le 24 février 1894, à l’âge de 26 ans, Georges Ledormeur découvre les Pyrénées, quand il arrive à Tarbes pour un séjour chez son frère, artilleur dans l'infanterie de cette même ville. Dans la limpidité d’une belle journée d’hiver, il découvre alors toute la chaîne enneigée qui étincelle au soleil. Immédiatement et irrémédiablement conquis, c’est le coup de foudre et il ne quittera plus Tarbes, où se déroulera désormais toute sa carrière professionnelle ainsi que sa retraite active. Il se met rapidement aux excursions, timidement d’abord comme un complément de ses randonnées à bicyclette, puis de manière plus hardie et continue, à tel point que l’on pourrait dire de lui, qu’il fut un pyrénéiste à temps complet, les cinquante-deux fins de semaine de l’année étant presque toutes occupées par la montagne. Il va supprimer le sommeil et marcher une bonne partie de la nuit du samedi au dimanche pour effectuer ses approches, d’où le surnom affectueux que lui donnèrent ses amis de « marchoucrève ». Il atteint d’abord Le Monné, Le Lhéris, L'Alian, Le Pibeste. Lors d'une excursion au Pic du Midi de Bigorre en septembre 1899, la rencontre au sommet de Georges le Normand et du Jurassien le Docteur Robach, amoureux comme lui des grands espaces, scellera une longue amitié. Au tout début du vingtième siècle, en 1901, il fonde la Société des excursionnistes tarbais (SET). En 1904, il crée avec onze membres la section de Tarbes du Club Alpin Français, dont il fut le premier secrétaire. Il est le plus actif et le plus fervent des fondateurs de ces deux jeunes sociétés. Dans sa carrière de pyrénéiste, il a réalisé l'ascension de plus de 1500 sommets, dont 120 de plus de 3000 mètres. Attiré par le ski, un bon moyen de parcourir la montagne en toute saison, il réussit, le 10 mars 1907, la première traversée à ski du col du Tourmalet. Il rentre en 1915 aux Chemins de Fer du Midi en tant que de dessinateur-architecte. C'est avec un Kodak 9×9 en bois, avec pied amovible, qu'il réalisera près de 7000 clichés en noir et blanc, pour garder le souvenir de ses excursions en montagne. Il ne veut voir dans tout cela que le moyen de retrouver son itinéraire. En 1926, la section du CAF de Tarbes, par les efforts soutenus de son concepteur, Georges Ledormeur, fit construire selon ses plans, dans la zone de Labassa, sur la piste du Balaïtous, son sommet fétiche, le refuge qui porte son nom. Un édifice de type ogival sur les modèles de Tuquerouye et de Baysselance. À partir de 1928, Georges Ledormeur met à profit son excellente connaissance des sommets et massifs pour publier son Guide des Pyrénées Centrales, qui fit l'objet de six rééditions, dont la dernière en 1950, deux ans avant sa disparition : le « Guide Ledormeur - Les Pyrénées Centrales du Val d'Aran à la Vallée d'Aspe » et réinvestit ses talents de dessinateur dans la Carte des Pyrénées Centrales au 1/80 000e. En 1947, alors âgé de 80 ans, la 5e édition du guide, abondamment enrichie, comptera 580 ascensions, 60 cartes-itinéraires, 90 excursions. Ayant à cœur de faire partager son amour de la montagne, c'est naturellement qu'il collabore à de nombreuses revues sportives et divers journaux régionaux. Durant sa vie, il a écrit de nombreux articles et chroniques sur les Pyrénées parus dans le « Bulletin pyrénéen », puis « Pyrénées », « La Dépêche du Midi », « La revue du CAF » « La Montagne » devenue désormais « La Montagne et Alpinisme », « La Nouvelle République des Pyrénées ». On trouve sa signature dès le numéro 27 de mars 1902, avec un article sur les grottes de Bétharram et, dès lors, les écrits vont se suivre avec régularité jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, dès le numéro 1 de « Pyrénées », Georges qui faisait partie du comité de rédaction de l’époque, approvisionnait la rubrique « montagne » du contenu rédactionnel de la revue, et ce, jusqu’à son décès. Il anime par ailleurs des conférences avec projection de ses clichés à Tarbes, Lourdes, Pau, Toulouse et Perpignan. Et, devant un auditoire de plus de huit cents parisiens rassemblés dans l'Institut océanographique, il révèle toutes les merveilles des Pyrénées. Il dessine de nombreuses tables d'orientation comme à Argelès-Gazost, sur la terrasse du Syndicat d'initiative et au château d'Ourout, au sommet du Cabaliros (dessin exécuté après maintes difficultés dues au temps incertain en montagne. Sa patience et sa ténacité lui firent mener à bien ce travail délicat) et à Tarbes au troisième étage de l'hôtel Moderne. C'est en souvenir de cette belle journée de février 1894, où la montagne s'offrit à lui dans sa majestueuse splendeur enneigée, qu'il dessine sur le parapet du Pont de l'Adour à Tarbes, la direction de quatorze pics de la chaîne des Pyrénées. Aujourd'hui, on peut encore suivre les tracés indiquant ces différents sommets. Ajoutons à cela qu’il était également artiste, et a laissé des dessins et des aquarelles. Georges Ledormeur s'est éteint le 22 mai 1952, jour de l'Ascension. Il repose au petit cimetière de Gavarnie, dans le carré des pyrénéistes célèbres, près de l'Abbé Gaurier, Célestin Passet, François Bernat-Salles, Jean Arlaud. Ses archives sont déposées au Musée Pyrénéen de Lourdes, aux archives départementales de Tarbes et au siège du Club Alpin de Tarbes. Afin que perdure sa mémoire, des rues d'Aureilhan, Lourdes, Pierrefitte-Nestalas, Séméac, Tarbes, et Toulouse portent son nom. En 2002, cinquante ans après cette disparition, une réédition du guide fut mise en vente, et un site Internet était créé par sa petite fille pour entretenir le souvenir du célèbre montagnard tarbais, et faire découvrir à ceux qui ne le connaîtraient pas cet homme hors du commun. Un pyrénéiste qui aura fortement marqué l'histoire de nos montagnes pyrénéennes. Et ce fut la rencontre entre un passionné des Pyrénées, un éditeur et la famille Ledormeur (son fils Charles, et sa petite-fille Denise Doubrère), qui est à l'origine de la réédition à 400 exemplaires numérotés de la première édition mythique de 1928, pour le cinquantenaire de la disparition de Georges Ledormeur.
Georges LEDORMEUR, né le 12 septembre 1867 à Rouen en Normandie et mort le 22 mai 1952, à l’âge de 84 ans. Il est le cadet d'une famille de quatre enfants dont les parents étaient marchands de papier dans la rue de la Grosse Horloge. En 1875, la famille part s'installer à La Flèche dans la Sarthe puis à Bordeaux en Gironde. À treize ans, il commence son apprentissage par la typographie puis s'oriente vers une autre profession comme employé de bourse. Le 24 février 1894, à l’âge de 26 ans, Georges Ledormeur découvre les Pyrénées, quand il arrive à Tarbes pour un séjour chez son frère, artilleur dans l'infanterie de cette même ville. Dans la limpidité d’une belle journée d’hiver, il découvre alors toute la chaîne enneigée qui étincelle au soleil. Immédiatement et irrémédiablement conquis, c’est le coup de foudre et il ne quittera plus Tarbes, où se déroulera désormais toute sa carrière professionnelle ainsi que sa retraite active. Il se met rapidement aux excursions, timidement d’abord comme un complément de ses randonnées à bicyclette, puis de manière plus hardie et continue, à tel point que l’on pourrait dire de lui, qu’il fut un pyrénéiste à temps complet, les cinquante-deux fins de semaine de l’année étant presque toutes occupées par la montagne. Il va supprimer le sommeil et marcher une bonne partie de la nuit du samedi au dimanche pour effectuer ses approches, d’où le surnom affectueux que lui donnèrent ses amis de « marchoucrève ». Il atteint d’abord Le Monné, Le Lhéris, L'Alian, Le Pibeste. Lors d'une excursion au Pic du Midi de Bigorre en septembre 1899, la rencontre au sommet de Georges le Normand et du Jurassien le Docteur Robach, amoureux comme lui des grands espaces, scellera une longue amitié. Au tout début du vingtième siècle, en 1901, il fonde la Société des excursionnistes tarbais (SET). En 1904, il crée avec onze membres la section de Tarbes du Club Alpin Français, dont il fut le premier secrétaire. Il est le plus actif et le plus fervent des fondateurs de ces deux jeunes sociétés. Dans sa carrière de pyrénéiste, il a réalisé l'ascension de plus de 1500 sommets, dont 120 de plus de 3000 mètres. Attiré par le ski, un bon moyen de parcourir la montagne en toute saison, il réussit, le 10 mars 1907, la première traversée à ski du col du Tourmalet. Il rentre en 1915 aux Chemins de Fer du Midi en tant que de dessinateur-architecte. C'est avec un Kodak 9×9 en bois, avec pied amovible, qu'il réalisera près de 7000 clichés en noir et blanc, pour garder le souvenir de ses excursions en montagne. Il ne veut voir dans tout cela que le moyen de retrouver son itinéraire. En 1926, la section du CAF de Tarbes, par les efforts soutenus de son concepteur, Georges Ledormeur, fit construire selon ses plans, dans la zone de Labassa, sur la piste du Balaïtous, son sommet fétiche, le refuge qui porte son nom. Un édifice de type ogival sur les modèles de Tuquerouye et de Baysselance. À partir de 1928, Georges Ledormeur met à profit son excellente connaissance des sommets et massifs pour publier son Guide des Pyrénées Centrales, qui fit l'objet de six rééditions, dont la dernière en 1950, deux ans avant sa disparition : le « Guide Ledormeur - Les Pyrénées Centrales du Val d'Aran à la Vallée d'Aspe » et réinvestit ses talents de dessinateur dans la Carte des Pyrénées Centrales au 1/80 000e. En 1947, alors âgé de 80 ans, la 5e édition du guide, abondamment enrichie, comptera 580 ascensions, 60 cartes-itinéraires, 90 excursions. Ayant à cœur de faire partager son amour de la montagne, c'est naturellement qu'il collabore à de nombreuses revues sportives et divers journaux régionaux. Durant sa vie, il a écrit de nombreux articles et chroniques sur les Pyrénées parus dans le « Bulletin pyrénéen », puis « Pyrénées », « La Dépêche du Midi », « La revue du CAF » « La Montagne » devenue désormais « La Montagne et Alpinisme », « La Nouvelle République des Pyrénées ». On trouve sa signature dès le numéro 27 de mars 1902, avec un article sur les grottes de Bétharram et, dès lors, les écrits vont se suivre avec régularité jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, dès le numéro 1 de « Pyrénées », Georges qui faisait partie du comité de rédaction de l’époque, approvisionnait la rubrique « montagne » du contenu rédactionnel de la revue, et ce, jusqu’à son décès. Il anime par ailleurs des conférences avec projection de ses clichés à Tarbes, Lourdes, Pau, Toulouse et Perpignan. Et, devant un auditoire de plus de huit cents parisiens rassemblés dans l'Institut océanographique, il révèle toutes les merveilles des Pyrénées. Il dessine de nombreuses tables d'orientation comme à Argelès-Gazost, sur la terrasse du Syndicat d'initiative et au château d'Ourout, au sommet du Cabaliros (dessin exécuté après maintes difficultés dues au temps incertain en montagne. Sa patience et sa ténacité lui firent mener à bien ce travail délicat) et à Tarbes au troisième étage de l'hôtel Moderne. C'est en souvenir de cette belle journée de février 1894, où la montagne s'offrit à lui dans sa majestueuse splendeur enneigée, qu'il dessine sur le parapet du Pont de l'Adour à Tarbes, la direction de quatorze pics de la chaîne des Pyrénées. Aujourd'hui, on peut encore suivre les tracés indiquant ces différents sommets. Ajoutons à cela qu’il était également artiste, et a laissé des dessins et des aquarelles. Georges Ledormeur s'est éteint le 22 mai 1952, jour de l'Ascension. Il repose au petit cimetière de Gavarnie, dans le carré des pyrénéistes célèbres, près de l'Abbé Gaurier, Célestin Passet, François Bernat-Salles, Jean Arlaud. Ses archives sont déposées au Musée Pyrénéen de Lourdes, aux archives départementales de Tarbes et au siège du Club Alpin de Tarbes. Afin que perdure sa mémoire, des rues d'Aureilhan, Lourdes, Pierrefitte-Nestalas, Séméac, Tarbes, et Toulouse portent son nom. En 2002, cinquante ans après cette disparition, une réédition du guide fut mise en vente, et un site Internet était créé par sa petite fille pour entretenir le souvenir du célèbre montagnard tarbais, et faire découvrir à ceux qui ne le connaîtraient pas cet homme hors du commun. Un pyrénéiste qui aura fortement marqué l'histoire de nos montagnes pyrénéennes. Et ce fut la rencontre entre un passionné des Pyrénées, un éditeur et la famille Ledormeur (son fils Charles, et sa petite-fille Denise Doubrère), qui est à l'origine de la réédition à 400 exemplaires numérotés de la première édition mythique de 1928, pour le cinquantenaire de la disparition de Georges Ledormeur.LEFRÈRE Jean-Jacques (1954-2015)
Hématologue, écrivain et biographe
 Jean-Jacques LEFRÈRE, né le 10 août 1954 à Tarbes et mort le 16 avril 2015 à Paris, à l’âge de 60 ans. Il est connu du grand public pour ses travaux sur la sécurité transfusionnelle et ses recherches littéraires sur Rimbaud et Lautréamont. Son premier fait de gloire est précoce. Isidore Ducasse, dit le comte de Lautréamont (1846-1870), était passé par le lycée Théophile-Gautier, dans ce qui était alors le lycée impérial, où lui-même est scolarisé. L’été de ses 17 ans, il prend son Solex et entreprend de retrouver ceux qui, en Bigorre, l’ont connu. C’est ainsi qu’il découvre dans un album de la famille Dazet la seule photo d'Isidore Ducasse collégien, l’auteur des Chants de Maldoror, auquel il consacrera plusieurs ouvrages. Jean-Jacques Lefrère a passé son enfance et son adolescence dans les Hautes Pyrénées, puis a fait ses études de médecine à l'université Paris-Descartes. En 1982, il effectue son service militaire à la présidence de la République. Nommé au Palais de l’Élysée comme médecin-aspirant pendant son service militaire, attaché à la personne du chef de l’État, il passe alors un an aux côtés de François Mitterrand, à éprouver les effets de son étrange charisme. Accompagnant le président dans ses déplacements, il avait même eu deux ou trois conversations avec lui, parce qu'il avait su qu’il avait écrit un livre sur Lautréamont. Après son service militaire il s’est spécialisé en hématologie. Il deviendra maître de conférences universitaire à l'hôpital Saint-Antoine, professeur à la Faculté de médecine et chef du service d’hématologie biologique au CHU d’Amiens avant d'être professeur de médecine à Paris-Descartes et directeur de l'Institut national de transfusion sanguine (INTS). Ses recherches portent sur les agents pathogènes transmissibles par le sang et donc sur la sécurité des transfusions. Rédacteur-associé aux revues scientifiques Transfusion clinique et biologique et Hématologie, il a signé plus de 300 publications scientifiques dans des revues à comité de lecture et publié une dizaine d’ouvrages dans sa discipline. Parallèlement à cette carrière de chercheur et d’universitaire, il a consacré de nombreux travaux à différents auteurs de la fin du XIXe siècle français. Parmi les plus connus, Arthur Rimbaud, Lautréamont, Jules Laforgue, sur lesquels il a écrit des biographies. Ses enquêtes de terrain (jusqu'à Aden et Harar sur les traces de Rimbaud, jusqu’à Montevideo sur celles de Lautréamont) lui permettent d'exhumer de nombreux documents inédits. Déjà docteur en médecine (1985) et docteur en biologie, titulaire d'une thèse de doctorat en sciences médicales sur le VIH, il a également soutenu une thèse de doctorat ès lettres en 1996, consacrée au rimbaldien Rodolphe Darzens. Il est également cofondateur, avec Michel Pierssens, d’une revue littéraire intitulée Histoires littéraires et du « Colloque des Invalides », qui accorde à ses participants des interventions strictement limitées à cinq minutes. Il a aussi cofondé, avec Sylvain-Christian David, les Cahiers Lautréamont, parus de 1987 à 2010 (cahiers imprimés), puis 2012 (cahiers numériques), et a donné pendant des années des critiques à La Quinzaine littéraire durant la direction de Maurice Nadeau. Spécialiste de la littérature française du XIXe siècle, il sera aussi président de l'AAPPFID-France, Association des amis passés, présents et futurs d'Isidore Ducasse (en 2002), directeur de la revue "Histoires littéraires" (en 2006). En 2010, il fut témoin à décharge dans le procès intenté par Pierre Perret au Nouvel Observateur, dont un article accusait le chanteur d’avoir largement imaginé ses rencontres avec l’écrivain Paul Léautaud. En 2012, Jean-Jacques Lefrère a été acteur dans le film de Pascal Thomas, Associés contre le crime…, avec Catherine Frot et André Dussollier. En 2013, il collabore, avec le dessinateur Bertrand David, à un ouvrage présentant une nouvelle théorie sur l'art pariétal, appelée théorie des ombres (les hommes préhistoriques auraient inventé le dessin en traçant le contour d'ombres projetées à partir de figurines animalières). Cependant cette hypothèse est très controversée dans le monde scientifique. La théorie des ombres comprend une deuxième hypothèse portant sur l'interprétation de ces peintures, dans la lignée de la théorie totémique de Henri Breuil, mais proposant de voir dans ces grottes d'accès difficile des nécropoles symboliques. L'art préhistorique aurait servi de « monument aux morts » avant l'apparition des premières nécropoles, associées à la sédentarisation : de fait, il disparaît à cette date des suites d’un cancer foudroyant. Jean-Jacques Lefrère, médecin, aura consacré sa « seconde vie » à sa passion : l’Histoire littéraire. Chercheur infatigable, enquêteur méticuleux, il a exhumé un grand nombre de documents, textes et photographies inédites. Ses biographies de Lautréamont, Rimbaud et Laforgue font toujours référence. Durant des années, il s’était attelé à un travail inédit en France : celui de reconstituer, jour après jour, la genèse et la construction du mythe rimbaldien, de la mort du poète aux années 1930. Il est l'auteur d'une biographie d'Arthur Rimbaud (Fayard, 2001). Il a également publié, toujours chez Fayard, Les Saisons littéraires de Rodolphe Darzens (1998), Isidore Ducasse, comte de Lautréamont (1998), Che Guevara, en collaboration avec Jean-Hugues Berrou (2003), Jules Laforgue (2005), les albums Rimbaud à Harrar, Rimbaud à Aden et Rimbaud ailleurs, avec Pierre Leroy et Jean-Hugues Berrou (publiés entre 2001 et 2004), Ôte-moi d'un doute…L'énigme Corneille-Molière (avec Jean-Paul Goujon, 2006), et Correspondance d'Arthur Rimbaud (2007). Jean-Jacques Lefrère n’était pas un homme ordinaire. Les hommes ordinaires ont un métier chacun, qu’ils exercent tant bien que mal. Lefrère, lui, avait beaucoup hésité dans sa jeunesse entre la médecine et l’histoire littéraire. « J’ai finalement fait les deux », disait-il du ton de ceux qui ne regrettent rien. Il ne les a pas faits à moitié. Professeur en hématologie, scientifique reconnu, auteur de près de 300 articles parus dans des revues internationales et de nombreux ouvrages consacrés à l’« utilisation des produits sanguins », aux « hépatites virales » ou aux « Virus transmissibles par le sang », qu’il tenait bien rangés dans son bureau de directeur général de l’Institut national de transfusion sanguine (INTS), clairvoyant, cet auteur et médecin, l’était. Il y avait même quelque chose du sourcier et du fin limier chez cet infatigable chercheur d’inédits, auquel on doit quantité de trouvailles ayant enrichi l’histoire littéraire. Par la suite il identifiera l’ultime pellicule que possédait Che Guevara le jour de sa mort, localise la maison de maître où Rimbaud a vécu à Aden (Yémen), et met la main sur son portrait réalisé par Forain. Pour exhumer un document précieux, il n’hésite pas à s’envoler pour Moscou ou New York. Il part ainsi sur les traces de Rimbaud à Harar (Ethiopie) et de Lautréamont à Montevideo (Uruguay). Parfois les inédits étaient tout proches, sans que quiconque le sache. Par exemple, ce rare exemplaire des Poésies d’Isidore Ducasse, dormant à la Bibliothèque nationale, ou le dossier contenant l’original de la Lettre du voyant, de Rimbaud, qui, contrairement aux croyances des spécialistes, n’avait jamais quitté Paris. Ces trésors sous la semelle, à portée de pas, Jean-Jacques Lefrère, tête et barbe de corsaire, en parle comme du « syndrome de Rackham le Rouge ». Il appartient à cette race d’érudits obstinés, des hommes de démesure qui collectent tout, vérifient tout. Au point que Bernard Pivot a dit de lui : « Où Jean-Jacques Lefrère passe, les biographies ne repoussent pas. » Son édition de la correspondance d’Arthur Rimbaud, en trois volumes de plus de 1 200 pages chacun, pour laquelle Lefrère apprend même le dialecte amharique d’Abyssinie (empire d’Ethiopie), fut, à cet égard, un chantier titanesque. Il eût suffi à une vie d’homme. Pas à lui. Au fil des ans, l’historien s’est également attaché à l’œuvre de Jules Laforgue, aux poésies de François Caradec, a étudié les romans de Catulle Mendès, rédigé des ouvrages sur les symbolistes Rodolphe Darzens et Jean Ajalbert, sorti de l’oubli, avec Philippe Oriol, la figure de l’anarchiste Zo d’Axa (La feuille qui ne tremblait pas, Flammarion, 2013). C'est l'Indiana Jones de la rimbaldologie. Pour mettre la main sur un dossier constitué dans les années 1880 par le symboliste Rodolphe Darzens, et qui contenait l'original de la « Lettre du voyant » (envoyée au poète Paul Demeny le 15 mai 1871), cet hématologue qui a décidément la poésie dans le sang a fait le tour du monde : Ce dossier, je l'ai cherché à Moscou, où avait vécu Darzens, en Amérique du Sud, aux Etats-Unis, autant de fausses pistes et d'impasses. Un jour, je reçois un coup de fil du détenteur du dossier : il résidait à trois cents mètres de mon domicile. Une autre de ses aventures a été cette photo de Rimbaud, prise à l'Hôtel de l'Univers d'Aden, qu'il a authentifiée en 2010 : elle a donné lieu à une belle polémique et vient d'inspirer un joli petit roman à Serge Filippini (« Rimbaldo », la Table Ronde, 146 p., 16 euros). L'expertise de Lefrère a été confirmée par un chercheur en biométrique de similarité, cette technique de police scientifique qui compare plusieurs portraits d'un individu en mesurant chaque partie du visage, avec une précision au centième de millimètre. Ce Pic de la Mirandole qui a fait son service militaire comme médecin aspirant à l'Elysée, joué dans un film de Pascal Thomas, retrouvé l'ultime pellicule de photos prises par Che Guevara avant son exécution, et cosigné un essai audacieux sur le mystère des peintures pariétales, a poursuivi une des entreprises éditoriales les plus démesurées qui soient : publier, en sept tomes, tous les documents sur Rimbaud qu'il a pu dénicher. En fait, ce genre de livre se fait tout seul ou presque. « J'accumule au fil du temps des dossiers sur des sujets qui m'intéressent, j'ai la photocopie facile... et un système d'organisation que j'affine avec une certaine délectation d'artiste. C'est une méthode qui m'a aidé à vivre plusieurs vies à la fois. Et puis changer de thème de recherche est une forme de repos. » « Après ma journée de médecin, le soir j'entame une deuxième journée de lecture et d'écriture, c'est tout », balaie le modeste Sherlock Holmes tarbais. L'homme n'a rien d'un universitaire retranché derrière ses archives. Drôle de parcours que celui de cet hématologue de profession, titulaire de trois doctorats (médecine, biologie, ès lettres), qui a mené une double carrière pendant plusieurs décennies : la semaine pour la science, le week-end voué à la littérature. Expert en virologie, et professeur à l'université Paris-Descartes, il codirigeait l'Institut national de transfusion sanguine de Paris. A ce titre, il a signé plus de trois cents articles majeurs sur la transfusion sanguine dans des publications scientifiques réputées. Avec la même rigueur, il a cofondé les Cahiers Lautréamont, parus de 1987 à 2010, ainsi que la revue Histoires littéraires, avec son complice Michel Pierssens. Avec Jean-Jacques Lefrère, l’un des plus grands biographes de poètes du XIXe siècle, reconnu de la République des lettres, de Louis Aragon à Frédéric Mitterrand et Bernard Pivot, s'est éteint l'héritier spirituel de l'érudit Pascal Pia et de l'éditeur Maurice Nadeau, qu'il avait eu la chance de fréquenter et avec lesquels il partageait sa passion pour l'histoire littéraire, ses chemins de traverse et ses mystifications. Des années durant, la famille Lefrère s'installa au mois d'août dans l'appartement des arrière-grands-parents Calas, place Marcadieu, à quelques mètres de la graineterie bien connue des vieux Tarbais. Les randonnées s'enchaînaient dans les trois vallées sans que jamais Jean-Jacques Lefrère ne se sépare d'un petit carnet dans lequel il griffonnait ce qui lui venait à l'esprit, mettant à profit la moindre halte, le moindre ralentissement dans la circulation pour coucher quelque idée sur le papier. Marié à Kathryn, ils étaient les parents de deux enfants Caroline et Nicolas. Jean-Jacques avait aussi un frère François, médecin comme lui.
Jean-Jacques LEFRÈRE, né le 10 août 1954 à Tarbes et mort le 16 avril 2015 à Paris, à l’âge de 60 ans. Il est connu du grand public pour ses travaux sur la sécurité transfusionnelle et ses recherches littéraires sur Rimbaud et Lautréamont. Son premier fait de gloire est précoce. Isidore Ducasse, dit le comte de Lautréamont (1846-1870), était passé par le lycée Théophile-Gautier, dans ce qui était alors le lycée impérial, où lui-même est scolarisé. L’été de ses 17 ans, il prend son Solex et entreprend de retrouver ceux qui, en Bigorre, l’ont connu. C’est ainsi qu’il découvre dans un album de la famille Dazet la seule photo d'Isidore Ducasse collégien, l’auteur des Chants de Maldoror, auquel il consacrera plusieurs ouvrages. Jean-Jacques Lefrère a passé son enfance et son adolescence dans les Hautes Pyrénées, puis a fait ses études de médecine à l'université Paris-Descartes. En 1982, il effectue son service militaire à la présidence de la République. Nommé au Palais de l’Élysée comme médecin-aspirant pendant son service militaire, attaché à la personne du chef de l’État, il passe alors un an aux côtés de François Mitterrand, à éprouver les effets de son étrange charisme. Accompagnant le président dans ses déplacements, il avait même eu deux ou trois conversations avec lui, parce qu'il avait su qu’il avait écrit un livre sur Lautréamont. Après son service militaire il s’est spécialisé en hématologie. Il deviendra maître de conférences universitaire à l'hôpital Saint-Antoine, professeur à la Faculté de médecine et chef du service d’hématologie biologique au CHU d’Amiens avant d'être professeur de médecine à Paris-Descartes et directeur de l'Institut national de transfusion sanguine (INTS). Ses recherches portent sur les agents pathogènes transmissibles par le sang et donc sur la sécurité des transfusions. Rédacteur-associé aux revues scientifiques Transfusion clinique et biologique et Hématologie, il a signé plus de 300 publications scientifiques dans des revues à comité de lecture et publié une dizaine d’ouvrages dans sa discipline. Parallèlement à cette carrière de chercheur et d’universitaire, il a consacré de nombreux travaux à différents auteurs de la fin du XIXe siècle français. Parmi les plus connus, Arthur Rimbaud, Lautréamont, Jules Laforgue, sur lesquels il a écrit des biographies. Ses enquêtes de terrain (jusqu'à Aden et Harar sur les traces de Rimbaud, jusqu’à Montevideo sur celles de Lautréamont) lui permettent d'exhumer de nombreux documents inédits. Déjà docteur en médecine (1985) et docteur en biologie, titulaire d'une thèse de doctorat en sciences médicales sur le VIH, il a également soutenu une thèse de doctorat ès lettres en 1996, consacrée au rimbaldien Rodolphe Darzens. Il est également cofondateur, avec Michel Pierssens, d’une revue littéraire intitulée Histoires littéraires et du « Colloque des Invalides », qui accorde à ses participants des interventions strictement limitées à cinq minutes. Il a aussi cofondé, avec Sylvain-Christian David, les Cahiers Lautréamont, parus de 1987 à 2010 (cahiers imprimés), puis 2012 (cahiers numériques), et a donné pendant des années des critiques à La Quinzaine littéraire durant la direction de Maurice Nadeau. Spécialiste de la littérature française du XIXe siècle, il sera aussi président de l'AAPPFID-France, Association des amis passés, présents et futurs d'Isidore Ducasse (en 2002), directeur de la revue "Histoires littéraires" (en 2006). En 2010, il fut témoin à décharge dans le procès intenté par Pierre Perret au Nouvel Observateur, dont un article accusait le chanteur d’avoir largement imaginé ses rencontres avec l’écrivain Paul Léautaud. En 2012, Jean-Jacques Lefrère a été acteur dans le film de Pascal Thomas, Associés contre le crime…, avec Catherine Frot et André Dussollier. En 2013, il collabore, avec le dessinateur Bertrand David, à un ouvrage présentant une nouvelle théorie sur l'art pariétal, appelée théorie des ombres (les hommes préhistoriques auraient inventé le dessin en traçant le contour d'ombres projetées à partir de figurines animalières). Cependant cette hypothèse est très controversée dans le monde scientifique. La théorie des ombres comprend une deuxième hypothèse portant sur l'interprétation de ces peintures, dans la lignée de la théorie totémique de Henri Breuil, mais proposant de voir dans ces grottes d'accès difficile des nécropoles symboliques. L'art préhistorique aurait servi de « monument aux morts » avant l'apparition des premières nécropoles, associées à la sédentarisation : de fait, il disparaît à cette date des suites d’un cancer foudroyant. Jean-Jacques Lefrère, médecin, aura consacré sa « seconde vie » à sa passion : l’Histoire littéraire. Chercheur infatigable, enquêteur méticuleux, il a exhumé un grand nombre de documents, textes et photographies inédites. Ses biographies de Lautréamont, Rimbaud et Laforgue font toujours référence. Durant des années, il s’était attelé à un travail inédit en France : celui de reconstituer, jour après jour, la genèse et la construction du mythe rimbaldien, de la mort du poète aux années 1930. Il est l'auteur d'une biographie d'Arthur Rimbaud (Fayard, 2001). Il a également publié, toujours chez Fayard, Les Saisons littéraires de Rodolphe Darzens (1998), Isidore Ducasse, comte de Lautréamont (1998), Che Guevara, en collaboration avec Jean-Hugues Berrou (2003), Jules Laforgue (2005), les albums Rimbaud à Harrar, Rimbaud à Aden et Rimbaud ailleurs, avec Pierre Leroy et Jean-Hugues Berrou (publiés entre 2001 et 2004), Ôte-moi d'un doute…L'énigme Corneille-Molière (avec Jean-Paul Goujon, 2006), et Correspondance d'Arthur Rimbaud (2007). Jean-Jacques Lefrère n’était pas un homme ordinaire. Les hommes ordinaires ont un métier chacun, qu’ils exercent tant bien que mal. Lefrère, lui, avait beaucoup hésité dans sa jeunesse entre la médecine et l’histoire littéraire. « J’ai finalement fait les deux », disait-il du ton de ceux qui ne regrettent rien. Il ne les a pas faits à moitié. Professeur en hématologie, scientifique reconnu, auteur de près de 300 articles parus dans des revues internationales et de nombreux ouvrages consacrés à l’« utilisation des produits sanguins », aux « hépatites virales » ou aux « Virus transmissibles par le sang », qu’il tenait bien rangés dans son bureau de directeur général de l’Institut national de transfusion sanguine (INTS), clairvoyant, cet auteur et médecin, l’était. Il y avait même quelque chose du sourcier et du fin limier chez cet infatigable chercheur d’inédits, auquel on doit quantité de trouvailles ayant enrichi l’histoire littéraire. Par la suite il identifiera l’ultime pellicule que possédait Che Guevara le jour de sa mort, localise la maison de maître où Rimbaud a vécu à Aden (Yémen), et met la main sur son portrait réalisé par Forain. Pour exhumer un document précieux, il n’hésite pas à s’envoler pour Moscou ou New York. Il part ainsi sur les traces de Rimbaud à Harar (Ethiopie) et de Lautréamont à Montevideo (Uruguay). Parfois les inédits étaient tout proches, sans que quiconque le sache. Par exemple, ce rare exemplaire des Poésies d’Isidore Ducasse, dormant à la Bibliothèque nationale, ou le dossier contenant l’original de la Lettre du voyant, de Rimbaud, qui, contrairement aux croyances des spécialistes, n’avait jamais quitté Paris. Ces trésors sous la semelle, à portée de pas, Jean-Jacques Lefrère, tête et barbe de corsaire, en parle comme du « syndrome de Rackham le Rouge ». Il appartient à cette race d’érudits obstinés, des hommes de démesure qui collectent tout, vérifient tout. Au point que Bernard Pivot a dit de lui : « Où Jean-Jacques Lefrère passe, les biographies ne repoussent pas. » Son édition de la correspondance d’Arthur Rimbaud, en trois volumes de plus de 1 200 pages chacun, pour laquelle Lefrère apprend même le dialecte amharique d’Abyssinie (empire d’Ethiopie), fut, à cet égard, un chantier titanesque. Il eût suffi à une vie d’homme. Pas à lui. Au fil des ans, l’historien s’est également attaché à l’œuvre de Jules Laforgue, aux poésies de François Caradec, a étudié les romans de Catulle Mendès, rédigé des ouvrages sur les symbolistes Rodolphe Darzens et Jean Ajalbert, sorti de l’oubli, avec Philippe Oriol, la figure de l’anarchiste Zo d’Axa (La feuille qui ne tremblait pas, Flammarion, 2013). C'est l'Indiana Jones de la rimbaldologie. Pour mettre la main sur un dossier constitué dans les années 1880 par le symboliste Rodolphe Darzens, et qui contenait l'original de la « Lettre du voyant » (envoyée au poète Paul Demeny le 15 mai 1871), cet hématologue qui a décidément la poésie dans le sang a fait le tour du monde : Ce dossier, je l'ai cherché à Moscou, où avait vécu Darzens, en Amérique du Sud, aux Etats-Unis, autant de fausses pistes et d'impasses. Un jour, je reçois un coup de fil du détenteur du dossier : il résidait à trois cents mètres de mon domicile. Une autre de ses aventures a été cette photo de Rimbaud, prise à l'Hôtel de l'Univers d'Aden, qu'il a authentifiée en 2010 : elle a donné lieu à une belle polémique et vient d'inspirer un joli petit roman à Serge Filippini (« Rimbaldo », la Table Ronde, 146 p., 16 euros). L'expertise de Lefrère a été confirmée par un chercheur en biométrique de similarité, cette technique de police scientifique qui compare plusieurs portraits d'un individu en mesurant chaque partie du visage, avec une précision au centième de millimètre. Ce Pic de la Mirandole qui a fait son service militaire comme médecin aspirant à l'Elysée, joué dans un film de Pascal Thomas, retrouvé l'ultime pellicule de photos prises par Che Guevara avant son exécution, et cosigné un essai audacieux sur le mystère des peintures pariétales, a poursuivi une des entreprises éditoriales les plus démesurées qui soient : publier, en sept tomes, tous les documents sur Rimbaud qu'il a pu dénicher. En fait, ce genre de livre se fait tout seul ou presque. « J'accumule au fil du temps des dossiers sur des sujets qui m'intéressent, j'ai la photocopie facile... et un système d'organisation que j'affine avec une certaine délectation d'artiste. C'est une méthode qui m'a aidé à vivre plusieurs vies à la fois. Et puis changer de thème de recherche est une forme de repos. » « Après ma journée de médecin, le soir j'entame une deuxième journée de lecture et d'écriture, c'est tout », balaie le modeste Sherlock Holmes tarbais. L'homme n'a rien d'un universitaire retranché derrière ses archives. Drôle de parcours que celui de cet hématologue de profession, titulaire de trois doctorats (médecine, biologie, ès lettres), qui a mené une double carrière pendant plusieurs décennies : la semaine pour la science, le week-end voué à la littérature. Expert en virologie, et professeur à l'université Paris-Descartes, il codirigeait l'Institut national de transfusion sanguine de Paris. A ce titre, il a signé plus de trois cents articles majeurs sur la transfusion sanguine dans des publications scientifiques réputées. Avec la même rigueur, il a cofondé les Cahiers Lautréamont, parus de 1987 à 2010, ainsi que la revue Histoires littéraires, avec son complice Michel Pierssens. Avec Jean-Jacques Lefrère, l’un des plus grands biographes de poètes du XIXe siècle, reconnu de la République des lettres, de Louis Aragon à Frédéric Mitterrand et Bernard Pivot, s'est éteint l'héritier spirituel de l'érudit Pascal Pia et de l'éditeur Maurice Nadeau, qu'il avait eu la chance de fréquenter et avec lesquels il partageait sa passion pour l'histoire littéraire, ses chemins de traverse et ses mystifications. Des années durant, la famille Lefrère s'installa au mois d'août dans l'appartement des arrière-grands-parents Calas, place Marcadieu, à quelques mètres de la graineterie bien connue des vieux Tarbais. Les randonnées s'enchaînaient dans les trois vallées sans que jamais Jean-Jacques Lefrère ne se sépare d'un petit carnet dans lequel il griffonnait ce qui lui venait à l'esprit, mettant à profit la moindre halte, le moindre ralentissement dans la circulation pour coucher quelque idée sur le papier. Marié à Kathryn, ils étaient les parents de deux enfants Caroline et Nicolas. Jean-Jacques avait aussi un frère François, médecin comme lui.
 Jean-Jacques LEFRÈRE, né le 10 août 1954 à Tarbes et mort le 16 avril 2015 à Paris, à l’âge de 60 ans. Il est connu du grand public pour ses travaux sur la sécurité transfusionnelle et ses recherches littéraires sur Rimbaud et Lautréamont. Son premier fait de gloire est précoce. Isidore Ducasse, dit le comte de Lautréamont (1846-1870), était passé par le lycée Théophile-Gautier, dans ce qui était alors le lycée impérial, où lui-même est scolarisé. L’été de ses 17 ans, il prend son Solex et entreprend de retrouver ceux qui, en Bigorre, l’ont connu. C’est ainsi qu’il découvre dans un album de la famille Dazet la seule photo d'Isidore Ducasse collégien, l’auteur des Chants de Maldoror, auquel il consacrera plusieurs ouvrages. Jean-Jacques Lefrère a passé son enfance et son adolescence dans les Hautes Pyrénées, puis a fait ses études de médecine à l'université Paris-Descartes. En 1982, il effectue son service militaire à la présidence de la République. Nommé au Palais de l’Élysée comme médecin-aspirant pendant son service militaire, attaché à la personne du chef de l’État, il passe alors un an aux côtés de François Mitterrand, à éprouver les effets de son étrange charisme. Accompagnant le président dans ses déplacements, il avait même eu deux ou trois conversations avec lui, parce qu'il avait su qu’il avait écrit un livre sur Lautréamont. Après son service militaire il s’est spécialisé en hématologie. Il deviendra maître de conférences universitaire à l'hôpital Saint-Antoine, professeur à la Faculté de médecine et chef du service d’hématologie biologique au CHU d’Amiens avant d'être professeur de médecine à Paris-Descartes et directeur de l'Institut national de transfusion sanguine (INTS). Ses recherches portent sur les agents pathogènes transmissibles par le sang et donc sur la sécurité des transfusions. Rédacteur-associé aux revues scientifiques Transfusion clinique et biologique et Hématologie, il a signé plus de 300 publications scientifiques dans des revues à comité de lecture et publié une dizaine d’ouvrages dans sa discipline. Parallèlement à cette carrière de chercheur et d’universitaire, il a consacré de nombreux travaux à différents auteurs de la fin du XIXe siècle français. Parmi les plus connus, Arthur Rimbaud, Lautréamont, Jules Laforgue, sur lesquels il a écrit des biographies. Ses enquêtes de terrain (jusqu'à Aden et Harar sur les traces de Rimbaud, jusqu’à Montevideo sur celles de Lautréamont) lui permettent d'exhumer de nombreux documents inédits. Déjà docteur en médecine (1985) et docteur en biologie, titulaire d'une thèse de doctorat en sciences médicales sur le VIH, il a également soutenu une thèse de doctorat ès lettres en 1996, consacrée au rimbaldien Rodolphe Darzens. Il est également cofondateur, avec Michel Pierssens, d’une revue littéraire intitulée Histoires littéraires et du « Colloque des Invalides », qui accorde à ses participants des interventions strictement limitées à cinq minutes. Il a aussi cofondé, avec Sylvain-Christian David, les Cahiers Lautréamont, parus de 1987 à 2010 (cahiers imprimés), puis 2012 (cahiers numériques), et a donné pendant des années des critiques à La Quinzaine littéraire durant la direction de Maurice Nadeau. Spécialiste de la littérature française du XIXe siècle, il sera aussi président de l'AAPPFID-France, Association des amis passés, présents et futurs d'Isidore Ducasse (en 2002), directeur de la revue "Histoires littéraires" (en 2006). En 2010, il fut témoin à décharge dans le procès intenté par Pierre Perret au Nouvel Observateur, dont un article accusait le chanteur d’avoir largement imaginé ses rencontres avec l’écrivain Paul Léautaud. En 2012, Jean-Jacques Lefrère a été acteur dans le film de Pascal Thomas, Associés contre le crime…, avec Catherine Frot et André Dussollier. En 2013, il collabore, avec le dessinateur Bertrand David, à un ouvrage présentant une nouvelle théorie sur l'art pariétal, appelée théorie des ombres (les hommes préhistoriques auraient inventé le dessin en traçant le contour d'ombres projetées à partir de figurines animalières). Cependant cette hypothèse est très controversée dans le monde scientifique. La théorie des ombres comprend une deuxième hypothèse portant sur l'interprétation de ces peintures, dans la lignée de la théorie totémique de Henri Breuil, mais proposant de voir dans ces grottes d'accès difficile des nécropoles symboliques. L'art préhistorique aurait servi de « monument aux morts » avant l'apparition des premières nécropoles, associées à la sédentarisation : de fait, il disparaît à cette date des suites d’un cancer foudroyant. Jean-Jacques Lefrère, médecin, aura consacré sa « seconde vie » à sa passion : l’Histoire littéraire. Chercheur infatigable, enquêteur méticuleux, il a exhumé un grand nombre de documents, textes et photographies inédites. Ses biographies de Lautréamont, Rimbaud et Laforgue font toujours référence. Durant des années, il s’était attelé à un travail inédit en France : celui de reconstituer, jour après jour, la genèse et la construction du mythe rimbaldien, de la mort du poète aux années 1930. Il est l'auteur d'une biographie d'Arthur Rimbaud (Fayard, 2001). Il a également publié, toujours chez Fayard, Les Saisons littéraires de Rodolphe Darzens (1998), Isidore Ducasse, comte de Lautréamont (1998), Che Guevara, en collaboration avec Jean-Hugues Berrou (2003), Jules Laforgue (2005), les albums Rimbaud à Harrar, Rimbaud à Aden et Rimbaud ailleurs, avec Pierre Leroy et Jean-Hugues Berrou (publiés entre 2001 et 2004), Ôte-moi d'un doute…L'énigme Corneille-Molière (avec Jean-Paul Goujon, 2006), et Correspondance d'Arthur Rimbaud (2007). Jean-Jacques Lefrère n’était pas un homme ordinaire. Les hommes ordinaires ont un métier chacun, qu’ils exercent tant bien que mal. Lefrère, lui, avait beaucoup hésité dans sa jeunesse entre la médecine et l’histoire littéraire. « J’ai finalement fait les deux », disait-il du ton de ceux qui ne regrettent rien. Il ne les a pas faits à moitié. Professeur en hématologie, scientifique reconnu, auteur de près de 300 articles parus dans des revues internationales et de nombreux ouvrages consacrés à l’« utilisation des produits sanguins », aux « hépatites virales » ou aux « Virus transmissibles par le sang », qu’il tenait bien rangés dans son bureau de directeur général de l’Institut national de transfusion sanguine (INTS), clairvoyant, cet auteur et médecin, l’était. Il y avait même quelque chose du sourcier et du fin limier chez cet infatigable chercheur d’inédits, auquel on doit quantité de trouvailles ayant enrichi l’histoire littéraire. Par la suite il identifiera l’ultime pellicule que possédait Che Guevara le jour de sa mort, localise la maison de maître où Rimbaud a vécu à Aden (Yémen), et met la main sur son portrait réalisé par Forain. Pour exhumer un document précieux, il n’hésite pas à s’envoler pour Moscou ou New York. Il part ainsi sur les traces de Rimbaud à Harar (Ethiopie) et de Lautréamont à Montevideo (Uruguay). Parfois les inédits étaient tout proches, sans que quiconque le sache. Par exemple, ce rare exemplaire des Poésies d’Isidore Ducasse, dormant à la Bibliothèque nationale, ou le dossier contenant l’original de la Lettre du voyant, de Rimbaud, qui, contrairement aux croyances des spécialistes, n’avait jamais quitté Paris. Ces trésors sous la semelle, à portée de pas, Jean-Jacques Lefrère, tête et barbe de corsaire, en parle comme du « syndrome de Rackham le Rouge ». Il appartient à cette race d’érudits obstinés, des hommes de démesure qui collectent tout, vérifient tout. Au point que Bernard Pivot a dit de lui : « Où Jean-Jacques Lefrère passe, les biographies ne repoussent pas. » Son édition de la correspondance d’Arthur Rimbaud, en trois volumes de plus de 1 200 pages chacun, pour laquelle Lefrère apprend même le dialecte amharique d’Abyssinie (empire d’Ethiopie), fut, à cet égard, un chantier titanesque. Il eût suffi à une vie d’homme. Pas à lui. Au fil des ans, l’historien s’est également attaché à l’œuvre de Jules Laforgue, aux poésies de François Caradec, a étudié les romans de Catulle Mendès, rédigé des ouvrages sur les symbolistes Rodolphe Darzens et Jean Ajalbert, sorti de l’oubli, avec Philippe Oriol, la figure de l’anarchiste Zo d’Axa (La feuille qui ne tremblait pas, Flammarion, 2013). C'est l'Indiana Jones de la rimbaldologie. Pour mettre la main sur un dossier constitué dans les années 1880 par le symboliste Rodolphe Darzens, et qui contenait l'original de la « Lettre du voyant » (envoyée au poète Paul Demeny le 15 mai 1871), cet hématologue qui a décidément la poésie dans le sang a fait le tour du monde : Ce dossier, je l'ai cherché à Moscou, où avait vécu Darzens, en Amérique du Sud, aux Etats-Unis, autant de fausses pistes et d'impasses. Un jour, je reçois un coup de fil du détenteur du dossier : il résidait à trois cents mètres de mon domicile. Une autre de ses aventures a été cette photo de Rimbaud, prise à l'Hôtel de l'Univers d'Aden, qu'il a authentifiée en 2010 : elle a donné lieu à une belle polémique et vient d'inspirer un joli petit roman à Serge Filippini (« Rimbaldo », la Table Ronde, 146 p., 16 euros). L'expertise de Lefrère a été confirmée par un chercheur en biométrique de similarité, cette technique de police scientifique qui compare plusieurs portraits d'un individu en mesurant chaque partie du visage, avec une précision au centième de millimètre. Ce Pic de la Mirandole qui a fait son service militaire comme médecin aspirant à l'Elysée, joué dans un film de Pascal Thomas, retrouvé l'ultime pellicule de photos prises par Che Guevara avant son exécution, et cosigné un essai audacieux sur le mystère des peintures pariétales, a poursuivi une des entreprises éditoriales les plus démesurées qui soient : publier, en sept tomes, tous les documents sur Rimbaud qu'il a pu dénicher. En fait, ce genre de livre se fait tout seul ou presque. « J'accumule au fil du temps des dossiers sur des sujets qui m'intéressent, j'ai la photocopie facile... et un système d'organisation que j'affine avec une certaine délectation d'artiste. C'est une méthode qui m'a aidé à vivre plusieurs vies à la fois. Et puis changer de thème de recherche est une forme de repos. » « Après ma journée de médecin, le soir j'entame une deuxième journée de lecture et d'écriture, c'est tout », balaie le modeste Sherlock Holmes tarbais. L'homme n'a rien d'un universitaire retranché derrière ses archives. Drôle de parcours que celui de cet hématologue de profession, titulaire de trois doctorats (médecine, biologie, ès lettres), qui a mené une double carrière pendant plusieurs décennies : la semaine pour la science, le week-end voué à la littérature. Expert en virologie, et professeur à l'université Paris-Descartes, il codirigeait l'Institut national de transfusion sanguine de Paris. A ce titre, il a signé plus de trois cents articles majeurs sur la transfusion sanguine dans des publications scientifiques réputées. Avec la même rigueur, il a cofondé les Cahiers Lautréamont, parus de 1987 à 2010, ainsi que la revue Histoires littéraires, avec son complice Michel Pierssens. Avec Jean-Jacques Lefrère, l’un des plus grands biographes de poètes du XIXe siècle, reconnu de la République des lettres, de Louis Aragon à Frédéric Mitterrand et Bernard Pivot, s'est éteint l'héritier spirituel de l'érudit Pascal Pia et de l'éditeur Maurice Nadeau, qu'il avait eu la chance de fréquenter et avec lesquels il partageait sa passion pour l'histoire littéraire, ses chemins de traverse et ses mystifications. Des années durant, la famille Lefrère s'installa au mois d'août dans l'appartement des arrière-grands-parents Calas, place Marcadieu, à quelques mètres de la graineterie bien connue des vieux Tarbais. Les randonnées s'enchaînaient dans les trois vallées sans que jamais Jean-Jacques Lefrère ne se sépare d'un petit carnet dans lequel il griffonnait ce qui lui venait à l'esprit, mettant à profit la moindre halte, le moindre ralentissement dans la circulation pour coucher quelque idée sur le papier. Marié à Kathryn, ils étaient les parents de deux enfants Caroline et Nicolas. Jean-Jacques avait aussi un frère François, médecin comme lui.
Jean-Jacques LEFRÈRE, né le 10 août 1954 à Tarbes et mort le 16 avril 2015 à Paris, à l’âge de 60 ans. Il est connu du grand public pour ses travaux sur la sécurité transfusionnelle et ses recherches littéraires sur Rimbaud et Lautréamont. Son premier fait de gloire est précoce. Isidore Ducasse, dit le comte de Lautréamont (1846-1870), était passé par le lycée Théophile-Gautier, dans ce qui était alors le lycée impérial, où lui-même est scolarisé. L’été de ses 17 ans, il prend son Solex et entreprend de retrouver ceux qui, en Bigorre, l’ont connu. C’est ainsi qu’il découvre dans un album de la famille Dazet la seule photo d'Isidore Ducasse collégien, l’auteur des Chants de Maldoror, auquel il consacrera plusieurs ouvrages. Jean-Jacques Lefrère a passé son enfance et son adolescence dans les Hautes Pyrénées, puis a fait ses études de médecine à l'université Paris-Descartes. En 1982, il effectue son service militaire à la présidence de la République. Nommé au Palais de l’Élysée comme médecin-aspirant pendant son service militaire, attaché à la personne du chef de l’État, il passe alors un an aux côtés de François Mitterrand, à éprouver les effets de son étrange charisme. Accompagnant le président dans ses déplacements, il avait même eu deux ou trois conversations avec lui, parce qu'il avait su qu’il avait écrit un livre sur Lautréamont. Après son service militaire il s’est spécialisé en hématologie. Il deviendra maître de conférences universitaire à l'hôpital Saint-Antoine, professeur à la Faculté de médecine et chef du service d’hématologie biologique au CHU d’Amiens avant d'être professeur de médecine à Paris-Descartes et directeur de l'Institut national de transfusion sanguine (INTS). Ses recherches portent sur les agents pathogènes transmissibles par le sang et donc sur la sécurité des transfusions. Rédacteur-associé aux revues scientifiques Transfusion clinique et biologique et Hématologie, il a signé plus de 300 publications scientifiques dans des revues à comité de lecture et publié une dizaine d’ouvrages dans sa discipline. Parallèlement à cette carrière de chercheur et d’universitaire, il a consacré de nombreux travaux à différents auteurs de la fin du XIXe siècle français. Parmi les plus connus, Arthur Rimbaud, Lautréamont, Jules Laforgue, sur lesquels il a écrit des biographies. Ses enquêtes de terrain (jusqu'à Aden et Harar sur les traces de Rimbaud, jusqu’à Montevideo sur celles de Lautréamont) lui permettent d'exhumer de nombreux documents inédits. Déjà docteur en médecine (1985) et docteur en biologie, titulaire d'une thèse de doctorat en sciences médicales sur le VIH, il a également soutenu une thèse de doctorat ès lettres en 1996, consacrée au rimbaldien Rodolphe Darzens. Il est également cofondateur, avec Michel Pierssens, d’une revue littéraire intitulée Histoires littéraires et du « Colloque des Invalides », qui accorde à ses participants des interventions strictement limitées à cinq minutes. Il a aussi cofondé, avec Sylvain-Christian David, les Cahiers Lautréamont, parus de 1987 à 2010 (cahiers imprimés), puis 2012 (cahiers numériques), et a donné pendant des années des critiques à La Quinzaine littéraire durant la direction de Maurice Nadeau. Spécialiste de la littérature française du XIXe siècle, il sera aussi président de l'AAPPFID-France, Association des amis passés, présents et futurs d'Isidore Ducasse (en 2002), directeur de la revue "Histoires littéraires" (en 2006). En 2010, il fut témoin à décharge dans le procès intenté par Pierre Perret au Nouvel Observateur, dont un article accusait le chanteur d’avoir largement imaginé ses rencontres avec l’écrivain Paul Léautaud. En 2012, Jean-Jacques Lefrère a été acteur dans le film de Pascal Thomas, Associés contre le crime…, avec Catherine Frot et André Dussollier. En 2013, il collabore, avec le dessinateur Bertrand David, à un ouvrage présentant une nouvelle théorie sur l'art pariétal, appelée théorie des ombres (les hommes préhistoriques auraient inventé le dessin en traçant le contour d'ombres projetées à partir de figurines animalières). Cependant cette hypothèse est très controversée dans le monde scientifique. La théorie des ombres comprend une deuxième hypothèse portant sur l'interprétation de ces peintures, dans la lignée de la théorie totémique de Henri Breuil, mais proposant de voir dans ces grottes d'accès difficile des nécropoles symboliques. L'art préhistorique aurait servi de « monument aux morts » avant l'apparition des premières nécropoles, associées à la sédentarisation : de fait, il disparaît à cette date des suites d’un cancer foudroyant. Jean-Jacques Lefrère, médecin, aura consacré sa « seconde vie » à sa passion : l’Histoire littéraire. Chercheur infatigable, enquêteur méticuleux, il a exhumé un grand nombre de documents, textes et photographies inédites. Ses biographies de Lautréamont, Rimbaud et Laforgue font toujours référence. Durant des années, il s’était attelé à un travail inédit en France : celui de reconstituer, jour après jour, la genèse et la construction du mythe rimbaldien, de la mort du poète aux années 1930. Il est l'auteur d'une biographie d'Arthur Rimbaud (Fayard, 2001). Il a également publié, toujours chez Fayard, Les Saisons littéraires de Rodolphe Darzens (1998), Isidore Ducasse, comte de Lautréamont (1998), Che Guevara, en collaboration avec Jean-Hugues Berrou (2003), Jules Laforgue (2005), les albums Rimbaud à Harrar, Rimbaud à Aden et Rimbaud ailleurs, avec Pierre Leroy et Jean-Hugues Berrou (publiés entre 2001 et 2004), Ôte-moi d'un doute…L'énigme Corneille-Molière (avec Jean-Paul Goujon, 2006), et Correspondance d'Arthur Rimbaud (2007). Jean-Jacques Lefrère n’était pas un homme ordinaire. Les hommes ordinaires ont un métier chacun, qu’ils exercent tant bien que mal. Lefrère, lui, avait beaucoup hésité dans sa jeunesse entre la médecine et l’histoire littéraire. « J’ai finalement fait les deux », disait-il du ton de ceux qui ne regrettent rien. Il ne les a pas faits à moitié. Professeur en hématologie, scientifique reconnu, auteur de près de 300 articles parus dans des revues internationales et de nombreux ouvrages consacrés à l’« utilisation des produits sanguins », aux « hépatites virales » ou aux « Virus transmissibles par le sang », qu’il tenait bien rangés dans son bureau de directeur général de l’Institut national de transfusion sanguine (INTS), clairvoyant, cet auteur et médecin, l’était. Il y avait même quelque chose du sourcier et du fin limier chez cet infatigable chercheur d’inédits, auquel on doit quantité de trouvailles ayant enrichi l’histoire littéraire. Par la suite il identifiera l’ultime pellicule que possédait Che Guevara le jour de sa mort, localise la maison de maître où Rimbaud a vécu à Aden (Yémen), et met la main sur son portrait réalisé par Forain. Pour exhumer un document précieux, il n’hésite pas à s’envoler pour Moscou ou New York. Il part ainsi sur les traces de Rimbaud à Harar (Ethiopie) et de Lautréamont à Montevideo (Uruguay). Parfois les inédits étaient tout proches, sans que quiconque le sache. Par exemple, ce rare exemplaire des Poésies d’Isidore Ducasse, dormant à la Bibliothèque nationale, ou le dossier contenant l’original de la Lettre du voyant, de Rimbaud, qui, contrairement aux croyances des spécialistes, n’avait jamais quitté Paris. Ces trésors sous la semelle, à portée de pas, Jean-Jacques Lefrère, tête et barbe de corsaire, en parle comme du « syndrome de Rackham le Rouge ». Il appartient à cette race d’érudits obstinés, des hommes de démesure qui collectent tout, vérifient tout. Au point que Bernard Pivot a dit de lui : « Où Jean-Jacques Lefrère passe, les biographies ne repoussent pas. » Son édition de la correspondance d’Arthur Rimbaud, en trois volumes de plus de 1 200 pages chacun, pour laquelle Lefrère apprend même le dialecte amharique d’Abyssinie (empire d’Ethiopie), fut, à cet égard, un chantier titanesque. Il eût suffi à une vie d’homme. Pas à lui. Au fil des ans, l’historien s’est également attaché à l’œuvre de Jules Laforgue, aux poésies de François Caradec, a étudié les romans de Catulle Mendès, rédigé des ouvrages sur les symbolistes Rodolphe Darzens et Jean Ajalbert, sorti de l’oubli, avec Philippe Oriol, la figure de l’anarchiste Zo d’Axa (La feuille qui ne tremblait pas, Flammarion, 2013). C'est l'Indiana Jones de la rimbaldologie. Pour mettre la main sur un dossier constitué dans les années 1880 par le symboliste Rodolphe Darzens, et qui contenait l'original de la « Lettre du voyant » (envoyée au poète Paul Demeny le 15 mai 1871), cet hématologue qui a décidément la poésie dans le sang a fait le tour du monde : Ce dossier, je l'ai cherché à Moscou, où avait vécu Darzens, en Amérique du Sud, aux Etats-Unis, autant de fausses pistes et d'impasses. Un jour, je reçois un coup de fil du détenteur du dossier : il résidait à trois cents mètres de mon domicile. Une autre de ses aventures a été cette photo de Rimbaud, prise à l'Hôtel de l'Univers d'Aden, qu'il a authentifiée en 2010 : elle a donné lieu à une belle polémique et vient d'inspirer un joli petit roman à Serge Filippini (« Rimbaldo », la Table Ronde, 146 p., 16 euros). L'expertise de Lefrère a été confirmée par un chercheur en biométrique de similarité, cette technique de police scientifique qui compare plusieurs portraits d'un individu en mesurant chaque partie du visage, avec une précision au centième de millimètre. Ce Pic de la Mirandole qui a fait son service militaire comme médecin aspirant à l'Elysée, joué dans un film de Pascal Thomas, retrouvé l'ultime pellicule de photos prises par Che Guevara avant son exécution, et cosigné un essai audacieux sur le mystère des peintures pariétales, a poursuivi une des entreprises éditoriales les plus démesurées qui soient : publier, en sept tomes, tous les documents sur Rimbaud qu'il a pu dénicher. En fait, ce genre de livre se fait tout seul ou presque. « J'accumule au fil du temps des dossiers sur des sujets qui m'intéressent, j'ai la photocopie facile... et un système d'organisation que j'affine avec une certaine délectation d'artiste. C'est une méthode qui m'a aidé à vivre plusieurs vies à la fois. Et puis changer de thème de recherche est une forme de repos. » « Après ma journée de médecin, le soir j'entame une deuxième journée de lecture et d'écriture, c'est tout », balaie le modeste Sherlock Holmes tarbais. L'homme n'a rien d'un universitaire retranché derrière ses archives. Drôle de parcours que celui de cet hématologue de profession, titulaire de trois doctorats (médecine, biologie, ès lettres), qui a mené une double carrière pendant plusieurs décennies : la semaine pour la science, le week-end voué à la littérature. Expert en virologie, et professeur à l'université Paris-Descartes, il codirigeait l'Institut national de transfusion sanguine de Paris. A ce titre, il a signé plus de trois cents articles majeurs sur la transfusion sanguine dans des publications scientifiques réputées. Avec la même rigueur, il a cofondé les Cahiers Lautréamont, parus de 1987 à 2010, ainsi que la revue Histoires littéraires, avec son complice Michel Pierssens. Avec Jean-Jacques Lefrère, l’un des plus grands biographes de poètes du XIXe siècle, reconnu de la République des lettres, de Louis Aragon à Frédéric Mitterrand et Bernard Pivot, s'est éteint l'héritier spirituel de l'érudit Pascal Pia et de l'éditeur Maurice Nadeau, qu'il avait eu la chance de fréquenter et avec lesquels il partageait sa passion pour l'histoire littéraire, ses chemins de traverse et ses mystifications. Des années durant, la famille Lefrère s'installa au mois d'août dans l'appartement des arrière-grands-parents Calas, place Marcadieu, à quelques mètres de la graineterie bien connue des vieux Tarbais. Les randonnées s'enchaînaient dans les trois vallées sans que jamais Jean-Jacques Lefrère ne se sépare d'un petit carnet dans lequel il griffonnait ce qui lui venait à l'esprit, mettant à profit la moindre halte, le moindre ralentissement dans la circulation pour coucher quelque idée sur le papier. Marié à Kathryn, ils étaient les parents de deux enfants Caroline et Nicolas. Jean-Jacques avait aussi un frère François, médecin comme lui.LEGENDRE Anouk (1961-XXXX)
Architecte et cofondatrice de l'agence parisienne XTU
 Anouk LEGENDRE, née le 28 juin 1961 à Aureilhan est architecte, associée et cofondatrice de XTU architects à Paris. Diplômée de l’École d’architecture de Paris-la Villette en 1986, elle est titulaire d’un certificat d'études approfondies en architecture de paysage et d’un diplôme d’études approfondies en aménagement (Sorbonne). Plusieurs fois lauréate de la compétition des jeunes architectes Europan, elle remporte les Albums des jeunes architectes en 1992, aux côtés de Nicolas Desmazières avec qui elle fonde l’agence XTU en 2000 après avoir travaillé sur l'American Center de Franck Gehry à Paris. Riche d’une vingtaine d’années d'expérience dans la conception de grands projets et infrastructures urbains, elle est aujourd’hui membre du comité scientifique du Think-Tank "Énergie et Territoires" d’EDF, de l’association Architectes Français à l'Export - AFEX et de l’association Cobaty. Elle donne des conférences dans le monde entier (Montréal, Oslo, Wuhan, Yaoundé, Paris, Budapest, Zurich, Londres, Taipei, Tel Aviv, Rome...). Elle est présidente du jury national de la construction bois 2018. XTU (X pour l’inconnue mathématique; TU, suffixe de «situ») est spécialisé dans la recherche académique et environnementale ainsi que dans les bâtiments résidentiels et culturels. Ses travaux ont fait l’objet de plusieurs expositions : galerie d’architecture, Académie d’architecture de Séoul, Centre Pompidou en 2019 (27 maquettes de l’agence sont rentrées dans les collections du Centre Pompidou), Archilab. Les réalisations de XTU ont de nombreuses fois été primées : Jeongok Prehistory Museum en Corée du Sud (prix de l’Académie Coréenne d’Architecture), Pavillon France de l’Exposition universelle Milano 2015 (prix du meilleur pavillon section architecture), Cité du vin à Bordeaux (prix d’honneur du prix national de la Construction bois 2017), TED à Strasbourg en France (tour à énergie positive). Adeptes de la biodiversité dans la ville, les deux fondateurs de l’agence XTU architects travaillent avec ardeur à concevoir la métropole du futur « sobre, dense et résiliente ». De Gyeonggi en Corée du Sud à San Francisco en Californie, ils font rayonner l’innovation architecturale française. Leur chemin se croise en Bavière en Allemagne à l’occasion d’un voyage d’études. Suivront le Japon, « fondateur » de leur travail, des randonnées dans le désert africain pour se ressourcer et l’Islande avec ses paysages « façonnés par les flux », en rupture totale avec la conception traditionnelle de la géométrie. Anouk Legendre, un nom qui commence à bien briller dans le monde de l'architecture. Avec son associé dans le cabinet XTU, Nicolas Desmazières, né au Maroc et fils de diplomate, elle avait signé la Cité du vin à Bordeaux, devenue, sur la rive de la Gironde, l'emblème du Bordelais. Mais pas seulement… Même si elle vit à Paris, elle a toujours gardé un lien très fort avec la Bigorre. « J'ai vécu à Tarbes de ma naissance jusqu'au bac, ensuite j'ai poursuivi mes études à Bordeaux, puis à Paris, à l'École nationale supérieure d'architecture de La Villette, où j'ai d'ailleurs rencontré Nicolas, mon associé. Un de nos premiers gros projets a été le musée de la Préhistoire de Jeongok, en Corée du Sud, dans lequel il a fallu s'intégrer au paysage, mais surtout intégrer la culture asiatique du feng shui. Je pense que ça a été fondateur. Dans la foulée, nous avons réalisé le musée des Civilisations de la Réunion, où nous avons pu mettre en application nos idées. Nous portons l'idée qu'un bâtiment doit être en cohérence avec son milieu, son contexte. Ne pas le dénaturer, ni visuellement, ni techniquement… Déjà, nous utilisons des matériaux naturels, comme le bois par exemple pour le pavillon de la France à l'Exposition universelle de Milan, que nous avions dessiné. Mais on va plus loin. On parle beaucoup de bâtiments à énergie positive, mais généralement, les solutions classiques ne font que stocker l'énergie dans le bâtiment. Nous, on cherche, par des solutions végétales, à créer des climatisations, ou des chauffages naturels. On raisonne en flux d'énergie, pas en quantité. Le concept de départ, c'est de verdir la ville, utiliser les toits pour des plantations par exemple, ou installer des murs végétalisés, qui créent une fraîcheur naturelle. Et puis, on a ce concept de bio-façades, des sortes de champs verticaux. Entre deux parois de verre, on cultive des micro-algues, qui ont la vertu d'être isolantes, de produire du frais quand il fait chaud et inversement, mais elles sont aussi capables de produire des aliments, des cosmétiques, des médicaments. Cette façade de nouvelle génération permettrait de cultiver, au sein de capteurs solaires biologiques (photobioréacteurs), des micro-algues à haute valeur ajoutée pour la recherche médicale. Mais au-delà de tout, l'idée, c'est d'améliorer le vécu dans la ville. Nous avons remporté un projet, à Paris, d'une résidence entièrement équipée de bio-façades, qui sera le premier bâtiment résidentiel au monde construit avec ce procédé. Qui est 100 % français, et ça, on en est assez fiers. Parce que c'est sans doute la technologie architecturale du futur. Sans doute mes origines tarbaises, l'air des Pyrénées ! J'ai toujours été proche de la nature, de la campagne. J'aime l'idée d'amener la campagne dans les villes, faire, en quelque sorte, du béton ver. » Anouk et Nicolas, les deux architectes fondateurs de l'agence XTU en 2000, ont développé une approche résolument novatrice de la ville et de l’habitat inspirée du vivant. Actifs depuis 20 ans, ils explorent les rapports du bâti avec le vivant et le végétal. Musées, logements, bureaux, équipements publics, quartiers… en France et à l’étranger, leurs projets traduisent leur implication dans la recherche expérimentale, animée par cette conviction : l’architecture doit anticiper le futur et la troisième révolution industrielle sera biologique. Ils comptent de nombreuses réalisations innovantes, souvent primées, tant sur le plan architectural qu’environnemental. Ils s'investissent fortement dans l'agriculture urbaine et la recherche expérimentale, à la croisée des sciences du vivant, de l'écologie, de l'architecture et de l'urbanisme. Titulaires de trois brevets technologiques en 2011, ils ont notamment inventé et développé avec le CNRS, le système de « bio-façades » (façades actives intégrant des cultures de micro-algues). La bio-façade solaire à micro-algues agit comme une serre en accumulant l’énergie solaire et crée un tampon thermique qui améliore l’isolation du bâtiment. La façade est composée de trois vitrages. Dans l’un des interstices, court un filet d’eau qui nourrit des algues solaires. Ce plancton, qui présente les mêmes besoins thermiques que l’homme, transforme, selon le principe de la photosynthèse, le CO2 en oxygène et biomasse. Une architecture dépolluante et verte qui permet ainsi une économie de 50% sur les besoins thermiques d’un bâtiment. Plusieurs projets de bio-façades sont en cours à travers le monde. De Gyeonggi en Corée du Sud à San Francisco en Californie, ils font rayonner l’innovation architecturale française. Pour Anouk, le premier voyage est celui qui l’a menée de Tarbes à l’École d’architecture de Bordeaux. « Au départ, je voulais devenir ingénieur agronome ». La jeune femme pense ensuite à peindre, sa famille lui suggère d’avoir un véritable métier. Ce sera archi à Bordeaux, puis à la Villette en 5ème année. Elle rencontre Nicolas lors d’un voyage d’étude. « Nous visitions des églises baroques en Bavière », sourient-ils. En 1990, ils découvrent ensemble le Japon. Les architectes retiennent l’image d’un « monde flambant neuf » et les reflets d’enseignes lumineuses dans le canal Dotombori à Osaka. « Le projet du Forum des Images est un souvenir d’Osaka », disent-ils. Avant même d’adopter l’inconnue et sans avoir jamais construit, Anouk Legendre et Nicolas Desmazières furent lauréats, en 1992, des « Nouveaux albums des jeunes architectes (NAJA) ». À l’époque, le couple travaillait à domicile dans un deux-pièces. Parents de Paul et de Louise nés en 1990 et 1991, ils installaient les bébés dans la salle de bain pour passer des coups de fils. Soudain l’éclaircie. La récompense leur permit de participer à de nombreux concours et de monter leur première agence. « Nous avons gagné deux concours universitaires, l’UFR de géographie à Lille et un bâtiment universitaire à Rennes… et avons enfin trouvé des places en crèche ». L’UFR de Chimie ne doit rien au hasard. À ce propos, leur fils Paul ira aux Beaux-Arts, en sculpture et Louise s’orientera en agronomie. En 2018, Anouk et Nicolas ont livré deux projets : la tour Elithis Danube à Strasbourg et les logements Nuages à Paris. L'agence s'est diversifiée ces dernières années en réalisant des projets de logements environnementaux et des projets culturels et musées, en France et à l'étranger. Et on retiendra surtout que l'agence XTU a réalisé le Jeongok Prehistory Museum en Corée du Sud en 2011, le Pavillon de la France pour l'exposition Universelle de Milan en 2015 et La Cité du vin à Bordeaux en 2016.
Anouk LEGENDRE, née le 28 juin 1961 à Aureilhan est architecte, associée et cofondatrice de XTU architects à Paris. Diplômée de l’École d’architecture de Paris-la Villette en 1986, elle est titulaire d’un certificat d'études approfondies en architecture de paysage et d’un diplôme d’études approfondies en aménagement (Sorbonne). Plusieurs fois lauréate de la compétition des jeunes architectes Europan, elle remporte les Albums des jeunes architectes en 1992, aux côtés de Nicolas Desmazières avec qui elle fonde l’agence XTU en 2000 après avoir travaillé sur l'American Center de Franck Gehry à Paris. Riche d’une vingtaine d’années d'expérience dans la conception de grands projets et infrastructures urbains, elle est aujourd’hui membre du comité scientifique du Think-Tank "Énergie et Territoires" d’EDF, de l’association Architectes Français à l'Export - AFEX et de l’association Cobaty. Elle donne des conférences dans le monde entier (Montréal, Oslo, Wuhan, Yaoundé, Paris, Budapest, Zurich, Londres, Taipei, Tel Aviv, Rome...). Elle est présidente du jury national de la construction bois 2018. XTU (X pour l’inconnue mathématique; TU, suffixe de «situ») est spécialisé dans la recherche académique et environnementale ainsi que dans les bâtiments résidentiels et culturels. Ses travaux ont fait l’objet de plusieurs expositions : galerie d’architecture, Académie d’architecture de Séoul, Centre Pompidou en 2019 (27 maquettes de l’agence sont rentrées dans les collections du Centre Pompidou), Archilab. Les réalisations de XTU ont de nombreuses fois été primées : Jeongok Prehistory Museum en Corée du Sud (prix de l’Académie Coréenne d’Architecture), Pavillon France de l’Exposition universelle Milano 2015 (prix du meilleur pavillon section architecture), Cité du vin à Bordeaux (prix d’honneur du prix national de la Construction bois 2017), TED à Strasbourg en France (tour à énergie positive). Adeptes de la biodiversité dans la ville, les deux fondateurs de l’agence XTU architects travaillent avec ardeur à concevoir la métropole du futur « sobre, dense et résiliente ». De Gyeonggi en Corée du Sud à San Francisco en Californie, ils font rayonner l’innovation architecturale française. Leur chemin se croise en Bavière en Allemagne à l’occasion d’un voyage d’études. Suivront le Japon, « fondateur » de leur travail, des randonnées dans le désert africain pour se ressourcer et l’Islande avec ses paysages « façonnés par les flux », en rupture totale avec la conception traditionnelle de la géométrie. Anouk Legendre, un nom qui commence à bien briller dans le monde de l'architecture. Avec son associé dans le cabinet XTU, Nicolas Desmazières, né au Maroc et fils de diplomate, elle avait signé la Cité du vin à Bordeaux, devenue, sur la rive de la Gironde, l'emblème du Bordelais. Mais pas seulement… Même si elle vit à Paris, elle a toujours gardé un lien très fort avec la Bigorre. « J'ai vécu à Tarbes de ma naissance jusqu'au bac, ensuite j'ai poursuivi mes études à Bordeaux, puis à Paris, à l'École nationale supérieure d'architecture de La Villette, où j'ai d'ailleurs rencontré Nicolas, mon associé. Un de nos premiers gros projets a été le musée de la Préhistoire de Jeongok, en Corée du Sud, dans lequel il a fallu s'intégrer au paysage, mais surtout intégrer la culture asiatique du feng shui. Je pense que ça a été fondateur. Dans la foulée, nous avons réalisé le musée des Civilisations de la Réunion, où nous avons pu mettre en application nos idées. Nous portons l'idée qu'un bâtiment doit être en cohérence avec son milieu, son contexte. Ne pas le dénaturer, ni visuellement, ni techniquement… Déjà, nous utilisons des matériaux naturels, comme le bois par exemple pour le pavillon de la France à l'Exposition universelle de Milan, que nous avions dessiné. Mais on va plus loin. On parle beaucoup de bâtiments à énergie positive, mais généralement, les solutions classiques ne font que stocker l'énergie dans le bâtiment. Nous, on cherche, par des solutions végétales, à créer des climatisations, ou des chauffages naturels. On raisonne en flux d'énergie, pas en quantité. Le concept de départ, c'est de verdir la ville, utiliser les toits pour des plantations par exemple, ou installer des murs végétalisés, qui créent une fraîcheur naturelle. Et puis, on a ce concept de bio-façades, des sortes de champs verticaux. Entre deux parois de verre, on cultive des micro-algues, qui ont la vertu d'être isolantes, de produire du frais quand il fait chaud et inversement, mais elles sont aussi capables de produire des aliments, des cosmétiques, des médicaments. Cette façade de nouvelle génération permettrait de cultiver, au sein de capteurs solaires biologiques (photobioréacteurs), des micro-algues à haute valeur ajoutée pour la recherche médicale. Mais au-delà de tout, l'idée, c'est d'améliorer le vécu dans la ville. Nous avons remporté un projet, à Paris, d'une résidence entièrement équipée de bio-façades, qui sera le premier bâtiment résidentiel au monde construit avec ce procédé. Qui est 100 % français, et ça, on en est assez fiers. Parce que c'est sans doute la technologie architecturale du futur. Sans doute mes origines tarbaises, l'air des Pyrénées ! J'ai toujours été proche de la nature, de la campagne. J'aime l'idée d'amener la campagne dans les villes, faire, en quelque sorte, du béton ver. » Anouk et Nicolas, les deux architectes fondateurs de l'agence XTU en 2000, ont développé une approche résolument novatrice de la ville et de l’habitat inspirée du vivant. Actifs depuis 20 ans, ils explorent les rapports du bâti avec le vivant et le végétal. Musées, logements, bureaux, équipements publics, quartiers… en France et à l’étranger, leurs projets traduisent leur implication dans la recherche expérimentale, animée par cette conviction : l’architecture doit anticiper le futur et la troisième révolution industrielle sera biologique. Ils comptent de nombreuses réalisations innovantes, souvent primées, tant sur le plan architectural qu’environnemental. Ils s'investissent fortement dans l'agriculture urbaine et la recherche expérimentale, à la croisée des sciences du vivant, de l'écologie, de l'architecture et de l'urbanisme. Titulaires de trois brevets technologiques en 2011, ils ont notamment inventé et développé avec le CNRS, le système de « bio-façades » (façades actives intégrant des cultures de micro-algues). La bio-façade solaire à micro-algues agit comme une serre en accumulant l’énergie solaire et crée un tampon thermique qui améliore l’isolation du bâtiment. La façade est composée de trois vitrages. Dans l’un des interstices, court un filet d’eau qui nourrit des algues solaires. Ce plancton, qui présente les mêmes besoins thermiques que l’homme, transforme, selon le principe de la photosynthèse, le CO2 en oxygène et biomasse. Une architecture dépolluante et verte qui permet ainsi une économie de 50% sur les besoins thermiques d’un bâtiment. Plusieurs projets de bio-façades sont en cours à travers le monde. De Gyeonggi en Corée du Sud à San Francisco en Californie, ils font rayonner l’innovation architecturale française. Pour Anouk, le premier voyage est celui qui l’a menée de Tarbes à l’École d’architecture de Bordeaux. « Au départ, je voulais devenir ingénieur agronome ». La jeune femme pense ensuite à peindre, sa famille lui suggère d’avoir un véritable métier. Ce sera archi à Bordeaux, puis à la Villette en 5ème année. Elle rencontre Nicolas lors d’un voyage d’étude. « Nous visitions des églises baroques en Bavière », sourient-ils. En 1990, ils découvrent ensemble le Japon. Les architectes retiennent l’image d’un « monde flambant neuf » et les reflets d’enseignes lumineuses dans le canal Dotombori à Osaka. « Le projet du Forum des Images est un souvenir d’Osaka », disent-ils. Avant même d’adopter l’inconnue et sans avoir jamais construit, Anouk Legendre et Nicolas Desmazières furent lauréats, en 1992, des « Nouveaux albums des jeunes architectes (NAJA) ». À l’époque, le couple travaillait à domicile dans un deux-pièces. Parents de Paul et de Louise nés en 1990 et 1991, ils installaient les bébés dans la salle de bain pour passer des coups de fils. Soudain l’éclaircie. La récompense leur permit de participer à de nombreux concours et de monter leur première agence. « Nous avons gagné deux concours universitaires, l’UFR de géographie à Lille et un bâtiment universitaire à Rennes… et avons enfin trouvé des places en crèche ». L’UFR de Chimie ne doit rien au hasard. À ce propos, leur fils Paul ira aux Beaux-Arts, en sculpture et Louise s’orientera en agronomie. En 2018, Anouk et Nicolas ont livré deux projets : la tour Elithis Danube à Strasbourg et les logements Nuages à Paris. L'agence s'est diversifiée ces dernières années en réalisant des projets de logements environnementaux et des projets culturels et musées, en France et à l'étranger. Et on retiendra surtout que l'agence XTU a réalisé le Jeongok Prehistory Museum en Corée du Sud en 2011, le Pavillon de la France pour l'exposition Universelle de Milan en 2015 et La Cité du vin à Bordeaux en 2016.
 Anouk LEGENDRE, née le 28 juin 1961 à Aureilhan est architecte, associée et cofondatrice de XTU architects à Paris. Diplômée de l’École d’architecture de Paris-la Villette en 1986, elle est titulaire d’un certificat d'études approfondies en architecture de paysage et d’un diplôme d’études approfondies en aménagement (Sorbonne). Plusieurs fois lauréate de la compétition des jeunes architectes Europan, elle remporte les Albums des jeunes architectes en 1992, aux côtés de Nicolas Desmazières avec qui elle fonde l’agence XTU en 2000 après avoir travaillé sur l'American Center de Franck Gehry à Paris. Riche d’une vingtaine d’années d'expérience dans la conception de grands projets et infrastructures urbains, elle est aujourd’hui membre du comité scientifique du Think-Tank "Énergie et Territoires" d’EDF, de l’association Architectes Français à l'Export - AFEX et de l’association Cobaty. Elle donne des conférences dans le monde entier (Montréal, Oslo, Wuhan, Yaoundé, Paris, Budapest, Zurich, Londres, Taipei, Tel Aviv, Rome...). Elle est présidente du jury national de la construction bois 2018. XTU (X pour l’inconnue mathématique; TU, suffixe de «situ») est spécialisé dans la recherche académique et environnementale ainsi que dans les bâtiments résidentiels et culturels. Ses travaux ont fait l’objet de plusieurs expositions : galerie d’architecture, Académie d’architecture de Séoul, Centre Pompidou en 2019 (27 maquettes de l’agence sont rentrées dans les collections du Centre Pompidou), Archilab. Les réalisations de XTU ont de nombreuses fois été primées : Jeongok Prehistory Museum en Corée du Sud (prix de l’Académie Coréenne d’Architecture), Pavillon France de l’Exposition universelle Milano 2015 (prix du meilleur pavillon section architecture), Cité du vin à Bordeaux (prix d’honneur du prix national de la Construction bois 2017), TED à Strasbourg en France (tour à énergie positive). Adeptes de la biodiversité dans la ville, les deux fondateurs de l’agence XTU architects travaillent avec ardeur à concevoir la métropole du futur « sobre, dense et résiliente ». De Gyeonggi en Corée du Sud à San Francisco en Californie, ils font rayonner l’innovation architecturale française. Leur chemin se croise en Bavière en Allemagne à l’occasion d’un voyage d’études. Suivront le Japon, « fondateur » de leur travail, des randonnées dans le désert africain pour se ressourcer et l’Islande avec ses paysages « façonnés par les flux », en rupture totale avec la conception traditionnelle de la géométrie. Anouk Legendre, un nom qui commence à bien briller dans le monde de l'architecture. Avec son associé dans le cabinet XTU, Nicolas Desmazières, né au Maroc et fils de diplomate, elle avait signé la Cité du vin à Bordeaux, devenue, sur la rive de la Gironde, l'emblème du Bordelais. Mais pas seulement… Même si elle vit à Paris, elle a toujours gardé un lien très fort avec la Bigorre. « J'ai vécu à Tarbes de ma naissance jusqu'au bac, ensuite j'ai poursuivi mes études à Bordeaux, puis à Paris, à l'École nationale supérieure d'architecture de La Villette, où j'ai d'ailleurs rencontré Nicolas, mon associé. Un de nos premiers gros projets a été le musée de la Préhistoire de Jeongok, en Corée du Sud, dans lequel il a fallu s'intégrer au paysage, mais surtout intégrer la culture asiatique du feng shui. Je pense que ça a été fondateur. Dans la foulée, nous avons réalisé le musée des Civilisations de la Réunion, où nous avons pu mettre en application nos idées. Nous portons l'idée qu'un bâtiment doit être en cohérence avec son milieu, son contexte. Ne pas le dénaturer, ni visuellement, ni techniquement… Déjà, nous utilisons des matériaux naturels, comme le bois par exemple pour le pavillon de la France à l'Exposition universelle de Milan, que nous avions dessiné. Mais on va plus loin. On parle beaucoup de bâtiments à énergie positive, mais généralement, les solutions classiques ne font que stocker l'énergie dans le bâtiment. Nous, on cherche, par des solutions végétales, à créer des climatisations, ou des chauffages naturels. On raisonne en flux d'énergie, pas en quantité. Le concept de départ, c'est de verdir la ville, utiliser les toits pour des plantations par exemple, ou installer des murs végétalisés, qui créent une fraîcheur naturelle. Et puis, on a ce concept de bio-façades, des sortes de champs verticaux. Entre deux parois de verre, on cultive des micro-algues, qui ont la vertu d'être isolantes, de produire du frais quand il fait chaud et inversement, mais elles sont aussi capables de produire des aliments, des cosmétiques, des médicaments. Cette façade de nouvelle génération permettrait de cultiver, au sein de capteurs solaires biologiques (photobioréacteurs), des micro-algues à haute valeur ajoutée pour la recherche médicale. Mais au-delà de tout, l'idée, c'est d'améliorer le vécu dans la ville. Nous avons remporté un projet, à Paris, d'une résidence entièrement équipée de bio-façades, qui sera le premier bâtiment résidentiel au monde construit avec ce procédé. Qui est 100 % français, et ça, on en est assez fiers. Parce que c'est sans doute la technologie architecturale du futur. Sans doute mes origines tarbaises, l'air des Pyrénées ! J'ai toujours été proche de la nature, de la campagne. J'aime l'idée d'amener la campagne dans les villes, faire, en quelque sorte, du béton ver. » Anouk et Nicolas, les deux architectes fondateurs de l'agence XTU en 2000, ont développé une approche résolument novatrice de la ville et de l’habitat inspirée du vivant. Actifs depuis 20 ans, ils explorent les rapports du bâti avec le vivant et le végétal. Musées, logements, bureaux, équipements publics, quartiers… en France et à l’étranger, leurs projets traduisent leur implication dans la recherche expérimentale, animée par cette conviction : l’architecture doit anticiper le futur et la troisième révolution industrielle sera biologique. Ils comptent de nombreuses réalisations innovantes, souvent primées, tant sur le plan architectural qu’environnemental. Ils s'investissent fortement dans l'agriculture urbaine et la recherche expérimentale, à la croisée des sciences du vivant, de l'écologie, de l'architecture et de l'urbanisme. Titulaires de trois brevets technologiques en 2011, ils ont notamment inventé et développé avec le CNRS, le système de « bio-façades » (façades actives intégrant des cultures de micro-algues). La bio-façade solaire à micro-algues agit comme une serre en accumulant l’énergie solaire et crée un tampon thermique qui améliore l’isolation du bâtiment. La façade est composée de trois vitrages. Dans l’un des interstices, court un filet d’eau qui nourrit des algues solaires. Ce plancton, qui présente les mêmes besoins thermiques que l’homme, transforme, selon le principe de la photosynthèse, le CO2 en oxygène et biomasse. Une architecture dépolluante et verte qui permet ainsi une économie de 50% sur les besoins thermiques d’un bâtiment. Plusieurs projets de bio-façades sont en cours à travers le monde. De Gyeonggi en Corée du Sud à San Francisco en Californie, ils font rayonner l’innovation architecturale française. Pour Anouk, le premier voyage est celui qui l’a menée de Tarbes à l’École d’architecture de Bordeaux. « Au départ, je voulais devenir ingénieur agronome ». La jeune femme pense ensuite à peindre, sa famille lui suggère d’avoir un véritable métier. Ce sera archi à Bordeaux, puis à la Villette en 5ème année. Elle rencontre Nicolas lors d’un voyage d’étude. « Nous visitions des églises baroques en Bavière », sourient-ils. En 1990, ils découvrent ensemble le Japon. Les architectes retiennent l’image d’un « monde flambant neuf » et les reflets d’enseignes lumineuses dans le canal Dotombori à Osaka. « Le projet du Forum des Images est un souvenir d’Osaka », disent-ils. Avant même d’adopter l’inconnue et sans avoir jamais construit, Anouk Legendre et Nicolas Desmazières furent lauréats, en 1992, des « Nouveaux albums des jeunes architectes (NAJA) ». À l’époque, le couple travaillait à domicile dans un deux-pièces. Parents de Paul et de Louise nés en 1990 et 1991, ils installaient les bébés dans la salle de bain pour passer des coups de fils. Soudain l’éclaircie. La récompense leur permit de participer à de nombreux concours et de monter leur première agence. « Nous avons gagné deux concours universitaires, l’UFR de géographie à Lille et un bâtiment universitaire à Rennes… et avons enfin trouvé des places en crèche ». L’UFR de Chimie ne doit rien au hasard. À ce propos, leur fils Paul ira aux Beaux-Arts, en sculpture et Louise s’orientera en agronomie. En 2018, Anouk et Nicolas ont livré deux projets : la tour Elithis Danube à Strasbourg et les logements Nuages à Paris. L'agence s'est diversifiée ces dernières années en réalisant des projets de logements environnementaux et des projets culturels et musées, en France et à l'étranger. Et on retiendra surtout que l'agence XTU a réalisé le Jeongok Prehistory Museum en Corée du Sud en 2011, le Pavillon de la France pour l'exposition Universelle de Milan en 2015 et La Cité du vin à Bordeaux en 2016.
Anouk LEGENDRE, née le 28 juin 1961 à Aureilhan est architecte, associée et cofondatrice de XTU architects à Paris. Diplômée de l’École d’architecture de Paris-la Villette en 1986, elle est titulaire d’un certificat d'études approfondies en architecture de paysage et d’un diplôme d’études approfondies en aménagement (Sorbonne). Plusieurs fois lauréate de la compétition des jeunes architectes Europan, elle remporte les Albums des jeunes architectes en 1992, aux côtés de Nicolas Desmazières avec qui elle fonde l’agence XTU en 2000 après avoir travaillé sur l'American Center de Franck Gehry à Paris. Riche d’une vingtaine d’années d'expérience dans la conception de grands projets et infrastructures urbains, elle est aujourd’hui membre du comité scientifique du Think-Tank "Énergie et Territoires" d’EDF, de l’association Architectes Français à l'Export - AFEX et de l’association Cobaty. Elle donne des conférences dans le monde entier (Montréal, Oslo, Wuhan, Yaoundé, Paris, Budapest, Zurich, Londres, Taipei, Tel Aviv, Rome...). Elle est présidente du jury national de la construction bois 2018. XTU (X pour l’inconnue mathématique; TU, suffixe de «situ») est spécialisé dans la recherche académique et environnementale ainsi que dans les bâtiments résidentiels et culturels. Ses travaux ont fait l’objet de plusieurs expositions : galerie d’architecture, Académie d’architecture de Séoul, Centre Pompidou en 2019 (27 maquettes de l’agence sont rentrées dans les collections du Centre Pompidou), Archilab. Les réalisations de XTU ont de nombreuses fois été primées : Jeongok Prehistory Museum en Corée du Sud (prix de l’Académie Coréenne d’Architecture), Pavillon France de l’Exposition universelle Milano 2015 (prix du meilleur pavillon section architecture), Cité du vin à Bordeaux (prix d’honneur du prix national de la Construction bois 2017), TED à Strasbourg en France (tour à énergie positive). Adeptes de la biodiversité dans la ville, les deux fondateurs de l’agence XTU architects travaillent avec ardeur à concevoir la métropole du futur « sobre, dense et résiliente ». De Gyeonggi en Corée du Sud à San Francisco en Californie, ils font rayonner l’innovation architecturale française. Leur chemin se croise en Bavière en Allemagne à l’occasion d’un voyage d’études. Suivront le Japon, « fondateur » de leur travail, des randonnées dans le désert africain pour se ressourcer et l’Islande avec ses paysages « façonnés par les flux », en rupture totale avec la conception traditionnelle de la géométrie. Anouk Legendre, un nom qui commence à bien briller dans le monde de l'architecture. Avec son associé dans le cabinet XTU, Nicolas Desmazières, né au Maroc et fils de diplomate, elle avait signé la Cité du vin à Bordeaux, devenue, sur la rive de la Gironde, l'emblème du Bordelais. Mais pas seulement… Même si elle vit à Paris, elle a toujours gardé un lien très fort avec la Bigorre. « J'ai vécu à Tarbes de ma naissance jusqu'au bac, ensuite j'ai poursuivi mes études à Bordeaux, puis à Paris, à l'École nationale supérieure d'architecture de La Villette, où j'ai d'ailleurs rencontré Nicolas, mon associé. Un de nos premiers gros projets a été le musée de la Préhistoire de Jeongok, en Corée du Sud, dans lequel il a fallu s'intégrer au paysage, mais surtout intégrer la culture asiatique du feng shui. Je pense que ça a été fondateur. Dans la foulée, nous avons réalisé le musée des Civilisations de la Réunion, où nous avons pu mettre en application nos idées. Nous portons l'idée qu'un bâtiment doit être en cohérence avec son milieu, son contexte. Ne pas le dénaturer, ni visuellement, ni techniquement… Déjà, nous utilisons des matériaux naturels, comme le bois par exemple pour le pavillon de la France à l'Exposition universelle de Milan, que nous avions dessiné. Mais on va plus loin. On parle beaucoup de bâtiments à énergie positive, mais généralement, les solutions classiques ne font que stocker l'énergie dans le bâtiment. Nous, on cherche, par des solutions végétales, à créer des climatisations, ou des chauffages naturels. On raisonne en flux d'énergie, pas en quantité. Le concept de départ, c'est de verdir la ville, utiliser les toits pour des plantations par exemple, ou installer des murs végétalisés, qui créent une fraîcheur naturelle. Et puis, on a ce concept de bio-façades, des sortes de champs verticaux. Entre deux parois de verre, on cultive des micro-algues, qui ont la vertu d'être isolantes, de produire du frais quand il fait chaud et inversement, mais elles sont aussi capables de produire des aliments, des cosmétiques, des médicaments. Cette façade de nouvelle génération permettrait de cultiver, au sein de capteurs solaires biologiques (photobioréacteurs), des micro-algues à haute valeur ajoutée pour la recherche médicale. Mais au-delà de tout, l'idée, c'est d'améliorer le vécu dans la ville. Nous avons remporté un projet, à Paris, d'une résidence entièrement équipée de bio-façades, qui sera le premier bâtiment résidentiel au monde construit avec ce procédé. Qui est 100 % français, et ça, on en est assez fiers. Parce que c'est sans doute la technologie architecturale du futur. Sans doute mes origines tarbaises, l'air des Pyrénées ! J'ai toujours été proche de la nature, de la campagne. J'aime l'idée d'amener la campagne dans les villes, faire, en quelque sorte, du béton ver. » Anouk et Nicolas, les deux architectes fondateurs de l'agence XTU en 2000, ont développé une approche résolument novatrice de la ville et de l’habitat inspirée du vivant. Actifs depuis 20 ans, ils explorent les rapports du bâti avec le vivant et le végétal. Musées, logements, bureaux, équipements publics, quartiers… en France et à l’étranger, leurs projets traduisent leur implication dans la recherche expérimentale, animée par cette conviction : l’architecture doit anticiper le futur et la troisième révolution industrielle sera biologique. Ils comptent de nombreuses réalisations innovantes, souvent primées, tant sur le plan architectural qu’environnemental. Ils s'investissent fortement dans l'agriculture urbaine et la recherche expérimentale, à la croisée des sciences du vivant, de l'écologie, de l'architecture et de l'urbanisme. Titulaires de trois brevets technologiques en 2011, ils ont notamment inventé et développé avec le CNRS, le système de « bio-façades » (façades actives intégrant des cultures de micro-algues). La bio-façade solaire à micro-algues agit comme une serre en accumulant l’énergie solaire et crée un tampon thermique qui améliore l’isolation du bâtiment. La façade est composée de trois vitrages. Dans l’un des interstices, court un filet d’eau qui nourrit des algues solaires. Ce plancton, qui présente les mêmes besoins thermiques que l’homme, transforme, selon le principe de la photosynthèse, le CO2 en oxygène et biomasse. Une architecture dépolluante et verte qui permet ainsi une économie de 50% sur les besoins thermiques d’un bâtiment. Plusieurs projets de bio-façades sont en cours à travers le monde. De Gyeonggi en Corée du Sud à San Francisco en Californie, ils font rayonner l’innovation architecturale française. Pour Anouk, le premier voyage est celui qui l’a menée de Tarbes à l’École d’architecture de Bordeaux. « Au départ, je voulais devenir ingénieur agronome ». La jeune femme pense ensuite à peindre, sa famille lui suggère d’avoir un véritable métier. Ce sera archi à Bordeaux, puis à la Villette en 5ème année. Elle rencontre Nicolas lors d’un voyage d’étude. « Nous visitions des églises baroques en Bavière », sourient-ils. En 1990, ils découvrent ensemble le Japon. Les architectes retiennent l’image d’un « monde flambant neuf » et les reflets d’enseignes lumineuses dans le canal Dotombori à Osaka. « Le projet du Forum des Images est un souvenir d’Osaka », disent-ils. Avant même d’adopter l’inconnue et sans avoir jamais construit, Anouk Legendre et Nicolas Desmazières furent lauréats, en 1992, des « Nouveaux albums des jeunes architectes (NAJA) ». À l’époque, le couple travaillait à domicile dans un deux-pièces. Parents de Paul et de Louise nés en 1990 et 1991, ils installaient les bébés dans la salle de bain pour passer des coups de fils. Soudain l’éclaircie. La récompense leur permit de participer à de nombreux concours et de monter leur première agence. « Nous avons gagné deux concours universitaires, l’UFR de géographie à Lille et un bâtiment universitaire à Rennes… et avons enfin trouvé des places en crèche ». L’UFR de Chimie ne doit rien au hasard. À ce propos, leur fils Paul ira aux Beaux-Arts, en sculpture et Louise s’orientera en agronomie. En 2018, Anouk et Nicolas ont livré deux projets : la tour Elithis Danube à Strasbourg et les logements Nuages à Paris. L'agence s'est diversifiée ces dernières années en réalisant des projets de logements environnementaux et des projets culturels et musées, en France et à l'étranger. Et on retiendra surtout que l'agence XTU a réalisé le Jeongok Prehistory Museum en Corée du Sud en 2011, le Pavillon de la France pour l'exposition Universelle de Milan en 2015 et La Cité du vin à Bordeaux en 2016.LOPEZ Nicolas (1980-XXXX)
Escrimeur pratiquant le sabre médaillé olympique
 Nicolas LOPEZ, né le 14 novembre 1980 à Tarbes est un escrimeur pratiquant le sabre. Titulaire d’un BEP en électrotechnique, licencié à l’Amicale Tarbaise d’Escrime, son club formateur, il a décroché la médaille d'or au sabre par équipes aux JO de Pékin en 2008, en battant en finale l'équipe des États-Unis (45-37) et remporté la médaille d'argent en sabre individuel. En individuel, après avoir éliminé le Russe Stanislav Pozdniakov (15-7) puis le Roumain Mihai Covaliu (15-13) il sera battu 15 touches à 9 par Zhong Man, galvanisé par la foule pékinoise. Son palmarès : 1999, champion du monde junior par équipes ; 2001, médaille d'argent par équipes lors des Championnats d'Europe ; 2005, médaille de bronze par équipes lors des Championnats du monde d'escrime, médaille de bronze en individuel lors des Championnats d'Europe et médaille d'or aux Championnats de France; 2006, champion du monde par équipes à Turin et médaille d'or aux Championnats de France ; 2007, médaille d’argent par équipes aux Championnats du monde de Saint-Pétersbourg et médaille de bronze par équipes lors des championnats d'Europe ; 2008, médaille d'or du tournoi par équipes avec Julien Pillet, Boris Sanson et Vincent Anstett, en battant l'équipe des États-Unis en finale et médaille d’argent en individuel aux Jeux olympiques de Pékin et médaille d'or aux Championnats de France ; 2009, médaille de bronze par équipes lors des championnats d'Europe ; 2012, médaille d'or aux Championnats de France. Après une décennie au sommet de sa discipline, à 32 ans, en 2012, après les Jeux olympiques de Londres, où il n’est pas présent, ce grand champion de sabre quitte Paris et le monde de la compétition (l'INSEP) pour revenir s’installer dans les Pyrénées, qui l’ont vu grandir. Il passe un diplôme d'accompagnateur de moyenne montagne, baroude au gré de ses envies et en parallèle prend la défense de l’environnement et fréquente certains milieux zadistes. L'escrimeur-altermondialiste est revenu poser ses bagages au pied des montagnes pour vivre avec sa compagne et ses deux petites filles dans une maison familiale à Villelongue, dans les Hautes-Pyrénées. Sa vie est désormais rythmée par son travail d'éducateur sportif à la mairie de Tarbes. L'ex-sabreur intervient dans les écoles pour organiser des sorties en ski de fond ou des randonnées. Il s'investit également comme maître d'armes à l'Amicale Tarbaise d’Escrime (ATE), le club de son enfance, en entraînant les bretteurs, amateurs ou confirmés. Il y transmet son expérience et contribue avec d'autres éducateurs à faire de ce club une référence mondiale de la discipline. Il a été fait chevalier de la Légion d'honneur.
Nicolas LOPEZ, né le 14 novembre 1980 à Tarbes est un escrimeur pratiquant le sabre. Titulaire d’un BEP en électrotechnique, licencié à l’Amicale Tarbaise d’Escrime, son club formateur, il a décroché la médaille d'or au sabre par équipes aux JO de Pékin en 2008, en battant en finale l'équipe des États-Unis (45-37) et remporté la médaille d'argent en sabre individuel. En individuel, après avoir éliminé le Russe Stanislav Pozdniakov (15-7) puis le Roumain Mihai Covaliu (15-13) il sera battu 15 touches à 9 par Zhong Man, galvanisé par la foule pékinoise. Son palmarès : 1999, champion du monde junior par équipes ; 2001, médaille d'argent par équipes lors des Championnats d'Europe ; 2005, médaille de bronze par équipes lors des Championnats du monde d'escrime, médaille de bronze en individuel lors des Championnats d'Europe et médaille d'or aux Championnats de France; 2006, champion du monde par équipes à Turin et médaille d'or aux Championnats de France ; 2007, médaille d’argent par équipes aux Championnats du monde de Saint-Pétersbourg et médaille de bronze par équipes lors des championnats d'Europe ; 2008, médaille d'or du tournoi par équipes avec Julien Pillet, Boris Sanson et Vincent Anstett, en battant l'équipe des États-Unis en finale et médaille d’argent en individuel aux Jeux olympiques de Pékin et médaille d'or aux Championnats de France ; 2009, médaille de bronze par équipes lors des championnats d'Europe ; 2012, médaille d'or aux Championnats de France. Après une décennie au sommet de sa discipline, à 32 ans, en 2012, après les Jeux olympiques de Londres, où il n’est pas présent, ce grand champion de sabre quitte Paris et le monde de la compétition (l'INSEP) pour revenir s’installer dans les Pyrénées, qui l’ont vu grandir. Il passe un diplôme d'accompagnateur de moyenne montagne, baroude au gré de ses envies et en parallèle prend la défense de l’environnement et fréquente certains milieux zadistes. L'escrimeur-altermondialiste est revenu poser ses bagages au pied des montagnes pour vivre avec sa compagne et ses deux petites filles dans une maison familiale à Villelongue, dans les Hautes-Pyrénées. Sa vie est désormais rythmée par son travail d'éducateur sportif à la mairie de Tarbes. L'ex-sabreur intervient dans les écoles pour organiser des sorties en ski de fond ou des randonnées. Il s'investit également comme maître d'armes à l'Amicale Tarbaise d’Escrime (ATE), le club de son enfance, en entraînant les bretteurs, amateurs ou confirmés. Il y transmet son expérience et contribue avec d'autres éducateurs à faire de ce club une référence mondiale de la discipline. Il a été fait chevalier de la Légion d'honneur.
 Nicolas LOPEZ, né le 14 novembre 1980 à Tarbes est un escrimeur pratiquant le sabre. Titulaire d’un BEP en électrotechnique, licencié à l’Amicale Tarbaise d’Escrime, son club formateur, il a décroché la médaille d'or au sabre par équipes aux JO de Pékin en 2008, en battant en finale l'équipe des États-Unis (45-37) et remporté la médaille d'argent en sabre individuel. En individuel, après avoir éliminé le Russe Stanislav Pozdniakov (15-7) puis le Roumain Mihai Covaliu (15-13) il sera battu 15 touches à 9 par Zhong Man, galvanisé par la foule pékinoise. Son palmarès : 1999, champion du monde junior par équipes ; 2001, médaille d'argent par équipes lors des Championnats d'Europe ; 2005, médaille de bronze par équipes lors des Championnats du monde d'escrime, médaille de bronze en individuel lors des Championnats d'Europe et médaille d'or aux Championnats de France; 2006, champion du monde par équipes à Turin et médaille d'or aux Championnats de France ; 2007, médaille d’argent par équipes aux Championnats du monde de Saint-Pétersbourg et médaille de bronze par équipes lors des championnats d'Europe ; 2008, médaille d'or du tournoi par équipes avec Julien Pillet, Boris Sanson et Vincent Anstett, en battant l'équipe des États-Unis en finale et médaille d’argent en individuel aux Jeux olympiques de Pékin et médaille d'or aux Championnats de France ; 2009, médaille de bronze par équipes lors des championnats d'Europe ; 2012, médaille d'or aux Championnats de France. Après une décennie au sommet de sa discipline, à 32 ans, en 2012, après les Jeux olympiques de Londres, où il n’est pas présent, ce grand champion de sabre quitte Paris et le monde de la compétition (l'INSEP) pour revenir s’installer dans les Pyrénées, qui l’ont vu grandir. Il passe un diplôme d'accompagnateur de moyenne montagne, baroude au gré de ses envies et en parallèle prend la défense de l’environnement et fréquente certains milieux zadistes. L'escrimeur-altermondialiste est revenu poser ses bagages au pied des montagnes pour vivre avec sa compagne et ses deux petites filles dans une maison familiale à Villelongue, dans les Hautes-Pyrénées. Sa vie est désormais rythmée par son travail d'éducateur sportif à la mairie de Tarbes. L'ex-sabreur intervient dans les écoles pour organiser des sorties en ski de fond ou des randonnées. Il s'investit également comme maître d'armes à l'Amicale Tarbaise d’Escrime (ATE), le club de son enfance, en entraînant les bretteurs, amateurs ou confirmés. Il y transmet son expérience et contribue avec d'autres éducateurs à faire de ce club une référence mondiale de la discipline. Il a été fait chevalier de la Légion d'honneur.
Nicolas LOPEZ, né le 14 novembre 1980 à Tarbes est un escrimeur pratiquant le sabre. Titulaire d’un BEP en électrotechnique, licencié à l’Amicale Tarbaise d’Escrime, son club formateur, il a décroché la médaille d'or au sabre par équipes aux JO de Pékin en 2008, en battant en finale l'équipe des États-Unis (45-37) et remporté la médaille d'argent en sabre individuel. En individuel, après avoir éliminé le Russe Stanislav Pozdniakov (15-7) puis le Roumain Mihai Covaliu (15-13) il sera battu 15 touches à 9 par Zhong Man, galvanisé par la foule pékinoise. Son palmarès : 1999, champion du monde junior par équipes ; 2001, médaille d'argent par équipes lors des Championnats d'Europe ; 2005, médaille de bronze par équipes lors des Championnats du monde d'escrime, médaille de bronze en individuel lors des Championnats d'Europe et médaille d'or aux Championnats de France; 2006, champion du monde par équipes à Turin et médaille d'or aux Championnats de France ; 2007, médaille d’argent par équipes aux Championnats du monde de Saint-Pétersbourg et médaille de bronze par équipes lors des championnats d'Europe ; 2008, médaille d'or du tournoi par équipes avec Julien Pillet, Boris Sanson et Vincent Anstett, en battant l'équipe des États-Unis en finale et médaille d’argent en individuel aux Jeux olympiques de Pékin et médaille d'or aux Championnats de France ; 2009, médaille de bronze par équipes lors des championnats d'Europe ; 2012, médaille d'or aux Championnats de France. Après une décennie au sommet de sa discipline, à 32 ans, en 2012, après les Jeux olympiques de Londres, où il n’est pas présent, ce grand champion de sabre quitte Paris et le monde de la compétition (l'INSEP) pour revenir s’installer dans les Pyrénées, qui l’ont vu grandir. Il passe un diplôme d'accompagnateur de moyenne montagne, baroude au gré de ses envies et en parallèle prend la défense de l’environnement et fréquente certains milieux zadistes. L'escrimeur-altermondialiste est revenu poser ses bagages au pied des montagnes pour vivre avec sa compagne et ses deux petites filles dans une maison familiale à Villelongue, dans les Hautes-Pyrénées. Sa vie est désormais rythmée par son travail d'éducateur sportif à la mairie de Tarbes. L'ex-sabreur intervient dans les écoles pour organiser des sorties en ski de fond ou des randonnées. Il s'investit également comme maître d'armes à l'Amicale Tarbaise d’Escrime (ATE), le club de son enfance, en entraînant les bretteurs, amateurs ou confirmés. Il y transmet son expérience et contribue avec d'autres éducateurs à faire de ce club une référence mondiale de la discipline. Il a été fait chevalier de la Légion d'honneur.MACRON Emmanuel (1977-XXXX)
Président de la République française, petit-fils de Bigourdans
 Emmanuel MACRON, né le 21 décembre 1977 à Amiens, est un homme d’État français. Il est président de la République française depuis le 7 mai 2017. Fils de Françoise Noguès, médecin et de Jean-Michel Macron, professeur de neurologie, il a de profondes attaches dans la vallée de l’Adour. Sa grand-mère maternelle, Germaine Noguès née Arribet, surnommée Manette, était originaire de Montgaillard. Née à Tarbes en 1916, elle était devenue directrice de collège dans la Somme. Avant la Seconde Guerre mondiale, elle épousa Jean Noguès, un enseignant dont les parents étaient commerçants à Bagnères-de-Bigorre. Le couple partira s’installer dans la Nièvre puis à Amiens. De leur union naîtront trois enfants dont Françoise, la mère d’Emmanuel. Mais à toutes les vacances scolaires, Manette et Jean, reviennent à Bagnères-de-Bigorre, dans la maison familiale, avec le petit «Manu», le chouchou de Germaine. Dans leur belle demeure, Manette façonne l’éducation de son petit-fils. Il faut dire qu’il y passait le plus clair de son temps à lire, étudier, et s’enrichir des savoirs de cette mamie enseignante. C’est elle qui lui donne le goût des livres et lui transmet sa passion pour la littérature et les grands auteurs. Sylvie Andréjacq, sa cousine, commerçante à Bagnères, se rappelle « un petit garçon qui bûchait énormément, capable de laisser tomber ses copains pour aller faire ses devoirs. Il voulait que sa grand-mère bien-aimée soit fière de lui ». Le grand-père de Sylvie, Roger Noguès, et celui d’Emmanuel, Jean Noguès, étaient frères, de vrais Bagnérais. Il adorait skier à la Mongie ou pêcher avec son grand-père. Avec sa grand-mère il allait en promenade au Vallon de Salut. Avec Brigitte, qu’il épousa en 2007, il a continué à venir skier chaque année dans cette station familière de La Mongie, À tel point que le domaine du Grand Tourmalet a fait regarnir en bleu, blanc et rouge, la banquette et les protections du véhicule du télésiège ‘Le Béarnais’, utilisé par le couple présidentiel. En haut du Tourmalet, il retrouve depuis jeune adolescent son ami Éric Abadie, éleveur et gérant de « L’Étape du berger ». Le béret vissé sur la tête, le restaurateur raconte : « Quand tu as une discussion avec lui, tu en ressors toujours plus intelligent.» Le 12 avril 2017, pendant la campagne présidentielle, il avait même poussé la chansonnette avec des amis pyrénéens. En mars 2019, de retour d’un déplacement au Kenya, le Président était venu se ressourcer quelques jours à La Mongie, heureux d’y retrouver des paysages et des visages amis. D’ascendance bigourdane du côté maternel, cet enfant du pays, est quelqu’un qui éprouve un attachement sincère à ce département et qui aime revenir sur les terres de ses grands-parents, et auprès de ses cousins et amis et venir se recueillir sur la tombe de Manette, sa grand-mère adorée, décédée en 2013. En visite d’État en France les 6 et 7 mai 2024 pour célébrer les 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays, le président chinois Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan se sont rendus le 7 mai au col du Tourmalet, ‘haut lieu de la culture sportive française’, accueillis par Emmanuel et Brigitte Macron à « l’Étape du berger », le restaurant d’altitude tenu par son ami Éric Abadie. L’occasion lors de cette visite historique et de ce déjeuner d’État au sommet, de partager ses racines pyrénéennes avec son homologue chinois autour de la gastronomie locale et du folklore bigourdan avec au menu les meilleurs produits des terroirs de Bigorre (garbure, agneau, porc noir, haricots tarbais, fromage à la truffe et tarte aux myrtilles) et des vins d’exception produits au pied des Pyrénées. Cela restera un grand moment d’histoire pour ce territoire de La Mongie et une rencontre au sommet qui portera bien son nom et surtout avec Xi Jinping représentant 1,4 milliards d’habitants, un immense coup de projecteur sur le département des Hautes-Pyrénées.
Emmanuel MACRON, né le 21 décembre 1977 à Amiens, est un homme d’État français. Il est président de la République française depuis le 7 mai 2017. Fils de Françoise Noguès, médecin et de Jean-Michel Macron, professeur de neurologie, il a de profondes attaches dans la vallée de l’Adour. Sa grand-mère maternelle, Germaine Noguès née Arribet, surnommée Manette, était originaire de Montgaillard. Née à Tarbes en 1916, elle était devenue directrice de collège dans la Somme. Avant la Seconde Guerre mondiale, elle épousa Jean Noguès, un enseignant dont les parents étaient commerçants à Bagnères-de-Bigorre. Le couple partira s’installer dans la Nièvre puis à Amiens. De leur union naîtront trois enfants dont Françoise, la mère d’Emmanuel. Mais à toutes les vacances scolaires, Manette et Jean, reviennent à Bagnères-de-Bigorre, dans la maison familiale, avec le petit «Manu», le chouchou de Germaine. Dans leur belle demeure, Manette façonne l’éducation de son petit-fils. Il faut dire qu’il y passait le plus clair de son temps à lire, étudier, et s’enrichir des savoirs de cette mamie enseignante. C’est elle qui lui donne le goût des livres et lui transmet sa passion pour la littérature et les grands auteurs. Sylvie Andréjacq, sa cousine, commerçante à Bagnères, se rappelle « un petit garçon qui bûchait énormément, capable de laisser tomber ses copains pour aller faire ses devoirs. Il voulait que sa grand-mère bien-aimée soit fière de lui ». Le grand-père de Sylvie, Roger Noguès, et celui d’Emmanuel, Jean Noguès, étaient frères, de vrais Bagnérais. Il adorait skier à la Mongie ou pêcher avec son grand-père. Avec sa grand-mère il allait en promenade au Vallon de Salut. Avec Brigitte, qu’il épousa en 2007, il a continué à venir skier chaque année dans cette station familière de La Mongie, À tel point que le domaine du Grand Tourmalet a fait regarnir en bleu, blanc et rouge, la banquette et les protections du véhicule du télésiège ‘Le Béarnais’, utilisé par le couple présidentiel. En haut du Tourmalet, il retrouve depuis jeune adolescent son ami Éric Abadie, éleveur et gérant de « L’Étape du berger ». Le béret vissé sur la tête, le restaurateur raconte : « Quand tu as une discussion avec lui, tu en ressors toujours plus intelligent.» Le 12 avril 2017, pendant la campagne présidentielle, il avait même poussé la chansonnette avec des amis pyrénéens. En mars 2019, de retour d’un déplacement au Kenya, le Président était venu se ressourcer quelques jours à La Mongie, heureux d’y retrouver des paysages et des visages amis. D’ascendance bigourdane du côté maternel, cet enfant du pays, est quelqu’un qui éprouve un attachement sincère à ce département et qui aime revenir sur les terres de ses grands-parents, et auprès de ses cousins et amis et venir se recueillir sur la tombe de Manette, sa grand-mère adorée, décédée en 2013. En visite d’État en France les 6 et 7 mai 2024 pour célébrer les 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays, le président chinois Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan se sont rendus le 7 mai au col du Tourmalet, ‘haut lieu de la culture sportive française’, accueillis par Emmanuel et Brigitte Macron à « l’Étape du berger », le restaurant d’altitude tenu par son ami Éric Abadie. L’occasion lors de cette visite historique et de ce déjeuner d’État au sommet, de partager ses racines pyrénéennes avec son homologue chinois autour de la gastronomie locale et du folklore bigourdan avec au menu les meilleurs produits des terroirs de Bigorre (garbure, agneau, porc noir, haricots tarbais, fromage à la truffe et tarte aux myrtilles) et des vins d’exception produits au pied des Pyrénées. Cela restera un grand moment d’histoire pour ce territoire de La Mongie et une rencontre au sommet qui portera bien son nom et surtout avec Xi Jinping représentant 1,4 milliards d’habitants, un immense coup de projecteur sur le département des Hautes-Pyrénées.
 Emmanuel MACRON, né le 21 décembre 1977 à Amiens, est un homme d’État français. Il est président de la République française depuis le 7 mai 2017. Fils de Françoise Noguès, médecin et de Jean-Michel Macron, professeur de neurologie, il a de profondes attaches dans la vallée de l’Adour. Sa grand-mère maternelle, Germaine Noguès née Arribet, surnommée Manette, était originaire de Montgaillard. Née à Tarbes en 1916, elle était devenue directrice de collège dans la Somme. Avant la Seconde Guerre mondiale, elle épousa Jean Noguès, un enseignant dont les parents étaient commerçants à Bagnères-de-Bigorre. Le couple partira s’installer dans la Nièvre puis à Amiens. De leur union naîtront trois enfants dont Françoise, la mère d’Emmanuel. Mais à toutes les vacances scolaires, Manette et Jean, reviennent à Bagnères-de-Bigorre, dans la maison familiale, avec le petit «Manu», le chouchou de Germaine. Dans leur belle demeure, Manette façonne l’éducation de son petit-fils. Il faut dire qu’il y passait le plus clair de son temps à lire, étudier, et s’enrichir des savoirs de cette mamie enseignante. C’est elle qui lui donne le goût des livres et lui transmet sa passion pour la littérature et les grands auteurs. Sylvie Andréjacq, sa cousine, commerçante à Bagnères, se rappelle « un petit garçon qui bûchait énormément, capable de laisser tomber ses copains pour aller faire ses devoirs. Il voulait que sa grand-mère bien-aimée soit fière de lui ». Le grand-père de Sylvie, Roger Noguès, et celui d’Emmanuel, Jean Noguès, étaient frères, de vrais Bagnérais. Il adorait skier à la Mongie ou pêcher avec son grand-père. Avec sa grand-mère il allait en promenade au Vallon de Salut. Avec Brigitte, qu’il épousa en 2007, il a continué à venir skier chaque année dans cette station familière de La Mongie, À tel point que le domaine du Grand Tourmalet a fait regarnir en bleu, blanc et rouge, la banquette et les protections du véhicule du télésiège ‘Le Béarnais’, utilisé par le couple présidentiel. En haut du Tourmalet, il retrouve depuis jeune adolescent son ami Éric Abadie, éleveur et gérant de « L’Étape du berger ». Le béret vissé sur la tête, le restaurateur raconte : « Quand tu as une discussion avec lui, tu en ressors toujours plus intelligent.» Le 12 avril 2017, pendant la campagne présidentielle, il avait même poussé la chansonnette avec des amis pyrénéens. En mars 2019, de retour d’un déplacement au Kenya, le Président était venu se ressourcer quelques jours à La Mongie, heureux d’y retrouver des paysages et des visages amis. D’ascendance bigourdane du côté maternel, cet enfant du pays, est quelqu’un qui éprouve un attachement sincère à ce département et qui aime revenir sur les terres de ses grands-parents, et auprès de ses cousins et amis et venir se recueillir sur la tombe de Manette, sa grand-mère adorée, décédée en 2013. En visite d’État en France les 6 et 7 mai 2024 pour célébrer les 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays, le président chinois Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan se sont rendus le 7 mai au col du Tourmalet, ‘haut lieu de la culture sportive française’, accueillis par Emmanuel et Brigitte Macron à « l’Étape du berger », le restaurant d’altitude tenu par son ami Éric Abadie. L’occasion lors de cette visite historique et de ce déjeuner d’État au sommet, de partager ses racines pyrénéennes avec son homologue chinois autour de la gastronomie locale et du folklore bigourdan avec au menu les meilleurs produits des terroirs de Bigorre (garbure, agneau, porc noir, haricots tarbais, fromage à la truffe et tarte aux myrtilles) et des vins d’exception produits au pied des Pyrénées. Cela restera un grand moment d’histoire pour ce territoire de La Mongie et une rencontre au sommet qui portera bien son nom et surtout avec Xi Jinping représentant 1,4 milliards d’habitants, un immense coup de projecteur sur le département des Hautes-Pyrénées.
Emmanuel MACRON, né le 21 décembre 1977 à Amiens, est un homme d’État français. Il est président de la République française depuis le 7 mai 2017. Fils de Françoise Noguès, médecin et de Jean-Michel Macron, professeur de neurologie, il a de profondes attaches dans la vallée de l’Adour. Sa grand-mère maternelle, Germaine Noguès née Arribet, surnommée Manette, était originaire de Montgaillard. Née à Tarbes en 1916, elle était devenue directrice de collège dans la Somme. Avant la Seconde Guerre mondiale, elle épousa Jean Noguès, un enseignant dont les parents étaient commerçants à Bagnères-de-Bigorre. Le couple partira s’installer dans la Nièvre puis à Amiens. De leur union naîtront trois enfants dont Françoise, la mère d’Emmanuel. Mais à toutes les vacances scolaires, Manette et Jean, reviennent à Bagnères-de-Bigorre, dans la maison familiale, avec le petit «Manu», le chouchou de Germaine. Dans leur belle demeure, Manette façonne l’éducation de son petit-fils. Il faut dire qu’il y passait le plus clair de son temps à lire, étudier, et s’enrichir des savoirs de cette mamie enseignante. C’est elle qui lui donne le goût des livres et lui transmet sa passion pour la littérature et les grands auteurs. Sylvie Andréjacq, sa cousine, commerçante à Bagnères, se rappelle « un petit garçon qui bûchait énormément, capable de laisser tomber ses copains pour aller faire ses devoirs. Il voulait que sa grand-mère bien-aimée soit fière de lui ». Le grand-père de Sylvie, Roger Noguès, et celui d’Emmanuel, Jean Noguès, étaient frères, de vrais Bagnérais. Il adorait skier à la Mongie ou pêcher avec son grand-père. Avec sa grand-mère il allait en promenade au Vallon de Salut. Avec Brigitte, qu’il épousa en 2007, il a continué à venir skier chaque année dans cette station familière de La Mongie, À tel point que le domaine du Grand Tourmalet a fait regarnir en bleu, blanc et rouge, la banquette et les protections du véhicule du télésiège ‘Le Béarnais’, utilisé par le couple présidentiel. En haut du Tourmalet, il retrouve depuis jeune adolescent son ami Éric Abadie, éleveur et gérant de « L’Étape du berger ». Le béret vissé sur la tête, le restaurateur raconte : « Quand tu as une discussion avec lui, tu en ressors toujours plus intelligent.» Le 12 avril 2017, pendant la campagne présidentielle, il avait même poussé la chansonnette avec des amis pyrénéens. En mars 2019, de retour d’un déplacement au Kenya, le Président était venu se ressourcer quelques jours à La Mongie, heureux d’y retrouver des paysages et des visages amis. D’ascendance bigourdane du côté maternel, cet enfant du pays, est quelqu’un qui éprouve un attachement sincère à ce département et qui aime revenir sur les terres de ses grands-parents, et auprès de ses cousins et amis et venir se recueillir sur la tombe de Manette, sa grand-mère adorée, décédée en 2013. En visite d’État en France les 6 et 7 mai 2024 pour célébrer les 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays, le président chinois Xi Jinping et son épouse Peng Liyuan se sont rendus le 7 mai au col du Tourmalet, ‘haut lieu de la culture sportive française’, accueillis par Emmanuel et Brigitte Macron à « l’Étape du berger », le restaurant d’altitude tenu par son ami Éric Abadie. L’occasion lors de cette visite historique et de ce déjeuner d’État au sommet, de partager ses racines pyrénéennes avec son homologue chinois autour de la gastronomie locale et du folklore bigourdan avec au menu les meilleurs produits des terroirs de Bigorre (garbure, agneau, porc noir, haricots tarbais, fromage à la truffe et tarte aux myrtilles) et des vins d’exception produits au pied des Pyrénées. Cela restera un grand moment d’histoire pour ce territoire de La Mongie et une rencontre au sommet qui portera bien son nom et surtout avec Xi Jinping représentant 1,4 milliards d’habitants, un immense coup de projecteur sur le département des Hautes-Pyrénées.MASSEY Placide (1777-1853)
Célèbre botaniste et grand bienfaiteur de la ville de Tarbes
 Placide MASSEY, né le 4 octobre 1777 à Tarbes dans la maison Serres, sise au Portail-devant, et mort dans la même ville le 18 novembre 1853, à l'âge de 76 ans. Placide Massey, le grand bienfaiteur de la ville de Tarbes, est le fils de Anne Marmouget et de Jean Massey, un modeste maître cordonnier. Dès 1778, il demeure au numéro 9 de la rue des Grands-Fossés. Il fait ses études à l'École centrale de Tarbes, l'actuel lycée Théophile-Gautier. Il est élève et aide-pharmacien chez Lécussan, au numéro 11 de la place Marcadieu, famille avec laquelle il entretiendra toute sa vie une fidèle amitié. À l'âge de 18 ans, il abandonne cet emploi et entre comme pharmacien de troisième classe à l’hôpital militaire de Tarbes où une épidémie décimait l’armée des Pyrénées occidentales. L’école centrale est ouverte en 1796, il reprend alors ses études. Brillant élève, il a eu de la chance de bénéficier pendant cinq ans de cet enseignement particulièrement novateur et d’y rencontrer le naturaliste Louis Ramond de Carbonnières (1755-1827), précurseur du pyrénéisme, et dont il devient l'adjoint. Ainsi à ses côtés, il a pu bénéficier de l’enseignement scientifique d’excellence de ce botaniste réputé. Et grâce à Louis Ramond, ce jeune Bigourdan a connu l’aubaine et l’originalité de participer à la naissance du pyrénéisme romantique. Entre 1803 et 1814, il sera au service de la famille Bonaparte. Entre 1804 et 1830, en rapport avec les savants les plus distingués, il participe, sous la direction de Cuvier, à la rédaction des 60 volumes du « dictionnaire des sciences naturelles ». En 1808, il est nommé intendant des jardins de la reine Hortense (en France et au Royaume de Hollande). Sur l'ordre du roi Louis-Philippe, il réalise de très importantes plantations d'arbres, dans la plaine de Trianon, de Chèvreloup et au parc de Saint-Cloud. À la retraite de Lelieur, il prend, en janvier 1819, la direction des pépinières, du potager et de l’orangerie du château de Versailles. Il est directeur aussi de la pépinière et du Fleuriste de Saint-Cloud. Dans le potager il introduit à son tour de nouveaux légumes, dont le chou crambé, développe les cultures hâtées, en particulier celle des asperges. À partir de 1829 se développe l'utilisation du thermosiphon, inventé en 1777 par un Français, Bonnemain, mais très peu utilisé en France jusqu'alors. Le procédé permet de chauffer les serres par circulation d'eau chaude. Ce progrès permet l'extension des productions exotiques : la culture de l'ananas se développe extraordinairement, dans les serres à ananas ; un bananier, installé dans la grande serre, y fructifie en 1840. En matière scientifique Placide Massey était progressiste. Il est donc l’un des premiers français à utiliser, dès 1829, le thermosiphon, c’est-à-dire le chauffage des serres par la circulation de l’eau chaude. Le 23 janvier 1832, il est nommé en outre inspecteur de tous les jardins de la couronne. Le 14 août 1832 il est appelé en outre directeur du jardin du palais de Versailles et des Trianons. Les principales préoccupations de Placide Massey furent la réorganisation, la modernisation et l’innovation des jardins de Versailles. En 1841, le roi Louis-Philippe, qui l’aimait et le considérait beaucoup, lui remet la Légion d’honneur. En 1849, avec la Deuxième République, les jardins de Versailles sont entièrement réorganisés, le potager est intégré au nouvel Institut national agronomique et il devient terrain d’application de l’école destinée aux agriculteurs. Placide Massey est remplacé en 1849. Amoureux et passionné des parcs et des jardins ce botaniste devenu célèbre, rêve de posséder son propre domaine. À chaque vacance, il ne manquait pas de venir dans sa ville natale. Désirant finir ses jours à Tarbes, dès 1825, il achète des terrains au nord de Tarbes, dans une zone marécageuse pour créer un grand jardin. Après avoir conçu un système ingénieux de drainage et d’irrigation du sol, il dessine le parc et y plante nombre d’arbres aux essences rares dans l’intention d’en faire un arboretum. En 1850, il prend sa retraite et se partage entre son domicile versaillais, l’hôtel de l’Univers à Paris et sa ville natale pour y construire sa maison, organiser son jardin d’agrément et continuer ses plantations d'arbres aux essences rares. Il veut également doter sa ville d’un muséum d’histoire naturelle, et fait construire à cette fin un bâtiment de style byzantin et mauresque, copie d’un palais du Caire oriental, dominé par une tour d'observation sur les Pyrénées et le Pic du Midi, œuvre de l'architecte tarbais Jean-Jacques Latour. C'est dans ce bâtiment, inachevé à sa mort, que fut créé le musée Massey. Placide Massey meurt à Tarbes le 18 novembre 1853, et est inhumé au cimetière Saint-Jean. Afin de poursuivre son rêve, il a légué, en 1853, son parc et sa maison, qui deviendront jardin d’agrément et musée, et presque tous ses biens à la ville de Tarbes. Dans son testament il précise ainsi ses volontés : « Je donne à la commune de Tarbes, ma ville natale, tous les immeubles que je possède sur son territoire et consistant en jardin d'ornement, pépinière, maisons, prairies, le jardin d'ornement pour servir de promenade ; la pépinière pour continuer la culture d'arbres fruitiers, les maisons et prairies pour employer leurs produits à l'entretien du jardin d'ornement et de la pépinière. Comme les produits ne peuvent pas être suffisants pour l'entretien du jardin d'ornement à cause du jardin d'hiver que j'y fais construire, je donne en outre, à la commune de Tarbes, soixante actions du Chemin de fer du nord qui produiront environ deux mille francs par an. » En acceptant le don, la ville s’est engagée à concrétiser le rêve de Massey. Le jardin botanique est aujourd’hui un « jardin remarquable », label décerné par le ministère de la Culture. Le muséum devenu « musée de France » porte le nom de son père fondateur et bienfaiteur. Placide Massey est à l’origine de la construction d’un lieu emblématique et d’une oasis urbaine où chaque Tarbais peut se reconnaître. Le Jardin Massey est un lieu tranquille dans la ville de Tarbes. On y trouve beaucoup d'animaux rares et intéressants, de belles fleurs, des arbres datant de 1830, une calèche ainsi que les vestiges d'un cloître qui proviennent de l'abbaye de Saint-Sever-de-Rustan, parmi d'autres vieux bâtiments. La maison de Placide Massey est agrandie de deux salles au sud, destinées à recevoir un musée et une bibliothèque. Le jardin d’hiver est déplacé à l’ouest du parc, actuelle orangerie. En 1864, les premières salles sont inaugurées, un muséum d’histoire naturelle pour conserver l’esprit de Placide Massey et un musée des beaux-arts pour présenter les collections initiées par Achille Jubinal. À la fin du 19ème siècle, le musée s’enrichit d’un fonds archéologique constitué de chapiteaux romans et gothiques provenant d’églises du département. En 1955, Marcel Boulin, nommé à la tête du musée, s’intéresse à la société agropastorale des Hautes-Pyrénées, au « cheval tarbais » à l’origine de l’implantation des régiments de hussards à Tarbes. Quelques années après la mort du célèbre botaniste, en 1882, un buste de Placide Massey fut installé dans le jardin. C'est le sculpteur tarbais Henri Nelli (1834-1903) qui accomplit ce travail. La statue déménagea plusieurs fois. On notera également dans le cimetière Saint-Jean à Tarbes, la présence d'un autre buste de Placide Massey sur sa tombe. Le buste est aussi l’œuvre d’Henri Nelli en 1859. Placide Massey fut, à la fin de sa vie, parmi les précurseurs de l’observatoire du Pic du Midi, puisqu’en 1852, il fonde avec ses amis du docteur Costallat, l’hôtellerie du Pic du Midi, qui avait pour vocation d’accueillir les touristes mais surtout d’attirer les scientifiques et aussi de faire des observations météorologiques. Au milieu du XIXe siècle, il est la deuxième personne la plus fortunée de Tarbes. Il dessina aussi le parc de Ferrières, en Seine-et-Oise, appartenant à James de Rothschild. Dans une chronique locale paru la nécrologie de Placide Massey, du 19 novembre 1853 : « La ville de Tarbes est en deuil, M. Massey, ancien directeur du potager de Versailles sous Louis-Philippe, un des hommes les plus versés dans la science de la botanique, le citoyen qui, depuis 1849, a entretenu à Tarbes, par ses travaux, une notable partie de la population ouvrière, l’homme le plus simple, le plus modeste qui se pût rencontrer, est mort hier, à midi. Les citoyens de toutes les classes, de toutes conditions ont compris quelle immense perte a faite notre cité, et ce deuil prend les proportions du deuil public… » Cet enfant de Tarbes, vécu très retiré, voyant à peine quelques rares, mais sincères amis, n’aimant ni le luxe, ni le monde, toujours mis simplement et sans décor montrant une richesse ou une aisance pourtant avérée.
Placide MASSEY, né le 4 octobre 1777 à Tarbes dans la maison Serres, sise au Portail-devant, et mort dans la même ville le 18 novembre 1853, à l'âge de 76 ans. Placide Massey, le grand bienfaiteur de la ville de Tarbes, est le fils de Anne Marmouget et de Jean Massey, un modeste maître cordonnier. Dès 1778, il demeure au numéro 9 de la rue des Grands-Fossés. Il fait ses études à l'École centrale de Tarbes, l'actuel lycée Théophile-Gautier. Il est élève et aide-pharmacien chez Lécussan, au numéro 11 de la place Marcadieu, famille avec laquelle il entretiendra toute sa vie une fidèle amitié. À l'âge de 18 ans, il abandonne cet emploi et entre comme pharmacien de troisième classe à l’hôpital militaire de Tarbes où une épidémie décimait l’armée des Pyrénées occidentales. L’école centrale est ouverte en 1796, il reprend alors ses études. Brillant élève, il a eu de la chance de bénéficier pendant cinq ans de cet enseignement particulièrement novateur et d’y rencontrer le naturaliste Louis Ramond de Carbonnières (1755-1827), précurseur du pyrénéisme, et dont il devient l'adjoint. Ainsi à ses côtés, il a pu bénéficier de l’enseignement scientifique d’excellence de ce botaniste réputé. Et grâce à Louis Ramond, ce jeune Bigourdan a connu l’aubaine et l’originalité de participer à la naissance du pyrénéisme romantique. Entre 1803 et 1814, il sera au service de la famille Bonaparte. Entre 1804 et 1830, en rapport avec les savants les plus distingués, il participe, sous la direction de Cuvier, à la rédaction des 60 volumes du « dictionnaire des sciences naturelles ». En 1808, il est nommé intendant des jardins de la reine Hortense (en France et au Royaume de Hollande). Sur l'ordre du roi Louis-Philippe, il réalise de très importantes plantations d'arbres, dans la plaine de Trianon, de Chèvreloup et au parc de Saint-Cloud. À la retraite de Lelieur, il prend, en janvier 1819, la direction des pépinières, du potager et de l’orangerie du château de Versailles. Il est directeur aussi de la pépinière et du Fleuriste de Saint-Cloud. Dans le potager il introduit à son tour de nouveaux légumes, dont le chou crambé, développe les cultures hâtées, en particulier celle des asperges. À partir de 1829 se développe l'utilisation du thermosiphon, inventé en 1777 par un Français, Bonnemain, mais très peu utilisé en France jusqu'alors. Le procédé permet de chauffer les serres par circulation d'eau chaude. Ce progrès permet l'extension des productions exotiques : la culture de l'ananas se développe extraordinairement, dans les serres à ananas ; un bananier, installé dans la grande serre, y fructifie en 1840. En matière scientifique Placide Massey était progressiste. Il est donc l’un des premiers français à utiliser, dès 1829, le thermosiphon, c’est-à-dire le chauffage des serres par la circulation de l’eau chaude. Le 23 janvier 1832, il est nommé en outre inspecteur de tous les jardins de la couronne. Le 14 août 1832 il est appelé en outre directeur du jardin du palais de Versailles et des Trianons. Les principales préoccupations de Placide Massey furent la réorganisation, la modernisation et l’innovation des jardins de Versailles. En 1841, le roi Louis-Philippe, qui l’aimait et le considérait beaucoup, lui remet la Légion d’honneur. En 1849, avec la Deuxième République, les jardins de Versailles sont entièrement réorganisés, le potager est intégré au nouvel Institut national agronomique et il devient terrain d’application de l’école destinée aux agriculteurs. Placide Massey est remplacé en 1849. Amoureux et passionné des parcs et des jardins ce botaniste devenu célèbre, rêve de posséder son propre domaine. À chaque vacance, il ne manquait pas de venir dans sa ville natale. Désirant finir ses jours à Tarbes, dès 1825, il achète des terrains au nord de Tarbes, dans une zone marécageuse pour créer un grand jardin. Après avoir conçu un système ingénieux de drainage et d’irrigation du sol, il dessine le parc et y plante nombre d’arbres aux essences rares dans l’intention d’en faire un arboretum. En 1850, il prend sa retraite et se partage entre son domicile versaillais, l’hôtel de l’Univers à Paris et sa ville natale pour y construire sa maison, organiser son jardin d’agrément et continuer ses plantations d'arbres aux essences rares. Il veut également doter sa ville d’un muséum d’histoire naturelle, et fait construire à cette fin un bâtiment de style byzantin et mauresque, copie d’un palais du Caire oriental, dominé par une tour d'observation sur les Pyrénées et le Pic du Midi, œuvre de l'architecte tarbais Jean-Jacques Latour. C'est dans ce bâtiment, inachevé à sa mort, que fut créé le musée Massey. Placide Massey meurt à Tarbes le 18 novembre 1853, et est inhumé au cimetière Saint-Jean. Afin de poursuivre son rêve, il a légué, en 1853, son parc et sa maison, qui deviendront jardin d’agrément et musée, et presque tous ses biens à la ville de Tarbes. Dans son testament il précise ainsi ses volontés : « Je donne à la commune de Tarbes, ma ville natale, tous les immeubles que je possède sur son territoire et consistant en jardin d'ornement, pépinière, maisons, prairies, le jardin d'ornement pour servir de promenade ; la pépinière pour continuer la culture d'arbres fruitiers, les maisons et prairies pour employer leurs produits à l'entretien du jardin d'ornement et de la pépinière. Comme les produits ne peuvent pas être suffisants pour l'entretien du jardin d'ornement à cause du jardin d'hiver que j'y fais construire, je donne en outre, à la commune de Tarbes, soixante actions du Chemin de fer du nord qui produiront environ deux mille francs par an. » En acceptant le don, la ville s’est engagée à concrétiser le rêve de Massey. Le jardin botanique est aujourd’hui un « jardin remarquable », label décerné par le ministère de la Culture. Le muséum devenu « musée de France » porte le nom de son père fondateur et bienfaiteur. Placide Massey est à l’origine de la construction d’un lieu emblématique et d’une oasis urbaine où chaque Tarbais peut se reconnaître. Le Jardin Massey est un lieu tranquille dans la ville de Tarbes. On y trouve beaucoup d'animaux rares et intéressants, de belles fleurs, des arbres datant de 1830, une calèche ainsi que les vestiges d'un cloître qui proviennent de l'abbaye de Saint-Sever-de-Rustan, parmi d'autres vieux bâtiments. La maison de Placide Massey est agrandie de deux salles au sud, destinées à recevoir un musée et une bibliothèque. Le jardin d’hiver est déplacé à l’ouest du parc, actuelle orangerie. En 1864, les premières salles sont inaugurées, un muséum d’histoire naturelle pour conserver l’esprit de Placide Massey et un musée des beaux-arts pour présenter les collections initiées par Achille Jubinal. À la fin du 19ème siècle, le musée s’enrichit d’un fonds archéologique constitué de chapiteaux romans et gothiques provenant d’églises du département. En 1955, Marcel Boulin, nommé à la tête du musée, s’intéresse à la société agropastorale des Hautes-Pyrénées, au « cheval tarbais » à l’origine de l’implantation des régiments de hussards à Tarbes. Quelques années après la mort du célèbre botaniste, en 1882, un buste de Placide Massey fut installé dans le jardin. C'est le sculpteur tarbais Henri Nelli (1834-1903) qui accomplit ce travail. La statue déménagea plusieurs fois. On notera également dans le cimetière Saint-Jean à Tarbes, la présence d'un autre buste de Placide Massey sur sa tombe. Le buste est aussi l’œuvre d’Henri Nelli en 1859. Placide Massey fut, à la fin de sa vie, parmi les précurseurs de l’observatoire du Pic du Midi, puisqu’en 1852, il fonde avec ses amis du docteur Costallat, l’hôtellerie du Pic du Midi, qui avait pour vocation d’accueillir les touristes mais surtout d’attirer les scientifiques et aussi de faire des observations météorologiques. Au milieu du XIXe siècle, il est la deuxième personne la plus fortunée de Tarbes. Il dessina aussi le parc de Ferrières, en Seine-et-Oise, appartenant à James de Rothschild. Dans une chronique locale paru la nécrologie de Placide Massey, du 19 novembre 1853 : « La ville de Tarbes est en deuil, M. Massey, ancien directeur du potager de Versailles sous Louis-Philippe, un des hommes les plus versés dans la science de la botanique, le citoyen qui, depuis 1849, a entretenu à Tarbes, par ses travaux, une notable partie de la population ouvrière, l’homme le plus simple, le plus modeste qui se pût rencontrer, est mort hier, à midi. Les citoyens de toutes les classes, de toutes conditions ont compris quelle immense perte a faite notre cité, et ce deuil prend les proportions du deuil public… » Cet enfant de Tarbes, vécu très retiré, voyant à peine quelques rares, mais sincères amis, n’aimant ni le luxe, ni le monde, toujours mis simplement et sans décor montrant une richesse ou une aisance pourtant avérée.
 Placide MASSEY, né le 4 octobre 1777 à Tarbes dans la maison Serres, sise au Portail-devant, et mort dans la même ville le 18 novembre 1853, à l'âge de 76 ans. Placide Massey, le grand bienfaiteur de la ville de Tarbes, est le fils de Anne Marmouget et de Jean Massey, un modeste maître cordonnier. Dès 1778, il demeure au numéro 9 de la rue des Grands-Fossés. Il fait ses études à l'École centrale de Tarbes, l'actuel lycée Théophile-Gautier. Il est élève et aide-pharmacien chez Lécussan, au numéro 11 de la place Marcadieu, famille avec laquelle il entretiendra toute sa vie une fidèle amitié. À l'âge de 18 ans, il abandonne cet emploi et entre comme pharmacien de troisième classe à l’hôpital militaire de Tarbes où une épidémie décimait l’armée des Pyrénées occidentales. L’école centrale est ouverte en 1796, il reprend alors ses études. Brillant élève, il a eu de la chance de bénéficier pendant cinq ans de cet enseignement particulièrement novateur et d’y rencontrer le naturaliste Louis Ramond de Carbonnières (1755-1827), précurseur du pyrénéisme, et dont il devient l'adjoint. Ainsi à ses côtés, il a pu bénéficier de l’enseignement scientifique d’excellence de ce botaniste réputé. Et grâce à Louis Ramond, ce jeune Bigourdan a connu l’aubaine et l’originalité de participer à la naissance du pyrénéisme romantique. Entre 1803 et 1814, il sera au service de la famille Bonaparte. Entre 1804 et 1830, en rapport avec les savants les plus distingués, il participe, sous la direction de Cuvier, à la rédaction des 60 volumes du « dictionnaire des sciences naturelles ». En 1808, il est nommé intendant des jardins de la reine Hortense (en France et au Royaume de Hollande). Sur l'ordre du roi Louis-Philippe, il réalise de très importantes plantations d'arbres, dans la plaine de Trianon, de Chèvreloup et au parc de Saint-Cloud. À la retraite de Lelieur, il prend, en janvier 1819, la direction des pépinières, du potager et de l’orangerie du château de Versailles. Il est directeur aussi de la pépinière et du Fleuriste de Saint-Cloud. Dans le potager il introduit à son tour de nouveaux légumes, dont le chou crambé, développe les cultures hâtées, en particulier celle des asperges. À partir de 1829 se développe l'utilisation du thermosiphon, inventé en 1777 par un Français, Bonnemain, mais très peu utilisé en France jusqu'alors. Le procédé permet de chauffer les serres par circulation d'eau chaude. Ce progrès permet l'extension des productions exotiques : la culture de l'ananas se développe extraordinairement, dans les serres à ananas ; un bananier, installé dans la grande serre, y fructifie en 1840. En matière scientifique Placide Massey était progressiste. Il est donc l’un des premiers français à utiliser, dès 1829, le thermosiphon, c’est-à-dire le chauffage des serres par la circulation de l’eau chaude. Le 23 janvier 1832, il est nommé en outre inspecteur de tous les jardins de la couronne. Le 14 août 1832 il est appelé en outre directeur du jardin du palais de Versailles et des Trianons. Les principales préoccupations de Placide Massey furent la réorganisation, la modernisation et l’innovation des jardins de Versailles. En 1841, le roi Louis-Philippe, qui l’aimait et le considérait beaucoup, lui remet la Légion d’honneur. En 1849, avec la Deuxième République, les jardins de Versailles sont entièrement réorganisés, le potager est intégré au nouvel Institut national agronomique et il devient terrain d’application de l’école destinée aux agriculteurs. Placide Massey est remplacé en 1849. Amoureux et passionné des parcs et des jardins ce botaniste devenu célèbre, rêve de posséder son propre domaine. À chaque vacance, il ne manquait pas de venir dans sa ville natale. Désirant finir ses jours à Tarbes, dès 1825, il achète des terrains au nord de Tarbes, dans une zone marécageuse pour créer un grand jardin. Après avoir conçu un système ingénieux de drainage et d’irrigation du sol, il dessine le parc et y plante nombre d’arbres aux essences rares dans l’intention d’en faire un arboretum. En 1850, il prend sa retraite et se partage entre son domicile versaillais, l’hôtel de l’Univers à Paris et sa ville natale pour y construire sa maison, organiser son jardin d’agrément et continuer ses plantations d'arbres aux essences rares. Il veut également doter sa ville d’un muséum d’histoire naturelle, et fait construire à cette fin un bâtiment de style byzantin et mauresque, copie d’un palais du Caire oriental, dominé par une tour d'observation sur les Pyrénées et le Pic du Midi, œuvre de l'architecte tarbais Jean-Jacques Latour. C'est dans ce bâtiment, inachevé à sa mort, que fut créé le musée Massey. Placide Massey meurt à Tarbes le 18 novembre 1853, et est inhumé au cimetière Saint-Jean. Afin de poursuivre son rêve, il a légué, en 1853, son parc et sa maison, qui deviendront jardin d’agrément et musée, et presque tous ses biens à la ville de Tarbes. Dans son testament il précise ainsi ses volontés : « Je donne à la commune de Tarbes, ma ville natale, tous les immeubles que je possède sur son territoire et consistant en jardin d'ornement, pépinière, maisons, prairies, le jardin d'ornement pour servir de promenade ; la pépinière pour continuer la culture d'arbres fruitiers, les maisons et prairies pour employer leurs produits à l'entretien du jardin d'ornement et de la pépinière. Comme les produits ne peuvent pas être suffisants pour l'entretien du jardin d'ornement à cause du jardin d'hiver que j'y fais construire, je donne en outre, à la commune de Tarbes, soixante actions du Chemin de fer du nord qui produiront environ deux mille francs par an. » En acceptant le don, la ville s’est engagée à concrétiser le rêve de Massey. Le jardin botanique est aujourd’hui un « jardin remarquable », label décerné par le ministère de la Culture. Le muséum devenu « musée de France » porte le nom de son père fondateur et bienfaiteur. Placide Massey est à l’origine de la construction d’un lieu emblématique et d’une oasis urbaine où chaque Tarbais peut se reconnaître. Le Jardin Massey est un lieu tranquille dans la ville de Tarbes. On y trouve beaucoup d'animaux rares et intéressants, de belles fleurs, des arbres datant de 1830, une calèche ainsi que les vestiges d'un cloître qui proviennent de l'abbaye de Saint-Sever-de-Rustan, parmi d'autres vieux bâtiments. La maison de Placide Massey est agrandie de deux salles au sud, destinées à recevoir un musée et une bibliothèque. Le jardin d’hiver est déplacé à l’ouest du parc, actuelle orangerie. En 1864, les premières salles sont inaugurées, un muséum d’histoire naturelle pour conserver l’esprit de Placide Massey et un musée des beaux-arts pour présenter les collections initiées par Achille Jubinal. À la fin du 19ème siècle, le musée s’enrichit d’un fonds archéologique constitué de chapiteaux romans et gothiques provenant d’églises du département. En 1955, Marcel Boulin, nommé à la tête du musée, s’intéresse à la société agropastorale des Hautes-Pyrénées, au « cheval tarbais » à l’origine de l’implantation des régiments de hussards à Tarbes. Quelques années après la mort du célèbre botaniste, en 1882, un buste de Placide Massey fut installé dans le jardin. C'est le sculpteur tarbais Henri Nelli (1834-1903) qui accomplit ce travail. La statue déménagea plusieurs fois. On notera également dans le cimetière Saint-Jean à Tarbes, la présence d'un autre buste de Placide Massey sur sa tombe. Le buste est aussi l’œuvre d’Henri Nelli en 1859. Placide Massey fut, à la fin de sa vie, parmi les précurseurs de l’observatoire du Pic du Midi, puisqu’en 1852, il fonde avec ses amis du docteur Costallat, l’hôtellerie du Pic du Midi, qui avait pour vocation d’accueillir les touristes mais surtout d’attirer les scientifiques et aussi de faire des observations météorologiques. Au milieu du XIXe siècle, il est la deuxième personne la plus fortunée de Tarbes. Il dessina aussi le parc de Ferrières, en Seine-et-Oise, appartenant à James de Rothschild. Dans une chronique locale paru la nécrologie de Placide Massey, du 19 novembre 1853 : « La ville de Tarbes est en deuil, M. Massey, ancien directeur du potager de Versailles sous Louis-Philippe, un des hommes les plus versés dans la science de la botanique, le citoyen qui, depuis 1849, a entretenu à Tarbes, par ses travaux, une notable partie de la population ouvrière, l’homme le plus simple, le plus modeste qui se pût rencontrer, est mort hier, à midi. Les citoyens de toutes les classes, de toutes conditions ont compris quelle immense perte a faite notre cité, et ce deuil prend les proportions du deuil public… » Cet enfant de Tarbes, vécu très retiré, voyant à peine quelques rares, mais sincères amis, n’aimant ni le luxe, ni le monde, toujours mis simplement et sans décor montrant une richesse ou une aisance pourtant avérée.
Placide MASSEY, né le 4 octobre 1777 à Tarbes dans la maison Serres, sise au Portail-devant, et mort dans la même ville le 18 novembre 1853, à l'âge de 76 ans. Placide Massey, le grand bienfaiteur de la ville de Tarbes, est le fils de Anne Marmouget et de Jean Massey, un modeste maître cordonnier. Dès 1778, il demeure au numéro 9 de la rue des Grands-Fossés. Il fait ses études à l'École centrale de Tarbes, l'actuel lycée Théophile-Gautier. Il est élève et aide-pharmacien chez Lécussan, au numéro 11 de la place Marcadieu, famille avec laquelle il entretiendra toute sa vie une fidèle amitié. À l'âge de 18 ans, il abandonne cet emploi et entre comme pharmacien de troisième classe à l’hôpital militaire de Tarbes où une épidémie décimait l’armée des Pyrénées occidentales. L’école centrale est ouverte en 1796, il reprend alors ses études. Brillant élève, il a eu de la chance de bénéficier pendant cinq ans de cet enseignement particulièrement novateur et d’y rencontrer le naturaliste Louis Ramond de Carbonnières (1755-1827), précurseur du pyrénéisme, et dont il devient l'adjoint. Ainsi à ses côtés, il a pu bénéficier de l’enseignement scientifique d’excellence de ce botaniste réputé. Et grâce à Louis Ramond, ce jeune Bigourdan a connu l’aubaine et l’originalité de participer à la naissance du pyrénéisme romantique. Entre 1803 et 1814, il sera au service de la famille Bonaparte. Entre 1804 et 1830, en rapport avec les savants les plus distingués, il participe, sous la direction de Cuvier, à la rédaction des 60 volumes du « dictionnaire des sciences naturelles ». En 1808, il est nommé intendant des jardins de la reine Hortense (en France et au Royaume de Hollande). Sur l'ordre du roi Louis-Philippe, il réalise de très importantes plantations d'arbres, dans la plaine de Trianon, de Chèvreloup et au parc de Saint-Cloud. À la retraite de Lelieur, il prend, en janvier 1819, la direction des pépinières, du potager et de l’orangerie du château de Versailles. Il est directeur aussi de la pépinière et du Fleuriste de Saint-Cloud. Dans le potager il introduit à son tour de nouveaux légumes, dont le chou crambé, développe les cultures hâtées, en particulier celle des asperges. À partir de 1829 se développe l'utilisation du thermosiphon, inventé en 1777 par un Français, Bonnemain, mais très peu utilisé en France jusqu'alors. Le procédé permet de chauffer les serres par circulation d'eau chaude. Ce progrès permet l'extension des productions exotiques : la culture de l'ananas se développe extraordinairement, dans les serres à ananas ; un bananier, installé dans la grande serre, y fructifie en 1840. En matière scientifique Placide Massey était progressiste. Il est donc l’un des premiers français à utiliser, dès 1829, le thermosiphon, c’est-à-dire le chauffage des serres par la circulation de l’eau chaude. Le 23 janvier 1832, il est nommé en outre inspecteur de tous les jardins de la couronne. Le 14 août 1832 il est appelé en outre directeur du jardin du palais de Versailles et des Trianons. Les principales préoccupations de Placide Massey furent la réorganisation, la modernisation et l’innovation des jardins de Versailles. En 1841, le roi Louis-Philippe, qui l’aimait et le considérait beaucoup, lui remet la Légion d’honneur. En 1849, avec la Deuxième République, les jardins de Versailles sont entièrement réorganisés, le potager est intégré au nouvel Institut national agronomique et il devient terrain d’application de l’école destinée aux agriculteurs. Placide Massey est remplacé en 1849. Amoureux et passionné des parcs et des jardins ce botaniste devenu célèbre, rêve de posséder son propre domaine. À chaque vacance, il ne manquait pas de venir dans sa ville natale. Désirant finir ses jours à Tarbes, dès 1825, il achète des terrains au nord de Tarbes, dans une zone marécageuse pour créer un grand jardin. Après avoir conçu un système ingénieux de drainage et d’irrigation du sol, il dessine le parc et y plante nombre d’arbres aux essences rares dans l’intention d’en faire un arboretum. En 1850, il prend sa retraite et se partage entre son domicile versaillais, l’hôtel de l’Univers à Paris et sa ville natale pour y construire sa maison, organiser son jardin d’agrément et continuer ses plantations d'arbres aux essences rares. Il veut également doter sa ville d’un muséum d’histoire naturelle, et fait construire à cette fin un bâtiment de style byzantin et mauresque, copie d’un palais du Caire oriental, dominé par une tour d'observation sur les Pyrénées et le Pic du Midi, œuvre de l'architecte tarbais Jean-Jacques Latour. C'est dans ce bâtiment, inachevé à sa mort, que fut créé le musée Massey. Placide Massey meurt à Tarbes le 18 novembre 1853, et est inhumé au cimetière Saint-Jean. Afin de poursuivre son rêve, il a légué, en 1853, son parc et sa maison, qui deviendront jardin d’agrément et musée, et presque tous ses biens à la ville de Tarbes. Dans son testament il précise ainsi ses volontés : « Je donne à la commune de Tarbes, ma ville natale, tous les immeubles que je possède sur son territoire et consistant en jardin d'ornement, pépinière, maisons, prairies, le jardin d'ornement pour servir de promenade ; la pépinière pour continuer la culture d'arbres fruitiers, les maisons et prairies pour employer leurs produits à l'entretien du jardin d'ornement et de la pépinière. Comme les produits ne peuvent pas être suffisants pour l'entretien du jardin d'ornement à cause du jardin d'hiver que j'y fais construire, je donne en outre, à la commune de Tarbes, soixante actions du Chemin de fer du nord qui produiront environ deux mille francs par an. » En acceptant le don, la ville s’est engagée à concrétiser le rêve de Massey. Le jardin botanique est aujourd’hui un « jardin remarquable », label décerné par le ministère de la Culture. Le muséum devenu « musée de France » porte le nom de son père fondateur et bienfaiteur. Placide Massey est à l’origine de la construction d’un lieu emblématique et d’une oasis urbaine où chaque Tarbais peut se reconnaître. Le Jardin Massey est un lieu tranquille dans la ville de Tarbes. On y trouve beaucoup d'animaux rares et intéressants, de belles fleurs, des arbres datant de 1830, une calèche ainsi que les vestiges d'un cloître qui proviennent de l'abbaye de Saint-Sever-de-Rustan, parmi d'autres vieux bâtiments. La maison de Placide Massey est agrandie de deux salles au sud, destinées à recevoir un musée et une bibliothèque. Le jardin d’hiver est déplacé à l’ouest du parc, actuelle orangerie. En 1864, les premières salles sont inaugurées, un muséum d’histoire naturelle pour conserver l’esprit de Placide Massey et un musée des beaux-arts pour présenter les collections initiées par Achille Jubinal. À la fin du 19ème siècle, le musée s’enrichit d’un fonds archéologique constitué de chapiteaux romans et gothiques provenant d’églises du département. En 1955, Marcel Boulin, nommé à la tête du musée, s’intéresse à la société agropastorale des Hautes-Pyrénées, au « cheval tarbais » à l’origine de l’implantation des régiments de hussards à Tarbes. Quelques années après la mort du célèbre botaniste, en 1882, un buste de Placide Massey fut installé dans le jardin. C'est le sculpteur tarbais Henri Nelli (1834-1903) qui accomplit ce travail. La statue déménagea plusieurs fois. On notera également dans le cimetière Saint-Jean à Tarbes, la présence d'un autre buste de Placide Massey sur sa tombe. Le buste est aussi l’œuvre d’Henri Nelli en 1859. Placide Massey fut, à la fin de sa vie, parmi les précurseurs de l’observatoire du Pic du Midi, puisqu’en 1852, il fonde avec ses amis du docteur Costallat, l’hôtellerie du Pic du Midi, qui avait pour vocation d’accueillir les touristes mais surtout d’attirer les scientifiques et aussi de faire des observations météorologiques. Au milieu du XIXe siècle, il est la deuxième personne la plus fortunée de Tarbes. Il dessina aussi le parc de Ferrières, en Seine-et-Oise, appartenant à James de Rothschild. Dans une chronique locale paru la nécrologie de Placide Massey, du 19 novembre 1853 : « La ville de Tarbes est en deuil, M. Massey, ancien directeur du potager de Versailles sous Louis-Philippe, un des hommes les plus versés dans la science de la botanique, le citoyen qui, depuis 1849, a entretenu à Tarbes, par ses travaux, une notable partie de la population ouvrière, l’homme le plus simple, le plus modeste qui se pût rencontrer, est mort hier, à midi. Les citoyens de toutes les classes, de toutes conditions ont compris quelle immense perte a faite notre cité, et ce deuil prend les proportions du deuil public… » Cet enfant de Tarbes, vécu très retiré, voyant à peine quelques rares, mais sincères amis, n’aimant ni le luxe, ni le monde, toujours mis simplement et sans décor montrant une richesse ou une aisance pourtant avérée.MATA David (1929-2017)
Écrivain et journaliste
 David MATA, né le 10 juillet 1929 à Tarbes et mort le 31 juillet 2017 à Barbastro (Espagne), à l’âge de 88 ans, fut un écrivain discret, d’origine aragonaise, disciple du philosophe espagnol Ortega y Gasset. Il grandit à Tarbes où ses parents espagnols avaient émigré avant la guerre. Très tôt, il se passionne pour la littérature. À dix-sept ans, il étudie seul le latin. Auteur à 20 ans de "Contes Aragonais", qu’il édita à compte d’auteur, il publiera son premier livre « Le Bûcher espagnol » chez Julliard en 1971. Ouvrage salué par la critique et qui lui valut une Radioscopie chez Jacques Chancel. Suivront « Un Mirador aragonais », roman sur deux frères durant la guerre d’Espagne : un qui s’engage et un qui refuse de s’engager, « La Fugue en Gascogne », « Le Film perdu », « Tarraco », « Hermann », « Violaine en son château », « Rendez-vous de Versailles », « Château d’Aldorfer », « Henri Borde » ou « Les Solistes de Dresde », un 8e roman que l’écrivain publia, quarante ans après la parution de son premier livre : « Le Bûcher espagnol ». Ancien journaliste, il collabora à la presse régionale, écrivit dans Le Monde et publia de nombreux articles dans la revue Éléments. Dans le numéro spécial que publia El Pais à l’occasion du centenaire d’Ortega y Gasset, son article représentait la France. Il signa le catalogue de l’exposition Jean-Marie Poumeyrol au Musée d’Art de Toulon et préfaça, en 2005, l’ouvrage sur le peintre Henri Borde (Éditions Cairn), les photos étant de Michel Dieuzaide. L’Aragon fut pour lui une vraie source d’inspiration et Alquezar, où sa mère naquit et son père dans un village proche, est un village qui tint une grande place dans ses deux premiers livres. Ce lettré tarbais demeura inconnu et discret toute sa vie, une sorte d’écrivain clandestin.
David MATA, né le 10 juillet 1929 à Tarbes et mort le 31 juillet 2017 à Barbastro (Espagne), à l’âge de 88 ans, fut un écrivain discret, d’origine aragonaise, disciple du philosophe espagnol Ortega y Gasset. Il grandit à Tarbes où ses parents espagnols avaient émigré avant la guerre. Très tôt, il se passionne pour la littérature. À dix-sept ans, il étudie seul le latin. Auteur à 20 ans de "Contes Aragonais", qu’il édita à compte d’auteur, il publiera son premier livre « Le Bûcher espagnol » chez Julliard en 1971. Ouvrage salué par la critique et qui lui valut une Radioscopie chez Jacques Chancel. Suivront « Un Mirador aragonais », roman sur deux frères durant la guerre d’Espagne : un qui s’engage et un qui refuse de s’engager, « La Fugue en Gascogne », « Le Film perdu », « Tarraco », « Hermann », « Violaine en son château », « Rendez-vous de Versailles », « Château d’Aldorfer », « Henri Borde » ou « Les Solistes de Dresde », un 8e roman que l’écrivain publia, quarante ans après la parution de son premier livre : « Le Bûcher espagnol ». Ancien journaliste, il collabora à la presse régionale, écrivit dans Le Monde et publia de nombreux articles dans la revue Éléments. Dans le numéro spécial que publia El Pais à l’occasion du centenaire d’Ortega y Gasset, son article représentait la France. Il signa le catalogue de l’exposition Jean-Marie Poumeyrol au Musée d’Art de Toulon et préfaça, en 2005, l’ouvrage sur le peintre Henri Borde (Éditions Cairn), les photos étant de Michel Dieuzaide. L’Aragon fut pour lui une vraie source d’inspiration et Alquezar, où sa mère naquit et son père dans un village proche, est un village qui tint une grande place dans ses deux premiers livres. Ce lettré tarbais demeura inconnu et discret toute sa vie, une sorte d’écrivain clandestin.
 David MATA, né le 10 juillet 1929 à Tarbes et mort le 31 juillet 2017 à Barbastro (Espagne), à l’âge de 88 ans, fut un écrivain discret, d’origine aragonaise, disciple du philosophe espagnol Ortega y Gasset. Il grandit à Tarbes où ses parents espagnols avaient émigré avant la guerre. Très tôt, il se passionne pour la littérature. À dix-sept ans, il étudie seul le latin. Auteur à 20 ans de "Contes Aragonais", qu’il édita à compte d’auteur, il publiera son premier livre « Le Bûcher espagnol » chez Julliard en 1971. Ouvrage salué par la critique et qui lui valut une Radioscopie chez Jacques Chancel. Suivront « Un Mirador aragonais », roman sur deux frères durant la guerre d’Espagne : un qui s’engage et un qui refuse de s’engager, « La Fugue en Gascogne », « Le Film perdu », « Tarraco », « Hermann », « Violaine en son château », « Rendez-vous de Versailles », « Château d’Aldorfer », « Henri Borde » ou « Les Solistes de Dresde », un 8e roman que l’écrivain publia, quarante ans après la parution de son premier livre : « Le Bûcher espagnol ». Ancien journaliste, il collabora à la presse régionale, écrivit dans Le Monde et publia de nombreux articles dans la revue Éléments. Dans le numéro spécial que publia El Pais à l’occasion du centenaire d’Ortega y Gasset, son article représentait la France. Il signa le catalogue de l’exposition Jean-Marie Poumeyrol au Musée d’Art de Toulon et préfaça, en 2005, l’ouvrage sur le peintre Henri Borde (Éditions Cairn), les photos étant de Michel Dieuzaide. L’Aragon fut pour lui une vraie source d’inspiration et Alquezar, où sa mère naquit et son père dans un village proche, est un village qui tint une grande place dans ses deux premiers livres. Ce lettré tarbais demeura inconnu et discret toute sa vie, une sorte d’écrivain clandestin.
David MATA, né le 10 juillet 1929 à Tarbes et mort le 31 juillet 2017 à Barbastro (Espagne), à l’âge de 88 ans, fut un écrivain discret, d’origine aragonaise, disciple du philosophe espagnol Ortega y Gasset. Il grandit à Tarbes où ses parents espagnols avaient émigré avant la guerre. Très tôt, il se passionne pour la littérature. À dix-sept ans, il étudie seul le latin. Auteur à 20 ans de "Contes Aragonais", qu’il édita à compte d’auteur, il publiera son premier livre « Le Bûcher espagnol » chez Julliard en 1971. Ouvrage salué par la critique et qui lui valut une Radioscopie chez Jacques Chancel. Suivront « Un Mirador aragonais », roman sur deux frères durant la guerre d’Espagne : un qui s’engage et un qui refuse de s’engager, « La Fugue en Gascogne », « Le Film perdu », « Tarraco », « Hermann », « Violaine en son château », « Rendez-vous de Versailles », « Château d’Aldorfer », « Henri Borde » ou « Les Solistes de Dresde », un 8e roman que l’écrivain publia, quarante ans après la parution de son premier livre : « Le Bûcher espagnol ». Ancien journaliste, il collabora à la presse régionale, écrivit dans Le Monde et publia de nombreux articles dans la revue Éléments. Dans le numéro spécial que publia El Pais à l’occasion du centenaire d’Ortega y Gasset, son article représentait la France. Il signa le catalogue de l’exposition Jean-Marie Poumeyrol au Musée d’Art de Toulon et préfaça, en 2005, l’ouvrage sur le peintre Henri Borde (Éditions Cairn), les photos étant de Michel Dieuzaide. L’Aragon fut pour lui une vraie source d’inspiration et Alquezar, où sa mère naquit et son père dans un village proche, est un village qui tint une grande place dans ses deux premiers livres. Ce lettré tarbais demeura inconnu et discret toute sa vie, une sorte d’écrivain clandestin.MATHET Louis Dominique (1853-1920)
Sculpteur praticien d’Auguste Rodin
 Louis Dominique MATHET, né le 20 novembre 1853 à Laloubère et mort le 22 avril 1920, à l’âge de 66 ans. Il est le fils d'Adolphe Mathet et d'Anne Dumont. Il débute comme apprenti chez le sculpteur tarbais Menvielle, puis chez Nelli, et enfin chez Géruzet, à Bagnères-de-Bigorre, où il fut le compagnon d'Edmond Desca, de Vic-en-Bigorre, Jean-Marie Mengue, de Bagnères-de-Luchon et Barras, un intime. Il suit les cours de dessin et de modelage du maître Maurice Journès, pour qui il gardera une amitié sincère. Le rêve d'un jeune marbrier n'est pas de se satisfaire de sa condition d'ouvrier mais de voir si une vocation de sculpteur n'apparaîtrait pas avec la pratique. Mathet et Barras voyagent en compagnie un certain temps et deviennent « cheminots de l'art », selon la juste expression de l'architecte diocésain Louis Caddau. À petites étapes, ils gagnent Poitiers, où ils se séparent. Mathet continue sur Paris. Un parent l'y accueille, ce qui facilite ses débuts dans la capitale. Très vite il cherche à s'embaucher dans un atelier, soucieux de ne pas être à la charge de la parenté. Il se lie d'amitié avec Agathon Léonard, sculpteur d'origine belge naturalisé français et auteur des célèbres « Petites Danseuses ». La progression dans la qualité de son travail lui permet d'être engagé dans l'atelier d’Auguste Dumont, à l'École des Beaux-Arts, où celui-ci enseigne. Là, il peut vraiment se dévouer à son art naissant : matinée consacrée aux études et le reste de la journée à un travail rétribué. Puis, vient le moment de servir le pays. Engagement au 8e régiment de hussards (8e RH), de 1874 à 1878. Cinq années de perdues. Il descend à Tarbes pour se marier le 7 juin 1879 avec Rose Bégarie, tailleuse de robes et originaire d'Argelès-Gazost. Le jeune marié a 25 ans et son témoin principal est le sculpteur Joseph Dupont, âgé lui de 26 ans. Louis Mathet, accompagné de son épouse, remonte à Paris. Un atelier, où les praticiens travaillent pour Eugène Guillaume, le remarque. Le maître des lieux, Eugène Guillaume, est l'auteur de deux chefs-d'œuvre : « La Musique instrumentale », en façade principale de l'Opéra Garnier, et « Anacréon », au musée d'Orsay. Pourquoi Eugène Guillaume, artiste confirmé, critique d'art, professeur au Collège de France, membre de l'Académie française et directeur de l'École des beaux-arts de Paris s’intéresse-t-il à Louis Mathet ? À ses yeux, sa façon de manier le ciseau le désigne pour succéder à son chef d’atelier qui vient de mourir. Le Bigourdan accepte avec empressement. Guillaume se prend d’affection pour Mathet et lui manifestera son amitié jusqu’à sa mort, en 1905. L’existence matérielle du jeune artiste est alors assurée. Tout naturellement, il vient à créer son propre atelier. Des bustes puis des statuettes sont présentés aux Salons des Artistes français. Après le décès d’Eugène Guillaume, Auguste Rodin veut tester le tarbais en lui demandant de l’aider à terminer un groupe. Peut-être s’agissait-il d’« Orphée et les Ménades », qui fut réalisé à trois avec Frédéric Ganier, entre 1903 et 1905 ? Le résultat est probant puisqu’il lui fait une proposition d’engagement. Notre Bigourdan n’accepte pas, car il veut garder sa liberté, mais il travaillera souvent pour le maître jusqu’à la mort de celui-ci, en novembre 1917. Comme ancien élève de l’École des Beaux-arts de Paris, il sera l’un des praticiens les plus actifs d’Auguste Rodin. Élève d’Auguste Dumont, il figura au Salon des Artistes français de 1884 à 1914. Membre de cette société depuis 1887, mention honorable en 1887, médaille de troisième classe en 1888, de bronze en 1889 (Exposition universelle), de deuxième classe en 1890, d’argent en 1900 (Exposition universelle). À Tarbes il participe avec Desca et Escoula à la création de « la fontaine des Quatre-Vallées », cette fontaine monumentale haute de 14 mètres, qui orne aujourd’hui le bout de la place Marcadieu, juste devant la halle du même nom. C’est le maire de l’époque, Vincent Lupau, qui fit appel à ces trois grands sculpteurs. Pour la partie fonderie, c’est Caddau qui emporta le marché : c’est lui qui fondra l’Aurore, élégante statue qui surmonte l’édifice. Elle est l’œuvre d’Escoula, et l’isard, à ses pieds, est signé Desca. On peut y voir une allégorie de Diane pour les quatres vallées : la plaine de Tarbes, la vallée d’Argelès, la vallée d’Aure et la vallée de Bagnères. Outre les vallées, il y a les rivières : l’Adour, la Neste, le Bastan et le gave. Un moulage en plâtre des torrents a reçu la médaille d’or de l’Exposition universelle de 1900 à Paris. Enfin, des animaux mythiques des Pyrénées : l’ours, le loup et l’aigle. Cette fontaine est une œuvre majeure de Tarbes. Mathet sculpta encore la fontaine de la place de la Courte Boule « L’Inondation » qui commémore la terrible crue de l’Adour qui, en 1875, fit de nombreuses victimes. Le monument représente une famille tentant de fuir la montée des eaux. Au premier plan, une jeune fille se réfugie à l’abri du corps de son père et regarde avec effroi l’eau qui bouillonne à ses pieds. Les marbres de Rodin furent parfois critiqués parce qu’il en sculpta peu lui-même. En effet, il faisait appel à des praticiens pour reproduire certaines de ses œuvres et répondre ainsi aux nombreuses commandes. Parmi ces praticiens, Louis Mathet travailla dans son atelier entre 1893 et 1910, puis entre 1916 et 1918. Il tailla notamment « La Petite fée des eaux » en 1903, « La Tempête », « Paolo et Francesca dans les nuages » en 1904, « Psyché-Pomode » en 1904-1906, « Le Secret » en 1909, ou encore « Lady Warwick » en 1909. Selon ses propres mots, le sculpteur perçoit alors son travail pour Rodin comme un véritable "mariage artistique", bien que cette collaboration ne se soit pas passée sans quelques tensions notables. Comme tous les praticiens de Rodin, Louis Mathet est également sculpteur statuaire en son nom propre. Et c’est à ce titre qu’il expose régulièrement au Salon et qu’il reçoit en 1900 une médaille d'argent à l'Exposition universelle pour « L’Inondation », groupe destiné à une fontaine tarbaise, figurant une famille en train de fuir la montée des eaux où il évoque alors le souvenir d’une crue meurtrière survenue à Tarbes en 1875. La jeune fille du relief « Aux cerises » dérive de ce groupe dramatique : le mouvement de fuite perceptible de l’enfant est justifié dans la composition initiale par les vagues qui l’assaillent de toute part, et dont la forme ondulante de la branche de cerises en partie supérieure est ici comme un souvenir. La jeune fille semble s’accrocher ou monter à un cerisier pour y cueillir des fruits qui tombent à ses pieds. Mais dans « Aux cerises », plus de drame, le regard de la jeune fille n’est plus celui de l’effroi mais de la joie et du bonheur : la scène devient bucolique et charmante, Louis Mathet opérant un détournement total du sens initial de sa figure, à l'instar d'Auguste Rodin, dont il exploite également l'esthétique du non finito. Cette œuvre se distingue pourtant nettement du style de Rodin, offrant une composition à la fois plus douce et plus décorative. Venons-en aux œuvres majeures exposées au Salon des Artistes français. « Hésitation », statue plâtre (Salon, 1887), reproduite en bronze ; « Jeune fille à la fontaine », statuette en bronze ; « Orphée et les Ménades », marbre, François-Auguste-René Rodin (Auguste Rodin), Louis Dominique Mathet (de 1903 à 1905) ; En 1887, « Hésitation » obtint une mention honorable, un grand succès populaire et le « marbre » obtient, l’année suivante, la 3e médaille. Un moulage figure au Musée Massey de Tarbes. Un autre fut placé, en 1892, dans le parc d’Argelès-Gazost ; En 1890, le plâtre d’« Oréade », nymphe des montagnes de la suite d’Artémis, est exposé. Le « bronze (1891) » et le « marbre (1903) » suivront ; En 1892, le groupe en plâtre « La première prière » obtient la médaille du Salon. Évocation du paradis terrestre, Rose Mathet l’a donné au Musée Massey ; En 1894, « Matinée de printemps » et « Flore » en 1896. De 1893 à 1897, il collabore à l’érection de la fontaine Duvignau-Bousigues, à Tarbes et réalise trois allégories : La « Plaine de Tarbes » contemple son cheval et pointe le canon de l’Arsenal, la « Vallée d’Argelès » caresse un taureau de son élevage et soutient un agnelet, enfin, la « Vallée d’Aure » joue avec son bouc et une flûte de Pan ; En 1898, il réalise pour sa ville de Tarbes, en souvenir de la terrible inondation de 1875 qui a fait fuir les riverains, « L’Inondation », groupe en marbre, inauguré le 15 avril 1901 par le sénateur Jean Dupuy, ministre de l’Agriculture. Placé sur la place Maubourguet – place de Verdun – il sera déplacé, en 1934, sur la place de la Courte Boule, face au 35e R.A.P ; Il avait spécialement conçu cette œuvre pour sa ville natale « en souvenir de l’Adour renversant nos ponts et ravageant nos campagnes ». Un très bel ensemble d’un grand réalisme et d’une grande expression qui avait donc figuré au Salon de 1898, puis à l’Exposition universelle de 1900, où il obtint une médaille d’argent. L’effroi et la stupeur sont très visibles sur chacun des visages. La nudité des personnages évoquant le dépouillement et l’impuissance face au cataclysme. Les muscles très saillants du père et de la mère rendant compte de l’effort fourni pour accéder au sommet d’un rocher. Et l’eau étant représentée sous forme de multiples vaguelettes créant de l’écume. En 1899, il expose « Peureuse » ; En 1901, c’est « Bouton de rose » buste d’enfant en marbre ; En 1907, 1912, 1918, il présente « Consolatrix », qui prendra sa forme définitive, en 1911, avec une 1ère médaille, où l’on remarque l’influence du maître Rodin, le bas-relief « Jour de fête » et « Capulet » un buste d’enfant en marbre. Que dire de notre compatriote Louis Mathet ? Ces contemporains l’ont qualifié « d’artiste habile et consciencieux ». Je crois qu’il était beaucoup plus. Sa maîtrise du ciseau sur des sujets éminemment délicats faisait de ce praticien un allégoriste et un symboliste qui excellait dans l’imitation dans le monde des idées. Bien sûr, l’époque inclinait à un réalisme dur, parfois brutal, mais tout en étant fasciné par la force des réalisations d’Auguste Rodin, son maître qu’il veillera pendant la nuit précédant les obsèques, il préserve sa personnalité et infléchit le cours de son art vers la douceur, la nuance, la féminité. « Hésitation », « Oréade », « La première prière », « Jeune fille à la fontaine », « Peureuse », sont là pour l’attester. Louis Caddau déclare au sujet de l’artiste tarbais : « Pas d’idées complexes, technique savante, modelé souple et solide à la fois, telles sont les caractéristiques du talent de Mathet, très apprécié des maîtres de la sculpture française, dont il avait été le collaborateur, et desquels il avait reçu les témoignages les plus flatteurs, les dédicaces les plus sympathiques ». La reconnaissance sera internationale. Il exposa à l’Exposition universelle de Saint-Louis en 1904, à l’Exposition universelle de Liège en 1905, à l’Exposition franco-britannique de Londres en 1908. Malgré la mort brutale de Rose Mathet, épuisée de fatigue, et la disparition de papiers personnels après le pillage de son atelier, il reste le témoignage écrit de la considération et de l’estime que portait le grand Auguste Rodin à Louis Dominique Mathet. Le maître signe ses billets : « À mon ami et collaborateur Mathet » et n’hésite pas à lui demander conseil à maintes reprises. Le Bigourdan était membre de la Société des Artistes Français. La ville de Tarbes a donné son nom en 1934 à une rue du quartier Lupau. Près d’une année durant, l’œuvre en marbre blanc de Carrare de « Aux cerises » avait été prêtée au musée Massey avant de rejoindre en 2019 le musée Rodin à Paris. Le Laloubérien fut aussi injustement accusé dans une affaire de faux-Rodin, pour laquelle le juge rendit une ordonnance de non-lieu. Une maladie de l’estomac se déclara à l’âge de 66 ans et la mort de l’artiste surviendra le 22 avril 1920.
Louis Dominique MATHET, né le 20 novembre 1853 à Laloubère et mort le 22 avril 1920, à l’âge de 66 ans. Il est le fils d'Adolphe Mathet et d'Anne Dumont. Il débute comme apprenti chez le sculpteur tarbais Menvielle, puis chez Nelli, et enfin chez Géruzet, à Bagnères-de-Bigorre, où il fut le compagnon d'Edmond Desca, de Vic-en-Bigorre, Jean-Marie Mengue, de Bagnères-de-Luchon et Barras, un intime. Il suit les cours de dessin et de modelage du maître Maurice Journès, pour qui il gardera une amitié sincère. Le rêve d'un jeune marbrier n'est pas de se satisfaire de sa condition d'ouvrier mais de voir si une vocation de sculpteur n'apparaîtrait pas avec la pratique. Mathet et Barras voyagent en compagnie un certain temps et deviennent « cheminots de l'art », selon la juste expression de l'architecte diocésain Louis Caddau. À petites étapes, ils gagnent Poitiers, où ils se séparent. Mathet continue sur Paris. Un parent l'y accueille, ce qui facilite ses débuts dans la capitale. Très vite il cherche à s'embaucher dans un atelier, soucieux de ne pas être à la charge de la parenté. Il se lie d'amitié avec Agathon Léonard, sculpteur d'origine belge naturalisé français et auteur des célèbres « Petites Danseuses ». La progression dans la qualité de son travail lui permet d'être engagé dans l'atelier d’Auguste Dumont, à l'École des Beaux-Arts, où celui-ci enseigne. Là, il peut vraiment se dévouer à son art naissant : matinée consacrée aux études et le reste de la journée à un travail rétribué. Puis, vient le moment de servir le pays. Engagement au 8e régiment de hussards (8e RH), de 1874 à 1878. Cinq années de perdues. Il descend à Tarbes pour se marier le 7 juin 1879 avec Rose Bégarie, tailleuse de robes et originaire d'Argelès-Gazost. Le jeune marié a 25 ans et son témoin principal est le sculpteur Joseph Dupont, âgé lui de 26 ans. Louis Mathet, accompagné de son épouse, remonte à Paris. Un atelier, où les praticiens travaillent pour Eugène Guillaume, le remarque. Le maître des lieux, Eugène Guillaume, est l'auteur de deux chefs-d'œuvre : « La Musique instrumentale », en façade principale de l'Opéra Garnier, et « Anacréon », au musée d'Orsay. Pourquoi Eugène Guillaume, artiste confirmé, critique d'art, professeur au Collège de France, membre de l'Académie française et directeur de l'École des beaux-arts de Paris s’intéresse-t-il à Louis Mathet ? À ses yeux, sa façon de manier le ciseau le désigne pour succéder à son chef d’atelier qui vient de mourir. Le Bigourdan accepte avec empressement. Guillaume se prend d’affection pour Mathet et lui manifestera son amitié jusqu’à sa mort, en 1905. L’existence matérielle du jeune artiste est alors assurée. Tout naturellement, il vient à créer son propre atelier. Des bustes puis des statuettes sont présentés aux Salons des Artistes français. Après le décès d’Eugène Guillaume, Auguste Rodin veut tester le tarbais en lui demandant de l’aider à terminer un groupe. Peut-être s’agissait-il d’« Orphée et les Ménades », qui fut réalisé à trois avec Frédéric Ganier, entre 1903 et 1905 ? Le résultat est probant puisqu’il lui fait une proposition d’engagement. Notre Bigourdan n’accepte pas, car il veut garder sa liberté, mais il travaillera souvent pour le maître jusqu’à la mort de celui-ci, en novembre 1917. Comme ancien élève de l’École des Beaux-arts de Paris, il sera l’un des praticiens les plus actifs d’Auguste Rodin. Élève d’Auguste Dumont, il figura au Salon des Artistes français de 1884 à 1914. Membre de cette société depuis 1887, mention honorable en 1887, médaille de troisième classe en 1888, de bronze en 1889 (Exposition universelle), de deuxième classe en 1890, d’argent en 1900 (Exposition universelle). À Tarbes il participe avec Desca et Escoula à la création de « la fontaine des Quatre-Vallées », cette fontaine monumentale haute de 14 mètres, qui orne aujourd’hui le bout de la place Marcadieu, juste devant la halle du même nom. C’est le maire de l’époque, Vincent Lupau, qui fit appel à ces trois grands sculpteurs. Pour la partie fonderie, c’est Caddau qui emporta le marché : c’est lui qui fondra l’Aurore, élégante statue qui surmonte l’édifice. Elle est l’œuvre d’Escoula, et l’isard, à ses pieds, est signé Desca. On peut y voir une allégorie de Diane pour les quatres vallées : la plaine de Tarbes, la vallée d’Argelès, la vallée d’Aure et la vallée de Bagnères. Outre les vallées, il y a les rivières : l’Adour, la Neste, le Bastan et le gave. Un moulage en plâtre des torrents a reçu la médaille d’or de l’Exposition universelle de 1900 à Paris. Enfin, des animaux mythiques des Pyrénées : l’ours, le loup et l’aigle. Cette fontaine est une œuvre majeure de Tarbes. Mathet sculpta encore la fontaine de la place de la Courte Boule « L’Inondation » qui commémore la terrible crue de l’Adour qui, en 1875, fit de nombreuses victimes. Le monument représente une famille tentant de fuir la montée des eaux. Au premier plan, une jeune fille se réfugie à l’abri du corps de son père et regarde avec effroi l’eau qui bouillonne à ses pieds. Les marbres de Rodin furent parfois critiqués parce qu’il en sculpta peu lui-même. En effet, il faisait appel à des praticiens pour reproduire certaines de ses œuvres et répondre ainsi aux nombreuses commandes. Parmi ces praticiens, Louis Mathet travailla dans son atelier entre 1893 et 1910, puis entre 1916 et 1918. Il tailla notamment « La Petite fée des eaux » en 1903, « La Tempête », « Paolo et Francesca dans les nuages » en 1904, « Psyché-Pomode » en 1904-1906, « Le Secret » en 1909, ou encore « Lady Warwick » en 1909. Selon ses propres mots, le sculpteur perçoit alors son travail pour Rodin comme un véritable "mariage artistique", bien que cette collaboration ne se soit pas passée sans quelques tensions notables. Comme tous les praticiens de Rodin, Louis Mathet est également sculpteur statuaire en son nom propre. Et c’est à ce titre qu’il expose régulièrement au Salon et qu’il reçoit en 1900 une médaille d'argent à l'Exposition universelle pour « L’Inondation », groupe destiné à une fontaine tarbaise, figurant une famille en train de fuir la montée des eaux où il évoque alors le souvenir d’une crue meurtrière survenue à Tarbes en 1875. La jeune fille du relief « Aux cerises » dérive de ce groupe dramatique : le mouvement de fuite perceptible de l’enfant est justifié dans la composition initiale par les vagues qui l’assaillent de toute part, et dont la forme ondulante de la branche de cerises en partie supérieure est ici comme un souvenir. La jeune fille semble s’accrocher ou monter à un cerisier pour y cueillir des fruits qui tombent à ses pieds. Mais dans « Aux cerises », plus de drame, le regard de la jeune fille n’est plus celui de l’effroi mais de la joie et du bonheur : la scène devient bucolique et charmante, Louis Mathet opérant un détournement total du sens initial de sa figure, à l'instar d'Auguste Rodin, dont il exploite également l'esthétique du non finito. Cette œuvre se distingue pourtant nettement du style de Rodin, offrant une composition à la fois plus douce et plus décorative. Venons-en aux œuvres majeures exposées au Salon des Artistes français. « Hésitation », statue plâtre (Salon, 1887), reproduite en bronze ; « Jeune fille à la fontaine », statuette en bronze ; « Orphée et les Ménades », marbre, François-Auguste-René Rodin (Auguste Rodin), Louis Dominique Mathet (de 1903 à 1905) ; En 1887, « Hésitation » obtint une mention honorable, un grand succès populaire et le « marbre » obtient, l’année suivante, la 3e médaille. Un moulage figure au Musée Massey de Tarbes. Un autre fut placé, en 1892, dans le parc d’Argelès-Gazost ; En 1890, le plâtre d’« Oréade », nymphe des montagnes de la suite d’Artémis, est exposé. Le « bronze (1891) » et le « marbre (1903) » suivront ; En 1892, le groupe en plâtre « La première prière » obtient la médaille du Salon. Évocation du paradis terrestre, Rose Mathet l’a donné au Musée Massey ; En 1894, « Matinée de printemps » et « Flore » en 1896. De 1893 à 1897, il collabore à l’érection de la fontaine Duvignau-Bousigues, à Tarbes et réalise trois allégories : La « Plaine de Tarbes » contemple son cheval et pointe le canon de l’Arsenal, la « Vallée d’Argelès » caresse un taureau de son élevage et soutient un agnelet, enfin, la « Vallée d’Aure » joue avec son bouc et une flûte de Pan ; En 1898, il réalise pour sa ville de Tarbes, en souvenir de la terrible inondation de 1875 qui a fait fuir les riverains, « L’Inondation », groupe en marbre, inauguré le 15 avril 1901 par le sénateur Jean Dupuy, ministre de l’Agriculture. Placé sur la place Maubourguet – place de Verdun – il sera déplacé, en 1934, sur la place de la Courte Boule, face au 35e R.A.P ; Il avait spécialement conçu cette œuvre pour sa ville natale « en souvenir de l’Adour renversant nos ponts et ravageant nos campagnes ». Un très bel ensemble d’un grand réalisme et d’une grande expression qui avait donc figuré au Salon de 1898, puis à l’Exposition universelle de 1900, où il obtint une médaille d’argent. L’effroi et la stupeur sont très visibles sur chacun des visages. La nudité des personnages évoquant le dépouillement et l’impuissance face au cataclysme. Les muscles très saillants du père et de la mère rendant compte de l’effort fourni pour accéder au sommet d’un rocher. Et l’eau étant représentée sous forme de multiples vaguelettes créant de l’écume. En 1899, il expose « Peureuse » ; En 1901, c’est « Bouton de rose » buste d’enfant en marbre ; En 1907, 1912, 1918, il présente « Consolatrix », qui prendra sa forme définitive, en 1911, avec une 1ère médaille, où l’on remarque l’influence du maître Rodin, le bas-relief « Jour de fête » et « Capulet » un buste d’enfant en marbre. Que dire de notre compatriote Louis Mathet ? Ces contemporains l’ont qualifié « d’artiste habile et consciencieux ». Je crois qu’il était beaucoup plus. Sa maîtrise du ciseau sur des sujets éminemment délicats faisait de ce praticien un allégoriste et un symboliste qui excellait dans l’imitation dans le monde des idées. Bien sûr, l’époque inclinait à un réalisme dur, parfois brutal, mais tout en étant fasciné par la force des réalisations d’Auguste Rodin, son maître qu’il veillera pendant la nuit précédant les obsèques, il préserve sa personnalité et infléchit le cours de son art vers la douceur, la nuance, la féminité. « Hésitation », « Oréade », « La première prière », « Jeune fille à la fontaine », « Peureuse », sont là pour l’attester. Louis Caddau déclare au sujet de l’artiste tarbais : « Pas d’idées complexes, technique savante, modelé souple et solide à la fois, telles sont les caractéristiques du talent de Mathet, très apprécié des maîtres de la sculpture française, dont il avait été le collaborateur, et desquels il avait reçu les témoignages les plus flatteurs, les dédicaces les plus sympathiques ». La reconnaissance sera internationale. Il exposa à l’Exposition universelle de Saint-Louis en 1904, à l’Exposition universelle de Liège en 1905, à l’Exposition franco-britannique de Londres en 1908. Malgré la mort brutale de Rose Mathet, épuisée de fatigue, et la disparition de papiers personnels après le pillage de son atelier, il reste le témoignage écrit de la considération et de l’estime que portait le grand Auguste Rodin à Louis Dominique Mathet. Le maître signe ses billets : « À mon ami et collaborateur Mathet » et n’hésite pas à lui demander conseil à maintes reprises. Le Bigourdan était membre de la Société des Artistes Français. La ville de Tarbes a donné son nom en 1934 à une rue du quartier Lupau. Près d’une année durant, l’œuvre en marbre blanc de Carrare de « Aux cerises » avait été prêtée au musée Massey avant de rejoindre en 2019 le musée Rodin à Paris. Le Laloubérien fut aussi injustement accusé dans une affaire de faux-Rodin, pour laquelle le juge rendit une ordonnance de non-lieu. Une maladie de l’estomac se déclara à l’âge de 66 ans et la mort de l’artiste surviendra le 22 avril 1920.
 Louis Dominique MATHET, né le 20 novembre 1853 à Laloubère et mort le 22 avril 1920, à l’âge de 66 ans. Il est le fils d'Adolphe Mathet et d'Anne Dumont. Il débute comme apprenti chez le sculpteur tarbais Menvielle, puis chez Nelli, et enfin chez Géruzet, à Bagnères-de-Bigorre, où il fut le compagnon d'Edmond Desca, de Vic-en-Bigorre, Jean-Marie Mengue, de Bagnères-de-Luchon et Barras, un intime. Il suit les cours de dessin et de modelage du maître Maurice Journès, pour qui il gardera une amitié sincère. Le rêve d'un jeune marbrier n'est pas de se satisfaire de sa condition d'ouvrier mais de voir si une vocation de sculpteur n'apparaîtrait pas avec la pratique. Mathet et Barras voyagent en compagnie un certain temps et deviennent « cheminots de l'art », selon la juste expression de l'architecte diocésain Louis Caddau. À petites étapes, ils gagnent Poitiers, où ils se séparent. Mathet continue sur Paris. Un parent l'y accueille, ce qui facilite ses débuts dans la capitale. Très vite il cherche à s'embaucher dans un atelier, soucieux de ne pas être à la charge de la parenté. Il se lie d'amitié avec Agathon Léonard, sculpteur d'origine belge naturalisé français et auteur des célèbres « Petites Danseuses ». La progression dans la qualité de son travail lui permet d'être engagé dans l'atelier d’Auguste Dumont, à l'École des Beaux-Arts, où celui-ci enseigne. Là, il peut vraiment se dévouer à son art naissant : matinée consacrée aux études et le reste de la journée à un travail rétribué. Puis, vient le moment de servir le pays. Engagement au 8e régiment de hussards (8e RH), de 1874 à 1878. Cinq années de perdues. Il descend à Tarbes pour se marier le 7 juin 1879 avec Rose Bégarie, tailleuse de robes et originaire d'Argelès-Gazost. Le jeune marié a 25 ans et son témoin principal est le sculpteur Joseph Dupont, âgé lui de 26 ans. Louis Mathet, accompagné de son épouse, remonte à Paris. Un atelier, où les praticiens travaillent pour Eugène Guillaume, le remarque. Le maître des lieux, Eugène Guillaume, est l'auteur de deux chefs-d'œuvre : « La Musique instrumentale », en façade principale de l'Opéra Garnier, et « Anacréon », au musée d'Orsay. Pourquoi Eugène Guillaume, artiste confirmé, critique d'art, professeur au Collège de France, membre de l'Académie française et directeur de l'École des beaux-arts de Paris s’intéresse-t-il à Louis Mathet ? À ses yeux, sa façon de manier le ciseau le désigne pour succéder à son chef d’atelier qui vient de mourir. Le Bigourdan accepte avec empressement. Guillaume se prend d’affection pour Mathet et lui manifestera son amitié jusqu’à sa mort, en 1905. L’existence matérielle du jeune artiste est alors assurée. Tout naturellement, il vient à créer son propre atelier. Des bustes puis des statuettes sont présentés aux Salons des Artistes français. Après le décès d’Eugène Guillaume, Auguste Rodin veut tester le tarbais en lui demandant de l’aider à terminer un groupe. Peut-être s’agissait-il d’« Orphée et les Ménades », qui fut réalisé à trois avec Frédéric Ganier, entre 1903 et 1905 ? Le résultat est probant puisqu’il lui fait une proposition d’engagement. Notre Bigourdan n’accepte pas, car il veut garder sa liberté, mais il travaillera souvent pour le maître jusqu’à la mort de celui-ci, en novembre 1917. Comme ancien élève de l’École des Beaux-arts de Paris, il sera l’un des praticiens les plus actifs d’Auguste Rodin. Élève d’Auguste Dumont, il figura au Salon des Artistes français de 1884 à 1914. Membre de cette société depuis 1887, mention honorable en 1887, médaille de troisième classe en 1888, de bronze en 1889 (Exposition universelle), de deuxième classe en 1890, d’argent en 1900 (Exposition universelle). À Tarbes il participe avec Desca et Escoula à la création de « la fontaine des Quatre-Vallées », cette fontaine monumentale haute de 14 mètres, qui orne aujourd’hui le bout de la place Marcadieu, juste devant la halle du même nom. C’est le maire de l’époque, Vincent Lupau, qui fit appel à ces trois grands sculpteurs. Pour la partie fonderie, c’est Caddau qui emporta le marché : c’est lui qui fondra l’Aurore, élégante statue qui surmonte l’édifice. Elle est l’œuvre d’Escoula, et l’isard, à ses pieds, est signé Desca. On peut y voir une allégorie de Diane pour les quatres vallées : la plaine de Tarbes, la vallée d’Argelès, la vallée d’Aure et la vallée de Bagnères. Outre les vallées, il y a les rivières : l’Adour, la Neste, le Bastan et le gave. Un moulage en plâtre des torrents a reçu la médaille d’or de l’Exposition universelle de 1900 à Paris. Enfin, des animaux mythiques des Pyrénées : l’ours, le loup et l’aigle. Cette fontaine est une œuvre majeure de Tarbes. Mathet sculpta encore la fontaine de la place de la Courte Boule « L’Inondation » qui commémore la terrible crue de l’Adour qui, en 1875, fit de nombreuses victimes. Le monument représente une famille tentant de fuir la montée des eaux. Au premier plan, une jeune fille se réfugie à l’abri du corps de son père et regarde avec effroi l’eau qui bouillonne à ses pieds. Les marbres de Rodin furent parfois critiqués parce qu’il en sculpta peu lui-même. En effet, il faisait appel à des praticiens pour reproduire certaines de ses œuvres et répondre ainsi aux nombreuses commandes. Parmi ces praticiens, Louis Mathet travailla dans son atelier entre 1893 et 1910, puis entre 1916 et 1918. Il tailla notamment « La Petite fée des eaux » en 1903, « La Tempête », « Paolo et Francesca dans les nuages » en 1904, « Psyché-Pomode » en 1904-1906, « Le Secret » en 1909, ou encore « Lady Warwick » en 1909. Selon ses propres mots, le sculpteur perçoit alors son travail pour Rodin comme un véritable "mariage artistique", bien que cette collaboration ne se soit pas passée sans quelques tensions notables. Comme tous les praticiens de Rodin, Louis Mathet est également sculpteur statuaire en son nom propre. Et c’est à ce titre qu’il expose régulièrement au Salon et qu’il reçoit en 1900 une médaille d'argent à l'Exposition universelle pour « L’Inondation », groupe destiné à une fontaine tarbaise, figurant une famille en train de fuir la montée des eaux où il évoque alors le souvenir d’une crue meurtrière survenue à Tarbes en 1875. La jeune fille du relief « Aux cerises » dérive de ce groupe dramatique : le mouvement de fuite perceptible de l’enfant est justifié dans la composition initiale par les vagues qui l’assaillent de toute part, et dont la forme ondulante de la branche de cerises en partie supérieure est ici comme un souvenir. La jeune fille semble s’accrocher ou monter à un cerisier pour y cueillir des fruits qui tombent à ses pieds. Mais dans « Aux cerises », plus de drame, le regard de la jeune fille n’est plus celui de l’effroi mais de la joie et du bonheur : la scène devient bucolique et charmante, Louis Mathet opérant un détournement total du sens initial de sa figure, à l'instar d'Auguste Rodin, dont il exploite également l'esthétique du non finito. Cette œuvre se distingue pourtant nettement du style de Rodin, offrant une composition à la fois plus douce et plus décorative. Venons-en aux œuvres majeures exposées au Salon des Artistes français. « Hésitation », statue plâtre (Salon, 1887), reproduite en bronze ; « Jeune fille à la fontaine », statuette en bronze ; « Orphée et les Ménades », marbre, François-Auguste-René Rodin (Auguste Rodin), Louis Dominique Mathet (de 1903 à 1905) ; En 1887, « Hésitation » obtint une mention honorable, un grand succès populaire et le « marbre » obtient, l’année suivante, la 3e médaille. Un moulage figure au Musée Massey de Tarbes. Un autre fut placé, en 1892, dans le parc d’Argelès-Gazost ; En 1890, le plâtre d’« Oréade », nymphe des montagnes de la suite d’Artémis, est exposé. Le « bronze (1891) » et le « marbre (1903) » suivront ; En 1892, le groupe en plâtre « La première prière » obtient la médaille du Salon. Évocation du paradis terrestre, Rose Mathet l’a donné au Musée Massey ; En 1894, « Matinée de printemps » et « Flore » en 1896. De 1893 à 1897, il collabore à l’érection de la fontaine Duvignau-Bousigues, à Tarbes et réalise trois allégories : La « Plaine de Tarbes » contemple son cheval et pointe le canon de l’Arsenal, la « Vallée d’Argelès » caresse un taureau de son élevage et soutient un agnelet, enfin, la « Vallée d’Aure » joue avec son bouc et une flûte de Pan ; En 1898, il réalise pour sa ville de Tarbes, en souvenir de la terrible inondation de 1875 qui a fait fuir les riverains, « L’Inondation », groupe en marbre, inauguré le 15 avril 1901 par le sénateur Jean Dupuy, ministre de l’Agriculture. Placé sur la place Maubourguet – place de Verdun – il sera déplacé, en 1934, sur la place de la Courte Boule, face au 35e R.A.P ; Il avait spécialement conçu cette œuvre pour sa ville natale « en souvenir de l’Adour renversant nos ponts et ravageant nos campagnes ». Un très bel ensemble d’un grand réalisme et d’une grande expression qui avait donc figuré au Salon de 1898, puis à l’Exposition universelle de 1900, où il obtint une médaille d’argent. L’effroi et la stupeur sont très visibles sur chacun des visages. La nudité des personnages évoquant le dépouillement et l’impuissance face au cataclysme. Les muscles très saillants du père et de la mère rendant compte de l’effort fourni pour accéder au sommet d’un rocher. Et l’eau étant représentée sous forme de multiples vaguelettes créant de l’écume. En 1899, il expose « Peureuse » ; En 1901, c’est « Bouton de rose » buste d’enfant en marbre ; En 1907, 1912, 1918, il présente « Consolatrix », qui prendra sa forme définitive, en 1911, avec une 1ère médaille, où l’on remarque l’influence du maître Rodin, le bas-relief « Jour de fête » et « Capulet » un buste d’enfant en marbre. Que dire de notre compatriote Louis Mathet ? Ces contemporains l’ont qualifié « d’artiste habile et consciencieux ». Je crois qu’il était beaucoup plus. Sa maîtrise du ciseau sur des sujets éminemment délicats faisait de ce praticien un allégoriste et un symboliste qui excellait dans l’imitation dans le monde des idées. Bien sûr, l’époque inclinait à un réalisme dur, parfois brutal, mais tout en étant fasciné par la force des réalisations d’Auguste Rodin, son maître qu’il veillera pendant la nuit précédant les obsèques, il préserve sa personnalité et infléchit le cours de son art vers la douceur, la nuance, la féminité. « Hésitation », « Oréade », « La première prière », « Jeune fille à la fontaine », « Peureuse », sont là pour l’attester. Louis Caddau déclare au sujet de l’artiste tarbais : « Pas d’idées complexes, technique savante, modelé souple et solide à la fois, telles sont les caractéristiques du talent de Mathet, très apprécié des maîtres de la sculpture française, dont il avait été le collaborateur, et desquels il avait reçu les témoignages les plus flatteurs, les dédicaces les plus sympathiques ». La reconnaissance sera internationale. Il exposa à l’Exposition universelle de Saint-Louis en 1904, à l’Exposition universelle de Liège en 1905, à l’Exposition franco-britannique de Londres en 1908. Malgré la mort brutale de Rose Mathet, épuisée de fatigue, et la disparition de papiers personnels après le pillage de son atelier, il reste le témoignage écrit de la considération et de l’estime que portait le grand Auguste Rodin à Louis Dominique Mathet. Le maître signe ses billets : « À mon ami et collaborateur Mathet » et n’hésite pas à lui demander conseil à maintes reprises. Le Bigourdan était membre de la Société des Artistes Français. La ville de Tarbes a donné son nom en 1934 à une rue du quartier Lupau. Près d’une année durant, l’œuvre en marbre blanc de Carrare de « Aux cerises » avait été prêtée au musée Massey avant de rejoindre en 2019 le musée Rodin à Paris. Le Laloubérien fut aussi injustement accusé dans une affaire de faux-Rodin, pour laquelle le juge rendit une ordonnance de non-lieu. Une maladie de l’estomac se déclara à l’âge de 66 ans et la mort de l’artiste surviendra le 22 avril 1920.
Louis Dominique MATHET, né le 20 novembre 1853 à Laloubère et mort le 22 avril 1920, à l’âge de 66 ans. Il est le fils d'Adolphe Mathet et d'Anne Dumont. Il débute comme apprenti chez le sculpteur tarbais Menvielle, puis chez Nelli, et enfin chez Géruzet, à Bagnères-de-Bigorre, où il fut le compagnon d'Edmond Desca, de Vic-en-Bigorre, Jean-Marie Mengue, de Bagnères-de-Luchon et Barras, un intime. Il suit les cours de dessin et de modelage du maître Maurice Journès, pour qui il gardera une amitié sincère. Le rêve d'un jeune marbrier n'est pas de se satisfaire de sa condition d'ouvrier mais de voir si une vocation de sculpteur n'apparaîtrait pas avec la pratique. Mathet et Barras voyagent en compagnie un certain temps et deviennent « cheminots de l'art », selon la juste expression de l'architecte diocésain Louis Caddau. À petites étapes, ils gagnent Poitiers, où ils se séparent. Mathet continue sur Paris. Un parent l'y accueille, ce qui facilite ses débuts dans la capitale. Très vite il cherche à s'embaucher dans un atelier, soucieux de ne pas être à la charge de la parenté. Il se lie d'amitié avec Agathon Léonard, sculpteur d'origine belge naturalisé français et auteur des célèbres « Petites Danseuses ». La progression dans la qualité de son travail lui permet d'être engagé dans l'atelier d’Auguste Dumont, à l'École des Beaux-Arts, où celui-ci enseigne. Là, il peut vraiment se dévouer à son art naissant : matinée consacrée aux études et le reste de la journée à un travail rétribué. Puis, vient le moment de servir le pays. Engagement au 8e régiment de hussards (8e RH), de 1874 à 1878. Cinq années de perdues. Il descend à Tarbes pour se marier le 7 juin 1879 avec Rose Bégarie, tailleuse de robes et originaire d'Argelès-Gazost. Le jeune marié a 25 ans et son témoin principal est le sculpteur Joseph Dupont, âgé lui de 26 ans. Louis Mathet, accompagné de son épouse, remonte à Paris. Un atelier, où les praticiens travaillent pour Eugène Guillaume, le remarque. Le maître des lieux, Eugène Guillaume, est l'auteur de deux chefs-d'œuvre : « La Musique instrumentale », en façade principale de l'Opéra Garnier, et « Anacréon », au musée d'Orsay. Pourquoi Eugène Guillaume, artiste confirmé, critique d'art, professeur au Collège de France, membre de l'Académie française et directeur de l'École des beaux-arts de Paris s’intéresse-t-il à Louis Mathet ? À ses yeux, sa façon de manier le ciseau le désigne pour succéder à son chef d’atelier qui vient de mourir. Le Bigourdan accepte avec empressement. Guillaume se prend d’affection pour Mathet et lui manifestera son amitié jusqu’à sa mort, en 1905. L’existence matérielle du jeune artiste est alors assurée. Tout naturellement, il vient à créer son propre atelier. Des bustes puis des statuettes sont présentés aux Salons des Artistes français. Après le décès d’Eugène Guillaume, Auguste Rodin veut tester le tarbais en lui demandant de l’aider à terminer un groupe. Peut-être s’agissait-il d’« Orphée et les Ménades », qui fut réalisé à trois avec Frédéric Ganier, entre 1903 et 1905 ? Le résultat est probant puisqu’il lui fait une proposition d’engagement. Notre Bigourdan n’accepte pas, car il veut garder sa liberté, mais il travaillera souvent pour le maître jusqu’à la mort de celui-ci, en novembre 1917. Comme ancien élève de l’École des Beaux-arts de Paris, il sera l’un des praticiens les plus actifs d’Auguste Rodin. Élève d’Auguste Dumont, il figura au Salon des Artistes français de 1884 à 1914. Membre de cette société depuis 1887, mention honorable en 1887, médaille de troisième classe en 1888, de bronze en 1889 (Exposition universelle), de deuxième classe en 1890, d’argent en 1900 (Exposition universelle). À Tarbes il participe avec Desca et Escoula à la création de « la fontaine des Quatre-Vallées », cette fontaine monumentale haute de 14 mètres, qui orne aujourd’hui le bout de la place Marcadieu, juste devant la halle du même nom. C’est le maire de l’époque, Vincent Lupau, qui fit appel à ces trois grands sculpteurs. Pour la partie fonderie, c’est Caddau qui emporta le marché : c’est lui qui fondra l’Aurore, élégante statue qui surmonte l’édifice. Elle est l’œuvre d’Escoula, et l’isard, à ses pieds, est signé Desca. On peut y voir une allégorie de Diane pour les quatres vallées : la plaine de Tarbes, la vallée d’Argelès, la vallée d’Aure et la vallée de Bagnères. Outre les vallées, il y a les rivières : l’Adour, la Neste, le Bastan et le gave. Un moulage en plâtre des torrents a reçu la médaille d’or de l’Exposition universelle de 1900 à Paris. Enfin, des animaux mythiques des Pyrénées : l’ours, le loup et l’aigle. Cette fontaine est une œuvre majeure de Tarbes. Mathet sculpta encore la fontaine de la place de la Courte Boule « L’Inondation » qui commémore la terrible crue de l’Adour qui, en 1875, fit de nombreuses victimes. Le monument représente une famille tentant de fuir la montée des eaux. Au premier plan, une jeune fille se réfugie à l’abri du corps de son père et regarde avec effroi l’eau qui bouillonne à ses pieds. Les marbres de Rodin furent parfois critiqués parce qu’il en sculpta peu lui-même. En effet, il faisait appel à des praticiens pour reproduire certaines de ses œuvres et répondre ainsi aux nombreuses commandes. Parmi ces praticiens, Louis Mathet travailla dans son atelier entre 1893 et 1910, puis entre 1916 et 1918. Il tailla notamment « La Petite fée des eaux » en 1903, « La Tempête », « Paolo et Francesca dans les nuages » en 1904, « Psyché-Pomode » en 1904-1906, « Le Secret » en 1909, ou encore « Lady Warwick » en 1909. Selon ses propres mots, le sculpteur perçoit alors son travail pour Rodin comme un véritable "mariage artistique", bien que cette collaboration ne se soit pas passée sans quelques tensions notables. Comme tous les praticiens de Rodin, Louis Mathet est également sculpteur statuaire en son nom propre. Et c’est à ce titre qu’il expose régulièrement au Salon et qu’il reçoit en 1900 une médaille d'argent à l'Exposition universelle pour « L’Inondation », groupe destiné à une fontaine tarbaise, figurant une famille en train de fuir la montée des eaux où il évoque alors le souvenir d’une crue meurtrière survenue à Tarbes en 1875. La jeune fille du relief « Aux cerises » dérive de ce groupe dramatique : le mouvement de fuite perceptible de l’enfant est justifié dans la composition initiale par les vagues qui l’assaillent de toute part, et dont la forme ondulante de la branche de cerises en partie supérieure est ici comme un souvenir. La jeune fille semble s’accrocher ou monter à un cerisier pour y cueillir des fruits qui tombent à ses pieds. Mais dans « Aux cerises », plus de drame, le regard de la jeune fille n’est plus celui de l’effroi mais de la joie et du bonheur : la scène devient bucolique et charmante, Louis Mathet opérant un détournement total du sens initial de sa figure, à l'instar d'Auguste Rodin, dont il exploite également l'esthétique du non finito. Cette œuvre se distingue pourtant nettement du style de Rodin, offrant une composition à la fois plus douce et plus décorative. Venons-en aux œuvres majeures exposées au Salon des Artistes français. « Hésitation », statue plâtre (Salon, 1887), reproduite en bronze ; « Jeune fille à la fontaine », statuette en bronze ; « Orphée et les Ménades », marbre, François-Auguste-René Rodin (Auguste Rodin), Louis Dominique Mathet (de 1903 à 1905) ; En 1887, « Hésitation » obtint une mention honorable, un grand succès populaire et le « marbre » obtient, l’année suivante, la 3e médaille. Un moulage figure au Musée Massey de Tarbes. Un autre fut placé, en 1892, dans le parc d’Argelès-Gazost ; En 1890, le plâtre d’« Oréade », nymphe des montagnes de la suite d’Artémis, est exposé. Le « bronze (1891) » et le « marbre (1903) » suivront ; En 1892, le groupe en plâtre « La première prière » obtient la médaille du Salon. Évocation du paradis terrestre, Rose Mathet l’a donné au Musée Massey ; En 1894, « Matinée de printemps » et « Flore » en 1896. De 1893 à 1897, il collabore à l’érection de la fontaine Duvignau-Bousigues, à Tarbes et réalise trois allégories : La « Plaine de Tarbes » contemple son cheval et pointe le canon de l’Arsenal, la « Vallée d’Argelès » caresse un taureau de son élevage et soutient un agnelet, enfin, la « Vallée d’Aure » joue avec son bouc et une flûte de Pan ; En 1898, il réalise pour sa ville de Tarbes, en souvenir de la terrible inondation de 1875 qui a fait fuir les riverains, « L’Inondation », groupe en marbre, inauguré le 15 avril 1901 par le sénateur Jean Dupuy, ministre de l’Agriculture. Placé sur la place Maubourguet – place de Verdun – il sera déplacé, en 1934, sur la place de la Courte Boule, face au 35e R.A.P ; Il avait spécialement conçu cette œuvre pour sa ville natale « en souvenir de l’Adour renversant nos ponts et ravageant nos campagnes ». Un très bel ensemble d’un grand réalisme et d’une grande expression qui avait donc figuré au Salon de 1898, puis à l’Exposition universelle de 1900, où il obtint une médaille d’argent. L’effroi et la stupeur sont très visibles sur chacun des visages. La nudité des personnages évoquant le dépouillement et l’impuissance face au cataclysme. Les muscles très saillants du père et de la mère rendant compte de l’effort fourni pour accéder au sommet d’un rocher. Et l’eau étant représentée sous forme de multiples vaguelettes créant de l’écume. En 1899, il expose « Peureuse » ; En 1901, c’est « Bouton de rose » buste d’enfant en marbre ; En 1907, 1912, 1918, il présente « Consolatrix », qui prendra sa forme définitive, en 1911, avec une 1ère médaille, où l’on remarque l’influence du maître Rodin, le bas-relief « Jour de fête » et « Capulet » un buste d’enfant en marbre. Que dire de notre compatriote Louis Mathet ? Ces contemporains l’ont qualifié « d’artiste habile et consciencieux ». Je crois qu’il était beaucoup plus. Sa maîtrise du ciseau sur des sujets éminemment délicats faisait de ce praticien un allégoriste et un symboliste qui excellait dans l’imitation dans le monde des idées. Bien sûr, l’époque inclinait à un réalisme dur, parfois brutal, mais tout en étant fasciné par la force des réalisations d’Auguste Rodin, son maître qu’il veillera pendant la nuit précédant les obsèques, il préserve sa personnalité et infléchit le cours de son art vers la douceur, la nuance, la féminité. « Hésitation », « Oréade », « La première prière », « Jeune fille à la fontaine », « Peureuse », sont là pour l’attester. Louis Caddau déclare au sujet de l’artiste tarbais : « Pas d’idées complexes, technique savante, modelé souple et solide à la fois, telles sont les caractéristiques du talent de Mathet, très apprécié des maîtres de la sculpture française, dont il avait été le collaborateur, et desquels il avait reçu les témoignages les plus flatteurs, les dédicaces les plus sympathiques ». La reconnaissance sera internationale. Il exposa à l’Exposition universelle de Saint-Louis en 1904, à l’Exposition universelle de Liège en 1905, à l’Exposition franco-britannique de Londres en 1908. Malgré la mort brutale de Rose Mathet, épuisée de fatigue, et la disparition de papiers personnels après le pillage de son atelier, il reste le témoignage écrit de la considération et de l’estime que portait le grand Auguste Rodin à Louis Dominique Mathet. Le maître signe ses billets : « À mon ami et collaborateur Mathet » et n’hésite pas à lui demander conseil à maintes reprises. Le Bigourdan était membre de la Société des Artistes Français. La ville de Tarbes a donné son nom en 1934 à une rue du quartier Lupau. Près d’une année durant, l’œuvre en marbre blanc de Carrare de « Aux cerises » avait été prêtée au musée Massey avant de rejoindre en 2019 le musée Rodin à Paris. Le Laloubérien fut aussi injustement accusé dans une affaire de faux-Rodin, pour laquelle le juge rendit une ordonnance de non-lieu. Une maladie de l’estomac se déclara à l’âge de 66 ans et la mort de l’artiste surviendra le 22 avril 1920.MESPLÉ Mady (1931-2020)
Cantatrice soprano à la notoriété internationale qui avait aussi ses habitudes à Saint-Lary-Soulan
 Mady MESPLÉ, née le 7 mars 1931 à Toulouse dans une famille de mélomanes et qui est décédée, le 30 mai 2020, à l’âge de 89 ans dans cette même ville. Grande voix cristalline de l'opéra des années 1950 à la fin des années 1970, elle a été une des premières cantatrices françaises à avoir une carrière internationale. Ils ne sont pas si fréquents les musiciens qui ont su honorer avec une égale ferveur l’opérette, le style baroque et la musique contemporaine, et porter les couleurs de l’art lyrique sur les scènes internationales comme sur les grands plateaux de télévision. Ainsi pendant sa carrière, sa passion pour la musique l’a conduite à aborder tous les répertoires : opérette, opéra, musique contemporaine. Telle était Mady Mesplé. Dès son plus jeune âge, à 4 ans, sa mère l’emmène à l’opéra. Une vraie révélation pour Mady qui restera fidèle au Capitole toute sa vie. « J’ai eu le choc de ma vie, à l’âge de quatre ans, en assistant à une représentation de Faust au Capitole de Toulouse… » confiera-t-elle. Très rapidement, elle enchaîne avec du solfège, puis des cours de piano. Bercée par le Bel Canto, elle montre des dons fascinants, un professeur vient même à domicile pour lui donner des cours tant et si bien qu’elle intègre le Conservatoire de Toulouse dès l’âge de 7 ans et demi. Elle suit alors les cours de Mme Marchant pour le piano et Mme Cayla pour le solfège. Elle entre plus tard dans la classe de Mme Blanc-Daurat, femme de Didier Daurat, le célèbre pionnier de l’aéropostale, comme elle le souhaitait. Pour le solfège, elle est l’élève de Mme Pauly. Tout ceci alors qu’elle est issue d’un milieu modeste, ce qui a un peu freiné sa carrière lorsqu’il a fallu partir à Paris. Ayant obtenu un premier prix de piano, elle s’engage alors dans une carrière de pianiste accompagnatrice d’artistes de variétés. À 18 ans, elle retourne au Conservatoire de Toulouse, dans la classe de chant de Mme Izar-Lasson, la femme du ténor Louis Izar, directeur du théâtre du Capitole de Toulouse. Cette même famille qui a des attaches en Belgique et qui la fera débuter à l’opéra de Liège en 1953 dans son rôle fétiche : « Lakmé » de Delibes. C’est donc au Capitole que la grande soprano découvrit sa passion pour la musique. Elle y a pris ses cours de chant et, devenue star, y a chanté ses plus grands rôles. Le Théâtre du Capitole de Toulouse, qu'elle fréquentera toute sa vie. L'adolescente toulousaine voulait devenir pianiste, mais au Théâtre du Capitole, on remarqua ses qualités pour le chant. « Le chemin était tout tracé. Je n’ai pas l’impression d’avoir choisi. J’avais une voix juste, et ça c’est un don. Qu’est-ce qu’on peut faire contre cela ou pour cela ? », confia la cantatrice dans un entretien à France-Musique. Se partageant entre le piano et le chant, elle étudie auprès d’illustres professeurs comme Madeleine Malraux, l’épouse d’André Malraux, puis la soprano Janine Micheau. Un premier prix de chant en poche, elle auditionne à Liège en Belgique où elle débute en 1953. Pour ses débuts, Mady Mesplé se glisse dans les vocalises étourdissantes de Lakmé, l’opéra orientaliste de Léo Delibes, dont l’Air des clochettes deviendra un des « tubes » de la soprano aux suraigus ravageurs. À cette époque, Lakmé était pour les sopranos colorature françaises, le rôle phare. Un rôle fétiche pour elle. C'est à Liège qu'elle chantera pour la première fois la plupart des rôles de son répertoire, notamment Rosine dans Le Barbier de Séville et Gilda dans Rigoletto, tout en se produisant au théâtre de la Monnaie de Bruxelles. Elle chante aussi à Lyon Olympia dans Les Contes d'Hoffmann, puis au Festival d'Aix-en-Provence en 1956 dans Zémire et Azor de Grétry. Sa fine silhouette et son visage très pur conviennent si bien aux héroïnes lyriques de Donizetti (Lucia de Lammermoor) ou Verdi (Rigoletto) mais aussi Richard Strauss (la délurée Zerbinetta d’Ariane à Naxos). À partir de 1956, elle chante à l'Opéra de Paris. Elle interprète sœur Constance de Dialogues des carmélites de Francis Poulenc en 1958 et 1960. On la voit aussi dans Rigoletto et Les Indes galantes. En 1960, elle triomphe à l'Opéra Garnier de Paris avec le rôle-titre de Lucia di Lammermoor de Donizetti. Elle remplace au pied levé Joan Sutherland dans Lucia di Lammermoor au festival international d'Édimbourg en 1962. Elle chante à l’Opéra-Comique dans Lakmé (1960), Le Barbier de Séville, Les Contes d'Hoffmann, participe à la création de Princesse Pauline de Henri Tomasi, du Dernier Sauvage de Gian Carlo Menotti (1963), et reprend Les Noces de Jeannette de Victor Massé (décors de Raymond Peynet). Les grandes maisons d'opéras des capitales lui ouvrent alors leurs portes : débutant à Miami dans Lakmé. Viennent ensuite Madrid, Lisbonne, Porto, Barcelone, Londres, Édimbourg, Amsterdam, Vienne, Munich, Montréal, Seattle, Chicago, Dallas, le Metropolitan Opera House de New York (en 1972), Buenos Aires, Rio de Janeiro, le Bolchoï de Moscou (1972), Novossibirsk, Odessa, Talin, Tokyo, Belgrade, Poznań, etc. Elle parcourt le monde et interprète les plus grands rôles de l'opéra ; elle fut souvent Rosine du Barbier de Séville, la poupée des Contes d'Hoffmann ou encore Lucia de Lammermoor. Elle s’illustre aussi bien dans les rôles du répertoire français (Lakmé, Philine, Olympia, Ophélie), qu’italien (Lucia, Gilda, Norina, Rosina, Amina) et allemand (la Reine de la Nuit de La Flûte enchantée de Mozart, Zerbinetta d’Ariane à Naxos au festival d'Aix-en-Provence en 1966). Madeleine Mesplé, de son vrai prénom, était également une grande musicienne et une comédienne de talent, qui a défendu un répertoire largement ouvert sur la musique contemporaine. Elle ne se cantonnera pas à un seul registre, un seul répertoire. De nature très curieuse et ouverte, elle s’est glissée dans les grands classiques du lyrique comme dans des œuvres contemporaines plus audacieuses (Boulez, Schoenberg, Betsy Jolas…). Mady Mesplé aborde la musique contemporaine avec la création du quatuor n°2 écrit pour elle par Betsy Jolas ; de même, un autre Toulousain devenu célèbre, le compositeur Charles Chaynes compose pour elle ses Quatre poèmes de Sappho. Elle interprète aussi les œuvres de Patrice Mestral, Yves Prin et on lui doit la création en langue française en 1965 de l’Élégie pour jeunes amants (Elegie für junge Liebende) de Hans Werner Henze. Pierre Boulez lui demande à plusieurs reprises de chanter L'Échelle de Jacob (Die Jacobsleiter) de Schönberg et L'Enfant et les Sortilèges de Ravel, notamment à Londres. Elle ouvre, par ailleurs, la série de récitals de mélodies à l'Opéra de Paris en 1971. À l’Opéra de Paris, elle chante encore Olympia des Contes d'Hoffmann dans la mise en scène de Patrice Chéreau en 1975. Mady Mesplé a chanté entre autres sous la direction de Georges Prêtre, Pierre Boulez, Berislav Klobučar, Bernard Haitink, Pierre Dervaux, Alain Lombard et a travaillé sous la direction scénique de Patrice Chéreau et Franco Zeffirelli. Grande styliste, Mady abandonnera l'opéra à la fin des années 70 pour se consacrer à la mélodie et à l'enseignement. Dans les années 1980, Mady Mesplé commence une carrière pédagogique comme professeur à l'Académie de Nice, l'été. À peu près à la même époque, elle abandonne la scène lyrique (l'opéra) pour se consacrer aux récitals et aux concerts. Ce qui la mène à New York, Pékin, Shanghai, Toronto, Rome, etc. Elle a été professeur aux conservatoires nationaux de région de Lyon, Bordeaux et Saint-Maur-des-Fossés et a organisé de nombreuses master class (notamment à l'abbaye de Sylvanès) et au CNIPAL. Elle a été durant plusieurs années professeur à l'École normale de musique de Paris. Pendant plusieurs années, elle dirige une master class à Navarrenx dans les Pyrénées-Atlantiques et est la Présidente d'honneur de l'Association des Pierres lyriques, dirigée par François Ithurbide, dont la vocation est de promouvoir l'art lyrique en Béarn. Elle a également fait partie de nombreux jurys en France et à l'étranger (Washington, Toronto, Genève, Italie, etc.). Parallèlement, ses nombreux passages à la télévision pour défendre et démocratiser le chant lyrique (notamment sous l'égide de Jacques Martin, Pascal Sevran, etc.) assurent sa popularité auprès du grand public. L’enseignement et la promotion de l’opéra auprès du grand public, dans les émissions de Jacques Martin notamment, complètent cette carrière rayonnante. Elle est une des cantatrices françaises qui a le plus enregistré surtout chez EMI aussi bien l'opéra, l'opérette ou la mélodie que la musique sacrée ou la musique contemporaine. Mady Mesplé avait enregistré chez EMI le rôle de Lakmé de l’opéra de Léo Delibes sous la baguette du chef d’orchestre Alain Lombard. En 1996, on lui diagnostique la maladie de Parkinson. En 2010, elle devient la marraine de l'Association France Parkinson et publie son témoignage dans un livre intitulé « La Voix du corps », de son combat avec la grâce et la sincérité qui auront marqué son art et sa vie. L’ouvrage qu’elle dédie à sa fille est préfacé par le professeur Olivier Lyon-Caen. En 2016, elle est la marraine de la 6e édition du concours international de belcanto Vincenzo Bellini fondé par Marco Guidarini et qui s'est déroulé à l'opéra municipal de Marseille. La discographie de Mady Mesplé est extrêmement abondante, regroupant autant des opéras que des opéras-comiques, opérettes et œuvres qui témoignent de l'étendue de son art. Elle s'est fait connaître du grand public avec ses airs d'opérette : elle y excellait aussi, avec toute cette joie de vivre. Elle a mis fin à sa carrière en 1990. L’une de ses ultimes apparitions scéniques remonte au 14 mai 1990. C’était au théâtre des Champs-Élysées à Paris lors d’un hommage à Régine Crespin. Elle y interpréta « La dame de Monte-Carlo » de Francis Poulenc. Elle chanta avec l’Orchestre national du Capitole dirigé par Michel Plasson. À presque 60 ans, la magie était toujours intacte. Mady Mesplé, qui s'est éteinte le samedi 30 mai 2020 à Toulouse, sa ville où elle était née 89 ans plus tôt, possédait une voix de soprano colorature agile et cristalline, et une présence chaleureuse qui lui valut de vulgariser l’opéra à la télévision. Demeurée le symbole d’une Toulousaine amoureuse de beau chant, portant haut les couleurs de Toulouse au plan international, Mady Mesplé, la soprano à la qualité de voix exceptionnelle aura abordé la plupart de ses grands rôles à l’Opéra national de Paris dans les années 50 et se sera produite sur les plus grandes scènes du monde. Elle aura brillé au firmament des plus grandes cantatrices du XXe siècle et demeure inégalée dans son répertoire, qui allait du grand opéra (Rossini, Donizetti, Delibes…) à l’opérette (Strauss, Offenbach…). Une voix brillante comme un diamant avec des aigus et des suraigus et une femme simple qui répondait courtoisement aux gens qui l'abordaient dans la rue. « Elle pouvait tout interpréter, avec justesse et sensibilité et aura contribué à faire rayonner notre culture sur les scènes du monde entier », a tweeté le ministre de la Culture Franck Riester. Elle avait chanté sur les plus grandes scènes, visitant le monde et c’est pourtant dans la vallée d’Aure et plus précisément à Saint-Lary-Soulan qu’elle avait choisi de poser ses valises, chaque fois qu’elle le pouvait. Elle était arrivée par hasard en vallée d’Aure avec des amis. Ce fut le coup de foudre immédiat. Et la décision aussi : « Je veux un appartement ici, tout de suite ». Mady était comme ça, prompte à aimer, prompte à donner et à partager. Ce sera d’abord un petit studio, puis un appartement plus grand. Elle adorait la vallée d’Aure et Saint-Lary, où elle venait passer tous les étés et beaucoup de fêtes et de vacances, et où elle avait noué de solides amitiés, en particulier avec le Père Francis Tisné. Une grande amitié, une immense complicité unissaient ces deux personnalités enthousiastes et créatives. Elle avait accepté d’être l’active Présidente d’honneur de l’association du Festival des Petites Églises de montagne, créée en 2006. Grâce au Festival, elle rencontrait de nombreux amis. Elle y amènera des mélomanes aussi, et d’abord, celle qui en est aujourd’hui directrice artistique, Bernadette Fantin Epstein. Avec Gisèle sa sœur, elle parcourait les vallées : du côté espagnol que la chanteuse adorait, mais aussi au barrage de Cap de Long, où la cantatrice avait sympathisé avec Athos, le chien de Francis Tougne, qui tient le restaurant tout là-haut. Elle appréciait aussi le Relais du Néouvielle à Fabian, où elle avait organisé un concert improvisé avec un groupe « Talin » venu jouer pour le Festival. Elle aimait danser, faire la fête, bien manger et avait un appétit effrayant pour quelqu’un d’aussi mince. Mady était gourmande de la vie. Elle adorait aussi aller promener au col d’Aspin. À la fin de sa vie, seule la maladie de Parkinson dont elle était atteinte l'a tenue à l'écart du Théâtre du Capitole, où elle avait ses habitudes depuis son enfance. Elle était l’une des dernières sopranos coloratures mythiques de l’après-guerre. Et malgré une carrière internationale exceptionnelle, elle n’avait pas oublié pour autant ses racines toulousaines et occitanes, ni son amour pour la vallée d’Aure et le chant. Elle était décrite comme un bourreau de travail, une boulimique de musique. Elle s'étonnait que les élèves du conservatoire n'aient aujourd'hui "qu'une heure et quart de solfège par jour alors qu'on en avait six à mon époque". Le 5 novembre 2019, dans le Salon Rouge du Capitole, le Président Nicolas Sarkozy, en présence de Monsieur Jean-luc Moudenc, de M. le Préfet, des directeurs du Théâtre du Capitole et du Ballet du Capitole, avait tenu à remettre lui-même à Mady Mesplé la Grand-Croix dans l'Ordre national du Mérite, le plus haut échelon de cet ordre, une distinction qui rend hommage à une voix remarquable et à une longue carrière qui a vu la Toulousaine traverser les époques au service des plus grands rôles de l’opéra. Le mardi 21 avril 2015, Georges Prêtre avait déjà remis dans la salle des Illustres au Capitole de Toulouse les insignes de Grand officier de la Légion d'honneur à Mady Mesplé. Le prestigieux chef d'orchestre, qui avait dirigé l'orchestre national du Capitole dans les années 50. Georges Prêtre, lui-même Grand officier de la Légion d'honneur, était un ami de longue date de la soprano colorature. Et aussi en 2011, elle avait reçu le grand prix de l'Académie Charles-Cros pour l’ensemble de sa carrière. Elle a été inhumée au cimetière de Terre-Cabade à Toulouse.
Mady MESPLÉ, née le 7 mars 1931 à Toulouse dans une famille de mélomanes et qui est décédée, le 30 mai 2020, à l’âge de 89 ans dans cette même ville. Grande voix cristalline de l'opéra des années 1950 à la fin des années 1970, elle a été une des premières cantatrices françaises à avoir une carrière internationale. Ils ne sont pas si fréquents les musiciens qui ont su honorer avec une égale ferveur l’opérette, le style baroque et la musique contemporaine, et porter les couleurs de l’art lyrique sur les scènes internationales comme sur les grands plateaux de télévision. Ainsi pendant sa carrière, sa passion pour la musique l’a conduite à aborder tous les répertoires : opérette, opéra, musique contemporaine. Telle était Mady Mesplé. Dès son plus jeune âge, à 4 ans, sa mère l’emmène à l’opéra. Une vraie révélation pour Mady qui restera fidèle au Capitole toute sa vie. « J’ai eu le choc de ma vie, à l’âge de quatre ans, en assistant à une représentation de Faust au Capitole de Toulouse… » confiera-t-elle. Très rapidement, elle enchaîne avec du solfège, puis des cours de piano. Bercée par le Bel Canto, elle montre des dons fascinants, un professeur vient même à domicile pour lui donner des cours tant et si bien qu’elle intègre le Conservatoire de Toulouse dès l’âge de 7 ans et demi. Elle suit alors les cours de Mme Marchant pour le piano et Mme Cayla pour le solfège. Elle entre plus tard dans la classe de Mme Blanc-Daurat, femme de Didier Daurat, le célèbre pionnier de l’aéropostale, comme elle le souhaitait. Pour le solfège, elle est l’élève de Mme Pauly. Tout ceci alors qu’elle est issue d’un milieu modeste, ce qui a un peu freiné sa carrière lorsqu’il a fallu partir à Paris. Ayant obtenu un premier prix de piano, elle s’engage alors dans une carrière de pianiste accompagnatrice d’artistes de variétés. À 18 ans, elle retourne au Conservatoire de Toulouse, dans la classe de chant de Mme Izar-Lasson, la femme du ténor Louis Izar, directeur du théâtre du Capitole de Toulouse. Cette même famille qui a des attaches en Belgique et qui la fera débuter à l’opéra de Liège en 1953 dans son rôle fétiche : « Lakmé » de Delibes. C’est donc au Capitole que la grande soprano découvrit sa passion pour la musique. Elle y a pris ses cours de chant et, devenue star, y a chanté ses plus grands rôles. Le Théâtre du Capitole de Toulouse, qu'elle fréquentera toute sa vie. L'adolescente toulousaine voulait devenir pianiste, mais au Théâtre du Capitole, on remarqua ses qualités pour le chant. « Le chemin était tout tracé. Je n’ai pas l’impression d’avoir choisi. J’avais une voix juste, et ça c’est un don. Qu’est-ce qu’on peut faire contre cela ou pour cela ? », confia la cantatrice dans un entretien à France-Musique. Se partageant entre le piano et le chant, elle étudie auprès d’illustres professeurs comme Madeleine Malraux, l’épouse d’André Malraux, puis la soprano Janine Micheau. Un premier prix de chant en poche, elle auditionne à Liège en Belgique où elle débute en 1953. Pour ses débuts, Mady Mesplé se glisse dans les vocalises étourdissantes de Lakmé, l’opéra orientaliste de Léo Delibes, dont l’Air des clochettes deviendra un des « tubes » de la soprano aux suraigus ravageurs. À cette époque, Lakmé était pour les sopranos colorature françaises, le rôle phare. Un rôle fétiche pour elle. C'est à Liège qu'elle chantera pour la première fois la plupart des rôles de son répertoire, notamment Rosine dans Le Barbier de Séville et Gilda dans Rigoletto, tout en se produisant au théâtre de la Monnaie de Bruxelles. Elle chante aussi à Lyon Olympia dans Les Contes d'Hoffmann, puis au Festival d'Aix-en-Provence en 1956 dans Zémire et Azor de Grétry. Sa fine silhouette et son visage très pur conviennent si bien aux héroïnes lyriques de Donizetti (Lucia de Lammermoor) ou Verdi (Rigoletto) mais aussi Richard Strauss (la délurée Zerbinetta d’Ariane à Naxos). À partir de 1956, elle chante à l'Opéra de Paris. Elle interprète sœur Constance de Dialogues des carmélites de Francis Poulenc en 1958 et 1960. On la voit aussi dans Rigoletto et Les Indes galantes. En 1960, elle triomphe à l'Opéra Garnier de Paris avec le rôle-titre de Lucia di Lammermoor de Donizetti. Elle remplace au pied levé Joan Sutherland dans Lucia di Lammermoor au festival international d'Édimbourg en 1962. Elle chante à l’Opéra-Comique dans Lakmé (1960), Le Barbier de Séville, Les Contes d'Hoffmann, participe à la création de Princesse Pauline de Henri Tomasi, du Dernier Sauvage de Gian Carlo Menotti (1963), et reprend Les Noces de Jeannette de Victor Massé (décors de Raymond Peynet). Les grandes maisons d'opéras des capitales lui ouvrent alors leurs portes : débutant à Miami dans Lakmé. Viennent ensuite Madrid, Lisbonne, Porto, Barcelone, Londres, Édimbourg, Amsterdam, Vienne, Munich, Montréal, Seattle, Chicago, Dallas, le Metropolitan Opera House de New York (en 1972), Buenos Aires, Rio de Janeiro, le Bolchoï de Moscou (1972), Novossibirsk, Odessa, Talin, Tokyo, Belgrade, Poznań, etc. Elle parcourt le monde et interprète les plus grands rôles de l'opéra ; elle fut souvent Rosine du Barbier de Séville, la poupée des Contes d'Hoffmann ou encore Lucia de Lammermoor. Elle s’illustre aussi bien dans les rôles du répertoire français (Lakmé, Philine, Olympia, Ophélie), qu’italien (Lucia, Gilda, Norina, Rosina, Amina) et allemand (la Reine de la Nuit de La Flûte enchantée de Mozart, Zerbinetta d’Ariane à Naxos au festival d'Aix-en-Provence en 1966). Madeleine Mesplé, de son vrai prénom, était également une grande musicienne et une comédienne de talent, qui a défendu un répertoire largement ouvert sur la musique contemporaine. Elle ne se cantonnera pas à un seul registre, un seul répertoire. De nature très curieuse et ouverte, elle s’est glissée dans les grands classiques du lyrique comme dans des œuvres contemporaines plus audacieuses (Boulez, Schoenberg, Betsy Jolas…). Mady Mesplé aborde la musique contemporaine avec la création du quatuor n°2 écrit pour elle par Betsy Jolas ; de même, un autre Toulousain devenu célèbre, le compositeur Charles Chaynes compose pour elle ses Quatre poèmes de Sappho. Elle interprète aussi les œuvres de Patrice Mestral, Yves Prin et on lui doit la création en langue française en 1965 de l’Élégie pour jeunes amants (Elegie für junge Liebende) de Hans Werner Henze. Pierre Boulez lui demande à plusieurs reprises de chanter L'Échelle de Jacob (Die Jacobsleiter) de Schönberg et L'Enfant et les Sortilèges de Ravel, notamment à Londres. Elle ouvre, par ailleurs, la série de récitals de mélodies à l'Opéra de Paris en 1971. À l’Opéra de Paris, elle chante encore Olympia des Contes d'Hoffmann dans la mise en scène de Patrice Chéreau en 1975. Mady Mesplé a chanté entre autres sous la direction de Georges Prêtre, Pierre Boulez, Berislav Klobučar, Bernard Haitink, Pierre Dervaux, Alain Lombard et a travaillé sous la direction scénique de Patrice Chéreau et Franco Zeffirelli. Grande styliste, Mady abandonnera l'opéra à la fin des années 70 pour se consacrer à la mélodie et à l'enseignement. Dans les années 1980, Mady Mesplé commence une carrière pédagogique comme professeur à l'Académie de Nice, l'été. À peu près à la même époque, elle abandonne la scène lyrique (l'opéra) pour se consacrer aux récitals et aux concerts. Ce qui la mène à New York, Pékin, Shanghai, Toronto, Rome, etc. Elle a été professeur aux conservatoires nationaux de région de Lyon, Bordeaux et Saint-Maur-des-Fossés et a organisé de nombreuses master class (notamment à l'abbaye de Sylvanès) et au CNIPAL. Elle a été durant plusieurs années professeur à l'École normale de musique de Paris. Pendant plusieurs années, elle dirige une master class à Navarrenx dans les Pyrénées-Atlantiques et est la Présidente d'honneur de l'Association des Pierres lyriques, dirigée par François Ithurbide, dont la vocation est de promouvoir l'art lyrique en Béarn. Elle a également fait partie de nombreux jurys en France et à l'étranger (Washington, Toronto, Genève, Italie, etc.). Parallèlement, ses nombreux passages à la télévision pour défendre et démocratiser le chant lyrique (notamment sous l'égide de Jacques Martin, Pascal Sevran, etc.) assurent sa popularité auprès du grand public. L’enseignement et la promotion de l’opéra auprès du grand public, dans les émissions de Jacques Martin notamment, complètent cette carrière rayonnante. Elle est une des cantatrices françaises qui a le plus enregistré surtout chez EMI aussi bien l'opéra, l'opérette ou la mélodie que la musique sacrée ou la musique contemporaine. Mady Mesplé avait enregistré chez EMI le rôle de Lakmé de l’opéra de Léo Delibes sous la baguette du chef d’orchestre Alain Lombard. En 1996, on lui diagnostique la maladie de Parkinson. En 2010, elle devient la marraine de l'Association France Parkinson et publie son témoignage dans un livre intitulé « La Voix du corps », de son combat avec la grâce et la sincérité qui auront marqué son art et sa vie. L’ouvrage qu’elle dédie à sa fille est préfacé par le professeur Olivier Lyon-Caen. En 2016, elle est la marraine de la 6e édition du concours international de belcanto Vincenzo Bellini fondé par Marco Guidarini et qui s'est déroulé à l'opéra municipal de Marseille. La discographie de Mady Mesplé est extrêmement abondante, regroupant autant des opéras que des opéras-comiques, opérettes et œuvres qui témoignent de l'étendue de son art. Elle s'est fait connaître du grand public avec ses airs d'opérette : elle y excellait aussi, avec toute cette joie de vivre. Elle a mis fin à sa carrière en 1990. L’une de ses ultimes apparitions scéniques remonte au 14 mai 1990. C’était au théâtre des Champs-Élysées à Paris lors d’un hommage à Régine Crespin. Elle y interpréta « La dame de Monte-Carlo » de Francis Poulenc. Elle chanta avec l’Orchestre national du Capitole dirigé par Michel Plasson. À presque 60 ans, la magie était toujours intacte. Mady Mesplé, qui s'est éteinte le samedi 30 mai 2020 à Toulouse, sa ville où elle était née 89 ans plus tôt, possédait une voix de soprano colorature agile et cristalline, et une présence chaleureuse qui lui valut de vulgariser l’opéra à la télévision. Demeurée le symbole d’une Toulousaine amoureuse de beau chant, portant haut les couleurs de Toulouse au plan international, Mady Mesplé, la soprano à la qualité de voix exceptionnelle aura abordé la plupart de ses grands rôles à l’Opéra national de Paris dans les années 50 et se sera produite sur les plus grandes scènes du monde. Elle aura brillé au firmament des plus grandes cantatrices du XXe siècle et demeure inégalée dans son répertoire, qui allait du grand opéra (Rossini, Donizetti, Delibes…) à l’opérette (Strauss, Offenbach…). Une voix brillante comme un diamant avec des aigus et des suraigus et une femme simple qui répondait courtoisement aux gens qui l'abordaient dans la rue. « Elle pouvait tout interpréter, avec justesse et sensibilité et aura contribué à faire rayonner notre culture sur les scènes du monde entier », a tweeté le ministre de la Culture Franck Riester. Elle avait chanté sur les plus grandes scènes, visitant le monde et c’est pourtant dans la vallée d’Aure et plus précisément à Saint-Lary-Soulan qu’elle avait choisi de poser ses valises, chaque fois qu’elle le pouvait. Elle était arrivée par hasard en vallée d’Aure avec des amis. Ce fut le coup de foudre immédiat. Et la décision aussi : « Je veux un appartement ici, tout de suite ». Mady était comme ça, prompte à aimer, prompte à donner et à partager. Ce sera d’abord un petit studio, puis un appartement plus grand. Elle adorait la vallée d’Aure et Saint-Lary, où elle venait passer tous les étés et beaucoup de fêtes et de vacances, et où elle avait noué de solides amitiés, en particulier avec le Père Francis Tisné. Une grande amitié, une immense complicité unissaient ces deux personnalités enthousiastes et créatives. Elle avait accepté d’être l’active Présidente d’honneur de l’association du Festival des Petites Églises de montagne, créée en 2006. Grâce au Festival, elle rencontrait de nombreux amis. Elle y amènera des mélomanes aussi, et d’abord, celle qui en est aujourd’hui directrice artistique, Bernadette Fantin Epstein. Avec Gisèle sa sœur, elle parcourait les vallées : du côté espagnol que la chanteuse adorait, mais aussi au barrage de Cap de Long, où la cantatrice avait sympathisé avec Athos, le chien de Francis Tougne, qui tient le restaurant tout là-haut. Elle appréciait aussi le Relais du Néouvielle à Fabian, où elle avait organisé un concert improvisé avec un groupe « Talin » venu jouer pour le Festival. Elle aimait danser, faire la fête, bien manger et avait un appétit effrayant pour quelqu’un d’aussi mince. Mady était gourmande de la vie. Elle adorait aussi aller promener au col d’Aspin. À la fin de sa vie, seule la maladie de Parkinson dont elle était atteinte l'a tenue à l'écart du Théâtre du Capitole, où elle avait ses habitudes depuis son enfance. Elle était l’une des dernières sopranos coloratures mythiques de l’après-guerre. Et malgré une carrière internationale exceptionnelle, elle n’avait pas oublié pour autant ses racines toulousaines et occitanes, ni son amour pour la vallée d’Aure et le chant. Elle était décrite comme un bourreau de travail, une boulimique de musique. Elle s'étonnait que les élèves du conservatoire n'aient aujourd'hui "qu'une heure et quart de solfège par jour alors qu'on en avait six à mon époque". Le 5 novembre 2019, dans le Salon Rouge du Capitole, le Président Nicolas Sarkozy, en présence de Monsieur Jean-luc Moudenc, de M. le Préfet, des directeurs du Théâtre du Capitole et du Ballet du Capitole, avait tenu à remettre lui-même à Mady Mesplé la Grand-Croix dans l'Ordre national du Mérite, le plus haut échelon de cet ordre, une distinction qui rend hommage à une voix remarquable et à une longue carrière qui a vu la Toulousaine traverser les époques au service des plus grands rôles de l’opéra. Le mardi 21 avril 2015, Georges Prêtre avait déjà remis dans la salle des Illustres au Capitole de Toulouse les insignes de Grand officier de la Légion d'honneur à Mady Mesplé. Le prestigieux chef d'orchestre, qui avait dirigé l'orchestre national du Capitole dans les années 50. Georges Prêtre, lui-même Grand officier de la Légion d'honneur, était un ami de longue date de la soprano colorature. Et aussi en 2011, elle avait reçu le grand prix de l'Académie Charles-Cros pour l’ensemble de sa carrière. Elle a été inhumée au cimetière de Terre-Cabade à Toulouse.
 Mady MESPLÉ, née le 7 mars 1931 à Toulouse dans une famille de mélomanes et qui est décédée, le 30 mai 2020, à l’âge de 89 ans dans cette même ville. Grande voix cristalline de l'opéra des années 1950 à la fin des années 1970, elle a été une des premières cantatrices françaises à avoir une carrière internationale. Ils ne sont pas si fréquents les musiciens qui ont su honorer avec une égale ferveur l’opérette, le style baroque et la musique contemporaine, et porter les couleurs de l’art lyrique sur les scènes internationales comme sur les grands plateaux de télévision. Ainsi pendant sa carrière, sa passion pour la musique l’a conduite à aborder tous les répertoires : opérette, opéra, musique contemporaine. Telle était Mady Mesplé. Dès son plus jeune âge, à 4 ans, sa mère l’emmène à l’opéra. Une vraie révélation pour Mady qui restera fidèle au Capitole toute sa vie. « J’ai eu le choc de ma vie, à l’âge de quatre ans, en assistant à une représentation de Faust au Capitole de Toulouse… » confiera-t-elle. Très rapidement, elle enchaîne avec du solfège, puis des cours de piano. Bercée par le Bel Canto, elle montre des dons fascinants, un professeur vient même à domicile pour lui donner des cours tant et si bien qu’elle intègre le Conservatoire de Toulouse dès l’âge de 7 ans et demi. Elle suit alors les cours de Mme Marchant pour le piano et Mme Cayla pour le solfège. Elle entre plus tard dans la classe de Mme Blanc-Daurat, femme de Didier Daurat, le célèbre pionnier de l’aéropostale, comme elle le souhaitait. Pour le solfège, elle est l’élève de Mme Pauly. Tout ceci alors qu’elle est issue d’un milieu modeste, ce qui a un peu freiné sa carrière lorsqu’il a fallu partir à Paris. Ayant obtenu un premier prix de piano, elle s’engage alors dans une carrière de pianiste accompagnatrice d’artistes de variétés. À 18 ans, elle retourne au Conservatoire de Toulouse, dans la classe de chant de Mme Izar-Lasson, la femme du ténor Louis Izar, directeur du théâtre du Capitole de Toulouse. Cette même famille qui a des attaches en Belgique et qui la fera débuter à l’opéra de Liège en 1953 dans son rôle fétiche : « Lakmé » de Delibes. C’est donc au Capitole que la grande soprano découvrit sa passion pour la musique. Elle y a pris ses cours de chant et, devenue star, y a chanté ses plus grands rôles. Le Théâtre du Capitole de Toulouse, qu'elle fréquentera toute sa vie. L'adolescente toulousaine voulait devenir pianiste, mais au Théâtre du Capitole, on remarqua ses qualités pour le chant. « Le chemin était tout tracé. Je n’ai pas l’impression d’avoir choisi. J’avais une voix juste, et ça c’est un don. Qu’est-ce qu’on peut faire contre cela ou pour cela ? », confia la cantatrice dans un entretien à France-Musique. Se partageant entre le piano et le chant, elle étudie auprès d’illustres professeurs comme Madeleine Malraux, l’épouse d’André Malraux, puis la soprano Janine Micheau. Un premier prix de chant en poche, elle auditionne à Liège en Belgique où elle débute en 1953. Pour ses débuts, Mady Mesplé se glisse dans les vocalises étourdissantes de Lakmé, l’opéra orientaliste de Léo Delibes, dont l’Air des clochettes deviendra un des « tubes » de la soprano aux suraigus ravageurs. À cette époque, Lakmé était pour les sopranos colorature françaises, le rôle phare. Un rôle fétiche pour elle. C'est à Liège qu'elle chantera pour la première fois la plupart des rôles de son répertoire, notamment Rosine dans Le Barbier de Séville et Gilda dans Rigoletto, tout en se produisant au théâtre de la Monnaie de Bruxelles. Elle chante aussi à Lyon Olympia dans Les Contes d'Hoffmann, puis au Festival d'Aix-en-Provence en 1956 dans Zémire et Azor de Grétry. Sa fine silhouette et son visage très pur conviennent si bien aux héroïnes lyriques de Donizetti (Lucia de Lammermoor) ou Verdi (Rigoletto) mais aussi Richard Strauss (la délurée Zerbinetta d’Ariane à Naxos). À partir de 1956, elle chante à l'Opéra de Paris. Elle interprète sœur Constance de Dialogues des carmélites de Francis Poulenc en 1958 et 1960. On la voit aussi dans Rigoletto et Les Indes galantes. En 1960, elle triomphe à l'Opéra Garnier de Paris avec le rôle-titre de Lucia di Lammermoor de Donizetti. Elle remplace au pied levé Joan Sutherland dans Lucia di Lammermoor au festival international d'Édimbourg en 1962. Elle chante à l’Opéra-Comique dans Lakmé (1960), Le Barbier de Séville, Les Contes d'Hoffmann, participe à la création de Princesse Pauline de Henri Tomasi, du Dernier Sauvage de Gian Carlo Menotti (1963), et reprend Les Noces de Jeannette de Victor Massé (décors de Raymond Peynet). Les grandes maisons d'opéras des capitales lui ouvrent alors leurs portes : débutant à Miami dans Lakmé. Viennent ensuite Madrid, Lisbonne, Porto, Barcelone, Londres, Édimbourg, Amsterdam, Vienne, Munich, Montréal, Seattle, Chicago, Dallas, le Metropolitan Opera House de New York (en 1972), Buenos Aires, Rio de Janeiro, le Bolchoï de Moscou (1972), Novossibirsk, Odessa, Talin, Tokyo, Belgrade, Poznań, etc. Elle parcourt le monde et interprète les plus grands rôles de l'opéra ; elle fut souvent Rosine du Barbier de Séville, la poupée des Contes d'Hoffmann ou encore Lucia de Lammermoor. Elle s’illustre aussi bien dans les rôles du répertoire français (Lakmé, Philine, Olympia, Ophélie), qu’italien (Lucia, Gilda, Norina, Rosina, Amina) et allemand (la Reine de la Nuit de La Flûte enchantée de Mozart, Zerbinetta d’Ariane à Naxos au festival d'Aix-en-Provence en 1966). Madeleine Mesplé, de son vrai prénom, était également une grande musicienne et une comédienne de talent, qui a défendu un répertoire largement ouvert sur la musique contemporaine. Elle ne se cantonnera pas à un seul registre, un seul répertoire. De nature très curieuse et ouverte, elle s’est glissée dans les grands classiques du lyrique comme dans des œuvres contemporaines plus audacieuses (Boulez, Schoenberg, Betsy Jolas…). Mady Mesplé aborde la musique contemporaine avec la création du quatuor n°2 écrit pour elle par Betsy Jolas ; de même, un autre Toulousain devenu célèbre, le compositeur Charles Chaynes compose pour elle ses Quatre poèmes de Sappho. Elle interprète aussi les œuvres de Patrice Mestral, Yves Prin et on lui doit la création en langue française en 1965 de l’Élégie pour jeunes amants (Elegie für junge Liebende) de Hans Werner Henze. Pierre Boulez lui demande à plusieurs reprises de chanter L'Échelle de Jacob (Die Jacobsleiter) de Schönberg et L'Enfant et les Sortilèges de Ravel, notamment à Londres. Elle ouvre, par ailleurs, la série de récitals de mélodies à l'Opéra de Paris en 1971. À l’Opéra de Paris, elle chante encore Olympia des Contes d'Hoffmann dans la mise en scène de Patrice Chéreau en 1975. Mady Mesplé a chanté entre autres sous la direction de Georges Prêtre, Pierre Boulez, Berislav Klobučar, Bernard Haitink, Pierre Dervaux, Alain Lombard et a travaillé sous la direction scénique de Patrice Chéreau et Franco Zeffirelli. Grande styliste, Mady abandonnera l'opéra à la fin des années 70 pour se consacrer à la mélodie et à l'enseignement. Dans les années 1980, Mady Mesplé commence une carrière pédagogique comme professeur à l'Académie de Nice, l'été. À peu près à la même époque, elle abandonne la scène lyrique (l'opéra) pour se consacrer aux récitals et aux concerts. Ce qui la mène à New York, Pékin, Shanghai, Toronto, Rome, etc. Elle a été professeur aux conservatoires nationaux de région de Lyon, Bordeaux et Saint-Maur-des-Fossés et a organisé de nombreuses master class (notamment à l'abbaye de Sylvanès) et au CNIPAL. Elle a été durant plusieurs années professeur à l'École normale de musique de Paris. Pendant plusieurs années, elle dirige une master class à Navarrenx dans les Pyrénées-Atlantiques et est la Présidente d'honneur de l'Association des Pierres lyriques, dirigée par François Ithurbide, dont la vocation est de promouvoir l'art lyrique en Béarn. Elle a également fait partie de nombreux jurys en France et à l'étranger (Washington, Toronto, Genève, Italie, etc.). Parallèlement, ses nombreux passages à la télévision pour défendre et démocratiser le chant lyrique (notamment sous l'égide de Jacques Martin, Pascal Sevran, etc.) assurent sa popularité auprès du grand public. L’enseignement et la promotion de l’opéra auprès du grand public, dans les émissions de Jacques Martin notamment, complètent cette carrière rayonnante. Elle est une des cantatrices françaises qui a le plus enregistré surtout chez EMI aussi bien l'opéra, l'opérette ou la mélodie que la musique sacrée ou la musique contemporaine. Mady Mesplé avait enregistré chez EMI le rôle de Lakmé de l’opéra de Léo Delibes sous la baguette du chef d’orchestre Alain Lombard. En 1996, on lui diagnostique la maladie de Parkinson. En 2010, elle devient la marraine de l'Association France Parkinson et publie son témoignage dans un livre intitulé « La Voix du corps », de son combat avec la grâce et la sincérité qui auront marqué son art et sa vie. L’ouvrage qu’elle dédie à sa fille est préfacé par le professeur Olivier Lyon-Caen. En 2016, elle est la marraine de la 6e édition du concours international de belcanto Vincenzo Bellini fondé par Marco Guidarini et qui s'est déroulé à l'opéra municipal de Marseille. La discographie de Mady Mesplé est extrêmement abondante, regroupant autant des opéras que des opéras-comiques, opérettes et œuvres qui témoignent de l'étendue de son art. Elle s'est fait connaître du grand public avec ses airs d'opérette : elle y excellait aussi, avec toute cette joie de vivre. Elle a mis fin à sa carrière en 1990. L’une de ses ultimes apparitions scéniques remonte au 14 mai 1990. C’était au théâtre des Champs-Élysées à Paris lors d’un hommage à Régine Crespin. Elle y interpréta « La dame de Monte-Carlo » de Francis Poulenc. Elle chanta avec l’Orchestre national du Capitole dirigé par Michel Plasson. À presque 60 ans, la magie était toujours intacte. Mady Mesplé, qui s'est éteinte le samedi 30 mai 2020 à Toulouse, sa ville où elle était née 89 ans plus tôt, possédait une voix de soprano colorature agile et cristalline, et une présence chaleureuse qui lui valut de vulgariser l’opéra à la télévision. Demeurée le symbole d’une Toulousaine amoureuse de beau chant, portant haut les couleurs de Toulouse au plan international, Mady Mesplé, la soprano à la qualité de voix exceptionnelle aura abordé la plupart de ses grands rôles à l’Opéra national de Paris dans les années 50 et se sera produite sur les plus grandes scènes du monde. Elle aura brillé au firmament des plus grandes cantatrices du XXe siècle et demeure inégalée dans son répertoire, qui allait du grand opéra (Rossini, Donizetti, Delibes…) à l’opérette (Strauss, Offenbach…). Une voix brillante comme un diamant avec des aigus et des suraigus et une femme simple qui répondait courtoisement aux gens qui l'abordaient dans la rue. « Elle pouvait tout interpréter, avec justesse et sensibilité et aura contribué à faire rayonner notre culture sur les scènes du monde entier », a tweeté le ministre de la Culture Franck Riester. Elle avait chanté sur les plus grandes scènes, visitant le monde et c’est pourtant dans la vallée d’Aure et plus précisément à Saint-Lary-Soulan qu’elle avait choisi de poser ses valises, chaque fois qu’elle le pouvait. Elle était arrivée par hasard en vallée d’Aure avec des amis. Ce fut le coup de foudre immédiat. Et la décision aussi : « Je veux un appartement ici, tout de suite ». Mady était comme ça, prompte à aimer, prompte à donner et à partager. Ce sera d’abord un petit studio, puis un appartement plus grand. Elle adorait la vallée d’Aure et Saint-Lary, où elle venait passer tous les étés et beaucoup de fêtes et de vacances, et où elle avait noué de solides amitiés, en particulier avec le Père Francis Tisné. Une grande amitié, une immense complicité unissaient ces deux personnalités enthousiastes et créatives. Elle avait accepté d’être l’active Présidente d’honneur de l’association du Festival des Petites Églises de montagne, créée en 2006. Grâce au Festival, elle rencontrait de nombreux amis. Elle y amènera des mélomanes aussi, et d’abord, celle qui en est aujourd’hui directrice artistique, Bernadette Fantin Epstein. Avec Gisèle sa sœur, elle parcourait les vallées : du côté espagnol que la chanteuse adorait, mais aussi au barrage de Cap de Long, où la cantatrice avait sympathisé avec Athos, le chien de Francis Tougne, qui tient le restaurant tout là-haut. Elle appréciait aussi le Relais du Néouvielle à Fabian, où elle avait organisé un concert improvisé avec un groupe « Talin » venu jouer pour le Festival. Elle aimait danser, faire la fête, bien manger et avait un appétit effrayant pour quelqu’un d’aussi mince. Mady était gourmande de la vie. Elle adorait aussi aller promener au col d’Aspin. À la fin de sa vie, seule la maladie de Parkinson dont elle était atteinte l'a tenue à l'écart du Théâtre du Capitole, où elle avait ses habitudes depuis son enfance. Elle était l’une des dernières sopranos coloratures mythiques de l’après-guerre. Et malgré une carrière internationale exceptionnelle, elle n’avait pas oublié pour autant ses racines toulousaines et occitanes, ni son amour pour la vallée d’Aure et le chant. Elle était décrite comme un bourreau de travail, une boulimique de musique. Elle s'étonnait que les élèves du conservatoire n'aient aujourd'hui "qu'une heure et quart de solfège par jour alors qu'on en avait six à mon époque". Le 5 novembre 2019, dans le Salon Rouge du Capitole, le Président Nicolas Sarkozy, en présence de Monsieur Jean-luc Moudenc, de M. le Préfet, des directeurs du Théâtre du Capitole et du Ballet du Capitole, avait tenu à remettre lui-même à Mady Mesplé la Grand-Croix dans l'Ordre national du Mérite, le plus haut échelon de cet ordre, une distinction qui rend hommage à une voix remarquable et à une longue carrière qui a vu la Toulousaine traverser les époques au service des plus grands rôles de l’opéra. Le mardi 21 avril 2015, Georges Prêtre avait déjà remis dans la salle des Illustres au Capitole de Toulouse les insignes de Grand officier de la Légion d'honneur à Mady Mesplé. Le prestigieux chef d'orchestre, qui avait dirigé l'orchestre national du Capitole dans les années 50. Georges Prêtre, lui-même Grand officier de la Légion d'honneur, était un ami de longue date de la soprano colorature. Et aussi en 2011, elle avait reçu le grand prix de l'Académie Charles-Cros pour l’ensemble de sa carrière. Elle a été inhumée au cimetière de Terre-Cabade à Toulouse.
Mady MESPLÉ, née le 7 mars 1931 à Toulouse dans une famille de mélomanes et qui est décédée, le 30 mai 2020, à l’âge de 89 ans dans cette même ville. Grande voix cristalline de l'opéra des années 1950 à la fin des années 1970, elle a été une des premières cantatrices françaises à avoir une carrière internationale. Ils ne sont pas si fréquents les musiciens qui ont su honorer avec une égale ferveur l’opérette, le style baroque et la musique contemporaine, et porter les couleurs de l’art lyrique sur les scènes internationales comme sur les grands plateaux de télévision. Ainsi pendant sa carrière, sa passion pour la musique l’a conduite à aborder tous les répertoires : opérette, opéra, musique contemporaine. Telle était Mady Mesplé. Dès son plus jeune âge, à 4 ans, sa mère l’emmène à l’opéra. Une vraie révélation pour Mady qui restera fidèle au Capitole toute sa vie. « J’ai eu le choc de ma vie, à l’âge de quatre ans, en assistant à une représentation de Faust au Capitole de Toulouse… » confiera-t-elle. Très rapidement, elle enchaîne avec du solfège, puis des cours de piano. Bercée par le Bel Canto, elle montre des dons fascinants, un professeur vient même à domicile pour lui donner des cours tant et si bien qu’elle intègre le Conservatoire de Toulouse dès l’âge de 7 ans et demi. Elle suit alors les cours de Mme Marchant pour le piano et Mme Cayla pour le solfège. Elle entre plus tard dans la classe de Mme Blanc-Daurat, femme de Didier Daurat, le célèbre pionnier de l’aéropostale, comme elle le souhaitait. Pour le solfège, elle est l’élève de Mme Pauly. Tout ceci alors qu’elle est issue d’un milieu modeste, ce qui a un peu freiné sa carrière lorsqu’il a fallu partir à Paris. Ayant obtenu un premier prix de piano, elle s’engage alors dans une carrière de pianiste accompagnatrice d’artistes de variétés. À 18 ans, elle retourne au Conservatoire de Toulouse, dans la classe de chant de Mme Izar-Lasson, la femme du ténor Louis Izar, directeur du théâtre du Capitole de Toulouse. Cette même famille qui a des attaches en Belgique et qui la fera débuter à l’opéra de Liège en 1953 dans son rôle fétiche : « Lakmé » de Delibes. C’est donc au Capitole que la grande soprano découvrit sa passion pour la musique. Elle y a pris ses cours de chant et, devenue star, y a chanté ses plus grands rôles. Le Théâtre du Capitole de Toulouse, qu'elle fréquentera toute sa vie. L'adolescente toulousaine voulait devenir pianiste, mais au Théâtre du Capitole, on remarqua ses qualités pour le chant. « Le chemin était tout tracé. Je n’ai pas l’impression d’avoir choisi. J’avais une voix juste, et ça c’est un don. Qu’est-ce qu’on peut faire contre cela ou pour cela ? », confia la cantatrice dans un entretien à France-Musique. Se partageant entre le piano et le chant, elle étudie auprès d’illustres professeurs comme Madeleine Malraux, l’épouse d’André Malraux, puis la soprano Janine Micheau. Un premier prix de chant en poche, elle auditionne à Liège en Belgique où elle débute en 1953. Pour ses débuts, Mady Mesplé se glisse dans les vocalises étourdissantes de Lakmé, l’opéra orientaliste de Léo Delibes, dont l’Air des clochettes deviendra un des « tubes » de la soprano aux suraigus ravageurs. À cette époque, Lakmé était pour les sopranos colorature françaises, le rôle phare. Un rôle fétiche pour elle. C'est à Liège qu'elle chantera pour la première fois la plupart des rôles de son répertoire, notamment Rosine dans Le Barbier de Séville et Gilda dans Rigoletto, tout en se produisant au théâtre de la Monnaie de Bruxelles. Elle chante aussi à Lyon Olympia dans Les Contes d'Hoffmann, puis au Festival d'Aix-en-Provence en 1956 dans Zémire et Azor de Grétry. Sa fine silhouette et son visage très pur conviennent si bien aux héroïnes lyriques de Donizetti (Lucia de Lammermoor) ou Verdi (Rigoletto) mais aussi Richard Strauss (la délurée Zerbinetta d’Ariane à Naxos). À partir de 1956, elle chante à l'Opéra de Paris. Elle interprète sœur Constance de Dialogues des carmélites de Francis Poulenc en 1958 et 1960. On la voit aussi dans Rigoletto et Les Indes galantes. En 1960, elle triomphe à l'Opéra Garnier de Paris avec le rôle-titre de Lucia di Lammermoor de Donizetti. Elle remplace au pied levé Joan Sutherland dans Lucia di Lammermoor au festival international d'Édimbourg en 1962. Elle chante à l’Opéra-Comique dans Lakmé (1960), Le Barbier de Séville, Les Contes d'Hoffmann, participe à la création de Princesse Pauline de Henri Tomasi, du Dernier Sauvage de Gian Carlo Menotti (1963), et reprend Les Noces de Jeannette de Victor Massé (décors de Raymond Peynet). Les grandes maisons d'opéras des capitales lui ouvrent alors leurs portes : débutant à Miami dans Lakmé. Viennent ensuite Madrid, Lisbonne, Porto, Barcelone, Londres, Édimbourg, Amsterdam, Vienne, Munich, Montréal, Seattle, Chicago, Dallas, le Metropolitan Opera House de New York (en 1972), Buenos Aires, Rio de Janeiro, le Bolchoï de Moscou (1972), Novossibirsk, Odessa, Talin, Tokyo, Belgrade, Poznań, etc. Elle parcourt le monde et interprète les plus grands rôles de l'opéra ; elle fut souvent Rosine du Barbier de Séville, la poupée des Contes d'Hoffmann ou encore Lucia de Lammermoor. Elle s’illustre aussi bien dans les rôles du répertoire français (Lakmé, Philine, Olympia, Ophélie), qu’italien (Lucia, Gilda, Norina, Rosina, Amina) et allemand (la Reine de la Nuit de La Flûte enchantée de Mozart, Zerbinetta d’Ariane à Naxos au festival d'Aix-en-Provence en 1966). Madeleine Mesplé, de son vrai prénom, était également une grande musicienne et une comédienne de talent, qui a défendu un répertoire largement ouvert sur la musique contemporaine. Elle ne se cantonnera pas à un seul registre, un seul répertoire. De nature très curieuse et ouverte, elle s’est glissée dans les grands classiques du lyrique comme dans des œuvres contemporaines plus audacieuses (Boulez, Schoenberg, Betsy Jolas…). Mady Mesplé aborde la musique contemporaine avec la création du quatuor n°2 écrit pour elle par Betsy Jolas ; de même, un autre Toulousain devenu célèbre, le compositeur Charles Chaynes compose pour elle ses Quatre poèmes de Sappho. Elle interprète aussi les œuvres de Patrice Mestral, Yves Prin et on lui doit la création en langue française en 1965 de l’Élégie pour jeunes amants (Elegie für junge Liebende) de Hans Werner Henze. Pierre Boulez lui demande à plusieurs reprises de chanter L'Échelle de Jacob (Die Jacobsleiter) de Schönberg et L'Enfant et les Sortilèges de Ravel, notamment à Londres. Elle ouvre, par ailleurs, la série de récitals de mélodies à l'Opéra de Paris en 1971. À l’Opéra de Paris, elle chante encore Olympia des Contes d'Hoffmann dans la mise en scène de Patrice Chéreau en 1975. Mady Mesplé a chanté entre autres sous la direction de Georges Prêtre, Pierre Boulez, Berislav Klobučar, Bernard Haitink, Pierre Dervaux, Alain Lombard et a travaillé sous la direction scénique de Patrice Chéreau et Franco Zeffirelli. Grande styliste, Mady abandonnera l'opéra à la fin des années 70 pour se consacrer à la mélodie et à l'enseignement. Dans les années 1980, Mady Mesplé commence une carrière pédagogique comme professeur à l'Académie de Nice, l'été. À peu près à la même époque, elle abandonne la scène lyrique (l'opéra) pour se consacrer aux récitals et aux concerts. Ce qui la mène à New York, Pékin, Shanghai, Toronto, Rome, etc. Elle a été professeur aux conservatoires nationaux de région de Lyon, Bordeaux et Saint-Maur-des-Fossés et a organisé de nombreuses master class (notamment à l'abbaye de Sylvanès) et au CNIPAL. Elle a été durant plusieurs années professeur à l'École normale de musique de Paris. Pendant plusieurs années, elle dirige une master class à Navarrenx dans les Pyrénées-Atlantiques et est la Présidente d'honneur de l'Association des Pierres lyriques, dirigée par François Ithurbide, dont la vocation est de promouvoir l'art lyrique en Béarn. Elle a également fait partie de nombreux jurys en France et à l'étranger (Washington, Toronto, Genève, Italie, etc.). Parallèlement, ses nombreux passages à la télévision pour défendre et démocratiser le chant lyrique (notamment sous l'égide de Jacques Martin, Pascal Sevran, etc.) assurent sa popularité auprès du grand public. L’enseignement et la promotion de l’opéra auprès du grand public, dans les émissions de Jacques Martin notamment, complètent cette carrière rayonnante. Elle est une des cantatrices françaises qui a le plus enregistré surtout chez EMI aussi bien l'opéra, l'opérette ou la mélodie que la musique sacrée ou la musique contemporaine. Mady Mesplé avait enregistré chez EMI le rôle de Lakmé de l’opéra de Léo Delibes sous la baguette du chef d’orchestre Alain Lombard. En 1996, on lui diagnostique la maladie de Parkinson. En 2010, elle devient la marraine de l'Association France Parkinson et publie son témoignage dans un livre intitulé « La Voix du corps », de son combat avec la grâce et la sincérité qui auront marqué son art et sa vie. L’ouvrage qu’elle dédie à sa fille est préfacé par le professeur Olivier Lyon-Caen. En 2016, elle est la marraine de la 6e édition du concours international de belcanto Vincenzo Bellini fondé par Marco Guidarini et qui s'est déroulé à l'opéra municipal de Marseille. La discographie de Mady Mesplé est extrêmement abondante, regroupant autant des opéras que des opéras-comiques, opérettes et œuvres qui témoignent de l'étendue de son art. Elle s'est fait connaître du grand public avec ses airs d'opérette : elle y excellait aussi, avec toute cette joie de vivre. Elle a mis fin à sa carrière en 1990. L’une de ses ultimes apparitions scéniques remonte au 14 mai 1990. C’était au théâtre des Champs-Élysées à Paris lors d’un hommage à Régine Crespin. Elle y interpréta « La dame de Monte-Carlo » de Francis Poulenc. Elle chanta avec l’Orchestre national du Capitole dirigé par Michel Plasson. À presque 60 ans, la magie était toujours intacte. Mady Mesplé, qui s'est éteinte le samedi 30 mai 2020 à Toulouse, sa ville où elle était née 89 ans plus tôt, possédait une voix de soprano colorature agile et cristalline, et une présence chaleureuse qui lui valut de vulgariser l’opéra à la télévision. Demeurée le symbole d’une Toulousaine amoureuse de beau chant, portant haut les couleurs de Toulouse au plan international, Mady Mesplé, la soprano à la qualité de voix exceptionnelle aura abordé la plupart de ses grands rôles à l’Opéra national de Paris dans les années 50 et se sera produite sur les plus grandes scènes du monde. Elle aura brillé au firmament des plus grandes cantatrices du XXe siècle et demeure inégalée dans son répertoire, qui allait du grand opéra (Rossini, Donizetti, Delibes…) à l’opérette (Strauss, Offenbach…). Une voix brillante comme un diamant avec des aigus et des suraigus et une femme simple qui répondait courtoisement aux gens qui l'abordaient dans la rue. « Elle pouvait tout interpréter, avec justesse et sensibilité et aura contribué à faire rayonner notre culture sur les scènes du monde entier », a tweeté le ministre de la Culture Franck Riester. Elle avait chanté sur les plus grandes scènes, visitant le monde et c’est pourtant dans la vallée d’Aure et plus précisément à Saint-Lary-Soulan qu’elle avait choisi de poser ses valises, chaque fois qu’elle le pouvait. Elle était arrivée par hasard en vallée d’Aure avec des amis. Ce fut le coup de foudre immédiat. Et la décision aussi : « Je veux un appartement ici, tout de suite ». Mady était comme ça, prompte à aimer, prompte à donner et à partager. Ce sera d’abord un petit studio, puis un appartement plus grand. Elle adorait la vallée d’Aure et Saint-Lary, où elle venait passer tous les étés et beaucoup de fêtes et de vacances, et où elle avait noué de solides amitiés, en particulier avec le Père Francis Tisné. Une grande amitié, une immense complicité unissaient ces deux personnalités enthousiastes et créatives. Elle avait accepté d’être l’active Présidente d’honneur de l’association du Festival des Petites Églises de montagne, créée en 2006. Grâce au Festival, elle rencontrait de nombreux amis. Elle y amènera des mélomanes aussi, et d’abord, celle qui en est aujourd’hui directrice artistique, Bernadette Fantin Epstein. Avec Gisèle sa sœur, elle parcourait les vallées : du côté espagnol que la chanteuse adorait, mais aussi au barrage de Cap de Long, où la cantatrice avait sympathisé avec Athos, le chien de Francis Tougne, qui tient le restaurant tout là-haut. Elle appréciait aussi le Relais du Néouvielle à Fabian, où elle avait organisé un concert improvisé avec un groupe « Talin » venu jouer pour le Festival. Elle aimait danser, faire la fête, bien manger et avait un appétit effrayant pour quelqu’un d’aussi mince. Mady était gourmande de la vie. Elle adorait aussi aller promener au col d’Aspin. À la fin de sa vie, seule la maladie de Parkinson dont elle était atteinte l'a tenue à l'écart du Théâtre du Capitole, où elle avait ses habitudes depuis son enfance. Elle était l’une des dernières sopranos coloratures mythiques de l’après-guerre. Et malgré une carrière internationale exceptionnelle, elle n’avait pas oublié pour autant ses racines toulousaines et occitanes, ni son amour pour la vallée d’Aure et le chant. Elle était décrite comme un bourreau de travail, une boulimique de musique. Elle s'étonnait que les élèves du conservatoire n'aient aujourd'hui "qu'une heure et quart de solfège par jour alors qu'on en avait six à mon époque". Le 5 novembre 2019, dans le Salon Rouge du Capitole, le Président Nicolas Sarkozy, en présence de Monsieur Jean-luc Moudenc, de M. le Préfet, des directeurs du Théâtre du Capitole et du Ballet du Capitole, avait tenu à remettre lui-même à Mady Mesplé la Grand-Croix dans l'Ordre national du Mérite, le plus haut échelon de cet ordre, une distinction qui rend hommage à une voix remarquable et à une longue carrière qui a vu la Toulousaine traverser les époques au service des plus grands rôles de l’opéra. Le mardi 21 avril 2015, Georges Prêtre avait déjà remis dans la salle des Illustres au Capitole de Toulouse les insignes de Grand officier de la Légion d'honneur à Mady Mesplé. Le prestigieux chef d'orchestre, qui avait dirigé l'orchestre national du Capitole dans les années 50. Georges Prêtre, lui-même Grand officier de la Légion d'honneur, était un ami de longue date de la soprano colorature. Et aussi en 2011, elle avait reçu le grand prix de l'Académie Charles-Cros pour l’ensemble de sa carrière. Elle a été inhumée au cimetière de Terre-Cabade à Toulouse.MIR Isabelle (1949-XXXX)
Skieuse alpine médaillée olympique
 Isabelle MIR, née le 2 mars 1949 à Saint-Lary-Soulan, est la fille de Vincent Mir, ancien maire de Saint-Lary-Soulan et la cousine de Jean-Henri Mir, maire de Saint-Lary-Soulan, joueur de rugby à XV et vainqueur du Grand Chelem en 1968. Skieuse alpine, elle est considérée comme l’une des plus grandes descendeuses de l’histoire du ski français. Dans cette discipline, elle a remporté deux médailles d’argent en descente, aux Jeux olympiques de Grenoble en 1968 et aux Championnats du monde de 1970 à Val Gardena en Italie, ainsi que deux globes de cristal en 1968 et 1970. Elle aura remporté un total de neuf victoires en Coupe du monde : 8 descentes et 1 géant. Elle fut championne de France de descente en 1968 et 1970 et vainqueur du slalom en 1970 à Garmisch, en Allemagne. Elle formait à l’époque un duo très énergique avec la Béarnaise, Annie Famose, championne du monde de slalom en 1966, à Portillo au Chili et double médaillée (argent et bronze) aux Jeux olympiques de Grenoble en 1968. À 18 ans déjà, elle enlevait sa première descente du circuit mondial à Franconia, dans l’Est des États-Unis. Elle termina à la quatrième place lors de l’édition des Jeux olympiques d’hiver de 1972, à Sapporo au Japon. Elle sera exclue de l’équipe nationale par les dirigeants de l’époque pour avoir exprimé son souhait d’effectuer son entraînement d’été aux États-Unis. En 1974, elle rachète avec sa complice béarnaise un magasin de location de skis à Avoriaz. En 1975, elle montera encore avec son amie Annie Famose, le « Village des enfants », une école de ski à Avoriaz, qui accueille les enfants et adolescents de 3 ans à 16 ans et qui a fêté en 2015 ses 40 ans. Puis dans les années 80, elle quittera l’aventure et revendra ses magasins de sport pour faire du consulting dans le tourisme. En 2006, elle fera partie de l’ouvrage photographique "Téléphérique pour l’enfance", dont Avoriaz fournit le décor.
Isabelle MIR, née le 2 mars 1949 à Saint-Lary-Soulan, est la fille de Vincent Mir, ancien maire de Saint-Lary-Soulan et la cousine de Jean-Henri Mir, maire de Saint-Lary-Soulan, joueur de rugby à XV et vainqueur du Grand Chelem en 1968. Skieuse alpine, elle est considérée comme l’une des plus grandes descendeuses de l’histoire du ski français. Dans cette discipline, elle a remporté deux médailles d’argent en descente, aux Jeux olympiques de Grenoble en 1968 et aux Championnats du monde de 1970 à Val Gardena en Italie, ainsi que deux globes de cristal en 1968 et 1970. Elle aura remporté un total de neuf victoires en Coupe du monde : 8 descentes et 1 géant. Elle fut championne de France de descente en 1968 et 1970 et vainqueur du slalom en 1970 à Garmisch, en Allemagne. Elle formait à l’époque un duo très énergique avec la Béarnaise, Annie Famose, championne du monde de slalom en 1966, à Portillo au Chili et double médaillée (argent et bronze) aux Jeux olympiques de Grenoble en 1968. À 18 ans déjà, elle enlevait sa première descente du circuit mondial à Franconia, dans l’Est des États-Unis. Elle termina à la quatrième place lors de l’édition des Jeux olympiques d’hiver de 1972, à Sapporo au Japon. Elle sera exclue de l’équipe nationale par les dirigeants de l’époque pour avoir exprimé son souhait d’effectuer son entraînement d’été aux États-Unis. En 1974, elle rachète avec sa complice béarnaise un magasin de location de skis à Avoriaz. En 1975, elle montera encore avec son amie Annie Famose, le « Village des enfants », une école de ski à Avoriaz, qui accueille les enfants et adolescents de 3 ans à 16 ans et qui a fêté en 2015 ses 40 ans. Puis dans les années 80, elle quittera l’aventure et revendra ses magasins de sport pour faire du consulting dans le tourisme. En 2006, elle fera partie de l’ouvrage photographique "Téléphérique pour l’enfance", dont Avoriaz fournit le décor.
 Isabelle MIR, née le 2 mars 1949 à Saint-Lary-Soulan, est la fille de Vincent Mir, ancien maire de Saint-Lary-Soulan et la cousine de Jean-Henri Mir, maire de Saint-Lary-Soulan, joueur de rugby à XV et vainqueur du Grand Chelem en 1968. Skieuse alpine, elle est considérée comme l’une des plus grandes descendeuses de l’histoire du ski français. Dans cette discipline, elle a remporté deux médailles d’argent en descente, aux Jeux olympiques de Grenoble en 1968 et aux Championnats du monde de 1970 à Val Gardena en Italie, ainsi que deux globes de cristal en 1968 et 1970. Elle aura remporté un total de neuf victoires en Coupe du monde : 8 descentes et 1 géant. Elle fut championne de France de descente en 1968 et 1970 et vainqueur du slalom en 1970 à Garmisch, en Allemagne. Elle formait à l’époque un duo très énergique avec la Béarnaise, Annie Famose, championne du monde de slalom en 1966, à Portillo au Chili et double médaillée (argent et bronze) aux Jeux olympiques de Grenoble en 1968. À 18 ans déjà, elle enlevait sa première descente du circuit mondial à Franconia, dans l’Est des États-Unis. Elle termina à la quatrième place lors de l’édition des Jeux olympiques d’hiver de 1972, à Sapporo au Japon. Elle sera exclue de l’équipe nationale par les dirigeants de l’époque pour avoir exprimé son souhait d’effectuer son entraînement d’été aux États-Unis. En 1974, elle rachète avec sa complice béarnaise un magasin de location de skis à Avoriaz. En 1975, elle montera encore avec son amie Annie Famose, le « Village des enfants », une école de ski à Avoriaz, qui accueille les enfants et adolescents de 3 ans à 16 ans et qui a fêté en 2015 ses 40 ans. Puis dans les années 80, elle quittera l’aventure et revendra ses magasins de sport pour faire du consulting dans le tourisme. En 2006, elle fera partie de l’ouvrage photographique "Téléphérique pour l’enfance", dont Avoriaz fournit le décor.
Isabelle MIR, née le 2 mars 1949 à Saint-Lary-Soulan, est la fille de Vincent Mir, ancien maire de Saint-Lary-Soulan et la cousine de Jean-Henri Mir, maire de Saint-Lary-Soulan, joueur de rugby à XV et vainqueur du Grand Chelem en 1968. Skieuse alpine, elle est considérée comme l’une des plus grandes descendeuses de l’histoire du ski français. Dans cette discipline, elle a remporté deux médailles d’argent en descente, aux Jeux olympiques de Grenoble en 1968 et aux Championnats du monde de 1970 à Val Gardena en Italie, ainsi que deux globes de cristal en 1968 et 1970. Elle aura remporté un total de neuf victoires en Coupe du monde : 8 descentes et 1 géant. Elle fut championne de France de descente en 1968 et 1970 et vainqueur du slalom en 1970 à Garmisch, en Allemagne. Elle formait à l’époque un duo très énergique avec la Béarnaise, Annie Famose, championne du monde de slalom en 1966, à Portillo au Chili et double médaillée (argent et bronze) aux Jeux olympiques de Grenoble en 1968. À 18 ans déjà, elle enlevait sa première descente du circuit mondial à Franconia, dans l’Est des États-Unis. Elle termina à la quatrième place lors de l’édition des Jeux olympiques d’hiver de 1972, à Sapporo au Japon. Elle sera exclue de l’équipe nationale par les dirigeants de l’époque pour avoir exprimé son souhait d’effectuer son entraînement d’été aux États-Unis. En 1974, elle rachète avec sa complice béarnaise un magasin de location de skis à Avoriaz. En 1975, elle montera encore avec son amie Annie Famose, le « Village des enfants », une école de ski à Avoriaz, qui accueille les enfants et adolescents de 3 ans à 16 ans et qui a fêté en 2015 ses 40 ans. Puis dans les années 80, elle quittera l’aventure et revendra ses magasins de sport pour faire du consulting dans le tourisme. En 2006, elle fera partie de l’ouvrage photographique "Téléphérique pour l’enfance", dont Avoriaz fournit le décor.MOMPOU Frédéric (1893-1987)
Compositeur et pianiste espagnol
 Frédéric MOMPOU i DENCAUSSE, Né au Poble Sec à Barcelone le 16 avril 1893 de mère française (Joséphine Dencausse) et de père catalan (Frédéric Mompou) et mort à Barcelone le 30 juin 1987, à l’âge de 94 ans. Il est issu d’une famille aisée catalane avec des racines françaises. Ses grands-parents maternels, originaires de Tarbes, étaient propriétaires d’une fonderie de cloches (les cloches Dencausse). D’ailleurs on retrouve dans son œuvre de nombreuses allusions à ce thème, comme dans « La fontaine et la cloche », « Música callada (ou la voix du silence) » (n° 5, 8 et 9) ou encore dans le dernier « charme », « Pour appeler la joie ». Le père de Josefina et son oncle étaient venus à Barcelone au milieu du XIXe siècle pour y installer une succursale de la fonderie de cloches que possédait la famille Dencausse à Tarbes. La nouvelle fonderie était située au pied de la butte de Montjuïc. II est possible que la fascination pour le son que manifesta Frédéric Mompou dès son enfance provienne de ces cloches et de leurs résonnances harmoniques. À chaque fois qu’il se rendait à la fonderie, il se sentait attiré par la musique qui emplissait la nef industrielle et essayait de percevoir la note exacte de chaque cloche. « J’aime les accords qui ont une sonorité de cloche », disait-il. Son frère Josep Mompou (1888-1968) est lui devenu peintre. Frédéric Mompou reçoit ses premières leçons de piano d’une de ses tantes. Il fréquente l’école française de Barcelone et suit des études musicales à l’Orfeo Barcelonais avec Pedro Serra. Il donne son premier concert public le 4 mai 1908 et profite de l’occasion pour abandonner l’école. Il semble que l’envie de devenir compositeur lui est venue de l’audition du Quintette pour piano et cordes en fa de Gabriel Fauré interprété par le compositeur en avril 1909 à la Salle Mozart de Barcelone. Le début de son recueil les Impressions intimes date de 1911 et fixe définitivement son style d’improvisation notée. Recommandé par Enrique Granados auprès de Gabriel Fauré alors directeur du Conservatoire de Paris, de Louis Diemer (1843-1919) et d’Isidore Philipp qui y sont professeurs, ainsi qu’auprès de Ricardo Viñes par un violoniste de connaissance, il s’installe à Paris en octobre 1911 dans le but de poursuivre ses études musicales. Il suit des cours de piano avec Diemer et de composition avec Émile Pessard, mais renonce à entrer au Conservatoire. Isidore Philipp le recommande à Ferdinand Motte-Lacroix qui fait alors une belle carrière de pianiste et enseigne dans les années 1920 au Conservatoire de Strasbourg. Il suit sans intérêt et sans succès quelques cours d’harmonie avec Samuel Rousseau. Il passe l’été 1912 à Barcelone, de retour à Paris il s’installe à Montmartre, continue ses études avec Motte-Lacroix, retourne faire son service militaire en Espagne, où il restera jusqu’en 1920. Il est rapidement réformé, renonce à la carrière de pianiste, ébauche quelques pages de théorie esthétique et achève les Impressions intimes en 1914. En 1915 il compose Jeux sur la plage et les Scènes d’enfants. La même année il fait la connaissance du compositeur Manuel Blancafort (1897-1987), dont le père qui fabrique des rouleaux pour des instruments mécaniques (la firme Victoria) est propriétaire de l’établissement thermal de La Garriga. Mompou passe une jeunesse dorée. Il rencontre Manuel de Falla ou Prokofiev au cours de réceptions organisées par sa mère dans la grande maison familiale. Il rencontre aussi Arthur Rubinstein avec lequel il fait le tour des cafés et cabarets de la ville. En 1920, sur l’intervention du pianiste Agustin Quintas, l’Unión Musical Española édite ses Chants magiques dédiés à Motte-Lacroix, qui connaissent un certain succès. En 1920, il revient à Paris, où Motte-Lacroix et Vuillermoz lui assurent une bonne publicité, mais avant de rencontrer Vuillermoz qui a préparé un entretien, il entre précipitamment à Barcelone. Il est de nouveau à Paris en 1921 pour un concert de Motte-Lacroix, qui a mis de ses œuvres à son programme. C’est un succès qui l’introduit dans les salons parisiens. En 1923, il s’installe à Paris, dès lors sa terre d’adoption, où il restera jusqu’en 1941 sans pour autant changer son mode de vie ni mener une existence mondaine. Il est cependant en relation avec la « haute société » et des personnalités des arts et des lettres comme Paul Valéry, dont il utilisera les textes dans certaines de ses compositions, ou Heitor Villa-Lobos, Francis Poulenc et Darius Milhaud. C’est aussi en 1923, qu’il a une liaison avec Maria ***, une femme mariée dont il gère les biens. En 1924, il crée une société de chocolats glacés en Espagne qui fait rapidement faillite. À Paris, il tente sans y réussir d’écrire un quatuor à cordes et transcrit le premier concerto de Paganini pour violon et piano à la demande du violoniste Ramon Borras. En 1927, il passe l’été à Dinard avec son amante et commence la composition de ses Préludes. Il passe également l’été 1928 à Dinard avec sa famille et un ami de sa mère Lluis Duran I Ventosa. En 1931, il se joint à quelques compositeurs catalans au sein d’un groupe des « Compositeurs Indépendants de Catalogne » qui ne survit pas à un premier concert à Barcelone. Jusqu’en 1937, sujet à de nouvelles crises de neurasthénie, il ne compose plus. Son frère est atteint de tuberculose et très malade, son père décède en mars 1935, et sa mère se remarie avec Lluis Duran I Ventosa en octobre 1938. Il les accompagne en voyage de noces en Italie, mais reste à Paris, puis gagne Biarritz avec son amante quand la guerre éclate, alors que sa famille rejoint Barcelone, qu’il regagne lui-même en 1941, fuyant l’occupation allemande de Paris et s’y fixe définitivement. La guerre civile espagnole le troublera également beaucoup. Durant son séjour à Paris, sa production se ralentit, mais il compose néanmoins les Chansons et danses n°1 à 4, les Préludes n°1 à 6, Dialogues, Souvenirs de l’Exposition, Variations sur un thème de Chopin, Cançoneta incerta, Trois comptines et Quatre mélodies. De retour en Catalogne en 1941, la même année, à l’occasion d’un concours de piano, il rencontre une jeune candidate pianiste, Carmen Bravo, avec laquelle il lie une longue et fructueuse amitié qui aboutira à un mariage en 1957, à l’âge de 64 ans. Elle était de 30 ans sa cadette. Il compose à nouveau, retrouve la notoriété et reçoit des reconnaissances officielles tant de la France que de l’Espagne. Sa musique a un grand succès en Angleterre. En 1955, la création d’un ballet sur plusieurs de ses compositions est un triomphe. Il est invité par Ségovia à donner des conférences à l’Académie d’été de Santiago de Compostelle. En 1962, il compose la Suite Compostelana dédiée à Ségovia. Une hémorragie cérébrale met fin à ses activités en 1978. Il meurt le 30 juin 1987, à l’âge de 94 ans, dans sa maison du passeig de Gràcia de Barcelone. Il est enterré au cimetière de Montjuïc à Barcelone. Son épouse meurt en 2007. Après la mort de sa veuve environ 80 œuvres inédites et jusque-là inconnues ont été découvertes dans les dossiers de Mompou à son domicile et dans les fichiers de la Bibliothèque nationale de Catalogne. Sa musique est principalement dédiée au piano. Son écriture se caractérise par une grande simplicité notamment par l’absence de barres de mesure lui permettant ainsi une grande souplesse dans ses mélodies. Il aura passé une majeure partie de sa vie à Paris où il étudia le piano et la composition avec Marcel Samuel-Rousseau. 6 œuvres 1911-1914 : Impressions intimes ; 1914-1917 : Les Crèches ; 1915-1918 : Scènes d’enfants et Jeunes filles au jardin ; 1916-1917 : Suburbis ; 1917-1919 : Cantos magicos ; 1921 : Trois Variations. Frederic Mompou est sans doute le compositeur le plus représentatif de l’histoire de la musique catalane. Il est celui qui donna à l’âme de la musique catalane une réelle projection universelle. Il a également été influencé par les sons et les odeurs du quartier maritime de Barcelone, le cri des mouettes, le bruit des enfants qui jouent et la culture populaire catalane. Comme le dit Vladimir Jankélévitch, « Mompou n’a jamais prétendu être un folkloriste ; mais il aime et utilise le chant populaire, le chant populaire catalan, et parfois aussi il le réinvente ; il est lui-même l’âme chantante de la Catalogne ». Mais, si Mompou refuse d’être un folkloriste, et bien que toutes ses compositions soient inspirées de thèmes traditionnels catalans, il rejette aussi l’appellation de compositeur nationaliste. « Je n’aime pas qu’on dise de moi que je suis un compositeur nationaliste. Toute ma musique est imprégnée de l’esprit catalan, grâce à l’utilisation d’accords ou de sonorités déterminés. Je n’ai jamais utilisé un seul thème de façon directe. » Il disait aussi : « je crois, tout simplement, que je suis une musique, une musique dont je suis convaincu que ce n’est pas moi qui la fais, car j’ai toujours la sensation qu’elle vient en moi de dehors. » Comment un être aussi intuitif a-t-il pu composer une œuvre aussi vaste dont l’intégrale pour piano représente l’un des apports les plus singuliers et considérables du répertoire pianistique du XXe siècle ? Au cours de sa carrière, Frédéric Mompou a reçu de nombreux prix, dont : Chevalier des Arts et Lettres en France, el Premio Nacional de Música en Espagne, Docteur honoris causa, Universitat de Barcelona (1979) et la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (1980). Frédéric Mompou a produit une œuvre féconde, s’étendant sur plus d’un demi-siècle, et d’une originalité intéressant chaque jour davantage surtout les jeunes, qui sont séduits par cette œuvre cohérente d’une extraordinaire beauté. De toute sa création, qui est sans nul doute une des plus importantes productions pour le piano du XXe siècle, ses œuvres vocales et pour piano, et pour piano seul sont les plus marquantes. Le piano y occupe une place si importante que l’on a souvent l’impression qu’il constitue un prolongement du musicien, qui considérait d’ailleurs que seul cet instrument était capable d’établir un contact avec la matière sonore.
Frédéric MOMPOU i DENCAUSSE, Né au Poble Sec à Barcelone le 16 avril 1893 de mère française (Joséphine Dencausse) et de père catalan (Frédéric Mompou) et mort à Barcelone le 30 juin 1987, à l’âge de 94 ans. Il est issu d’une famille aisée catalane avec des racines françaises. Ses grands-parents maternels, originaires de Tarbes, étaient propriétaires d’une fonderie de cloches (les cloches Dencausse). D’ailleurs on retrouve dans son œuvre de nombreuses allusions à ce thème, comme dans « La fontaine et la cloche », « Música callada (ou la voix du silence) » (n° 5, 8 et 9) ou encore dans le dernier « charme », « Pour appeler la joie ». Le père de Josefina et son oncle étaient venus à Barcelone au milieu du XIXe siècle pour y installer une succursale de la fonderie de cloches que possédait la famille Dencausse à Tarbes. La nouvelle fonderie était située au pied de la butte de Montjuïc. II est possible que la fascination pour le son que manifesta Frédéric Mompou dès son enfance provienne de ces cloches et de leurs résonnances harmoniques. À chaque fois qu’il se rendait à la fonderie, il se sentait attiré par la musique qui emplissait la nef industrielle et essayait de percevoir la note exacte de chaque cloche. « J’aime les accords qui ont une sonorité de cloche », disait-il. Son frère Josep Mompou (1888-1968) est lui devenu peintre. Frédéric Mompou reçoit ses premières leçons de piano d’une de ses tantes. Il fréquente l’école française de Barcelone et suit des études musicales à l’Orfeo Barcelonais avec Pedro Serra. Il donne son premier concert public le 4 mai 1908 et profite de l’occasion pour abandonner l’école. Il semble que l’envie de devenir compositeur lui est venue de l’audition du Quintette pour piano et cordes en fa de Gabriel Fauré interprété par le compositeur en avril 1909 à la Salle Mozart de Barcelone. Le début de son recueil les Impressions intimes date de 1911 et fixe définitivement son style d’improvisation notée. Recommandé par Enrique Granados auprès de Gabriel Fauré alors directeur du Conservatoire de Paris, de Louis Diemer (1843-1919) et d’Isidore Philipp qui y sont professeurs, ainsi qu’auprès de Ricardo Viñes par un violoniste de connaissance, il s’installe à Paris en octobre 1911 dans le but de poursuivre ses études musicales. Il suit des cours de piano avec Diemer et de composition avec Émile Pessard, mais renonce à entrer au Conservatoire. Isidore Philipp le recommande à Ferdinand Motte-Lacroix qui fait alors une belle carrière de pianiste et enseigne dans les années 1920 au Conservatoire de Strasbourg. Il suit sans intérêt et sans succès quelques cours d’harmonie avec Samuel Rousseau. Il passe l’été 1912 à Barcelone, de retour à Paris il s’installe à Montmartre, continue ses études avec Motte-Lacroix, retourne faire son service militaire en Espagne, où il restera jusqu’en 1920. Il est rapidement réformé, renonce à la carrière de pianiste, ébauche quelques pages de théorie esthétique et achève les Impressions intimes en 1914. En 1915 il compose Jeux sur la plage et les Scènes d’enfants. La même année il fait la connaissance du compositeur Manuel Blancafort (1897-1987), dont le père qui fabrique des rouleaux pour des instruments mécaniques (la firme Victoria) est propriétaire de l’établissement thermal de La Garriga. Mompou passe une jeunesse dorée. Il rencontre Manuel de Falla ou Prokofiev au cours de réceptions organisées par sa mère dans la grande maison familiale. Il rencontre aussi Arthur Rubinstein avec lequel il fait le tour des cafés et cabarets de la ville. En 1920, sur l’intervention du pianiste Agustin Quintas, l’Unión Musical Española édite ses Chants magiques dédiés à Motte-Lacroix, qui connaissent un certain succès. En 1920, il revient à Paris, où Motte-Lacroix et Vuillermoz lui assurent une bonne publicité, mais avant de rencontrer Vuillermoz qui a préparé un entretien, il entre précipitamment à Barcelone. Il est de nouveau à Paris en 1921 pour un concert de Motte-Lacroix, qui a mis de ses œuvres à son programme. C’est un succès qui l’introduit dans les salons parisiens. En 1923, il s’installe à Paris, dès lors sa terre d’adoption, où il restera jusqu’en 1941 sans pour autant changer son mode de vie ni mener une existence mondaine. Il est cependant en relation avec la « haute société » et des personnalités des arts et des lettres comme Paul Valéry, dont il utilisera les textes dans certaines de ses compositions, ou Heitor Villa-Lobos, Francis Poulenc et Darius Milhaud. C’est aussi en 1923, qu’il a une liaison avec Maria ***, une femme mariée dont il gère les biens. En 1924, il crée une société de chocolats glacés en Espagne qui fait rapidement faillite. À Paris, il tente sans y réussir d’écrire un quatuor à cordes et transcrit le premier concerto de Paganini pour violon et piano à la demande du violoniste Ramon Borras. En 1927, il passe l’été à Dinard avec son amante et commence la composition de ses Préludes. Il passe également l’été 1928 à Dinard avec sa famille et un ami de sa mère Lluis Duran I Ventosa. En 1931, il se joint à quelques compositeurs catalans au sein d’un groupe des « Compositeurs Indépendants de Catalogne » qui ne survit pas à un premier concert à Barcelone. Jusqu’en 1937, sujet à de nouvelles crises de neurasthénie, il ne compose plus. Son frère est atteint de tuberculose et très malade, son père décède en mars 1935, et sa mère se remarie avec Lluis Duran I Ventosa en octobre 1938. Il les accompagne en voyage de noces en Italie, mais reste à Paris, puis gagne Biarritz avec son amante quand la guerre éclate, alors que sa famille rejoint Barcelone, qu’il regagne lui-même en 1941, fuyant l’occupation allemande de Paris et s’y fixe définitivement. La guerre civile espagnole le troublera également beaucoup. Durant son séjour à Paris, sa production se ralentit, mais il compose néanmoins les Chansons et danses n°1 à 4, les Préludes n°1 à 6, Dialogues, Souvenirs de l’Exposition, Variations sur un thème de Chopin, Cançoneta incerta, Trois comptines et Quatre mélodies. De retour en Catalogne en 1941, la même année, à l’occasion d’un concours de piano, il rencontre une jeune candidate pianiste, Carmen Bravo, avec laquelle il lie une longue et fructueuse amitié qui aboutira à un mariage en 1957, à l’âge de 64 ans. Elle était de 30 ans sa cadette. Il compose à nouveau, retrouve la notoriété et reçoit des reconnaissances officielles tant de la France que de l’Espagne. Sa musique a un grand succès en Angleterre. En 1955, la création d’un ballet sur plusieurs de ses compositions est un triomphe. Il est invité par Ségovia à donner des conférences à l’Académie d’été de Santiago de Compostelle. En 1962, il compose la Suite Compostelana dédiée à Ségovia. Une hémorragie cérébrale met fin à ses activités en 1978. Il meurt le 30 juin 1987, à l’âge de 94 ans, dans sa maison du passeig de Gràcia de Barcelone. Il est enterré au cimetière de Montjuïc à Barcelone. Son épouse meurt en 2007. Après la mort de sa veuve environ 80 œuvres inédites et jusque-là inconnues ont été découvertes dans les dossiers de Mompou à son domicile et dans les fichiers de la Bibliothèque nationale de Catalogne. Sa musique est principalement dédiée au piano. Son écriture se caractérise par une grande simplicité notamment par l’absence de barres de mesure lui permettant ainsi une grande souplesse dans ses mélodies. Il aura passé une majeure partie de sa vie à Paris où il étudia le piano et la composition avec Marcel Samuel-Rousseau. 6 œuvres 1911-1914 : Impressions intimes ; 1914-1917 : Les Crèches ; 1915-1918 : Scènes d’enfants et Jeunes filles au jardin ; 1916-1917 : Suburbis ; 1917-1919 : Cantos magicos ; 1921 : Trois Variations. Frederic Mompou est sans doute le compositeur le plus représentatif de l’histoire de la musique catalane. Il est celui qui donna à l’âme de la musique catalane une réelle projection universelle. Il a également été influencé par les sons et les odeurs du quartier maritime de Barcelone, le cri des mouettes, le bruit des enfants qui jouent et la culture populaire catalane. Comme le dit Vladimir Jankélévitch, « Mompou n’a jamais prétendu être un folkloriste ; mais il aime et utilise le chant populaire, le chant populaire catalan, et parfois aussi il le réinvente ; il est lui-même l’âme chantante de la Catalogne ». Mais, si Mompou refuse d’être un folkloriste, et bien que toutes ses compositions soient inspirées de thèmes traditionnels catalans, il rejette aussi l’appellation de compositeur nationaliste. « Je n’aime pas qu’on dise de moi que je suis un compositeur nationaliste. Toute ma musique est imprégnée de l’esprit catalan, grâce à l’utilisation d’accords ou de sonorités déterminés. Je n’ai jamais utilisé un seul thème de façon directe. » Il disait aussi : « je crois, tout simplement, que je suis une musique, une musique dont je suis convaincu que ce n’est pas moi qui la fais, car j’ai toujours la sensation qu’elle vient en moi de dehors. » Comment un être aussi intuitif a-t-il pu composer une œuvre aussi vaste dont l’intégrale pour piano représente l’un des apports les plus singuliers et considérables du répertoire pianistique du XXe siècle ? Au cours de sa carrière, Frédéric Mompou a reçu de nombreux prix, dont : Chevalier des Arts et Lettres en France, el Premio Nacional de Música en Espagne, Docteur honoris causa, Universitat de Barcelona (1979) et la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (1980). Frédéric Mompou a produit une œuvre féconde, s’étendant sur plus d’un demi-siècle, et d’une originalité intéressant chaque jour davantage surtout les jeunes, qui sont séduits par cette œuvre cohérente d’une extraordinaire beauté. De toute sa création, qui est sans nul doute une des plus importantes productions pour le piano du XXe siècle, ses œuvres vocales et pour piano, et pour piano seul sont les plus marquantes. Le piano y occupe une place si importante que l’on a souvent l’impression qu’il constitue un prolongement du musicien, qui considérait d’ailleurs que seul cet instrument était capable d’établir un contact avec la matière sonore.
 Frédéric MOMPOU i DENCAUSSE, Né au Poble Sec à Barcelone le 16 avril 1893 de mère française (Joséphine Dencausse) et de père catalan (Frédéric Mompou) et mort à Barcelone le 30 juin 1987, à l’âge de 94 ans. Il est issu d’une famille aisée catalane avec des racines françaises. Ses grands-parents maternels, originaires de Tarbes, étaient propriétaires d’une fonderie de cloches (les cloches Dencausse). D’ailleurs on retrouve dans son œuvre de nombreuses allusions à ce thème, comme dans « La fontaine et la cloche », « Música callada (ou la voix du silence) » (n° 5, 8 et 9) ou encore dans le dernier « charme », « Pour appeler la joie ». Le père de Josefina et son oncle étaient venus à Barcelone au milieu du XIXe siècle pour y installer une succursale de la fonderie de cloches que possédait la famille Dencausse à Tarbes. La nouvelle fonderie était située au pied de la butte de Montjuïc. II est possible que la fascination pour le son que manifesta Frédéric Mompou dès son enfance provienne de ces cloches et de leurs résonnances harmoniques. À chaque fois qu’il se rendait à la fonderie, il se sentait attiré par la musique qui emplissait la nef industrielle et essayait de percevoir la note exacte de chaque cloche. « J’aime les accords qui ont une sonorité de cloche », disait-il. Son frère Josep Mompou (1888-1968) est lui devenu peintre. Frédéric Mompou reçoit ses premières leçons de piano d’une de ses tantes. Il fréquente l’école française de Barcelone et suit des études musicales à l’Orfeo Barcelonais avec Pedro Serra. Il donne son premier concert public le 4 mai 1908 et profite de l’occasion pour abandonner l’école. Il semble que l’envie de devenir compositeur lui est venue de l’audition du Quintette pour piano et cordes en fa de Gabriel Fauré interprété par le compositeur en avril 1909 à la Salle Mozart de Barcelone. Le début de son recueil les Impressions intimes date de 1911 et fixe définitivement son style d’improvisation notée. Recommandé par Enrique Granados auprès de Gabriel Fauré alors directeur du Conservatoire de Paris, de Louis Diemer (1843-1919) et d’Isidore Philipp qui y sont professeurs, ainsi qu’auprès de Ricardo Viñes par un violoniste de connaissance, il s’installe à Paris en octobre 1911 dans le but de poursuivre ses études musicales. Il suit des cours de piano avec Diemer et de composition avec Émile Pessard, mais renonce à entrer au Conservatoire. Isidore Philipp le recommande à Ferdinand Motte-Lacroix qui fait alors une belle carrière de pianiste et enseigne dans les années 1920 au Conservatoire de Strasbourg. Il suit sans intérêt et sans succès quelques cours d’harmonie avec Samuel Rousseau. Il passe l’été 1912 à Barcelone, de retour à Paris il s’installe à Montmartre, continue ses études avec Motte-Lacroix, retourne faire son service militaire en Espagne, où il restera jusqu’en 1920. Il est rapidement réformé, renonce à la carrière de pianiste, ébauche quelques pages de théorie esthétique et achève les Impressions intimes en 1914. En 1915 il compose Jeux sur la plage et les Scènes d’enfants. La même année il fait la connaissance du compositeur Manuel Blancafort (1897-1987), dont le père qui fabrique des rouleaux pour des instruments mécaniques (la firme Victoria) est propriétaire de l’établissement thermal de La Garriga. Mompou passe une jeunesse dorée. Il rencontre Manuel de Falla ou Prokofiev au cours de réceptions organisées par sa mère dans la grande maison familiale. Il rencontre aussi Arthur Rubinstein avec lequel il fait le tour des cafés et cabarets de la ville. En 1920, sur l’intervention du pianiste Agustin Quintas, l’Unión Musical Española édite ses Chants magiques dédiés à Motte-Lacroix, qui connaissent un certain succès. En 1920, il revient à Paris, où Motte-Lacroix et Vuillermoz lui assurent une bonne publicité, mais avant de rencontrer Vuillermoz qui a préparé un entretien, il entre précipitamment à Barcelone. Il est de nouveau à Paris en 1921 pour un concert de Motte-Lacroix, qui a mis de ses œuvres à son programme. C’est un succès qui l’introduit dans les salons parisiens. En 1923, il s’installe à Paris, dès lors sa terre d’adoption, où il restera jusqu’en 1941 sans pour autant changer son mode de vie ni mener une existence mondaine. Il est cependant en relation avec la « haute société » et des personnalités des arts et des lettres comme Paul Valéry, dont il utilisera les textes dans certaines de ses compositions, ou Heitor Villa-Lobos, Francis Poulenc et Darius Milhaud. C’est aussi en 1923, qu’il a une liaison avec Maria ***, une femme mariée dont il gère les biens. En 1924, il crée une société de chocolats glacés en Espagne qui fait rapidement faillite. À Paris, il tente sans y réussir d’écrire un quatuor à cordes et transcrit le premier concerto de Paganini pour violon et piano à la demande du violoniste Ramon Borras. En 1927, il passe l’été à Dinard avec son amante et commence la composition de ses Préludes. Il passe également l’été 1928 à Dinard avec sa famille et un ami de sa mère Lluis Duran I Ventosa. En 1931, il se joint à quelques compositeurs catalans au sein d’un groupe des « Compositeurs Indépendants de Catalogne » qui ne survit pas à un premier concert à Barcelone. Jusqu’en 1937, sujet à de nouvelles crises de neurasthénie, il ne compose plus. Son frère est atteint de tuberculose et très malade, son père décède en mars 1935, et sa mère se remarie avec Lluis Duran I Ventosa en octobre 1938. Il les accompagne en voyage de noces en Italie, mais reste à Paris, puis gagne Biarritz avec son amante quand la guerre éclate, alors que sa famille rejoint Barcelone, qu’il regagne lui-même en 1941, fuyant l’occupation allemande de Paris et s’y fixe définitivement. La guerre civile espagnole le troublera également beaucoup. Durant son séjour à Paris, sa production se ralentit, mais il compose néanmoins les Chansons et danses n°1 à 4, les Préludes n°1 à 6, Dialogues, Souvenirs de l’Exposition, Variations sur un thème de Chopin, Cançoneta incerta, Trois comptines et Quatre mélodies. De retour en Catalogne en 1941, la même année, à l’occasion d’un concours de piano, il rencontre une jeune candidate pianiste, Carmen Bravo, avec laquelle il lie une longue et fructueuse amitié qui aboutira à un mariage en 1957, à l’âge de 64 ans. Elle était de 30 ans sa cadette. Il compose à nouveau, retrouve la notoriété et reçoit des reconnaissances officielles tant de la France que de l’Espagne. Sa musique a un grand succès en Angleterre. En 1955, la création d’un ballet sur plusieurs de ses compositions est un triomphe. Il est invité par Ségovia à donner des conférences à l’Académie d’été de Santiago de Compostelle. En 1962, il compose la Suite Compostelana dédiée à Ségovia. Une hémorragie cérébrale met fin à ses activités en 1978. Il meurt le 30 juin 1987, à l’âge de 94 ans, dans sa maison du passeig de Gràcia de Barcelone. Il est enterré au cimetière de Montjuïc à Barcelone. Son épouse meurt en 2007. Après la mort de sa veuve environ 80 œuvres inédites et jusque-là inconnues ont été découvertes dans les dossiers de Mompou à son domicile et dans les fichiers de la Bibliothèque nationale de Catalogne. Sa musique est principalement dédiée au piano. Son écriture se caractérise par une grande simplicité notamment par l’absence de barres de mesure lui permettant ainsi une grande souplesse dans ses mélodies. Il aura passé une majeure partie de sa vie à Paris où il étudia le piano et la composition avec Marcel Samuel-Rousseau. 6 œuvres 1911-1914 : Impressions intimes ; 1914-1917 : Les Crèches ; 1915-1918 : Scènes d’enfants et Jeunes filles au jardin ; 1916-1917 : Suburbis ; 1917-1919 : Cantos magicos ; 1921 : Trois Variations. Frederic Mompou est sans doute le compositeur le plus représentatif de l’histoire de la musique catalane. Il est celui qui donna à l’âme de la musique catalane une réelle projection universelle. Il a également été influencé par les sons et les odeurs du quartier maritime de Barcelone, le cri des mouettes, le bruit des enfants qui jouent et la culture populaire catalane. Comme le dit Vladimir Jankélévitch, « Mompou n’a jamais prétendu être un folkloriste ; mais il aime et utilise le chant populaire, le chant populaire catalan, et parfois aussi il le réinvente ; il est lui-même l’âme chantante de la Catalogne ». Mais, si Mompou refuse d’être un folkloriste, et bien que toutes ses compositions soient inspirées de thèmes traditionnels catalans, il rejette aussi l’appellation de compositeur nationaliste. « Je n’aime pas qu’on dise de moi que je suis un compositeur nationaliste. Toute ma musique est imprégnée de l’esprit catalan, grâce à l’utilisation d’accords ou de sonorités déterminés. Je n’ai jamais utilisé un seul thème de façon directe. » Il disait aussi : « je crois, tout simplement, que je suis une musique, une musique dont je suis convaincu que ce n’est pas moi qui la fais, car j’ai toujours la sensation qu’elle vient en moi de dehors. » Comment un être aussi intuitif a-t-il pu composer une œuvre aussi vaste dont l’intégrale pour piano représente l’un des apports les plus singuliers et considérables du répertoire pianistique du XXe siècle ? Au cours de sa carrière, Frédéric Mompou a reçu de nombreux prix, dont : Chevalier des Arts et Lettres en France, el Premio Nacional de Música en Espagne, Docteur honoris causa, Universitat de Barcelona (1979) et la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (1980). Frédéric Mompou a produit une œuvre féconde, s’étendant sur plus d’un demi-siècle, et d’une originalité intéressant chaque jour davantage surtout les jeunes, qui sont séduits par cette œuvre cohérente d’une extraordinaire beauté. De toute sa création, qui est sans nul doute une des plus importantes productions pour le piano du XXe siècle, ses œuvres vocales et pour piano, et pour piano seul sont les plus marquantes. Le piano y occupe une place si importante que l’on a souvent l’impression qu’il constitue un prolongement du musicien, qui considérait d’ailleurs que seul cet instrument était capable d’établir un contact avec la matière sonore.
Frédéric MOMPOU i DENCAUSSE, Né au Poble Sec à Barcelone le 16 avril 1893 de mère française (Joséphine Dencausse) et de père catalan (Frédéric Mompou) et mort à Barcelone le 30 juin 1987, à l’âge de 94 ans. Il est issu d’une famille aisée catalane avec des racines françaises. Ses grands-parents maternels, originaires de Tarbes, étaient propriétaires d’une fonderie de cloches (les cloches Dencausse). D’ailleurs on retrouve dans son œuvre de nombreuses allusions à ce thème, comme dans « La fontaine et la cloche », « Música callada (ou la voix du silence) » (n° 5, 8 et 9) ou encore dans le dernier « charme », « Pour appeler la joie ». Le père de Josefina et son oncle étaient venus à Barcelone au milieu du XIXe siècle pour y installer une succursale de la fonderie de cloches que possédait la famille Dencausse à Tarbes. La nouvelle fonderie était située au pied de la butte de Montjuïc. II est possible que la fascination pour le son que manifesta Frédéric Mompou dès son enfance provienne de ces cloches et de leurs résonnances harmoniques. À chaque fois qu’il se rendait à la fonderie, il se sentait attiré par la musique qui emplissait la nef industrielle et essayait de percevoir la note exacte de chaque cloche. « J’aime les accords qui ont une sonorité de cloche », disait-il. Son frère Josep Mompou (1888-1968) est lui devenu peintre. Frédéric Mompou reçoit ses premières leçons de piano d’une de ses tantes. Il fréquente l’école française de Barcelone et suit des études musicales à l’Orfeo Barcelonais avec Pedro Serra. Il donne son premier concert public le 4 mai 1908 et profite de l’occasion pour abandonner l’école. Il semble que l’envie de devenir compositeur lui est venue de l’audition du Quintette pour piano et cordes en fa de Gabriel Fauré interprété par le compositeur en avril 1909 à la Salle Mozart de Barcelone. Le début de son recueil les Impressions intimes date de 1911 et fixe définitivement son style d’improvisation notée. Recommandé par Enrique Granados auprès de Gabriel Fauré alors directeur du Conservatoire de Paris, de Louis Diemer (1843-1919) et d’Isidore Philipp qui y sont professeurs, ainsi qu’auprès de Ricardo Viñes par un violoniste de connaissance, il s’installe à Paris en octobre 1911 dans le but de poursuivre ses études musicales. Il suit des cours de piano avec Diemer et de composition avec Émile Pessard, mais renonce à entrer au Conservatoire. Isidore Philipp le recommande à Ferdinand Motte-Lacroix qui fait alors une belle carrière de pianiste et enseigne dans les années 1920 au Conservatoire de Strasbourg. Il suit sans intérêt et sans succès quelques cours d’harmonie avec Samuel Rousseau. Il passe l’été 1912 à Barcelone, de retour à Paris il s’installe à Montmartre, continue ses études avec Motte-Lacroix, retourne faire son service militaire en Espagne, où il restera jusqu’en 1920. Il est rapidement réformé, renonce à la carrière de pianiste, ébauche quelques pages de théorie esthétique et achève les Impressions intimes en 1914. En 1915 il compose Jeux sur la plage et les Scènes d’enfants. La même année il fait la connaissance du compositeur Manuel Blancafort (1897-1987), dont le père qui fabrique des rouleaux pour des instruments mécaniques (la firme Victoria) est propriétaire de l’établissement thermal de La Garriga. Mompou passe une jeunesse dorée. Il rencontre Manuel de Falla ou Prokofiev au cours de réceptions organisées par sa mère dans la grande maison familiale. Il rencontre aussi Arthur Rubinstein avec lequel il fait le tour des cafés et cabarets de la ville. En 1920, sur l’intervention du pianiste Agustin Quintas, l’Unión Musical Española édite ses Chants magiques dédiés à Motte-Lacroix, qui connaissent un certain succès. En 1920, il revient à Paris, où Motte-Lacroix et Vuillermoz lui assurent une bonne publicité, mais avant de rencontrer Vuillermoz qui a préparé un entretien, il entre précipitamment à Barcelone. Il est de nouveau à Paris en 1921 pour un concert de Motte-Lacroix, qui a mis de ses œuvres à son programme. C’est un succès qui l’introduit dans les salons parisiens. En 1923, il s’installe à Paris, dès lors sa terre d’adoption, où il restera jusqu’en 1941 sans pour autant changer son mode de vie ni mener une existence mondaine. Il est cependant en relation avec la « haute société » et des personnalités des arts et des lettres comme Paul Valéry, dont il utilisera les textes dans certaines de ses compositions, ou Heitor Villa-Lobos, Francis Poulenc et Darius Milhaud. C’est aussi en 1923, qu’il a une liaison avec Maria ***, une femme mariée dont il gère les biens. En 1924, il crée une société de chocolats glacés en Espagne qui fait rapidement faillite. À Paris, il tente sans y réussir d’écrire un quatuor à cordes et transcrit le premier concerto de Paganini pour violon et piano à la demande du violoniste Ramon Borras. En 1927, il passe l’été à Dinard avec son amante et commence la composition de ses Préludes. Il passe également l’été 1928 à Dinard avec sa famille et un ami de sa mère Lluis Duran I Ventosa. En 1931, il se joint à quelques compositeurs catalans au sein d’un groupe des « Compositeurs Indépendants de Catalogne » qui ne survit pas à un premier concert à Barcelone. Jusqu’en 1937, sujet à de nouvelles crises de neurasthénie, il ne compose plus. Son frère est atteint de tuberculose et très malade, son père décède en mars 1935, et sa mère se remarie avec Lluis Duran I Ventosa en octobre 1938. Il les accompagne en voyage de noces en Italie, mais reste à Paris, puis gagne Biarritz avec son amante quand la guerre éclate, alors que sa famille rejoint Barcelone, qu’il regagne lui-même en 1941, fuyant l’occupation allemande de Paris et s’y fixe définitivement. La guerre civile espagnole le troublera également beaucoup. Durant son séjour à Paris, sa production se ralentit, mais il compose néanmoins les Chansons et danses n°1 à 4, les Préludes n°1 à 6, Dialogues, Souvenirs de l’Exposition, Variations sur un thème de Chopin, Cançoneta incerta, Trois comptines et Quatre mélodies. De retour en Catalogne en 1941, la même année, à l’occasion d’un concours de piano, il rencontre une jeune candidate pianiste, Carmen Bravo, avec laquelle il lie une longue et fructueuse amitié qui aboutira à un mariage en 1957, à l’âge de 64 ans. Elle était de 30 ans sa cadette. Il compose à nouveau, retrouve la notoriété et reçoit des reconnaissances officielles tant de la France que de l’Espagne. Sa musique a un grand succès en Angleterre. En 1955, la création d’un ballet sur plusieurs de ses compositions est un triomphe. Il est invité par Ségovia à donner des conférences à l’Académie d’été de Santiago de Compostelle. En 1962, il compose la Suite Compostelana dédiée à Ségovia. Une hémorragie cérébrale met fin à ses activités en 1978. Il meurt le 30 juin 1987, à l’âge de 94 ans, dans sa maison du passeig de Gràcia de Barcelone. Il est enterré au cimetière de Montjuïc à Barcelone. Son épouse meurt en 2007. Après la mort de sa veuve environ 80 œuvres inédites et jusque-là inconnues ont été découvertes dans les dossiers de Mompou à son domicile et dans les fichiers de la Bibliothèque nationale de Catalogne. Sa musique est principalement dédiée au piano. Son écriture se caractérise par une grande simplicité notamment par l’absence de barres de mesure lui permettant ainsi une grande souplesse dans ses mélodies. Il aura passé une majeure partie de sa vie à Paris où il étudia le piano et la composition avec Marcel Samuel-Rousseau. 6 œuvres 1911-1914 : Impressions intimes ; 1914-1917 : Les Crèches ; 1915-1918 : Scènes d’enfants et Jeunes filles au jardin ; 1916-1917 : Suburbis ; 1917-1919 : Cantos magicos ; 1921 : Trois Variations. Frederic Mompou est sans doute le compositeur le plus représentatif de l’histoire de la musique catalane. Il est celui qui donna à l’âme de la musique catalane une réelle projection universelle. Il a également été influencé par les sons et les odeurs du quartier maritime de Barcelone, le cri des mouettes, le bruit des enfants qui jouent et la culture populaire catalane. Comme le dit Vladimir Jankélévitch, « Mompou n’a jamais prétendu être un folkloriste ; mais il aime et utilise le chant populaire, le chant populaire catalan, et parfois aussi il le réinvente ; il est lui-même l’âme chantante de la Catalogne ». Mais, si Mompou refuse d’être un folkloriste, et bien que toutes ses compositions soient inspirées de thèmes traditionnels catalans, il rejette aussi l’appellation de compositeur nationaliste. « Je n’aime pas qu’on dise de moi que je suis un compositeur nationaliste. Toute ma musique est imprégnée de l’esprit catalan, grâce à l’utilisation d’accords ou de sonorités déterminés. Je n’ai jamais utilisé un seul thème de façon directe. » Il disait aussi : « je crois, tout simplement, que je suis une musique, une musique dont je suis convaincu que ce n’est pas moi qui la fais, car j’ai toujours la sensation qu’elle vient en moi de dehors. » Comment un être aussi intuitif a-t-il pu composer une œuvre aussi vaste dont l’intégrale pour piano représente l’un des apports les plus singuliers et considérables du répertoire pianistique du XXe siècle ? Au cours de sa carrière, Frédéric Mompou a reçu de nombreux prix, dont : Chevalier des Arts et Lettres en France, el Premio Nacional de Música en Espagne, Docteur honoris causa, Universitat de Barcelona (1979) et la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (1980). Frédéric Mompou a produit une œuvre féconde, s’étendant sur plus d’un demi-siècle, et d’une originalité intéressant chaque jour davantage surtout les jeunes, qui sont séduits par cette œuvre cohérente d’une extraordinaire beauté. De toute sa création, qui est sans nul doute une des plus importantes productions pour le piano du XXe siècle, ses œuvres vocales et pour piano, et pour piano seul sont les plus marquantes. Le piano y occupe une place si importante que l’on a souvent l’impression qu’il constitue un prolongement du musicien, qui considérait d’ailleurs que seul cet instrument était capable d’établir un contact avec la matière sonore.MONTÈS Bastien (1985-XXXX)
Skieur de vitesse champion du monde
 Bastien MONTÈS, né le 17 décembre 1985 à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, est un skieur de vitesse, addict aux sports extrêmes et aux sensations fortes, voyageant à travers le monde, également freestyler et freerider. Champion du monde 2017, et skiant à plus de 251km/h, il vit actuellement à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Avec 98% de pente au départ, de 0 à 200 km/h en 5,5s son accélération est supérieure à celle d’une formule1. Le 25 mars 2017, il est sacré Champion du monde de ski de vitesse à Idre en Suède, puis remporte le Globe de cristal du classement général la même année. Il ajoutera la Triple couronne à son palmarès en s'adjugeant la victoire aux Speed Masters de Vars (Hautes-Alpes) à plus de 251km/h. Produit d'un père professeur d'EPS et moniteur de ski, et d'une mère éducatrice sportive et maître-nageuse sauveteuse (MNS), ce Pyrénéen est donc tombé dans la marmite « Sport » tout petit. Bastien a commencé le sport à l'âge de quatre ans par la gymnastique à la Bigourdane de Tarbes en compagnie de quelques têtes connues comme Mathieu Crépel ou Vincent Valéry. Mais, retenu en sélection régionale, les journées d'entraînement s'enchaînaient à trop grande vitesse pour ses parents (24h/semaine à l'âge de 11 ans) et à la suite de quelques blessures notamment au genou, Bastien a dû d'abord diminuer puis enfin arrêter la gymnastique au profit du ski. Il gardera tout de même en souvenir les titres de 3e des championnats de France FFG par équipe, champion de France FSGT et champion de France UNSS. Ses parents souhaitant en premier lieu lui faire découvrir le plus d'univers sportifs possibles, Bastien a pratiqué en plus de la gymnastique et du ski : le karaté pendant un an, la danse près de quatre ans, le snowboard deux ans (3e des championnats de France UNSS en freestyle), le rugby (vice-champion de France Universitaire N1 avec Pau), auquel il joue encore de temps à autre pour dépanner le club de chez lui, et le surf qu'il pratique depuis son plus jeune âge, devenu sa seconde passion. Ses débuts en ski ont commencé à l'âge de cinq ans, sur les pentes de la station de Gavarnie-Gèdre. Au début skieur alpin en compétition, il s'est vite tourné vers les disciplines plus « libres » comme le ski de vitesse ou le ski freestyle. Sa première descente sur une piste de kilomètre lancé (KL), s'est faite à l'âge de six ans, en « ouverture » du challenge Quiksilver de Gavarnie-Gèdre. Bastien Montès l'effectue à 48 km/h. Devenu sa passion, il a pu s'exercer lors des épreuves UNSS de Luz, Gavarnie et celles du Challenge Quiksilver national à Vars. En épreuves Jeunes, il remporte quatre titres de champion de France dans les différentes catégories. Ses débuts sur la scène internationale se sont faits dès 2003, en catégorie Junior, saison au terme de laquelle Bastien Montès remporte son 1er titre de Champion du monde Junior FIS à Salla en Finlande, et empoche le record du monde Junior catégorie descente en franchissant la barre mythique des 200,780 km/h. Le 2e sacre mondial Junior arrivera en 2005, avec sa victoire sur la piste de Breuil-Cervinia en Italie. À la suite de ces années apparaissent les premières difficultés avec l'entrée dans la catégorie Senior. L'apprentissage est difficile et début 2007 il se laisse une dernière chance jusqu'en 2008 avant de mettre un terme, ou non, à sa carrière. Les portes du succès s'ouvrent enfin avec les premières apparitions dans les 10 premiers du classement dès la fin 2007, record personnel à 239,08 km/h, avant de se placer, en 2008, 5e du Pro mondial de France et 4e de la Red Rock Cup (courses professionnelles), 6e d'une étape de Coupe du monde FIS au Canada et d'obtenir le titre de champion de France 2007 FFS toutes catégories. La consécration vient lors de la dernière épreuve de la saison avec la 3e place du Championnat du monde FIS toutes catégories, à Verbier en Suisse. « Il faut savoir qu’une descente en ski de vitesse est très courte. Tout juste 30s pendant lesquelles on fait le plein de sensations. Difficile de trouver beaucoup d’autres sports avec une telle décharge d’adrénaline. Quand tu es au sommet de la piste tu dois pouvoir rester concentré, dans ta bulle, car derrière un run à plus de 250 km/h tout peut se jouer. 98% de pente au sommet, moins de 6s pour atteindre les 200 km/h (accélération supérieure aux F1), évidemment ça fait réfléchir… Tu as forcement de l’appréhension, mais on est là pour repousser les limites, pour ce shoot d’adrénaline. Cette appréhension te permet de garder les pieds sur terre, mais en aucun cas elle ne doit se transformer en peur. Tu ne peux pas partir à reculons sur de telles pistes, l’engagement doit être total pour préserver ton intégrité. Si tu as peur, il vaut mieux refuser le départ, et cela arrive, même pour les meilleurs. Une fois lancé, c’est le grand saut dans le vide. Tu pars vers l’inconnu, tu vas peut-être atteindre une vitesse jamais réalisée, et tu seras le seul à en connaître les sensations, les effets. Tu dois être maître de ton sujet, c’est à toi de dompter la piste et le vent. Tout va ensuite très vite. Tu es propulsé contre un mur d’air qui dans quelques secondes va chercher à te faire décoller du sol, te soulever la tête et t’allonger sur tes skis. La neige se dérobe sous tes planches de 2m40 qui vibrent, tapent dans tous les sens, flottent au-dessus de la piste, cherchent à filer dans les couloirs qui t’entourent, et qu’il faut toujours piloter et tenir dans l’axe. Imaginez le corps qu’il faut tenir gainé, profilé comme une carrosserie pour fendre l’air et ne pas perdre quelques précieux centièmes de km/h. Et puis, le champ de vision qui se rétrécit, le souffle qui se coupe avec la pression et la vitesse, qui essaye de se frayer un chemin pour alimenter le moteur en oxygène. Tu as ce dénivelé monstrueux à abattre en à peine une dizaine de secondes, le timing déjà, 100 longs mètres la tête au ras de la piste… Et enfin l’ouverture, ou plutôt l’atterrissage. Ce que je ressens, je ne sais pas trop. Mais comment je me sens, plus vivant que jamais ! Quand je suis sur les skis à plus de 200 km/h, je suis dans un autre monde, c’est mon élément. J’ai parfois l’impression qu’il faut que je sois à plus de 200 km/h pour respirer. » Son palmarès : 4e aux championnats du monde 2007 (Arosa) ; 1er en coupe d'Europe 2008 à St Gallenkirch ; 5e en coupe du monde 2008 à Leysin ; 3e en coupe du monde 2008 à Stoneham ; 3e en coupe du monde 2008 à Valmalenco ; 7e classement en coupe du monde 2008 (2e Français) ; 1er en coupe de France 2012 à Peyragudes, vice-champion du monde 2013 à Vars ; 1er aux championnats du monde 2017 à Idrefjall. Ses records personnels : Descente : 200,780 km/h réalisé en 2002 (ancien record du monde junior de la catégorie) ; Record de la chute la plus rapide du monde : 243,572 km/h réalisé en 2014 à Vars ; Speed One : 251,397 km/h réalisé en 2017 sur la fameuse piste Chabrières de Vars, la plus impressionnante au monde, la plus rapide également. Il devient Champion du monde de ski de vitesse à Idrefjall en Suède, puis remporte le Globe de Cristal à l’issu du classement général de la Coupe du Monde. À côté de son sport favori, il est agent administratif à mi-temps au sein de l’Office départemental des Sports du Conseil général des Hautes-Pyrénées, en charge des pôles espoirs et des sections sportives du département et de l’organisation événementielle sportive (tour de France, ski, snowboard, randonnées cyclistes, etc.). Il bénéficie par ailleurs du soutien de la ville de Tarbes. Depuis 2012, il est gérant associé d’une brasserie-bar à vin-tapas au cœur du marché de Tarbes. Et ayant la chance d’avoir pu passer son monitorat de ski, cela lui permet de donner quelques cours et de garder un contact avec sa passion, et de la transmettre aux plus jeunes. Mais son objectif est surtout de devenir l’homme le plus rapide du monde et d’atteindre les 255km/h. « D’être l’homme le plus rapide de l’année, c’est un rêve d’enfant tout simplement, difficile de réaliser même maintenant. Un titre que je dédie à mon père, disparu il y a maintenant 3 ans, qui me suivait sur chaque course ; peut-être le seul à avoir cru cela possible. Il doit bien rigoler là-haut. » Il compte bien continuer à profiter de son sport et l’amener au plus haut. Il œuvre et il continuera d’œuvrer dans la recherche de pistes à plus de 200 km/h. Actuellement, il y a seulement cinq pistes. L’objectif serait de tripler ce chiffre d’ici 2022. Aujourd’hui le Comité international olympique a fait savoir qu’il était favorable au retour des épreuves de ski de vitesse, et Bastien souhaiterait cette officialisation pour les JO de 2022. Son petit frère, Jimmy Montès, est actuellement détenteur du record du monde Junior de la catégorie descente à plus de 204 km/h. De retour dans la compétition en 2019, après un an d’absence suite à une grave blessure au genou, Bastien s’est classé quatrième à Vars avec un run à 226,70 km/h. Mais son plus grand rêve qui le hante, sera de tenter de battre le record mondial de vitesse, détenu par l’italien Ivan Origone, flashé le 26 mars 2016 à 254,958 km/h sur la piste mythique de Vars Chabrières. À force de travail et de persévérance, Bastien Montès, devenu l’une des personnes les plus rapides de la planète, a fait sa trace depuis de nombreuses années et pris des risques fous pour réaliser ses rêves.
Bastien MONTÈS, né le 17 décembre 1985 à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, est un skieur de vitesse, addict aux sports extrêmes et aux sensations fortes, voyageant à travers le monde, également freestyler et freerider. Champion du monde 2017, et skiant à plus de 251km/h, il vit actuellement à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Avec 98% de pente au départ, de 0 à 200 km/h en 5,5s son accélération est supérieure à celle d’une formule1. Le 25 mars 2017, il est sacré Champion du monde de ski de vitesse à Idre en Suède, puis remporte le Globe de cristal du classement général la même année. Il ajoutera la Triple couronne à son palmarès en s'adjugeant la victoire aux Speed Masters de Vars (Hautes-Alpes) à plus de 251km/h. Produit d'un père professeur d'EPS et moniteur de ski, et d'une mère éducatrice sportive et maître-nageuse sauveteuse (MNS), ce Pyrénéen est donc tombé dans la marmite « Sport » tout petit. Bastien a commencé le sport à l'âge de quatre ans par la gymnastique à la Bigourdane de Tarbes en compagnie de quelques têtes connues comme Mathieu Crépel ou Vincent Valéry. Mais, retenu en sélection régionale, les journées d'entraînement s'enchaînaient à trop grande vitesse pour ses parents (24h/semaine à l'âge de 11 ans) et à la suite de quelques blessures notamment au genou, Bastien a dû d'abord diminuer puis enfin arrêter la gymnastique au profit du ski. Il gardera tout de même en souvenir les titres de 3e des championnats de France FFG par équipe, champion de France FSGT et champion de France UNSS. Ses parents souhaitant en premier lieu lui faire découvrir le plus d'univers sportifs possibles, Bastien a pratiqué en plus de la gymnastique et du ski : le karaté pendant un an, la danse près de quatre ans, le snowboard deux ans (3e des championnats de France UNSS en freestyle), le rugby (vice-champion de France Universitaire N1 avec Pau), auquel il joue encore de temps à autre pour dépanner le club de chez lui, et le surf qu'il pratique depuis son plus jeune âge, devenu sa seconde passion. Ses débuts en ski ont commencé à l'âge de cinq ans, sur les pentes de la station de Gavarnie-Gèdre. Au début skieur alpin en compétition, il s'est vite tourné vers les disciplines plus « libres » comme le ski de vitesse ou le ski freestyle. Sa première descente sur une piste de kilomètre lancé (KL), s'est faite à l'âge de six ans, en « ouverture » du challenge Quiksilver de Gavarnie-Gèdre. Bastien Montès l'effectue à 48 km/h. Devenu sa passion, il a pu s'exercer lors des épreuves UNSS de Luz, Gavarnie et celles du Challenge Quiksilver national à Vars. En épreuves Jeunes, il remporte quatre titres de champion de France dans les différentes catégories. Ses débuts sur la scène internationale se sont faits dès 2003, en catégorie Junior, saison au terme de laquelle Bastien Montès remporte son 1er titre de Champion du monde Junior FIS à Salla en Finlande, et empoche le record du monde Junior catégorie descente en franchissant la barre mythique des 200,780 km/h. Le 2e sacre mondial Junior arrivera en 2005, avec sa victoire sur la piste de Breuil-Cervinia en Italie. À la suite de ces années apparaissent les premières difficultés avec l'entrée dans la catégorie Senior. L'apprentissage est difficile et début 2007 il se laisse une dernière chance jusqu'en 2008 avant de mettre un terme, ou non, à sa carrière. Les portes du succès s'ouvrent enfin avec les premières apparitions dans les 10 premiers du classement dès la fin 2007, record personnel à 239,08 km/h, avant de se placer, en 2008, 5e du Pro mondial de France et 4e de la Red Rock Cup (courses professionnelles), 6e d'une étape de Coupe du monde FIS au Canada et d'obtenir le titre de champion de France 2007 FFS toutes catégories. La consécration vient lors de la dernière épreuve de la saison avec la 3e place du Championnat du monde FIS toutes catégories, à Verbier en Suisse. « Il faut savoir qu’une descente en ski de vitesse est très courte. Tout juste 30s pendant lesquelles on fait le plein de sensations. Difficile de trouver beaucoup d’autres sports avec une telle décharge d’adrénaline. Quand tu es au sommet de la piste tu dois pouvoir rester concentré, dans ta bulle, car derrière un run à plus de 250 km/h tout peut se jouer. 98% de pente au sommet, moins de 6s pour atteindre les 200 km/h (accélération supérieure aux F1), évidemment ça fait réfléchir… Tu as forcement de l’appréhension, mais on est là pour repousser les limites, pour ce shoot d’adrénaline. Cette appréhension te permet de garder les pieds sur terre, mais en aucun cas elle ne doit se transformer en peur. Tu ne peux pas partir à reculons sur de telles pistes, l’engagement doit être total pour préserver ton intégrité. Si tu as peur, il vaut mieux refuser le départ, et cela arrive, même pour les meilleurs. Une fois lancé, c’est le grand saut dans le vide. Tu pars vers l’inconnu, tu vas peut-être atteindre une vitesse jamais réalisée, et tu seras le seul à en connaître les sensations, les effets. Tu dois être maître de ton sujet, c’est à toi de dompter la piste et le vent. Tout va ensuite très vite. Tu es propulsé contre un mur d’air qui dans quelques secondes va chercher à te faire décoller du sol, te soulever la tête et t’allonger sur tes skis. La neige se dérobe sous tes planches de 2m40 qui vibrent, tapent dans tous les sens, flottent au-dessus de la piste, cherchent à filer dans les couloirs qui t’entourent, et qu’il faut toujours piloter et tenir dans l’axe. Imaginez le corps qu’il faut tenir gainé, profilé comme une carrosserie pour fendre l’air et ne pas perdre quelques précieux centièmes de km/h. Et puis, le champ de vision qui se rétrécit, le souffle qui se coupe avec la pression et la vitesse, qui essaye de se frayer un chemin pour alimenter le moteur en oxygène. Tu as ce dénivelé monstrueux à abattre en à peine une dizaine de secondes, le timing déjà, 100 longs mètres la tête au ras de la piste… Et enfin l’ouverture, ou plutôt l’atterrissage. Ce que je ressens, je ne sais pas trop. Mais comment je me sens, plus vivant que jamais ! Quand je suis sur les skis à plus de 200 km/h, je suis dans un autre monde, c’est mon élément. J’ai parfois l’impression qu’il faut que je sois à plus de 200 km/h pour respirer. » Son palmarès : 4e aux championnats du monde 2007 (Arosa) ; 1er en coupe d'Europe 2008 à St Gallenkirch ; 5e en coupe du monde 2008 à Leysin ; 3e en coupe du monde 2008 à Stoneham ; 3e en coupe du monde 2008 à Valmalenco ; 7e classement en coupe du monde 2008 (2e Français) ; 1er en coupe de France 2012 à Peyragudes, vice-champion du monde 2013 à Vars ; 1er aux championnats du monde 2017 à Idrefjall. Ses records personnels : Descente : 200,780 km/h réalisé en 2002 (ancien record du monde junior de la catégorie) ; Record de la chute la plus rapide du monde : 243,572 km/h réalisé en 2014 à Vars ; Speed One : 251,397 km/h réalisé en 2017 sur la fameuse piste Chabrières de Vars, la plus impressionnante au monde, la plus rapide également. Il devient Champion du monde de ski de vitesse à Idrefjall en Suède, puis remporte le Globe de Cristal à l’issu du classement général de la Coupe du Monde. À côté de son sport favori, il est agent administratif à mi-temps au sein de l’Office départemental des Sports du Conseil général des Hautes-Pyrénées, en charge des pôles espoirs et des sections sportives du département et de l’organisation événementielle sportive (tour de France, ski, snowboard, randonnées cyclistes, etc.). Il bénéficie par ailleurs du soutien de la ville de Tarbes. Depuis 2012, il est gérant associé d’une brasserie-bar à vin-tapas au cœur du marché de Tarbes. Et ayant la chance d’avoir pu passer son monitorat de ski, cela lui permet de donner quelques cours et de garder un contact avec sa passion, et de la transmettre aux plus jeunes. Mais son objectif est surtout de devenir l’homme le plus rapide du monde et d’atteindre les 255km/h. « D’être l’homme le plus rapide de l’année, c’est un rêve d’enfant tout simplement, difficile de réaliser même maintenant. Un titre que je dédie à mon père, disparu il y a maintenant 3 ans, qui me suivait sur chaque course ; peut-être le seul à avoir cru cela possible. Il doit bien rigoler là-haut. » Il compte bien continuer à profiter de son sport et l’amener au plus haut. Il œuvre et il continuera d’œuvrer dans la recherche de pistes à plus de 200 km/h. Actuellement, il y a seulement cinq pistes. L’objectif serait de tripler ce chiffre d’ici 2022. Aujourd’hui le Comité international olympique a fait savoir qu’il était favorable au retour des épreuves de ski de vitesse, et Bastien souhaiterait cette officialisation pour les JO de 2022. Son petit frère, Jimmy Montès, est actuellement détenteur du record du monde Junior de la catégorie descente à plus de 204 km/h. De retour dans la compétition en 2019, après un an d’absence suite à une grave blessure au genou, Bastien s’est classé quatrième à Vars avec un run à 226,70 km/h. Mais son plus grand rêve qui le hante, sera de tenter de battre le record mondial de vitesse, détenu par l’italien Ivan Origone, flashé le 26 mars 2016 à 254,958 km/h sur la piste mythique de Vars Chabrières. À force de travail et de persévérance, Bastien Montès, devenu l’une des personnes les plus rapides de la planète, a fait sa trace depuis de nombreuses années et pris des risques fous pour réaliser ses rêves.
 Bastien MONTÈS, né le 17 décembre 1985 à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, est un skieur de vitesse, addict aux sports extrêmes et aux sensations fortes, voyageant à travers le monde, également freestyler et freerider. Champion du monde 2017, et skiant à plus de 251km/h, il vit actuellement à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Avec 98% de pente au départ, de 0 à 200 km/h en 5,5s son accélération est supérieure à celle d’une formule1. Le 25 mars 2017, il est sacré Champion du monde de ski de vitesse à Idre en Suède, puis remporte le Globe de cristal du classement général la même année. Il ajoutera la Triple couronne à son palmarès en s'adjugeant la victoire aux Speed Masters de Vars (Hautes-Alpes) à plus de 251km/h. Produit d'un père professeur d'EPS et moniteur de ski, et d'une mère éducatrice sportive et maître-nageuse sauveteuse (MNS), ce Pyrénéen est donc tombé dans la marmite « Sport » tout petit. Bastien a commencé le sport à l'âge de quatre ans par la gymnastique à la Bigourdane de Tarbes en compagnie de quelques têtes connues comme Mathieu Crépel ou Vincent Valéry. Mais, retenu en sélection régionale, les journées d'entraînement s'enchaînaient à trop grande vitesse pour ses parents (24h/semaine à l'âge de 11 ans) et à la suite de quelques blessures notamment au genou, Bastien a dû d'abord diminuer puis enfin arrêter la gymnastique au profit du ski. Il gardera tout de même en souvenir les titres de 3e des championnats de France FFG par équipe, champion de France FSGT et champion de France UNSS. Ses parents souhaitant en premier lieu lui faire découvrir le plus d'univers sportifs possibles, Bastien a pratiqué en plus de la gymnastique et du ski : le karaté pendant un an, la danse près de quatre ans, le snowboard deux ans (3e des championnats de France UNSS en freestyle), le rugby (vice-champion de France Universitaire N1 avec Pau), auquel il joue encore de temps à autre pour dépanner le club de chez lui, et le surf qu'il pratique depuis son plus jeune âge, devenu sa seconde passion. Ses débuts en ski ont commencé à l'âge de cinq ans, sur les pentes de la station de Gavarnie-Gèdre. Au début skieur alpin en compétition, il s'est vite tourné vers les disciplines plus « libres » comme le ski de vitesse ou le ski freestyle. Sa première descente sur une piste de kilomètre lancé (KL), s'est faite à l'âge de six ans, en « ouverture » du challenge Quiksilver de Gavarnie-Gèdre. Bastien Montès l'effectue à 48 km/h. Devenu sa passion, il a pu s'exercer lors des épreuves UNSS de Luz, Gavarnie et celles du Challenge Quiksilver national à Vars. En épreuves Jeunes, il remporte quatre titres de champion de France dans les différentes catégories. Ses débuts sur la scène internationale se sont faits dès 2003, en catégorie Junior, saison au terme de laquelle Bastien Montès remporte son 1er titre de Champion du monde Junior FIS à Salla en Finlande, et empoche le record du monde Junior catégorie descente en franchissant la barre mythique des 200,780 km/h. Le 2e sacre mondial Junior arrivera en 2005, avec sa victoire sur la piste de Breuil-Cervinia en Italie. À la suite de ces années apparaissent les premières difficultés avec l'entrée dans la catégorie Senior. L'apprentissage est difficile et début 2007 il se laisse une dernière chance jusqu'en 2008 avant de mettre un terme, ou non, à sa carrière. Les portes du succès s'ouvrent enfin avec les premières apparitions dans les 10 premiers du classement dès la fin 2007, record personnel à 239,08 km/h, avant de se placer, en 2008, 5e du Pro mondial de France et 4e de la Red Rock Cup (courses professionnelles), 6e d'une étape de Coupe du monde FIS au Canada et d'obtenir le titre de champion de France 2007 FFS toutes catégories. La consécration vient lors de la dernière épreuve de la saison avec la 3e place du Championnat du monde FIS toutes catégories, à Verbier en Suisse. « Il faut savoir qu’une descente en ski de vitesse est très courte. Tout juste 30s pendant lesquelles on fait le plein de sensations. Difficile de trouver beaucoup d’autres sports avec une telle décharge d’adrénaline. Quand tu es au sommet de la piste tu dois pouvoir rester concentré, dans ta bulle, car derrière un run à plus de 250 km/h tout peut se jouer. 98% de pente au sommet, moins de 6s pour atteindre les 200 km/h (accélération supérieure aux F1), évidemment ça fait réfléchir… Tu as forcement de l’appréhension, mais on est là pour repousser les limites, pour ce shoot d’adrénaline. Cette appréhension te permet de garder les pieds sur terre, mais en aucun cas elle ne doit se transformer en peur. Tu ne peux pas partir à reculons sur de telles pistes, l’engagement doit être total pour préserver ton intégrité. Si tu as peur, il vaut mieux refuser le départ, et cela arrive, même pour les meilleurs. Une fois lancé, c’est le grand saut dans le vide. Tu pars vers l’inconnu, tu vas peut-être atteindre une vitesse jamais réalisée, et tu seras le seul à en connaître les sensations, les effets. Tu dois être maître de ton sujet, c’est à toi de dompter la piste et le vent. Tout va ensuite très vite. Tu es propulsé contre un mur d’air qui dans quelques secondes va chercher à te faire décoller du sol, te soulever la tête et t’allonger sur tes skis. La neige se dérobe sous tes planches de 2m40 qui vibrent, tapent dans tous les sens, flottent au-dessus de la piste, cherchent à filer dans les couloirs qui t’entourent, et qu’il faut toujours piloter et tenir dans l’axe. Imaginez le corps qu’il faut tenir gainé, profilé comme une carrosserie pour fendre l’air et ne pas perdre quelques précieux centièmes de km/h. Et puis, le champ de vision qui se rétrécit, le souffle qui se coupe avec la pression et la vitesse, qui essaye de se frayer un chemin pour alimenter le moteur en oxygène. Tu as ce dénivelé monstrueux à abattre en à peine une dizaine de secondes, le timing déjà, 100 longs mètres la tête au ras de la piste… Et enfin l’ouverture, ou plutôt l’atterrissage. Ce que je ressens, je ne sais pas trop. Mais comment je me sens, plus vivant que jamais ! Quand je suis sur les skis à plus de 200 km/h, je suis dans un autre monde, c’est mon élément. J’ai parfois l’impression qu’il faut que je sois à plus de 200 km/h pour respirer. » Son palmarès : 4e aux championnats du monde 2007 (Arosa) ; 1er en coupe d'Europe 2008 à St Gallenkirch ; 5e en coupe du monde 2008 à Leysin ; 3e en coupe du monde 2008 à Stoneham ; 3e en coupe du monde 2008 à Valmalenco ; 7e classement en coupe du monde 2008 (2e Français) ; 1er en coupe de France 2012 à Peyragudes, vice-champion du monde 2013 à Vars ; 1er aux championnats du monde 2017 à Idrefjall. Ses records personnels : Descente : 200,780 km/h réalisé en 2002 (ancien record du monde junior de la catégorie) ; Record de la chute la plus rapide du monde : 243,572 km/h réalisé en 2014 à Vars ; Speed One : 251,397 km/h réalisé en 2017 sur la fameuse piste Chabrières de Vars, la plus impressionnante au monde, la plus rapide également. Il devient Champion du monde de ski de vitesse à Idrefjall en Suède, puis remporte le Globe de Cristal à l’issu du classement général de la Coupe du Monde. À côté de son sport favori, il est agent administratif à mi-temps au sein de l’Office départemental des Sports du Conseil général des Hautes-Pyrénées, en charge des pôles espoirs et des sections sportives du département et de l’organisation événementielle sportive (tour de France, ski, snowboard, randonnées cyclistes, etc.). Il bénéficie par ailleurs du soutien de la ville de Tarbes. Depuis 2012, il est gérant associé d’une brasserie-bar à vin-tapas au cœur du marché de Tarbes. Et ayant la chance d’avoir pu passer son monitorat de ski, cela lui permet de donner quelques cours et de garder un contact avec sa passion, et de la transmettre aux plus jeunes. Mais son objectif est surtout de devenir l’homme le plus rapide du monde et d’atteindre les 255km/h. « D’être l’homme le plus rapide de l’année, c’est un rêve d’enfant tout simplement, difficile de réaliser même maintenant. Un titre que je dédie à mon père, disparu il y a maintenant 3 ans, qui me suivait sur chaque course ; peut-être le seul à avoir cru cela possible. Il doit bien rigoler là-haut. » Il compte bien continuer à profiter de son sport et l’amener au plus haut. Il œuvre et il continuera d’œuvrer dans la recherche de pistes à plus de 200 km/h. Actuellement, il y a seulement cinq pistes. L’objectif serait de tripler ce chiffre d’ici 2022. Aujourd’hui le Comité international olympique a fait savoir qu’il était favorable au retour des épreuves de ski de vitesse, et Bastien souhaiterait cette officialisation pour les JO de 2022. Son petit frère, Jimmy Montès, est actuellement détenteur du record du monde Junior de la catégorie descente à plus de 204 km/h. De retour dans la compétition en 2019, après un an d’absence suite à une grave blessure au genou, Bastien s’est classé quatrième à Vars avec un run à 226,70 km/h. Mais son plus grand rêve qui le hante, sera de tenter de battre le record mondial de vitesse, détenu par l’italien Ivan Origone, flashé le 26 mars 2016 à 254,958 km/h sur la piste mythique de Vars Chabrières. À force de travail et de persévérance, Bastien Montès, devenu l’une des personnes les plus rapides de la planète, a fait sa trace depuis de nombreuses années et pris des risques fous pour réaliser ses rêves.
Bastien MONTÈS, né le 17 décembre 1985 à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques, est un skieur de vitesse, addict aux sports extrêmes et aux sensations fortes, voyageant à travers le monde, également freestyler et freerider. Champion du monde 2017, et skiant à plus de 251km/h, il vit actuellement à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Avec 98% de pente au départ, de 0 à 200 km/h en 5,5s son accélération est supérieure à celle d’une formule1. Le 25 mars 2017, il est sacré Champion du monde de ski de vitesse à Idre en Suède, puis remporte le Globe de cristal du classement général la même année. Il ajoutera la Triple couronne à son palmarès en s'adjugeant la victoire aux Speed Masters de Vars (Hautes-Alpes) à plus de 251km/h. Produit d'un père professeur d'EPS et moniteur de ski, et d'une mère éducatrice sportive et maître-nageuse sauveteuse (MNS), ce Pyrénéen est donc tombé dans la marmite « Sport » tout petit. Bastien a commencé le sport à l'âge de quatre ans par la gymnastique à la Bigourdane de Tarbes en compagnie de quelques têtes connues comme Mathieu Crépel ou Vincent Valéry. Mais, retenu en sélection régionale, les journées d'entraînement s'enchaînaient à trop grande vitesse pour ses parents (24h/semaine à l'âge de 11 ans) et à la suite de quelques blessures notamment au genou, Bastien a dû d'abord diminuer puis enfin arrêter la gymnastique au profit du ski. Il gardera tout de même en souvenir les titres de 3e des championnats de France FFG par équipe, champion de France FSGT et champion de France UNSS. Ses parents souhaitant en premier lieu lui faire découvrir le plus d'univers sportifs possibles, Bastien a pratiqué en plus de la gymnastique et du ski : le karaté pendant un an, la danse près de quatre ans, le snowboard deux ans (3e des championnats de France UNSS en freestyle), le rugby (vice-champion de France Universitaire N1 avec Pau), auquel il joue encore de temps à autre pour dépanner le club de chez lui, et le surf qu'il pratique depuis son plus jeune âge, devenu sa seconde passion. Ses débuts en ski ont commencé à l'âge de cinq ans, sur les pentes de la station de Gavarnie-Gèdre. Au début skieur alpin en compétition, il s'est vite tourné vers les disciplines plus « libres » comme le ski de vitesse ou le ski freestyle. Sa première descente sur une piste de kilomètre lancé (KL), s'est faite à l'âge de six ans, en « ouverture » du challenge Quiksilver de Gavarnie-Gèdre. Bastien Montès l'effectue à 48 km/h. Devenu sa passion, il a pu s'exercer lors des épreuves UNSS de Luz, Gavarnie et celles du Challenge Quiksilver national à Vars. En épreuves Jeunes, il remporte quatre titres de champion de France dans les différentes catégories. Ses débuts sur la scène internationale se sont faits dès 2003, en catégorie Junior, saison au terme de laquelle Bastien Montès remporte son 1er titre de Champion du monde Junior FIS à Salla en Finlande, et empoche le record du monde Junior catégorie descente en franchissant la barre mythique des 200,780 km/h. Le 2e sacre mondial Junior arrivera en 2005, avec sa victoire sur la piste de Breuil-Cervinia en Italie. À la suite de ces années apparaissent les premières difficultés avec l'entrée dans la catégorie Senior. L'apprentissage est difficile et début 2007 il se laisse une dernière chance jusqu'en 2008 avant de mettre un terme, ou non, à sa carrière. Les portes du succès s'ouvrent enfin avec les premières apparitions dans les 10 premiers du classement dès la fin 2007, record personnel à 239,08 km/h, avant de se placer, en 2008, 5e du Pro mondial de France et 4e de la Red Rock Cup (courses professionnelles), 6e d'une étape de Coupe du monde FIS au Canada et d'obtenir le titre de champion de France 2007 FFS toutes catégories. La consécration vient lors de la dernière épreuve de la saison avec la 3e place du Championnat du monde FIS toutes catégories, à Verbier en Suisse. « Il faut savoir qu’une descente en ski de vitesse est très courte. Tout juste 30s pendant lesquelles on fait le plein de sensations. Difficile de trouver beaucoup d’autres sports avec une telle décharge d’adrénaline. Quand tu es au sommet de la piste tu dois pouvoir rester concentré, dans ta bulle, car derrière un run à plus de 250 km/h tout peut se jouer. 98% de pente au sommet, moins de 6s pour atteindre les 200 km/h (accélération supérieure aux F1), évidemment ça fait réfléchir… Tu as forcement de l’appréhension, mais on est là pour repousser les limites, pour ce shoot d’adrénaline. Cette appréhension te permet de garder les pieds sur terre, mais en aucun cas elle ne doit se transformer en peur. Tu ne peux pas partir à reculons sur de telles pistes, l’engagement doit être total pour préserver ton intégrité. Si tu as peur, il vaut mieux refuser le départ, et cela arrive, même pour les meilleurs. Une fois lancé, c’est le grand saut dans le vide. Tu pars vers l’inconnu, tu vas peut-être atteindre une vitesse jamais réalisée, et tu seras le seul à en connaître les sensations, les effets. Tu dois être maître de ton sujet, c’est à toi de dompter la piste et le vent. Tout va ensuite très vite. Tu es propulsé contre un mur d’air qui dans quelques secondes va chercher à te faire décoller du sol, te soulever la tête et t’allonger sur tes skis. La neige se dérobe sous tes planches de 2m40 qui vibrent, tapent dans tous les sens, flottent au-dessus de la piste, cherchent à filer dans les couloirs qui t’entourent, et qu’il faut toujours piloter et tenir dans l’axe. Imaginez le corps qu’il faut tenir gainé, profilé comme une carrosserie pour fendre l’air et ne pas perdre quelques précieux centièmes de km/h. Et puis, le champ de vision qui se rétrécit, le souffle qui se coupe avec la pression et la vitesse, qui essaye de se frayer un chemin pour alimenter le moteur en oxygène. Tu as ce dénivelé monstrueux à abattre en à peine une dizaine de secondes, le timing déjà, 100 longs mètres la tête au ras de la piste… Et enfin l’ouverture, ou plutôt l’atterrissage. Ce que je ressens, je ne sais pas trop. Mais comment je me sens, plus vivant que jamais ! Quand je suis sur les skis à plus de 200 km/h, je suis dans un autre monde, c’est mon élément. J’ai parfois l’impression qu’il faut que je sois à plus de 200 km/h pour respirer. » Son palmarès : 4e aux championnats du monde 2007 (Arosa) ; 1er en coupe d'Europe 2008 à St Gallenkirch ; 5e en coupe du monde 2008 à Leysin ; 3e en coupe du monde 2008 à Stoneham ; 3e en coupe du monde 2008 à Valmalenco ; 7e classement en coupe du monde 2008 (2e Français) ; 1er en coupe de France 2012 à Peyragudes, vice-champion du monde 2013 à Vars ; 1er aux championnats du monde 2017 à Idrefjall. Ses records personnels : Descente : 200,780 km/h réalisé en 2002 (ancien record du monde junior de la catégorie) ; Record de la chute la plus rapide du monde : 243,572 km/h réalisé en 2014 à Vars ; Speed One : 251,397 km/h réalisé en 2017 sur la fameuse piste Chabrières de Vars, la plus impressionnante au monde, la plus rapide également. Il devient Champion du monde de ski de vitesse à Idrefjall en Suède, puis remporte le Globe de Cristal à l’issu du classement général de la Coupe du Monde. À côté de son sport favori, il est agent administratif à mi-temps au sein de l’Office départemental des Sports du Conseil général des Hautes-Pyrénées, en charge des pôles espoirs et des sections sportives du département et de l’organisation événementielle sportive (tour de France, ski, snowboard, randonnées cyclistes, etc.). Il bénéficie par ailleurs du soutien de la ville de Tarbes. Depuis 2012, il est gérant associé d’une brasserie-bar à vin-tapas au cœur du marché de Tarbes. Et ayant la chance d’avoir pu passer son monitorat de ski, cela lui permet de donner quelques cours et de garder un contact avec sa passion, et de la transmettre aux plus jeunes. Mais son objectif est surtout de devenir l’homme le plus rapide du monde et d’atteindre les 255km/h. « D’être l’homme le plus rapide de l’année, c’est un rêve d’enfant tout simplement, difficile de réaliser même maintenant. Un titre que je dédie à mon père, disparu il y a maintenant 3 ans, qui me suivait sur chaque course ; peut-être le seul à avoir cru cela possible. Il doit bien rigoler là-haut. » Il compte bien continuer à profiter de son sport et l’amener au plus haut. Il œuvre et il continuera d’œuvrer dans la recherche de pistes à plus de 200 km/h. Actuellement, il y a seulement cinq pistes. L’objectif serait de tripler ce chiffre d’ici 2022. Aujourd’hui le Comité international olympique a fait savoir qu’il était favorable au retour des épreuves de ski de vitesse, et Bastien souhaiterait cette officialisation pour les JO de 2022. Son petit frère, Jimmy Montès, est actuellement détenteur du record du monde Junior de la catégorie descente à plus de 204 km/h. De retour dans la compétition en 2019, après un an d’absence suite à une grave blessure au genou, Bastien s’est classé quatrième à Vars avec un run à 226,70 km/h. Mais son plus grand rêve qui le hante, sera de tenter de battre le record mondial de vitesse, détenu par l’italien Ivan Origone, flashé le 26 mars 2016 à 254,958 km/h sur la piste mythique de Vars Chabrières. À force de travail et de persévérance, Bastien Montès, devenu l’une des personnes les plus rapides de la planète, a fait sa trace depuis de nombreuses années et pris des risques fous pour réaliser ses rêves.MOTTET Anne (1978 -XXXX)
Compagne de l’astronaute Thomas Pesquet, elle a écrit une thèse sur les Hautes-Pyrénées
 Anne MOTTET, née en 1978 en Bretagne, est titulaire d’une maîtrise en agronomie et d’un doctorat en agroécosystèmes. Cette pétillante brunette, aussi belle qu'intelligente, est la compagne depuis plusieurs années de l'ancien pilote de ligne devenu astronaute, Thomas Pesquet, qui décolla ce jeudi 17 novembre 2016 à 21h20 heure de Paris du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan pour la Station spatiale internationale, avec à bord de la fusée Soyouz, le cosmonaute russe Oleg Novitski et l'Américaine Peggy Whitson. S’il est l’un des plus célèbres astronautes français, elle est une ancienne agroéconomiste désormais en charge des politiques d’élevage à la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Thomas Pesquet avait déclaré à un quotidien avant son départ : « elle travaille à sauver le monde, développe des cultures résistant aux changements climatiques ». Très discrète, la chérie de Thomas Pesquet est une femme engagée. Chargée des politiques d’élevage à la FAO, elle vit à Rome, bien loin de son homme. Une relation à distance qui fonctionne d’autant plus quand le spationaute vadrouille au beau milieu des étoiles. Mais, comme l’a révélé un magazine, quand Thomas Pesquet est sur Terre, le couple a l’habitude de se voir tous les 15 jours. Mais, savez-vous qu’Anne Mottet connaît parfaitement notre région du Lavedan, qui fut dans les années 2000 son terrain d’études doctorantes. En effet, elle avait défendu une thèse parlant de l'abandon des terres agricoles situées dans les montagnes en se servant de la situation dans quatre communes se trouvant dans le Devantaygue. Un versant orienté nord-ouest, le long du Gave de Pau, qui compte huit communes, sept d’entre elles étant situées en zone périphérique du Parc national des Pyrénées. Une thèse présentée pour obtenir le titre de docteur de l’Institut national polytechnique de Toulouse (2002-2005), qu’elle soutiendra le 21 décembre 2005 (thèse dont le contenu est accessible sur Internet). Et dont le sujet était : « Transformations des systèmes d’élevage depuis 1950 et conséquences pour la dynamique des paysages dans les Pyrénées - Contribution à l'étude du phénomène d'abandon de terres agricoles en montagne à partir de l'exemple de quatre communes des Hautes-Pyrénées. » La jeune femme a en effet rédigé une thèse sur l'abandon des terres agricoles en montagne à partir des exemples de quatre communes des Hautes-Pyrénées, qui sont : Villelongue, Vier-Bordes, Artalens-Souin et Saint-Pastous, retenues sur la base des typologies de structure et d’évolution. Elle traitera entre autres le boisement dans le paysage du village de Villelongue, entre 1950 et 2002, avec illustrations à l’appui. L’objectif de son travail était d’éclairer les relations entre les transformations de l’élevage en zone de montagne et l’abandon agricole. Elle s’était basée pour cela sur l’analyse socio-technique et historique de 40 exploitations agricoles du territoire de ces quatre communes des Hautes-Pyrénées, enquêtées au printemps 2003, pour un total d’environ 1700 parcelles et 750 ha de terres agricoles. Le taux de disparition d’exploitations sur la période 1950-2000 est important et globalement plus élevé en zone de montagne qu’en plaine. Cette thèse avait aussi pour ambition de contribuer au courant de recherche qui s’attache à mieux comprendre les relations entre les transformations des activités agricoles et les transformations des paysages. Ses travaux portaient sur une zone de montagne, sur les versants des Pyrénées bigourdanes, où l’exode vers les plaines, l’évolution de la technologie agricole et les transformations de l’élevage se traduisent par le boisement spontané des versants et la fermeture du paysage. Suite à cela, comme ingénieure agroéconomiste, diplômée de Toulouse INP, elle était devenue chargée de politiques d'élevage à la FAO. Un rôle clé, qui lui convient à merveille puisqu'elle ne cesse de briller et de s'épanouir. Sa carrière est cependant particulièrement prenante tout comme celle de Thomas Pesquet, et ils doivent donc faire des efforts afin de trouver du temps à partager. Si de longs mois de séparation pourraient faire peur à certains couples, ce n'est certainement pas le cas de Thomas Pesquet et d'Anne Mottet. Une femme brillante et très occupée donc, tout comme son compagnon ! Ce qui n'empêche pas le couple d'avoir de beaux projets... "Je vais certainement l'emmener dans un des endroits que j'ai admirés de là-haut : les Bahamas, avec ce camaïeu de bleus, l'Australie ou l'Afrique de l'Est...", espérait Thomas Pesquet. Les deux tourtereaux ont l'habitude de se voir deux fois par mois. Un rythme de croisière largement satisfaisant, qui sort certes des sentiers battus, mais permet de ne pas tomber dans la routine. En 2016-2017, à bord de la Station spatiale, la technologie aidant malgré tout, les deux tourtereaux avaient droit à un appel téléphonique par semaine. La jeune femme avait eu la bonne idée d'organiser une visioconférence chaque semaine entre elle, le scientifique et ses proches pour garder le contact pendant sa mission spatiale. Il paraît que quand on aime on ne compte pas, et pourtant il y a de grandes chances que pour eux, chaque seconde passée au bout du fil comptait... Forte, indépendante et brillante mais aussi très éprise et visiblement bien organisée, Anne Mottet est aussi épatante que son célèbre compagnon, déjà prêt à s'envoler une seconde fois vers la Station spatiale internationale (ISS) au printemps 2021, à bord de la nouvelle capsule américaine Crew Dragon de SpaceX, depuis Cap Canaveral en Floride.
Anne MOTTET, née en 1978 en Bretagne, est titulaire d’une maîtrise en agronomie et d’un doctorat en agroécosystèmes. Cette pétillante brunette, aussi belle qu'intelligente, est la compagne depuis plusieurs années de l'ancien pilote de ligne devenu astronaute, Thomas Pesquet, qui décolla ce jeudi 17 novembre 2016 à 21h20 heure de Paris du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan pour la Station spatiale internationale, avec à bord de la fusée Soyouz, le cosmonaute russe Oleg Novitski et l'Américaine Peggy Whitson. S’il est l’un des plus célèbres astronautes français, elle est une ancienne agroéconomiste désormais en charge des politiques d’élevage à la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Thomas Pesquet avait déclaré à un quotidien avant son départ : « elle travaille à sauver le monde, développe des cultures résistant aux changements climatiques ». Très discrète, la chérie de Thomas Pesquet est une femme engagée. Chargée des politiques d’élevage à la FAO, elle vit à Rome, bien loin de son homme. Une relation à distance qui fonctionne d’autant plus quand le spationaute vadrouille au beau milieu des étoiles. Mais, comme l’a révélé un magazine, quand Thomas Pesquet est sur Terre, le couple a l’habitude de se voir tous les 15 jours. Mais, savez-vous qu’Anne Mottet connaît parfaitement notre région du Lavedan, qui fut dans les années 2000 son terrain d’études doctorantes. En effet, elle avait défendu une thèse parlant de l'abandon des terres agricoles situées dans les montagnes en se servant de la situation dans quatre communes se trouvant dans le Devantaygue. Un versant orienté nord-ouest, le long du Gave de Pau, qui compte huit communes, sept d’entre elles étant situées en zone périphérique du Parc national des Pyrénées. Une thèse présentée pour obtenir le titre de docteur de l’Institut national polytechnique de Toulouse (2002-2005), qu’elle soutiendra le 21 décembre 2005 (thèse dont le contenu est accessible sur Internet). Et dont le sujet était : « Transformations des systèmes d’élevage depuis 1950 et conséquences pour la dynamique des paysages dans les Pyrénées - Contribution à l'étude du phénomène d'abandon de terres agricoles en montagne à partir de l'exemple de quatre communes des Hautes-Pyrénées. » La jeune femme a en effet rédigé une thèse sur l'abandon des terres agricoles en montagne à partir des exemples de quatre communes des Hautes-Pyrénées, qui sont : Villelongue, Vier-Bordes, Artalens-Souin et Saint-Pastous, retenues sur la base des typologies de structure et d’évolution. Elle traitera entre autres le boisement dans le paysage du village de Villelongue, entre 1950 et 2002, avec illustrations à l’appui. L’objectif de son travail était d’éclairer les relations entre les transformations de l’élevage en zone de montagne et l’abandon agricole. Elle s’était basée pour cela sur l’analyse socio-technique et historique de 40 exploitations agricoles du territoire de ces quatre communes des Hautes-Pyrénées, enquêtées au printemps 2003, pour un total d’environ 1700 parcelles et 750 ha de terres agricoles. Le taux de disparition d’exploitations sur la période 1950-2000 est important et globalement plus élevé en zone de montagne qu’en plaine. Cette thèse avait aussi pour ambition de contribuer au courant de recherche qui s’attache à mieux comprendre les relations entre les transformations des activités agricoles et les transformations des paysages. Ses travaux portaient sur une zone de montagne, sur les versants des Pyrénées bigourdanes, où l’exode vers les plaines, l’évolution de la technologie agricole et les transformations de l’élevage se traduisent par le boisement spontané des versants et la fermeture du paysage. Suite à cela, comme ingénieure agroéconomiste, diplômée de Toulouse INP, elle était devenue chargée de politiques d'élevage à la FAO. Un rôle clé, qui lui convient à merveille puisqu'elle ne cesse de briller et de s'épanouir. Sa carrière est cependant particulièrement prenante tout comme celle de Thomas Pesquet, et ils doivent donc faire des efforts afin de trouver du temps à partager. Si de longs mois de séparation pourraient faire peur à certains couples, ce n'est certainement pas le cas de Thomas Pesquet et d'Anne Mottet. Une femme brillante et très occupée donc, tout comme son compagnon ! Ce qui n'empêche pas le couple d'avoir de beaux projets... "Je vais certainement l'emmener dans un des endroits que j'ai admirés de là-haut : les Bahamas, avec ce camaïeu de bleus, l'Australie ou l'Afrique de l'Est...", espérait Thomas Pesquet. Les deux tourtereaux ont l'habitude de se voir deux fois par mois. Un rythme de croisière largement satisfaisant, qui sort certes des sentiers battus, mais permet de ne pas tomber dans la routine. En 2016-2017, à bord de la Station spatiale, la technologie aidant malgré tout, les deux tourtereaux avaient droit à un appel téléphonique par semaine. La jeune femme avait eu la bonne idée d'organiser une visioconférence chaque semaine entre elle, le scientifique et ses proches pour garder le contact pendant sa mission spatiale. Il paraît que quand on aime on ne compte pas, et pourtant il y a de grandes chances que pour eux, chaque seconde passée au bout du fil comptait... Forte, indépendante et brillante mais aussi très éprise et visiblement bien organisée, Anne Mottet est aussi épatante que son célèbre compagnon, déjà prêt à s'envoler une seconde fois vers la Station spatiale internationale (ISS) au printemps 2021, à bord de la nouvelle capsule américaine Crew Dragon de SpaceX, depuis Cap Canaveral en Floride.
 Anne MOTTET, née en 1978 en Bretagne, est titulaire d’une maîtrise en agronomie et d’un doctorat en agroécosystèmes. Cette pétillante brunette, aussi belle qu'intelligente, est la compagne depuis plusieurs années de l'ancien pilote de ligne devenu astronaute, Thomas Pesquet, qui décolla ce jeudi 17 novembre 2016 à 21h20 heure de Paris du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan pour la Station spatiale internationale, avec à bord de la fusée Soyouz, le cosmonaute russe Oleg Novitski et l'Américaine Peggy Whitson. S’il est l’un des plus célèbres astronautes français, elle est une ancienne agroéconomiste désormais en charge des politiques d’élevage à la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Thomas Pesquet avait déclaré à un quotidien avant son départ : « elle travaille à sauver le monde, développe des cultures résistant aux changements climatiques ». Très discrète, la chérie de Thomas Pesquet est une femme engagée. Chargée des politiques d’élevage à la FAO, elle vit à Rome, bien loin de son homme. Une relation à distance qui fonctionne d’autant plus quand le spationaute vadrouille au beau milieu des étoiles. Mais, comme l’a révélé un magazine, quand Thomas Pesquet est sur Terre, le couple a l’habitude de se voir tous les 15 jours. Mais, savez-vous qu’Anne Mottet connaît parfaitement notre région du Lavedan, qui fut dans les années 2000 son terrain d’études doctorantes. En effet, elle avait défendu une thèse parlant de l'abandon des terres agricoles situées dans les montagnes en se servant de la situation dans quatre communes se trouvant dans le Devantaygue. Un versant orienté nord-ouest, le long du Gave de Pau, qui compte huit communes, sept d’entre elles étant situées en zone périphérique du Parc national des Pyrénées. Une thèse présentée pour obtenir le titre de docteur de l’Institut national polytechnique de Toulouse (2002-2005), qu’elle soutiendra le 21 décembre 2005 (thèse dont le contenu est accessible sur Internet). Et dont le sujet était : « Transformations des systèmes d’élevage depuis 1950 et conséquences pour la dynamique des paysages dans les Pyrénées - Contribution à l'étude du phénomène d'abandon de terres agricoles en montagne à partir de l'exemple de quatre communes des Hautes-Pyrénées. » La jeune femme a en effet rédigé une thèse sur l'abandon des terres agricoles en montagne à partir des exemples de quatre communes des Hautes-Pyrénées, qui sont : Villelongue, Vier-Bordes, Artalens-Souin et Saint-Pastous, retenues sur la base des typologies de structure et d’évolution. Elle traitera entre autres le boisement dans le paysage du village de Villelongue, entre 1950 et 2002, avec illustrations à l’appui. L’objectif de son travail était d’éclairer les relations entre les transformations de l’élevage en zone de montagne et l’abandon agricole. Elle s’était basée pour cela sur l’analyse socio-technique et historique de 40 exploitations agricoles du territoire de ces quatre communes des Hautes-Pyrénées, enquêtées au printemps 2003, pour un total d’environ 1700 parcelles et 750 ha de terres agricoles. Le taux de disparition d’exploitations sur la période 1950-2000 est important et globalement plus élevé en zone de montagne qu’en plaine. Cette thèse avait aussi pour ambition de contribuer au courant de recherche qui s’attache à mieux comprendre les relations entre les transformations des activités agricoles et les transformations des paysages. Ses travaux portaient sur une zone de montagne, sur les versants des Pyrénées bigourdanes, où l’exode vers les plaines, l’évolution de la technologie agricole et les transformations de l’élevage se traduisent par le boisement spontané des versants et la fermeture du paysage. Suite à cela, comme ingénieure agroéconomiste, diplômée de Toulouse INP, elle était devenue chargée de politiques d'élevage à la FAO. Un rôle clé, qui lui convient à merveille puisqu'elle ne cesse de briller et de s'épanouir. Sa carrière est cependant particulièrement prenante tout comme celle de Thomas Pesquet, et ils doivent donc faire des efforts afin de trouver du temps à partager. Si de longs mois de séparation pourraient faire peur à certains couples, ce n'est certainement pas le cas de Thomas Pesquet et d'Anne Mottet. Une femme brillante et très occupée donc, tout comme son compagnon ! Ce qui n'empêche pas le couple d'avoir de beaux projets... "Je vais certainement l'emmener dans un des endroits que j'ai admirés de là-haut : les Bahamas, avec ce camaïeu de bleus, l'Australie ou l'Afrique de l'Est...", espérait Thomas Pesquet. Les deux tourtereaux ont l'habitude de se voir deux fois par mois. Un rythme de croisière largement satisfaisant, qui sort certes des sentiers battus, mais permet de ne pas tomber dans la routine. En 2016-2017, à bord de la Station spatiale, la technologie aidant malgré tout, les deux tourtereaux avaient droit à un appel téléphonique par semaine. La jeune femme avait eu la bonne idée d'organiser une visioconférence chaque semaine entre elle, le scientifique et ses proches pour garder le contact pendant sa mission spatiale. Il paraît que quand on aime on ne compte pas, et pourtant il y a de grandes chances que pour eux, chaque seconde passée au bout du fil comptait... Forte, indépendante et brillante mais aussi très éprise et visiblement bien organisée, Anne Mottet est aussi épatante que son célèbre compagnon, déjà prêt à s'envoler une seconde fois vers la Station spatiale internationale (ISS) au printemps 2021, à bord de la nouvelle capsule américaine Crew Dragon de SpaceX, depuis Cap Canaveral en Floride.
Anne MOTTET, née en 1978 en Bretagne, est titulaire d’une maîtrise en agronomie et d’un doctorat en agroécosystèmes. Cette pétillante brunette, aussi belle qu'intelligente, est la compagne depuis plusieurs années de l'ancien pilote de ligne devenu astronaute, Thomas Pesquet, qui décolla ce jeudi 17 novembre 2016 à 21h20 heure de Paris du cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan pour la Station spatiale internationale, avec à bord de la fusée Soyouz, le cosmonaute russe Oleg Novitski et l'Américaine Peggy Whitson. S’il est l’un des plus célèbres astronautes français, elle est une ancienne agroéconomiste désormais en charge des politiques d’élevage à la FAO, l'Organisation des Nations unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. Thomas Pesquet avait déclaré à un quotidien avant son départ : « elle travaille à sauver le monde, développe des cultures résistant aux changements climatiques ». Très discrète, la chérie de Thomas Pesquet est une femme engagée. Chargée des politiques d’élevage à la FAO, elle vit à Rome, bien loin de son homme. Une relation à distance qui fonctionne d’autant plus quand le spationaute vadrouille au beau milieu des étoiles. Mais, comme l’a révélé un magazine, quand Thomas Pesquet est sur Terre, le couple a l’habitude de se voir tous les 15 jours. Mais, savez-vous qu’Anne Mottet connaît parfaitement notre région du Lavedan, qui fut dans les années 2000 son terrain d’études doctorantes. En effet, elle avait défendu une thèse parlant de l'abandon des terres agricoles situées dans les montagnes en se servant de la situation dans quatre communes se trouvant dans le Devantaygue. Un versant orienté nord-ouest, le long du Gave de Pau, qui compte huit communes, sept d’entre elles étant situées en zone périphérique du Parc national des Pyrénées. Une thèse présentée pour obtenir le titre de docteur de l’Institut national polytechnique de Toulouse (2002-2005), qu’elle soutiendra le 21 décembre 2005 (thèse dont le contenu est accessible sur Internet). Et dont le sujet était : « Transformations des systèmes d’élevage depuis 1950 et conséquences pour la dynamique des paysages dans les Pyrénées - Contribution à l'étude du phénomène d'abandon de terres agricoles en montagne à partir de l'exemple de quatre communes des Hautes-Pyrénées. » La jeune femme a en effet rédigé une thèse sur l'abandon des terres agricoles en montagne à partir des exemples de quatre communes des Hautes-Pyrénées, qui sont : Villelongue, Vier-Bordes, Artalens-Souin et Saint-Pastous, retenues sur la base des typologies de structure et d’évolution. Elle traitera entre autres le boisement dans le paysage du village de Villelongue, entre 1950 et 2002, avec illustrations à l’appui. L’objectif de son travail était d’éclairer les relations entre les transformations de l’élevage en zone de montagne et l’abandon agricole. Elle s’était basée pour cela sur l’analyse socio-technique et historique de 40 exploitations agricoles du territoire de ces quatre communes des Hautes-Pyrénées, enquêtées au printemps 2003, pour un total d’environ 1700 parcelles et 750 ha de terres agricoles. Le taux de disparition d’exploitations sur la période 1950-2000 est important et globalement plus élevé en zone de montagne qu’en plaine. Cette thèse avait aussi pour ambition de contribuer au courant de recherche qui s’attache à mieux comprendre les relations entre les transformations des activités agricoles et les transformations des paysages. Ses travaux portaient sur une zone de montagne, sur les versants des Pyrénées bigourdanes, où l’exode vers les plaines, l’évolution de la technologie agricole et les transformations de l’élevage se traduisent par le boisement spontané des versants et la fermeture du paysage. Suite à cela, comme ingénieure agroéconomiste, diplômée de Toulouse INP, elle était devenue chargée de politiques d'élevage à la FAO. Un rôle clé, qui lui convient à merveille puisqu'elle ne cesse de briller et de s'épanouir. Sa carrière est cependant particulièrement prenante tout comme celle de Thomas Pesquet, et ils doivent donc faire des efforts afin de trouver du temps à partager. Si de longs mois de séparation pourraient faire peur à certains couples, ce n'est certainement pas le cas de Thomas Pesquet et d'Anne Mottet. Une femme brillante et très occupée donc, tout comme son compagnon ! Ce qui n'empêche pas le couple d'avoir de beaux projets... "Je vais certainement l'emmener dans un des endroits que j'ai admirés de là-haut : les Bahamas, avec ce camaïeu de bleus, l'Australie ou l'Afrique de l'Est...", espérait Thomas Pesquet. Les deux tourtereaux ont l'habitude de se voir deux fois par mois. Un rythme de croisière largement satisfaisant, qui sort certes des sentiers battus, mais permet de ne pas tomber dans la routine. En 2016-2017, à bord de la Station spatiale, la technologie aidant malgré tout, les deux tourtereaux avaient droit à un appel téléphonique par semaine. La jeune femme avait eu la bonne idée d'organiser une visioconférence chaque semaine entre elle, le scientifique et ses proches pour garder le contact pendant sa mission spatiale. Il paraît que quand on aime on ne compte pas, et pourtant il y a de grandes chances que pour eux, chaque seconde passée au bout du fil comptait... Forte, indépendante et brillante mais aussi très éprise et visiblement bien organisée, Anne Mottet est aussi épatante que son célèbre compagnon, déjà prêt à s'envoler une seconde fois vers la Station spatiale internationale (ISS) au printemps 2021, à bord de la nouvelle capsule américaine Crew Dragon de SpaceX, depuis Cap Canaveral en Floride.MOURET Roland (1961-XXXX)
Mannequin, styliste et couturier des stars
 Roland MOURET, né le 27 août 1961 à Lourdes est l'un des couturiers les plus en vogue de la planète. Enfance dans une famille modeste de Pierrefitte-Nestalas, où son père était artisan boucher. Il a flatté toutes les silhouettes et habillé les plus grandes stars du monde, de Victoria Beckham à Nicole Kidman et Claudia Schiffer, en passant par Cameron Diaz, Scarlett Johansson, Naomi Watts, Björk, Jennifer Lopez, Demi Moore, Halle Berry, Katie Holmes, Catherine Zeta-Jones, Kate Moss, Dita Von Teese, Katy Perry, Heidi Klum, Beyoncé, Michelle Obama, la duchesse de Cambridge Kate Middleton sans oublier Carla Bruni-Sarkozy, Marion Cotillard, Mélita Toscan du Plantier, Valérie Lemercier ou Meghan Markle, qui la veille de son mariage lui a fait un beau cadeau : elle s'est habillée avec une de ses robes pour aller boire le thé avec la reine Elisabeth II. Il a fait partie des 200 convives les plus proches lors de cette fameuse soirée privée, qui a suivi la noce, organisée par le prince Charles, père de Harry, au manoir de Frogmore House. Études au lycée professionnel et technologique de l'Arrouza à Lourdes pour devenir serveur. Après quelques saisons, il part étudier trois mois au studio Berçot, une école de mode à Paris et devient mannequin pour Jean-Paul Gaultier. Il défilera pour Jean-Paul Gaultier, Yohji Yamamoto ou Azzedine Alaïa. De fil en aiguille, il travaille pour la presse en tant que styliste, puis devient directeur artistique de Robert Clergerie, l'un des rois de la chaussure de luxe, durant quatre ans. À 30 ans, il débarque à Londres, où il ouvre un bar branché dans le quartier de Soho, le « freedom café ». Il continue à dessiner des modèles pour une marque italienne avec pour seule ambition : la haute couture. En 1997, à l'âge de 36 ans, il décide de lancer en Angleterre sa propre marque. D'emblée, l'accueil dans la presse spécialisée est remarquable et les succès s'enchaînent jusqu'à la robe Galaxy, l’une de ses plus célèbres créations, qui provoque la folie auprès des fashionistas, jeunes bobos branchés qui font la mode à travers le monde et qui lui vaut l'honneur d'être récompensé en 2002 du titre de "British Designer of the Year". En 2009 il est récompensé aux « Elle Style Awards » et défile à New York. Il est à la tête d'une société d'une centaine de personnes avec sa marque « RM by Roland Mouret » implantée à Londres, Paris et Los Angeles. Ayant vécu à Paris, il y retourne une fois par semaine en tant que directeur artistique de la maison Robert Clergerie. Depuis 2011, il est installé à Mayfair et est directeur de création chez Robert Clergerie. En 2010, Jean-Pierre Artiganave, maire de Lourdes lui remet la médaille de la ville de Lourdes et le fait Citoyen d’honneur. En 2011, il reçut la médaille d'honneur de la Région Midi-Pyrénées des mains de son président Martin Malvy et fut fait Citoyen de la Région. La légende dit que c’est en poussant la porte de son atelier en 2004 pour échapper aux paparazzis que Scarlett Johansson aurait fait sa réputation. Planquée chez lui durant trois heures, elle essaya ses modèles. Quelque temps plus tard, divine en blond platine, elle porta une de ses robes couleur pêche pour les Oscars. Trois fois par an, il revient se ressourcer en famille, auprès de sa mère à Pierrefitte-Nestalas et de sa sœur à Lourdes. Drapeur de génie, il créé ses robes directement sur mannequin. L'hebdomadaire « Elle » britannique l'avait sacré en 2003 « Styliste de l'année ». Couturier des stars, il s’est désormais fait un nom à Londres. Ce créateur à succès installé à Londres et New York depuis l’ouverture d’une boutique sur Madison Avenue, vient de lancer son premier parfum, le bien nommé « Une amourette », pour fêter les vingt ans de sa marque. Le parfumeur Daniela Andrier a imaginé pour lui un parfum « racé et sombre », une composition de néroli, iris, vanille, encens, akigalawood, patchouli et indole, un mélange floral à la fois boisé et un peu sucré vraiment sublime. Un « parfum de femme… pour un homme ». « Mouret, amourette » entendait-il autrefois dans les couloirs de son école de Pierrefitte-Nestalas. De cette moquerie il vient d’en faire une victoire et une eau de parfum qui va vous emporter ! Étrangement, le succès de ce Français formé dans la capitale mondiale de la couture est venu de l'étranger. Plus précisément d'Angleterre, où il réside depuis trente ans. La légende raconte toujours que l'actrice Scarlett Johansson serait entrée par le plus grand des hasards dans son atelier pour fuir des paparazzis. Elle y aurait fait des emplettes et commandé une robe pour les Oscars. Le début d'une ascension presque trop parfaite pour ne pas avoir été romancée. Lui attribue son succès à sa capacité de flatter sans entraver les proportions des femmes. « Derrière le glamour hollywoodien, il y a des illusions d'optique. Un travail de matières élastiques et modelantes, principalement du stretch et du powermesh, mais aussi une connaissance du corps et de sa répartition entre muscles et gras qu'il faut savoir apprivoiser ». « Mes vêtements ont une touche sensuelle bien française, un qwerk typiquement british et un confort très américain », renchérit en franglais ce célèbre directeur artistique, dont la maison éponyme emploie une centaine de personnes. Très proche de Meghan Markle, la duchesse de Sussex, ce dernier avait été pressenti pour dessiner sa robe de mariée.
Roland MOURET, né le 27 août 1961 à Lourdes est l'un des couturiers les plus en vogue de la planète. Enfance dans une famille modeste de Pierrefitte-Nestalas, où son père était artisan boucher. Il a flatté toutes les silhouettes et habillé les plus grandes stars du monde, de Victoria Beckham à Nicole Kidman et Claudia Schiffer, en passant par Cameron Diaz, Scarlett Johansson, Naomi Watts, Björk, Jennifer Lopez, Demi Moore, Halle Berry, Katie Holmes, Catherine Zeta-Jones, Kate Moss, Dita Von Teese, Katy Perry, Heidi Klum, Beyoncé, Michelle Obama, la duchesse de Cambridge Kate Middleton sans oublier Carla Bruni-Sarkozy, Marion Cotillard, Mélita Toscan du Plantier, Valérie Lemercier ou Meghan Markle, qui la veille de son mariage lui a fait un beau cadeau : elle s'est habillée avec une de ses robes pour aller boire le thé avec la reine Elisabeth II. Il a fait partie des 200 convives les plus proches lors de cette fameuse soirée privée, qui a suivi la noce, organisée par le prince Charles, père de Harry, au manoir de Frogmore House. Études au lycée professionnel et technologique de l'Arrouza à Lourdes pour devenir serveur. Après quelques saisons, il part étudier trois mois au studio Berçot, une école de mode à Paris et devient mannequin pour Jean-Paul Gaultier. Il défilera pour Jean-Paul Gaultier, Yohji Yamamoto ou Azzedine Alaïa. De fil en aiguille, il travaille pour la presse en tant que styliste, puis devient directeur artistique de Robert Clergerie, l'un des rois de la chaussure de luxe, durant quatre ans. À 30 ans, il débarque à Londres, où il ouvre un bar branché dans le quartier de Soho, le « freedom café ». Il continue à dessiner des modèles pour une marque italienne avec pour seule ambition : la haute couture. En 1997, à l'âge de 36 ans, il décide de lancer en Angleterre sa propre marque. D'emblée, l'accueil dans la presse spécialisée est remarquable et les succès s'enchaînent jusqu'à la robe Galaxy, l’une de ses plus célèbres créations, qui provoque la folie auprès des fashionistas, jeunes bobos branchés qui font la mode à travers le monde et qui lui vaut l'honneur d'être récompensé en 2002 du titre de "British Designer of the Year". En 2009 il est récompensé aux « Elle Style Awards » et défile à New York. Il est à la tête d'une société d'une centaine de personnes avec sa marque « RM by Roland Mouret » implantée à Londres, Paris et Los Angeles. Ayant vécu à Paris, il y retourne une fois par semaine en tant que directeur artistique de la maison Robert Clergerie. Depuis 2011, il est installé à Mayfair et est directeur de création chez Robert Clergerie. En 2010, Jean-Pierre Artiganave, maire de Lourdes lui remet la médaille de la ville de Lourdes et le fait Citoyen d’honneur. En 2011, il reçut la médaille d'honneur de la Région Midi-Pyrénées des mains de son président Martin Malvy et fut fait Citoyen de la Région. La légende dit que c’est en poussant la porte de son atelier en 2004 pour échapper aux paparazzis que Scarlett Johansson aurait fait sa réputation. Planquée chez lui durant trois heures, elle essaya ses modèles. Quelque temps plus tard, divine en blond platine, elle porta une de ses robes couleur pêche pour les Oscars. Trois fois par an, il revient se ressourcer en famille, auprès de sa mère à Pierrefitte-Nestalas et de sa sœur à Lourdes. Drapeur de génie, il créé ses robes directement sur mannequin. L'hebdomadaire « Elle » britannique l'avait sacré en 2003 « Styliste de l'année ». Couturier des stars, il s’est désormais fait un nom à Londres. Ce créateur à succès installé à Londres et New York depuis l’ouverture d’une boutique sur Madison Avenue, vient de lancer son premier parfum, le bien nommé « Une amourette », pour fêter les vingt ans de sa marque. Le parfumeur Daniela Andrier a imaginé pour lui un parfum « racé et sombre », une composition de néroli, iris, vanille, encens, akigalawood, patchouli et indole, un mélange floral à la fois boisé et un peu sucré vraiment sublime. Un « parfum de femme… pour un homme ». « Mouret, amourette » entendait-il autrefois dans les couloirs de son école de Pierrefitte-Nestalas. De cette moquerie il vient d’en faire une victoire et une eau de parfum qui va vous emporter ! Étrangement, le succès de ce Français formé dans la capitale mondiale de la couture est venu de l'étranger. Plus précisément d'Angleterre, où il réside depuis trente ans. La légende raconte toujours que l'actrice Scarlett Johansson serait entrée par le plus grand des hasards dans son atelier pour fuir des paparazzis. Elle y aurait fait des emplettes et commandé une robe pour les Oscars. Le début d'une ascension presque trop parfaite pour ne pas avoir été romancée. Lui attribue son succès à sa capacité de flatter sans entraver les proportions des femmes. « Derrière le glamour hollywoodien, il y a des illusions d'optique. Un travail de matières élastiques et modelantes, principalement du stretch et du powermesh, mais aussi une connaissance du corps et de sa répartition entre muscles et gras qu'il faut savoir apprivoiser ». « Mes vêtements ont une touche sensuelle bien française, un qwerk typiquement british et un confort très américain », renchérit en franglais ce célèbre directeur artistique, dont la maison éponyme emploie une centaine de personnes. Très proche de Meghan Markle, la duchesse de Sussex, ce dernier avait été pressenti pour dessiner sa robe de mariée.
 Roland MOURET, né le 27 août 1961 à Lourdes est l'un des couturiers les plus en vogue de la planète. Enfance dans une famille modeste de Pierrefitte-Nestalas, où son père était artisan boucher. Il a flatté toutes les silhouettes et habillé les plus grandes stars du monde, de Victoria Beckham à Nicole Kidman et Claudia Schiffer, en passant par Cameron Diaz, Scarlett Johansson, Naomi Watts, Björk, Jennifer Lopez, Demi Moore, Halle Berry, Katie Holmes, Catherine Zeta-Jones, Kate Moss, Dita Von Teese, Katy Perry, Heidi Klum, Beyoncé, Michelle Obama, la duchesse de Cambridge Kate Middleton sans oublier Carla Bruni-Sarkozy, Marion Cotillard, Mélita Toscan du Plantier, Valérie Lemercier ou Meghan Markle, qui la veille de son mariage lui a fait un beau cadeau : elle s'est habillée avec une de ses robes pour aller boire le thé avec la reine Elisabeth II. Il a fait partie des 200 convives les plus proches lors de cette fameuse soirée privée, qui a suivi la noce, organisée par le prince Charles, père de Harry, au manoir de Frogmore House. Études au lycée professionnel et technologique de l'Arrouza à Lourdes pour devenir serveur. Après quelques saisons, il part étudier trois mois au studio Berçot, une école de mode à Paris et devient mannequin pour Jean-Paul Gaultier. Il défilera pour Jean-Paul Gaultier, Yohji Yamamoto ou Azzedine Alaïa. De fil en aiguille, il travaille pour la presse en tant que styliste, puis devient directeur artistique de Robert Clergerie, l'un des rois de la chaussure de luxe, durant quatre ans. À 30 ans, il débarque à Londres, où il ouvre un bar branché dans le quartier de Soho, le « freedom café ». Il continue à dessiner des modèles pour une marque italienne avec pour seule ambition : la haute couture. En 1997, à l'âge de 36 ans, il décide de lancer en Angleterre sa propre marque. D'emblée, l'accueil dans la presse spécialisée est remarquable et les succès s'enchaînent jusqu'à la robe Galaxy, l’une de ses plus célèbres créations, qui provoque la folie auprès des fashionistas, jeunes bobos branchés qui font la mode à travers le monde et qui lui vaut l'honneur d'être récompensé en 2002 du titre de "British Designer of the Year". En 2009 il est récompensé aux « Elle Style Awards » et défile à New York. Il est à la tête d'une société d'une centaine de personnes avec sa marque « RM by Roland Mouret » implantée à Londres, Paris et Los Angeles. Ayant vécu à Paris, il y retourne une fois par semaine en tant que directeur artistique de la maison Robert Clergerie. Depuis 2011, il est installé à Mayfair et est directeur de création chez Robert Clergerie. En 2010, Jean-Pierre Artiganave, maire de Lourdes lui remet la médaille de la ville de Lourdes et le fait Citoyen d’honneur. En 2011, il reçut la médaille d'honneur de la Région Midi-Pyrénées des mains de son président Martin Malvy et fut fait Citoyen de la Région. La légende dit que c’est en poussant la porte de son atelier en 2004 pour échapper aux paparazzis que Scarlett Johansson aurait fait sa réputation. Planquée chez lui durant trois heures, elle essaya ses modèles. Quelque temps plus tard, divine en blond platine, elle porta une de ses robes couleur pêche pour les Oscars. Trois fois par an, il revient se ressourcer en famille, auprès de sa mère à Pierrefitte-Nestalas et de sa sœur à Lourdes. Drapeur de génie, il créé ses robes directement sur mannequin. L'hebdomadaire « Elle » britannique l'avait sacré en 2003 « Styliste de l'année ». Couturier des stars, il s’est désormais fait un nom à Londres. Ce créateur à succès installé à Londres et New York depuis l’ouverture d’une boutique sur Madison Avenue, vient de lancer son premier parfum, le bien nommé « Une amourette », pour fêter les vingt ans de sa marque. Le parfumeur Daniela Andrier a imaginé pour lui un parfum « racé et sombre », une composition de néroli, iris, vanille, encens, akigalawood, patchouli et indole, un mélange floral à la fois boisé et un peu sucré vraiment sublime. Un « parfum de femme… pour un homme ». « Mouret, amourette » entendait-il autrefois dans les couloirs de son école de Pierrefitte-Nestalas. De cette moquerie il vient d’en faire une victoire et une eau de parfum qui va vous emporter ! Étrangement, le succès de ce Français formé dans la capitale mondiale de la couture est venu de l'étranger. Plus précisément d'Angleterre, où il réside depuis trente ans. La légende raconte toujours que l'actrice Scarlett Johansson serait entrée par le plus grand des hasards dans son atelier pour fuir des paparazzis. Elle y aurait fait des emplettes et commandé une robe pour les Oscars. Le début d'une ascension presque trop parfaite pour ne pas avoir été romancée. Lui attribue son succès à sa capacité de flatter sans entraver les proportions des femmes. « Derrière le glamour hollywoodien, il y a des illusions d'optique. Un travail de matières élastiques et modelantes, principalement du stretch et du powermesh, mais aussi une connaissance du corps et de sa répartition entre muscles et gras qu'il faut savoir apprivoiser ». « Mes vêtements ont une touche sensuelle bien française, un qwerk typiquement british et un confort très américain », renchérit en franglais ce célèbre directeur artistique, dont la maison éponyme emploie une centaine de personnes. Très proche de Meghan Markle, la duchesse de Sussex, ce dernier avait été pressenti pour dessiner sa robe de mariée.
Roland MOURET, né le 27 août 1961 à Lourdes est l'un des couturiers les plus en vogue de la planète. Enfance dans une famille modeste de Pierrefitte-Nestalas, où son père était artisan boucher. Il a flatté toutes les silhouettes et habillé les plus grandes stars du monde, de Victoria Beckham à Nicole Kidman et Claudia Schiffer, en passant par Cameron Diaz, Scarlett Johansson, Naomi Watts, Björk, Jennifer Lopez, Demi Moore, Halle Berry, Katie Holmes, Catherine Zeta-Jones, Kate Moss, Dita Von Teese, Katy Perry, Heidi Klum, Beyoncé, Michelle Obama, la duchesse de Cambridge Kate Middleton sans oublier Carla Bruni-Sarkozy, Marion Cotillard, Mélita Toscan du Plantier, Valérie Lemercier ou Meghan Markle, qui la veille de son mariage lui a fait un beau cadeau : elle s'est habillée avec une de ses robes pour aller boire le thé avec la reine Elisabeth II. Il a fait partie des 200 convives les plus proches lors de cette fameuse soirée privée, qui a suivi la noce, organisée par le prince Charles, père de Harry, au manoir de Frogmore House. Études au lycée professionnel et technologique de l'Arrouza à Lourdes pour devenir serveur. Après quelques saisons, il part étudier trois mois au studio Berçot, une école de mode à Paris et devient mannequin pour Jean-Paul Gaultier. Il défilera pour Jean-Paul Gaultier, Yohji Yamamoto ou Azzedine Alaïa. De fil en aiguille, il travaille pour la presse en tant que styliste, puis devient directeur artistique de Robert Clergerie, l'un des rois de la chaussure de luxe, durant quatre ans. À 30 ans, il débarque à Londres, où il ouvre un bar branché dans le quartier de Soho, le « freedom café ». Il continue à dessiner des modèles pour une marque italienne avec pour seule ambition : la haute couture. En 1997, à l'âge de 36 ans, il décide de lancer en Angleterre sa propre marque. D'emblée, l'accueil dans la presse spécialisée est remarquable et les succès s'enchaînent jusqu'à la robe Galaxy, l’une de ses plus célèbres créations, qui provoque la folie auprès des fashionistas, jeunes bobos branchés qui font la mode à travers le monde et qui lui vaut l'honneur d'être récompensé en 2002 du titre de "British Designer of the Year". En 2009 il est récompensé aux « Elle Style Awards » et défile à New York. Il est à la tête d'une société d'une centaine de personnes avec sa marque « RM by Roland Mouret » implantée à Londres, Paris et Los Angeles. Ayant vécu à Paris, il y retourne une fois par semaine en tant que directeur artistique de la maison Robert Clergerie. Depuis 2011, il est installé à Mayfair et est directeur de création chez Robert Clergerie. En 2010, Jean-Pierre Artiganave, maire de Lourdes lui remet la médaille de la ville de Lourdes et le fait Citoyen d’honneur. En 2011, il reçut la médaille d'honneur de la Région Midi-Pyrénées des mains de son président Martin Malvy et fut fait Citoyen de la Région. La légende dit que c’est en poussant la porte de son atelier en 2004 pour échapper aux paparazzis que Scarlett Johansson aurait fait sa réputation. Planquée chez lui durant trois heures, elle essaya ses modèles. Quelque temps plus tard, divine en blond platine, elle porta une de ses robes couleur pêche pour les Oscars. Trois fois par an, il revient se ressourcer en famille, auprès de sa mère à Pierrefitte-Nestalas et de sa sœur à Lourdes. Drapeur de génie, il créé ses robes directement sur mannequin. L'hebdomadaire « Elle » britannique l'avait sacré en 2003 « Styliste de l'année ». Couturier des stars, il s’est désormais fait un nom à Londres. Ce créateur à succès installé à Londres et New York depuis l’ouverture d’une boutique sur Madison Avenue, vient de lancer son premier parfum, le bien nommé « Une amourette », pour fêter les vingt ans de sa marque. Le parfumeur Daniela Andrier a imaginé pour lui un parfum « racé et sombre », une composition de néroli, iris, vanille, encens, akigalawood, patchouli et indole, un mélange floral à la fois boisé et un peu sucré vraiment sublime. Un « parfum de femme… pour un homme ». « Mouret, amourette » entendait-il autrefois dans les couloirs de son école de Pierrefitte-Nestalas. De cette moquerie il vient d’en faire une victoire et une eau de parfum qui va vous emporter ! Étrangement, le succès de ce Français formé dans la capitale mondiale de la couture est venu de l'étranger. Plus précisément d'Angleterre, où il réside depuis trente ans. La légende raconte toujours que l'actrice Scarlett Johansson serait entrée par le plus grand des hasards dans son atelier pour fuir des paparazzis. Elle y aurait fait des emplettes et commandé une robe pour les Oscars. Le début d'une ascension presque trop parfaite pour ne pas avoir été romancée. Lui attribue son succès à sa capacité de flatter sans entraver les proportions des femmes. « Derrière le glamour hollywoodien, il y a des illusions d'optique. Un travail de matières élastiques et modelantes, principalement du stretch et du powermesh, mais aussi une connaissance du corps et de sa répartition entre muscles et gras qu'il faut savoir apprivoiser ». « Mes vêtements ont une touche sensuelle bien française, un qwerk typiquement british et un confort très américain », renchérit en franglais ce célèbre directeur artistique, dont la maison éponyme emploie une centaine de personnes. Très proche de Meghan Markle, la duchesse de Sussex, ce dernier avait été pressenti pour dessiner sa robe de mariée.NANSOUTY Charles Marie Étienne Champion Dubois de (1815-1895)
Général comte et météorologiste, co-fondateur avec l'ingénieur Célestin-Xavier Vaussenat de l’Observatoire du Pic du Midi de Bigorre
 Charles Marie Étienne Champion Dubois de NANSOUTY, né le 20 février 1815 à Dijon et mort à Dax dans les Landes le 15 mars 1895, à l’âge de 80 ans est un militaire français qui, après sa retraite de général, se consacra à la création de l’Observatoire du pic du Midi de Bigorre. Il est le fils de Pierre Marie Eugène Champion de Nansouty, lieutenant-colonel d'infanterie et de Alix Antoinette Herminie du Bois d’Aisy. Il est le petit-fils de Jean-Baptiste Champion (né en 1730), Seigneur de Nan-sous-Thil (en Bourgogne, ce qui a donné « Nansouty »), et de Charles de Brosses (président de Brosses, l'auteur des Lettres écrites d’Italie) ; il est aussi le neveu du général de cavalerie Étienne Marie Antoine Champion de Nansouty, qui s'était illustré lors des guerres de la Révolution et de l'Empire et qui fut élevé au grade de général de division en 1803, le grade le plus élevé de la hiérarchie militaire française et dont le nom est inscrit sur l’Arc de triomphe de l’Étoile. Charles de Nansouty épouse le 14 juillet 1852 Hortense Rosalie Fanny de Dion-Wandonne. Son frère Max Marie Paul Adrien (1816-1844), enseigne de vaisseau, meurt à Mahaena (Tahiti) lors de la guerre franco-tahitienne. L'îlot Taaupiri à Mahaena, où il fut inhumé porte son nom ainsi qu'une rue de Papeete. À 12 ans, il est reçu à l’École des pages de Charles XI, où il est élève durant trois années (1827-1830) mais les Trois Glorieuses de 1830 l’en excluent. Il entra, après la révolution de Juillet, dans une usine que possédait son père et qui ne tarda pas à péricliter. En septembre 1837, il s’engage comme volontaire dans l’artillerie et est affecté au 12e régiment d’artillerie et devient brigadier fourrier en mars 1938 puis maréchal des logis en décembre 1838. Grâce à l'appui de la comtesse de Nansouty et d'un ami député, il est ensuite affecté en décembre 1840 au 8e régiment de hussards en formation. En avril 1841, il devient sous-lieutenant au 7e régiment de hussards. En juillet 1842, il part en Algérie française où il est affecté au corps de cavalerie indigène. Peu avant la prise de la smala d'Abd el Kader par le duc d'Aumale, le 14 mai 1843, il est cité à l'ordre de la division d'Oran lors du combat de Sidi El Rashed où il est blessé à la tête, puis une nouvelle fois comme s'étant particulièrement distingué lors du coup de main exécuté le 12 septembre 1843 sur le camp d'Abd el Kader dans la plaine d'Assian sidi Youssef, où son cheval est tué. Le 19 juillet 1845, il devient lieutenant et passe en août 1845 au 3e régiment de Spahis algériens, devenant capitaine en mars 1847 sous les ordres du général Yusuf. Durant toute sa carrière en Afrique, il obtient des notes brillantes, mais en 1851, le général Yusuf le note médiocrement : "Distingué de forme et de manières, intelligent et brillant officier. Son instruction militaire laisse à désirer et ses rapports avec ses chefs ne sont pas toujours convenables." Il revient en France en juin 1851 et rejoint le 7e régiment de cuirassiers puis en août 1852 il rejoint le régiment des Guides de la Garde impériale sous les ordres d’Auguste Regnaud de Saint-Jean d'Angély. En janvier 1853, il est nommé chef d’escadron. Le général Saint-Jean d'Angély, commandant la Garde impériale le note ainsi : "Officier instruit, vigoureux et énergique. Il est à regretter qu'il ait autant de rudesse dans les formes." Élie de Comminges dans son ouvrage Souvenirs d'enfance et de régiment (Paris, 1930) le décrit de la manière suivante : « M. de Nansouty, mon chef d'escadron, un type de vieil africain à moustaches et à barbiche énormes, mal embouché, égrenant un chapelet de jurons à faire dresser les cheveux sur la tête, passant alors pour un brave à trois poils, un sabreur fini ». En août 1857, il est nommé lieutenant-colonel au 6e régiment de Lanciers et enfin colonel en août 1861 du 8e régiment de Lanciers. En février 1867, il retourne en Afrique pour mettre sur pied le 4e régiment de chasseurs d'Afrique. En février 1869, il est nommé général de brigade et prend le commandement de la subdivision du Maine et Loire. En mars 1869, il va au Camp de Chalons pour commander la 1ère brigade de la division de cavalerie, puis en avril 1869 prend la tête de la subdivision des Hautes-Pyrénées. En juillet 1870, il est nommé commandant de le 2e brigade de la division de cavalerie du 1er Corps d’Armée du Rhin. Il participe à la guerre franco-allemande de 1870. Sa brigade est en deuxième ligne en août 1870 lors de la bataille de Frœschwiller-Wœrth (5 et 6 août 1870, dans le Bas-Rhin). Victoire des Prussiens sur les Français du maréchal de Mac Mahon. En novembre 1870, il est nommé général de division à titre provisoire et est affecté à Toulouse, où il est confronté aux troubles entraînés par la Commune (Ligue du Sud-Ouest). Son commandement n'est pas un succès car à Toulouse il refuse d’ouvrir le feu sur les insurgés de la Commune. Il se trouve assiégé dans la caserne et est remplacé dans son commandement par le général Pourcet, étant dès lors relevé de son commandement pour inaction. En avril 1871, il est remis général de brigade dans les Hautes-Pyrénées. Puis la commission de grade le met en non-activité par retrait d'emploi en septembre 1871, pour avoir exercé un commandement actif à la suite de la capitulation à la bataille de Sedan de 1870, et, la paix signée, alors que l'armée s'était rendue. En désobéissant aux ordres, il avait ainsi évité la capture de ses 12.000 hommes et rejoint l’armée de la Loire à Versailles, où il fut nommé à la tête d'une brigade de cavalerie du 16e Corps d’Armée. Ulcéré, il adresse un violent courrier de protestation au Conseil, et écope de 60 jours de prison par le ministre. Une peine qu’il exécute en fin d’année à la citadelle de Bayonne. En janvier 1872, il est réintégré, mais reste en disponibilité sans affectation. Il ne fut jamais rappelé à l'activité et, passé en 1877 au cadre de réserve, fut mis, à sa demande, à la retraite. Après sa carrière militaire, Charles de Nansouty se retire dans les Pyrénées et s’adonne à la conchyliologie, à la géologie, à la paléontologie, et se passionne pour la haute montagne. Il fouille aux environs de Lourdes des tumuli et se plonge dans l’étude des mollusques découverts sur les pierres des murs. Et dès 1873, il se passionne pour un projet de création d'un observatoire météorologique au sommet du pic du Midi de Bigorre et contribue à poser les bases du futur observatoire. Pour démontrer qu'on pouvait passer l'hiver en altitude, il n'hésite pas à s'installer au col de Sencours, à 2.378 m d’altitude, qu'il dû d'ailleurs quitter au péril de sa vie et de celle de ses deux compagnons en décembre 1874. Il ne fut pas découragé pour autant et recommença à y séjourner les hivers suivants. Il y vit en ermite, étudie les phénomènes physiques mais aussi la faune, la flore, la minéralogie. Aidé par la Société Ramond de Bagnères-de-Bigorre dans les Pyrénées, où il avait acheté une maison en 1860, et dont il est membre, Charles de Nansouty installe à 500 mètres au-dessous du sommet du Pic du Midi, à l'auberge de Sencours, une station météorologique où il passera tous ses hivers et qui fut remplacée en 1881 par un véritable observatoire, construit à partir du 22 mai 1878, avec le produit de souscriptions, et d'après les plans de l'ingénieur Célestin-Xavier Vaussenat, au sommet même du pic du Midi de Bigorre, à 2.877 mètres d’altitude. Charles de Nansouty avait connu Célestin-Xavier Vaussenat, qui était ingénieur civil des mines, au sein de la société Ramond. Le gros œuvre fut achevé le 30 juillet 1880, l’aménagement définitif le 1er octobre 1881. Charles de Nansouty n’était pas parmi les fondateurs, le 19 août 1864, à l'hôtel des Voyageurs du cirque de Gavarnie, de la société Ramond, société savante et de montagnards, où étaient Charles Packe, Émilien Frossard, le comte Henry Russell et par la suite le Dr Costallat, un des créateurs en 1854 de l'hôtellerie de Sencours et qui lança l’idée d’un observatoire, Célestin-Xavier Vaussenat, mais il en sera le président de 1865 jusqu’à sa mort en 1895. À partir de ce groupe de personnes fut lancé le projet d’études du Pic du Midi de Bigorre. Célestin-Xavier Vaussenat se charge de trouver les fonds nécessaires à ce projet. Parmi les donateurs la société Ramond, Montréjeau Charles Baggio de Carvin, Paul Bert d'Auxerre, M. Offshein de Paris et les ministres Bardoux, Freycinet, J. Ferry. Charles de Nansouty resta huit ans au col de Sencours, en contrebas du Pic du Midi de Bigorre où il fit des observations météorologiques de routine dans la station météorologique provisoire installée en 1873. Le 14 décembre 1874, il dut quitter les lieux car la station fut violemment ébranlée le 11 décembre 1874, par un tremblement de terre dont les trépidations rendirent le local inhabitable et que MM. de Nansouty, V. Baylac et Brau durent évacuer au péril de leurs jours. Une plaque commémorative est posée en 1974 au col de Sencours pour la première et dernière retraite du général et ses hommes en ce lieu inhospitalier et en hommage aux premiers pionniers de l’Observatoire du pic du Midi. Le 31 décembre 1875, il fut rejoint par Roger de Monts pour fêter le nouvel an au sommet du Pic du Midi de Bigorre. De là vient la vocation de Roger de Monts pour les ascensions hivernales. Les premiers terrassements au sommet du pic commencent en 1875. Le 21 mai 1878, la première pierre de l'Observatoire du pic du Midi est posée. Les travaux commencèrent le 28 juin 1878, couverts donc par souscription, grâce à la persévérance et sous la direction du général de Nansouty qui ne passe rien, vaillamment aidé par l'ingénieur Célestin-Xavier Vaussenat. Ils durent 4 ans parce que les travaux ne peuvent se faire que pendant les quatre mois où le sommet n’est pas recouvert de neige et est aisément accessible à pied ou à mulet entre la fin juillet et la mi-octobre. En mars 1879, une avalanche emporta et broya l'observatoire, dont les habitants s'échappèrent par miracle. Une construction homérique, où les matériaux sont montés à dos d'hommes, d’ânes et de mulets. L'enfer. Le gros œuvre est achevé le 30 juillet 1880. L'Observatoire est inauguré au mois d'août 1882. Les premiers locaux, plus que rustiques, sont achevés le 8 septembre 1882, et l’observatoire fonctionne. Cette opération est une réussite, mais la gestion très lourde ruine les finances de la société Ramond, qui doit se résoudre à céder l’observatoire à l’État. Ses fondateurs étant dans l'impossibilité d'assurer la gestion et l'entretien de leur œuvre, ils en font don à l'État, à condition que celui-ci paie les dettes restantes et qu'il fournisse une subvention annuelle de 30.000 francs pour couvrir le salaire du directeur et de quelques employés et les frais de fonctionnement de la station. L'Observatoire du Pic du Midi fut donc racheté le 7 septembre 1882 par l'État, et le général Charles de Nansouty en fut nommé directeur honoraire. Le directeur étant Célestin-Xavier Vaussenat. L'astéroïde (44263) Nansouty de la ceinture principale d'astéroïdes, qui fut découvert le 28 août 1998 à Dax par P. Dupouy et F. Maréchal, porte son nom car le pic du Midi est devenu ensuite un Observatoire astronomique. Et Charles de Nansouty mourut bien avant de voir le pic jouer un rôle important dans l’astronomie moderne. L’inauguration des deux bustes de Nansouty et Vaussenat eut lieu le 25 septembre 1899. Mais ne vous fiez pas à la photographie des deux hommes qui ont l’air de bien s’entendre : vers la fin de leur aventure, les deux hommes étaient brouillés et ne s’adressaient plus la parole. Mais le premier défi, sans doute le plus grand de tous, a bien été la création même de l’Observatoire du pic. L'idée d'y établir une station d'observation scientifique, météo et botanique d'abord, était complètement dingue, le mot n'est pas trop fort. Aujourd'hui, monter au pic du Midi, c'est presque devenu banal, avec le téléphérique. Mais quand Charles Nansouty, un général excentrique, a eu cette idée dingue, il n’y avait rien au pic du Midi, à part des conditions de vie dantesques. La première observation scientifique fut faite par l’astronome François de Plantade en 1706 lors d'une éclipse solaire. Mais son ascension, à 70 ans, du pic du Midi de Bigorre lui fut fatale. Le 25 août 1741, il meurt au col de Sencours, sextant au poing, en s'exclamant : « Ah ! que tout ceci est beau ! » Plusieurs autres observations vont suivre. En 1901, le directeur de l’Observatoire de Toulouse Benjamin Baillaud, séduit par la qualité du ciel du pic du Midi, lance l’idée d’un observatoire astronomique et le fait équiper progressivement en lunettes et télescopes. Il y fait monter en 22 caisses de 350 à 700 kg un télescope équatorial de 50 cm de diamètre et 6 m focale. Cet instrument associé à la pureté du ciel permet de remarquables observations qui rendent l’Observatoire rapidement célèbre. Et le premier télescope est installé en 1907 par Baillaud. Une première antenne relais est montée en 1927 pour assurer la radiodiffusion. Dans les années 1930 l’astronome français Bernard Lyot monte régulièrement à l’Observatoire du pic du Midi pour y observer les planètes et surtout utiliser son coronographe, un instrument dont il est l’inventeur et qui permet d’étudier la couronne solaire sans être obligé d’attendre une éclipse totale de Soleil. Il faut patienter jusqu’en 1949 pour que l’électricité arrive au sommet et ne plus dépendre des groupes électrogènes. Trois ans plus tard un téléphérique permet d’acheminer les observateurs ; c’est la fin des montées et descentes par tous les temps qui pouvaient durer entre 5 heures… et 2 jours, suivant les conditions climatiques ! Au début des années 1960, le pic du Midi est équipé d’un télescope de 1m de diamètre destiné à l’étude détaillée des sites potentiels d’alunissage pour les missions américaines Apollo et en 1980 c’est un télescope de 2m de diamètre qui est mis en service, le Télescope Bernard Lyot (TBL). Dans les années 1990, l’État envisage la fermeture du site pour financer d’autres observatoires mieux équipés. Grâce à la mobilisation de la région Midi-Pyrénées le site est rénové : désormais, il accueille conjointement chercheurs et grand public. Sans l'entêtement un peu fou de Charles de Nansouty, dont le buste orne la terrasse sud, l'aventure du pic du Midi n'aurait peut-être pas été celle que l'on connaît aujourd'hui. Sur la façade de l’ancienne « habitation des astronomes », le plus vieux bâtiment du pic du Midi (un peu réaménagé) », accessible par la station téléphérique de La Mongie, deux bustes en bronze commémorent la construction de l’Observatoire, à gauche celui, par Nicolas Grandmaison, du général Charles de Nansouty, qui, une fois à la retraite s’est consacré à la création de l’Observatoire du pic du Midi de Bigorre, après avoir pendant huit ans fait des observations météorologiques dans une station provisoire installée en 1873 au col de Sencours. À droite le buste de Célestin-Xavier Vaussenat, ingénieur civil des mines, promoteur de l’observatoire qui se charge de trouver les fonds nécessaires à ce projet. Son buste est l’œuvre de Madeleine Jouvray, collaboratrice de Rodin, dont la signature figure sur le buste. Commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur le 1er août 1867, vingt-cinq ans de service, dix campagnes et une citation, il se retire en 1885 à Dax où il mourra le 11 mars 1895. Un quartier de roche du pic du Midi de Bigorre orne aujourd'hui sa tombe. Charles de Nansouty a publié la plupart de ses recherches dans le Bulletin de la Société Ramond puis dans celui de la Société d'histoire naturelle de Toulouse. L’histoire de l’Observatoire du Pic du Midi est étroitement associée à ces deux initiateurs, Charles du Bois de Nansouty et Célestin-Xavier Vaussenat. Quand on voit scintiller son antenne blanche au soleil, on ne peut s'empêcher de l'admirer, avec une petite bouffée d'orgueil haut-pyrénéen. C'est qu'il en impose ce Pic, tant les défis qui l'accompagnent sont grands. Station météo, station astronomique, étude du Soleil, clichés de la Lune pour la célébrissime mission Apollo 11, préalable indispensable à la pose du pied de Neil Amstrong sur l'astre blanc. Depuis le cœur de la station de La Mongie, le téléphérique du pic du Midi vous transporte en 15 minutes à 2.877 mètres d’altitude. C’est une ascension spectaculaire qui se déroule en deux étapes vers la haute montagne. Un premier trajet vous conduit jusqu’à la gare intermédiaire du Taoulet. Changement de quai, une autre cabine vous attend pour la seconde partie plus spectaculaire, avec un survol maximum de 320 mètres. Puis c’est l’arrivée au sommet. Une plaque en hommage aux courageux porteurs de la vallée, qui ployant sous la charge, malgré le danger, ont permis de vaincre l’isolement du Pic du Midi de Bigorre, où les travaux scientifiques purent se développer ainsi qu’une autre plaque en hommage aux ânes et mulets porteurs du Pic qui ont contribué à la construction et au ravitaillement de l’Observatoire du Pic du Midi apposée en 2017 lors d'un tournage reconstituant la période des portages au Pic du Midi, témoignent des difficultés de construction de cet édifice exposé aux pires avalanches, aux tempêtes terribles et à la foudre, qui non seulement emportaient leurs instruments de travail, mais mirent nuit et jour et à toute heure leur existence en danger.
Charles Marie Étienne Champion Dubois de NANSOUTY, né le 20 février 1815 à Dijon et mort à Dax dans les Landes le 15 mars 1895, à l’âge de 80 ans est un militaire français qui, après sa retraite de général, se consacra à la création de l’Observatoire du pic du Midi de Bigorre. Il est le fils de Pierre Marie Eugène Champion de Nansouty, lieutenant-colonel d'infanterie et de Alix Antoinette Herminie du Bois d’Aisy. Il est le petit-fils de Jean-Baptiste Champion (né en 1730), Seigneur de Nan-sous-Thil (en Bourgogne, ce qui a donné « Nansouty »), et de Charles de Brosses (président de Brosses, l'auteur des Lettres écrites d’Italie) ; il est aussi le neveu du général de cavalerie Étienne Marie Antoine Champion de Nansouty, qui s'était illustré lors des guerres de la Révolution et de l'Empire et qui fut élevé au grade de général de division en 1803, le grade le plus élevé de la hiérarchie militaire française et dont le nom est inscrit sur l’Arc de triomphe de l’Étoile. Charles de Nansouty épouse le 14 juillet 1852 Hortense Rosalie Fanny de Dion-Wandonne. Son frère Max Marie Paul Adrien (1816-1844), enseigne de vaisseau, meurt à Mahaena (Tahiti) lors de la guerre franco-tahitienne. L'îlot Taaupiri à Mahaena, où il fut inhumé porte son nom ainsi qu'une rue de Papeete. À 12 ans, il est reçu à l’École des pages de Charles XI, où il est élève durant trois années (1827-1830) mais les Trois Glorieuses de 1830 l’en excluent. Il entra, après la révolution de Juillet, dans une usine que possédait son père et qui ne tarda pas à péricliter. En septembre 1837, il s’engage comme volontaire dans l’artillerie et est affecté au 12e régiment d’artillerie et devient brigadier fourrier en mars 1938 puis maréchal des logis en décembre 1838. Grâce à l'appui de la comtesse de Nansouty et d'un ami député, il est ensuite affecté en décembre 1840 au 8e régiment de hussards en formation. En avril 1841, il devient sous-lieutenant au 7e régiment de hussards. En juillet 1842, il part en Algérie française où il est affecté au corps de cavalerie indigène. Peu avant la prise de la smala d'Abd el Kader par le duc d'Aumale, le 14 mai 1843, il est cité à l'ordre de la division d'Oran lors du combat de Sidi El Rashed où il est blessé à la tête, puis une nouvelle fois comme s'étant particulièrement distingué lors du coup de main exécuté le 12 septembre 1843 sur le camp d'Abd el Kader dans la plaine d'Assian sidi Youssef, où son cheval est tué. Le 19 juillet 1845, il devient lieutenant et passe en août 1845 au 3e régiment de Spahis algériens, devenant capitaine en mars 1847 sous les ordres du général Yusuf. Durant toute sa carrière en Afrique, il obtient des notes brillantes, mais en 1851, le général Yusuf le note médiocrement : "Distingué de forme et de manières, intelligent et brillant officier. Son instruction militaire laisse à désirer et ses rapports avec ses chefs ne sont pas toujours convenables." Il revient en France en juin 1851 et rejoint le 7e régiment de cuirassiers puis en août 1852 il rejoint le régiment des Guides de la Garde impériale sous les ordres d’Auguste Regnaud de Saint-Jean d'Angély. En janvier 1853, il est nommé chef d’escadron. Le général Saint-Jean d'Angély, commandant la Garde impériale le note ainsi : "Officier instruit, vigoureux et énergique. Il est à regretter qu'il ait autant de rudesse dans les formes." Élie de Comminges dans son ouvrage Souvenirs d'enfance et de régiment (Paris, 1930) le décrit de la manière suivante : « M. de Nansouty, mon chef d'escadron, un type de vieil africain à moustaches et à barbiche énormes, mal embouché, égrenant un chapelet de jurons à faire dresser les cheveux sur la tête, passant alors pour un brave à trois poils, un sabreur fini ». En août 1857, il est nommé lieutenant-colonel au 6e régiment de Lanciers et enfin colonel en août 1861 du 8e régiment de Lanciers. En février 1867, il retourne en Afrique pour mettre sur pied le 4e régiment de chasseurs d'Afrique. En février 1869, il est nommé général de brigade et prend le commandement de la subdivision du Maine et Loire. En mars 1869, il va au Camp de Chalons pour commander la 1ère brigade de la division de cavalerie, puis en avril 1869 prend la tête de la subdivision des Hautes-Pyrénées. En juillet 1870, il est nommé commandant de le 2e brigade de la division de cavalerie du 1er Corps d’Armée du Rhin. Il participe à la guerre franco-allemande de 1870. Sa brigade est en deuxième ligne en août 1870 lors de la bataille de Frœschwiller-Wœrth (5 et 6 août 1870, dans le Bas-Rhin). Victoire des Prussiens sur les Français du maréchal de Mac Mahon. En novembre 1870, il est nommé général de division à titre provisoire et est affecté à Toulouse, où il est confronté aux troubles entraînés par la Commune (Ligue du Sud-Ouest). Son commandement n'est pas un succès car à Toulouse il refuse d’ouvrir le feu sur les insurgés de la Commune. Il se trouve assiégé dans la caserne et est remplacé dans son commandement par le général Pourcet, étant dès lors relevé de son commandement pour inaction. En avril 1871, il est remis général de brigade dans les Hautes-Pyrénées. Puis la commission de grade le met en non-activité par retrait d'emploi en septembre 1871, pour avoir exercé un commandement actif à la suite de la capitulation à la bataille de Sedan de 1870, et, la paix signée, alors que l'armée s'était rendue. En désobéissant aux ordres, il avait ainsi évité la capture de ses 12.000 hommes et rejoint l’armée de la Loire à Versailles, où il fut nommé à la tête d'une brigade de cavalerie du 16e Corps d’Armée. Ulcéré, il adresse un violent courrier de protestation au Conseil, et écope de 60 jours de prison par le ministre. Une peine qu’il exécute en fin d’année à la citadelle de Bayonne. En janvier 1872, il est réintégré, mais reste en disponibilité sans affectation. Il ne fut jamais rappelé à l'activité et, passé en 1877 au cadre de réserve, fut mis, à sa demande, à la retraite. Après sa carrière militaire, Charles de Nansouty se retire dans les Pyrénées et s’adonne à la conchyliologie, à la géologie, à la paléontologie, et se passionne pour la haute montagne. Il fouille aux environs de Lourdes des tumuli et se plonge dans l’étude des mollusques découverts sur les pierres des murs. Et dès 1873, il se passionne pour un projet de création d'un observatoire météorologique au sommet du pic du Midi de Bigorre et contribue à poser les bases du futur observatoire. Pour démontrer qu'on pouvait passer l'hiver en altitude, il n'hésite pas à s'installer au col de Sencours, à 2.378 m d’altitude, qu'il dû d'ailleurs quitter au péril de sa vie et de celle de ses deux compagnons en décembre 1874. Il ne fut pas découragé pour autant et recommença à y séjourner les hivers suivants. Il y vit en ermite, étudie les phénomènes physiques mais aussi la faune, la flore, la minéralogie. Aidé par la Société Ramond de Bagnères-de-Bigorre dans les Pyrénées, où il avait acheté une maison en 1860, et dont il est membre, Charles de Nansouty installe à 500 mètres au-dessous du sommet du Pic du Midi, à l'auberge de Sencours, une station météorologique où il passera tous ses hivers et qui fut remplacée en 1881 par un véritable observatoire, construit à partir du 22 mai 1878, avec le produit de souscriptions, et d'après les plans de l'ingénieur Célestin-Xavier Vaussenat, au sommet même du pic du Midi de Bigorre, à 2.877 mètres d’altitude. Charles de Nansouty avait connu Célestin-Xavier Vaussenat, qui était ingénieur civil des mines, au sein de la société Ramond. Le gros œuvre fut achevé le 30 juillet 1880, l’aménagement définitif le 1er octobre 1881. Charles de Nansouty n’était pas parmi les fondateurs, le 19 août 1864, à l'hôtel des Voyageurs du cirque de Gavarnie, de la société Ramond, société savante et de montagnards, où étaient Charles Packe, Émilien Frossard, le comte Henry Russell et par la suite le Dr Costallat, un des créateurs en 1854 de l'hôtellerie de Sencours et qui lança l’idée d’un observatoire, Célestin-Xavier Vaussenat, mais il en sera le président de 1865 jusqu’à sa mort en 1895. À partir de ce groupe de personnes fut lancé le projet d’études du Pic du Midi de Bigorre. Célestin-Xavier Vaussenat se charge de trouver les fonds nécessaires à ce projet. Parmi les donateurs la société Ramond, Montréjeau Charles Baggio de Carvin, Paul Bert d'Auxerre, M. Offshein de Paris et les ministres Bardoux, Freycinet, J. Ferry. Charles de Nansouty resta huit ans au col de Sencours, en contrebas du Pic du Midi de Bigorre où il fit des observations météorologiques de routine dans la station météorologique provisoire installée en 1873. Le 14 décembre 1874, il dut quitter les lieux car la station fut violemment ébranlée le 11 décembre 1874, par un tremblement de terre dont les trépidations rendirent le local inhabitable et que MM. de Nansouty, V. Baylac et Brau durent évacuer au péril de leurs jours. Une plaque commémorative est posée en 1974 au col de Sencours pour la première et dernière retraite du général et ses hommes en ce lieu inhospitalier et en hommage aux premiers pionniers de l’Observatoire du pic du Midi. Le 31 décembre 1875, il fut rejoint par Roger de Monts pour fêter le nouvel an au sommet du Pic du Midi de Bigorre. De là vient la vocation de Roger de Monts pour les ascensions hivernales. Les premiers terrassements au sommet du pic commencent en 1875. Le 21 mai 1878, la première pierre de l'Observatoire du pic du Midi est posée. Les travaux commencèrent le 28 juin 1878, couverts donc par souscription, grâce à la persévérance et sous la direction du général de Nansouty qui ne passe rien, vaillamment aidé par l'ingénieur Célestin-Xavier Vaussenat. Ils durent 4 ans parce que les travaux ne peuvent se faire que pendant les quatre mois où le sommet n’est pas recouvert de neige et est aisément accessible à pied ou à mulet entre la fin juillet et la mi-octobre. En mars 1879, une avalanche emporta et broya l'observatoire, dont les habitants s'échappèrent par miracle. Une construction homérique, où les matériaux sont montés à dos d'hommes, d’ânes et de mulets. L'enfer. Le gros œuvre est achevé le 30 juillet 1880. L'Observatoire est inauguré au mois d'août 1882. Les premiers locaux, plus que rustiques, sont achevés le 8 septembre 1882, et l’observatoire fonctionne. Cette opération est une réussite, mais la gestion très lourde ruine les finances de la société Ramond, qui doit se résoudre à céder l’observatoire à l’État. Ses fondateurs étant dans l'impossibilité d'assurer la gestion et l'entretien de leur œuvre, ils en font don à l'État, à condition que celui-ci paie les dettes restantes et qu'il fournisse une subvention annuelle de 30.000 francs pour couvrir le salaire du directeur et de quelques employés et les frais de fonctionnement de la station. L'Observatoire du Pic du Midi fut donc racheté le 7 septembre 1882 par l'État, et le général Charles de Nansouty en fut nommé directeur honoraire. Le directeur étant Célestin-Xavier Vaussenat. L'astéroïde (44263) Nansouty de la ceinture principale d'astéroïdes, qui fut découvert le 28 août 1998 à Dax par P. Dupouy et F. Maréchal, porte son nom car le pic du Midi est devenu ensuite un Observatoire astronomique. Et Charles de Nansouty mourut bien avant de voir le pic jouer un rôle important dans l’astronomie moderne. L’inauguration des deux bustes de Nansouty et Vaussenat eut lieu le 25 septembre 1899. Mais ne vous fiez pas à la photographie des deux hommes qui ont l’air de bien s’entendre : vers la fin de leur aventure, les deux hommes étaient brouillés et ne s’adressaient plus la parole. Mais le premier défi, sans doute le plus grand de tous, a bien été la création même de l’Observatoire du pic. L'idée d'y établir une station d'observation scientifique, météo et botanique d'abord, était complètement dingue, le mot n'est pas trop fort. Aujourd'hui, monter au pic du Midi, c'est presque devenu banal, avec le téléphérique. Mais quand Charles Nansouty, un général excentrique, a eu cette idée dingue, il n’y avait rien au pic du Midi, à part des conditions de vie dantesques. La première observation scientifique fut faite par l’astronome François de Plantade en 1706 lors d'une éclipse solaire. Mais son ascension, à 70 ans, du pic du Midi de Bigorre lui fut fatale. Le 25 août 1741, il meurt au col de Sencours, sextant au poing, en s'exclamant : « Ah ! que tout ceci est beau ! » Plusieurs autres observations vont suivre. En 1901, le directeur de l’Observatoire de Toulouse Benjamin Baillaud, séduit par la qualité du ciel du pic du Midi, lance l’idée d’un observatoire astronomique et le fait équiper progressivement en lunettes et télescopes. Il y fait monter en 22 caisses de 350 à 700 kg un télescope équatorial de 50 cm de diamètre et 6 m focale. Cet instrument associé à la pureté du ciel permet de remarquables observations qui rendent l’Observatoire rapidement célèbre. Et le premier télescope est installé en 1907 par Baillaud. Une première antenne relais est montée en 1927 pour assurer la radiodiffusion. Dans les années 1930 l’astronome français Bernard Lyot monte régulièrement à l’Observatoire du pic du Midi pour y observer les planètes et surtout utiliser son coronographe, un instrument dont il est l’inventeur et qui permet d’étudier la couronne solaire sans être obligé d’attendre une éclipse totale de Soleil. Il faut patienter jusqu’en 1949 pour que l’électricité arrive au sommet et ne plus dépendre des groupes électrogènes. Trois ans plus tard un téléphérique permet d’acheminer les observateurs ; c’est la fin des montées et descentes par tous les temps qui pouvaient durer entre 5 heures… et 2 jours, suivant les conditions climatiques ! Au début des années 1960, le pic du Midi est équipé d’un télescope de 1m de diamètre destiné à l’étude détaillée des sites potentiels d’alunissage pour les missions américaines Apollo et en 1980 c’est un télescope de 2m de diamètre qui est mis en service, le Télescope Bernard Lyot (TBL). Dans les années 1990, l’État envisage la fermeture du site pour financer d’autres observatoires mieux équipés. Grâce à la mobilisation de la région Midi-Pyrénées le site est rénové : désormais, il accueille conjointement chercheurs et grand public. Sans l'entêtement un peu fou de Charles de Nansouty, dont le buste orne la terrasse sud, l'aventure du pic du Midi n'aurait peut-être pas été celle que l'on connaît aujourd'hui. Sur la façade de l’ancienne « habitation des astronomes », le plus vieux bâtiment du pic du Midi (un peu réaménagé) », accessible par la station téléphérique de La Mongie, deux bustes en bronze commémorent la construction de l’Observatoire, à gauche celui, par Nicolas Grandmaison, du général Charles de Nansouty, qui, une fois à la retraite s’est consacré à la création de l’Observatoire du pic du Midi de Bigorre, après avoir pendant huit ans fait des observations météorologiques dans une station provisoire installée en 1873 au col de Sencours. À droite le buste de Célestin-Xavier Vaussenat, ingénieur civil des mines, promoteur de l’observatoire qui se charge de trouver les fonds nécessaires à ce projet. Son buste est l’œuvre de Madeleine Jouvray, collaboratrice de Rodin, dont la signature figure sur le buste. Commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur le 1er août 1867, vingt-cinq ans de service, dix campagnes et une citation, il se retire en 1885 à Dax où il mourra le 11 mars 1895. Un quartier de roche du pic du Midi de Bigorre orne aujourd'hui sa tombe. Charles de Nansouty a publié la plupart de ses recherches dans le Bulletin de la Société Ramond puis dans celui de la Société d'histoire naturelle de Toulouse. L’histoire de l’Observatoire du Pic du Midi est étroitement associée à ces deux initiateurs, Charles du Bois de Nansouty et Célestin-Xavier Vaussenat. Quand on voit scintiller son antenne blanche au soleil, on ne peut s'empêcher de l'admirer, avec une petite bouffée d'orgueil haut-pyrénéen. C'est qu'il en impose ce Pic, tant les défis qui l'accompagnent sont grands. Station météo, station astronomique, étude du Soleil, clichés de la Lune pour la célébrissime mission Apollo 11, préalable indispensable à la pose du pied de Neil Amstrong sur l'astre blanc. Depuis le cœur de la station de La Mongie, le téléphérique du pic du Midi vous transporte en 15 minutes à 2.877 mètres d’altitude. C’est une ascension spectaculaire qui se déroule en deux étapes vers la haute montagne. Un premier trajet vous conduit jusqu’à la gare intermédiaire du Taoulet. Changement de quai, une autre cabine vous attend pour la seconde partie plus spectaculaire, avec un survol maximum de 320 mètres. Puis c’est l’arrivée au sommet. Une plaque en hommage aux courageux porteurs de la vallée, qui ployant sous la charge, malgré le danger, ont permis de vaincre l’isolement du Pic du Midi de Bigorre, où les travaux scientifiques purent se développer ainsi qu’une autre plaque en hommage aux ânes et mulets porteurs du Pic qui ont contribué à la construction et au ravitaillement de l’Observatoire du Pic du Midi apposée en 2017 lors d'un tournage reconstituant la période des portages au Pic du Midi, témoignent des difficultés de construction de cet édifice exposé aux pires avalanches, aux tempêtes terribles et à la foudre, qui non seulement emportaient leurs instruments de travail, mais mirent nuit et jour et à toute heure leur existence en danger.
 Charles Marie Étienne Champion Dubois de NANSOUTY, né le 20 février 1815 à Dijon et mort à Dax dans les Landes le 15 mars 1895, à l’âge de 80 ans est un militaire français qui, après sa retraite de général, se consacra à la création de l’Observatoire du pic du Midi de Bigorre. Il est le fils de Pierre Marie Eugène Champion de Nansouty, lieutenant-colonel d'infanterie et de Alix Antoinette Herminie du Bois d’Aisy. Il est le petit-fils de Jean-Baptiste Champion (né en 1730), Seigneur de Nan-sous-Thil (en Bourgogne, ce qui a donné « Nansouty »), et de Charles de Brosses (président de Brosses, l'auteur des Lettres écrites d’Italie) ; il est aussi le neveu du général de cavalerie Étienne Marie Antoine Champion de Nansouty, qui s'était illustré lors des guerres de la Révolution et de l'Empire et qui fut élevé au grade de général de division en 1803, le grade le plus élevé de la hiérarchie militaire française et dont le nom est inscrit sur l’Arc de triomphe de l’Étoile. Charles de Nansouty épouse le 14 juillet 1852 Hortense Rosalie Fanny de Dion-Wandonne. Son frère Max Marie Paul Adrien (1816-1844), enseigne de vaisseau, meurt à Mahaena (Tahiti) lors de la guerre franco-tahitienne. L'îlot Taaupiri à Mahaena, où il fut inhumé porte son nom ainsi qu'une rue de Papeete. À 12 ans, il est reçu à l’École des pages de Charles XI, où il est élève durant trois années (1827-1830) mais les Trois Glorieuses de 1830 l’en excluent. Il entra, après la révolution de Juillet, dans une usine que possédait son père et qui ne tarda pas à péricliter. En septembre 1837, il s’engage comme volontaire dans l’artillerie et est affecté au 12e régiment d’artillerie et devient brigadier fourrier en mars 1938 puis maréchal des logis en décembre 1838. Grâce à l'appui de la comtesse de Nansouty et d'un ami député, il est ensuite affecté en décembre 1840 au 8e régiment de hussards en formation. En avril 1841, il devient sous-lieutenant au 7e régiment de hussards. En juillet 1842, il part en Algérie française où il est affecté au corps de cavalerie indigène. Peu avant la prise de la smala d'Abd el Kader par le duc d'Aumale, le 14 mai 1843, il est cité à l'ordre de la division d'Oran lors du combat de Sidi El Rashed où il est blessé à la tête, puis une nouvelle fois comme s'étant particulièrement distingué lors du coup de main exécuté le 12 septembre 1843 sur le camp d'Abd el Kader dans la plaine d'Assian sidi Youssef, où son cheval est tué. Le 19 juillet 1845, il devient lieutenant et passe en août 1845 au 3e régiment de Spahis algériens, devenant capitaine en mars 1847 sous les ordres du général Yusuf. Durant toute sa carrière en Afrique, il obtient des notes brillantes, mais en 1851, le général Yusuf le note médiocrement : "Distingué de forme et de manières, intelligent et brillant officier. Son instruction militaire laisse à désirer et ses rapports avec ses chefs ne sont pas toujours convenables." Il revient en France en juin 1851 et rejoint le 7e régiment de cuirassiers puis en août 1852 il rejoint le régiment des Guides de la Garde impériale sous les ordres d’Auguste Regnaud de Saint-Jean d'Angély. En janvier 1853, il est nommé chef d’escadron. Le général Saint-Jean d'Angély, commandant la Garde impériale le note ainsi : "Officier instruit, vigoureux et énergique. Il est à regretter qu'il ait autant de rudesse dans les formes." Élie de Comminges dans son ouvrage Souvenirs d'enfance et de régiment (Paris, 1930) le décrit de la manière suivante : « M. de Nansouty, mon chef d'escadron, un type de vieil africain à moustaches et à barbiche énormes, mal embouché, égrenant un chapelet de jurons à faire dresser les cheveux sur la tête, passant alors pour un brave à trois poils, un sabreur fini ». En août 1857, il est nommé lieutenant-colonel au 6e régiment de Lanciers et enfin colonel en août 1861 du 8e régiment de Lanciers. En février 1867, il retourne en Afrique pour mettre sur pied le 4e régiment de chasseurs d'Afrique. En février 1869, il est nommé général de brigade et prend le commandement de la subdivision du Maine et Loire. En mars 1869, il va au Camp de Chalons pour commander la 1ère brigade de la division de cavalerie, puis en avril 1869 prend la tête de la subdivision des Hautes-Pyrénées. En juillet 1870, il est nommé commandant de le 2e brigade de la division de cavalerie du 1er Corps d’Armée du Rhin. Il participe à la guerre franco-allemande de 1870. Sa brigade est en deuxième ligne en août 1870 lors de la bataille de Frœschwiller-Wœrth (5 et 6 août 1870, dans le Bas-Rhin). Victoire des Prussiens sur les Français du maréchal de Mac Mahon. En novembre 1870, il est nommé général de division à titre provisoire et est affecté à Toulouse, où il est confronté aux troubles entraînés par la Commune (Ligue du Sud-Ouest). Son commandement n'est pas un succès car à Toulouse il refuse d’ouvrir le feu sur les insurgés de la Commune. Il se trouve assiégé dans la caserne et est remplacé dans son commandement par le général Pourcet, étant dès lors relevé de son commandement pour inaction. En avril 1871, il est remis général de brigade dans les Hautes-Pyrénées. Puis la commission de grade le met en non-activité par retrait d'emploi en septembre 1871, pour avoir exercé un commandement actif à la suite de la capitulation à la bataille de Sedan de 1870, et, la paix signée, alors que l'armée s'était rendue. En désobéissant aux ordres, il avait ainsi évité la capture de ses 12.000 hommes et rejoint l’armée de la Loire à Versailles, où il fut nommé à la tête d'une brigade de cavalerie du 16e Corps d’Armée. Ulcéré, il adresse un violent courrier de protestation au Conseil, et écope de 60 jours de prison par le ministre. Une peine qu’il exécute en fin d’année à la citadelle de Bayonne. En janvier 1872, il est réintégré, mais reste en disponibilité sans affectation. Il ne fut jamais rappelé à l'activité et, passé en 1877 au cadre de réserve, fut mis, à sa demande, à la retraite. Après sa carrière militaire, Charles de Nansouty se retire dans les Pyrénées et s’adonne à la conchyliologie, à la géologie, à la paléontologie, et se passionne pour la haute montagne. Il fouille aux environs de Lourdes des tumuli et se plonge dans l’étude des mollusques découverts sur les pierres des murs. Et dès 1873, il se passionne pour un projet de création d'un observatoire météorologique au sommet du pic du Midi de Bigorre et contribue à poser les bases du futur observatoire. Pour démontrer qu'on pouvait passer l'hiver en altitude, il n'hésite pas à s'installer au col de Sencours, à 2.378 m d’altitude, qu'il dû d'ailleurs quitter au péril de sa vie et de celle de ses deux compagnons en décembre 1874. Il ne fut pas découragé pour autant et recommença à y séjourner les hivers suivants. Il y vit en ermite, étudie les phénomènes physiques mais aussi la faune, la flore, la minéralogie. Aidé par la Société Ramond de Bagnères-de-Bigorre dans les Pyrénées, où il avait acheté une maison en 1860, et dont il est membre, Charles de Nansouty installe à 500 mètres au-dessous du sommet du Pic du Midi, à l'auberge de Sencours, une station météorologique où il passera tous ses hivers et qui fut remplacée en 1881 par un véritable observatoire, construit à partir du 22 mai 1878, avec le produit de souscriptions, et d'après les plans de l'ingénieur Célestin-Xavier Vaussenat, au sommet même du pic du Midi de Bigorre, à 2.877 mètres d’altitude. Charles de Nansouty avait connu Célestin-Xavier Vaussenat, qui était ingénieur civil des mines, au sein de la société Ramond. Le gros œuvre fut achevé le 30 juillet 1880, l’aménagement définitif le 1er octobre 1881. Charles de Nansouty n’était pas parmi les fondateurs, le 19 août 1864, à l'hôtel des Voyageurs du cirque de Gavarnie, de la société Ramond, société savante et de montagnards, où étaient Charles Packe, Émilien Frossard, le comte Henry Russell et par la suite le Dr Costallat, un des créateurs en 1854 de l'hôtellerie de Sencours et qui lança l’idée d’un observatoire, Célestin-Xavier Vaussenat, mais il en sera le président de 1865 jusqu’à sa mort en 1895. À partir de ce groupe de personnes fut lancé le projet d’études du Pic du Midi de Bigorre. Célestin-Xavier Vaussenat se charge de trouver les fonds nécessaires à ce projet. Parmi les donateurs la société Ramond, Montréjeau Charles Baggio de Carvin, Paul Bert d'Auxerre, M. Offshein de Paris et les ministres Bardoux, Freycinet, J. Ferry. Charles de Nansouty resta huit ans au col de Sencours, en contrebas du Pic du Midi de Bigorre où il fit des observations météorologiques de routine dans la station météorologique provisoire installée en 1873. Le 14 décembre 1874, il dut quitter les lieux car la station fut violemment ébranlée le 11 décembre 1874, par un tremblement de terre dont les trépidations rendirent le local inhabitable et que MM. de Nansouty, V. Baylac et Brau durent évacuer au péril de leurs jours. Une plaque commémorative est posée en 1974 au col de Sencours pour la première et dernière retraite du général et ses hommes en ce lieu inhospitalier et en hommage aux premiers pionniers de l’Observatoire du pic du Midi. Le 31 décembre 1875, il fut rejoint par Roger de Monts pour fêter le nouvel an au sommet du Pic du Midi de Bigorre. De là vient la vocation de Roger de Monts pour les ascensions hivernales. Les premiers terrassements au sommet du pic commencent en 1875. Le 21 mai 1878, la première pierre de l'Observatoire du pic du Midi est posée. Les travaux commencèrent le 28 juin 1878, couverts donc par souscription, grâce à la persévérance et sous la direction du général de Nansouty qui ne passe rien, vaillamment aidé par l'ingénieur Célestin-Xavier Vaussenat. Ils durent 4 ans parce que les travaux ne peuvent se faire que pendant les quatre mois où le sommet n’est pas recouvert de neige et est aisément accessible à pied ou à mulet entre la fin juillet et la mi-octobre. En mars 1879, une avalanche emporta et broya l'observatoire, dont les habitants s'échappèrent par miracle. Une construction homérique, où les matériaux sont montés à dos d'hommes, d’ânes et de mulets. L'enfer. Le gros œuvre est achevé le 30 juillet 1880. L'Observatoire est inauguré au mois d'août 1882. Les premiers locaux, plus que rustiques, sont achevés le 8 septembre 1882, et l’observatoire fonctionne. Cette opération est une réussite, mais la gestion très lourde ruine les finances de la société Ramond, qui doit se résoudre à céder l’observatoire à l’État. Ses fondateurs étant dans l'impossibilité d'assurer la gestion et l'entretien de leur œuvre, ils en font don à l'État, à condition que celui-ci paie les dettes restantes et qu'il fournisse une subvention annuelle de 30.000 francs pour couvrir le salaire du directeur et de quelques employés et les frais de fonctionnement de la station. L'Observatoire du Pic du Midi fut donc racheté le 7 septembre 1882 par l'État, et le général Charles de Nansouty en fut nommé directeur honoraire. Le directeur étant Célestin-Xavier Vaussenat. L'astéroïde (44263) Nansouty de la ceinture principale d'astéroïdes, qui fut découvert le 28 août 1998 à Dax par P. Dupouy et F. Maréchal, porte son nom car le pic du Midi est devenu ensuite un Observatoire astronomique. Et Charles de Nansouty mourut bien avant de voir le pic jouer un rôle important dans l’astronomie moderne. L’inauguration des deux bustes de Nansouty et Vaussenat eut lieu le 25 septembre 1899. Mais ne vous fiez pas à la photographie des deux hommes qui ont l’air de bien s’entendre : vers la fin de leur aventure, les deux hommes étaient brouillés et ne s’adressaient plus la parole. Mais le premier défi, sans doute le plus grand de tous, a bien été la création même de l’Observatoire du pic. L'idée d'y établir une station d'observation scientifique, météo et botanique d'abord, était complètement dingue, le mot n'est pas trop fort. Aujourd'hui, monter au pic du Midi, c'est presque devenu banal, avec le téléphérique. Mais quand Charles Nansouty, un général excentrique, a eu cette idée dingue, il n’y avait rien au pic du Midi, à part des conditions de vie dantesques. La première observation scientifique fut faite par l’astronome François de Plantade en 1706 lors d'une éclipse solaire. Mais son ascension, à 70 ans, du pic du Midi de Bigorre lui fut fatale. Le 25 août 1741, il meurt au col de Sencours, sextant au poing, en s'exclamant : « Ah ! que tout ceci est beau ! » Plusieurs autres observations vont suivre. En 1901, le directeur de l’Observatoire de Toulouse Benjamin Baillaud, séduit par la qualité du ciel du pic du Midi, lance l’idée d’un observatoire astronomique et le fait équiper progressivement en lunettes et télescopes. Il y fait monter en 22 caisses de 350 à 700 kg un télescope équatorial de 50 cm de diamètre et 6 m focale. Cet instrument associé à la pureté du ciel permet de remarquables observations qui rendent l’Observatoire rapidement célèbre. Et le premier télescope est installé en 1907 par Baillaud. Une première antenne relais est montée en 1927 pour assurer la radiodiffusion. Dans les années 1930 l’astronome français Bernard Lyot monte régulièrement à l’Observatoire du pic du Midi pour y observer les planètes et surtout utiliser son coronographe, un instrument dont il est l’inventeur et qui permet d’étudier la couronne solaire sans être obligé d’attendre une éclipse totale de Soleil. Il faut patienter jusqu’en 1949 pour que l’électricité arrive au sommet et ne plus dépendre des groupes électrogènes. Trois ans plus tard un téléphérique permet d’acheminer les observateurs ; c’est la fin des montées et descentes par tous les temps qui pouvaient durer entre 5 heures… et 2 jours, suivant les conditions climatiques ! Au début des années 1960, le pic du Midi est équipé d’un télescope de 1m de diamètre destiné à l’étude détaillée des sites potentiels d’alunissage pour les missions américaines Apollo et en 1980 c’est un télescope de 2m de diamètre qui est mis en service, le Télescope Bernard Lyot (TBL). Dans les années 1990, l’État envisage la fermeture du site pour financer d’autres observatoires mieux équipés. Grâce à la mobilisation de la région Midi-Pyrénées le site est rénové : désormais, il accueille conjointement chercheurs et grand public. Sans l'entêtement un peu fou de Charles de Nansouty, dont le buste orne la terrasse sud, l'aventure du pic du Midi n'aurait peut-être pas été celle que l'on connaît aujourd'hui. Sur la façade de l’ancienne « habitation des astronomes », le plus vieux bâtiment du pic du Midi (un peu réaménagé) », accessible par la station téléphérique de La Mongie, deux bustes en bronze commémorent la construction de l’Observatoire, à gauche celui, par Nicolas Grandmaison, du général Charles de Nansouty, qui, une fois à la retraite s’est consacré à la création de l’Observatoire du pic du Midi de Bigorre, après avoir pendant huit ans fait des observations météorologiques dans une station provisoire installée en 1873 au col de Sencours. À droite le buste de Célestin-Xavier Vaussenat, ingénieur civil des mines, promoteur de l’observatoire qui se charge de trouver les fonds nécessaires à ce projet. Son buste est l’œuvre de Madeleine Jouvray, collaboratrice de Rodin, dont la signature figure sur le buste. Commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur le 1er août 1867, vingt-cinq ans de service, dix campagnes et une citation, il se retire en 1885 à Dax où il mourra le 11 mars 1895. Un quartier de roche du pic du Midi de Bigorre orne aujourd'hui sa tombe. Charles de Nansouty a publié la plupart de ses recherches dans le Bulletin de la Société Ramond puis dans celui de la Société d'histoire naturelle de Toulouse. L’histoire de l’Observatoire du Pic du Midi est étroitement associée à ces deux initiateurs, Charles du Bois de Nansouty et Célestin-Xavier Vaussenat. Quand on voit scintiller son antenne blanche au soleil, on ne peut s'empêcher de l'admirer, avec une petite bouffée d'orgueil haut-pyrénéen. C'est qu'il en impose ce Pic, tant les défis qui l'accompagnent sont grands. Station météo, station astronomique, étude du Soleil, clichés de la Lune pour la célébrissime mission Apollo 11, préalable indispensable à la pose du pied de Neil Amstrong sur l'astre blanc. Depuis le cœur de la station de La Mongie, le téléphérique du pic du Midi vous transporte en 15 minutes à 2.877 mètres d’altitude. C’est une ascension spectaculaire qui se déroule en deux étapes vers la haute montagne. Un premier trajet vous conduit jusqu’à la gare intermédiaire du Taoulet. Changement de quai, une autre cabine vous attend pour la seconde partie plus spectaculaire, avec un survol maximum de 320 mètres. Puis c’est l’arrivée au sommet. Une plaque en hommage aux courageux porteurs de la vallée, qui ployant sous la charge, malgré le danger, ont permis de vaincre l’isolement du Pic du Midi de Bigorre, où les travaux scientifiques purent se développer ainsi qu’une autre plaque en hommage aux ânes et mulets porteurs du Pic qui ont contribué à la construction et au ravitaillement de l’Observatoire du Pic du Midi apposée en 2017 lors d'un tournage reconstituant la période des portages au Pic du Midi, témoignent des difficultés de construction de cet édifice exposé aux pires avalanches, aux tempêtes terribles et à la foudre, qui non seulement emportaient leurs instruments de travail, mais mirent nuit et jour et à toute heure leur existence en danger.
Charles Marie Étienne Champion Dubois de NANSOUTY, né le 20 février 1815 à Dijon et mort à Dax dans les Landes le 15 mars 1895, à l’âge de 80 ans est un militaire français qui, après sa retraite de général, se consacra à la création de l’Observatoire du pic du Midi de Bigorre. Il est le fils de Pierre Marie Eugène Champion de Nansouty, lieutenant-colonel d'infanterie et de Alix Antoinette Herminie du Bois d’Aisy. Il est le petit-fils de Jean-Baptiste Champion (né en 1730), Seigneur de Nan-sous-Thil (en Bourgogne, ce qui a donné « Nansouty »), et de Charles de Brosses (président de Brosses, l'auteur des Lettres écrites d’Italie) ; il est aussi le neveu du général de cavalerie Étienne Marie Antoine Champion de Nansouty, qui s'était illustré lors des guerres de la Révolution et de l'Empire et qui fut élevé au grade de général de division en 1803, le grade le plus élevé de la hiérarchie militaire française et dont le nom est inscrit sur l’Arc de triomphe de l’Étoile. Charles de Nansouty épouse le 14 juillet 1852 Hortense Rosalie Fanny de Dion-Wandonne. Son frère Max Marie Paul Adrien (1816-1844), enseigne de vaisseau, meurt à Mahaena (Tahiti) lors de la guerre franco-tahitienne. L'îlot Taaupiri à Mahaena, où il fut inhumé porte son nom ainsi qu'une rue de Papeete. À 12 ans, il est reçu à l’École des pages de Charles XI, où il est élève durant trois années (1827-1830) mais les Trois Glorieuses de 1830 l’en excluent. Il entra, après la révolution de Juillet, dans une usine que possédait son père et qui ne tarda pas à péricliter. En septembre 1837, il s’engage comme volontaire dans l’artillerie et est affecté au 12e régiment d’artillerie et devient brigadier fourrier en mars 1938 puis maréchal des logis en décembre 1838. Grâce à l'appui de la comtesse de Nansouty et d'un ami député, il est ensuite affecté en décembre 1840 au 8e régiment de hussards en formation. En avril 1841, il devient sous-lieutenant au 7e régiment de hussards. En juillet 1842, il part en Algérie française où il est affecté au corps de cavalerie indigène. Peu avant la prise de la smala d'Abd el Kader par le duc d'Aumale, le 14 mai 1843, il est cité à l'ordre de la division d'Oran lors du combat de Sidi El Rashed où il est blessé à la tête, puis une nouvelle fois comme s'étant particulièrement distingué lors du coup de main exécuté le 12 septembre 1843 sur le camp d'Abd el Kader dans la plaine d'Assian sidi Youssef, où son cheval est tué. Le 19 juillet 1845, il devient lieutenant et passe en août 1845 au 3e régiment de Spahis algériens, devenant capitaine en mars 1847 sous les ordres du général Yusuf. Durant toute sa carrière en Afrique, il obtient des notes brillantes, mais en 1851, le général Yusuf le note médiocrement : "Distingué de forme et de manières, intelligent et brillant officier. Son instruction militaire laisse à désirer et ses rapports avec ses chefs ne sont pas toujours convenables." Il revient en France en juin 1851 et rejoint le 7e régiment de cuirassiers puis en août 1852 il rejoint le régiment des Guides de la Garde impériale sous les ordres d’Auguste Regnaud de Saint-Jean d'Angély. En janvier 1853, il est nommé chef d’escadron. Le général Saint-Jean d'Angély, commandant la Garde impériale le note ainsi : "Officier instruit, vigoureux et énergique. Il est à regretter qu'il ait autant de rudesse dans les formes." Élie de Comminges dans son ouvrage Souvenirs d'enfance et de régiment (Paris, 1930) le décrit de la manière suivante : « M. de Nansouty, mon chef d'escadron, un type de vieil africain à moustaches et à barbiche énormes, mal embouché, égrenant un chapelet de jurons à faire dresser les cheveux sur la tête, passant alors pour un brave à trois poils, un sabreur fini ». En août 1857, il est nommé lieutenant-colonel au 6e régiment de Lanciers et enfin colonel en août 1861 du 8e régiment de Lanciers. En février 1867, il retourne en Afrique pour mettre sur pied le 4e régiment de chasseurs d'Afrique. En février 1869, il est nommé général de brigade et prend le commandement de la subdivision du Maine et Loire. En mars 1869, il va au Camp de Chalons pour commander la 1ère brigade de la division de cavalerie, puis en avril 1869 prend la tête de la subdivision des Hautes-Pyrénées. En juillet 1870, il est nommé commandant de le 2e brigade de la division de cavalerie du 1er Corps d’Armée du Rhin. Il participe à la guerre franco-allemande de 1870. Sa brigade est en deuxième ligne en août 1870 lors de la bataille de Frœschwiller-Wœrth (5 et 6 août 1870, dans le Bas-Rhin). Victoire des Prussiens sur les Français du maréchal de Mac Mahon. En novembre 1870, il est nommé général de division à titre provisoire et est affecté à Toulouse, où il est confronté aux troubles entraînés par la Commune (Ligue du Sud-Ouest). Son commandement n'est pas un succès car à Toulouse il refuse d’ouvrir le feu sur les insurgés de la Commune. Il se trouve assiégé dans la caserne et est remplacé dans son commandement par le général Pourcet, étant dès lors relevé de son commandement pour inaction. En avril 1871, il est remis général de brigade dans les Hautes-Pyrénées. Puis la commission de grade le met en non-activité par retrait d'emploi en septembre 1871, pour avoir exercé un commandement actif à la suite de la capitulation à la bataille de Sedan de 1870, et, la paix signée, alors que l'armée s'était rendue. En désobéissant aux ordres, il avait ainsi évité la capture de ses 12.000 hommes et rejoint l’armée de la Loire à Versailles, où il fut nommé à la tête d'une brigade de cavalerie du 16e Corps d’Armée. Ulcéré, il adresse un violent courrier de protestation au Conseil, et écope de 60 jours de prison par le ministre. Une peine qu’il exécute en fin d’année à la citadelle de Bayonne. En janvier 1872, il est réintégré, mais reste en disponibilité sans affectation. Il ne fut jamais rappelé à l'activité et, passé en 1877 au cadre de réserve, fut mis, à sa demande, à la retraite. Après sa carrière militaire, Charles de Nansouty se retire dans les Pyrénées et s’adonne à la conchyliologie, à la géologie, à la paléontologie, et se passionne pour la haute montagne. Il fouille aux environs de Lourdes des tumuli et se plonge dans l’étude des mollusques découverts sur les pierres des murs. Et dès 1873, il se passionne pour un projet de création d'un observatoire météorologique au sommet du pic du Midi de Bigorre et contribue à poser les bases du futur observatoire. Pour démontrer qu'on pouvait passer l'hiver en altitude, il n'hésite pas à s'installer au col de Sencours, à 2.378 m d’altitude, qu'il dû d'ailleurs quitter au péril de sa vie et de celle de ses deux compagnons en décembre 1874. Il ne fut pas découragé pour autant et recommença à y séjourner les hivers suivants. Il y vit en ermite, étudie les phénomènes physiques mais aussi la faune, la flore, la minéralogie. Aidé par la Société Ramond de Bagnères-de-Bigorre dans les Pyrénées, où il avait acheté une maison en 1860, et dont il est membre, Charles de Nansouty installe à 500 mètres au-dessous du sommet du Pic du Midi, à l'auberge de Sencours, une station météorologique où il passera tous ses hivers et qui fut remplacée en 1881 par un véritable observatoire, construit à partir du 22 mai 1878, avec le produit de souscriptions, et d'après les plans de l'ingénieur Célestin-Xavier Vaussenat, au sommet même du pic du Midi de Bigorre, à 2.877 mètres d’altitude. Charles de Nansouty avait connu Célestin-Xavier Vaussenat, qui était ingénieur civil des mines, au sein de la société Ramond. Le gros œuvre fut achevé le 30 juillet 1880, l’aménagement définitif le 1er octobre 1881. Charles de Nansouty n’était pas parmi les fondateurs, le 19 août 1864, à l'hôtel des Voyageurs du cirque de Gavarnie, de la société Ramond, société savante et de montagnards, où étaient Charles Packe, Émilien Frossard, le comte Henry Russell et par la suite le Dr Costallat, un des créateurs en 1854 de l'hôtellerie de Sencours et qui lança l’idée d’un observatoire, Célestin-Xavier Vaussenat, mais il en sera le président de 1865 jusqu’à sa mort en 1895. À partir de ce groupe de personnes fut lancé le projet d’études du Pic du Midi de Bigorre. Célestin-Xavier Vaussenat se charge de trouver les fonds nécessaires à ce projet. Parmi les donateurs la société Ramond, Montréjeau Charles Baggio de Carvin, Paul Bert d'Auxerre, M. Offshein de Paris et les ministres Bardoux, Freycinet, J. Ferry. Charles de Nansouty resta huit ans au col de Sencours, en contrebas du Pic du Midi de Bigorre où il fit des observations météorologiques de routine dans la station météorologique provisoire installée en 1873. Le 14 décembre 1874, il dut quitter les lieux car la station fut violemment ébranlée le 11 décembre 1874, par un tremblement de terre dont les trépidations rendirent le local inhabitable et que MM. de Nansouty, V. Baylac et Brau durent évacuer au péril de leurs jours. Une plaque commémorative est posée en 1974 au col de Sencours pour la première et dernière retraite du général et ses hommes en ce lieu inhospitalier et en hommage aux premiers pionniers de l’Observatoire du pic du Midi. Le 31 décembre 1875, il fut rejoint par Roger de Monts pour fêter le nouvel an au sommet du Pic du Midi de Bigorre. De là vient la vocation de Roger de Monts pour les ascensions hivernales. Les premiers terrassements au sommet du pic commencent en 1875. Le 21 mai 1878, la première pierre de l'Observatoire du pic du Midi est posée. Les travaux commencèrent le 28 juin 1878, couverts donc par souscription, grâce à la persévérance et sous la direction du général de Nansouty qui ne passe rien, vaillamment aidé par l'ingénieur Célestin-Xavier Vaussenat. Ils durent 4 ans parce que les travaux ne peuvent se faire que pendant les quatre mois où le sommet n’est pas recouvert de neige et est aisément accessible à pied ou à mulet entre la fin juillet et la mi-octobre. En mars 1879, une avalanche emporta et broya l'observatoire, dont les habitants s'échappèrent par miracle. Une construction homérique, où les matériaux sont montés à dos d'hommes, d’ânes et de mulets. L'enfer. Le gros œuvre est achevé le 30 juillet 1880. L'Observatoire est inauguré au mois d'août 1882. Les premiers locaux, plus que rustiques, sont achevés le 8 septembre 1882, et l’observatoire fonctionne. Cette opération est une réussite, mais la gestion très lourde ruine les finances de la société Ramond, qui doit se résoudre à céder l’observatoire à l’État. Ses fondateurs étant dans l'impossibilité d'assurer la gestion et l'entretien de leur œuvre, ils en font don à l'État, à condition que celui-ci paie les dettes restantes et qu'il fournisse une subvention annuelle de 30.000 francs pour couvrir le salaire du directeur et de quelques employés et les frais de fonctionnement de la station. L'Observatoire du Pic du Midi fut donc racheté le 7 septembre 1882 par l'État, et le général Charles de Nansouty en fut nommé directeur honoraire. Le directeur étant Célestin-Xavier Vaussenat. L'astéroïde (44263) Nansouty de la ceinture principale d'astéroïdes, qui fut découvert le 28 août 1998 à Dax par P. Dupouy et F. Maréchal, porte son nom car le pic du Midi est devenu ensuite un Observatoire astronomique. Et Charles de Nansouty mourut bien avant de voir le pic jouer un rôle important dans l’astronomie moderne. L’inauguration des deux bustes de Nansouty et Vaussenat eut lieu le 25 septembre 1899. Mais ne vous fiez pas à la photographie des deux hommes qui ont l’air de bien s’entendre : vers la fin de leur aventure, les deux hommes étaient brouillés et ne s’adressaient plus la parole. Mais le premier défi, sans doute le plus grand de tous, a bien été la création même de l’Observatoire du pic. L'idée d'y établir une station d'observation scientifique, météo et botanique d'abord, était complètement dingue, le mot n'est pas trop fort. Aujourd'hui, monter au pic du Midi, c'est presque devenu banal, avec le téléphérique. Mais quand Charles Nansouty, un général excentrique, a eu cette idée dingue, il n’y avait rien au pic du Midi, à part des conditions de vie dantesques. La première observation scientifique fut faite par l’astronome François de Plantade en 1706 lors d'une éclipse solaire. Mais son ascension, à 70 ans, du pic du Midi de Bigorre lui fut fatale. Le 25 août 1741, il meurt au col de Sencours, sextant au poing, en s'exclamant : « Ah ! que tout ceci est beau ! » Plusieurs autres observations vont suivre. En 1901, le directeur de l’Observatoire de Toulouse Benjamin Baillaud, séduit par la qualité du ciel du pic du Midi, lance l’idée d’un observatoire astronomique et le fait équiper progressivement en lunettes et télescopes. Il y fait monter en 22 caisses de 350 à 700 kg un télescope équatorial de 50 cm de diamètre et 6 m focale. Cet instrument associé à la pureté du ciel permet de remarquables observations qui rendent l’Observatoire rapidement célèbre. Et le premier télescope est installé en 1907 par Baillaud. Une première antenne relais est montée en 1927 pour assurer la radiodiffusion. Dans les années 1930 l’astronome français Bernard Lyot monte régulièrement à l’Observatoire du pic du Midi pour y observer les planètes et surtout utiliser son coronographe, un instrument dont il est l’inventeur et qui permet d’étudier la couronne solaire sans être obligé d’attendre une éclipse totale de Soleil. Il faut patienter jusqu’en 1949 pour que l’électricité arrive au sommet et ne plus dépendre des groupes électrogènes. Trois ans plus tard un téléphérique permet d’acheminer les observateurs ; c’est la fin des montées et descentes par tous les temps qui pouvaient durer entre 5 heures… et 2 jours, suivant les conditions climatiques ! Au début des années 1960, le pic du Midi est équipé d’un télescope de 1m de diamètre destiné à l’étude détaillée des sites potentiels d’alunissage pour les missions américaines Apollo et en 1980 c’est un télescope de 2m de diamètre qui est mis en service, le Télescope Bernard Lyot (TBL). Dans les années 1990, l’État envisage la fermeture du site pour financer d’autres observatoires mieux équipés. Grâce à la mobilisation de la région Midi-Pyrénées le site est rénové : désormais, il accueille conjointement chercheurs et grand public. Sans l'entêtement un peu fou de Charles de Nansouty, dont le buste orne la terrasse sud, l'aventure du pic du Midi n'aurait peut-être pas été celle que l'on connaît aujourd'hui. Sur la façade de l’ancienne « habitation des astronomes », le plus vieux bâtiment du pic du Midi (un peu réaménagé) », accessible par la station téléphérique de La Mongie, deux bustes en bronze commémorent la construction de l’Observatoire, à gauche celui, par Nicolas Grandmaison, du général Charles de Nansouty, qui, une fois à la retraite s’est consacré à la création de l’Observatoire du pic du Midi de Bigorre, après avoir pendant huit ans fait des observations météorologiques dans une station provisoire installée en 1873 au col de Sencours. À droite le buste de Célestin-Xavier Vaussenat, ingénieur civil des mines, promoteur de l’observatoire qui se charge de trouver les fonds nécessaires à ce projet. Son buste est l’œuvre de Madeleine Jouvray, collaboratrice de Rodin, dont la signature figure sur le buste. Commandeur de l'Ordre national de la Légion d'honneur le 1er août 1867, vingt-cinq ans de service, dix campagnes et une citation, il se retire en 1885 à Dax où il mourra le 11 mars 1895. Un quartier de roche du pic du Midi de Bigorre orne aujourd'hui sa tombe. Charles de Nansouty a publié la plupart de ses recherches dans le Bulletin de la Société Ramond puis dans celui de la Société d'histoire naturelle de Toulouse. L’histoire de l’Observatoire du Pic du Midi est étroitement associée à ces deux initiateurs, Charles du Bois de Nansouty et Célestin-Xavier Vaussenat. Quand on voit scintiller son antenne blanche au soleil, on ne peut s'empêcher de l'admirer, avec une petite bouffée d'orgueil haut-pyrénéen. C'est qu'il en impose ce Pic, tant les défis qui l'accompagnent sont grands. Station météo, station astronomique, étude du Soleil, clichés de la Lune pour la célébrissime mission Apollo 11, préalable indispensable à la pose du pied de Neil Amstrong sur l'astre blanc. Depuis le cœur de la station de La Mongie, le téléphérique du pic du Midi vous transporte en 15 minutes à 2.877 mètres d’altitude. C’est une ascension spectaculaire qui se déroule en deux étapes vers la haute montagne. Un premier trajet vous conduit jusqu’à la gare intermédiaire du Taoulet. Changement de quai, une autre cabine vous attend pour la seconde partie plus spectaculaire, avec un survol maximum de 320 mètres. Puis c’est l’arrivée au sommet. Une plaque en hommage aux courageux porteurs de la vallée, qui ployant sous la charge, malgré le danger, ont permis de vaincre l’isolement du Pic du Midi de Bigorre, où les travaux scientifiques purent se développer ainsi qu’une autre plaque en hommage aux ânes et mulets porteurs du Pic qui ont contribué à la construction et au ravitaillement de l’Observatoire du Pic du Midi apposée en 2017 lors d'un tournage reconstituant la période des portages au Pic du Midi, témoignent des difficultés de construction de cet édifice exposé aux pires avalanches, aux tempêtes terribles et à la foudre, qui non seulement emportaient leurs instruments de travail, mais mirent nuit et jour et à toute heure leur existence en danger.NARS François (1959-XXXX)
Maquilleur professionnel, photographe et iconoclaste
 François NARS, est né en 1959 à Tarbes. Quand il était enfant, avec ses parents, il faisait énormément de balades et d’escalade dans les Pyrénées. Il aimait les lacs d'eau claire, le bruit des cascades. Biarritz, où il avait passé la plupart de ses vacances avec ses parents est aussi une grande source de souvenirs. Il a toujours gardé une nostalgie des embruns de l'océan et de l’air des Pyrénées. Dès son plus jeune âge, vers 12-13 ans, il développe une passion dévorante pour les magazines de mode et les mises en beauté qu’il y découvre mais également pour les grands couturiers, en particulier Yves Saint Laurent, à qui il voue une admiration considérable. Ce sont ses parents et grands-parents qui lui donnent ce goût pour l’art et en particulier sa mère Claudette, qui possédait sa propre collection de vêtements de créateurs et aussi ses deux grands-mères Léa et Ginette. Sa mère a été d’une aide précieuse dans sa carrière, notamment en l’introduisant dans le domaine du make-up et en l’aidant également à acquérir son premier emploi en tant qu'assistant de certains des meilleurs maquilleurs de Paris. L’influence de sa famille transparaît encore aujourd’hui à travers la passion de Nars pour l’architecture et les musées. Il est fasciné par les grands peintres des 18e, 19e et 20e siècles : de Picasso et les impressionnistes aux peintres modernes, parmi lesquels Rothko ou Mondrian. Après avoir obtenu son diplôme de l'école d’esthétique et de maquillage de l’Institut Carita à Paris, il s’engage dans une carrière plus que prolifique et riche de prestigieuses collaborations. Il travaille tout d’abord avec le photographe Paolo Roversi. Puis il part en 1984 poser ses valises à New York pour vivre pleinement sa passion pour le maquillage, sur les conseils de la célèbre styliste américaine Polly Mellen. Une ville, où il sera amené à travailler pour Harper’s Bazaar ainsi que pour le Vogue américain et italien. Ce sera le début d’une brillante carrière au fil de laquelle il travaille avec les top models les plus en vue de l’époque : Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell ou encore Kate Moss dans les années 1990. Parmi ses nombreuses collaborations – marques, photographes, célébrités – on retrouve les créateurs Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, Valentino…les photographes Patrick Demarchelier, Helmut Newton, Richard Avedon et tant de célébrités, dont Sharon Stone, Madonna, Isabella Rossellini, Anjelica Houston, Catherine Deneuve, Michelle Pfeiffer et dernièrement Bella Hadid. New York, où il vit toujours par intermittence, lui préférant la Polynésie française sur sa propre île privée “Motu Tane”, proche de Bora Bora, où il a vécu ces quinze dernières années. New York, fut un choix décisif pour sa carrière. Rapidement, il devient le maquilleur chouchou auprès de nombreux créateurs comme Marc Jacobs, et s’attire les faveurs de nombreuses stars comme Naomi Campbell, ou encore Linda Evangelista. Il a une approche très artistique du maquillage, le considérant comme un moyen de faire ressortir la personnalité de celle ou celui qui le porte. Il joue avec les couleurs pour accentuer le caractère et les traits du visage, créant ainsi des looks ultra modernes, tout en se tournant volontiers pour un travail du teint minimaliste. Et il s’est fait ainsi connaître pour son amour de la couleur et du style moderne. Au début des années 1990, il commence à s’interroger sur les limites du maquillage qu’il peut trouver dans le commerce en tant que maquilleur freelance. Son imagination va bien au-delà du maquillage proposé à l’époque, tant en termes de textures que de couleurs. En 1992, Il travaille pour la styliste Anna Sui et la chanteuse Madona pour le livre « Sex », qu’elle a écrit sous le pseudonyme de Dita. Au cours des deux années suivantes il continue à travailler pour Anna Sui, Versace et Marc Jacobs. C’est en 1994, que le maquilleur et photographe de talent décide de créer et de distribuer sa propre ligne de maquillage, et de fonder sa propre marque éponyme NARS Cosmetics, composée alors uniquement de douze rouges à lèvres, initialement vendus chez Barney’s à New York. Fasciné par la couleur et les textures, il choisit lui-même chaque teinte avec un soin méticuleux et se plie en quatre pour proposer des produits innovants à la qualité exceptionnelle. Cette entreprise française de cosmétiques et de soins de la peau, compte aujourd’hui de nombreux produits de référence pour les maquilleurs professionnels comme le célèbre « blush Orgasm », blush aux reflets scintillants, une référence dans le maquillage, au monde et l’un des produits phares les plus vendus de l’enseigne, et ayant reçu consécutivement par Sephora le prix de meilleur blush pour les années 2006, 2007 et 2008. Le maquilleur se distingue également par ses talents de photographe, domaine dans lequel il évolue depuis 1996, et qu’il a notamment mis en lumière dans différents livres dédiés. Il est devenu photographe pour créer l’identité visuelle des campagnes Nars Cosmetics. S’il n’avait pas été maquilleur, il serait assurément photographe. La photographie étant devenue rapidement une passion à part entière pour lui. Il a publié plusieurs ouvrages de photos, et depuis il shoote les clichés de ses publicités. Il fera des shootings pour les grands magazines, Vogue Paris, Vanity Fair, Harper Bazaar’s, Elle ou Marie Claire entre autres. Il a collaboré avec les plus grands photographes entre Paris et New York, de Richard Avedon à Helmut Newton en passant par Steven Meisel, Paolo Roversi, Irving Penn, Patrick Demarchelier, Bruce Weber, Sarah Moon, pour ne citer qu’eux. Depuis lors, NARS a créé divers produits de beauté à usages multiples et est maintenant une filiale de Shiseido. Bien que la société ait été vendue à Shiseido en 2000, Nars reste directeur artistique de l’enseigne, photographe interne et rédacteur publicitaire pour sa marque. A l’occasion d’une interview accordée au magazine Marie-Claire, il confiera : « Si j’étais resté dans la montagne, je ne serais pas ce que je suis. Plus que de la chance, pour réussir là où on le souhaite, il faut avoir du culot, se tracer une ligne de conduite et s’y tenir. Il faut aussi, j'en suis sûr, beaucoup de passion et, parfois, un peu de patience. La passion est très importante. Le jour où vous perdez la passion, il faut se retirer tout de suite, retourner dans les montagnes, et reprendre les randonnées... Heureusement, j’ai encore beaucoup de passion et de choses à dire, donc la rando ça n'est pas pour tout de suite ! ». En 2016, la marque sort la collection de rouges à lèvres semi-mats Velvet Lip Glide. Aujourd’hui, les produits de maquillage et les soins de la peau sont disponibles dans de nombreuses parfumeries, notamment chez Sephora, mais également sur la boutique en ligne officielle. La marque fait partie du groupe Shiseido, auquel appartiennent également les enseignes Serge Lutens, Narciso Rodriguez, Elie Saab, Zadig et Voltaire. Vingt ans après, nous ne pouvons que témoigner du succès de l’entreprise, succès qui vient sans doute du fait que malgré le rachat en 2000 de la marque – par le groupe Shiseido – François Nars en est resté le directeur artistique et prend encore toutes les décisions. En 1999, il publie un livre de photographies « X-Ray » dans lequel il capture la beauté, le style et la personnalité de ses modèles. S’en suivra en 2001 « Makeup Your Mind (Maquillage Votre Esprit) », une leçon de maquillage donnée à travers des dizaines de photos des tops les plus connus, maquillés par ses soins. Puis plus récemment, le sublime livre « François Nars ». 2019, fut encore une année pleine de nouveauté pour la marque puisque François Nars a décidé de lancer son tout premier parfum, en plus des jolies collections à venir ! Le parfum Audacious, créé en partenariat avec la célèbre parfumeuse Olivia Gicobetti, signature de François Nars, qui présente des notes de tête de frangipanier blanc et de fumée d’encens, s’accordant à la fleur de tiare et au bois de santal. Pour célébrer cette success-story à l'américaine et saluer le travail acharné de ce citoyen d'exception, la France a donc décidé de lui décerner en 2016 sa plus haute distinction civile : la Légion d'honneur. Une récompense qu'il a reçue avec modestie et émotion au cours d'une cérémonie intime animée par Bénédicte de Montlaur, conseillère culturelle de l'Ambassade de France et Ariane Daguin, ancienne lauréate. "Je suis incroyablement humble et fier de recevoir ce prestigieux prix, c'est l'un des plus grands moments de ma carrière. La France est ma patrie et aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Je suis vraiment honoré", avait-il déclaré dans un court discours de remerciements.
François NARS, est né en 1959 à Tarbes. Quand il était enfant, avec ses parents, il faisait énormément de balades et d’escalade dans les Pyrénées. Il aimait les lacs d'eau claire, le bruit des cascades. Biarritz, où il avait passé la plupart de ses vacances avec ses parents est aussi une grande source de souvenirs. Il a toujours gardé une nostalgie des embruns de l'océan et de l’air des Pyrénées. Dès son plus jeune âge, vers 12-13 ans, il développe une passion dévorante pour les magazines de mode et les mises en beauté qu’il y découvre mais également pour les grands couturiers, en particulier Yves Saint Laurent, à qui il voue une admiration considérable. Ce sont ses parents et grands-parents qui lui donnent ce goût pour l’art et en particulier sa mère Claudette, qui possédait sa propre collection de vêtements de créateurs et aussi ses deux grands-mères Léa et Ginette. Sa mère a été d’une aide précieuse dans sa carrière, notamment en l’introduisant dans le domaine du make-up et en l’aidant également à acquérir son premier emploi en tant qu'assistant de certains des meilleurs maquilleurs de Paris. L’influence de sa famille transparaît encore aujourd’hui à travers la passion de Nars pour l’architecture et les musées. Il est fasciné par les grands peintres des 18e, 19e et 20e siècles : de Picasso et les impressionnistes aux peintres modernes, parmi lesquels Rothko ou Mondrian. Après avoir obtenu son diplôme de l'école d’esthétique et de maquillage de l’Institut Carita à Paris, il s’engage dans une carrière plus que prolifique et riche de prestigieuses collaborations. Il travaille tout d’abord avec le photographe Paolo Roversi. Puis il part en 1984 poser ses valises à New York pour vivre pleinement sa passion pour le maquillage, sur les conseils de la célèbre styliste américaine Polly Mellen. Une ville, où il sera amené à travailler pour Harper’s Bazaar ainsi que pour le Vogue américain et italien. Ce sera le début d’une brillante carrière au fil de laquelle il travaille avec les top models les plus en vue de l’époque : Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell ou encore Kate Moss dans les années 1990. Parmi ses nombreuses collaborations – marques, photographes, célébrités – on retrouve les créateurs Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, Valentino…les photographes Patrick Demarchelier, Helmut Newton, Richard Avedon et tant de célébrités, dont Sharon Stone, Madonna, Isabella Rossellini, Anjelica Houston, Catherine Deneuve, Michelle Pfeiffer et dernièrement Bella Hadid. New York, où il vit toujours par intermittence, lui préférant la Polynésie française sur sa propre île privée “Motu Tane”, proche de Bora Bora, où il a vécu ces quinze dernières années. New York, fut un choix décisif pour sa carrière. Rapidement, il devient le maquilleur chouchou auprès de nombreux créateurs comme Marc Jacobs, et s’attire les faveurs de nombreuses stars comme Naomi Campbell, ou encore Linda Evangelista. Il a une approche très artistique du maquillage, le considérant comme un moyen de faire ressortir la personnalité de celle ou celui qui le porte. Il joue avec les couleurs pour accentuer le caractère et les traits du visage, créant ainsi des looks ultra modernes, tout en se tournant volontiers pour un travail du teint minimaliste. Et il s’est fait ainsi connaître pour son amour de la couleur et du style moderne. Au début des années 1990, il commence à s’interroger sur les limites du maquillage qu’il peut trouver dans le commerce en tant que maquilleur freelance. Son imagination va bien au-delà du maquillage proposé à l’époque, tant en termes de textures que de couleurs. En 1992, Il travaille pour la styliste Anna Sui et la chanteuse Madona pour le livre « Sex », qu’elle a écrit sous le pseudonyme de Dita. Au cours des deux années suivantes il continue à travailler pour Anna Sui, Versace et Marc Jacobs. C’est en 1994, que le maquilleur et photographe de talent décide de créer et de distribuer sa propre ligne de maquillage, et de fonder sa propre marque éponyme NARS Cosmetics, composée alors uniquement de douze rouges à lèvres, initialement vendus chez Barney’s à New York. Fasciné par la couleur et les textures, il choisit lui-même chaque teinte avec un soin méticuleux et se plie en quatre pour proposer des produits innovants à la qualité exceptionnelle. Cette entreprise française de cosmétiques et de soins de la peau, compte aujourd’hui de nombreux produits de référence pour les maquilleurs professionnels comme le célèbre « blush Orgasm », blush aux reflets scintillants, une référence dans le maquillage, au monde et l’un des produits phares les plus vendus de l’enseigne, et ayant reçu consécutivement par Sephora le prix de meilleur blush pour les années 2006, 2007 et 2008. Le maquilleur se distingue également par ses talents de photographe, domaine dans lequel il évolue depuis 1996, et qu’il a notamment mis en lumière dans différents livres dédiés. Il est devenu photographe pour créer l’identité visuelle des campagnes Nars Cosmetics. S’il n’avait pas été maquilleur, il serait assurément photographe. La photographie étant devenue rapidement une passion à part entière pour lui. Il a publié plusieurs ouvrages de photos, et depuis il shoote les clichés de ses publicités. Il fera des shootings pour les grands magazines, Vogue Paris, Vanity Fair, Harper Bazaar’s, Elle ou Marie Claire entre autres. Il a collaboré avec les plus grands photographes entre Paris et New York, de Richard Avedon à Helmut Newton en passant par Steven Meisel, Paolo Roversi, Irving Penn, Patrick Demarchelier, Bruce Weber, Sarah Moon, pour ne citer qu’eux. Depuis lors, NARS a créé divers produits de beauté à usages multiples et est maintenant une filiale de Shiseido. Bien que la société ait été vendue à Shiseido en 2000, Nars reste directeur artistique de l’enseigne, photographe interne et rédacteur publicitaire pour sa marque. A l’occasion d’une interview accordée au magazine Marie-Claire, il confiera : « Si j’étais resté dans la montagne, je ne serais pas ce que je suis. Plus que de la chance, pour réussir là où on le souhaite, il faut avoir du culot, se tracer une ligne de conduite et s’y tenir. Il faut aussi, j'en suis sûr, beaucoup de passion et, parfois, un peu de patience. La passion est très importante. Le jour où vous perdez la passion, il faut se retirer tout de suite, retourner dans les montagnes, et reprendre les randonnées... Heureusement, j’ai encore beaucoup de passion et de choses à dire, donc la rando ça n'est pas pour tout de suite ! ». En 2016, la marque sort la collection de rouges à lèvres semi-mats Velvet Lip Glide. Aujourd’hui, les produits de maquillage et les soins de la peau sont disponibles dans de nombreuses parfumeries, notamment chez Sephora, mais également sur la boutique en ligne officielle. La marque fait partie du groupe Shiseido, auquel appartiennent également les enseignes Serge Lutens, Narciso Rodriguez, Elie Saab, Zadig et Voltaire. Vingt ans après, nous ne pouvons que témoigner du succès de l’entreprise, succès qui vient sans doute du fait que malgré le rachat en 2000 de la marque – par le groupe Shiseido – François Nars en est resté le directeur artistique et prend encore toutes les décisions. En 1999, il publie un livre de photographies « X-Ray » dans lequel il capture la beauté, le style et la personnalité de ses modèles. S’en suivra en 2001 « Makeup Your Mind (Maquillage Votre Esprit) », une leçon de maquillage donnée à travers des dizaines de photos des tops les plus connus, maquillés par ses soins. Puis plus récemment, le sublime livre « François Nars ». 2019, fut encore une année pleine de nouveauté pour la marque puisque François Nars a décidé de lancer son tout premier parfum, en plus des jolies collections à venir ! Le parfum Audacious, créé en partenariat avec la célèbre parfumeuse Olivia Gicobetti, signature de François Nars, qui présente des notes de tête de frangipanier blanc et de fumée d’encens, s’accordant à la fleur de tiare et au bois de santal. Pour célébrer cette success-story à l'américaine et saluer le travail acharné de ce citoyen d'exception, la France a donc décidé de lui décerner en 2016 sa plus haute distinction civile : la Légion d'honneur. Une récompense qu'il a reçue avec modestie et émotion au cours d'une cérémonie intime animée par Bénédicte de Montlaur, conseillère culturelle de l'Ambassade de France et Ariane Daguin, ancienne lauréate. "Je suis incroyablement humble et fier de recevoir ce prestigieux prix, c'est l'un des plus grands moments de ma carrière. La France est ma patrie et aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Je suis vraiment honoré", avait-il déclaré dans un court discours de remerciements.
 François NARS, est né en 1959 à Tarbes. Quand il était enfant, avec ses parents, il faisait énormément de balades et d’escalade dans les Pyrénées. Il aimait les lacs d'eau claire, le bruit des cascades. Biarritz, où il avait passé la plupart de ses vacances avec ses parents est aussi une grande source de souvenirs. Il a toujours gardé une nostalgie des embruns de l'océan et de l’air des Pyrénées. Dès son plus jeune âge, vers 12-13 ans, il développe une passion dévorante pour les magazines de mode et les mises en beauté qu’il y découvre mais également pour les grands couturiers, en particulier Yves Saint Laurent, à qui il voue une admiration considérable. Ce sont ses parents et grands-parents qui lui donnent ce goût pour l’art et en particulier sa mère Claudette, qui possédait sa propre collection de vêtements de créateurs et aussi ses deux grands-mères Léa et Ginette. Sa mère a été d’une aide précieuse dans sa carrière, notamment en l’introduisant dans le domaine du make-up et en l’aidant également à acquérir son premier emploi en tant qu'assistant de certains des meilleurs maquilleurs de Paris. L’influence de sa famille transparaît encore aujourd’hui à travers la passion de Nars pour l’architecture et les musées. Il est fasciné par les grands peintres des 18e, 19e et 20e siècles : de Picasso et les impressionnistes aux peintres modernes, parmi lesquels Rothko ou Mondrian. Après avoir obtenu son diplôme de l'école d’esthétique et de maquillage de l’Institut Carita à Paris, il s’engage dans une carrière plus que prolifique et riche de prestigieuses collaborations. Il travaille tout d’abord avec le photographe Paolo Roversi. Puis il part en 1984 poser ses valises à New York pour vivre pleinement sa passion pour le maquillage, sur les conseils de la célèbre styliste américaine Polly Mellen. Une ville, où il sera amené à travailler pour Harper’s Bazaar ainsi que pour le Vogue américain et italien. Ce sera le début d’une brillante carrière au fil de laquelle il travaille avec les top models les plus en vue de l’époque : Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell ou encore Kate Moss dans les années 1990. Parmi ses nombreuses collaborations – marques, photographes, célébrités – on retrouve les créateurs Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, Valentino…les photographes Patrick Demarchelier, Helmut Newton, Richard Avedon et tant de célébrités, dont Sharon Stone, Madonna, Isabella Rossellini, Anjelica Houston, Catherine Deneuve, Michelle Pfeiffer et dernièrement Bella Hadid. New York, où il vit toujours par intermittence, lui préférant la Polynésie française sur sa propre île privée “Motu Tane”, proche de Bora Bora, où il a vécu ces quinze dernières années. New York, fut un choix décisif pour sa carrière. Rapidement, il devient le maquilleur chouchou auprès de nombreux créateurs comme Marc Jacobs, et s’attire les faveurs de nombreuses stars comme Naomi Campbell, ou encore Linda Evangelista. Il a une approche très artistique du maquillage, le considérant comme un moyen de faire ressortir la personnalité de celle ou celui qui le porte. Il joue avec les couleurs pour accentuer le caractère et les traits du visage, créant ainsi des looks ultra modernes, tout en se tournant volontiers pour un travail du teint minimaliste. Et il s’est fait ainsi connaître pour son amour de la couleur et du style moderne. Au début des années 1990, il commence à s’interroger sur les limites du maquillage qu’il peut trouver dans le commerce en tant que maquilleur freelance. Son imagination va bien au-delà du maquillage proposé à l’époque, tant en termes de textures que de couleurs. En 1992, Il travaille pour la styliste Anna Sui et la chanteuse Madona pour le livre « Sex », qu’elle a écrit sous le pseudonyme de Dita. Au cours des deux années suivantes il continue à travailler pour Anna Sui, Versace et Marc Jacobs. C’est en 1994, que le maquilleur et photographe de talent décide de créer et de distribuer sa propre ligne de maquillage, et de fonder sa propre marque éponyme NARS Cosmetics, composée alors uniquement de douze rouges à lèvres, initialement vendus chez Barney’s à New York. Fasciné par la couleur et les textures, il choisit lui-même chaque teinte avec un soin méticuleux et se plie en quatre pour proposer des produits innovants à la qualité exceptionnelle. Cette entreprise française de cosmétiques et de soins de la peau, compte aujourd’hui de nombreux produits de référence pour les maquilleurs professionnels comme le célèbre « blush Orgasm », blush aux reflets scintillants, une référence dans le maquillage, au monde et l’un des produits phares les plus vendus de l’enseigne, et ayant reçu consécutivement par Sephora le prix de meilleur blush pour les années 2006, 2007 et 2008. Le maquilleur se distingue également par ses talents de photographe, domaine dans lequel il évolue depuis 1996, et qu’il a notamment mis en lumière dans différents livres dédiés. Il est devenu photographe pour créer l’identité visuelle des campagnes Nars Cosmetics. S’il n’avait pas été maquilleur, il serait assurément photographe. La photographie étant devenue rapidement une passion à part entière pour lui. Il a publié plusieurs ouvrages de photos, et depuis il shoote les clichés de ses publicités. Il fera des shootings pour les grands magazines, Vogue Paris, Vanity Fair, Harper Bazaar’s, Elle ou Marie Claire entre autres. Il a collaboré avec les plus grands photographes entre Paris et New York, de Richard Avedon à Helmut Newton en passant par Steven Meisel, Paolo Roversi, Irving Penn, Patrick Demarchelier, Bruce Weber, Sarah Moon, pour ne citer qu’eux. Depuis lors, NARS a créé divers produits de beauté à usages multiples et est maintenant une filiale de Shiseido. Bien que la société ait été vendue à Shiseido en 2000, Nars reste directeur artistique de l’enseigne, photographe interne et rédacteur publicitaire pour sa marque. A l’occasion d’une interview accordée au magazine Marie-Claire, il confiera : « Si j’étais resté dans la montagne, je ne serais pas ce que je suis. Plus que de la chance, pour réussir là où on le souhaite, il faut avoir du culot, se tracer une ligne de conduite et s’y tenir. Il faut aussi, j'en suis sûr, beaucoup de passion et, parfois, un peu de patience. La passion est très importante. Le jour où vous perdez la passion, il faut se retirer tout de suite, retourner dans les montagnes, et reprendre les randonnées... Heureusement, j’ai encore beaucoup de passion et de choses à dire, donc la rando ça n'est pas pour tout de suite ! ». En 2016, la marque sort la collection de rouges à lèvres semi-mats Velvet Lip Glide. Aujourd’hui, les produits de maquillage et les soins de la peau sont disponibles dans de nombreuses parfumeries, notamment chez Sephora, mais également sur la boutique en ligne officielle. La marque fait partie du groupe Shiseido, auquel appartiennent également les enseignes Serge Lutens, Narciso Rodriguez, Elie Saab, Zadig et Voltaire. Vingt ans après, nous ne pouvons que témoigner du succès de l’entreprise, succès qui vient sans doute du fait que malgré le rachat en 2000 de la marque – par le groupe Shiseido – François Nars en est resté le directeur artistique et prend encore toutes les décisions. En 1999, il publie un livre de photographies « X-Ray » dans lequel il capture la beauté, le style et la personnalité de ses modèles. S’en suivra en 2001 « Makeup Your Mind (Maquillage Votre Esprit) », une leçon de maquillage donnée à travers des dizaines de photos des tops les plus connus, maquillés par ses soins. Puis plus récemment, le sublime livre « François Nars ». 2019, fut encore une année pleine de nouveauté pour la marque puisque François Nars a décidé de lancer son tout premier parfum, en plus des jolies collections à venir ! Le parfum Audacious, créé en partenariat avec la célèbre parfumeuse Olivia Gicobetti, signature de François Nars, qui présente des notes de tête de frangipanier blanc et de fumée d’encens, s’accordant à la fleur de tiare et au bois de santal. Pour célébrer cette success-story à l'américaine et saluer le travail acharné de ce citoyen d'exception, la France a donc décidé de lui décerner en 2016 sa plus haute distinction civile : la Légion d'honneur. Une récompense qu'il a reçue avec modestie et émotion au cours d'une cérémonie intime animée par Bénédicte de Montlaur, conseillère culturelle de l'Ambassade de France et Ariane Daguin, ancienne lauréate. "Je suis incroyablement humble et fier de recevoir ce prestigieux prix, c'est l'un des plus grands moments de ma carrière. La France est ma patrie et aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Je suis vraiment honoré", avait-il déclaré dans un court discours de remerciements.
François NARS, est né en 1959 à Tarbes. Quand il était enfant, avec ses parents, il faisait énormément de balades et d’escalade dans les Pyrénées. Il aimait les lacs d'eau claire, le bruit des cascades. Biarritz, où il avait passé la plupart de ses vacances avec ses parents est aussi une grande source de souvenirs. Il a toujours gardé une nostalgie des embruns de l'océan et de l’air des Pyrénées. Dès son plus jeune âge, vers 12-13 ans, il développe une passion dévorante pour les magazines de mode et les mises en beauté qu’il y découvre mais également pour les grands couturiers, en particulier Yves Saint Laurent, à qui il voue une admiration considérable. Ce sont ses parents et grands-parents qui lui donnent ce goût pour l’art et en particulier sa mère Claudette, qui possédait sa propre collection de vêtements de créateurs et aussi ses deux grands-mères Léa et Ginette. Sa mère a été d’une aide précieuse dans sa carrière, notamment en l’introduisant dans le domaine du make-up et en l’aidant également à acquérir son premier emploi en tant qu'assistant de certains des meilleurs maquilleurs de Paris. L’influence de sa famille transparaît encore aujourd’hui à travers la passion de Nars pour l’architecture et les musées. Il est fasciné par les grands peintres des 18e, 19e et 20e siècles : de Picasso et les impressionnistes aux peintres modernes, parmi lesquels Rothko ou Mondrian. Après avoir obtenu son diplôme de l'école d’esthétique et de maquillage de l’Institut Carita à Paris, il s’engage dans une carrière plus que prolifique et riche de prestigieuses collaborations. Il travaille tout d’abord avec le photographe Paolo Roversi. Puis il part en 1984 poser ses valises à New York pour vivre pleinement sa passion pour le maquillage, sur les conseils de la célèbre styliste américaine Polly Mellen. Une ville, où il sera amené à travailler pour Harper’s Bazaar ainsi que pour le Vogue américain et italien. Ce sera le début d’une brillante carrière au fil de laquelle il travaille avec les top models les plus en vue de l’époque : Linda Evangelista, Cindy Crawford, Naomi Campbell ou encore Kate Moss dans les années 1990. Parmi ses nombreuses collaborations – marques, photographes, célébrités – on retrouve les créateurs Dolce & Gabbana, Marc Jacobs, Valentino…les photographes Patrick Demarchelier, Helmut Newton, Richard Avedon et tant de célébrités, dont Sharon Stone, Madonna, Isabella Rossellini, Anjelica Houston, Catherine Deneuve, Michelle Pfeiffer et dernièrement Bella Hadid. New York, où il vit toujours par intermittence, lui préférant la Polynésie française sur sa propre île privée “Motu Tane”, proche de Bora Bora, où il a vécu ces quinze dernières années. New York, fut un choix décisif pour sa carrière. Rapidement, il devient le maquilleur chouchou auprès de nombreux créateurs comme Marc Jacobs, et s’attire les faveurs de nombreuses stars comme Naomi Campbell, ou encore Linda Evangelista. Il a une approche très artistique du maquillage, le considérant comme un moyen de faire ressortir la personnalité de celle ou celui qui le porte. Il joue avec les couleurs pour accentuer le caractère et les traits du visage, créant ainsi des looks ultra modernes, tout en se tournant volontiers pour un travail du teint minimaliste. Et il s’est fait ainsi connaître pour son amour de la couleur et du style moderne. Au début des années 1990, il commence à s’interroger sur les limites du maquillage qu’il peut trouver dans le commerce en tant que maquilleur freelance. Son imagination va bien au-delà du maquillage proposé à l’époque, tant en termes de textures que de couleurs. En 1992, Il travaille pour la styliste Anna Sui et la chanteuse Madona pour le livre « Sex », qu’elle a écrit sous le pseudonyme de Dita. Au cours des deux années suivantes il continue à travailler pour Anna Sui, Versace et Marc Jacobs. C’est en 1994, que le maquilleur et photographe de talent décide de créer et de distribuer sa propre ligne de maquillage, et de fonder sa propre marque éponyme NARS Cosmetics, composée alors uniquement de douze rouges à lèvres, initialement vendus chez Barney’s à New York. Fasciné par la couleur et les textures, il choisit lui-même chaque teinte avec un soin méticuleux et se plie en quatre pour proposer des produits innovants à la qualité exceptionnelle. Cette entreprise française de cosmétiques et de soins de la peau, compte aujourd’hui de nombreux produits de référence pour les maquilleurs professionnels comme le célèbre « blush Orgasm », blush aux reflets scintillants, une référence dans le maquillage, au monde et l’un des produits phares les plus vendus de l’enseigne, et ayant reçu consécutivement par Sephora le prix de meilleur blush pour les années 2006, 2007 et 2008. Le maquilleur se distingue également par ses talents de photographe, domaine dans lequel il évolue depuis 1996, et qu’il a notamment mis en lumière dans différents livres dédiés. Il est devenu photographe pour créer l’identité visuelle des campagnes Nars Cosmetics. S’il n’avait pas été maquilleur, il serait assurément photographe. La photographie étant devenue rapidement une passion à part entière pour lui. Il a publié plusieurs ouvrages de photos, et depuis il shoote les clichés de ses publicités. Il fera des shootings pour les grands magazines, Vogue Paris, Vanity Fair, Harper Bazaar’s, Elle ou Marie Claire entre autres. Il a collaboré avec les plus grands photographes entre Paris et New York, de Richard Avedon à Helmut Newton en passant par Steven Meisel, Paolo Roversi, Irving Penn, Patrick Demarchelier, Bruce Weber, Sarah Moon, pour ne citer qu’eux. Depuis lors, NARS a créé divers produits de beauté à usages multiples et est maintenant une filiale de Shiseido. Bien que la société ait été vendue à Shiseido en 2000, Nars reste directeur artistique de l’enseigne, photographe interne et rédacteur publicitaire pour sa marque. A l’occasion d’une interview accordée au magazine Marie-Claire, il confiera : « Si j’étais resté dans la montagne, je ne serais pas ce que je suis. Plus que de la chance, pour réussir là où on le souhaite, il faut avoir du culot, se tracer une ligne de conduite et s’y tenir. Il faut aussi, j'en suis sûr, beaucoup de passion et, parfois, un peu de patience. La passion est très importante. Le jour où vous perdez la passion, il faut se retirer tout de suite, retourner dans les montagnes, et reprendre les randonnées... Heureusement, j’ai encore beaucoup de passion et de choses à dire, donc la rando ça n'est pas pour tout de suite ! ». En 2016, la marque sort la collection de rouges à lèvres semi-mats Velvet Lip Glide. Aujourd’hui, les produits de maquillage et les soins de la peau sont disponibles dans de nombreuses parfumeries, notamment chez Sephora, mais également sur la boutique en ligne officielle. La marque fait partie du groupe Shiseido, auquel appartiennent également les enseignes Serge Lutens, Narciso Rodriguez, Elie Saab, Zadig et Voltaire. Vingt ans après, nous ne pouvons que témoigner du succès de l’entreprise, succès qui vient sans doute du fait que malgré le rachat en 2000 de la marque – par le groupe Shiseido – François Nars en est resté le directeur artistique et prend encore toutes les décisions. En 1999, il publie un livre de photographies « X-Ray » dans lequel il capture la beauté, le style et la personnalité de ses modèles. S’en suivra en 2001 « Makeup Your Mind (Maquillage Votre Esprit) », une leçon de maquillage donnée à travers des dizaines de photos des tops les plus connus, maquillés par ses soins. Puis plus récemment, le sublime livre « François Nars ». 2019, fut encore une année pleine de nouveauté pour la marque puisque François Nars a décidé de lancer son tout premier parfum, en plus des jolies collections à venir ! Le parfum Audacious, créé en partenariat avec la célèbre parfumeuse Olivia Gicobetti, signature de François Nars, qui présente des notes de tête de frangipanier blanc et de fumée d’encens, s’accordant à la fleur de tiare et au bois de santal. Pour célébrer cette success-story à l'américaine et saluer le travail acharné de ce citoyen d'exception, la France a donc décidé de lui décerner en 2016 sa plus haute distinction civile : la Légion d'honneur. Une récompense qu'il a reçue avec modestie et émotion au cours d'une cérémonie intime animée par Bénédicte de Montlaur, conseillère culturelle de l'Ambassade de France et Ariane Daguin, ancienne lauréate. "Je suis incroyablement humble et fier de recevoir ce prestigieux prix, c'est l'un des plus grands moments de ma carrière. La France est ma patrie et aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Je suis vraiment honoré", avait-il déclaré dans un court discours de remerciements.NEVEU Boris (1986-XXXX)
Kayakiste champion du monde en slalom K1 par équipes et en individuel
 Boris NEVEU, né le 12 avril 1986 à Lourdes, est un kayakiste multi-champion de canoë-kayak dans la spécialité slalom K1. Il mesure 1m85 pour 78 kg. Lors des championnats du monde 2021 en Slovaquie il remporte la médaille d’or sur l’épreuve par équipes et s’impose sur la course individuelle. À 35 ans, il devient pour la deuxième fois de sa carrière, champion du monde de slalom individuel. Après son titre et sa médaille d’or à Deep Creek aux États-Unis, en 2014, c’est sur le bassin de Bratislava qu’il double la mise. Il devance de 4s avec un chrono canon de 83''92 l’Italien Marcello Beda (87''75) et l’Espagnol Joan Crespo (87''90) à l’issue de la descente. Boris débute le kayak vers l'âge de cinq ans, où il commence à donner ses premiers coups de pagaie en vacances, sur des rivières très calmes. Car comme beaucoup de kayakistes, ses parents pratiquaient eux-mêmes en loisirs. Il se pique au jeu mais découvre également d’autres disciplines. Il s’essaie notamment un peu au football avant de revenir vers les bassins à l’adolescence. Sa véritable passion pour la compétition s’est révélée vers l'âge de 15 ans, en suivant les exploits de médailles du duo Adisson/Forgues en canoë biplace, licenciés dans le même club (ALCK Bagnères-de-Bigorre). Rapidement, il s’est retrouvé parmi les meilleurs jeunes. C’est finalement dans les épreuves de slalom K1, une pratique individuelle, qu’il atteint le meilleur niveau. Et ses résultats dans les catégories de jeunes montrent une progression régulière, sans être fulgurante : médaillé de bronze aux championnats de France cadets (15-16 ans) en kayak monoplace slalom K1 en 2002 à Foix, puis vice-champion de France juniors (17-18 ans) en 2004 à l'Argentière-la-Bessée, il est alors en concurrence avec d'autres futurs médaillés internationaux comme Samuel Hernanz (futur international espagnol et grand ami de Boris), Sébastien Combot et Pierre Bourliaud. Il accède à la Nationale 1 masculine, le plus haut échelon français, lors de sa deuxième année chez les juniors, en 2004, et profite de cette année pour gagner sa première médaille internationale en étant champion du monde junior par équipe (associé notamment à Samuel Hernanz). Il intègre rapidement le Pôle France de Pau. Dès lors, son ascension vers les sommets de la hiérarchie va devenir de plus en plus nette : vainqueur d'une course de N1 pour la première fois en 2005 à Épinal, il participe à ses premières courses internationales chez les seniors en 2005 (il finira sur le podium à Augsbourg), puis accède à l’Équipe de France A en 2006, où il remporte la médaille d'or aux Championnats du monde de slalom 2006 à Prague en K1 par équipe (avec Fabien Lefèvre et Julien Billaut). Il devient Champion de France senior pour la première fois en 2007. Les années suivantes sont celles de la consolidation : il forme à Pau, au stade d’eaux vives Pau Béarn Pyrénées, avec Tony Estanguet et Emilie Fer un petit groupe axé sur la recherche d'or aux Jeux Olympiques de Londres. À cette époque, Sylvain Curinier devient son entraîneur attitré. Les résultats ne tardent pas à arriver, et 2009 est une année faste : médaillé d'argent lors des Championnats du monde de slalom 2009 à La Seu d'Urgell en K1, il est également cette même année vice-champion d'Europe à Nottingham en individuel (3e par équipe), tout en collectant deux autres médailles aux championnats du monde organisés pour les moins de 23 ans : l'or par équipe et l'argent en individuel. Il devient par la suite un pilier de l’Équipe de France, médaillé d'argent en K1 par équipes aux Mondiaux de 2010 et de 2011, sans toutefois passer à l'échelon supérieur en individuel, où il ne parvient pas à se hisser sur la plus haute marche du podium. 2012 marque pour lui l'année de la rupture : en cette année olympique, une seule personne représentera la France aux JO de Londres. Les sélections, qui se déroulent à Pau, sont extrêmement relevées, avec notamment Fabien Lefèvre et Benoît Peschier qui font valoir leur expérience mais c'est Boris qui semble en sortir vainqueur au soir de la dernière course de sélection. 30 minutes après le dernier passage de concurrents, alors qu'on commence à le féliciter pour son "billet" pour Londres, on apprend que c'est finalement Étienne Daille qui est le vainqueur. Le coup est rude pour Boris, qui mettra du temps à digérer cet épilogue même si le fait que ses partenaires d'entraînement Tony Estanguet et Emilie Fer décrochent l'or olympique, lui montrera que la voie suivie est la bonne. La reconstruction commence par une médaille de bronze en K1 par équipes aux Championnats du monde de slalom 2013 à Prague avec Étienne Daille et Mathieu Biazizzo, mais les résultats individuels sont encore un peu décevants à son goût. Galasport, son fournisseur historique de kayaks, lui accorde cependant une confiance accrue en lui permettant de dessiner ses propres embarcations. Le 20 septembre 2014, à Deep Creek aux États-Unis, Boris Neveu remporte son premier titre mondial individuel en kayak monoplace (K1). Il mène à cette occasion un triplé inédit des pagayeurs français, puisque Sébastien Combot et Mathieu Biazizzo terminent médaillés d'argent et de bronze, avant de remporter tous les trois conjointement le titre en course par équipe. Dès lors, Boris devient la référence sur le circuit international, qu'il domine assez nettement, remportant notamment les Championnats d'Europe de slalom 2015 à Markkleeberg, même si cette domination est brutalement stoppée par une décevante 11e place aux Championnats du Monde 2015 de Londres. Sa saison 2016 est marquée par une nouvelle désillusion olympique : alors qu'il est largement favori des courses de sélection, il est dominé sur l'ultime course pour 6 centièmes de secondes par Sébastien Combot, échouant ainsi à gagner un ticket olympique qui sera attribué à son rival lannionais. Lors de l'olympiade 2016-2020, il est un peu plus en retrait au niveau international. Malgré quelques performances de premier ordre, telles qu'aux Championnats d'Europe de slalom 2017 à Tacen en Slovénie, où il remporte la médaille d'argent en K1 slalom par équipes, il redescend un peu dans la hiérarchie mondiale en slalom. Il profite cependant de cette occasion pour participer à quelques compétitions de slalom extrême, remportant notamment deux titres de vice-champion du monde dans cette discipline. Il remporte avec Mathurin Madoré et Quentin Burgi la médaille d'or en kayak par équipes aux Championnats d'Europe de slalom 2020 à Prague. Le 25 septembre 2021, le Bigourdan Boris Neveu (club ALCK Bagnères-de-Bigorre) est devenu champion du Monde en kayak monoplace en devançant largement les autres concurrents (avec un chrono de 83’92) et par équipes aux Championnats du monde de slalom 2021 à Bratislava. Il décroche ainsi son deuxième titre mondial, sept ans après celui des Mondiaux de 2014 remporté aux Etats-Unis et aussi arrivé second en 2019. Un sacre mondial qui vient clore une saison forte émotionnellement, notamment après sa déception moins de deux mois avant lors des Jeux Olympiques de Tokyo (7e à Tokyo). Le kayakiste avait été sacré champion du monde en 2014 puis champion d’Europe en 2015. En kayak extrême il s'était illustré, deux fois vice-champion du monde de cette future discipline olympique. À 35 ans, Boris affiche un des plus beaux palmarès du kayak mondial. Une réussite qui lui permet de parcourir le monde, de bassin en bassin. Mais une aventure qui ne l’empêche pas de conserver un attachement sans borne pour la terre de son enfance. Né à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, il vit aujourd’hui à Bizanos près de Pau avec sa famille, mais est resté fidèle au club de sa première licence : l’Amicale laïque de canoë-kayak de Bagnères-de-Bigorre. Professionnellement, il évolue en tant que professeur de sport rattaché à l’INSEP depuis 2011, ce qui lui permet de concilier vie sportive et professionnelle.
Boris NEVEU, né le 12 avril 1986 à Lourdes, est un kayakiste multi-champion de canoë-kayak dans la spécialité slalom K1. Il mesure 1m85 pour 78 kg. Lors des championnats du monde 2021 en Slovaquie il remporte la médaille d’or sur l’épreuve par équipes et s’impose sur la course individuelle. À 35 ans, il devient pour la deuxième fois de sa carrière, champion du monde de slalom individuel. Après son titre et sa médaille d’or à Deep Creek aux États-Unis, en 2014, c’est sur le bassin de Bratislava qu’il double la mise. Il devance de 4s avec un chrono canon de 83''92 l’Italien Marcello Beda (87''75) et l’Espagnol Joan Crespo (87''90) à l’issue de la descente. Boris débute le kayak vers l'âge de cinq ans, où il commence à donner ses premiers coups de pagaie en vacances, sur des rivières très calmes. Car comme beaucoup de kayakistes, ses parents pratiquaient eux-mêmes en loisirs. Il se pique au jeu mais découvre également d’autres disciplines. Il s’essaie notamment un peu au football avant de revenir vers les bassins à l’adolescence. Sa véritable passion pour la compétition s’est révélée vers l'âge de 15 ans, en suivant les exploits de médailles du duo Adisson/Forgues en canoë biplace, licenciés dans le même club (ALCK Bagnères-de-Bigorre). Rapidement, il s’est retrouvé parmi les meilleurs jeunes. C’est finalement dans les épreuves de slalom K1, une pratique individuelle, qu’il atteint le meilleur niveau. Et ses résultats dans les catégories de jeunes montrent une progression régulière, sans être fulgurante : médaillé de bronze aux championnats de France cadets (15-16 ans) en kayak monoplace slalom K1 en 2002 à Foix, puis vice-champion de France juniors (17-18 ans) en 2004 à l'Argentière-la-Bessée, il est alors en concurrence avec d'autres futurs médaillés internationaux comme Samuel Hernanz (futur international espagnol et grand ami de Boris), Sébastien Combot et Pierre Bourliaud. Il accède à la Nationale 1 masculine, le plus haut échelon français, lors de sa deuxième année chez les juniors, en 2004, et profite de cette année pour gagner sa première médaille internationale en étant champion du monde junior par équipe (associé notamment à Samuel Hernanz). Il intègre rapidement le Pôle France de Pau. Dès lors, son ascension vers les sommets de la hiérarchie va devenir de plus en plus nette : vainqueur d'une course de N1 pour la première fois en 2005 à Épinal, il participe à ses premières courses internationales chez les seniors en 2005 (il finira sur le podium à Augsbourg), puis accède à l’Équipe de France A en 2006, où il remporte la médaille d'or aux Championnats du monde de slalom 2006 à Prague en K1 par équipe (avec Fabien Lefèvre et Julien Billaut). Il devient Champion de France senior pour la première fois en 2007. Les années suivantes sont celles de la consolidation : il forme à Pau, au stade d’eaux vives Pau Béarn Pyrénées, avec Tony Estanguet et Emilie Fer un petit groupe axé sur la recherche d'or aux Jeux Olympiques de Londres. À cette époque, Sylvain Curinier devient son entraîneur attitré. Les résultats ne tardent pas à arriver, et 2009 est une année faste : médaillé d'argent lors des Championnats du monde de slalom 2009 à La Seu d'Urgell en K1, il est également cette même année vice-champion d'Europe à Nottingham en individuel (3e par équipe), tout en collectant deux autres médailles aux championnats du monde organisés pour les moins de 23 ans : l'or par équipe et l'argent en individuel. Il devient par la suite un pilier de l’Équipe de France, médaillé d'argent en K1 par équipes aux Mondiaux de 2010 et de 2011, sans toutefois passer à l'échelon supérieur en individuel, où il ne parvient pas à se hisser sur la plus haute marche du podium. 2012 marque pour lui l'année de la rupture : en cette année olympique, une seule personne représentera la France aux JO de Londres. Les sélections, qui se déroulent à Pau, sont extrêmement relevées, avec notamment Fabien Lefèvre et Benoît Peschier qui font valoir leur expérience mais c'est Boris qui semble en sortir vainqueur au soir de la dernière course de sélection. 30 minutes après le dernier passage de concurrents, alors qu'on commence à le féliciter pour son "billet" pour Londres, on apprend que c'est finalement Étienne Daille qui est le vainqueur. Le coup est rude pour Boris, qui mettra du temps à digérer cet épilogue même si le fait que ses partenaires d'entraînement Tony Estanguet et Emilie Fer décrochent l'or olympique, lui montrera que la voie suivie est la bonne. La reconstruction commence par une médaille de bronze en K1 par équipes aux Championnats du monde de slalom 2013 à Prague avec Étienne Daille et Mathieu Biazizzo, mais les résultats individuels sont encore un peu décevants à son goût. Galasport, son fournisseur historique de kayaks, lui accorde cependant une confiance accrue en lui permettant de dessiner ses propres embarcations. Le 20 septembre 2014, à Deep Creek aux États-Unis, Boris Neveu remporte son premier titre mondial individuel en kayak monoplace (K1). Il mène à cette occasion un triplé inédit des pagayeurs français, puisque Sébastien Combot et Mathieu Biazizzo terminent médaillés d'argent et de bronze, avant de remporter tous les trois conjointement le titre en course par équipe. Dès lors, Boris devient la référence sur le circuit international, qu'il domine assez nettement, remportant notamment les Championnats d'Europe de slalom 2015 à Markkleeberg, même si cette domination est brutalement stoppée par une décevante 11e place aux Championnats du Monde 2015 de Londres. Sa saison 2016 est marquée par une nouvelle désillusion olympique : alors qu'il est largement favori des courses de sélection, il est dominé sur l'ultime course pour 6 centièmes de secondes par Sébastien Combot, échouant ainsi à gagner un ticket olympique qui sera attribué à son rival lannionais. Lors de l'olympiade 2016-2020, il est un peu plus en retrait au niveau international. Malgré quelques performances de premier ordre, telles qu'aux Championnats d'Europe de slalom 2017 à Tacen en Slovénie, où il remporte la médaille d'argent en K1 slalom par équipes, il redescend un peu dans la hiérarchie mondiale en slalom. Il profite cependant de cette occasion pour participer à quelques compétitions de slalom extrême, remportant notamment deux titres de vice-champion du monde dans cette discipline. Il remporte avec Mathurin Madoré et Quentin Burgi la médaille d'or en kayak par équipes aux Championnats d'Europe de slalom 2020 à Prague. Le 25 septembre 2021, le Bigourdan Boris Neveu (club ALCK Bagnères-de-Bigorre) est devenu champion du Monde en kayak monoplace en devançant largement les autres concurrents (avec un chrono de 83’92) et par équipes aux Championnats du monde de slalom 2021 à Bratislava. Il décroche ainsi son deuxième titre mondial, sept ans après celui des Mondiaux de 2014 remporté aux Etats-Unis et aussi arrivé second en 2019. Un sacre mondial qui vient clore une saison forte émotionnellement, notamment après sa déception moins de deux mois avant lors des Jeux Olympiques de Tokyo (7e à Tokyo). Le kayakiste avait été sacré champion du monde en 2014 puis champion d’Europe en 2015. En kayak extrême il s'était illustré, deux fois vice-champion du monde de cette future discipline olympique. À 35 ans, Boris affiche un des plus beaux palmarès du kayak mondial. Une réussite qui lui permet de parcourir le monde, de bassin en bassin. Mais une aventure qui ne l’empêche pas de conserver un attachement sans borne pour la terre de son enfance. Né à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, il vit aujourd’hui à Bizanos près de Pau avec sa famille, mais est resté fidèle au club de sa première licence : l’Amicale laïque de canoë-kayak de Bagnères-de-Bigorre. Professionnellement, il évolue en tant que professeur de sport rattaché à l’INSEP depuis 2011, ce qui lui permet de concilier vie sportive et professionnelle.
 Boris NEVEU, né le 12 avril 1986 à Lourdes, est un kayakiste multi-champion de canoë-kayak dans la spécialité slalom K1. Il mesure 1m85 pour 78 kg. Lors des championnats du monde 2021 en Slovaquie il remporte la médaille d’or sur l’épreuve par équipes et s’impose sur la course individuelle. À 35 ans, il devient pour la deuxième fois de sa carrière, champion du monde de slalom individuel. Après son titre et sa médaille d’or à Deep Creek aux États-Unis, en 2014, c’est sur le bassin de Bratislava qu’il double la mise. Il devance de 4s avec un chrono canon de 83''92 l’Italien Marcello Beda (87''75) et l’Espagnol Joan Crespo (87''90) à l’issue de la descente. Boris débute le kayak vers l'âge de cinq ans, où il commence à donner ses premiers coups de pagaie en vacances, sur des rivières très calmes. Car comme beaucoup de kayakistes, ses parents pratiquaient eux-mêmes en loisirs. Il se pique au jeu mais découvre également d’autres disciplines. Il s’essaie notamment un peu au football avant de revenir vers les bassins à l’adolescence. Sa véritable passion pour la compétition s’est révélée vers l'âge de 15 ans, en suivant les exploits de médailles du duo Adisson/Forgues en canoë biplace, licenciés dans le même club (ALCK Bagnères-de-Bigorre). Rapidement, il s’est retrouvé parmi les meilleurs jeunes. C’est finalement dans les épreuves de slalom K1, une pratique individuelle, qu’il atteint le meilleur niveau. Et ses résultats dans les catégories de jeunes montrent une progression régulière, sans être fulgurante : médaillé de bronze aux championnats de France cadets (15-16 ans) en kayak monoplace slalom K1 en 2002 à Foix, puis vice-champion de France juniors (17-18 ans) en 2004 à l'Argentière-la-Bessée, il est alors en concurrence avec d'autres futurs médaillés internationaux comme Samuel Hernanz (futur international espagnol et grand ami de Boris), Sébastien Combot et Pierre Bourliaud. Il accède à la Nationale 1 masculine, le plus haut échelon français, lors de sa deuxième année chez les juniors, en 2004, et profite de cette année pour gagner sa première médaille internationale en étant champion du monde junior par équipe (associé notamment à Samuel Hernanz). Il intègre rapidement le Pôle France de Pau. Dès lors, son ascension vers les sommets de la hiérarchie va devenir de plus en plus nette : vainqueur d'une course de N1 pour la première fois en 2005 à Épinal, il participe à ses premières courses internationales chez les seniors en 2005 (il finira sur le podium à Augsbourg), puis accède à l’Équipe de France A en 2006, où il remporte la médaille d'or aux Championnats du monde de slalom 2006 à Prague en K1 par équipe (avec Fabien Lefèvre et Julien Billaut). Il devient Champion de France senior pour la première fois en 2007. Les années suivantes sont celles de la consolidation : il forme à Pau, au stade d’eaux vives Pau Béarn Pyrénées, avec Tony Estanguet et Emilie Fer un petit groupe axé sur la recherche d'or aux Jeux Olympiques de Londres. À cette époque, Sylvain Curinier devient son entraîneur attitré. Les résultats ne tardent pas à arriver, et 2009 est une année faste : médaillé d'argent lors des Championnats du monde de slalom 2009 à La Seu d'Urgell en K1, il est également cette même année vice-champion d'Europe à Nottingham en individuel (3e par équipe), tout en collectant deux autres médailles aux championnats du monde organisés pour les moins de 23 ans : l'or par équipe et l'argent en individuel. Il devient par la suite un pilier de l’Équipe de France, médaillé d'argent en K1 par équipes aux Mondiaux de 2010 et de 2011, sans toutefois passer à l'échelon supérieur en individuel, où il ne parvient pas à se hisser sur la plus haute marche du podium. 2012 marque pour lui l'année de la rupture : en cette année olympique, une seule personne représentera la France aux JO de Londres. Les sélections, qui se déroulent à Pau, sont extrêmement relevées, avec notamment Fabien Lefèvre et Benoît Peschier qui font valoir leur expérience mais c'est Boris qui semble en sortir vainqueur au soir de la dernière course de sélection. 30 minutes après le dernier passage de concurrents, alors qu'on commence à le féliciter pour son "billet" pour Londres, on apprend que c'est finalement Étienne Daille qui est le vainqueur. Le coup est rude pour Boris, qui mettra du temps à digérer cet épilogue même si le fait que ses partenaires d'entraînement Tony Estanguet et Emilie Fer décrochent l'or olympique, lui montrera que la voie suivie est la bonne. La reconstruction commence par une médaille de bronze en K1 par équipes aux Championnats du monde de slalom 2013 à Prague avec Étienne Daille et Mathieu Biazizzo, mais les résultats individuels sont encore un peu décevants à son goût. Galasport, son fournisseur historique de kayaks, lui accorde cependant une confiance accrue en lui permettant de dessiner ses propres embarcations. Le 20 septembre 2014, à Deep Creek aux États-Unis, Boris Neveu remporte son premier titre mondial individuel en kayak monoplace (K1). Il mène à cette occasion un triplé inédit des pagayeurs français, puisque Sébastien Combot et Mathieu Biazizzo terminent médaillés d'argent et de bronze, avant de remporter tous les trois conjointement le titre en course par équipe. Dès lors, Boris devient la référence sur le circuit international, qu'il domine assez nettement, remportant notamment les Championnats d'Europe de slalom 2015 à Markkleeberg, même si cette domination est brutalement stoppée par une décevante 11e place aux Championnats du Monde 2015 de Londres. Sa saison 2016 est marquée par une nouvelle désillusion olympique : alors qu'il est largement favori des courses de sélection, il est dominé sur l'ultime course pour 6 centièmes de secondes par Sébastien Combot, échouant ainsi à gagner un ticket olympique qui sera attribué à son rival lannionais. Lors de l'olympiade 2016-2020, il est un peu plus en retrait au niveau international. Malgré quelques performances de premier ordre, telles qu'aux Championnats d'Europe de slalom 2017 à Tacen en Slovénie, où il remporte la médaille d'argent en K1 slalom par équipes, il redescend un peu dans la hiérarchie mondiale en slalom. Il profite cependant de cette occasion pour participer à quelques compétitions de slalom extrême, remportant notamment deux titres de vice-champion du monde dans cette discipline. Il remporte avec Mathurin Madoré et Quentin Burgi la médaille d'or en kayak par équipes aux Championnats d'Europe de slalom 2020 à Prague. Le 25 septembre 2021, le Bigourdan Boris Neveu (club ALCK Bagnères-de-Bigorre) est devenu champion du Monde en kayak monoplace en devançant largement les autres concurrents (avec un chrono de 83’92) et par équipes aux Championnats du monde de slalom 2021 à Bratislava. Il décroche ainsi son deuxième titre mondial, sept ans après celui des Mondiaux de 2014 remporté aux Etats-Unis et aussi arrivé second en 2019. Un sacre mondial qui vient clore une saison forte émotionnellement, notamment après sa déception moins de deux mois avant lors des Jeux Olympiques de Tokyo (7e à Tokyo). Le kayakiste avait été sacré champion du monde en 2014 puis champion d’Europe en 2015. En kayak extrême il s'était illustré, deux fois vice-champion du monde de cette future discipline olympique. À 35 ans, Boris affiche un des plus beaux palmarès du kayak mondial. Une réussite qui lui permet de parcourir le monde, de bassin en bassin. Mais une aventure qui ne l’empêche pas de conserver un attachement sans borne pour la terre de son enfance. Né à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, il vit aujourd’hui à Bizanos près de Pau avec sa famille, mais est resté fidèle au club de sa première licence : l’Amicale laïque de canoë-kayak de Bagnères-de-Bigorre. Professionnellement, il évolue en tant que professeur de sport rattaché à l’INSEP depuis 2011, ce qui lui permet de concilier vie sportive et professionnelle.
Boris NEVEU, né le 12 avril 1986 à Lourdes, est un kayakiste multi-champion de canoë-kayak dans la spécialité slalom K1. Il mesure 1m85 pour 78 kg. Lors des championnats du monde 2021 en Slovaquie il remporte la médaille d’or sur l’épreuve par équipes et s’impose sur la course individuelle. À 35 ans, il devient pour la deuxième fois de sa carrière, champion du monde de slalom individuel. Après son titre et sa médaille d’or à Deep Creek aux États-Unis, en 2014, c’est sur le bassin de Bratislava qu’il double la mise. Il devance de 4s avec un chrono canon de 83''92 l’Italien Marcello Beda (87''75) et l’Espagnol Joan Crespo (87''90) à l’issue de la descente. Boris débute le kayak vers l'âge de cinq ans, où il commence à donner ses premiers coups de pagaie en vacances, sur des rivières très calmes. Car comme beaucoup de kayakistes, ses parents pratiquaient eux-mêmes en loisirs. Il se pique au jeu mais découvre également d’autres disciplines. Il s’essaie notamment un peu au football avant de revenir vers les bassins à l’adolescence. Sa véritable passion pour la compétition s’est révélée vers l'âge de 15 ans, en suivant les exploits de médailles du duo Adisson/Forgues en canoë biplace, licenciés dans le même club (ALCK Bagnères-de-Bigorre). Rapidement, il s’est retrouvé parmi les meilleurs jeunes. C’est finalement dans les épreuves de slalom K1, une pratique individuelle, qu’il atteint le meilleur niveau. Et ses résultats dans les catégories de jeunes montrent une progression régulière, sans être fulgurante : médaillé de bronze aux championnats de France cadets (15-16 ans) en kayak monoplace slalom K1 en 2002 à Foix, puis vice-champion de France juniors (17-18 ans) en 2004 à l'Argentière-la-Bessée, il est alors en concurrence avec d'autres futurs médaillés internationaux comme Samuel Hernanz (futur international espagnol et grand ami de Boris), Sébastien Combot et Pierre Bourliaud. Il accède à la Nationale 1 masculine, le plus haut échelon français, lors de sa deuxième année chez les juniors, en 2004, et profite de cette année pour gagner sa première médaille internationale en étant champion du monde junior par équipe (associé notamment à Samuel Hernanz). Il intègre rapidement le Pôle France de Pau. Dès lors, son ascension vers les sommets de la hiérarchie va devenir de plus en plus nette : vainqueur d'une course de N1 pour la première fois en 2005 à Épinal, il participe à ses premières courses internationales chez les seniors en 2005 (il finira sur le podium à Augsbourg), puis accède à l’Équipe de France A en 2006, où il remporte la médaille d'or aux Championnats du monde de slalom 2006 à Prague en K1 par équipe (avec Fabien Lefèvre et Julien Billaut). Il devient Champion de France senior pour la première fois en 2007. Les années suivantes sont celles de la consolidation : il forme à Pau, au stade d’eaux vives Pau Béarn Pyrénées, avec Tony Estanguet et Emilie Fer un petit groupe axé sur la recherche d'or aux Jeux Olympiques de Londres. À cette époque, Sylvain Curinier devient son entraîneur attitré. Les résultats ne tardent pas à arriver, et 2009 est une année faste : médaillé d'argent lors des Championnats du monde de slalom 2009 à La Seu d'Urgell en K1, il est également cette même année vice-champion d'Europe à Nottingham en individuel (3e par équipe), tout en collectant deux autres médailles aux championnats du monde organisés pour les moins de 23 ans : l'or par équipe et l'argent en individuel. Il devient par la suite un pilier de l’Équipe de France, médaillé d'argent en K1 par équipes aux Mondiaux de 2010 et de 2011, sans toutefois passer à l'échelon supérieur en individuel, où il ne parvient pas à se hisser sur la plus haute marche du podium. 2012 marque pour lui l'année de la rupture : en cette année olympique, une seule personne représentera la France aux JO de Londres. Les sélections, qui se déroulent à Pau, sont extrêmement relevées, avec notamment Fabien Lefèvre et Benoît Peschier qui font valoir leur expérience mais c'est Boris qui semble en sortir vainqueur au soir de la dernière course de sélection. 30 minutes après le dernier passage de concurrents, alors qu'on commence à le féliciter pour son "billet" pour Londres, on apprend que c'est finalement Étienne Daille qui est le vainqueur. Le coup est rude pour Boris, qui mettra du temps à digérer cet épilogue même si le fait que ses partenaires d'entraînement Tony Estanguet et Emilie Fer décrochent l'or olympique, lui montrera que la voie suivie est la bonne. La reconstruction commence par une médaille de bronze en K1 par équipes aux Championnats du monde de slalom 2013 à Prague avec Étienne Daille et Mathieu Biazizzo, mais les résultats individuels sont encore un peu décevants à son goût. Galasport, son fournisseur historique de kayaks, lui accorde cependant une confiance accrue en lui permettant de dessiner ses propres embarcations. Le 20 septembre 2014, à Deep Creek aux États-Unis, Boris Neveu remporte son premier titre mondial individuel en kayak monoplace (K1). Il mène à cette occasion un triplé inédit des pagayeurs français, puisque Sébastien Combot et Mathieu Biazizzo terminent médaillés d'argent et de bronze, avant de remporter tous les trois conjointement le titre en course par équipe. Dès lors, Boris devient la référence sur le circuit international, qu'il domine assez nettement, remportant notamment les Championnats d'Europe de slalom 2015 à Markkleeberg, même si cette domination est brutalement stoppée par une décevante 11e place aux Championnats du Monde 2015 de Londres. Sa saison 2016 est marquée par une nouvelle désillusion olympique : alors qu'il est largement favori des courses de sélection, il est dominé sur l'ultime course pour 6 centièmes de secondes par Sébastien Combot, échouant ainsi à gagner un ticket olympique qui sera attribué à son rival lannionais. Lors de l'olympiade 2016-2020, il est un peu plus en retrait au niveau international. Malgré quelques performances de premier ordre, telles qu'aux Championnats d'Europe de slalom 2017 à Tacen en Slovénie, où il remporte la médaille d'argent en K1 slalom par équipes, il redescend un peu dans la hiérarchie mondiale en slalom. Il profite cependant de cette occasion pour participer à quelques compétitions de slalom extrême, remportant notamment deux titres de vice-champion du monde dans cette discipline. Il remporte avec Mathurin Madoré et Quentin Burgi la médaille d'or en kayak par équipes aux Championnats d'Europe de slalom 2020 à Prague. Le 25 septembre 2021, le Bigourdan Boris Neveu (club ALCK Bagnères-de-Bigorre) est devenu champion du Monde en kayak monoplace en devançant largement les autres concurrents (avec un chrono de 83’92) et par équipes aux Championnats du monde de slalom 2021 à Bratislava. Il décroche ainsi son deuxième titre mondial, sept ans après celui des Mondiaux de 2014 remporté aux Etats-Unis et aussi arrivé second en 2019. Un sacre mondial qui vient clore une saison forte émotionnellement, notamment après sa déception moins de deux mois avant lors des Jeux Olympiques de Tokyo (7e à Tokyo). Le kayakiste avait été sacré champion du monde en 2014 puis champion d’Europe en 2015. En kayak extrême il s'était illustré, deux fois vice-champion du monde de cette future discipline olympique. À 35 ans, Boris affiche un des plus beaux palmarès du kayak mondial. Une réussite qui lui permet de parcourir le monde, de bassin en bassin. Mais une aventure qui ne l’empêche pas de conserver un attachement sans borne pour la terre de son enfance. Né à Lourdes, dans les Hautes-Pyrénées, il vit aujourd’hui à Bizanos près de Pau avec sa famille, mais est resté fidèle au club de sa première licence : l’Amicale laïque de canoë-kayak de Bagnères-de-Bigorre. Professionnellement, il évolue en tant que professeur de sport rattaché à l’INSEP depuis 2011, ce qui lui permet de concilier vie sportive et professionnelle.NIMIER Roger (1925-1962)
Romancier, journaliste et scénariste, mobilisé au 2e régiment de hussards de Tarbes
 Roger NIMIER, né le 31 octobre 1925 à Paris et mort le 28 septembre 1962 à La Celle-Saint-Cloud, à l’âge de 36 ans. Romancier, journaliste et scénariste, il est considéré comme le chef de file du mouvement littéraire dit des « Hussards ». Fils de l'ingénieur Paul Nimier (1890-1939), l'inventeur de la télécommande de l'éclairage public mise au point après sa mort, et de l'horloge parlante de l'Observatoire. De 1933 à 1942, il fréquente le lycée Pasteur de Neuilly. Il est un brillant élève. Michel Tournier, son condisciple en classe de philosophie, juge sa précocité « un peu monstrueuse » et son intelligence et sa mémoire « hors du commun ». En 1942, il obtient un premier accessit au concours général de philosophie. Après son baccalauréat, à la rentrée de 1942, il commence des études à la Sorbonne, tout en étant employé par la maison de philatélie Miro, dirigée par son oncle. Il s'engage avant la fin de la guerre, le 3 mars 1945, au 2e régiment de hussards, qui est situé à Tarbes ; il est démobilisé le 20 août 1945. Nimier écrit dans un style proche de Giraudoux et de Cocteau un premier roman, très autobiographique, « L'Étrangère », qui sera publié après sa mort. Nimier est publié pour la première fois, à vingt-trois ans, avec « Les Épées (1948) », un roman plein d'insolence, mêlant la tendresse à la provocation politique dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Deux années plus tard, en 1950, paraissent son roman le plus célèbre, « Le Hussard bleu », qui renouvelle la veine des Épées et où il réemploie le personnage de François Sanders, puis « Perfide » et « Le Grand d'Espagne », un essai historico-politique au ton pamphlétaire qu'il conçoit comme un hommage à Georges Bernanos. En 1951, il publie « Les Enfants tristes », puis, en 1953, « Histoire d'un amour ». Suivant le conseil de Jacques Chardonne, qui juge sa production de cinq livres en cinq ans, trop rapide, il décide alors de ne publier aucun roman pendant dix ans. Entre-temps, Bernard Frank l'a sacré chef de file des Hussards en décembre 1952, dans un article célèbre paru dans Les Temps modernes, le nom de « Hussards » faisant référence au Hussard bleu. Un mois avant de mourir dans un accident de voiture au volant de son Aston Martin, Roger Nimier achève son « D’Artagnan amoureux », en exergue duquel il inscrit cette phrase de Madame de Sévigné : "Cette belle jeunesse, où nous avons souvent pensé crever de rire ensemble".
Roger NIMIER, né le 31 octobre 1925 à Paris et mort le 28 septembre 1962 à La Celle-Saint-Cloud, à l’âge de 36 ans. Romancier, journaliste et scénariste, il est considéré comme le chef de file du mouvement littéraire dit des « Hussards ». Fils de l'ingénieur Paul Nimier (1890-1939), l'inventeur de la télécommande de l'éclairage public mise au point après sa mort, et de l'horloge parlante de l'Observatoire. De 1933 à 1942, il fréquente le lycée Pasteur de Neuilly. Il est un brillant élève. Michel Tournier, son condisciple en classe de philosophie, juge sa précocité « un peu monstrueuse » et son intelligence et sa mémoire « hors du commun ». En 1942, il obtient un premier accessit au concours général de philosophie. Après son baccalauréat, à la rentrée de 1942, il commence des études à la Sorbonne, tout en étant employé par la maison de philatélie Miro, dirigée par son oncle. Il s'engage avant la fin de la guerre, le 3 mars 1945, au 2e régiment de hussards, qui est situé à Tarbes ; il est démobilisé le 20 août 1945. Nimier écrit dans un style proche de Giraudoux et de Cocteau un premier roman, très autobiographique, « L'Étrangère », qui sera publié après sa mort. Nimier est publié pour la première fois, à vingt-trois ans, avec « Les Épées (1948) », un roman plein d'insolence, mêlant la tendresse à la provocation politique dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Deux années plus tard, en 1950, paraissent son roman le plus célèbre, « Le Hussard bleu », qui renouvelle la veine des Épées et où il réemploie le personnage de François Sanders, puis « Perfide » et « Le Grand d'Espagne », un essai historico-politique au ton pamphlétaire qu'il conçoit comme un hommage à Georges Bernanos. En 1951, il publie « Les Enfants tristes », puis, en 1953, « Histoire d'un amour ». Suivant le conseil de Jacques Chardonne, qui juge sa production de cinq livres en cinq ans, trop rapide, il décide alors de ne publier aucun roman pendant dix ans. Entre-temps, Bernard Frank l'a sacré chef de file des Hussards en décembre 1952, dans un article célèbre paru dans Les Temps modernes, le nom de « Hussards » faisant référence au Hussard bleu. Un mois avant de mourir dans un accident de voiture au volant de son Aston Martin, Roger Nimier achève son « D’Artagnan amoureux », en exergue duquel il inscrit cette phrase de Madame de Sévigné : "Cette belle jeunesse, où nous avons souvent pensé crever de rire ensemble".
 Roger NIMIER, né le 31 octobre 1925 à Paris et mort le 28 septembre 1962 à La Celle-Saint-Cloud, à l’âge de 36 ans. Romancier, journaliste et scénariste, il est considéré comme le chef de file du mouvement littéraire dit des « Hussards ». Fils de l'ingénieur Paul Nimier (1890-1939), l'inventeur de la télécommande de l'éclairage public mise au point après sa mort, et de l'horloge parlante de l'Observatoire. De 1933 à 1942, il fréquente le lycée Pasteur de Neuilly. Il est un brillant élève. Michel Tournier, son condisciple en classe de philosophie, juge sa précocité « un peu monstrueuse » et son intelligence et sa mémoire « hors du commun ». En 1942, il obtient un premier accessit au concours général de philosophie. Après son baccalauréat, à la rentrée de 1942, il commence des études à la Sorbonne, tout en étant employé par la maison de philatélie Miro, dirigée par son oncle. Il s'engage avant la fin de la guerre, le 3 mars 1945, au 2e régiment de hussards, qui est situé à Tarbes ; il est démobilisé le 20 août 1945. Nimier écrit dans un style proche de Giraudoux et de Cocteau un premier roman, très autobiographique, « L'Étrangère », qui sera publié après sa mort. Nimier est publié pour la première fois, à vingt-trois ans, avec « Les Épées (1948) », un roman plein d'insolence, mêlant la tendresse à la provocation politique dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Deux années plus tard, en 1950, paraissent son roman le plus célèbre, « Le Hussard bleu », qui renouvelle la veine des Épées et où il réemploie le personnage de François Sanders, puis « Perfide » et « Le Grand d'Espagne », un essai historico-politique au ton pamphlétaire qu'il conçoit comme un hommage à Georges Bernanos. En 1951, il publie « Les Enfants tristes », puis, en 1953, « Histoire d'un amour ». Suivant le conseil de Jacques Chardonne, qui juge sa production de cinq livres en cinq ans, trop rapide, il décide alors de ne publier aucun roman pendant dix ans. Entre-temps, Bernard Frank l'a sacré chef de file des Hussards en décembre 1952, dans un article célèbre paru dans Les Temps modernes, le nom de « Hussards » faisant référence au Hussard bleu. Un mois avant de mourir dans un accident de voiture au volant de son Aston Martin, Roger Nimier achève son « D’Artagnan amoureux », en exergue duquel il inscrit cette phrase de Madame de Sévigné : "Cette belle jeunesse, où nous avons souvent pensé crever de rire ensemble".
Roger NIMIER, né le 31 octobre 1925 à Paris et mort le 28 septembre 1962 à La Celle-Saint-Cloud, à l’âge de 36 ans. Romancier, journaliste et scénariste, il est considéré comme le chef de file du mouvement littéraire dit des « Hussards ». Fils de l'ingénieur Paul Nimier (1890-1939), l'inventeur de la télécommande de l'éclairage public mise au point après sa mort, et de l'horloge parlante de l'Observatoire. De 1933 à 1942, il fréquente le lycée Pasteur de Neuilly. Il est un brillant élève. Michel Tournier, son condisciple en classe de philosophie, juge sa précocité « un peu monstrueuse » et son intelligence et sa mémoire « hors du commun ». En 1942, il obtient un premier accessit au concours général de philosophie. Après son baccalauréat, à la rentrée de 1942, il commence des études à la Sorbonne, tout en étant employé par la maison de philatélie Miro, dirigée par son oncle. Il s'engage avant la fin de la guerre, le 3 mars 1945, au 2e régiment de hussards, qui est situé à Tarbes ; il est démobilisé le 20 août 1945. Nimier écrit dans un style proche de Giraudoux et de Cocteau un premier roman, très autobiographique, « L'Étrangère », qui sera publié après sa mort. Nimier est publié pour la première fois, à vingt-trois ans, avec « Les Épées (1948) », un roman plein d'insolence, mêlant la tendresse à la provocation politique dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Deux années plus tard, en 1950, paraissent son roman le plus célèbre, « Le Hussard bleu », qui renouvelle la veine des Épées et où il réemploie le personnage de François Sanders, puis « Perfide » et « Le Grand d'Espagne », un essai historico-politique au ton pamphlétaire qu'il conçoit comme un hommage à Georges Bernanos. En 1951, il publie « Les Enfants tristes », puis, en 1953, « Histoire d'un amour ». Suivant le conseil de Jacques Chardonne, qui juge sa production de cinq livres en cinq ans, trop rapide, il décide alors de ne publier aucun roman pendant dix ans. Entre-temps, Bernard Frank l'a sacré chef de file des Hussards en décembre 1952, dans un article célèbre paru dans Les Temps modernes, le nom de « Hussards » faisant référence au Hussard bleu. Un mois avant de mourir dans un accident de voiture au volant de son Aston Martin, Roger Nimier achève son « D’Artagnan amoureux », en exergue duquel il inscrit cette phrase de Madame de Sévigné : "Cette belle jeunesse, où nous avons souvent pensé crever de rire ensemble".OUSSET Cécile (1936-XXXX)
Pianiste bien connue pour sa prestigieuse carrière
 Cécile OUSSET, née à Tarbes le 23 janvier 1936, est une grande pianiste française. Dernière enfant d'une famille de sept filles, elle est originaire du village de Ferrère, en vallée de Barousse, dont son père, le colonel Alexandre Ousset, fut le maire dans les années 1950. Elle donne son premier récital à l'âge de cinq ans. Plus tard, elle étudie au Conservatoire de Paris avec Marcel Ciampi. À quatorze ans, elle obtient son premier prix de piano lors de la promotion 1950. Elle remporte de nombreux concours internationaux dont le Concours international Marguerite-Long-Jacques-Thibaud à Genève à l’âge de 17 ans, le Prix du Concours International de Genève à 18 ans, le Premier Grand Prix du Concours International Viotti à 19 ans; the Premier Prix du Concours International Busoni (Italie) à 23 ans, le Prix Van Cliburn (USA) à 26 ans, et le quatrième prix du Concours musical international Reine Élisabeth de Belgique en 1956, où les autres primés sont Vladimir Ashkenazy (Premier prix), John Browning, Lazar Berman, Tamás Vásáry et Peter Frankl. Ce n’est qu’au début des années 80 que la carrière de Cécile Ousset prend son envol. Le tournant a été au Festival d'Edimbourg en 1980, où elle a remplacé une Martha Argerich indisposée. Après cela, Cécile Ousset était continuellement demandée. Cécile Ousset a fait ses débuts aux États-Unis avec les orchestres philharmoniques de Los Angeles et du Minnesota en 1984 et y est retournée chaque année pour des engagements, notamment des concerts avec le Boston Symphony Orchestra et le National Symphony (Washington), et en février 2000 son troisième retour dans l'Orchestre philharmonique de New York. Elle se produit dans le monde entier et enregistre un vaste répertoire allant des concertos pour piano de Brahms, Grieg, Liszt, Mendelssohn, Schumann, Tchaikovsky, Prokofiev, Rachmaninov, Saint-Saëns, Ravel et Poulenc. Mais elle a également joué Messiaen et Dutilleux, et plus tôt dans sa carrière Mozart et Beethoven. Elle aimait apprendre une nouvelle œuvre majeure chaque année et, ce faisant, se constituait un vaste répertoire. Elle est dirigée par les plus grands chefs d'orchestre, tels que Kurt Masur, Simon Rattle, Neville Marriner, Gunther Herbig... Elle a donc joué avec plusieurs des plus grands orchestres du monde en Europe, en Russie, en Amérique, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong, au Japon et en Afrique du Sud. Elle a travaillé régulièrement avec le chef d'orchestre Kurt Masur et en Grande-Bretagne avec Simon Rattle. Elle remporte le très convoité Grand Prix du Disque de l'académie Charles-Cros pour son enregistrement du deuxième concerto pour piano de Brahms sous la direction de Kurt Masur. Cécile Ousset a toujours éprouvé un grand plaisir à l'enseignement et au suivi de jeunes talents. Elle aime siéger à des jurys de concours de piano dans le monde entier et donner des master-classes. Ainsi elle a participé à de nombreuses master-classes aux États-Unis, Canada, Europe, Australie et en Asie. Ses propres master-classes sont très courues. Elles sont organisées depuis 1981, dans le village médiéval de Puycelsi dans le Tarn, où elle séjourne les étés. Elle est fréquemment invitée comme jury dans de nombreux concours internationaux, comme le Van Cliburn, Anton Rubinstein, Reine Elisabeth de Belgique, Leeds, Marguerite Long-Jacques-Thibaud, etc… On l'apprécie dans ses enregistrements d'œuvres de Ravel, Chopin, Rachmaninov et Debussy. Dans les années 1980 et 1990, Cécile Ousset a travaillé sans relâche, en 1987 donnant cinq récitals de musique française au Barbican de Londres. En 2006, Cécile Ousset s'est retirée de la scène publique en raison de problèmes de dos. Il est surprenant de constater que Cécile Ousset, avec sa panoplie de prix de concours, n'a été approchée par une maison de disques qu'à l'âge de vingt-neuf ans. En 1971, Cécile Ousset commence à enregistrer pour Decca en France. La parution pour la première fois en CD du legs Decca France de la pianiste française Cécile Ousset est une magnifique opportunité pour les mélomanes. Ces gravures du début des années soixante-dix n’ont rien perdu de leur intérêt. On s’interroge sur l’oubli d’une artiste possédant un tempérament et une virtuosité aussi électrisante. L’édition de ce coffret de CD répare un oubli sérieux de la discographie et une injustice faite à une artiste méconnue dans son propre pays. Sa carrière s’est surtout développée hors de nos frontières. Boudée par les scènes françaises, Cécile Ousset fut acclamée par l’Angleterre, l’Australie, le Japon… En Angleterre, elle joua à guichets fermés et quand elle revint à Bruxelles, quarante ans après son prix au Concours Reine-Elisabeth, la salle était pleine et le public, qui ne l’avait pas oubliée, était très enthousiaste. Elle se produit régulièrement aussi au festival de musique de Cannes. Lauréate du prix Marguerite-Long en 1953, avec ses jolis doigts et sa belle virtuosité, elle a bien mérité les prix qu'elle a récoltés dans le monde entier. Mais l'on se demande comment, sous ses doigts, des œuvres telles que le Concerto en sol, de Beethoven, ou le Concerto en fa mineur, de Chopin, peuvent apparaître aussi simplement agréables et anodines. Cécile Ousset, qui était l’une des solistes favorites de Simon Rattle au Royaume-Uni – leur discographie commune n’est pas mince – qui a enregistré avec Kurt Masur et pour Berlin Classics, n’a jamais quitté sa maison du Midi. Et elle ne s’explique pas non plus pourquoi elle avait joué si rarement dans son propre pays. Pianiste prodige, qui aura marqué l’Histoire de la musique classique, et dont l’immense carrière l'amena aux 4 coins du monde, de la Russie à l’Amérique du Sud, pour un nombre incalculable de concerts, elle est de fait une très grande fierté pour la Bigorre.
Cécile OUSSET, née à Tarbes le 23 janvier 1936, est une grande pianiste française. Dernière enfant d'une famille de sept filles, elle est originaire du village de Ferrère, en vallée de Barousse, dont son père, le colonel Alexandre Ousset, fut le maire dans les années 1950. Elle donne son premier récital à l'âge de cinq ans. Plus tard, elle étudie au Conservatoire de Paris avec Marcel Ciampi. À quatorze ans, elle obtient son premier prix de piano lors de la promotion 1950. Elle remporte de nombreux concours internationaux dont le Concours international Marguerite-Long-Jacques-Thibaud à Genève à l’âge de 17 ans, le Prix du Concours International de Genève à 18 ans, le Premier Grand Prix du Concours International Viotti à 19 ans; the Premier Prix du Concours International Busoni (Italie) à 23 ans, le Prix Van Cliburn (USA) à 26 ans, et le quatrième prix du Concours musical international Reine Élisabeth de Belgique en 1956, où les autres primés sont Vladimir Ashkenazy (Premier prix), John Browning, Lazar Berman, Tamás Vásáry et Peter Frankl. Ce n’est qu’au début des années 80 que la carrière de Cécile Ousset prend son envol. Le tournant a été au Festival d'Edimbourg en 1980, où elle a remplacé une Martha Argerich indisposée. Après cela, Cécile Ousset était continuellement demandée. Cécile Ousset a fait ses débuts aux États-Unis avec les orchestres philharmoniques de Los Angeles et du Minnesota en 1984 et y est retournée chaque année pour des engagements, notamment des concerts avec le Boston Symphony Orchestra et le National Symphony (Washington), et en février 2000 son troisième retour dans l'Orchestre philharmonique de New York. Elle se produit dans le monde entier et enregistre un vaste répertoire allant des concertos pour piano de Brahms, Grieg, Liszt, Mendelssohn, Schumann, Tchaikovsky, Prokofiev, Rachmaninov, Saint-Saëns, Ravel et Poulenc. Mais elle a également joué Messiaen et Dutilleux, et plus tôt dans sa carrière Mozart et Beethoven. Elle aimait apprendre une nouvelle œuvre majeure chaque année et, ce faisant, se constituait un vaste répertoire. Elle est dirigée par les plus grands chefs d'orchestre, tels que Kurt Masur, Simon Rattle, Neville Marriner, Gunther Herbig... Elle a donc joué avec plusieurs des plus grands orchestres du monde en Europe, en Russie, en Amérique, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong, au Japon et en Afrique du Sud. Elle a travaillé régulièrement avec le chef d'orchestre Kurt Masur et en Grande-Bretagne avec Simon Rattle. Elle remporte le très convoité Grand Prix du Disque de l'académie Charles-Cros pour son enregistrement du deuxième concerto pour piano de Brahms sous la direction de Kurt Masur. Cécile Ousset a toujours éprouvé un grand plaisir à l'enseignement et au suivi de jeunes talents. Elle aime siéger à des jurys de concours de piano dans le monde entier et donner des master-classes. Ainsi elle a participé à de nombreuses master-classes aux États-Unis, Canada, Europe, Australie et en Asie. Ses propres master-classes sont très courues. Elles sont organisées depuis 1981, dans le village médiéval de Puycelsi dans le Tarn, où elle séjourne les étés. Elle est fréquemment invitée comme jury dans de nombreux concours internationaux, comme le Van Cliburn, Anton Rubinstein, Reine Elisabeth de Belgique, Leeds, Marguerite Long-Jacques-Thibaud, etc… On l'apprécie dans ses enregistrements d'œuvres de Ravel, Chopin, Rachmaninov et Debussy. Dans les années 1980 et 1990, Cécile Ousset a travaillé sans relâche, en 1987 donnant cinq récitals de musique française au Barbican de Londres. En 2006, Cécile Ousset s'est retirée de la scène publique en raison de problèmes de dos. Il est surprenant de constater que Cécile Ousset, avec sa panoplie de prix de concours, n'a été approchée par une maison de disques qu'à l'âge de vingt-neuf ans. En 1971, Cécile Ousset commence à enregistrer pour Decca en France. La parution pour la première fois en CD du legs Decca France de la pianiste française Cécile Ousset est une magnifique opportunité pour les mélomanes. Ces gravures du début des années soixante-dix n’ont rien perdu de leur intérêt. On s’interroge sur l’oubli d’une artiste possédant un tempérament et une virtuosité aussi électrisante. L’édition de ce coffret de CD répare un oubli sérieux de la discographie et une injustice faite à une artiste méconnue dans son propre pays. Sa carrière s’est surtout développée hors de nos frontières. Boudée par les scènes françaises, Cécile Ousset fut acclamée par l’Angleterre, l’Australie, le Japon… En Angleterre, elle joua à guichets fermés et quand elle revint à Bruxelles, quarante ans après son prix au Concours Reine-Elisabeth, la salle était pleine et le public, qui ne l’avait pas oubliée, était très enthousiaste. Elle se produit régulièrement aussi au festival de musique de Cannes. Lauréate du prix Marguerite-Long en 1953, avec ses jolis doigts et sa belle virtuosité, elle a bien mérité les prix qu'elle a récoltés dans le monde entier. Mais l'on se demande comment, sous ses doigts, des œuvres telles que le Concerto en sol, de Beethoven, ou le Concerto en fa mineur, de Chopin, peuvent apparaître aussi simplement agréables et anodines. Cécile Ousset, qui était l’une des solistes favorites de Simon Rattle au Royaume-Uni – leur discographie commune n’est pas mince – qui a enregistré avec Kurt Masur et pour Berlin Classics, n’a jamais quitté sa maison du Midi. Et elle ne s’explique pas non plus pourquoi elle avait joué si rarement dans son propre pays. Pianiste prodige, qui aura marqué l’Histoire de la musique classique, et dont l’immense carrière l'amena aux 4 coins du monde, de la Russie à l’Amérique du Sud, pour un nombre incalculable de concerts, elle est de fait une très grande fierté pour la Bigorre.
 Cécile OUSSET, née à Tarbes le 23 janvier 1936, est une grande pianiste française. Dernière enfant d'une famille de sept filles, elle est originaire du village de Ferrère, en vallée de Barousse, dont son père, le colonel Alexandre Ousset, fut le maire dans les années 1950. Elle donne son premier récital à l'âge de cinq ans. Plus tard, elle étudie au Conservatoire de Paris avec Marcel Ciampi. À quatorze ans, elle obtient son premier prix de piano lors de la promotion 1950. Elle remporte de nombreux concours internationaux dont le Concours international Marguerite-Long-Jacques-Thibaud à Genève à l’âge de 17 ans, le Prix du Concours International de Genève à 18 ans, le Premier Grand Prix du Concours International Viotti à 19 ans; the Premier Prix du Concours International Busoni (Italie) à 23 ans, le Prix Van Cliburn (USA) à 26 ans, et le quatrième prix du Concours musical international Reine Élisabeth de Belgique en 1956, où les autres primés sont Vladimir Ashkenazy (Premier prix), John Browning, Lazar Berman, Tamás Vásáry et Peter Frankl. Ce n’est qu’au début des années 80 que la carrière de Cécile Ousset prend son envol. Le tournant a été au Festival d'Edimbourg en 1980, où elle a remplacé une Martha Argerich indisposée. Après cela, Cécile Ousset était continuellement demandée. Cécile Ousset a fait ses débuts aux États-Unis avec les orchestres philharmoniques de Los Angeles et du Minnesota en 1984 et y est retournée chaque année pour des engagements, notamment des concerts avec le Boston Symphony Orchestra et le National Symphony (Washington), et en février 2000 son troisième retour dans l'Orchestre philharmonique de New York. Elle se produit dans le monde entier et enregistre un vaste répertoire allant des concertos pour piano de Brahms, Grieg, Liszt, Mendelssohn, Schumann, Tchaikovsky, Prokofiev, Rachmaninov, Saint-Saëns, Ravel et Poulenc. Mais elle a également joué Messiaen et Dutilleux, et plus tôt dans sa carrière Mozart et Beethoven. Elle aimait apprendre une nouvelle œuvre majeure chaque année et, ce faisant, se constituait un vaste répertoire. Elle est dirigée par les plus grands chefs d'orchestre, tels que Kurt Masur, Simon Rattle, Neville Marriner, Gunther Herbig... Elle a donc joué avec plusieurs des plus grands orchestres du monde en Europe, en Russie, en Amérique, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong, au Japon et en Afrique du Sud. Elle a travaillé régulièrement avec le chef d'orchestre Kurt Masur et en Grande-Bretagne avec Simon Rattle. Elle remporte le très convoité Grand Prix du Disque de l'académie Charles-Cros pour son enregistrement du deuxième concerto pour piano de Brahms sous la direction de Kurt Masur. Cécile Ousset a toujours éprouvé un grand plaisir à l'enseignement et au suivi de jeunes talents. Elle aime siéger à des jurys de concours de piano dans le monde entier et donner des master-classes. Ainsi elle a participé à de nombreuses master-classes aux États-Unis, Canada, Europe, Australie et en Asie. Ses propres master-classes sont très courues. Elles sont organisées depuis 1981, dans le village médiéval de Puycelsi dans le Tarn, où elle séjourne les étés. Elle est fréquemment invitée comme jury dans de nombreux concours internationaux, comme le Van Cliburn, Anton Rubinstein, Reine Elisabeth de Belgique, Leeds, Marguerite Long-Jacques-Thibaud, etc… On l'apprécie dans ses enregistrements d'œuvres de Ravel, Chopin, Rachmaninov et Debussy. Dans les années 1980 et 1990, Cécile Ousset a travaillé sans relâche, en 1987 donnant cinq récitals de musique française au Barbican de Londres. En 2006, Cécile Ousset s'est retirée de la scène publique en raison de problèmes de dos. Il est surprenant de constater que Cécile Ousset, avec sa panoplie de prix de concours, n'a été approchée par une maison de disques qu'à l'âge de vingt-neuf ans. En 1971, Cécile Ousset commence à enregistrer pour Decca en France. La parution pour la première fois en CD du legs Decca France de la pianiste française Cécile Ousset est une magnifique opportunité pour les mélomanes. Ces gravures du début des années soixante-dix n’ont rien perdu de leur intérêt. On s’interroge sur l’oubli d’une artiste possédant un tempérament et une virtuosité aussi électrisante. L’édition de ce coffret de CD répare un oubli sérieux de la discographie et une injustice faite à une artiste méconnue dans son propre pays. Sa carrière s’est surtout développée hors de nos frontières. Boudée par les scènes françaises, Cécile Ousset fut acclamée par l’Angleterre, l’Australie, le Japon… En Angleterre, elle joua à guichets fermés et quand elle revint à Bruxelles, quarante ans après son prix au Concours Reine-Elisabeth, la salle était pleine et le public, qui ne l’avait pas oubliée, était très enthousiaste. Elle se produit régulièrement aussi au festival de musique de Cannes. Lauréate du prix Marguerite-Long en 1953, avec ses jolis doigts et sa belle virtuosité, elle a bien mérité les prix qu'elle a récoltés dans le monde entier. Mais l'on se demande comment, sous ses doigts, des œuvres telles que le Concerto en sol, de Beethoven, ou le Concerto en fa mineur, de Chopin, peuvent apparaître aussi simplement agréables et anodines. Cécile Ousset, qui était l’une des solistes favorites de Simon Rattle au Royaume-Uni – leur discographie commune n’est pas mince – qui a enregistré avec Kurt Masur et pour Berlin Classics, n’a jamais quitté sa maison du Midi. Et elle ne s’explique pas non plus pourquoi elle avait joué si rarement dans son propre pays. Pianiste prodige, qui aura marqué l’Histoire de la musique classique, et dont l’immense carrière l'amena aux 4 coins du monde, de la Russie à l’Amérique du Sud, pour un nombre incalculable de concerts, elle est de fait une très grande fierté pour la Bigorre.
Cécile OUSSET, née à Tarbes le 23 janvier 1936, est une grande pianiste française. Dernière enfant d'une famille de sept filles, elle est originaire du village de Ferrère, en vallée de Barousse, dont son père, le colonel Alexandre Ousset, fut le maire dans les années 1950. Elle donne son premier récital à l'âge de cinq ans. Plus tard, elle étudie au Conservatoire de Paris avec Marcel Ciampi. À quatorze ans, elle obtient son premier prix de piano lors de la promotion 1950. Elle remporte de nombreux concours internationaux dont le Concours international Marguerite-Long-Jacques-Thibaud à Genève à l’âge de 17 ans, le Prix du Concours International de Genève à 18 ans, le Premier Grand Prix du Concours International Viotti à 19 ans; the Premier Prix du Concours International Busoni (Italie) à 23 ans, le Prix Van Cliburn (USA) à 26 ans, et le quatrième prix du Concours musical international Reine Élisabeth de Belgique en 1956, où les autres primés sont Vladimir Ashkenazy (Premier prix), John Browning, Lazar Berman, Tamás Vásáry et Peter Frankl. Ce n’est qu’au début des années 80 que la carrière de Cécile Ousset prend son envol. Le tournant a été au Festival d'Edimbourg en 1980, où elle a remplacé une Martha Argerich indisposée. Après cela, Cécile Ousset était continuellement demandée. Cécile Ousset a fait ses débuts aux États-Unis avec les orchestres philharmoniques de Los Angeles et du Minnesota en 1984 et y est retournée chaque année pour des engagements, notamment des concerts avec le Boston Symphony Orchestra et le National Symphony (Washington), et en février 2000 son troisième retour dans l'Orchestre philharmonique de New York. Elle se produit dans le monde entier et enregistre un vaste répertoire allant des concertos pour piano de Brahms, Grieg, Liszt, Mendelssohn, Schumann, Tchaikovsky, Prokofiev, Rachmaninov, Saint-Saëns, Ravel et Poulenc. Mais elle a également joué Messiaen et Dutilleux, et plus tôt dans sa carrière Mozart et Beethoven. Elle aimait apprendre une nouvelle œuvre majeure chaque année et, ce faisant, se constituait un vaste répertoire. Elle est dirigée par les plus grands chefs d'orchestre, tels que Kurt Masur, Simon Rattle, Neville Marriner, Gunther Herbig... Elle a donc joué avec plusieurs des plus grands orchestres du monde en Europe, en Russie, en Amérique, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Hong Kong, au Japon et en Afrique du Sud. Elle a travaillé régulièrement avec le chef d'orchestre Kurt Masur et en Grande-Bretagne avec Simon Rattle. Elle remporte le très convoité Grand Prix du Disque de l'académie Charles-Cros pour son enregistrement du deuxième concerto pour piano de Brahms sous la direction de Kurt Masur. Cécile Ousset a toujours éprouvé un grand plaisir à l'enseignement et au suivi de jeunes talents. Elle aime siéger à des jurys de concours de piano dans le monde entier et donner des master-classes. Ainsi elle a participé à de nombreuses master-classes aux États-Unis, Canada, Europe, Australie et en Asie. Ses propres master-classes sont très courues. Elles sont organisées depuis 1981, dans le village médiéval de Puycelsi dans le Tarn, où elle séjourne les étés. Elle est fréquemment invitée comme jury dans de nombreux concours internationaux, comme le Van Cliburn, Anton Rubinstein, Reine Elisabeth de Belgique, Leeds, Marguerite Long-Jacques-Thibaud, etc… On l'apprécie dans ses enregistrements d'œuvres de Ravel, Chopin, Rachmaninov et Debussy. Dans les années 1980 et 1990, Cécile Ousset a travaillé sans relâche, en 1987 donnant cinq récitals de musique française au Barbican de Londres. En 2006, Cécile Ousset s'est retirée de la scène publique en raison de problèmes de dos. Il est surprenant de constater que Cécile Ousset, avec sa panoplie de prix de concours, n'a été approchée par une maison de disques qu'à l'âge de vingt-neuf ans. En 1971, Cécile Ousset commence à enregistrer pour Decca en France. La parution pour la première fois en CD du legs Decca France de la pianiste française Cécile Ousset est une magnifique opportunité pour les mélomanes. Ces gravures du début des années soixante-dix n’ont rien perdu de leur intérêt. On s’interroge sur l’oubli d’une artiste possédant un tempérament et une virtuosité aussi électrisante. L’édition de ce coffret de CD répare un oubli sérieux de la discographie et une injustice faite à une artiste méconnue dans son propre pays. Sa carrière s’est surtout développée hors de nos frontières. Boudée par les scènes françaises, Cécile Ousset fut acclamée par l’Angleterre, l’Australie, le Japon… En Angleterre, elle joua à guichets fermés et quand elle revint à Bruxelles, quarante ans après son prix au Concours Reine-Elisabeth, la salle était pleine et le public, qui ne l’avait pas oubliée, était très enthousiaste. Elle se produit régulièrement aussi au festival de musique de Cannes. Lauréate du prix Marguerite-Long en 1953, avec ses jolis doigts et sa belle virtuosité, elle a bien mérité les prix qu'elle a récoltés dans le monde entier. Mais l'on se demande comment, sous ses doigts, des œuvres telles que le Concerto en sol, de Beethoven, ou le Concerto en fa mineur, de Chopin, peuvent apparaître aussi simplement agréables et anodines. Cécile Ousset, qui était l’une des solistes favorites de Simon Rattle au Royaume-Uni – leur discographie commune n’est pas mince – qui a enregistré avec Kurt Masur et pour Berlin Classics, n’a jamais quitté sa maison du Midi. Et elle ne s’explique pas non plus pourquoi elle avait joué si rarement dans son propre pays. Pianiste prodige, qui aura marqué l’Histoire de la musique classique, et dont l’immense carrière l'amena aux 4 coins du monde, de la Russie à l’Amérique du Sud, pour un nombre incalculable de concerts, elle est de fait une très grande fierté pour la Bigorre.PASSET Célestin (1845-1917)
Guide de montagne, le plus célèbre des grands guides des Pyrénées
 Célestin PASSET est né à Gavarnie en 1845. Fils aîné d’Hippolyte et donc cousin germain d’Henri Passet (1845-1920), Célestin se révélera un des meilleurs guides du moment. En 1870, il épouse Justine Trescazes, de Sers, avec qui il aura trois filles et un garçon. Sa carrière montagnarde commence à l’âge de 27 ans. Chasseur, guide de montagne réputé, il accompagna à de nombreuses reprises Henry Russel, Franz Schrader, Jean Bazillac, Henri Brulle et Roger de Monts. En 1871, il accompagne Russell au Mont Perdu (3355m), par la brèche de Roland. En 1872, il trouve avec le même Russell un nouvel itinéraire vers le Mont Perdu, par les Rochers Blancs et l’Astazou, le lac Glacé, ce qu’on appellera la « terrasse Russell » et le col du Cylindre. Puis, ils font la première des Gourgs blancs et du pic qui portera plus tard le nom de Jean Arlaud. Entre 1872 et 1879, il réalise avec Russell les premières du Gabiétou par l’est, le pic des Tempêtes, le pic occidental de la Maladetta. Le 11 août 1878, en compagnie de Franz Schrader, il réalise la première ascension connue du Grand Batchimale (3177m), rebaptisé par la suite pic Schrader. En 1880, il réalise la première hivernale des Posets, avec Roger de Monts. En 1882, la première du Comaloforno avec Henri Brulle et Jean Bazillac. Le 26 juillet 1883, avec les guides de l’Oisans Gaspard père et fils et Henri Brulle, ils font la cinquième ascension de la Meije (première ascension en un jour). Cette même année, ils ascensionnent également les Écrins, l’Aiguille d’Arves, le Mont Blanc. En 1884, faisant équipe avec Henri Brulle, ils accomplissent un grand nombre de courses nouvelles dans les Alpes : Aiguille méridionale d’Arves, Dent Parrachée, Grande Casse, Grand paradis, Mont Blanc, Cervin, Dent Blanche, quatrième ascension des Drus (première en un jour depuis Chamonix). En 1887, le Pic entre les brèches, qui deviendra Pic Bazillac, avec Jean Bazillac, et le Doigt de la Fausse Brèche, avec Brulle et Bazillac. Toujours en 1887 la première du Mur de la Cascade avec Jean Bazillac et Roger de Monts. En 1888, la première de la face nord du Mont Perdu avec Roger de Monts et François Bernat-Salles. Le 6 août 1889, avec Henri Brulle, Roger de Monts, Jean Bazillac, et François Bernat-Salles, il ouvre l’ère du pyrénéisme moderne en réussissant la première du couloir de Gaube, sur le Vignemale. Bloqués dans cette faille étroite et gelée, sous l’imposant bloc coincé, Célestin taille plus de 1300 marches dans la glace avec le piolet de Brulle, qui lui facilite la tâche et lui permet de sauver l’escalade. Un instrument qui recevra par la suite le nom désormais historique de « Fleur de Gaube ». Il lui faudra pourtant deux heures d'efforts pour franchir ce passage. Événement majeur de l'histoire du pyrénéisme, cette ascension fut réalisée sous la conduite d'un guide de Gavarnie, grimpeur doué et prestigieux. Très fier de cet exploit, Célestin répétait volontiers que personne après lui ne le referait : « J’ai gardé la clé », disait-il. De fait, l’ascension du couloir de Gaube ne fut réitérée avec succès que quarante-quatre ans plus tard, par Henri Barrio, Joseph Aussat et Joseph Loustaunau, le 13 juillet 1933. En 1895, Célestin réalise la première de la face nord du Taillon, avec Henri Brulle. Peu bavard, presque distant, d’une grande élégance, impassible dans les pires situations, Célestin est resté un paysan, dont le métier est toujours cultivateur à Gavarnie. Mais son expérience fait qu’il peut être un brillant causeur qu’on aime écouter. Guide hors pair, sa réputation est telle qu’il est très demandé, et qu’il réalise de nombreuses courses, non seulement dans les Pyrénées, mais aussi dans d’autres massifs. Le chasseur anglais Buxton, qu’il conduit pour chasser le bouquetin en Espagne, l’invite à Londres pour chasser le renard. Sa réputation dépasse le petit cadre de Gavarnie ; il voyage à travers le monde, accompagnant ses nombreux clients. Il va ascensionner en Afrique du Nord, en Éthiopie, au Sinaï, en Crète, en Sardaigne, dans le Caucase, en Asie ... Il accompagne au Vignemale et au Mont Perdu l’alpiniste vainqueur du Cervin et graveur anglais Edward Whymper, qui a laissé un portrait de lui, et qui lui propose d’aller escalader avec lui le Chimborazo, dans les Andes. Mais Célestin décline l’offre pour rester auprès de sa mère et des quelques biens qu’il possède à Gavarnie. Durant 32 ans (de 1878 à 1910), il effectua un nombre impressionnant de premières. Très demandé comme son cousin Henri, avec qui il reçoit en 1890, la grande médaille du Club alpin français. Tous les grands Pyrénéistes se l’arrachent. : Henry Russell, Henri Brulle, Jean Bazillac, René d’Astorg, Jean d'Ussel, le comte de Saint-Saud ... Pourtant, il ne sera reconnu comme guide par l’administration qu’en 1901. Célestin Passet meurt en 1917 d’une attaque de paralysie. Sa maison, au centre du village, où il vivait avec son gendre Castagné devint l’hôtel Mourgat. Il est enterré au cimetière de Gavarnie, dans le carré des pyrénéistes. Deux textes à sa mémoire ont été écrits par Henri Brulle. Henry Russel l’avait surnommé l’isard bipède, vu ses aptitudes à l’escalade. En Catalogne, au massif du Besiberri, il y a un sommet dédié à Célestin Passet, la Punta de Passet. L’on peut dire que le pyrénéisme de difficulté est né avec lui. Un palmarès qui regroupe environ quatre-vingts "premières". Les générations suivantes seront moins brillantes : la diminution de la demande de guides de la part des grimpeurs, et un certain désintérêt des touristes y sont pour beaucoup. Les nouveaux guides ne sont plus des paysans, mais des citadins qui ont acquis des notions de pédagogie. Le fils d’Henri, Pierre Passet, a été tué en 1917. Désormais ce sont les gendres qui assureront la continuité : Cumia, gendre d’Henri, Theil et Germain Castagné, gendres de Célestin. Célestin Passet, un nom à jamais lié aux Pyrénées et un guide qui amène ses clients au bout de l'impossible. Le maître à tous. Également chasseur, il n'avait pas son pareil pour tirer l'isard. Tant il était apprécié, il fut ainsi convié à faire des courses et des chasses bien au-delà des Pyrénées. Un livre écrit par François Labadens lui est entièrement consacré sous le titre : Célestin Passet, un guide aux Pyrénées, aux éditions MonHélios, 2015. Ce sont les récits de ces courses de l'impossible que nous relate François Labadens en nous expliquant comment ce guide œuvrait pour parvenir à ses fins.
Célestin PASSET est né à Gavarnie en 1845. Fils aîné d’Hippolyte et donc cousin germain d’Henri Passet (1845-1920), Célestin se révélera un des meilleurs guides du moment. En 1870, il épouse Justine Trescazes, de Sers, avec qui il aura trois filles et un garçon. Sa carrière montagnarde commence à l’âge de 27 ans. Chasseur, guide de montagne réputé, il accompagna à de nombreuses reprises Henry Russel, Franz Schrader, Jean Bazillac, Henri Brulle et Roger de Monts. En 1871, il accompagne Russell au Mont Perdu (3355m), par la brèche de Roland. En 1872, il trouve avec le même Russell un nouvel itinéraire vers le Mont Perdu, par les Rochers Blancs et l’Astazou, le lac Glacé, ce qu’on appellera la « terrasse Russell » et le col du Cylindre. Puis, ils font la première des Gourgs blancs et du pic qui portera plus tard le nom de Jean Arlaud. Entre 1872 et 1879, il réalise avec Russell les premières du Gabiétou par l’est, le pic des Tempêtes, le pic occidental de la Maladetta. Le 11 août 1878, en compagnie de Franz Schrader, il réalise la première ascension connue du Grand Batchimale (3177m), rebaptisé par la suite pic Schrader. En 1880, il réalise la première hivernale des Posets, avec Roger de Monts. En 1882, la première du Comaloforno avec Henri Brulle et Jean Bazillac. Le 26 juillet 1883, avec les guides de l’Oisans Gaspard père et fils et Henri Brulle, ils font la cinquième ascension de la Meije (première ascension en un jour). Cette même année, ils ascensionnent également les Écrins, l’Aiguille d’Arves, le Mont Blanc. En 1884, faisant équipe avec Henri Brulle, ils accomplissent un grand nombre de courses nouvelles dans les Alpes : Aiguille méridionale d’Arves, Dent Parrachée, Grande Casse, Grand paradis, Mont Blanc, Cervin, Dent Blanche, quatrième ascension des Drus (première en un jour depuis Chamonix). En 1887, le Pic entre les brèches, qui deviendra Pic Bazillac, avec Jean Bazillac, et le Doigt de la Fausse Brèche, avec Brulle et Bazillac. Toujours en 1887 la première du Mur de la Cascade avec Jean Bazillac et Roger de Monts. En 1888, la première de la face nord du Mont Perdu avec Roger de Monts et François Bernat-Salles. Le 6 août 1889, avec Henri Brulle, Roger de Monts, Jean Bazillac, et François Bernat-Salles, il ouvre l’ère du pyrénéisme moderne en réussissant la première du couloir de Gaube, sur le Vignemale. Bloqués dans cette faille étroite et gelée, sous l’imposant bloc coincé, Célestin taille plus de 1300 marches dans la glace avec le piolet de Brulle, qui lui facilite la tâche et lui permet de sauver l’escalade. Un instrument qui recevra par la suite le nom désormais historique de « Fleur de Gaube ». Il lui faudra pourtant deux heures d'efforts pour franchir ce passage. Événement majeur de l'histoire du pyrénéisme, cette ascension fut réalisée sous la conduite d'un guide de Gavarnie, grimpeur doué et prestigieux. Très fier de cet exploit, Célestin répétait volontiers que personne après lui ne le referait : « J’ai gardé la clé », disait-il. De fait, l’ascension du couloir de Gaube ne fut réitérée avec succès que quarante-quatre ans plus tard, par Henri Barrio, Joseph Aussat et Joseph Loustaunau, le 13 juillet 1933. En 1895, Célestin réalise la première de la face nord du Taillon, avec Henri Brulle. Peu bavard, presque distant, d’une grande élégance, impassible dans les pires situations, Célestin est resté un paysan, dont le métier est toujours cultivateur à Gavarnie. Mais son expérience fait qu’il peut être un brillant causeur qu’on aime écouter. Guide hors pair, sa réputation est telle qu’il est très demandé, et qu’il réalise de nombreuses courses, non seulement dans les Pyrénées, mais aussi dans d’autres massifs. Le chasseur anglais Buxton, qu’il conduit pour chasser le bouquetin en Espagne, l’invite à Londres pour chasser le renard. Sa réputation dépasse le petit cadre de Gavarnie ; il voyage à travers le monde, accompagnant ses nombreux clients. Il va ascensionner en Afrique du Nord, en Éthiopie, au Sinaï, en Crète, en Sardaigne, dans le Caucase, en Asie ... Il accompagne au Vignemale et au Mont Perdu l’alpiniste vainqueur du Cervin et graveur anglais Edward Whymper, qui a laissé un portrait de lui, et qui lui propose d’aller escalader avec lui le Chimborazo, dans les Andes. Mais Célestin décline l’offre pour rester auprès de sa mère et des quelques biens qu’il possède à Gavarnie. Durant 32 ans (de 1878 à 1910), il effectua un nombre impressionnant de premières. Très demandé comme son cousin Henri, avec qui il reçoit en 1890, la grande médaille du Club alpin français. Tous les grands Pyrénéistes se l’arrachent. : Henry Russell, Henri Brulle, Jean Bazillac, René d’Astorg, Jean d'Ussel, le comte de Saint-Saud ... Pourtant, il ne sera reconnu comme guide par l’administration qu’en 1901. Célestin Passet meurt en 1917 d’une attaque de paralysie. Sa maison, au centre du village, où il vivait avec son gendre Castagné devint l’hôtel Mourgat. Il est enterré au cimetière de Gavarnie, dans le carré des pyrénéistes. Deux textes à sa mémoire ont été écrits par Henri Brulle. Henry Russel l’avait surnommé l’isard bipède, vu ses aptitudes à l’escalade. En Catalogne, au massif du Besiberri, il y a un sommet dédié à Célestin Passet, la Punta de Passet. L’on peut dire que le pyrénéisme de difficulté est né avec lui. Un palmarès qui regroupe environ quatre-vingts "premières". Les générations suivantes seront moins brillantes : la diminution de la demande de guides de la part des grimpeurs, et un certain désintérêt des touristes y sont pour beaucoup. Les nouveaux guides ne sont plus des paysans, mais des citadins qui ont acquis des notions de pédagogie. Le fils d’Henri, Pierre Passet, a été tué en 1917. Désormais ce sont les gendres qui assureront la continuité : Cumia, gendre d’Henri, Theil et Germain Castagné, gendres de Célestin. Célestin Passet, un nom à jamais lié aux Pyrénées et un guide qui amène ses clients au bout de l'impossible. Le maître à tous. Également chasseur, il n'avait pas son pareil pour tirer l'isard. Tant il était apprécié, il fut ainsi convié à faire des courses et des chasses bien au-delà des Pyrénées. Un livre écrit par François Labadens lui est entièrement consacré sous le titre : Célestin Passet, un guide aux Pyrénées, aux éditions MonHélios, 2015. Ce sont les récits de ces courses de l'impossible que nous relate François Labadens en nous expliquant comment ce guide œuvrait pour parvenir à ses fins.
 Célestin PASSET est né à Gavarnie en 1845. Fils aîné d’Hippolyte et donc cousin germain d’Henri Passet (1845-1920), Célestin se révélera un des meilleurs guides du moment. En 1870, il épouse Justine Trescazes, de Sers, avec qui il aura trois filles et un garçon. Sa carrière montagnarde commence à l’âge de 27 ans. Chasseur, guide de montagne réputé, il accompagna à de nombreuses reprises Henry Russel, Franz Schrader, Jean Bazillac, Henri Brulle et Roger de Monts. En 1871, il accompagne Russell au Mont Perdu (3355m), par la brèche de Roland. En 1872, il trouve avec le même Russell un nouvel itinéraire vers le Mont Perdu, par les Rochers Blancs et l’Astazou, le lac Glacé, ce qu’on appellera la « terrasse Russell » et le col du Cylindre. Puis, ils font la première des Gourgs blancs et du pic qui portera plus tard le nom de Jean Arlaud. Entre 1872 et 1879, il réalise avec Russell les premières du Gabiétou par l’est, le pic des Tempêtes, le pic occidental de la Maladetta. Le 11 août 1878, en compagnie de Franz Schrader, il réalise la première ascension connue du Grand Batchimale (3177m), rebaptisé par la suite pic Schrader. En 1880, il réalise la première hivernale des Posets, avec Roger de Monts. En 1882, la première du Comaloforno avec Henri Brulle et Jean Bazillac. Le 26 juillet 1883, avec les guides de l’Oisans Gaspard père et fils et Henri Brulle, ils font la cinquième ascension de la Meije (première ascension en un jour). Cette même année, ils ascensionnent également les Écrins, l’Aiguille d’Arves, le Mont Blanc. En 1884, faisant équipe avec Henri Brulle, ils accomplissent un grand nombre de courses nouvelles dans les Alpes : Aiguille méridionale d’Arves, Dent Parrachée, Grande Casse, Grand paradis, Mont Blanc, Cervin, Dent Blanche, quatrième ascension des Drus (première en un jour depuis Chamonix). En 1887, le Pic entre les brèches, qui deviendra Pic Bazillac, avec Jean Bazillac, et le Doigt de la Fausse Brèche, avec Brulle et Bazillac. Toujours en 1887 la première du Mur de la Cascade avec Jean Bazillac et Roger de Monts. En 1888, la première de la face nord du Mont Perdu avec Roger de Monts et François Bernat-Salles. Le 6 août 1889, avec Henri Brulle, Roger de Monts, Jean Bazillac, et François Bernat-Salles, il ouvre l’ère du pyrénéisme moderne en réussissant la première du couloir de Gaube, sur le Vignemale. Bloqués dans cette faille étroite et gelée, sous l’imposant bloc coincé, Célestin taille plus de 1300 marches dans la glace avec le piolet de Brulle, qui lui facilite la tâche et lui permet de sauver l’escalade. Un instrument qui recevra par la suite le nom désormais historique de « Fleur de Gaube ». Il lui faudra pourtant deux heures d'efforts pour franchir ce passage. Événement majeur de l'histoire du pyrénéisme, cette ascension fut réalisée sous la conduite d'un guide de Gavarnie, grimpeur doué et prestigieux. Très fier de cet exploit, Célestin répétait volontiers que personne après lui ne le referait : « J’ai gardé la clé », disait-il. De fait, l’ascension du couloir de Gaube ne fut réitérée avec succès que quarante-quatre ans plus tard, par Henri Barrio, Joseph Aussat et Joseph Loustaunau, le 13 juillet 1933. En 1895, Célestin réalise la première de la face nord du Taillon, avec Henri Brulle. Peu bavard, presque distant, d’une grande élégance, impassible dans les pires situations, Célestin est resté un paysan, dont le métier est toujours cultivateur à Gavarnie. Mais son expérience fait qu’il peut être un brillant causeur qu’on aime écouter. Guide hors pair, sa réputation est telle qu’il est très demandé, et qu’il réalise de nombreuses courses, non seulement dans les Pyrénées, mais aussi dans d’autres massifs. Le chasseur anglais Buxton, qu’il conduit pour chasser le bouquetin en Espagne, l’invite à Londres pour chasser le renard. Sa réputation dépasse le petit cadre de Gavarnie ; il voyage à travers le monde, accompagnant ses nombreux clients. Il va ascensionner en Afrique du Nord, en Éthiopie, au Sinaï, en Crète, en Sardaigne, dans le Caucase, en Asie ... Il accompagne au Vignemale et au Mont Perdu l’alpiniste vainqueur du Cervin et graveur anglais Edward Whymper, qui a laissé un portrait de lui, et qui lui propose d’aller escalader avec lui le Chimborazo, dans les Andes. Mais Célestin décline l’offre pour rester auprès de sa mère et des quelques biens qu’il possède à Gavarnie. Durant 32 ans (de 1878 à 1910), il effectua un nombre impressionnant de premières. Très demandé comme son cousin Henri, avec qui il reçoit en 1890, la grande médaille du Club alpin français. Tous les grands Pyrénéistes se l’arrachent. : Henry Russell, Henri Brulle, Jean Bazillac, René d’Astorg, Jean d'Ussel, le comte de Saint-Saud ... Pourtant, il ne sera reconnu comme guide par l’administration qu’en 1901. Célestin Passet meurt en 1917 d’une attaque de paralysie. Sa maison, au centre du village, où il vivait avec son gendre Castagné devint l’hôtel Mourgat. Il est enterré au cimetière de Gavarnie, dans le carré des pyrénéistes. Deux textes à sa mémoire ont été écrits par Henri Brulle. Henry Russel l’avait surnommé l’isard bipède, vu ses aptitudes à l’escalade. En Catalogne, au massif du Besiberri, il y a un sommet dédié à Célestin Passet, la Punta de Passet. L’on peut dire que le pyrénéisme de difficulté est né avec lui. Un palmarès qui regroupe environ quatre-vingts "premières". Les générations suivantes seront moins brillantes : la diminution de la demande de guides de la part des grimpeurs, et un certain désintérêt des touristes y sont pour beaucoup. Les nouveaux guides ne sont plus des paysans, mais des citadins qui ont acquis des notions de pédagogie. Le fils d’Henri, Pierre Passet, a été tué en 1917. Désormais ce sont les gendres qui assureront la continuité : Cumia, gendre d’Henri, Theil et Germain Castagné, gendres de Célestin. Célestin Passet, un nom à jamais lié aux Pyrénées et un guide qui amène ses clients au bout de l'impossible. Le maître à tous. Également chasseur, il n'avait pas son pareil pour tirer l'isard. Tant il était apprécié, il fut ainsi convié à faire des courses et des chasses bien au-delà des Pyrénées. Un livre écrit par François Labadens lui est entièrement consacré sous le titre : Célestin Passet, un guide aux Pyrénées, aux éditions MonHélios, 2015. Ce sont les récits de ces courses de l'impossible que nous relate François Labadens en nous expliquant comment ce guide œuvrait pour parvenir à ses fins.
Célestin PASSET est né à Gavarnie en 1845. Fils aîné d’Hippolyte et donc cousin germain d’Henri Passet (1845-1920), Célestin se révélera un des meilleurs guides du moment. En 1870, il épouse Justine Trescazes, de Sers, avec qui il aura trois filles et un garçon. Sa carrière montagnarde commence à l’âge de 27 ans. Chasseur, guide de montagne réputé, il accompagna à de nombreuses reprises Henry Russel, Franz Schrader, Jean Bazillac, Henri Brulle et Roger de Monts. En 1871, il accompagne Russell au Mont Perdu (3355m), par la brèche de Roland. En 1872, il trouve avec le même Russell un nouvel itinéraire vers le Mont Perdu, par les Rochers Blancs et l’Astazou, le lac Glacé, ce qu’on appellera la « terrasse Russell » et le col du Cylindre. Puis, ils font la première des Gourgs blancs et du pic qui portera plus tard le nom de Jean Arlaud. Entre 1872 et 1879, il réalise avec Russell les premières du Gabiétou par l’est, le pic des Tempêtes, le pic occidental de la Maladetta. Le 11 août 1878, en compagnie de Franz Schrader, il réalise la première ascension connue du Grand Batchimale (3177m), rebaptisé par la suite pic Schrader. En 1880, il réalise la première hivernale des Posets, avec Roger de Monts. En 1882, la première du Comaloforno avec Henri Brulle et Jean Bazillac. Le 26 juillet 1883, avec les guides de l’Oisans Gaspard père et fils et Henri Brulle, ils font la cinquième ascension de la Meije (première ascension en un jour). Cette même année, ils ascensionnent également les Écrins, l’Aiguille d’Arves, le Mont Blanc. En 1884, faisant équipe avec Henri Brulle, ils accomplissent un grand nombre de courses nouvelles dans les Alpes : Aiguille méridionale d’Arves, Dent Parrachée, Grande Casse, Grand paradis, Mont Blanc, Cervin, Dent Blanche, quatrième ascension des Drus (première en un jour depuis Chamonix). En 1887, le Pic entre les brèches, qui deviendra Pic Bazillac, avec Jean Bazillac, et le Doigt de la Fausse Brèche, avec Brulle et Bazillac. Toujours en 1887 la première du Mur de la Cascade avec Jean Bazillac et Roger de Monts. En 1888, la première de la face nord du Mont Perdu avec Roger de Monts et François Bernat-Salles. Le 6 août 1889, avec Henri Brulle, Roger de Monts, Jean Bazillac, et François Bernat-Salles, il ouvre l’ère du pyrénéisme moderne en réussissant la première du couloir de Gaube, sur le Vignemale. Bloqués dans cette faille étroite et gelée, sous l’imposant bloc coincé, Célestin taille plus de 1300 marches dans la glace avec le piolet de Brulle, qui lui facilite la tâche et lui permet de sauver l’escalade. Un instrument qui recevra par la suite le nom désormais historique de « Fleur de Gaube ». Il lui faudra pourtant deux heures d'efforts pour franchir ce passage. Événement majeur de l'histoire du pyrénéisme, cette ascension fut réalisée sous la conduite d'un guide de Gavarnie, grimpeur doué et prestigieux. Très fier de cet exploit, Célestin répétait volontiers que personne après lui ne le referait : « J’ai gardé la clé », disait-il. De fait, l’ascension du couloir de Gaube ne fut réitérée avec succès que quarante-quatre ans plus tard, par Henri Barrio, Joseph Aussat et Joseph Loustaunau, le 13 juillet 1933. En 1895, Célestin réalise la première de la face nord du Taillon, avec Henri Brulle. Peu bavard, presque distant, d’une grande élégance, impassible dans les pires situations, Célestin est resté un paysan, dont le métier est toujours cultivateur à Gavarnie. Mais son expérience fait qu’il peut être un brillant causeur qu’on aime écouter. Guide hors pair, sa réputation est telle qu’il est très demandé, et qu’il réalise de nombreuses courses, non seulement dans les Pyrénées, mais aussi dans d’autres massifs. Le chasseur anglais Buxton, qu’il conduit pour chasser le bouquetin en Espagne, l’invite à Londres pour chasser le renard. Sa réputation dépasse le petit cadre de Gavarnie ; il voyage à travers le monde, accompagnant ses nombreux clients. Il va ascensionner en Afrique du Nord, en Éthiopie, au Sinaï, en Crète, en Sardaigne, dans le Caucase, en Asie ... Il accompagne au Vignemale et au Mont Perdu l’alpiniste vainqueur du Cervin et graveur anglais Edward Whymper, qui a laissé un portrait de lui, et qui lui propose d’aller escalader avec lui le Chimborazo, dans les Andes. Mais Célestin décline l’offre pour rester auprès de sa mère et des quelques biens qu’il possède à Gavarnie. Durant 32 ans (de 1878 à 1910), il effectua un nombre impressionnant de premières. Très demandé comme son cousin Henri, avec qui il reçoit en 1890, la grande médaille du Club alpin français. Tous les grands Pyrénéistes se l’arrachent. : Henry Russell, Henri Brulle, Jean Bazillac, René d’Astorg, Jean d'Ussel, le comte de Saint-Saud ... Pourtant, il ne sera reconnu comme guide par l’administration qu’en 1901. Célestin Passet meurt en 1917 d’une attaque de paralysie. Sa maison, au centre du village, où il vivait avec son gendre Castagné devint l’hôtel Mourgat. Il est enterré au cimetière de Gavarnie, dans le carré des pyrénéistes. Deux textes à sa mémoire ont été écrits par Henri Brulle. Henry Russel l’avait surnommé l’isard bipède, vu ses aptitudes à l’escalade. En Catalogne, au massif du Besiberri, il y a un sommet dédié à Célestin Passet, la Punta de Passet. L’on peut dire que le pyrénéisme de difficulté est né avec lui. Un palmarès qui regroupe environ quatre-vingts "premières". Les générations suivantes seront moins brillantes : la diminution de la demande de guides de la part des grimpeurs, et un certain désintérêt des touristes y sont pour beaucoup. Les nouveaux guides ne sont plus des paysans, mais des citadins qui ont acquis des notions de pédagogie. Le fils d’Henri, Pierre Passet, a été tué en 1917. Désormais ce sont les gendres qui assureront la continuité : Cumia, gendre d’Henri, Theil et Germain Castagné, gendres de Célestin. Célestin Passet, un nom à jamais lié aux Pyrénées et un guide qui amène ses clients au bout de l'impossible. Le maître à tous. Également chasseur, il n'avait pas son pareil pour tirer l'isard. Tant il était apprécié, il fut ainsi convié à faire des courses et des chasses bien au-delà des Pyrénées. Un livre écrit par François Labadens lui est entièrement consacré sous le titre : Célestin Passet, un guide aux Pyrénées, aux éditions MonHélios, 2015. Ce sont les récits de ces courses de l'impossible que nous relate François Labadens en nous expliquant comment ce guide œuvrait pour parvenir à ses fins.PAULHAN Jean (1884-1968)
Écrivain, critique littéraire et éditeur, auteur du livre « Les Fleurs de Tarbes ou La Terreur dans les Lettres »
 Jean PAULHAN, né à Nîmes dans le Gard le 2 décembre 1884 et mort à Neuilly-sur-Seine le 9 octobre 1968, à l’âge de 83 ans, est un écrivain, critique littéraire et éditeur. Il est successivement secrétaire puis rédacteur en chef et enfin gérant de La Nouvelle Revue française (NRF) de 1920 à 1968. Jean Paulhan étudie la psychologie française dans le sillage de Pierre Janet et de Georges Dumas. Il écrit dans des revues de philosophie, comme La Revue philosophique de la France et de l'étranger, ou de sciences sociales, comme Le Spectateur. Il fréquente assidûment les milieux anarchistes et s'intéresse déjà aux lieux communs et aux proverbes, thèmes auxquels il pense consacrer sa thèse. À la fin de 1907, il part pour Madagascar, colonie française, où il enseigne au lycée de Tananarive le français et le latin et parfois aussi la gymnastique. C'est là qu'il recueille des textes populaires malgaches, les hain-teny, qui prolongent sa réflexion sur la logique de l'échange. De retour en France à la fin de 1910, il donne des cours de langue malgache à l'École des Langues orientales. Jean Paulhan vivait par l’écriture et pour l’écriture. Il pouvait traiter les questions les plus complexes (rhétorique, peinture ou guerre), comme les plus futiles (pinces, encriers et bulles de savons). Il avait un style travaillé, clair et concis ; il est souvent considéré comme un auteur ayant peu écrit. En réalité, son œuvre, d’importance et de qualité, est beaucoup plus fournie qu’on ne le croit généralement. Il est allé beaucoup plus avant dans les relations essentielles de la Terreur et de la Littérature, et sur un plan beaucoup plus théorique, dans l’essai intitulé « Les Fleurs de Tarbes ou la Terreur dans les Lettres », publié en 1941 chez Gallimard, mais écrit bien avant cette date, en 1936. Un essai où Paulhan prend la défense du plus décrié de tous les arts : la rhétorique. Une période caractérisée par l’image d’un écriteau mentionné par l’auteur et qui figurait à l’entrée du jardin public de Tarbes, où il était écrit : « Il est défendu d’entrer dans le jardin avec des fleurs à la main ». « On le trouve aussi, de nos jours, à l'entrée de la Littérature. Pourtant, il serait agréable de voir les filles de Tarbes (et les jeunes écrivains) porter une rose, un coquelicot, une gerbe de coquelicots ». Quand Paulhan méditait et écrivait Les Fleurs de Tarbes. Ces fleurs, ce sont les fleurs de rhétorique, bien sûr. Et pourquoi Tarbes ? Parce qu'à l'entrée du parc de cette ville se trouvait cet écriteau. Ainsi l'était-il d'entrer dans le jardin des Lettres. Cette interdiction remontait à quand ? Au tout début du XIXe siècle, sans doute. Le 24 janvier 1963, Jean Paulhan est élu membre de l'Académie française. Auteur, il est vrai, assez abscons des Fleurs de Tarbes, il fut surtout une éminence grise du monde intellectuel du second XXème siècle, et le puissant patron de la NRF.
Jean PAULHAN, né à Nîmes dans le Gard le 2 décembre 1884 et mort à Neuilly-sur-Seine le 9 octobre 1968, à l’âge de 83 ans, est un écrivain, critique littéraire et éditeur. Il est successivement secrétaire puis rédacteur en chef et enfin gérant de La Nouvelle Revue française (NRF) de 1920 à 1968. Jean Paulhan étudie la psychologie française dans le sillage de Pierre Janet et de Georges Dumas. Il écrit dans des revues de philosophie, comme La Revue philosophique de la France et de l'étranger, ou de sciences sociales, comme Le Spectateur. Il fréquente assidûment les milieux anarchistes et s'intéresse déjà aux lieux communs et aux proverbes, thèmes auxquels il pense consacrer sa thèse. À la fin de 1907, il part pour Madagascar, colonie française, où il enseigne au lycée de Tananarive le français et le latin et parfois aussi la gymnastique. C'est là qu'il recueille des textes populaires malgaches, les hain-teny, qui prolongent sa réflexion sur la logique de l'échange. De retour en France à la fin de 1910, il donne des cours de langue malgache à l'École des Langues orientales. Jean Paulhan vivait par l’écriture et pour l’écriture. Il pouvait traiter les questions les plus complexes (rhétorique, peinture ou guerre), comme les plus futiles (pinces, encriers et bulles de savons). Il avait un style travaillé, clair et concis ; il est souvent considéré comme un auteur ayant peu écrit. En réalité, son œuvre, d’importance et de qualité, est beaucoup plus fournie qu’on ne le croit généralement. Il est allé beaucoup plus avant dans les relations essentielles de la Terreur et de la Littérature, et sur un plan beaucoup plus théorique, dans l’essai intitulé « Les Fleurs de Tarbes ou la Terreur dans les Lettres », publié en 1941 chez Gallimard, mais écrit bien avant cette date, en 1936. Un essai où Paulhan prend la défense du plus décrié de tous les arts : la rhétorique. Une période caractérisée par l’image d’un écriteau mentionné par l’auteur et qui figurait à l’entrée du jardin public de Tarbes, où il était écrit : « Il est défendu d’entrer dans le jardin avec des fleurs à la main ». « On le trouve aussi, de nos jours, à l'entrée de la Littérature. Pourtant, il serait agréable de voir les filles de Tarbes (et les jeunes écrivains) porter une rose, un coquelicot, une gerbe de coquelicots ». Quand Paulhan méditait et écrivait Les Fleurs de Tarbes. Ces fleurs, ce sont les fleurs de rhétorique, bien sûr. Et pourquoi Tarbes ? Parce qu'à l'entrée du parc de cette ville se trouvait cet écriteau. Ainsi l'était-il d'entrer dans le jardin des Lettres. Cette interdiction remontait à quand ? Au tout début du XIXe siècle, sans doute. Le 24 janvier 1963, Jean Paulhan est élu membre de l'Académie française. Auteur, il est vrai, assez abscons des Fleurs de Tarbes, il fut surtout une éminence grise du monde intellectuel du second XXème siècle, et le puissant patron de la NRF.
 Jean PAULHAN, né à Nîmes dans le Gard le 2 décembre 1884 et mort à Neuilly-sur-Seine le 9 octobre 1968, à l’âge de 83 ans, est un écrivain, critique littéraire et éditeur. Il est successivement secrétaire puis rédacteur en chef et enfin gérant de La Nouvelle Revue française (NRF) de 1920 à 1968. Jean Paulhan étudie la psychologie française dans le sillage de Pierre Janet et de Georges Dumas. Il écrit dans des revues de philosophie, comme La Revue philosophique de la France et de l'étranger, ou de sciences sociales, comme Le Spectateur. Il fréquente assidûment les milieux anarchistes et s'intéresse déjà aux lieux communs et aux proverbes, thèmes auxquels il pense consacrer sa thèse. À la fin de 1907, il part pour Madagascar, colonie française, où il enseigne au lycée de Tananarive le français et le latin et parfois aussi la gymnastique. C'est là qu'il recueille des textes populaires malgaches, les hain-teny, qui prolongent sa réflexion sur la logique de l'échange. De retour en France à la fin de 1910, il donne des cours de langue malgache à l'École des Langues orientales. Jean Paulhan vivait par l’écriture et pour l’écriture. Il pouvait traiter les questions les plus complexes (rhétorique, peinture ou guerre), comme les plus futiles (pinces, encriers et bulles de savons). Il avait un style travaillé, clair et concis ; il est souvent considéré comme un auteur ayant peu écrit. En réalité, son œuvre, d’importance et de qualité, est beaucoup plus fournie qu’on ne le croit généralement. Il est allé beaucoup plus avant dans les relations essentielles de la Terreur et de la Littérature, et sur un plan beaucoup plus théorique, dans l’essai intitulé « Les Fleurs de Tarbes ou la Terreur dans les Lettres », publié en 1941 chez Gallimard, mais écrit bien avant cette date, en 1936. Un essai où Paulhan prend la défense du plus décrié de tous les arts : la rhétorique. Une période caractérisée par l’image d’un écriteau mentionné par l’auteur et qui figurait à l’entrée du jardin public de Tarbes, où il était écrit : « Il est défendu d’entrer dans le jardin avec des fleurs à la main ». « On le trouve aussi, de nos jours, à l'entrée de la Littérature. Pourtant, il serait agréable de voir les filles de Tarbes (et les jeunes écrivains) porter une rose, un coquelicot, une gerbe de coquelicots ». Quand Paulhan méditait et écrivait Les Fleurs de Tarbes. Ces fleurs, ce sont les fleurs de rhétorique, bien sûr. Et pourquoi Tarbes ? Parce qu'à l'entrée du parc de cette ville se trouvait cet écriteau. Ainsi l'était-il d'entrer dans le jardin des Lettres. Cette interdiction remontait à quand ? Au tout début du XIXe siècle, sans doute. Le 24 janvier 1963, Jean Paulhan est élu membre de l'Académie française. Auteur, il est vrai, assez abscons des Fleurs de Tarbes, il fut surtout une éminence grise du monde intellectuel du second XXème siècle, et le puissant patron de la NRF.
Jean PAULHAN, né à Nîmes dans le Gard le 2 décembre 1884 et mort à Neuilly-sur-Seine le 9 octobre 1968, à l’âge de 83 ans, est un écrivain, critique littéraire et éditeur. Il est successivement secrétaire puis rédacteur en chef et enfin gérant de La Nouvelle Revue française (NRF) de 1920 à 1968. Jean Paulhan étudie la psychologie française dans le sillage de Pierre Janet et de Georges Dumas. Il écrit dans des revues de philosophie, comme La Revue philosophique de la France et de l'étranger, ou de sciences sociales, comme Le Spectateur. Il fréquente assidûment les milieux anarchistes et s'intéresse déjà aux lieux communs et aux proverbes, thèmes auxquels il pense consacrer sa thèse. À la fin de 1907, il part pour Madagascar, colonie française, où il enseigne au lycée de Tananarive le français et le latin et parfois aussi la gymnastique. C'est là qu'il recueille des textes populaires malgaches, les hain-teny, qui prolongent sa réflexion sur la logique de l'échange. De retour en France à la fin de 1910, il donne des cours de langue malgache à l'École des Langues orientales. Jean Paulhan vivait par l’écriture et pour l’écriture. Il pouvait traiter les questions les plus complexes (rhétorique, peinture ou guerre), comme les plus futiles (pinces, encriers et bulles de savons). Il avait un style travaillé, clair et concis ; il est souvent considéré comme un auteur ayant peu écrit. En réalité, son œuvre, d’importance et de qualité, est beaucoup plus fournie qu’on ne le croit généralement. Il est allé beaucoup plus avant dans les relations essentielles de la Terreur et de la Littérature, et sur un plan beaucoup plus théorique, dans l’essai intitulé « Les Fleurs de Tarbes ou la Terreur dans les Lettres », publié en 1941 chez Gallimard, mais écrit bien avant cette date, en 1936. Un essai où Paulhan prend la défense du plus décrié de tous les arts : la rhétorique. Une période caractérisée par l’image d’un écriteau mentionné par l’auteur et qui figurait à l’entrée du jardin public de Tarbes, où il était écrit : « Il est défendu d’entrer dans le jardin avec des fleurs à la main ». « On le trouve aussi, de nos jours, à l'entrée de la Littérature. Pourtant, il serait agréable de voir les filles de Tarbes (et les jeunes écrivains) porter une rose, un coquelicot, une gerbe de coquelicots ». Quand Paulhan méditait et écrivait Les Fleurs de Tarbes. Ces fleurs, ce sont les fleurs de rhétorique, bien sûr. Et pourquoi Tarbes ? Parce qu'à l'entrée du parc de cette ville se trouvait cet écriteau. Ainsi l'était-il d'entrer dans le jardin des Lettres. Cette interdiction remontait à quand ? Au tout début du XIXe siècle, sans doute. Le 24 janvier 1963, Jean Paulhan est élu membre de l'Académie française. Auteur, il est vrai, assez abscons des Fleurs de Tarbes, il fut surtout une éminence grise du monde intellectuel du second XXème siècle, et le puissant patron de la NRF.PONCET Tony (1918-1979)
Grand ténor de l'Opéra surnommé le « Bombardier basque »
 Tony PONCET, né Antonio José Ponce Miròn le 23 décembre 1918 à Maria, près d'Almería en Espagne et mort le 13 novembre 1979 à Libourne, à l’âge de 60 ans. Le jeune Antonio José s'installe avec sa famille à Bagnères-de-Bigorre en 1922 et prend le nom d'Antoine Poncé. Scolarité médiocre, pauvreté qui l’oblige très tôt à divers travaux manuels. Dès l’âge de 15 ans, en 1933, il commence à chanter en amateur dans un chœur appelé « Les Chanteurs montagnards d'Alfred Roland » fondé en 1838. C’était un homme de petite taille 1m58 avec une carrure de rugbyman. À la déclaration de guerre, bien que non mobilisable puisque ressortissant espagnol, il s’engage volontairement dans la Légion étrangère. Grièvement blessé dans la Somme, en mai 1940 et fait prisonnier, il fera cinq ans de stalag en Bavière et deux tentatives d’évasion. Le chef de camp remarque sa voix et lui propose d’apprendre la musique au Mozarteum de Salzbourg. Il refuse : « Je fais partie d’un pays où les hommes sont fiers et chez moi, mon père s’il apprenait que j’ai chanté pour vous, je crois qu’il me donnerait un coup de fusil. Je l'aurais bien mérité. » Naturalisé français, celui qui est devenu Antoine Poncet entre au Conservatoire de Paris en 1947, où il étudie avec Fernand Francell et Louise Vullermos et où il côtoie Gabriel Bacquier, Michel Sénéchal, Michel Roux, Liliane Berton. Il fait des petits boulots de nuit pour vivre ou participe aux chœurs des spectacles d’André Dassary ou de Luis Mariano. Il fait ses débuts en concert à Lyon en 1953, puis chante à Avignon dans les rôles de Turridu dans Cavalleria rusticana et Canio dans Paillasse qui restera son rôle fétiche. À 36 ans, en 1954, il participe et gagne le premier prix à un concours de ténors à Cannes, ex-æquo avec Gustave Botiaux, Roger Gardes, Alain Vanzo et Guy Chauvet, obtenant une mention spéciale. La finale diffusée en direct à la radio, permet à Tony Poncet de se faire connaître de la France entière dans le redoutable Di quella pira. Puis il part en tournée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. À son retour, il connait ses premiers grands succès en Belgique, notamment à Gand, Liège et Bruxelles. Il fait ses débuts à l'Opéra-Comique de Paris et au Palais Garnier, où on le voit dans le Chanteur Italien du Chevalier à la Rose ou le Rodolphe de La Bohème, et où il s'impose en 1958 dans les rôles de ténor héroïque tels Arnold dans Guillaume Tell, qu'il chanta près de 90 fois, Éléazar dans La Juive, Raoul dans Les Huguenots, Fernand dans La Favorite, Vasco de Gama dans L'Africaine, Don José dans Carmen, Jean dans Hérodiade. Il chante aussi le répertoire italien, Il trovatore, Aïda, Tosca, Cavalleria rusticana, et surtout Canio dans Pagliacci, qu'il chanta environ 200 fois et joua aussi pour la première chaîne de télévision française. On le vit également sur le petit écran, en 1960, dans Angélique de Jacques Ibert et dans la production De Béthune au chat noir en 1974, et au cinéma dans La Pendule à Salomon de Vicky Ivernel en 1961. Paris ne programmant plus guère ses rôles favoris, il claque la porte des théâtres nationaux et chantera désormais essentiellement en Province, en Belgique et en Afrique du Nord : c’est à Alger qu’il chante son premier Radamès en 1960. Il se produisit dans un très grand nombre de concerts et de récitals. Ses activités l'amenèrent à chanter dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, où il fut invité à chanter Les Huguenots au Carnegie Hall en 1969, année où il se marie, aux côtés de Beverly Sills. On peut également noter qu'à l'occasion de ces spectacles, il enrichit son répertoire d'airs qui n'y figuraient pas auparavant, dont par exemple La Force du destin de Verdi, ainsi qu'en témoignent quelques enregistrements en direct datant de cette période. En 1971, sa santé, devenue précaire, le contraignit à abandonner progressivement le théâtre. Il fut très affecté d’avoir été écarté de l’Opéra de Paris par son nouveau directeur Rolf Liebermann. Sa dernière apparition à l'opéra eut lieu au Capitole à Toulouse en 1974, mais il continua néanmoins à se produire en concert, pratiquement jusqu'à la fin de ses jours. Il meurt d'un cancer à Libourne le 13 novembre 1979, à l'âge de 60 ans. Il repose à Saint-Aigulin, en Charente-Maritime, dans son costume d’Arnold. Un théâtre y porte son nom. Selon Alain Pâris, « sa voix puissante, aux aigus ahurissants, préfère aux nuances les éclats de la vaillance. » En reconnaissance de son attitude héroïque pendant la Seconde Guerre mondiale, comme ancien combattant français, prisonnier de guerre, ce patriote a reçu de nombreuses distinctions militaires : la croix de guerre, la médaille militaire, la croix du combattant de l'Europe, la croix du combattant volontaire, la médaille des engagés volontaires, la médaille des blessés de guerre, la médaille commémorative de la guerre 39/45 ainsi que la Presidential Medal of Freedom américaine. Il était aussi, à titre artistique, chevalier de la Légion d'honneur et des Arts et Lettres. Une stèle et une promenade en bord de fleuve commémorent sa mémoire dans la ville de Bagnères-de-Bigorre, où il passa son adolescence. En 2009, pour la commémoration des 30 ans de la disparition de l'artiste, une exposition est organisée dans la ville de Vauvert et une biographie est éditée. Sa fille, Mathilde Poncé, qui n’avait que dix ans au décès de son père, a publié en décembre 2009, à cette occasion, aux Editions L’Harmattan : « Tony Poncet, Ténor de l'Opéra, une Voix, un destin ». À chaque date anniversaire, est organisée à Saint-Aigulin, village charentais où repose le ténor, une évocation réalisée à partir de documents audiovisuels. Sans complexe, Tony Poncet se comparait aux plus grands, du passé et du présent, considérant avec fierté qu’il avait « deux notes d’aigu de plus » que chacun d’entre eux, y compris Caruso. Il mettait un point d’honneur à interpréter tous les ouvrages dans la tessiture originale, faisant remarquer qu’aucun ténor que l’on classe parmi les plus grands, Mario del Monaco, Giuseppe Di Stefano, Franco Corelli, ne chante dans le ton. Il rêvait de rencontrer les dix meilleurs ténors italiens et de les prendre un par un. Alors on verra bien celui qui chante et ceux qui vocalisent. Il ajoutait qu’il n’y avait eu que trois ténors en France : « Vezzani, Luccioni et…Poncet. » S’il était parfois d’une franchise peu diplomatique, il n’écrasait jamais ses partenaires. Les auditeurs étaient sensibles à cette sincérité et succombaient au charme d’une voix naturelle, à l’émission saine, qui s’était mesurée aux grondements du Gave et aux espaces des cirques pyrénéens. Triomphes, ovations, débordements d’enthousiasme ont accompagné tout au long de sa carrière un ténor qui ne manquait pas de caractère et possédait une voix capable de se mesurer avec les plus grands. De son enfance, entre gaves et sommets, Tony Poncet conserva un accent rocailleux, une rugosité dans le ton qui lui faisait dire : « Je parle comme coulent les torrents des Pyrénées où j'ai grandi ».
Tony PONCET, né Antonio José Ponce Miròn le 23 décembre 1918 à Maria, près d'Almería en Espagne et mort le 13 novembre 1979 à Libourne, à l’âge de 60 ans. Le jeune Antonio José s'installe avec sa famille à Bagnères-de-Bigorre en 1922 et prend le nom d'Antoine Poncé. Scolarité médiocre, pauvreté qui l’oblige très tôt à divers travaux manuels. Dès l’âge de 15 ans, en 1933, il commence à chanter en amateur dans un chœur appelé « Les Chanteurs montagnards d'Alfred Roland » fondé en 1838. C’était un homme de petite taille 1m58 avec une carrure de rugbyman. À la déclaration de guerre, bien que non mobilisable puisque ressortissant espagnol, il s’engage volontairement dans la Légion étrangère. Grièvement blessé dans la Somme, en mai 1940 et fait prisonnier, il fera cinq ans de stalag en Bavière et deux tentatives d’évasion. Le chef de camp remarque sa voix et lui propose d’apprendre la musique au Mozarteum de Salzbourg. Il refuse : « Je fais partie d’un pays où les hommes sont fiers et chez moi, mon père s’il apprenait que j’ai chanté pour vous, je crois qu’il me donnerait un coup de fusil. Je l'aurais bien mérité. » Naturalisé français, celui qui est devenu Antoine Poncet entre au Conservatoire de Paris en 1947, où il étudie avec Fernand Francell et Louise Vullermos et où il côtoie Gabriel Bacquier, Michel Sénéchal, Michel Roux, Liliane Berton. Il fait des petits boulots de nuit pour vivre ou participe aux chœurs des spectacles d’André Dassary ou de Luis Mariano. Il fait ses débuts en concert à Lyon en 1953, puis chante à Avignon dans les rôles de Turridu dans Cavalleria rusticana et Canio dans Paillasse qui restera son rôle fétiche. À 36 ans, en 1954, il participe et gagne le premier prix à un concours de ténors à Cannes, ex-æquo avec Gustave Botiaux, Roger Gardes, Alain Vanzo et Guy Chauvet, obtenant une mention spéciale. La finale diffusée en direct à la radio, permet à Tony Poncet de se faire connaître de la France entière dans le redoutable Di quella pira. Puis il part en tournée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. À son retour, il connait ses premiers grands succès en Belgique, notamment à Gand, Liège et Bruxelles. Il fait ses débuts à l'Opéra-Comique de Paris et au Palais Garnier, où on le voit dans le Chanteur Italien du Chevalier à la Rose ou le Rodolphe de La Bohème, et où il s'impose en 1958 dans les rôles de ténor héroïque tels Arnold dans Guillaume Tell, qu'il chanta près de 90 fois, Éléazar dans La Juive, Raoul dans Les Huguenots, Fernand dans La Favorite, Vasco de Gama dans L'Africaine, Don José dans Carmen, Jean dans Hérodiade. Il chante aussi le répertoire italien, Il trovatore, Aïda, Tosca, Cavalleria rusticana, et surtout Canio dans Pagliacci, qu'il chanta environ 200 fois et joua aussi pour la première chaîne de télévision française. On le vit également sur le petit écran, en 1960, dans Angélique de Jacques Ibert et dans la production De Béthune au chat noir en 1974, et au cinéma dans La Pendule à Salomon de Vicky Ivernel en 1961. Paris ne programmant plus guère ses rôles favoris, il claque la porte des théâtres nationaux et chantera désormais essentiellement en Province, en Belgique et en Afrique du Nord : c’est à Alger qu’il chante son premier Radamès en 1960. Il se produisit dans un très grand nombre de concerts et de récitals. Ses activités l'amenèrent à chanter dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, où il fut invité à chanter Les Huguenots au Carnegie Hall en 1969, année où il se marie, aux côtés de Beverly Sills. On peut également noter qu'à l'occasion de ces spectacles, il enrichit son répertoire d'airs qui n'y figuraient pas auparavant, dont par exemple La Force du destin de Verdi, ainsi qu'en témoignent quelques enregistrements en direct datant de cette période. En 1971, sa santé, devenue précaire, le contraignit à abandonner progressivement le théâtre. Il fut très affecté d’avoir été écarté de l’Opéra de Paris par son nouveau directeur Rolf Liebermann. Sa dernière apparition à l'opéra eut lieu au Capitole à Toulouse en 1974, mais il continua néanmoins à se produire en concert, pratiquement jusqu'à la fin de ses jours. Il meurt d'un cancer à Libourne le 13 novembre 1979, à l'âge de 60 ans. Il repose à Saint-Aigulin, en Charente-Maritime, dans son costume d’Arnold. Un théâtre y porte son nom. Selon Alain Pâris, « sa voix puissante, aux aigus ahurissants, préfère aux nuances les éclats de la vaillance. » En reconnaissance de son attitude héroïque pendant la Seconde Guerre mondiale, comme ancien combattant français, prisonnier de guerre, ce patriote a reçu de nombreuses distinctions militaires : la croix de guerre, la médaille militaire, la croix du combattant de l'Europe, la croix du combattant volontaire, la médaille des engagés volontaires, la médaille des blessés de guerre, la médaille commémorative de la guerre 39/45 ainsi que la Presidential Medal of Freedom américaine. Il était aussi, à titre artistique, chevalier de la Légion d'honneur et des Arts et Lettres. Une stèle et une promenade en bord de fleuve commémorent sa mémoire dans la ville de Bagnères-de-Bigorre, où il passa son adolescence. En 2009, pour la commémoration des 30 ans de la disparition de l'artiste, une exposition est organisée dans la ville de Vauvert et une biographie est éditée. Sa fille, Mathilde Poncé, qui n’avait que dix ans au décès de son père, a publié en décembre 2009, à cette occasion, aux Editions L’Harmattan : « Tony Poncet, Ténor de l'Opéra, une Voix, un destin ». À chaque date anniversaire, est organisée à Saint-Aigulin, village charentais où repose le ténor, une évocation réalisée à partir de documents audiovisuels. Sans complexe, Tony Poncet se comparait aux plus grands, du passé et du présent, considérant avec fierté qu’il avait « deux notes d’aigu de plus » que chacun d’entre eux, y compris Caruso. Il mettait un point d’honneur à interpréter tous les ouvrages dans la tessiture originale, faisant remarquer qu’aucun ténor que l’on classe parmi les plus grands, Mario del Monaco, Giuseppe Di Stefano, Franco Corelli, ne chante dans le ton. Il rêvait de rencontrer les dix meilleurs ténors italiens et de les prendre un par un. Alors on verra bien celui qui chante et ceux qui vocalisent. Il ajoutait qu’il n’y avait eu que trois ténors en France : « Vezzani, Luccioni et…Poncet. » S’il était parfois d’une franchise peu diplomatique, il n’écrasait jamais ses partenaires. Les auditeurs étaient sensibles à cette sincérité et succombaient au charme d’une voix naturelle, à l’émission saine, qui s’était mesurée aux grondements du Gave et aux espaces des cirques pyrénéens. Triomphes, ovations, débordements d’enthousiasme ont accompagné tout au long de sa carrière un ténor qui ne manquait pas de caractère et possédait une voix capable de se mesurer avec les plus grands. De son enfance, entre gaves et sommets, Tony Poncet conserva un accent rocailleux, une rugosité dans le ton qui lui faisait dire : « Je parle comme coulent les torrents des Pyrénées où j'ai grandi ».
 Tony PONCET, né Antonio José Ponce Miròn le 23 décembre 1918 à Maria, près d'Almería en Espagne et mort le 13 novembre 1979 à Libourne, à l’âge de 60 ans. Le jeune Antonio José s'installe avec sa famille à Bagnères-de-Bigorre en 1922 et prend le nom d'Antoine Poncé. Scolarité médiocre, pauvreté qui l’oblige très tôt à divers travaux manuels. Dès l’âge de 15 ans, en 1933, il commence à chanter en amateur dans un chœur appelé « Les Chanteurs montagnards d'Alfred Roland » fondé en 1838. C’était un homme de petite taille 1m58 avec une carrure de rugbyman. À la déclaration de guerre, bien que non mobilisable puisque ressortissant espagnol, il s’engage volontairement dans la Légion étrangère. Grièvement blessé dans la Somme, en mai 1940 et fait prisonnier, il fera cinq ans de stalag en Bavière et deux tentatives d’évasion. Le chef de camp remarque sa voix et lui propose d’apprendre la musique au Mozarteum de Salzbourg. Il refuse : « Je fais partie d’un pays où les hommes sont fiers et chez moi, mon père s’il apprenait que j’ai chanté pour vous, je crois qu’il me donnerait un coup de fusil. Je l'aurais bien mérité. » Naturalisé français, celui qui est devenu Antoine Poncet entre au Conservatoire de Paris en 1947, où il étudie avec Fernand Francell et Louise Vullermos et où il côtoie Gabriel Bacquier, Michel Sénéchal, Michel Roux, Liliane Berton. Il fait des petits boulots de nuit pour vivre ou participe aux chœurs des spectacles d’André Dassary ou de Luis Mariano. Il fait ses débuts en concert à Lyon en 1953, puis chante à Avignon dans les rôles de Turridu dans Cavalleria rusticana et Canio dans Paillasse qui restera son rôle fétiche. À 36 ans, en 1954, il participe et gagne le premier prix à un concours de ténors à Cannes, ex-æquo avec Gustave Botiaux, Roger Gardes, Alain Vanzo et Guy Chauvet, obtenant une mention spéciale. La finale diffusée en direct à la radio, permet à Tony Poncet de se faire connaître de la France entière dans le redoutable Di quella pira. Puis il part en tournée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. À son retour, il connait ses premiers grands succès en Belgique, notamment à Gand, Liège et Bruxelles. Il fait ses débuts à l'Opéra-Comique de Paris et au Palais Garnier, où on le voit dans le Chanteur Italien du Chevalier à la Rose ou le Rodolphe de La Bohème, et où il s'impose en 1958 dans les rôles de ténor héroïque tels Arnold dans Guillaume Tell, qu'il chanta près de 90 fois, Éléazar dans La Juive, Raoul dans Les Huguenots, Fernand dans La Favorite, Vasco de Gama dans L'Africaine, Don José dans Carmen, Jean dans Hérodiade. Il chante aussi le répertoire italien, Il trovatore, Aïda, Tosca, Cavalleria rusticana, et surtout Canio dans Pagliacci, qu'il chanta environ 200 fois et joua aussi pour la première chaîne de télévision française. On le vit également sur le petit écran, en 1960, dans Angélique de Jacques Ibert et dans la production De Béthune au chat noir en 1974, et au cinéma dans La Pendule à Salomon de Vicky Ivernel en 1961. Paris ne programmant plus guère ses rôles favoris, il claque la porte des théâtres nationaux et chantera désormais essentiellement en Province, en Belgique et en Afrique du Nord : c’est à Alger qu’il chante son premier Radamès en 1960. Il se produisit dans un très grand nombre de concerts et de récitals. Ses activités l'amenèrent à chanter dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, où il fut invité à chanter Les Huguenots au Carnegie Hall en 1969, année où il se marie, aux côtés de Beverly Sills. On peut également noter qu'à l'occasion de ces spectacles, il enrichit son répertoire d'airs qui n'y figuraient pas auparavant, dont par exemple La Force du destin de Verdi, ainsi qu'en témoignent quelques enregistrements en direct datant de cette période. En 1971, sa santé, devenue précaire, le contraignit à abandonner progressivement le théâtre. Il fut très affecté d’avoir été écarté de l’Opéra de Paris par son nouveau directeur Rolf Liebermann. Sa dernière apparition à l'opéra eut lieu au Capitole à Toulouse en 1974, mais il continua néanmoins à se produire en concert, pratiquement jusqu'à la fin de ses jours. Il meurt d'un cancer à Libourne le 13 novembre 1979, à l'âge de 60 ans. Il repose à Saint-Aigulin, en Charente-Maritime, dans son costume d’Arnold. Un théâtre y porte son nom. Selon Alain Pâris, « sa voix puissante, aux aigus ahurissants, préfère aux nuances les éclats de la vaillance. » En reconnaissance de son attitude héroïque pendant la Seconde Guerre mondiale, comme ancien combattant français, prisonnier de guerre, ce patriote a reçu de nombreuses distinctions militaires : la croix de guerre, la médaille militaire, la croix du combattant de l'Europe, la croix du combattant volontaire, la médaille des engagés volontaires, la médaille des blessés de guerre, la médaille commémorative de la guerre 39/45 ainsi que la Presidential Medal of Freedom américaine. Il était aussi, à titre artistique, chevalier de la Légion d'honneur et des Arts et Lettres. Une stèle et une promenade en bord de fleuve commémorent sa mémoire dans la ville de Bagnères-de-Bigorre, où il passa son adolescence. En 2009, pour la commémoration des 30 ans de la disparition de l'artiste, une exposition est organisée dans la ville de Vauvert et une biographie est éditée. Sa fille, Mathilde Poncé, qui n’avait que dix ans au décès de son père, a publié en décembre 2009, à cette occasion, aux Editions L’Harmattan : « Tony Poncet, Ténor de l'Opéra, une Voix, un destin ». À chaque date anniversaire, est organisée à Saint-Aigulin, village charentais où repose le ténor, une évocation réalisée à partir de documents audiovisuels. Sans complexe, Tony Poncet se comparait aux plus grands, du passé et du présent, considérant avec fierté qu’il avait « deux notes d’aigu de plus » que chacun d’entre eux, y compris Caruso. Il mettait un point d’honneur à interpréter tous les ouvrages dans la tessiture originale, faisant remarquer qu’aucun ténor que l’on classe parmi les plus grands, Mario del Monaco, Giuseppe Di Stefano, Franco Corelli, ne chante dans le ton. Il rêvait de rencontrer les dix meilleurs ténors italiens et de les prendre un par un. Alors on verra bien celui qui chante et ceux qui vocalisent. Il ajoutait qu’il n’y avait eu que trois ténors en France : « Vezzani, Luccioni et…Poncet. » S’il était parfois d’une franchise peu diplomatique, il n’écrasait jamais ses partenaires. Les auditeurs étaient sensibles à cette sincérité et succombaient au charme d’une voix naturelle, à l’émission saine, qui s’était mesurée aux grondements du Gave et aux espaces des cirques pyrénéens. Triomphes, ovations, débordements d’enthousiasme ont accompagné tout au long de sa carrière un ténor qui ne manquait pas de caractère et possédait une voix capable de se mesurer avec les plus grands. De son enfance, entre gaves et sommets, Tony Poncet conserva un accent rocailleux, une rugosité dans le ton qui lui faisait dire : « Je parle comme coulent les torrents des Pyrénées où j'ai grandi ».
Tony PONCET, né Antonio José Ponce Miròn le 23 décembre 1918 à Maria, près d'Almería en Espagne et mort le 13 novembre 1979 à Libourne, à l’âge de 60 ans. Le jeune Antonio José s'installe avec sa famille à Bagnères-de-Bigorre en 1922 et prend le nom d'Antoine Poncé. Scolarité médiocre, pauvreté qui l’oblige très tôt à divers travaux manuels. Dès l’âge de 15 ans, en 1933, il commence à chanter en amateur dans un chœur appelé « Les Chanteurs montagnards d'Alfred Roland » fondé en 1838. C’était un homme de petite taille 1m58 avec une carrure de rugbyman. À la déclaration de guerre, bien que non mobilisable puisque ressortissant espagnol, il s’engage volontairement dans la Légion étrangère. Grièvement blessé dans la Somme, en mai 1940 et fait prisonnier, il fera cinq ans de stalag en Bavière et deux tentatives d’évasion. Le chef de camp remarque sa voix et lui propose d’apprendre la musique au Mozarteum de Salzbourg. Il refuse : « Je fais partie d’un pays où les hommes sont fiers et chez moi, mon père s’il apprenait que j’ai chanté pour vous, je crois qu’il me donnerait un coup de fusil. Je l'aurais bien mérité. » Naturalisé français, celui qui est devenu Antoine Poncet entre au Conservatoire de Paris en 1947, où il étudie avec Fernand Francell et Louise Vullermos et où il côtoie Gabriel Bacquier, Michel Sénéchal, Michel Roux, Liliane Berton. Il fait des petits boulots de nuit pour vivre ou participe aux chœurs des spectacles d’André Dassary ou de Luis Mariano. Il fait ses débuts en concert à Lyon en 1953, puis chante à Avignon dans les rôles de Turridu dans Cavalleria rusticana et Canio dans Paillasse qui restera son rôle fétiche. À 36 ans, en 1954, il participe et gagne le premier prix à un concours de ténors à Cannes, ex-æquo avec Gustave Botiaux, Roger Gardes, Alain Vanzo et Guy Chauvet, obtenant une mention spéciale. La finale diffusée en direct à la radio, permet à Tony Poncet de se faire connaître de la France entière dans le redoutable Di quella pira. Puis il part en tournée aux États-Unis, au Mexique et au Canada. À son retour, il connait ses premiers grands succès en Belgique, notamment à Gand, Liège et Bruxelles. Il fait ses débuts à l'Opéra-Comique de Paris et au Palais Garnier, où on le voit dans le Chanteur Italien du Chevalier à la Rose ou le Rodolphe de La Bohème, et où il s'impose en 1958 dans les rôles de ténor héroïque tels Arnold dans Guillaume Tell, qu'il chanta près de 90 fois, Éléazar dans La Juive, Raoul dans Les Huguenots, Fernand dans La Favorite, Vasco de Gama dans L'Africaine, Don José dans Carmen, Jean dans Hérodiade. Il chante aussi le répertoire italien, Il trovatore, Aïda, Tosca, Cavalleria rusticana, et surtout Canio dans Pagliacci, qu'il chanta environ 200 fois et joua aussi pour la première chaîne de télévision française. On le vit également sur le petit écran, en 1960, dans Angélique de Jacques Ibert et dans la production De Béthune au chat noir en 1974, et au cinéma dans La Pendule à Salomon de Vicky Ivernel en 1961. Paris ne programmant plus guère ses rôles favoris, il claque la porte des théâtres nationaux et chantera désormais essentiellement en Province, en Belgique et en Afrique du Nord : c’est à Alger qu’il chante son premier Radamès en 1960. Il se produisit dans un très grand nombre de concerts et de récitals. Ses activités l'amenèrent à chanter dans de nombreux pays, notamment aux États-Unis, où il fut invité à chanter Les Huguenots au Carnegie Hall en 1969, année où il se marie, aux côtés de Beverly Sills. On peut également noter qu'à l'occasion de ces spectacles, il enrichit son répertoire d'airs qui n'y figuraient pas auparavant, dont par exemple La Force du destin de Verdi, ainsi qu'en témoignent quelques enregistrements en direct datant de cette période. En 1971, sa santé, devenue précaire, le contraignit à abandonner progressivement le théâtre. Il fut très affecté d’avoir été écarté de l’Opéra de Paris par son nouveau directeur Rolf Liebermann. Sa dernière apparition à l'opéra eut lieu au Capitole à Toulouse en 1974, mais il continua néanmoins à se produire en concert, pratiquement jusqu'à la fin de ses jours. Il meurt d'un cancer à Libourne le 13 novembre 1979, à l'âge de 60 ans. Il repose à Saint-Aigulin, en Charente-Maritime, dans son costume d’Arnold. Un théâtre y porte son nom. Selon Alain Pâris, « sa voix puissante, aux aigus ahurissants, préfère aux nuances les éclats de la vaillance. » En reconnaissance de son attitude héroïque pendant la Seconde Guerre mondiale, comme ancien combattant français, prisonnier de guerre, ce patriote a reçu de nombreuses distinctions militaires : la croix de guerre, la médaille militaire, la croix du combattant de l'Europe, la croix du combattant volontaire, la médaille des engagés volontaires, la médaille des blessés de guerre, la médaille commémorative de la guerre 39/45 ainsi que la Presidential Medal of Freedom américaine. Il était aussi, à titre artistique, chevalier de la Légion d'honneur et des Arts et Lettres. Une stèle et une promenade en bord de fleuve commémorent sa mémoire dans la ville de Bagnères-de-Bigorre, où il passa son adolescence. En 2009, pour la commémoration des 30 ans de la disparition de l'artiste, une exposition est organisée dans la ville de Vauvert et une biographie est éditée. Sa fille, Mathilde Poncé, qui n’avait que dix ans au décès de son père, a publié en décembre 2009, à cette occasion, aux Editions L’Harmattan : « Tony Poncet, Ténor de l'Opéra, une Voix, un destin ». À chaque date anniversaire, est organisée à Saint-Aigulin, village charentais où repose le ténor, une évocation réalisée à partir de documents audiovisuels. Sans complexe, Tony Poncet se comparait aux plus grands, du passé et du présent, considérant avec fierté qu’il avait « deux notes d’aigu de plus » que chacun d’entre eux, y compris Caruso. Il mettait un point d’honneur à interpréter tous les ouvrages dans la tessiture originale, faisant remarquer qu’aucun ténor que l’on classe parmi les plus grands, Mario del Monaco, Giuseppe Di Stefano, Franco Corelli, ne chante dans le ton. Il rêvait de rencontrer les dix meilleurs ténors italiens et de les prendre un par un. Alors on verra bien celui qui chante et ceux qui vocalisent. Il ajoutait qu’il n’y avait eu que trois ténors en France : « Vezzani, Luccioni et…Poncet. » S’il était parfois d’une franchise peu diplomatique, il n’écrasait jamais ses partenaires. Les auditeurs étaient sensibles à cette sincérité et succombaient au charme d’une voix naturelle, à l’émission saine, qui s’était mesurée aux grondements du Gave et aux espaces des cirques pyrénéens. Triomphes, ovations, débordements d’enthousiasme ont accompagné tout au long de sa carrière un ténor qui ne manquait pas de caractère et possédait une voix capable de se mesurer avec les plus grands. De son enfance, entre gaves et sommets, Tony Poncet conserva un accent rocailleux, une rugosité dans le ton qui lui faisait dire : « Je parle comme coulent les torrents des Pyrénées où j'ai grandi ».POULOT Robert (1941-XXXX)
Coureur cycliste professionnel équipier de Raymond Poulidor
 Robert POULOT, né le 5 juillet 1941 à Arrens, est un cycliste professionnel au talent indéniable. Il est le fils de Prosper Poulot, excellent skieur de fond, qui participa en 1937 aux championnats du monde de ski nordique, à Chamonix. La 11e étape du Tour de France 2002 a eu lieu le 18 juillet 2002 entre Pau et la station de La Mongie sur une distance de 158 km et sera remportée par l'Américain Lance Armstrong. Cette année encore, le Tour de France descend le col du Soulor et passe devant la maison de Robert Poulot, à Arrens. En 1964, Robert était dans le peloton. Dans une équipe Mercier, il portait le dossard 20 et Poulidor le 19, dans l'ordre alphabétique. Avec ses 1m86, Poulot était même l'un des plus grands après Rostollan (1m87) mais en réalité, il était le fidèle équipier du leader Raymond Poulidor, dont presque toute la France attendait qu'il détrônât le maître Anquetil. Robert Poulot termina cependant 47e sur 81 de cette fameuse édition 1964, la seule qu'il ait courue, et il affirme aujourd'hui : « Si je n'avais eu à m'occuper de personne, si je n'avais eu à attendre des coéquipiers sur crevaison alors que je me suis retrouvé tout seul à chaque incident, je me serais classé dans les 20 premiers. » La veille du passage à Arrens, Poulot était tombé dans le Portet d'Aspet, près de l'endroit où Casartelli a trouvé la mort. C'est pourquoi il avait franchi la ligne en bon dernier à Luchon, avec vingt minutes de retard. Son Col du Soulor avait été son calvaire : « Si le Tour n'était pas passé chez moi, j'aurais abandonné la veille car j'étais très diminué par ma chute ». Notre Pyrénéen marchait bien en 1964, s'adonnant l'hiver au ski de fond, son autre passion qui lui avait valu d'être sélectionné en équipe de France espoir et militaire. À vélo, il avait remporté une quinzaine de courses et d’indépendant chez Mercier il passe pro, et se retrouve dans l’équipe qui dispute le « Dauphiné Libéré ». Malgré de fortes chaleurs, des moyennes élevées (45-46 km/h) et déjà des incidents mécaniques, il avait rejoint Bahamontès parti à l'attaque et l'Espagnol n'en était pas revenu. Le comportement de Poulot dans le Galibier et le Télégraphe avait été également remarqué par Antonin Magne, qui l'avait retenu pour le Tour de France. Mais la belle aventure n'allait durer qu'une saison. Poulidor ayant été battu par son coéquipier Wolfshohl dans la Vuelta 65, Robert Poulot servit de bouc émissaire. Il raconte avec amertume : « Poulidor portait le maillot de leader mais ne contrôlait pas la course. Wolfshohl et moi avons fait partie, avec deux coéquipiers d'Anquetil, d'une échappée à six dans une étape de plat sous la canicule. On ne m'a jamais fait savoir si je devais rouler ou non. J'ai amené le sprint pour l'Allemand qui s'est classé 2e et nous sommes rentrés à l'hôtel. Nous avions pris la douche, quand nous avons appris que notre avance était de 16' et que Wolfshohl endossait ainsi le maillot jaune. Poulidor est venu lui jeter son maillot et il m'a accusé d'avoir roulé pour l'Allemand, ce qui était faux. Dans l'étape Pampelune-Bayonne, j'ai passé la journée à attendre et ramener Poulidor, puis Le Dissez, qui avaient chuté. J'ai été largué dans le col d'Ibardin et Antonin Magne m'a lancé : ''Vous ne grimpez pas, vous ne ferez pas le Tour 65''. Il fallait bien que quelqu'un porte le chapeau. Je n'étais pas très bien vu depuis une arrivée à Saint-Etienne, où mes câbles de freins étant près de casser, je m'en étais pris vivement au mécano devant Émile Mercier lui-même ». Robert Poulot participa au Dauphiné Libéré 66 avant de mettre un terme à sa carrière professionnelle l'année suivante, en 1967 : « Je ne me trouvais pas bien dans ce milieu ». Il s'en éloigna pour toujours, retournant dans le val d'Azun, où il sera nommé garde-moniteur du Parc national des Pyrénées. En 2002, il prendra sa retraite de chef de secteur du PNP, suffisant amplement à son bonheur. Trente-huit ans après son 1er Tour de France, le coéquipier de Poulidor livrera son sentiment sur une rivalité artificiellement entretenue : « J'aimais bien Anquetil. Je discutais plus facilement avec lui qu'avec Poulidor. Anquetil était supérieurement intelligent et il faisait, lui, la course en tête bien qu'il disposât d'excellents équipiers. En vérité, quand Anquetil a quitté le peloton, Poulidor n'a plus su de qui prendre la roue. J'ai toujours considéré que pour gagner le Tour de France, il fallait 30 % de plus que le second ». Coéquipier de Raymond Poulidor, Robert Poulot garde un souvenir précis de la fameuse 14e étape Andorre-Toulouse (186 km) du Tour de France, le lundi 6 juillet 1964, qui aurait pu coûter à maître Anquetil sa cinquième victoire dans le Tour. Il s'est trouvé au cœur de l'événement. Son récit fait peu de cas du légendaire méchoui de la veille organisé par Radio-Andorre, où la sangria coula à flots, et au cours duquel Anquetil aurait pêché par gourmandise, dévorant le mouton avec un grand appétit et fait une belle démonstration dans la sortie des Pyrénées le lendemain. Malgré 4 minutes de retard au sommet de la première ascension de l'histoire du Port d'Envalira, Anquetil auteur d'une belle descente dépassera Poulidor, il est vrai victime d'une seconde chute dans ce tour juste avant Toulouse : « La vérité, c'est que Raoul Rémy, directeur sportif de Bahamontès, et Antonin Magne, directeur sportif de Poulidor, se sont entendus pour porter une grosse attaque contre Anquetil dans l'Envalira. Effectivement, le Normand a été lâché. Je me suis trouvé intercalé entre le groupe Poulidor et le groupe Anquetil, en compagnie de Rostollan, qui attendait son leader. Nous avons effectué une folle descente, dans un brouillard qui limitait la visibilité à 40 mètres. Je suis allé tout droit dans un virage, mais je m'en suis tiré sans mal car j'ai eu la chance de tomber dans l'herbe. Anquetil arrivait quand je remontais sur le vélo et j'ai continué derrière lui. Une moto lui ouvrait la route. À L'Hospitalet, nous sommes revenus sur Janssen et Groussard, puis nous avons rattrapé Poulidor, Jimenez et Bahamontès à Tarascon. Là-dessus, Poulidor a cassé deux rayons et j'ai appelé la voiture. Pour l'aider à repartir, le mécano Loulou a poussé si fort Poulidor, pour favoriser son redémarrage, qu'il l'a expédié dans le fossé ! Mais le vélo de rechange était maintenant inutilisable et Poulidor doit reprendre sa monture d’origine. Et pendant ce temps le groupe de tête s’envole, toutes voiles dehors ». Chose rarissime, Poulidor bénéficie alors de l’abri des voitures suiveuses pour réintégrer le peloton. Mais ce jour-là, tolérance zéro pour Poulidor ! C’est à un véritable contre-la-montre qu’il doit se livrer avec l’aide éphémère d’un Poulot au bout du rouleau. « J'ai attendu notre leader, j'étais le seul Mercier avec lui. Nous avons roulé ensemble pendant 4 km puis, alors que nous apercevions le peloton de tête au bout d'une ligne droite, il m'a laissé sur place ! Il s'était comporté de la même façon au Tour d'Espagne, dans l'étape Valladolid-Madrid. Chacun pour soi, en quelque sorte. Poulidor n'a jamais recollé, il a même été rejoint par un deuxième groupe et terminera à deux minutes et trente-six secondes des premiers à Toulouse. C'est ce jour-là, pas au Puy-de-Dôme, qu'il aurait pu gagner le Tour. C'est ce jour-là qu'il l'a perdu ». Le Belge Ward Sels (Solo) l'a emporté au sprint au Stadium de Toulouse, Georges Groussard conservant le maillot jaune avec 1'11'' d'avance sur Anquetil. Poulidor, 3e à 1'42'' au départ de l’étape d'Andorre, passait 6e à Toulouse à 4'18''. Poulidor, maillot jaune virtuel dans l’Envalira, se retrouve finalement rejeté à plus de 3mn de son rival normand. Le soir de cette étape, Antonin Magne responsable avec Loulou de cette véritable bérézina essaiera de trouver les mots pour réconforter son champion. Antonin savait que l’on venait de vivre une de ces journées mémorables dont les épisodes entreront, pour toujours, dans la grande légende du sport cycliste. À l'issue du contre-la-montre final Versailles-Paris du 14 juillet 1964, Jacques Anquetil remportera son 5e Tour de France avec 55'' d'avance sur Poulidor. Et Robert Poulot terminera néanmoins le Tour à la 47e place sur 81 coureurs classés.
Robert POULOT, né le 5 juillet 1941 à Arrens, est un cycliste professionnel au talent indéniable. Il est le fils de Prosper Poulot, excellent skieur de fond, qui participa en 1937 aux championnats du monde de ski nordique, à Chamonix. La 11e étape du Tour de France 2002 a eu lieu le 18 juillet 2002 entre Pau et la station de La Mongie sur une distance de 158 km et sera remportée par l'Américain Lance Armstrong. Cette année encore, le Tour de France descend le col du Soulor et passe devant la maison de Robert Poulot, à Arrens. En 1964, Robert était dans le peloton. Dans une équipe Mercier, il portait le dossard 20 et Poulidor le 19, dans l'ordre alphabétique. Avec ses 1m86, Poulot était même l'un des plus grands après Rostollan (1m87) mais en réalité, il était le fidèle équipier du leader Raymond Poulidor, dont presque toute la France attendait qu'il détrônât le maître Anquetil. Robert Poulot termina cependant 47e sur 81 de cette fameuse édition 1964, la seule qu'il ait courue, et il affirme aujourd'hui : « Si je n'avais eu à m'occuper de personne, si je n'avais eu à attendre des coéquipiers sur crevaison alors que je me suis retrouvé tout seul à chaque incident, je me serais classé dans les 20 premiers. » La veille du passage à Arrens, Poulot était tombé dans le Portet d'Aspet, près de l'endroit où Casartelli a trouvé la mort. C'est pourquoi il avait franchi la ligne en bon dernier à Luchon, avec vingt minutes de retard. Son Col du Soulor avait été son calvaire : « Si le Tour n'était pas passé chez moi, j'aurais abandonné la veille car j'étais très diminué par ma chute ». Notre Pyrénéen marchait bien en 1964, s'adonnant l'hiver au ski de fond, son autre passion qui lui avait valu d'être sélectionné en équipe de France espoir et militaire. À vélo, il avait remporté une quinzaine de courses et d’indépendant chez Mercier il passe pro, et se retrouve dans l’équipe qui dispute le « Dauphiné Libéré ». Malgré de fortes chaleurs, des moyennes élevées (45-46 km/h) et déjà des incidents mécaniques, il avait rejoint Bahamontès parti à l'attaque et l'Espagnol n'en était pas revenu. Le comportement de Poulot dans le Galibier et le Télégraphe avait été également remarqué par Antonin Magne, qui l'avait retenu pour le Tour de France. Mais la belle aventure n'allait durer qu'une saison. Poulidor ayant été battu par son coéquipier Wolfshohl dans la Vuelta 65, Robert Poulot servit de bouc émissaire. Il raconte avec amertume : « Poulidor portait le maillot de leader mais ne contrôlait pas la course. Wolfshohl et moi avons fait partie, avec deux coéquipiers d'Anquetil, d'une échappée à six dans une étape de plat sous la canicule. On ne m'a jamais fait savoir si je devais rouler ou non. J'ai amené le sprint pour l'Allemand qui s'est classé 2e et nous sommes rentrés à l'hôtel. Nous avions pris la douche, quand nous avons appris que notre avance était de 16' et que Wolfshohl endossait ainsi le maillot jaune. Poulidor est venu lui jeter son maillot et il m'a accusé d'avoir roulé pour l'Allemand, ce qui était faux. Dans l'étape Pampelune-Bayonne, j'ai passé la journée à attendre et ramener Poulidor, puis Le Dissez, qui avaient chuté. J'ai été largué dans le col d'Ibardin et Antonin Magne m'a lancé : ''Vous ne grimpez pas, vous ne ferez pas le Tour 65''. Il fallait bien que quelqu'un porte le chapeau. Je n'étais pas très bien vu depuis une arrivée à Saint-Etienne, où mes câbles de freins étant près de casser, je m'en étais pris vivement au mécano devant Émile Mercier lui-même ». Robert Poulot participa au Dauphiné Libéré 66 avant de mettre un terme à sa carrière professionnelle l'année suivante, en 1967 : « Je ne me trouvais pas bien dans ce milieu ». Il s'en éloigna pour toujours, retournant dans le val d'Azun, où il sera nommé garde-moniteur du Parc national des Pyrénées. En 2002, il prendra sa retraite de chef de secteur du PNP, suffisant amplement à son bonheur. Trente-huit ans après son 1er Tour de France, le coéquipier de Poulidor livrera son sentiment sur une rivalité artificiellement entretenue : « J'aimais bien Anquetil. Je discutais plus facilement avec lui qu'avec Poulidor. Anquetil était supérieurement intelligent et il faisait, lui, la course en tête bien qu'il disposât d'excellents équipiers. En vérité, quand Anquetil a quitté le peloton, Poulidor n'a plus su de qui prendre la roue. J'ai toujours considéré que pour gagner le Tour de France, il fallait 30 % de plus que le second ». Coéquipier de Raymond Poulidor, Robert Poulot garde un souvenir précis de la fameuse 14e étape Andorre-Toulouse (186 km) du Tour de France, le lundi 6 juillet 1964, qui aurait pu coûter à maître Anquetil sa cinquième victoire dans le Tour. Il s'est trouvé au cœur de l'événement. Son récit fait peu de cas du légendaire méchoui de la veille organisé par Radio-Andorre, où la sangria coula à flots, et au cours duquel Anquetil aurait pêché par gourmandise, dévorant le mouton avec un grand appétit et fait une belle démonstration dans la sortie des Pyrénées le lendemain. Malgré 4 minutes de retard au sommet de la première ascension de l'histoire du Port d'Envalira, Anquetil auteur d'une belle descente dépassera Poulidor, il est vrai victime d'une seconde chute dans ce tour juste avant Toulouse : « La vérité, c'est que Raoul Rémy, directeur sportif de Bahamontès, et Antonin Magne, directeur sportif de Poulidor, se sont entendus pour porter une grosse attaque contre Anquetil dans l'Envalira. Effectivement, le Normand a été lâché. Je me suis trouvé intercalé entre le groupe Poulidor et le groupe Anquetil, en compagnie de Rostollan, qui attendait son leader. Nous avons effectué une folle descente, dans un brouillard qui limitait la visibilité à 40 mètres. Je suis allé tout droit dans un virage, mais je m'en suis tiré sans mal car j'ai eu la chance de tomber dans l'herbe. Anquetil arrivait quand je remontais sur le vélo et j'ai continué derrière lui. Une moto lui ouvrait la route. À L'Hospitalet, nous sommes revenus sur Janssen et Groussard, puis nous avons rattrapé Poulidor, Jimenez et Bahamontès à Tarascon. Là-dessus, Poulidor a cassé deux rayons et j'ai appelé la voiture. Pour l'aider à repartir, le mécano Loulou a poussé si fort Poulidor, pour favoriser son redémarrage, qu'il l'a expédié dans le fossé ! Mais le vélo de rechange était maintenant inutilisable et Poulidor doit reprendre sa monture d’origine. Et pendant ce temps le groupe de tête s’envole, toutes voiles dehors ». Chose rarissime, Poulidor bénéficie alors de l’abri des voitures suiveuses pour réintégrer le peloton. Mais ce jour-là, tolérance zéro pour Poulidor ! C’est à un véritable contre-la-montre qu’il doit se livrer avec l’aide éphémère d’un Poulot au bout du rouleau. « J'ai attendu notre leader, j'étais le seul Mercier avec lui. Nous avons roulé ensemble pendant 4 km puis, alors que nous apercevions le peloton de tête au bout d'une ligne droite, il m'a laissé sur place ! Il s'était comporté de la même façon au Tour d'Espagne, dans l'étape Valladolid-Madrid. Chacun pour soi, en quelque sorte. Poulidor n'a jamais recollé, il a même été rejoint par un deuxième groupe et terminera à deux minutes et trente-six secondes des premiers à Toulouse. C'est ce jour-là, pas au Puy-de-Dôme, qu'il aurait pu gagner le Tour. C'est ce jour-là qu'il l'a perdu ». Le Belge Ward Sels (Solo) l'a emporté au sprint au Stadium de Toulouse, Georges Groussard conservant le maillot jaune avec 1'11'' d'avance sur Anquetil. Poulidor, 3e à 1'42'' au départ de l’étape d'Andorre, passait 6e à Toulouse à 4'18''. Poulidor, maillot jaune virtuel dans l’Envalira, se retrouve finalement rejeté à plus de 3mn de son rival normand. Le soir de cette étape, Antonin Magne responsable avec Loulou de cette véritable bérézina essaiera de trouver les mots pour réconforter son champion. Antonin savait que l’on venait de vivre une de ces journées mémorables dont les épisodes entreront, pour toujours, dans la grande légende du sport cycliste. À l'issue du contre-la-montre final Versailles-Paris du 14 juillet 1964, Jacques Anquetil remportera son 5e Tour de France avec 55'' d'avance sur Poulidor. Et Robert Poulot terminera néanmoins le Tour à la 47e place sur 81 coureurs classés.
 Robert POULOT, né le 5 juillet 1941 à Arrens, est un cycliste professionnel au talent indéniable. Il est le fils de Prosper Poulot, excellent skieur de fond, qui participa en 1937 aux championnats du monde de ski nordique, à Chamonix. La 11e étape du Tour de France 2002 a eu lieu le 18 juillet 2002 entre Pau et la station de La Mongie sur une distance de 158 km et sera remportée par l'Américain Lance Armstrong. Cette année encore, le Tour de France descend le col du Soulor et passe devant la maison de Robert Poulot, à Arrens. En 1964, Robert était dans le peloton. Dans une équipe Mercier, il portait le dossard 20 et Poulidor le 19, dans l'ordre alphabétique. Avec ses 1m86, Poulot était même l'un des plus grands après Rostollan (1m87) mais en réalité, il était le fidèle équipier du leader Raymond Poulidor, dont presque toute la France attendait qu'il détrônât le maître Anquetil. Robert Poulot termina cependant 47e sur 81 de cette fameuse édition 1964, la seule qu'il ait courue, et il affirme aujourd'hui : « Si je n'avais eu à m'occuper de personne, si je n'avais eu à attendre des coéquipiers sur crevaison alors que je me suis retrouvé tout seul à chaque incident, je me serais classé dans les 20 premiers. » La veille du passage à Arrens, Poulot était tombé dans le Portet d'Aspet, près de l'endroit où Casartelli a trouvé la mort. C'est pourquoi il avait franchi la ligne en bon dernier à Luchon, avec vingt minutes de retard. Son Col du Soulor avait été son calvaire : « Si le Tour n'était pas passé chez moi, j'aurais abandonné la veille car j'étais très diminué par ma chute ». Notre Pyrénéen marchait bien en 1964, s'adonnant l'hiver au ski de fond, son autre passion qui lui avait valu d'être sélectionné en équipe de France espoir et militaire. À vélo, il avait remporté une quinzaine de courses et d’indépendant chez Mercier il passe pro, et se retrouve dans l’équipe qui dispute le « Dauphiné Libéré ». Malgré de fortes chaleurs, des moyennes élevées (45-46 km/h) et déjà des incidents mécaniques, il avait rejoint Bahamontès parti à l'attaque et l'Espagnol n'en était pas revenu. Le comportement de Poulot dans le Galibier et le Télégraphe avait été également remarqué par Antonin Magne, qui l'avait retenu pour le Tour de France. Mais la belle aventure n'allait durer qu'une saison. Poulidor ayant été battu par son coéquipier Wolfshohl dans la Vuelta 65, Robert Poulot servit de bouc émissaire. Il raconte avec amertume : « Poulidor portait le maillot de leader mais ne contrôlait pas la course. Wolfshohl et moi avons fait partie, avec deux coéquipiers d'Anquetil, d'une échappée à six dans une étape de plat sous la canicule. On ne m'a jamais fait savoir si je devais rouler ou non. J'ai amené le sprint pour l'Allemand qui s'est classé 2e et nous sommes rentrés à l'hôtel. Nous avions pris la douche, quand nous avons appris que notre avance était de 16' et que Wolfshohl endossait ainsi le maillot jaune. Poulidor est venu lui jeter son maillot et il m'a accusé d'avoir roulé pour l'Allemand, ce qui était faux. Dans l'étape Pampelune-Bayonne, j'ai passé la journée à attendre et ramener Poulidor, puis Le Dissez, qui avaient chuté. J'ai été largué dans le col d'Ibardin et Antonin Magne m'a lancé : ''Vous ne grimpez pas, vous ne ferez pas le Tour 65''. Il fallait bien que quelqu'un porte le chapeau. Je n'étais pas très bien vu depuis une arrivée à Saint-Etienne, où mes câbles de freins étant près de casser, je m'en étais pris vivement au mécano devant Émile Mercier lui-même ». Robert Poulot participa au Dauphiné Libéré 66 avant de mettre un terme à sa carrière professionnelle l'année suivante, en 1967 : « Je ne me trouvais pas bien dans ce milieu ». Il s'en éloigna pour toujours, retournant dans le val d'Azun, où il sera nommé garde-moniteur du Parc national des Pyrénées. En 2002, il prendra sa retraite de chef de secteur du PNP, suffisant amplement à son bonheur. Trente-huit ans après son 1er Tour de France, le coéquipier de Poulidor livrera son sentiment sur une rivalité artificiellement entretenue : « J'aimais bien Anquetil. Je discutais plus facilement avec lui qu'avec Poulidor. Anquetil était supérieurement intelligent et il faisait, lui, la course en tête bien qu'il disposât d'excellents équipiers. En vérité, quand Anquetil a quitté le peloton, Poulidor n'a plus su de qui prendre la roue. J'ai toujours considéré que pour gagner le Tour de France, il fallait 30 % de plus que le second ». Coéquipier de Raymond Poulidor, Robert Poulot garde un souvenir précis de la fameuse 14e étape Andorre-Toulouse (186 km) du Tour de France, le lundi 6 juillet 1964, qui aurait pu coûter à maître Anquetil sa cinquième victoire dans le Tour. Il s'est trouvé au cœur de l'événement. Son récit fait peu de cas du légendaire méchoui de la veille organisé par Radio-Andorre, où la sangria coula à flots, et au cours duquel Anquetil aurait pêché par gourmandise, dévorant le mouton avec un grand appétit et fait une belle démonstration dans la sortie des Pyrénées le lendemain. Malgré 4 minutes de retard au sommet de la première ascension de l'histoire du Port d'Envalira, Anquetil auteur d'une belle descente dépassera Poulidor, il est vrai victime d'une seconde chute dans ce tour juste avant Toulouse : « La vérité, c'est que Raoul Rémy, directeur sportif de Bahamontès, et Antonin Magne, directeur sportif de Poulidor, se sont entendus pour porter une grosse attaque contre Anquetil dans l'Envalira. Effectivement, le Normand a été lâché. Je me suis trouvé intercalé entre le groupe Poulidor et le groupe Anquetil, en compagnie de Rostollan, qui attendait son leader. Nous avons effectué une folle descente, dans un brouillard qui limitait la visibilité à 40 mètres. Je suis allé tout droit dans un virage, mais je m'en suis tiré sans mal car j'ai eu la chance de tomber dans l'herbe. Anquetil arrivait quand je remontais sur le vélo et j'ai continué derrière lui. Une moto lui ouvrait la route. À L'Hospitalet, nous sommes revenus sur Janssen et Groussard, puis nous avons rattrapé Poulidor, Jimenez et Bahamontès à Tarascon. Là-dessus, Poulidor a cassé deux rayons et j'ai appelé la voiture. Pour l'aider à repartir, le mécano Loulou a poussé si fort Poulidor, pour favoriser son redémarrage, qu'il l'a expédié dans le fossé ! Mais le vélo de rechange était maintenant inutilisable et Poulidor doit reprendre sa monture d’origine. Et pendant ce temps le groupe de tête s’envole, toutes voiles dehors ». Chose rarissime, Poulidor bénéficie alors de l’abri des voitures suiveuses pour réintégrer le peloton. Mais ce jour-là, tolérance zéro pour Poulidor ! C’est à un véritable contre-la-montre qu’il doit se livrer avec l’aide éphémère d’un Poulot au bout du rouleau. « J'ai attendu notre leader, j'étais le seul Mercier avec lui. Nous avons roulé ensemble pendant 4 km puis, alors que nous apercevions le peloton de tête au bout d'une ligne droite, il m'a laissé sur place ! Il s'était comporté de la même façon au Tour d'Espagne, dans l'étape Valladolid-Madrid. Chacun pour soi, en quelque sorte. Poulidor n'a jamais recollé, il a même été rejoint par un deuxième groupe et terminera à deux minutes et trente-six secondes des premiers à Toulouse. C'est ce jour-là, pas au Puy-de-Dôme, qu'il aurait pu gagner le Tour. C'est ce jour-là qu'il l'a perdu ». Le Belge Ward Sels (Solo) l'a emporté au sprint au Stadium de Toulouse, Georges Groussard conservant le maillot jaune avec 1'11'' d'avance sur Anquetil. Poulidor, 3e à 1'42'' au départ de l’étape d'Andorre, passait 6e à Toulouse à 4'18''. Poulidor, maillot jaune virtuel dans l’Envalira, se retrouve finalement rejeté à plus de 3mn de son rival normand. Le soir de cette étape, Antonin Magne responsable avec Loulou de cette véritable bérézina essaiera de trouver les mots pour réconforter son champion. Antonin savait que l’on venait de vivre une de ces journées mémorables dont les épisodes entreront, pour toujours, dans la grande légende du sport cycliste. À l'issue du contre-la-montre final Versailles-Paris du 14 juillet 1964, Jacques Anquetil remportera son 5e Tour de France avec 55'' d'avance sur Poulidor. Et Robert Poulot terminera néanmoins le Tour à la 47e place sur 81 coureurs classés.
Robert POULOT, né le 5 juillet 1941 à Arrens, est un cycliste professionnel au talent indéniable. Il est le fils de Prosper Poulot, excellent skieur de fond, qui participa en 1937 aux championnats du monde de ski nordique, à Chamonix. La 11e étape du Tour de France 2002 a eu lieu le 18 juillet 2002 entre Pau et la station de La Mongie sur une distance de 158 km et sera remportée par l'Américain Lance Armstrong. Cette année encore, le Tour de France descend le col du Soulor et passe devant la maison de Robert Poulot, à Arrens. En 1964, Robert était dans le peloton. Dans une équipe Mercier, il portait le dossard 20 et Poulidor le 19, dans l'ordre alphabétique. Avec ses 1m86, Poulot était même l'un des plus grands après Rostollan (1m87) mais en réalité, il était le fidèle équipier du leader Raymond Poulidor, dont presque toute la France attendait qu'il détrônât le maître Anquetil. Robert Poulot termina cependant 47e sur 81 de cette fameuse édition 1964, la seule qu'il ait courue, et il affirme aujourd'hui : « Si je n'avais eu à m'occuper de personne, si je n'avais eu à attendre des coéquipiers sur crevaison alors que je me suis retrouvé tout seul à chaque incident, je me serais classé dans les 20 premiers. » La veille du passage à Arrens, Poulot était tombé dans le Portet d'Aspet, près de l'endroit où Casartelli a trouvé la mort. C'est pourquoi il avait franchi la ligne en bon dernier à Luchon, avec vingt minutes de retard. Son Col du Soulor avait été son calvaire : « Si le Tour n'était pas passé chez moi, j'aurais abandonné la veille car j'étais très diminué par ma chute ». Notre Pyrénéen marchait bien en 1964, s'adonnant l'hiver au ski de fond, son autre passion qui lui avait valu d'être sélectionné en équipe de France espoir et militaire. À vélo, il avait remporté une quinzaine de courses et d’indépendant chez Mercier il passe pro, et se retrouve dans l’équipe qui dispute le « Dauphiné Libéré ». Malgré de fortes chaleurs, des moyennes élevées (45-46 km/h) et déjà des incidents mécaniques, il avait rejoint Bahamontès parti à l'attaque et l'Espagnol n'en était pas revenu. Le comportement de Poulot dans le Galibier et le Télégraphe avait été également remarqué par Antonin Magne, qui l'avait retenu pour le Tour de France. Mais la belle aventure n'allait durer qu'une saison. Poulidor ayant été battu par son coéquipier Wolfshohl dans la Vuelta 65, Robert Poulot servit de bouc émissaire. Il raconte avec amertume : « Poulidor portait le maillot de leader mais ne contrôlait pas la course. Wolfshohl et moi avons fait partie, avec deux coéquipiers d'Anquetil, d'une échappée à six dans une étape de plat sous la canicule. On ne m'a jamais fait savoir si je devais rouler ou non. J'ai amené le sprint pour l'Allemand qui s'est classé 2e et nous sommes rentrés à l'hôtel. Nous avions pris la douche, quand nous avons appris que notre avance était de 16' et que Wolfshohl endossait ainsi le maillot jaune. Poulidor est venu lui jeter son maillot et il m'a accusé d'avoir roulé pour l'Allemand, ce qui était faux. Dans l'étape Pampelune-Bayonne, j'ai passé la journée à attendre et ramener Poulidor, puis Le Dissez, qui avaient chuté. J'ai été largué dans le col d'Ibardin et Antonin Magne m'a lancé : ''Vous ne grimpez pas, vous ne ferez pas le Tour 65''. Il fallait bien que quelqu'un porte le chapeau. Je n'étais pas très bien vu depuis une arrivée à Saint-Etienne, où mes câbles de freins étant près de casser, je m'en étais pris vivement au mécano devant Émile Mercier lui-même ». Robert Poulot participa au Dauphiné Libéré 66 avant de mettre un terme à sa carrière professionnelle l'année suivante, en 1967 : « Je ne me trouvais pas bien dans ce milieu ». Il s'en éloigna pour toujours, retournant dans le val d'Azun, où il sera nommé garde-moniteur du Parc national des Pyrénées. En 2002, il prendra sa retraite de chef de secteur du PNP, suffisant amplement à son bonheur. Trente-huit ans après son 1er Tour de France, le coéquipier de Poulidor livrera son sentiment sur une rivalité artificiellement entretenue : « J'aimais bien Anquetil. Je discutais plus facilement avec lui qu'avec Poulidor. Anquetil était supérieurement intelligent et il faisait, lui, la course en tête bien qu'il disposât d'excellents équipiers. En vérité, quand Anquetil a quitté le peloton, Poulidor n'a plus su de qui prendre la roue. J'ai toujours considéré que pour gagner le Tour de France, il fallait 30 % de plus que le second ». Coéquipier de Raymond Poulidor, Robert Poulot garde un souvenir précis de la fameuse 14e étape Andorre-Toulouse (186 km) du Tour de France, le lundi 6 juillet 1964, qui aurait pu coûter à maître Anquetil sa cinquième victoire dans le Tour. Il s'est trouvé au cœur de l'événement. Son récit fait peu de cas du légendaire méchoui de la veille organisé par Radio-Andorre, où la sangria coula à flots, et au cours duquel Anquetil aurait pêché par gourmandise, dévorant le mouton avec un grand appétit et fait une belle démonstration dans la sortie des Pyrénées le lendemain. Malgré 4 minutes de retard au sommet de la première ascension de l'histoire du Port d'Envalira, Anquetil auteur d'une belle descente dépassera Poulidor, il est vrai victime d'une seconde chute dans ce tour juste avant Toulouse : « La vérité, c'est que Raoul Rémy, directeur sportif de Bahamontès, et Antonin Magne, directeur sportif de Poulidor, se sont entendus pour porter une grosse attaque contre Anquetil dans l'Envalira. Effectivement, le Normand a été lâché. Je me suis trouvé intercalé entre le groupe Poulidor et le groupe Anquetil, en compagnie de Rostollan, qui attendait son leader. Nous avons effectué une folle descente, dans un brouillard qui limitait la visibilité à 40 mètres. Je suis allé tout droit dans un virage, mais je m'en suis tiré sans mal car j'ai eu la chance de tomber dans l'herbe. Anquetil arrivait quand je remontais sur le vélo et j'ai continué derrière lui. Une moto lui ouvrait la route. À L'Hospitalet, nous sommes revenus sur Janssen et Groussard, puis nous avons rattrapé Poulidor, Jimenez et Bahamontès à Tarascon. Là-dessus, Poulidor a cassé deux rayons et j'ai appelé la voiture. Pour l'aider à repartir, le mécano Loulou a poussé si fort Poulidor, pour favoriser son redémarrage, qu'il l'a expédié dans le fossé ! Mais le vélo de rechange était maintenant inutilisable et Poulidor doit reprendre sa monture d’origine. Et pendant ce temps le groupe de tête s’envole, toutes voiles dehors ». Chose rarissime, Poulidor bénéficie alors de l’abri des voitures suiveuses pour réintégrer le peloton. Mais ce jour-là, tolérance zéro pour Poulidor ! C’est à un véritable contre-la-montre qu’il doit se livrer avec l’aide éphémère d’un Poulot au bout du rouleau. « J'ai attendu notre leader, j'étais le seul Mercier avec lui. Nous avons roulé ensemble pendant 4 km puis, alors que nous apercevions le peloton de tête au bout d'une ligne droite, il m'a laissé sur place ! Il s'était comporté de la même façon au Tour d'Espagne, dans l'étape Valladolid-Madrid. Chacun pour soi, en quelque sorte. Poulidor n'a jamais recollé, il a même été rejoint par un deuxième groupe et terminera à deux minutes et trente-six secondes des premiers à Toulouse. C'est ce jour-là, pas au Puy-de-Dôme, qu'il aurait pu gagner le Tour. C'est ce jour-là qu'il l'a perdu ». Le Belge Ward Sels (Solo) l'a emporté au sprint au Stadium de Toulouse, Georges Groussard conservant le maillot jaune avec 1'11'' d'avance sur Anquetil. Poulidor, 3e à 1'42'' au départ de l’étape d'Andorre, passait 6e à Toulouse à 4'18''. Poulidor, maillot jaune virtuel dans l’Envalira, se retrouve finalement rejeté à plus de 3mn de son rival normand. Le soir de cette étape, Antonin Magne responsable avec Loulou de cette véritable bérézina essaiera de trouver les mots pour réconforter son champion. Antonin savait que l’on venait de vivre une de ces journées mémorables dont les épisodes entreront, pour toujours, dans la grande légende du sport cycliste. À l'issue du contre-la-montre final Versailles-Paris du 14 juillet 1964, Jacques Anquetil remportera son 5e Tour de France avec 55'' d'avance sur Poulidor. Et Robert Poulot terminera néanmoins le Tour à la 47e place sur 81 coureurs classés.PRAT Jean (1923-2005)
Joueur de rugby à XV et première grande figure du rugby français, surnommé "Monsieur Rugby !"
 Jean PRAT, alias « Monsieur Rugby », né le 1er août 1923 à Lourdes et mort le 25 février 2005 à Tarbes, à l’âge de 81 ans. Grand joueur de rugby à XV, de 1m76 pour 84 kg, évoluant au poste de troisième ligne aile et ayant joué à chaque poste des lignes arrières, il fut sans doute la première grande figure du rugby à XV français. Doté d’un exceptionnel coup de botte, les Britanniques le surnommèrent « Mister Rugby », à l’issue du match qui vit le 28 février 1951, l’équipe de France battre pour la première fois l’équipe d’Angleterre à Twickenham (11-3). Les Anglais le surnommèrent ainsi pour son sens du commandement et surtout ses qualités de meneur d’hommes. De 1945 à 1955, il fut sélectionné cinquante et une fois (30 victoires, l nul, 20 défaites) en équipe de France (dont seize fois comme capitaine). En 1952, il devient le recordman du nombre de sélections en équipe de France. Comme capitaine, il fut le premier en France à remporter le Tournoi des Cinq Nations à deux reprises, en 1954 (avec Galles et Angleterre) et en 1955 (avec Galles). Capitaine du XV de France, il participe aussi à la victoire contre les All Blacks à Colombes le 27 février 1954, en marquant l’unique essai à trois points (3-0). Il a inscrit 139 points pour le XV de France : 9 essais, 26 transformations, 15 pénalités, 5 drops. Avec son club, le FC Lourdes, dont il était le capitaine et où évoluait aussi son frère Maurice, il fut six fois champion de France (1948, 1952, 1953, 1956, 1957, 1958), trois fois finaliste du championnat de France (1945, 1946, 1955), finaliste de la coupe de France en 1948, deux fois vainqueur de la coupe de France (1950, 1951) et trois fois vainqueur du challenge Yves du Manoir (1953, 1954, 1956). Très exigeant avec lui-même, il s’astreignait à un entraînement physique quotidien, ce qui était loin d’être courant à l’époque. Il acheva sa carrière internationale en 1955, porté en triomphe sur les épaules de ses vainqueurs gallois. Il mit fin à sa carrière de joueur en 1959 pour devenir entraîneur du club de Lourdes, puis le premier sélectionneur-entraîneur officiel du XV de France de 1963 à 1967. C’est ainsi sous sa direction, que le XV de France partit en tournée en Afrique du Sud en 1964, battant les Springboks chez eux à Springs (8-6). À mettre aussi à son actif, le Tournoi des Cinq nations 1967 remporté par la France. En 1967, suite à l’élection de l’équipe Ferrasse-Batigne-Basquet à la tête de la FFR, il fut aussi le premier à se faire virer, étant l’ennemi juré de Guy Basquet depuis qu’ils avaient cohabité en équipe de France au début des années 50. Il reçut la Légion d’honneur en 1959 et fut promu officier en 1990. Quelque temps avant sa mort, il préfaçait encore l’ouvrage « 100 ans de rugby Bleu » de Richard Escot, journaliste à L’Équipe magazine (éd. Solar). En 1928, son père Joseph Prat, cultivateur, avait cédé un terrain personnel au FC Lourdais, sur lequel fut construit l’actuel stade du club. Depuis 2005, le "Trophée Jean-Prat" est désormais attribué au club champion de France de Fédérale 1, premier des clubs à accéder chaque année en Pro D2. Décédé en 2005, il laisse le souvenir d’une star de l’ovalie du XXème siècle.
Jean PRAT, alias « Monsieur Rugby », né le 1er août 1923 à Lourdes et mort le 25 février 2005 à Tarbes, à l’âge de 81 ans. Grand joueur de rugby à XV, de 1m76 pour 84 kg, évoluant au poste de troisième ligne aile et ayant joué à chaque poste des lignes arrières, il fut sans doute la première grande figure du rugby à XV français. Doté d’un exceptionnel coup de botte, les Britanniques le surnommèrent « Mister Rugby », à l’issue du match qui vit le 28 février 1951, l’équipe de France battre pour la première fois l’équipe d’Angleterre à Twickenham (11-3). Les Anglais le surnommèrent ainsi pour son sens du commandement et surtout ses qualités de meneur d’hommes. De 1945 à 1955, il fut sélectionné cinquante et une fois (30 victoires, l nul, 20 défaites) en équipe de France (dont seize fois comme capitaine). En 1952, il devient le recordman du nombre de sélections en équipe de France. Comme capitaine, il fut le premier en France à remporter le Tournoi des Cinq Nations à deux reprises, en 1954 (avec Galles et Angleterre) et en 1955 (avec Galles). Capitaine du XV de France, il participe aussi à la victoire contre les All Blacks à Colombes le 27 février 1954, en marquant l’unique essai à trois points (3-0). Il a inscrit 139 points pour le XV de France : 9 essais, 26 transformations, 15 pénalités, 5 drops. Avec son club, le FC Lourdes, dont il était le capitaine et où évoluait aussi son frère Maurice, il fut six fois champion de France (1948, 1952, 1953, 1956, 1957, 1958), trois fois finaliste du championnat de France (1945, 1946, 1955), finaliste de la coupe de France en 1948, deux fois vainqueur de la coupe de France (1950, 1951) et trois fois vainqueur du challenge Yves du Manoir (1953, 1954, 1956). Très exigeant avec lui-même, il s’astreignait à un entraînement physique quotidien, ce qui était loin d’être courant à l’époque. Il acheva sa carrière internationale en 1955, porté en triomphe sur les épaules de ses vainqueurs gallois. Il mit fin à sa carrière de joueur en 1959 pour devenir entraîneur du club de Lourdes, puis le premier sélectionneur-entraîneur officiel du XV de France de 1963 à 1967. C’est ainsi sous sa direction, que le XV de France partit en tournée en Afrique du Sud en 1964, battant les Springboks chez eux à Springs (8-6). À mettre aussi à son actif, le Tournoi des Cinq nations 1967 remporté par la France. En 1967, suite à l’élection de l’équipe Ferrasse-Batigne-Basquet à la tête de la FFR, il fut aussi le premier à se faire virer, étant l’ennemi juré de Guy Basquet depuis qu’ils avaient cohabité en équipe de France au début des années 50. Il reçut la Légion d’honneur en 1959 et fut promu officier en 1990. Quelque temps avant sa mort, il préfaçait encore l’ouvrage « 100 ans de rugby Bleu » de Richard Escot, journaliste à L’Équipe magazine (éd. Solar). En 1928, son père Joseph Prat, cultivateur, avait cédé un terrain personnel au FC Lourdais, sur lequel fut construit l’actuel stade du club. Depuis 2005, le "Trophée Jean-Prat" est désormais attribué au club champion de France de Fédérale 1, premier des clubs à accéder chaque année en Pro D2. Décédé en 2005, il laisse le souvenir d’une star de l’ovalie du XXème siècle.
 Jean PRAT, alias « Monsieur Rugby », né le 1er août 1923 à Lourdes et mort le 25 février 2005 à Tarbes, à l’âge de 81 ans. Grand joueur de rugby à XV, de 1m76 pour 84 kg, évoluant au poste de troisième ligne aile et ayant joué à chaque poste des lignes arrières, il fut sans doute la première grande figure du rugby à XV français. Doté d’un exceptionnel coup de botte, les Britanniques le surnommèrent « Mister Rugby », à l’issue du match qui vit le 28 février 1951, l’équipe de France battre pour la première fois l’équipe d’Angleterre à Twickenham (11-3). Les Anglais le surnommèrent ainsi pour son sens du commandement et surtout ses qualités de meneur d’hommes. De 1945 à 1955, il fut sélectionné cinquante et une fois (30 victoires, l nul, 20 défaites) en équipe de France (dont seize fois comme capitaine). En 1952, il devient le recordman du nombre de sélections en équipe de France. Comme capitaine, il fut le premier en France à remporter le Tournoi des Cinq Nations à deux reprises, en 1954 (avec Galles et Angleterre) et en 1955 (avec Galles). Capitaine du XV de France, il participe aussi à la victoire contre les All Blacks à Colombes le 27 février 1954, en marquant l’unique essai à trois points (3-0). Il a inscrit 139 points pour le XV de France : 9 essais, 26 transformations, 15 pénalités, 5 drops. Avec son club, le FC Lourdes, dont il était le capitaine et où évoluait aussi son frère Maurice, il fut six fois champion de France (1948, 1952, 1953, 1956, 1957, 1958), trois fois finaliste du championnat de France (1945, 1946, 1955), finaliste de la coupe de France en 1948, deux fois vainqueur de la coupe de France (1950, 1951) et trois fois vainqueur du challenge Yves du Manoir (1953, 1954, 1956). Très exigeant avec lui-même, il s’astreignait à un entraînement physique quotidien, ce qui était loin d’être courant à l’époque. Il acheva sa carrière internationale en 1955, porté en triomphe sur les épaules de ses vainqueurs gallois. Il mit fin à sa carrière de joueur en 1959 pour devenir entraîneur du club de Lourdes, puis le premier sélectionneur-entraîneur officiel du XV de France de 1963 à 1967. C’est ainsi sous sa direction, que le XV de France partit en tournée en Afrique du Sud en 1964, battant les Springboks chez eux à Springs (8-6). À mettre aussi à son actif, le Tournoi des Cinq nations 1967 remporté par la France. En 1967, suite à l’élection de l’équipe Ferrasse-Batigne-Basquet à la tête de la FFR, il fut aussi le premier à se faire virer, étant l’ennemi juré de Guy Basquet depuis qu’ils avaient cohabité en équipe de France au début des années 50. Il reçut la Légion d’honneur en 1959 et fut promu officier en 1990. Quelque temps avant sa mort, il préfaçait encore l’ouvrage « 100 ans de rugby Bleu » de Richard Escot, journaliste à L’Équipe magazine (éd. Solar). En 1928, son père Joseph Prat, cultivateur, avait cédé un terrain personnel au FC Lourdais, sur lequel fut construit l’actuel stade du club. Depuis 2005, le "Trophée Jean-Prat" est désormais attribué au club champion de France de Fédérale 1, premier des clubs à accéder chaque année en Pro D2. Décédé en 2005, il laisse le souvenir d’une star de l’ovalie du XXème siècle.
Jean PRAT, alias « Monsieur Rugby », né le 1er août 1923 à Lourdes et mort le 25 février 2005 à Tarbes, à l’âge de 81 ans. Grand joueur de rugby à XV, de 1m76 pour 84 kg, évoluant au poste de troisième ligne aile et ayant joué à chaque poste des lignes arrières, il fut sans doute la première grande figure du rugby à XV français. Doté d’un exceptionnel coup de botte, les Britanniques le surnommèrent « Mister Rugby », à l’issue du match qui vit le 28 février 1951, l’équipe de France battre pour la première fois l’équipe d’Angleterre à Twickenham (11-3). Les Anglais le surnommèrent ainsi pour son sens du commandement et surtout ses qualités de meneur d’hommes. De 1945 à 1955, il fut sélectionné cinquante et une fois (30 victoires, l nul, 20 défaites) en équipe de France (dont seize fois comme capitaine). En 1952, il devient le recordman du nombre de sélections en équipe de France. Comme capitaine, il fut le premier en France à remporter le Tournoi des Cinq Nations à deux reprises, en 1954 (avec Galles et Angleterre) et en 1955 (avec Galles). Capitaine du XV de France, il participe aussi à la victoire contre les All Blacks à Colombes le 27 février 1954, en marquant l’unique essai à trois points (3-0). Il a inscrit 139 points pour le XV de France : 9 essais, 26 transformations, 15 pénalités, 5 drops. Avec son club, le FC Lourdes, dont il était le capitaine et où évoluait aussi son frère Maurice, il fut six fois champion de France (1948, 1952, 1953, 1956, 1957, 1958), trois fois finaliste du championnat de France (1945, 1946, 1955), finaliste de la coupe de France en 1948, deux fois vainqueur de la coupe de France (1950, 1951) et trois fois vainqueur du challenge Yves du Manoir (1953, 1954, 1956). Très exigeant avec lui-même, il s’astreignait à un entraînement physique quotidien, ce qui était loin d’être courant à l’époque. Il acheva sa carrière internationale en 1955, porté en triomphe sur les épaules de ses vainqueurs gallois. Il mit fin à sa carrière de joueur en 1959 pour devenir entraîneur du club de Lourdes, puis le premier sélectionneur-entraîneur officiel du XV de France de 1963 à 1967. C’est ainsi sous sa direction, que le XV de France partit en tournée en Afrique du Sud en 1964, battant les Springboks chez eux à Springs (8-6). À mettre aussi à son actif, le Tournoi des Cinq nations 1967 remporté par la France. En 1967, suite à l’élection de l’équipe Ferrasse-Batigne-Basquet à la tête de la FFR, il fut aussi le premier à se faire virer, étant l’ennemi juré de Guy Basquet depuis qu’ils avaient cohabité en équipe de France au début des années 50. Il reçut la Légion d’honneur en 1959 et fut promu officier en 1990. Quelque temps avant sa mort, il préfaçait encore l’ouvrage « 100 ans de rugby Bleu » de Richard Escot, journaliste à L’Équipe magazine (éd. Solar). En 1928, son père Joseph Prat, cultivateur, avait cédé un terrain personnel au FC Lourdais, sur lequel fut construit l’actuel stade du club. Depuis 2005, le "Trophée Jean-Prat" est désormais attribué au club champion de France de Fédérale 1, premier des clubs à accéder chaque année en Pro D2. Décédé en 2005, il laisse le souvenir d’une star de l’ovalie du XXème siècle.RAMOND DE CARBONNIÈRES Louis (1755-1827)
Baron de l’Empire, homme politique, géologue et botaniste, le père du pyrénéisme
 Louis Ramond de Carbonnières, né le 4 janvier 1755 à Strasbourg d’un père Languedocien et d’une mère Allemande et mort à Paris le 14 mai 1827, à l’âge de 72 ans. Il fait des études d’avocat et reçoit une instruction littéraire, scientifique, technique et polyglotte. Il est connu comme l’un des premiers à avoir exploré les hauts sommets des Pyrénées et est considéré comme le fondateur du Pyrénéisme. Il a aussi laissé son nom dans la botanique avec quelques plantes qu’il a nommées et surtout la Ramondia pyrenaica, petite fleur endémique et rare. Devenu en 1781 conseiller privé et secrétaire du prince de Rohan, cardinal-évêque de Strasbourg, il se trouve mêlé malgré lui à la célèbre affaire du collier de la reine Marie-Antoinette, et suit en 1786 son maître en exil en Auvergne. Il découvre les Pyrénées en juillet 1787, en accompagnant le cardinal aux thermes de Barèges. Le cardinal y est soigné par le docteur militaire Borgella, inspecteur des eaux thermales de Barèges. Afin de mieux connaître la formation géologique de cette montagne, il fait là ses premières excursions, explorant ce massif, examinant les roches et la flore et s’émerveille devant la beauté des paysages. Il va parcourir les montagnes les plus élevées de Gavarnie à la Maladeta pour évaluer l’état des glaciers, et noter des observations très précieuses de botanique, géologie, minéralogie, nivologie. Il gravit le Pic du Midi de Bigorre pour la première fois le 2 août 1787, puis va à Gavarnie. De retour à Paris en 1788 il fit paraître en 1789, à la veille de la Révolution, ses premières « Observations faites en Pyrénées », un ouvrage salué comme « l’acte de naissance des Pyrénées », selon Henri Beraldi, un autre grand historien du Pyrénéisme. Pour se perfectionner en histoire naturelle, il suit alors les cours de Bernard de Jussieu et René Desfontaines au Jardin du roi. En 1791, il est élu député de Paris à l’Assemblée législative. Se sentant menacé par les Jacobins, en raison de son engagement politique et des troubles de la Révolution, défenseur de la Monarchie constitutionnelle, en 1792 sous la Terreur il s’enfuit de Paris avec sa sœur Rosalie et se réfugie à Barèges jusqu’en 1795, où il multiplie les observations géologiques et les herborisations, répertorie des espèces et constitue un herbier. Il rédige alors ses « Carnets » qui sont d’une certaine façon l’un des premiers guides de découverte de la montagne pyrénéenne. Il correspond avec divers botanistes réputés de l’époque dont Jean Thore et Dominique Villars. Finalement, le 15 janvier 1794, accusé d’être un ennemi de la Révolution, il est arrêté et emprisonné à Tarbes pendant 7 mois qu’il mettra à profit pour écrire quelques mémoires et rapports. Il échappe de peu à la guillotine. Pendant son incarcération, sa sœur Rosalie se marie avec le docteur Borgella. À sa libération, Ramond suit le couple dans ses domiciles successifs de Barèges, Saint-Savin et Bagnères. Entre 1795 et 1805, il habite dans la maison du docteur Borgella à Bagnères-de-Bigorre. À partir de 1796, il se rend quotidiennement à Tarbes à cheval, où il est professeur d’histoire naturelle à l’École centrale. Il occupe ce poste jusqu’à la fermeture de l’école en 1800, année où il est élu membre du Corps législatif et où il revient à Paris. En janvier 1802, il fut élu membre de l’Académie des sciences de Paris. Travaillant principalement comme minéralogiste, il monte plusieurs expéditions d’ascension du Mont Perdu (3355m), considéré alors comme le « toit » de la chaîne pyrénéenne, qu’il réussit à atteindre en août 1802, à sa troisième tentative qu’il relate dans le Journal de Mines. Ascension qui le fit devenir célèbre. En 1801, il avait fait le récit de l’ascension dans « Voyages au Mont-Perdu et dans la partie adjacente des Hautes-Pyrénées ». L’expédition qui comprenait une quinzaine de personnes, dont Picot de Lapeyrouse et plusieurs de ses élèves, trouva de nombreux fossiles, mais n’atteignit pas le sommet. Il épousa Bonne-Olympe en 1805, la veuve du général Louis-Nicolas Chérin et la fille de son ami Bon-Joseph Dacier. Ami de Napoléon 1er, il fut nommé préfet du Puy-de-Dôme en 1806 jusqu’en 1814, ce qui l’éloigna un peu des Pyrénées et baron de l’Empire en 1809. Il effectuera sa trente-cinquième ascension du Pic du Midi en 1810, depuis Barèges son lieu de villégiature. Il y a récolté des plantes sur ses flancs, rassemblé des échantillons de roches, pris des mesures barométriques à son sommet. Les récits de ses ascensions au Pic du Midi sont regroupés dans un manuscrit : « Pic du Midi : mes voyages ». En 1815, il fut élu député du Puy-de-Dôme sous l’Empire. En 1818, il fut nommé au Conseil d’État et ne quitta plus la capitale que pour se rendre en Auvergne. Il prendra sa retraite politique en 1822. En 1826, il communiqua à l'Académie des sciences un mémoire « Sur l’état de la végétation au sommet du Pic du Midi : Observations météorologiques ». Passionné de botanique, il recensa plus de huit cent espèces. Son herbier, déposé par la Société Ramond au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées à Bagnères-de-Bigorre, constitue aujourd’hui une collection patrimoniale, historique et scientifique de premier ordre, qui a été entièrement numérisée et mise en ligne. Parmi les quelque 70 plantes qui ont été décrites et nommées par Louis Ramond de Carbonnières, très peu d’espèces sont encore acceptées par la nomenclature botanique internationale actuelle. Le botaniste français Louis Claude Marie Richard a créé en juin 1805 le genre Ramonda, en l’honneur de Louis Ramond de Carbonnières. On recense officiellement aujourd’hui trois espèces de cette superbe plante, dont Ramonda myconi, petite fleur vivace endémique des Pyrénées. Le 19 août 1864, Henry Russell, Franz Schrader, Émilien Frossard, Maxwell-Lyte et Charles Packe fondèrent la société Ramond, qui existe toujours, en hommage au grand homme des Pyrénées. En 1872, Schrader associe son nom avec un sommet non encore répertorié du massif du Mont Perdu : le Soum de Ramond (3254 m). Son nom est donné également à un sommet du massif du Néouvielle, le Pic Ramougn (3011 m). Ramond est enterré au cimetière de Montmartre.
Louis Ramond de Carbonnières, né le 4 janvier 1755 à Strasbourg d’un père Languedocien et d’une mère Allemande et mort à Paris le 14 mai 1827, à l’âge de 72 ans. Il fait des études d’avocat et reçoit une instruction littéraire, scientifique, technique et polyglotte. Il est connu comme l’un des premiers à avoir exploré les hauts sommets des Pyrénées et est considéré comme le fondateur du Pyrénéisme. Il a aussi laissé son nom dans la botanique avec quelques plantes qu’il a nommées et surtout la Ramondia pyrenaica, petite fleur endémique et rare. Devenu en 1781 conseiller privé et secrétaire du prince de Rohan, cardinal-évêque de Strasbourg, il se trouve mêlé malgré lui à la célèbre affaire du collier de la reine Marie-Antoinette, et suit en 1786 son maître en exil en Auvergne. Il découvre les Pyrénées en juillet 1787, en accompagnant le cardinal aux thermes de Barèges. Le cardinal y est soigné par le docteur militaire Borgella, inspecteur des eaux thermales de Barèges. Afin de mieux connaître la formation géologique de cette montagne, il fait là ses premières excursions, explorant ce massif, examinant les roches et la flore et s’émerveille devant la beauté des paysages. Il va parcourir les montagnes les plus élevées de Gavarnie à la Maladeta pour évaluer l’état des glaciers, et noter des observations très précieuses de botanique, géologie, minéralogie, nivologie. Il gravit le Pic du Midi de Bigorre pour la première fois le 2 août 1787, puis va à Gavarnie. De retour à Paris en 1788 il fit paraître en 1789, à la veille de la Révolution, ses premières « Observations faites en Pyrénées », un ouvrage salué comme « l’acte de naissance des Pyrénées », selon Henri Beraldi, un autre grand historien du Pyrénéisme. Pour se perfectionner en histoire naturelle, il suit alors les cours de Bernard de Jussieu et René Desfontaines au Jardin du roi. En 1791, il est élu député de Paris à l’Assemblée législative. Se sentant menacé par les Jacobins, en raison de son engagement politique et des troubles de la Révolution, défenseur de la Monarchie constitutionnelle, en 1792 sous la Terreur il s’enfuit de Paris avec sa sœur Rosalie et se réfugie à Barèges jusqu’en 1795, où il multiplie les observations géologiques et les herborisations, répertorie des espèces et constitue un herbier. Il rédige alors ses « Carnets » qui sont d’une certaine façon l’un des premiers guides de découverte de la montagne pyrénéenne. Il correspond avec divers botanistes réputés de l’époque dont Jean Thore et Dominique Villars. Finalement, le 15 janvier 1794, accusé d’être un ennemi de la Révolution, il est arrêté et emprisonné à Tarbes pendant 7 mois qu’il mettra à profit pour écrire quelques mémoires et rapports. Il échappe de peu à la guillotine. Pendant son incarcération, sa sœur Rosalie se marie avec le docteur Borgella. À sa libération, Ramond suit le couple dans ses domiciles successifs de Barèges, Saint-Savin et Bagnères. Entre 1795 et 1805, il habite dans la maison du docteur Borgella à Bagnères-de-Bigorre. À partir de 1796, il se rend quotidiennement à Tarbes à cheval, où il est professeur d’histoire naturelle à l’École centrale. Il occupe ce poste jusqu’à la fermeture de l’école en 1800, année où il est élu membre du Corps législatif et où il revient à Paris. En janvier 1802, il fut élu membre de l’Académie des sciences de Paris. Travaillant principalement comme minéralogiste, il monte plusieurs expéditions d’ascension du Mont Perdu (3355m), considéré alors comme le « toit » de la chaîne pyrénéenne, qu’il réussit à atteindre en août 1802, à sa troisième tentative qu’il relate dans le Journal de Mines. Ascension qui le fit devenir célèbre. En 1801, il avait fait le récit de l’ascension dans « Voyages au Mont-Perdu et dans la partie adjacente des Hautes-Pyrénées ». L’expédition qui comprenait une quinzaine de personnes, dont Picot de Lapeyrouse et plusieurs de ses élèves, trouva de nombreux fossiles, mais n’atteignit pas le sommet. Il épousa Bonne-Olympe en 1805, la veuve du général Louis-Nicolas Chérin et la fille de son ami Bon-Joseph Dacier. Ami de Napoléon 1er, il fut nommé préfet du Puy-de-Dôme en 1806 jusqu’en 1814, ce qui l’éloigna un peu des Pyrénées et baron de l’Empire en 1809. Il effectuera sa trente-cinquième ascension du Pic du Midi en 1810, depuis Barèges son lieu de villégiature. Il y a récolté des plantes sur ses flancs, rassemblé des échantillons de roches, pris des mesures barométriques à son sommet. Les récits de ses ascensions au Pic du Midi sont regroupés dans un manuscrit : « Pic du Midi : mes voyages ». En 1815, il fut élu député du Puy-de-Dôme sous l’Empire. En 1818, il fut nommé au Conseil d’État et ne quitta plus la capitale que pour se rendre en Auvergne. Il prendra sa retraite politique en 1822. En 1826, il communiqua à l'Académie des sciences un mémoire « Sur l’état de la végétation au sommet du Pic du Midi : Observations météorologiques ». Passionné de botanique, il recensa plus de huit cent espèces. Son herbier, déposé par la Société Ramond au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées à Bagnères-de-Bigorre, constitue aujourd’hui une collection patrimoniale, historique et scientifique de premier ordre, qui a été entièrement numérisée et mise en ligne. Parmi les quelque 70 plantes qui ont été décrites et nommées par Louis Ramond de Carbonnières, très peu d’espèces sont encore acceptées par la nomenclature botanique internationale actuelle. Le botaniste français Louis Claude Marie Richard a créé en juin 1805 le genre Ramonda, en l’honneur de Louis Ramond de Carbonnières. On recense officiellement aujourd’hui trois espèces de cette superbe plante, dont Ramonda myconi, petite fleur vivace endémique des Pyrénées. Le 19 août 1864, Henry Russell, Franz Schrader, Émilien Frossard, Maxwell-Lyte et Charles Packe fondèrent la société Ramond, qui existe toujours, en hommage au grand homme des Pyrénées. En 1872, Schrader associe son nom avec un sommet non encore répertorié du massif du Mont Perdu : le Soum de Ramond (3254 m). Son nom est donné également à un sommet du massif du Néouvielle, le Pic Ramougn (3011 m). Ramond est enterré au cimetière de Montmartre.
 Louis Ramond de Carbonnières, né le 4 janvier 1755 à Strasbourg d’un père Languedocien et d’une mère Allemande et mort à Paris le 14 mai 1827, à l’âge de 72 ans. Il fait des études d’avocat et reçoit une instruction littéraire, scientifique, technique et polyglotte. Il est connu comme l’un des premiers à avoir exploré les hauts sommets des Pyrénées et est considéré comme le fondateur du Pyrénéisme. Il a aussi laissé son nom dans la botanique avec quelques plantes qu’il a nommées et surtout la Ramondia pyrenaica, petite fleur endémique et rare. Devenu en 1781 conseiller privé et secrétaire du prince de Rohan, cardinal-évêque de Strasbourg, il se trouve mêlé malgré lui à la célèbre affaire du collier de la reine Marie-Antoinette, et suit en 1786 son maître en exil en Auvergne. Il découvre les Pyrénées en juillet 1787, en accompagnant le cardinal aux thermes de Barèges. Le cardinal y est soigné par le docteur militaire Borgella, inspecteur des eaux thermales de Barèges. Afin de mieux connaître la formation géologique de cette montagne, il fait là ses premières excursions, explorant ce massif, examinant les roches et la flore et s’émerveille devant la beauté des paysages. Il va parcourir les montagnes les plus élevées de Gavarnie à la Maladeta pour évaluer l’état des glaciers, et noter des observations très précieuses de botanique, géologie, minéralogie, nivologie. Il gravit le Pic du Midi de Bigorre pour la première fois le 2 août 1787, puis va à Gavarnie. De retour à Paris en 1788 il fit paraître en 1789, à la veille de la Révolution, ses premières « Observations faites en Pyrénées », un ouvrage salué comme « l’acte de naissance des Pyrénées », selon Henri Beraldi, un autre grand historien du Pyrénéisme. Pour se perfectionner en histoire naturelle, il suit alors les cours de Bernard de Jussieu et René Desfontaines au Jardin du roi. En 1791, il est élu député de Paris à l’Assemblée législative. Se sentant menacé par les Jacobins, en raison de son engagement politique et des troubles de la Révolution, défenseur de la Monarchie constitutionnelle, en 1792 sous la Terreur il s’enfuit de Paris avec sa sœur Rosalie et se réfugie à Barèges jusqu’en 1795, où il multiplie les observations géologiques et les herborisations, répertorie des espèces et constitue un herbier. Il rédige alors ses « Carnets » qui sont d’une certaine façon l’un des premiers guides de découverte de la montagne pyrénéenne. Il correspond avec divers botanistes réputés de l’époque dont Jean Thore et Dominique Villars. Finalement, le 15 janvier 1794, accusé d’être un ennemi de la Révolution, il est arrêté et emprisonné à Tarbes pendant 7 mois qu’il mettra à profit pour écrire quelques mémoires et rapports. Il échappe de peu à la guillotine. Pendant son incarcération, sa sœur Rosalie se marie avec le docteur Borgella. À sa libération, Ramond suit le couple dans ses domiciles successifs de Barèges, Saint-Savin et Bagnères. Entre 1795 et 1805, il habite dans la maison du docteur Borgella à Bagnères-de-Bigorre. À partir de 1796, il se rend quotidiennement à Tarbes à cheval, où il est professeur d’histoire naturelle à l’École centrale. Il occupe ce poste jusqu’à la fermeture de l’école en 1800, année où il est élu membre du Corps législatif et où il revient à Paris. En janvier 1802, il fut élu membre de l’Académie des sciences de Paris. Travaillant principalement comme minéralogiste, il monte plusieurs expéditions d’ascension du Mont Perdu (3355m), considéré alors comme le « toit » de la chaîne pyrénéenne, qu’il réussit à atteindre en août 1802, à sa troisième tentative qu’il relate dans le Journal de Mines. Ascension qui le fit devenir célèbre. En 1801, il avait fait le récit de l’ascension dans « Voyages au Mont-Perdu et dans la partie adjacente des Hautes-Pyrénées ». L’expédition qui comprenait une quinzaine de personnes, dont Picot de Lapeyrouse et plusieurs de ses élèves, trouva de nombreux fossiles, mais n’atteignit pas le sommet. Il épousa Bonne-Olympe en 1805, la veuve du général Louis-Nicolas Chérin et la fille de son ami Bon-Joseph Dacier. Ami de Napoléon 1er, il fut nommé préfet du Puy-de-Dôme en 1806 jusqu’en 1814, ce qui l’éloigna un peu des Pyrénées et baron de l’Empire en 1809. Il effectuera sa trente-cinquième ascension du Pic du Midi en 1810, depuis Barèges son lieu de villégiature. Il y a récolté des plantes sur ses flancs, rassemblé des échantillons de roches, pris des mesures barométriques à son sommet. Les récits de ses ascensions au Pic du Midi sont regroupés dans un manuscrit : « Pic du Midi : mes voyages ». En 1815, il fut élu député du Puy-de-Dôme sous l’Empire. En 1818, il fut nommé au Conseil d’État et ne quitta plus la capitale que pour se rendre en Auvergne. Il prendra sa retraite politique en 1822. En 1826, il communiqua à l'Académie des sciences un mémoire « Sur l’état de la végétation au sommet du Pic du Midi : Observations météorologiques ». Passionné de botanique, il recensa plus de huit cent espèces. Son herbier, déposé par la Société Ramond au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées à Bagnères-de-Bigorre, constitue aujourd’hui une collection patrimoniale, historique et scientifique de premier ordre, qui a été entièrement numérisée et mise en ligne. Parmi les quelque 70 plantes qui ont été décrites et nommées par Louis Ramond de Carbonnières, très peu d’espèces sont encore acceptées par la nomenclature botanique internationale actuelle. Le botaniste français Louis Claude Marie Richard a créé en juin 1805 le genre Ramonda, en l’honneur de Louis Ramond de Carbonnières. On recense officiellement aujourd’hui trois espèces de cette superbe plante, dont Ramonda myconi, petite fleur vivace endémique des Pyrénées. Le 19 août 1864, Henry Russell, Franz Schrader, Émilien Frossard, Maxwell-Lyte et Charles Packe fondèrent la société Ramond, qui existe toujours, en hommage au grand homme des Pyrénées. En 1872, Schrader associe son nom avec un sommet non encore répertorié du massif du Mont Perdu : le Soum de Ramond (3254 m). Son nom est donné également à un sommet du massif du Néouvielle, le Pic Ramougn (3011 m). Ramond est enterré au cimetière de Montmartre.
Louis Ramond de Carbonnières, né le 4 janvier 1755 à Strasbourg d’un père Languedocien et d’une mère Allemande et mort à Paris le 14 mai 1827, à l’âge de 72 ans. Il fait des études d’avocat et reçoit une instruction littéraire, scientifique, technique et polyglotte. Il est connu comme l’un des premiers à avoir exploré les hauts sommets des Pyrénées et est considéré comme le fondateur du Pyrénéisme. Il a aussi laissé son nom dans la botanique avec quelques plantes qu’il a nommées et surtout la Ramondia pyrenaica, petite fleur endémique et rare. Devenu en 1781 conseiller privé et secrétaire du prince de Rohan, cardinal-évêque de Strasbourg, il se trouve mêlé malgré lui à la célèbre affaire du collier de la reine Marie-Antoinette, et suit en 1786 son maître en exil en Auvergne. Il découvre les Pyrénées en juillet 1787, en accompagnant le cardinal aux thermes de Barèges. Le cardinal y est soigné par le docteur militaire Borgella, inspecteur des eaux thermales de Barèges. Afin de mieux connaître la formation géologique de cette montagne, il fait là ses premières excursions, explorant ce massif, examinant les roches et la flore et s’émerveille devant la beauté des paysages. Il va parcourir les montagnes les plus élevées de Gavarnie à la Maladeta pour évaluer l’état des glaciers, et noter des observations très précieuses de botanique, géologie, minéralogie, nivologie. Il gravit le Pic du Midi de Bigorre pour la première fois le 2 août 1787, puis va à Gavarnie. De retour à Paris en 1788 il fit paraître en 1789, à la veille de la Révolution, ses premières « Observations faites en Pyrénées », un ouvrage salué comme « l’acte de naissance des Pyrénées », selon Henri Beraldi, un autre grand historien du Pyrénéisme. Pour se perfectionner en histoire naturelle, il suit alors les cours de Bernard de Jussieu et René Desfontaines au Jardin du roi. En 1791, il est élu député de Paris à l’Assemblée législative. Se sentant menacé par les Jacobins, en raison de son engagement politique et des troubles de la Révolution, défenseur de la Monarchie constitutionnelle, en 1792 sous la Terreur il s’enfuit de Paris avec sa sœur Rosalie et se réfugie à Barèges jusqu’en 1795, où il multiplie les observations géologiques et les herborisations, répertorie des espèces et constitue un herbier. Il rédige alors ses « Carnets » qui sont d’une certaine façon l’un des premiers guides de découverte de la montagne pyrénéenne. Il correspond avec divers botanistes réputés de l’époque dont Jean Thore et Dominique Villars. Finalement, le 15 janvier 1794, accusé d’être un ennemi de la Révolution, il est arrêté et emprisonné à Tarbes pendant 7 mois qu’il mettra à profit pour écrire quelques mémoires et rapports. Il échappe de peu à la guillotine. Pendant son incarcération, sa sœur Rosalie se marie avec le docteur Borgella. À sa libération, Ramond suit le couple dans ses domiciles successifs de Barèges, Saint-Savin et Bagnères. Entre 1795 et 1805, il habite dans la maison du docteur Borgella à Bagnères-de-Bigorre. À partir de 1796, il se rend quotidiennement à Tarbes à cheval, où il est professeur d’histoire naturelle à l’École centrale. Il occupe ce poste jusqu’à la fermeture de l’école en 1800, année où il est élu membre du Corps législatif et où il revient à Paris. En janvier 1802, il fut élu membre de l’Académie des sciences de Paris. Travaillant principalement comme minéralogiste, il monte plusieurs expéditions d’ascension du Mont Perdu (3355m), considéré alors comme le « toit » de la chaîne pyrénéenne, qu’il réussit à atteindre en août 1802, à sa troisième tentative qu’il relate dans le Journal de Mines. Ascension qui le fit devenir célèbre. En 1801, il avait fait le récit de l’ascension dans « Voyages au Mont-Perdu et dans la partie adjacente des Hautes-Pyrénées ». L’expédition qui comprenait une quinzaine de personnes, dont Picot de Lapeyrouse et plusieurs de ses élèves, trouva de nombreux fossiles, mais n’atteignit pas le sommet. Il épousa Bonne-Olympe en 1805, la veuve du général Louis-Nicolas Chérin et la fille de son ami Bon-Joseph Dacier. Ami de Napoléon 1er, il fut nommé préfet du Puy-de-Dôme en 1806 jusqu’en 1814, ce qui l’éloigna un peu des Pyrénées et baron de l’Empire en 1809. Il effectuera sa trente-cinquième ascension du Pic du Midi en 1810, depuis Barèges son lieu de villégiature. Il y a récolté des plantes sur ses flancs, rassemblé des échantillons de roches, pris des mesures barométriques à son sommet. Les récits de ses ascensions au Pic du Midi sont regroupés dans un manuscrit : « Pic du Midi : mes voyages ». En 1815, il fut élu député du Puy-de-Dôme sous l’Empire. En 1818, il fut nommé au Conseil d’État et ne quitta plus la capitale que pour se rendre en Auvergne. Il prendra sa retraite politique en 1822. En 1826, il communiqua à l'Académie des sciences un mémoire « Sur l’état de la végétation au sommet du Pic du Midi : Observations météorologiques ». Passionné de botanique, il recensa plus de huit cent espèces. Son herbier, déposé par la Société Ramond au Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées à Bagnères-de-Bigorre, constitue aujourd’hui une collection patrimoniale, historique et scientifique de premier ordre, qui a été entièrement numérisée et mise en ligne. Parmi les quelque 70 plantes qui ont été décrites et nommées par Louis Ramond de Carbonnières, très peu d’espèces sont encore acceptées par la nomenclature botanique internationale actuelle. Le botaniste français Louis Claude Marie Richard a créé en juin 1805 le genre Ramonda, en l’honneur de Louis Ramond de Carbonnières. On recense officiellement aujourd’hui trois espèces de cette superbe plante, dont Ramonda myconi, petite fleur vivace endémique des Pyrénées. Le 19 août 1864, Henry Russell, Franz Schrader, Émilien Frossard, Maxwell-Lyte et Charles Packe fondèrent la société Ramond, qui existe toujours, en hommage au grand homme des Pyrénées. En 1872, Schrader associe son nom avec un sommet non encore répertorié du massif du Mont Perdu : le Soum de Ramond (3254 m). Son nom est donné également à un sommet du massif du Néouvielle, le Pic Ramougn (3011 m). Ramond est enterré au cimetière de Montmartre.REVEL Nicolas (1966-XXXX)
Directeur de cabinet du Premier ministre, ancien secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées
 Nicolas REVEL, né le 26 mai 1966 à Paris, est un haut fonctionnaire français. Il est le Directeur de cabinet du Premier ministre depuis le 3 juillet 2020. Fils de l’académicien Jean-François Revel et de la journaliste Claude Sarraute, il a été, de 1997 à 2000, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées. En 2000, Jean Glavany, Bigourdan d’adoption, alors ministre de l’Agriculture, a repéré le jeune énarque et en fait son conseiller technique à l’hôtel de Villeroy. Et l’ascension se poursuit : en 2003, il devient directeur de cabinet adjoint de Bertrand Delanoë à la Mairie de Paris, puis en 2008, directeur de cabinet de plein exercice. Et ce jusqu’en 2012, où il met un pied à l’Élysée, en étant nommé Secrétaire général adjoint de l’Élysée, sous François Hollande, aux côtés d’un certain Emmanuel Macron. Il est chargé des questions sociales. Puis, en 2014, il devient directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), poste auquel il a été confirmé en 2019. En 2017, Emmanuel Macron tenta en vain de l'imposer comme directeur de cabinet à Édouard Philippe après la nomination de ce dernier comme Premier ministre. En 2018, pressenti pour remplacer Gérard Collomb comme ministre de l'Intérieur, il décline poliment pour raisons personnelles. Il fut également approché pour remplacer Alexis Kohler, comme secrétaire général de l'Élysée. Et le voilà aujourd’hui n° 2 de Matignon.
Nicolas REVEL, né le 26 mai 1966 à Paris, est un haut fonctionnaire français. Il est le Directeur de cabinet du Premier ministre depuis le 3 juillet 2020. Fils de l’académicien Jean-François Revel et de la journaliste Claude Sarraute, il a été, de 1997 à 2000, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées. En 2000, Jean Glavany, Bigourdan d’adoption, alors ministre de l’Agriculture, a repéré le jeune énarque et en fait son conseiller technique à l’hôtel de Villeroy. Et l’ascension se poursuit : en 2003, il devient directeur de cabinet adjoint de Bertrand Delanoë à la Mairie de Paris, puis en 2008, directeur de cabinet de plein exercice. Et ce jusqu’en 2012, où il met un pied à l’Élysée, en étant nommé Secrétaire général adjoint de l’Élysée, sous François Hollande, aux côtés d’un certain Emmanuel Macron. Il est chargé des questions sociales. Puis, en 2014, il devient directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), poste auquel il a été confirmé en 2019. En 2017, Emmanuel Macron tenta en vain de l'imposer comme directeur de cabinet à Édouard Philippe après la nomination de ce dernier comme Premier ministre. En 2018, pressenti pour remplacer Gérard Collomb comme ministre de l'Intérieur, il décline poliment pour raisons personnelles. Il fut également approché pour remplacer Alexis Kohler, comme secrétaire général de l'Élysée. Et le voilà aujourd’hui n° 2 de Matignon.
 Nicolas REVEL, né le 26 mai 1966 à Paris, est un haut fonctionnaire français. Il est le Directeur de cabinet du Premier ministre depuis le 3 juillet 2020. Fils de l’académicien Jean-François Revel et de la journaliste Claude Sarraute, il a été, de 1997 à 2000, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées. En 2000, Jean Glavany, Bigourdan d’adoption, alors ministre de l’Agriculture, a repéré le jeune énarque et en fait son conseiller technique à l’hôtel de Villeroy. Et l’ascension se poursuit : en 2003, il devient directeur de cabinet adjoint de Bertrand Delanoë à la Mairie de Paris, puis en 2008, directeur de cabinet de plein exercice. Et ce jusqu’en 2012, où il met un pied à l’Élysée, en étant nommé Secrétaire général adjoint de l’Élysée, sous François Hollande, aux côtés d’un certain Emmanuel Macron. Il est chargé des questions sociales. Puis, en 2014, il devient directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), poste auquel il a été confirmé en 2019. En 2017, Emmanuel Macron tenta en vain de l'imposer comme directeur de cabinet à Édouard Philippe après la nomination de ce dernier comme Premier ministre. En 2018, pressenti pour remplacer Gérard Collomb comme ministre de l'Intérieur, il décline poliment pour raisons personnelles. Il fut également approché pour remplacer Alexis Kohler, comme secrétaire général de l'Élysée. Et le voilà aujourd’hui n° 2 de Matignon.
Nicolas REVEL, né le 26 mai 1966 à Paris, est un haut fonctionnaire français. Il est le Directeur de cabinet du Premier ministre depuis le 3 juillet 2020. Fils de l’académicien Jean-François Revel et de la journaliste Claude Sarraute, il a été, de 1997 à 2000, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Pyrénées. En 2000, Jean Glavany, Bigourdan d’adoption, alors ministre de l’Agriculture, a repéré le jeune énarque et en fait son conseiller technique à l’hôtel de Villeroy. Et l’ascension se poursuit : en 2003, il devient directeur de cabinet adjoint de Bertrand Delanoë à la Mairie de Paris, puis en 2008, directeur de cabinet de plein exercice. Et ce jusqu’en 2012, où il met un pied à l’Élysée, en étant nommé Secrétaire général adjoint de l’Élysée, sous François Hollande, aux côtés d’un certain Emmanuel Macron. Il est chargé des questions sociales. Puis, en 2014, il devient directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), poste auquel il a été confirmé en 2019. En 2017, Emmanuel Macron tenta en vain de l'imposer comme directeur de cabinet à Édouard Philippe après la nomination de ce dernier comme Premier ministre. En 2018, pressenti pour remplacer Gérard Collomb comme ministre de l'Intérieur, il décline poliment pour raisons personnelles. Il fut également approché pour remplacer Alexis Kohler, comme secrétaire général de l'Élysée. Et le voilà aujourd’hui n° 2 de Matignon.RUSSEL Henry (1834-1909)
Aristocrate, 26e baron de Killough, aventurier et écrivain, fondateur du pyrénéisme surnommé le «fou» du Vignemale
 Le comte Henry Russell, né en 1834 à Toulouse et mort à Biarritz le 5 février 1909, à l’âge de 75 ans est considéré comme l’apôtre du pyrénéisme. Fils d’aristocrate, mi-Irlandais par son père issu d’une vieille et riche famille irlandaise et mi-Gascon par sa mère, comtesse de Flamarens dans le Gers. Il découvre les Pyrénées lorsque sa famille s’installe à Pau et Bagnères-de-Bigorre. Et c’est sa mère qui le met pour la première fois en contact avec la montagne au cours de petites randonnées. Il arpente la chaîne pendant plus de 50 ans, y faisant la plupart des « premières » sur les pics de plus de 3000 mètres. Une rencontre va sceller son destin. De famille catholique, il s’éprend à Biarritz d’une jeune anglaise prénommée Maud, fille d’un pasteur anglican. Passion partagée, mais les deux familles refusent cette union entre deux religions inconciliables à l’époque. Henry va puiser dans ce chagrin d’amour le carburant de son désir d’absolu. Il épousera donc les Pyrénées ! Des années durant, le jeune comte parcourt ces montagnes féminines en une marche triomphante. Cette âme romantique choisit le plus haut sommet des Pyrénées françaises, dans les Hautes-Pyrénées, pour annoncer ses noces : le Vignemale (3298m), qu’il gravira 33 fois. « Elle sera mon épouse ! » proclame-t-il alors. Etablir une liaison amoureuse avec un tas de rochers aussi élevé soit-il, voilà une idée bien iconoclaste. À l’âge de 23 ans, il entreprend son premier voyage lointain, qui le conduit jusqu’en Amérique du nord. De retour à Pau, il se lance à la conquête des Pyrénées. L’été 1858, il se trouve à Barèges et découvre véritablement la montagne : il ascensionne le Néouvielle, l’Ardiden et trois fois le Mont Perdu, dont une fois seul à partir de Luz-Saint-Sauveur. En août 1858, à Gavarnie, il manque de mourir de froid, de faim et de fatigue : perdu dans la tempête sur les gradins du cirque, il erre une nuit durant au bord des précipices. Ayant l’âme d’un voyageur au long cours, en 1859, il s’engage dans la marine, et part pour son second voyage lointain qui durera trois ans. Il parcourt 65000 km. Il se rend à Saint-Pétersbourg, Moscou, Irkoutsk, Pékin. Il traverse deux fois le désert de Gobi, descend le fleuve Amour en Asie orientale. Par la voie maritime il rallie Shanghai, Hong Kong, Macao, Canton, Melbourne, Wellington, Ceylan, Calcutta. Il passe une année en Inde et reprend le chemin de l’Europe par Le Caire et Constantinople. Il vit ainsi de ses rentes, en bon explorateur et dandy qui se respecte. Deux périples lointains qui lui fournirent la matière de deux ouvrages devenus des incontournables de la littérature de voyage : « Notes par voies et chemins à travers le Nouveau Monde » (1858) et surtout « 16.000 lieues à travers l’Asie et l’Océanie » (1864), primé par la Société de Géographie. On dit que Jules Verne s’inspira des récits de ses voyages pour imaginer le personnage de Michel Strogoff ou même celui de Phileas Fogg dans « Le Tour du monde en 80 jours » (1872). Mais ne supportant plus cette discipline trop stricte à bord de navires, le voilà de retour dans les Pyrénées en 1861. Dès lors, il consacrera le reste de sa vie et sa fortune personnelle à l’exploration des Pyrénées. Seul, ou avec ses guides il effectue d’innombrables ascensions, réalisant une trentaine de premières, parfois en plein hiver. Il vit d’une belle fortune personnelle et des rentes de ses placements bancaires. Durant l’hiver il se plie aux contraintes de la vie mondaine dans les salons et réceptions de la haute bourgeoisie paloise, mais dès les premiers jours de l’été, il repart vers les sommets. Son destin est lié au Vignemale où il monte pour la première fois le 14 septembre 1861 avec le guide Laurent Passet. Le 19 août 1864, à l’Hôtel des Voyageurs de Gavarnie, il fonde avec Farnham Maxwell-Lyte, Charles Packe et Émilien Frossard, en hommage à Carbonnières, la première société de montagnards : la Société Ramond sur le modèle de l’Alpine Club, créé à Londres en 1857, auquel Russel et Packe appartiennent déjà. Le premier président d’honneur de la Société Ramond fut un autre pionnier du pyrénéisme, Vincent de Chausenque, ancien capitaine du Génie et auteur de : « Les Pyrénées ou voyages pédestres dans toutes les régions de ces montagnes depuis l’Océan jusqu’à la Méditerranée », publié en 1834. Sept ans plus tard en 1868, il monte au Vignemale pour la seconde fois avec Hippolyte Passet. Pour sa troisième ascension, il effectue la première hivernale le 11 février 1869 avec Hippolyte et Henri Passet. C’est la première grande ascension hivernale effectuée en Europe. Henry Russell veut passer des nuits en montagne et invente le sac de couchage en peaux d’agneaux cousues. Le 26 août 1880, il passe une nuit à la belle étoile au sommet de la Pique Longue. Mais rattrapé par le froid et souhaitant se fixer sur le Vignemale et en faire sa résidence d’été il envisage alors l’emménagement de grottes, car selon lui, tout autre construction défigurerait l’aspect sauvage de la montagne. Il fait creuser et aménager à ses frais sept grottes dans une roche extrêmement dure, à différentes altitudes, en raison des caprices du glacier d’Ossoue, afin de prendre ses quartiers d’été au-dessus de 3000 mètres d’altitude et de recevoir dignement ses amis de passage. Le travail s’étale de 1881 à 1893. Il fait creuser sa première grotte sur les flancs du Cerbillona, près du col de Cerbillona, en haut du glacier d’Ossoue, par l’entrepreneur Étienne Theil, de Gèdre, qui a déjà bâti l’abri du Mont Perdu. Le 1 août 1882 la première grotte percée à l’aide de barres à mine et d’explosifs est inaugurée ; c’est la villa Russell, située à 3195m d’altitude au col de Cerbillona (3 m de long, 2,5 m de large et 2 m de haut). Russell habite sa grotte pendant trois jours. Le 12 août 1884, il la fait bénir ainsi que le massif du Vignemale par le curé de Gèdre et le Père Pascal Carrère. Trois messes sont célébrées devant une assistance d’une trentaine de personnes. La grotte est progressivement équipée et aménagée, jusqu’à recevoir un poêle. Gravir la Pique Longue ne prend désormais qu’une dizaine de minutes, monter au Clot de la Hount et revenir ne prend pas plus de 25 minutes. En 1885, il fait creuser la seconde grotte ; celle des Guides à un niveau légèrement supérieur à celui de la Villa Russell, puis en 1886 la troisième et la plus haute ; celle des Dames, son plus grand succès, dira-t-il. Les dames de la bonne société cosmopolite qui, comme les guides, disposaient de leurs propres nids d’aigle, matelassés de paille et munis d’un poêle à charbon. Le 5 décembre 1888, il demande au préfet des Hautes-Pyrénées, de lui accorder la concession sur « sa » montagne du Vignemale (200 ha entre 2300 et 3300 mètres). Demande extravagante, mais elle est accordée. La location annuelle est fixée à 1 franc pour un bail emphytéotique de 99 ans, qui débute en janvier 1889 et s’acheva en 1989, quatre-vingt ans après sa mort. Il fera ériger au sommet du Vignemale une tour de pierres de trois mètres de haut pour lui faire dépasser symboliquement la barre des 3300 mètres. Certains étés, la croûte glaciaire recouvrant ses grottes aménagées, trois autres seront creusées 800 mètres plus bas en dessous du glacier et sur le sentier qui mène à la Hourquette d’Ossoue, à 2400 mètres : les grottes Bellevue creusées en 1888 et 1889. Et la légende veut qu’il y offre l’hospitalité et qu’on y organise des réceptions mondaines somptueuses et légendaires, recevant princes et rois, voyageurs et personnages illustres sur un tapis rouge, qu’il fait dérouler sur la neige. À la lueur des chandelles, dans un confort spartiate, on converse, on déguste vins fins et punch brûlant, on savoure la sole à la Dieppoise, on fume le cigare… Puis en 1892-93, avec la nostalgie de l’altitude, 18 mètres sous le dôme du Vignemale, à 3280 mètres, sa dernière grotte voit le jour : la grotte Paradis, offrant un point de vue magnifique sur le grand glacier d’Ossoue et les sommets alentour : Mont Perdu (3355m), ceux du Cirque de Gavarnie, le Balaïtous (3144m) … Chacune des sept grottes a une entrée maçonnée et est fermée par une porte en fer peinte au minium. Russel fait forger des clés avec ses initiales. Le voilà propriétaire du Vignemale : il en détient les clés. Il a voué sa vie à conquérir ces grands sommets, qu’il a inlassablement parcourus à grandes enjambées, du haut de sa haute silhouette dégingandée. Il montera pour la trente-troisième et dernière fois au sommet de son cher Grand Vignemale, à 3298 mètres au-dessus des mortels, le 8 août 1904 à l’âge de 70 ans. Au total, il y aura passé cent quarante-sept nuits en ermite et parfois avec ses invités de marque, artistes ou écrivains mondains, réchauffés par une profusion de tapis d’Orient dans un décor de colonnes de neige. Peu avant sa mort à Biarritz en 1909, il confiera les clés de ses grottes à un autre visiteur illustre, le poète et lauréat du prix Nobel de littérature (1960), Saint-John Perse. La grotte du Paradis sert toujours occasionnellement d’abri aux ascensionnistes. Une plaque en hommage à Russell, qui rappelle sa vie, son œuvre et son mythe y a été apposée. Cette légende vivante, cet ermite « qui avait épousé une montagne » et dont la vie est émaillée d’exploits, de premières, de réussites extraordinaires pour l’époque, repose au cimetière de Pau. Les grottes du comte Russel sont toujours visibles aujourd’hui, bien qu’en mauvais état. Quant au glacier d’Ossoue, il a considérablement reculé subissant de plein fouet les affres du changement climatique et des hivers moins neigeux. Il nous reste la légende du fantasque comte, tellement amoureux d’une montagne qu’il épousa corps et âme, faute de pouvoir vivre avec la femme de sa vie. Membre du Club alpin (CAF) de Bordeaux, il est le plus connu des pyrénéistes. Il a écrit ses mémoires, des récits de voyages et de nombreux ouvrages qui relatent ses ascensions et états d’âme dans « Souvenirs d’un montagnard », dont la première édition date de 1878. Cette somme de 730 pages relate par le menu plus d’une centaine d’ascensions pyrénéennes, dont de multiples premières, notamment celle du Petit Nethou (3205m), situé à l’extrémité Est du massif de la Maladeta, rebaptisé Pic Russell en son honneur. Considéré comme le fondateur du pyrénéisme, routard et écologiste avant l’heure, il est l’inventeur des refuges, même si sa vision élitiste lui fit rejeter les constructions en pierre, l’escalade sportive et l’ouverture de la montagne au grand public. Toutes ses ascensions avaient pour base de départ le village de Gavarnie et plus particulièrement le célèbre Hôtel des Voyageurs. Ce gentleman aventurier admiré, un brin excentrique, les yeux et l’esprit toujours tournés vers les sommets, nourri au sein romantique était reçu dans la bonne société paloise et biarrote, où on se bousculait pour l’entendre raconter les mille et une anecdotes qui avaient émaillé ses voyages et ses ascensions. Nous vous recommandons l’excellente biographie que nous livre son arrière-petite-nièce, Monique Dollin du Fresnel, dans un livre publié par les Éditions Sud Ouest, sous le titre « Henry Russel (1834-1909) – Une vie pour les Pyrénées » où elle y décrit avec amour cet oncle à la fois original et attachant, sauvage et mondain, romantique et précis, écrivain, poète, musicien, mélomane averti, mais surtout montagnard. Comme quoi, l’amour de la nature n’est pas incompatible avec celui de la culture, autre forme d’aventure. Plus modeste que l’ouvrage de Monique Dollin du Fresnel nous vous signalons aussi le livre de Marcel Pérès, né en 1943 à Ossun et ayant vécu à Argelès-Gazost, docteur ès lettres, ancien directeur de l’École nationale de ski et d’alpinisme à Chamonix (1979-1984) puis préfet hors cadre : « Henry Russel et ses grottes – Le fou du Vignemale », paru en 2009 chez PUG. Le 5 septembre 1911 fut inaugurée à l’entrée du village de Gavarnie, qui lui servait de « camp de base », une statue d’Henry Russel due au sculpteur Gaston Leroux. La Légion d’honneur lui avait été décernée en 1901.
Le comte Henry Russell, né en 1834 à Toulouse et mort à Biarritz le 5 février 1909, à l’âge de 75 ans est considéré comme l’apôtre du pyrénéisme. Fils d’aristocrate, mi-Irlandais par son père issu d’une vieille et riche famille irlandaise et mi-Gascon par sa mère, comtesse de Flamarens dans le Gers. Il découvre les Pyrénées lorsque sa famille s’installe à Pau et Bagnères-de-Bigorre. Et c’est sa mère qui le met pour la première fois en contact avec la montagne au cours de petites randonnées. Il arpente la chaîne pendant plus de 50 ans, y faisant la plupart des « premières » sur les pics de plus de 3000 mètres. Une rencontre va sceller son destin. De famille catholique, il s’éprend à Biarritz d’une jeune anglaise prénommée Maud, fille d’un pasteur anglican. Passion partagée, mais les deux familles refusent cette union entre deux religions inconciliables à l’époque. Henry va puiser dans ce chagrin d’amour le carburant de son désir d’absolu. Il épousera donc les Pyrénées ! Des années durant, le jeune comte parcourt ces montagnes féminines en une marche triomphante. Cette âme romantique choisit le plus haut sommet des Pyrénées françaises, dans les Hautes-Pyrénées, pour annoncer ses noces : le Vignemale (3298m), qu’il gravira 33 fois. « Elle sera mon épouse ! » proclame-t-il alors. Etablir une liaison amoureuse avec un tas de rochers aussi élevé soit-il, voilà une idée bien iconoclaste. À l’âge de 23 ans, il entreprend son premier voyage lointain, qui le conduit jusqu’en Amérique du nord. De retour à Pau, il se lance à la conquête des Pyrénées. L’été 1858, il se trouve à Barèges et découvre véritablement la montagne : il ascensionne le Néouvielle, l’Ardiden et trois fois le Mont Perdu, dont une fois seul à partir de Luz-Saint-Sauveur. En août 1858, à Gavarnie, il manque de mourir de froid, de faim et de fatigue : perdu dans la tempête sur les gradins du cirque, il erre une nuit durant au bord des précipices. Ayant l’âme d’un voyageur au long cours, en 1859, il s’engage dans la marine, et part pour son second voyage lointain qui durera trois ans. Il parcourt 65000 km. Il se rend à Saint-Pétersbourg, Moscou, Irkoutsk, Pékin. Il traverse deux fois le désert de Gobi, descend le fleuve Amour en Asie orientale. Par la voie maritime il rallie Shanghai, Hong Kong, Macao, Canton, Melbourne, Wellington, Ceylan, Calcutta. Il passe une année en Inde et reprend le chemin de l’Europe par Le Caire et Constantinople. Il vit ainsi de ses rentes, en bon explorateur et dandy qui se respecte. Deux périples lointains qui lui fournirent la matière de deux ouvrages devenus des incontournables de la littérature de voyage : « Notes par voies et chemins à travers le Nouveau Monde » (1858) et surtout « 16.000 lieues à travers l’Asie et l’Océanie » (1864), primé par la Société de Géographie. On dit que Jules Verne s’inspira des récits de ses voyages pour imaginer le personnage de Michel Strogoff ou même celui de Phileas Fogg dans « Le Tour du monde en 80 jours » (1872). Mais ne supportant plus cette discipline trop stricte à bord de navires, le voilà de retour dans les Pyrénées en 1861. Dès lors, il consacrera le reste de sa vie et sa fortune personnelle à l’exploration des Pyrénées. Seul, ou avec ses guides il effectue d’innombrables ascensions, réalisant une trentaine de premières, parfois en plein hiver. Il vit d’une belle fortune personnelle et des rentes de ses placements bancaires. Durant l’hiver il se plie aux contraintes de la vie mondaine dans les salons et réceptions de la haute bourgeoisie paloise, mais dès les premiers jours de l’été, il repart vers les sommets. Son destin est lié au Vignemale où il monte pour la première fois le 14 septembre 1861 avec le guide Laurent Passet. Le 19 août 1864, à l’Hôtel des Voyageurs de Gavarnie, il fonde avec Farnham Maxwell-Lyte, Charles Packe et Émilien Frossard, en hommage à Carbonnières, la première société de montagnards : la Société Ramond sur le modèle de l’Alpine Club, créé à Londres en 1857, auquel Russel et Packe appartiennent déjà. Le premier président d’honneur de la Société Ramond fut un autre pionnier du pyrénéisme, Vincent de Chausenque, ancien capitaine du Génie et auteur de : « Les Pyrénées ou voyages pédestres dans toutes les régions de ces montagnes depuis l’Océan jusqu’à la Méditerranée », publié en 1834. Sept ans plus tard en 1868, il monte au Vignemale pour la seconde fois avec Hippolyte Passet. Pour sa troisième ascension, il effectue la première hivernale le 11 février 1869 avec Hippolyte et Henri Passet. C’est la première grande ascension hivernale effectuée en Europe. Henry Russell veut passer des nuits en montagne et invente le sac de couchage en peaux d’agneaux cousues. Le 26 août 1880, il passe une nuit à la belle étoile au sommet de la Pique Longue. Mais rattrapé par le froid et souhaitant se fixer sur le Vignemale et en faire sa résidence d’été il envisage alors l’emménagement de grottes, car selon lui, tout autre construction défigurerait l’aspect sauvage de la montagne. Il fait creuser et aménager à ses frais sept grottes dans une roche extrêmement dure, à différentes altitudes, en raison des caprices du glacier d’Ossoue, afin de prendre ses quartiers d’été au-dessus de 3000 mètres d’altitude et de recevoir dignement ses amis de passage. Le travail s’étale de 1881 à 1893. Il fait creuser sa première grotte sur les flancs du Cerbillona, près du col de Cerbillona, en haut du glacier d’Ossoue, par l’entrepreneur Étienne Theil, de Gèdre, qui a déjà bâti l’abri du Mont Perdu. Le 1 août 1882 la première grotte percée à l’aide de barres à mine et d’explosifs est inaugurée ; c’est la villa Russell, située à 3195m d’altitude au col de Cerbillona (3 m de long, 2,5 m de large et 2 m de haut). Russell habite sa grotte pendant trois jours. Le 12 août 1884, il la fait bénir ainsi que le massif du Vignemale par le curé de Gèdre et le Père Pascal Carrère. Trois messes sont célébrées devant une assistance d’une trentaine de personnes. La grotte est progressivement équipée et aménagée, jusqu’à recevoir un poêle. Gravir la Pique Longue ne prend désormais qu’une dizaine de minutes, monter au Clot de la Hount et revenir ne prend pas plus de 25 minutes. En 1885, il fait creuser la seconde grotte ; celle des Guides à un niveau légèrement supérieur à celui de la Villa Russell, puis en 1886 la troisième et la plus haute ; celle des Dames, son plus grand succès, dira-t-il. Les dames de la bonne société cosmopolite qui, comme les guides, disposaient de leurs propres nids d’aigle, matelassés de paille et munis d’un poêle à charbon. Le 5 décembre 1888, il demande au préfet des Hautes-Pyrénées, de lui accorder la concession sur « sa » montagne du Vignemale (200 ha entre 2300 et 3300 mètres). Demande extravagante, mais elle est accordée. La location annuelle est fixée à 1 franc pour un bail emphytéotique de 99 ans, qui débute en janvier 1889 et s’acheva en 1989, quatre-vingt ans après sa mort. Il fera ériger au sommet du Vignemale une tour de pierres de trois mètres de haut pour lui faire dépasser symboliquement la barre des 3300 mètres. Certains étés, la croûte glaciaire recouvrant ses grottes aménagées, trois autres seront creusées 800 mètres plus bas en dessous du glacier et sur le sentier qui mène à la Hourquette d’Ossoue, à 2400 mètres : les grottes Bellevue creusées en 1888 et 1889. Et la légende veut qu’il y offre l’hospitalité et qu’on y organise des réceptions mondaines somptueuses et légendaires, recevant princes et rois, voyageurs et personnages illustres sur un tapis rouge, qu’il fait dérouler sur la neige. À la lueur des chandelles, dans un confort spartiate, on converse, on déguste vins fins et punch brûlant, on savoure la sole à la Dieppoise, on fume le cigare… Puis en 1892-93, avec la nostalgie de l’altitude, 18 mètres sous le dôme du Vignemale, à 3280 mètres, sa dernière grotte voit le jour : la grotte Paradis, offrant un point de vue magnifique sur le grand glacier d’Ossoue et les sommets alentour : Mont Perdu (3355m), ceux du Cirque de Gavarnie, le Balaïtous (3144m) … Chacune des sept grottes a une entrée maçonnée et est fermée par une porte en fer peinte au minium. Russel fait forger des clés avec ses initiales. Le voilà propriétaire du Vignemale : il en détient les clés. Il a voué sa vie à conquérir ces grands sommets, qu’il a inlassablement parcourus à grandes enjambées, du haut de sa haute silhouette dégingandée. Il montera pour la trente-troisième et dernière fois au sommet de son cher Grand Vignemale, à 3298 mètres au-dessus des mortels, le 8 août 1904 à l’âge de 70 ans. Au total, il y aura passé cent quarante-sept nuits en ermite et parfois avec ses invités de marque, artistes ou écrivains mondains, réchauffés par une profusion de tapis d’Orient dans un décor de colonnes de neige. Peu avant sa mort à Biarritz en 1909, il confiera les clés de ses grottes à un autre visiteur illustre, le poète et lauréat du prix Nobel de littérature (1960), Saint-John Perse. La grotte du Paradis sert toujours occasionnellement d’abri aux ascensionnistes. Une plaque en hommage à Russell, qui rappelle sa vie, son œuvre et son mythe y a été apposée. Cette légende vivante, cet ermite « qui avait épousé une montagne » et dont la vie est émaillée d’exploits, de premières, de réussites extraordinaires pour l’époque, repose au cimetière de Pau. Les grottes du comte Russel sont toujours visibles aujourd’hui, bien qu’en mauvais état. Quant au glacier d’Ossoue, il a considérablement reculé subissant de plein fouet les affres du changement climatique et des hivers moins neigeux. Il nous reste la légende du fantasque comte, tellement amoureux d’une montagne qu’il épousa corps et âme, faute de pouvoir vivre avec la femme de sa vie. Membre du Club alpin (CAF) de Bordeaux, il est le plus connu des pyrénéistes. Il a écrit ses mémoires, des récits de voyages et de nombreux ouvrages qui relatent ses ascensions et états d’âme dans « Souvenirs d’un montagnard », dont la première édition date de 1878. Cette somme de 730 pages relate par le menu plus d’une centaine d’ascensions pyrénéennes, dont de multiples premières, notamment celle du Petit Nethou (3205m), situé à l’extrémité Est du massif de la Maladeta, rebaptisé Pic Russell en son honneur. Considéré comme le fondateur du pyrénéisme, routard et écologiste avant l’heure, il est l’inventeur des refuges, même si sa vision élitiste lui fit rejeter les constructions en pierre, l’escalade sportive et l’ouverture de la montagne au grand public. Toutes ses ascensions avaient pour base de départ le village de Gavarnie et plus particulièrement le célèbre Hôtel des Voyageurs. Ce gentleman aventurier admiré, un brin excentrique, les yeux et l’esprit toujours tournés vers les sommets, nourri au sein romantique était reçu dans la bonne société paloise et biarrote, où on se bousculait pour l’entendre raconter les mille et une anecdotes qui avaient émaillé ses voyages et ses ascensions. Nous vous recommandons l’excellente biographie que nous livre son arrière-petite-nièce, Monique Dollin du Fresnel, dans un livre publié par les Éditions Sud Ouest, sous le titre « Henry Russel (1834-1909) – Une vie pour les Pyrénées » où elle y décrit avec amour cet oncle à la fois original et attachant, sauvage et mondain, romantique et précis, écrivain, poète, musicien, mélomane averti, mais surtout montagnard. Comme quoi, l’amour de la nature n’est pas incompatible avec celui de la culture, autre forme d’aventure. Plus modeste que l’ouvrage de Monique Dollin du Fresnel nous vous signalons aussi le livre de Marcel Pérès, né en 1943 à Ossun et ayant vécu à Argelès-Gazost, docteur ès lettres, ancien directeur de l’École nationale de ski et d’alpinisme à Chamonix (1979-1984) puis préfet hors cadre : « Henry Russel et ses grottes – Le fou du Vignemale », paru en 2009 chez PUG. Le 5 septembre 1911 fut inaugurée à l’entrée du village de Gavarnie, qui lui servait de « camp de base », une statue d’Henry Russel due au sculpteur Gaston Leroux. La Légion d’honneur lui avait été décernée en 1901.
 Le comte Henry Russell, né en 1834 à Toulouse et mort à Biarritz le 5 février 1909, à l’âge de 75 ans est considéré comme l’apôtre du pyrénéisme. Fils d’aristocrate, mi-Irlandais par son père issu d’une vieille et riche famille irlandaise et mi-Gascon par sa mère, comtesse de Flamarens dans le Gers. Il découvre les Pyrénées lorsque sa famille s’installe à Pau et Bagnères-de-Bigorre. Et c’est sa mère qui le met pour la première fois en contact avec la montagne au cours de petites randonnées. Il arpente la chaîne pendant plus de 50 ans, y faisant la plupart des « premières » sur les pics de plus de 3000 mètres. Une rencontre va sceller son destin. De famille catholique, il s’éprend à Biarritz d’une jeune anglaise prénommée Maud, fille d’un pasteur anglican. Passion partagée, mais les deux familles refusent cette union entre deux religions inconciliables à l’époque. Henry va puiser dans ce chagrin d’amour le carburant de son désir d’absolu. Il épousera donc les Pyrénées ! Des années durant, le jeune comte parcourt ces montagnes féminines en une marche triomphante. Cette âme romantique choisit le plus haut sommet des Pyrénées françaises, dans les Hautes-Pyrénées, pour annoncer ses noces : le Vignemale (3298m), qu’il gravira 33 fois. « Elle sera mon épouse ! » proclame-t-il alors. Etablir une liaison amoureuse avec un tas de rochers aussi élevé soit-il, voilà une idée bien iconoclaste. À l’âge de 23 ans, il entreprend son premier voyage lointain, qui le conduit jusqu’en Amérique du nord. De retour à Pau, il se lance à la conquête des Pyrénées. L’été 1858, il se trouve à Barèges et découvre véritablement la montagne : il ascensionne le Néouvielle, l’Ardiden et trois fois le Mont Perdu, dont une fois seul à partir de Luz-Saint-Sauveur. En août 1858, à Gavarnie, il manque de mourir de froid, de faim et de fatigue : perdu dans la tempête sur les gradins du cirque, il erre une nuit durant au bord des précipices. Ayant l’âme d’un voyageur au long cours, en 1859, il s’engage dans la marine, et part pour son second voyage lointain qui durera trois ans. Il parcourt 65000 km. Il se rend à Saint-Pétersbourg, Moscou, Irkoutsk, Pékin. Il traverse deux fois le désert de Gobi, descend le fleuve Amour en Asie orientale. Par la voie maritime il rallie Shanghai, Hong Kong, Macao, Canton, Melbourne, Wellington, Ceylan, Calcutta. Il passe une année en Inde et reprend le chemin de l’Europe par Le Caire et Constantinople. Il vit ainsi de ses rentes, en bon explorateur et dandy qui se respecte. Deux périples lointains qui lui fournirent la matière de deux ouvrages devenus des incontournables de la littérature de voyage : « Notes par voies et chemins à travers le Nouveau Monde » (1858) et surtout « 16.000 lieues à travers l’Asie et l’Océanie » (1864), primé par la Société de Géographie. On dit que Jules Verne s’inspira des récits de ses voyages pour imaginer le personnage de Michel Strogoff ou même celui de Phileas Fogg dans « Le Tour du monde en 80 jours » (1872). Mais ne supportant plus cette discipline trop stricte à bord de navires, le voilà de retour dans les Pyrénées en 1861. Dès lors, il consacrera le reste de sa vie et sa fortune personnelle à l’exploration des Pyrénées. Seul, ou avec ses guides il effectue d’innombrables ascensions, réalisant une trentaine de premières, parfois en plein hiver. Il vit d’une belle fortune personnelle et des rentes de ses placements bancaires. Durant l’hiver il se plie aux contraintes de la vie mondaine dans les salons et réceptions de la haute bourgeoisie paloise, mais dès les premiers jours de l’été, il repart vers les sommets. Son destin est lié au Vignemale où il monte pour la première fois le 14 septembre 1861 avec le guide Laurent Passet. Le 19 août 1864, à l’Hôtel des Voyageurs de Gavarnie, il fonde avec Farnham Maxwell-Lyte, Charles Packe et Émilien Frossard, en hommage à Carbonnières, la première société de montagnards : la Société Ramond sur le modèle de l’Alpine Club, créé à Londres en 1857, auquel Russel et Packe appartiennent déjà. Le premier président d’honneur de la Société Ramond fut un autre pionnier du pyrénéisme, Vincent de Chausenque, ancien capitaine du Génie et auteur de : « Les Pyrénées ou voyages pédestres dans toutes les régions de ces montagnes depuis l’Océan jusqu’à la Méditerranée », publié en 1834. Sept ans plus tard en 1868, il monte au Vignemale pour la seconde fois avec Hippolyte Passet. Pour sa troisième ascension, il effectue la première hivernale le 11 février 1869 avec Hippolyte et Henri Passet. C’est la première grande ascension hivernale effectuée en Europe. Henry Russell veut passer des nuits en montagne et invente le sac de couchage en peaux d’agneaux cousues. Le 26 août 1880, il passe une nuit à la belle étoile au sommet de la Pique Longue. Mais rattrapé par le froid et souhaitant se fixer sur le Vignemale et en faire sa résidence d’été il envisage alors l’emménagement de grottes, car selon lui, tout autre construction défigurerait l’aspect sauvage de la montagne. Il fait creuser et aménager à ses frais sept grottes dans une roche extrêmement dure, à différentes altitudes, en raison des caprices du glacier d’Ossoue, afin de prendre ses quartiers d’été au-dessus de 3000 mètres d’altitude et de recevoir dignement ses amis de passage. Le travail s’étale de 1881 à 1893. Il fait creuser sa première grotte sur les flancs du Cerbillona, près du col de Cerbillona, en haut du glacier d’Ossoue, par l’entrepreneur Étienne Theil, de Gèdre, qui a déjà bâti l’abri du Mont Perdu. Le 1 août 1882 la première grotte percée à l’aide de barres à mine et d’explosifs est inaugurée ; c’est la villa Russell, située à 3195m d’altitude au col de Cerbillona (3 m de long, 2,5 m de large et 2 m de haut). Russell habite sa grotte pendant trois jours. Le 12 août 1884, il la fait bénir ainsi que le massif du Vignemale par le curé de Gèdre et le Père Pascal Carrère. Trois messes sont célébrées devant une assistance d’une trentaine de personnes. La grotte est progressivement équipée et aménagée, jusqu’à recevoir un poêle. Gravir la Pique Longue ne prend désormais qu’une dizaine de minutes, monter au Clot de la Hount et revenir ne prend pas plus de 25 minutes. En 1885, il fait creuser la seconde grotte ; celle des Guides à un niveau légèrement supérieur à celui de la Villa Russell, puis en 1886 la troisième et la plus haute ; celle des Dames, son plus grand succès, dira-t-il. Les dames de la bonne société cosmopolite qui, comme les guides, disposaient de leurs propres nids d’aigle, matelassés de paille et munis d’un poêle à charbon. Le 5 décembre 1888, il demande au préfet des Hautes-Pyrénées, de lui accorder la concession sur « sa » montagne du Vignemale (200 ha entre 2300 et 3300 mètres). Demande extravagante, mais elle est accordée. La location annuelle est fixée à 1 franc pour un bail emphytéotique de 99 ans, qui débute en janvier 1889 et s’acheva en 1989, quatre-vingt ans après sa mort. Il fera ériger au sommet du Vignemale une tour de pierres de trois mètres de haut pour lui faire dépasser symboliquement la barre des 3300 mètres. Certains étés, la croûte glaciaire recouvrant ses grottes aménagées, trois autres seront creusées 800 mètres plus bas en dessous du glacier et sur le sentier qui mène à la Hourquette d’Ossoue, à 2400 mètres : les grottes Bellevue creusées en 1888 et 1889. Et la légende veut qu’il y offre l’hospitalité et qu’on y organise des réceptions mondaines somptueuses et légendaires, recevant princes et rois, voyageurs et personnages illustres sur un tapis rouge, qu’il fait dérouler sur la neige. À la lueur des chandelles, dans un confort spartiate, on converse, on déguste vins fins et punch brûlant, on savoure la sole à la Dieppoise, on fume le cigare… Puis en 1892-93, avec la nostalgie de l’altitude, 18 mètres sous le dôme du Vignemale, à 3280 mètres, sa dernière grotte voit le jour : la grotte Paradis, offrant un point de vue magnifique sur le grand glacier d’Ossoue et les sommets alentour : Mont Perdu (3355m), ceux du Cirque de Gavarnie, le Balaïtous (3144m) … Chacune des sept grottes a une entrée maçonnée et est fermée par une porte en fer peinte au minium. Russel fait forger des clés avec ses initiales. Le voilà propriétaire du Vignemale : il en détient les clés. Il a voué sa vie à conquérir ces grands sommets, qu’il a inlassablement parcourus à grandes enjambées, du haut de sa haute silhouette dégingandée. Il montera pour la trente-troisième et dernière fois au sommet de son cher Grand Vignemale, à 3298 mètres au-dessus des mortels, le 8 août 1904 à l’âge de 70 ans. Au total, il y aura passé cent quarante-sept nuits en ermite et parfois avec ses invités de marque, artistes ou écrivains mondains, réchauffés par une profusion de tapis d’Orient dans un décor de colonnes de neige. Peu avant sa mort à Biarritz en 1909, il confiera les clés de ses grottes à un autre visiteur illustre, le poète et lauréat du prix Nobel de littérature (1960), Saint-John Perse. La grotte du Paradis sert toujours occasionnellement d’abri aux ascensionnistes. Une plaque en hommage à Russell, qui rappelle sa vie, son œuvre et son mythe y a été apposée. Cette légende vivante, cet ermite « qui avait épousé une montagne » et dont la vie est émaillée d’exploits, de premières, de réussites extraordinaires pour l’époque, repose au cimetière de Pau. Les grottes du comte Russel sont toujours visibles aujourd’hui, bien qu’en mauvais état. Quant au glacier d’Ossoue, il a considérablement reculé subissant de plein fouet les affres du changement climatique et des hivers moins neigeux. Il nous reste la légende du fantasque comte, tellement amoureux d’une montagne qu’il épousa corps et âme, faute de pouvoir vivre avec la femme de sa vie. Membre du Club alpin (CAF) de Bordeaux, il est le plus connu des pyrénéistes. Il a écrit ses mémoires, des récits de voyages et de nombreux ouvrages qui relatent ses ascensions et états d’âme dans « Souvenirs d’un montagnard », dont la première édition date de 1878. Cette somme de 730 pages relate par le menu plus d’une centaine d’ascensions pyrénéennes, dont de multiples premières, notamment celle du Petit Nethou (3205m), situé à l’extrémité Est du massif de la Maladeta, rebaptisé Pic Russell en son honneur. Considéré comme le fondateur du pyrénéisme, routard et écologiste avant l’heure, il est l’inventeur des refuges, même si sa vision élitiste lui fit rejeter les constructions en pierre, l’escalade sportive et l’ouverture de la montagne au grand public. Toutes ses ascensions avaient pour base de départ le village de Gavarnie et plus particulièrement le célèbre Hôtel des Voyageurs. Ce gentleman aventurier admiré, un brin excentrique, les yeux et l’esprit toujours tournés vers les sommets, nourri au sein romantique était reçu dans la bonne société paloise et biarrote, où on se bousculait pour l’entendre raconter les mille et une anecdotes qui avaient émaillé ses voyages et ses ascensions. Nous vous recommandons l’excellente biographie que nous livre son arrière-petite-nièce, Monique Dollin du Fresnel, dans un livre publié par les Éditions Sud Ouest, sous le titre « Henry Russel (1834-1909) – Une vie pour les Pyrénées » où elle y décrit avec amour cet oncle à la fois original et attachant, sauvage et mondain, romantique et précis, écrivain, poète, musicien, mélomane averti, mais surtout montagnard. Comme quoi, l’amour de la nature n’est pas incompatible avec celui de la culture, autre forme d’aventure. Plus modeste que l’ouvrage de Monique Dollin du Fresnel nous vous signalons aussi le livre de Marcel Pérès, né en 1943 à Ossun et ayant vécu à Argelès-Gazost, docteur ès lettres, ancien directeur de l’École nationale de ski et d’alpinisme à Chamonix (1979-1984) puis préfet hors cadre : « Henry Russel et ses grottes – Le fou du Vignemale », paru en 2009 chez PUG. Le 5 septembre 1911 fut inaugurée à l’entrée du village de Gavarnie, qui lui servait de « camp de base », une statue d’Henry Russel due au sculpteur Gaston Leroux. La Légion d’honneur lui avait été décernée en 1901.
Le comte Henry Russell, né en 1834 à Toulouse et mort à Biarritz le 5 février 1909, à l’âge de 75 ans est considéré comme l’apôtre du pyrénéisme. Fils d’aristocrate, mi-Irlandais par son père issu d’une vieille et riche famille irlandaise et mi-Gascon par sa mère, comtesse de Flamarens dans le Gers. Il découvre les Pyrénées lorsque sa famille s’installe à Pau et Bagnères-de-Bigorre. Et c’est sa mère qui le met pour la première fois en contact avec la montagne au cours de petites randonnées. Il arpente la chaîne pendant plus de 50 ans, y faisant la plupart des « premières » sur les pics de plus de 3000 mètres. Une rencontre va sceller son destin. De famille catholique, il s’éprend à Biarritz d’une jeune anglaise prénommée Maud, fille d’un pasteur anglican. Passion partagée, mais les deux familles refusent cette union entre deux religions inconciliables à l’époque. Henry va puiser dans ce chagrin d’amour le carburant de son désir d’absolu. Il épousera donc les Pyrénées ! Des années durant, le jeune comte parcourt ces montagnes féminines en une marche triomphante. Cette âme romantique choisit le plus haut sommet des Pyrénées françaises, dans les Hautes-Pyrénées, pour annoncer ses noces : le Vignemale (3298m), qu’il gravira 33 fois. « Elle sera mon épouse ! » proclame-t-il alors. Etablir une liaison amoureuse avec un tas de rochers aussi élevé soit-il, voilà une idée bien iconoclaste. À l’âge de 23 ans, il entreprend son premier voyage lointain, qui le conduit jusqu’en Amérique du nord. De retour à Pau, il se lance à la conquête des Pyrénées. L’été 1858, il se trouve à Barèges et découvre véritablement la montagne : il ascensionne le Néouvielle, l’Ardiden et trois fois le Mont Perdu, dont une fois seul à partir de Luz-Saint-Sauveur. En août 1858, à Gavarnie, il manque de mourir de froid, de faim et de fatigue : perdu dans la tempête sur les gradins du cirque, il erre une nuit durant au bord des précipices. Ayant l’âme d’un voyageur au long cours, en 1859, il s’engage dans la marine, et part pour son second voyage lointain qui durera trois ans. Il parcourt 65000 km. Il se rend à Saint-Pétersbourg, Moscou, Irkoutsk, Pékin. Il traverse deux fois le désert de Gobi, descend le fleuve Amour en Asie orientale. Par la voie maritime il rallie Shanghai, Hong Kong, Macao, Canton, Melbourne, Wellington, Ceylan, Calcutta. Il passe une année en Inde et reprend le chemin de l’Europe par Le Caire et Constantinople. Il vit ainsi de ses rentes, en bon explorateur et dandy qui se respecte. Deux périples lointains qui lui fournirent la matière de deux ouvrages devenus des incontournables de la littérature de voyage : « Notes par voies et chemins à travers le Nouveau Monde » (1858) et surtout « 16.000 lieues à travers l’Asie et l’Océanie » (1864), primé par la Société de Géographie. On dit que Jules Verne s’inspira des récits de ses voyages pour imaginer le personnage de Michel Strogoff ou même celui de Phileas Fogg dans « Le Tour du monde en 80 jours » (1872). Mais ne supportant plus cette discipline trop stricte à bord de navires, le voilà de retour dans les Pyrénées en 1861. Dès lors, il consacrera le reste de sa vie et sa fortune personnelle à l’exploration des Pyrénées. Seul, ou avec ses guides il effectue d’innombrables ascensions, réalisant une trentaine de premières, parfois en plein hiver. Il vit d’une belle fortune personnelle et des rentes de ses placements bancaires. Durant l’hiver il se plie aux contraintes de la vie mondaine dans les salons et réceptions de la haute bourgeoisie paloise, mais dès les premiers jours de l’été, il repart vers les sommets. Son destin est lié au Vignemale où il monte pour la première fois le 14 septembre 1861 avec le guide Laurent Passet. Le 19 août 1864, à l’Hôtel des Voyageurs de Gavarnie, il fonde avec Farnham Maxwell-Lyte, Charles Packe et Émilien Frossard, en hommage à Carbonnières, la première société de montagnards : la Société Ramond sur le modèle de l’Alpine Club, créé à Londres en 1857, auquel Russel et Packe appartiennent déjà. Le premier président d’honneur de la Société Ramond fut un autre pionnier du pyrénéisme, Vincent de Chausenque, ancien capitaine du Génie et auteur de : « Les Pyrénées ou voyages pédestres dans toutes les régions de ces montagnes depuis l’Océan jusqu’à la Méditerranée », publié en 1834. Sept ans plus tard en 1868, il monte au Vignemale pour la seconde fois avec Hippolyte Passet. Pour sa troisième ascension, il effectue la première hivernale le 11 février 1869 avec Hippolyte et Henri Passet. C’est la première grande ascension hivernale effectuée en Europe. Henry Russell veut passer des nuits en montagne et invente le sac de couchage en peaux d’agneaux cousues. Le 26 août 1880, il passe une nuit à la belle étoile au sommet de la Pique Longue. Mais rattrapé par le froid et souhaitant se fixer sur le Vignemale et en faire sa résidence d’été il envisage alors l’emménagement de grottes, car selon lui, tout autre construction défigurerait l’aspect sauvage de la montagne. Il fait creuser et aménager à ses frais sept grottes dans une roche extrêmement dure, à différentes altitudes, en raison des caprices du glacier d’Ossoue, afin de prendre ses quartiers d’été au-dessus de 3000 mètres d’altitude et de recevoir dignement ses amis de passage. Le travail s’étale de 1881 à 1893. Il fait creuser sa première grotte sur les flancs du Cerbillona, près du col de Cerbillona, en haut du glacier d’Ossoue, par l’entrepreneur Étienne Theil, de Gèdre, qui a déjà bâti l’abri du Mont Perdu. Le 1 août 1882 la première grotte percée à l’aide de barres à mine et d’explosifs est inaugurée ; c’est la villa Russell, située à 3195m d’altitude au col de Cerbillona (3 m de long, 2,5 m de large et 2 m de haut). Russell habite sa grotte pendant trois jours. Le 12 août 1884, il la fait bénir ainsi que le massif du Vignemale par le curé de Gèdre et le Père Pascal Carrère. Trois messes sont célébrées devant une assistance d’une trentaine de personnes. La grotte est progressivement équipée et aménagée, jusqu’à recevoir un poêle. Gravir la Pique Longue ne prend désormais qu’une dizaine de minutes, monter au Clot de la Hount et revenir ne prend pas plus de 25 minutes. En 1885, il fait creuser la seconde grotte ; celle des Guides à un niveau légèrement supérieur à celui de la Villa Russell, puis en 1886 la troisième et la plus haute ; celle des Dames, son plus grand succès, dira-t-il. Les dames de la bonne société cosmopolite qui, comme les guides, disposaient de leurs propres nids d’aigle, matelassés de paille et munis d’un poêle à charbon. Le 5 décembre 1888, il demande au préfet des Hautes-Pyrénées, de lui accorder la concession sur « sa » montagne du Vignemale (200 ha entre 2300 et 3300 mètres). Demande extravagante, mais elle est accordée. La location annuelle est fixée à 1 franc pour un bail emphytéotique de 99 ans, qui débute en janvier 1889 et s’acheva en 1989, quatre-vingt ans après sa mort. Il fera ériger au sommet du Vignemale une tour de pierres de trois mètres de haut pour lui faire dépasser symboliquement la barre des 3300 mètres. Certains étés, la croûte glaciaire recouvrant ses grottes aménagées, trois autres seront creusées 800 mètres plus bas en dessous du glacier et sur le sentier qui mène à la Hourquette d’Ossoue, à 2400 mètres : les grottes Bellevue creusées en 1888 et 1889. Et la légende veut qu’il y offre l’hospitalité et qu’on y organise des réceptions mondaines somptueuses et légendaires, recevant princes et rois, voyageurs et personnages illustres sur un tapis rouge, qu’il fait dérouler sur la neige. À la lueur des chandelles, dans un confort spartiate, on converse, on déguste vins fins et punch brûlant, on savoure la sole à la Dieppoise, on fume le cigare… Puis en 1892-93, avec la nostalgie de l’altitude, 18 mètres sous le dôme du Vignemale, à 3280 mètres, sa dernière grotte voit le jour : la grotte Paradis, offrant un point de vue magnifique sur le grand glacier d’Ossoue et les sommets alentour : Mont Perdu (3355m), ceux du Cirque de Gavarnie, le Balaïtous (3144m) … Chacune des sept grottes a une entrée maçonnée et est fermée par une porte en fer peinte au minium. Russel fait forger des clés avec ses initiales. Le voilà propriétaire du Vignemale : il en détient les clés. Il a voué sa vie à conquérir ces grands sommets, qu’il a inlassablement parcourus à grandes enjambées, du haut de sa haute silhouette dégingandée. Il montera pour la trente-troisième et dernière fois au sommet de son cher Grand Vignemale, à 3298 mètres au-dessus des mortels, le 8 août 1904 à l’âge de 70 ans. Au total, il y aura passé cent quarante-sept nuits en ermite et parfois avec ses invités de marque, artistes ou écrivains mondains, réchauffés par une profusion de tapis d’Orient dans un décor de colonnes de neige. Peu avant sa mort à Biarritz en 1909, il confiera les clés de ses grottes à un autre visiteur illustre, le poète et lauréat du prix Nobel de littérature (1960), Saint-John Perse. La grotte du Paradis sert toujours occasionnellement d’abri aux ascensionnistes. Une plaque en hommage à Russell, qui rappelle sa vie, son œuvre et son mythe y a été apposée. Cette légende vivante, cet ermite « qui avait épousé une montagne » et dont la vie est émaillée d’exploits, de premières, de réussites extraordinaires pour l’époque, repose au cimetière de Pau. Les grottes du comte Russel sont toujours visibles aujourd’hui, bien qu’en mauvais état. Quant au glacier d’Ossoue, il a considérablement reculé subissant de plein fouet les affres du changement climatique et des hivers moins neigeux. Il nous reste la légende du fantasque comte, tellement amoureux d’une montagne qu’il épousa corps et âme, faute de pouvoir vivre avec la femme de sa vie. Membre du Club alpin (CAF) de Bordeaux, il est le plus connu des pyrénéistes. Il a écrit ses mémoires, des récits de voyages et de nombreux ouvrages qui relatent ses ascensions et états d’âme dans « Souvenirs d’un montagnard », dont la première édition date de 1878. Cette somme de 730 pages relate par le menu plus d’une centaine d’ascensions pyrénéennes, dont de multiples premières, notamment celle du Petit Nethou (3205m), situé à l’extrémité Est du massif de la Maladeta, rebaptisé Pic Russell en son honneur. Considéré comme le fondateur du pyrénéisme, routard et écologiste avant l’heure, il est l’inventeur des refuges, même si sa vision élitiste lui fit rejeter les constructions en pierre, l’escalade sportive et l’ouverture de la montagne au grand public. Toutes ses ascensions avaient pour base de départ le village de Gavarnie et plus particulièrement le célèbre Hôtel des Voyageurs. Ce gentleman aventurier admiré, un brin excentrique, les yeux et l’esprit toujours tournés vers les sommets, nourri au sein romantique était reçu dans la bonne société paloise et biarrote, où on se bousculait pour l’entendre raconter les mille et une anecdotes qui avaient émaillé ses voyages et ses ascensions. Nous vous recommandons l’excellente biographie que nous livre son arrière-petite-nièce, Monique Dollin du Fresnel, dans un livre publié par les Éditions Sud Ouest, sous le titre « Henry Russel (1834-1909) – Une vie pour les Pyrénées » où elle y décrit avec amour cet oncle à la fois original et attachant, sauvage et mondain, romantique et précis, écrivain, poète, musicien, mélomane averti, mais surtout montagnard. Comme quoi, l’amour de la nature n’est pas incompatible avec celui de la culture, autre forme d’aventure. Plus modeste que l’ouvrage de Monique Dollin du Fresnel nous vous signalons aussi le livre de Marcel Pérès, né en 1943 à Ossun et ayant vécu à Argelès-Gazost, docteur ès lettres, ancien directeur de l’École nationale de ski et d’alpinisme à Chamonix (1979-1984) puis préfet hors cadre : « Henry Russel et ses grottes – Le fou du Vignemale », paru en 2009 chez PUG. Le 5 septembre 1911 fut inaugurée à l’entrée du village de Gavarnie, qui lui servait de « camp de base », une statue d’Henry Russel due au sculpteur Gaston Leroux. La Légion d’honneur lui avait été décernée en 1901.SAINT-MARTIN Jean-Pierre (1950-XXXX)
Chef cuisinier du restaurant le Viscos à Saint-Savin
 Jean-Pierre SAINT-MARTIN, né en 1950 à Saint-Savin est le Chef du restaurant Le Viscos, à Saint-Savin, un village plein de charme, perché sur son piton rocheux, et le délégué d’Occitanie des Maîtres Cuisiniers de France. Depuis la terrasse fleurie du lieu, on a une superbe vue sur toute la vallée d'Argelès-Gazost. En plein cœur des Pyrénées, ce paradis du palais est idéalement situé. Les lecteurs de l'écrivain brésilien Paulo Coelho connaissent Saint-Savin, ce délicieux village figé dans le temps et dans la pierre. Ils y sont venus avec Pilar, en lisant « Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j’ai pleuré... » Si après 50 ans passés aux fourneaux, Jean-Pierre a passé la main à son fils Alexis et Maria sa belle-fille, la septième génération au « piano » du restaurant, il garde néanmoins l’œil sur tout, en cuisine comme en salle, et continue à faire le tour des tables dans un souci d’offrir du plaisir à ses clients fins gourmets. Il apparaît en salle et explique avec passion l’origine des produits et des arrivages et tout commence par une écoute attentive du maître qui vous conte le menu. Puis, vous entrez en dégustation, savourez ce plat relevé aux délicats parfums des herbes de montagne. Son grand restaurant connu du Pays Basque au Midi Toulousain, réputé pour sa délicieuse cuisine à la fois créative et traditionnelle du terroir serait presque le centre gastronomique de la Bigorre tant le chef y explore les saveurs de produits du terroir local : « la garbure qu'on ne trouve nulle part ailleurs, le foie poêlé et les pieds de cochon... ». Le chef fait avec son talent de véritables petites merveilles. Maître Cuisinier de France, souvent cité par les médias spécialisés, il propose cet art de la gastronomie inspiré par ses origines paysannes et un grand-oncle au talent reconnu, qui avait travaillé pour le comte de Paris, l’ambassade d’Espagne et divers palaces. Pour poursuivre une visite en Haute-Bigorre, rien de tel que la maison de Jean-Pierre. L’adresse est un voyage d’histoire et d’émotions, où les assiettes du terroir se mêlent aux époques et souvenirs conservés du temps. Et face aux immortelles montagnes pyrénéennes, on savoure son velouté de châtaignes et sa raviole de boudin aux épices, ses coustous laqués, ses gnocchis de topinambour et son émulsion au wasabi doux, sa brioche mousseline façon pain perdu à la pomme. Jean-Pierre et Alexis vous accueillent chez eux, dans leur restaurant, véritable institution locale. La table est gourmande. Il affiche 2 toques au Gault & Millau, qui le qualifie comme l'institution locale. Dans son village typiquement pyrénéen, entouré de hautes montagnes, Jean-Pierre aime s'inspirer des vieilles recettes où se mêlent les saveurs des plantes de montagne, de porc noir de Bigorre, mais aussi du moelleux haricot tarbais ou de l'oignon doux de Trébons. Les Saint-Martin sont restaurateurs de père en fils depuis sept générations. C’est dire combien leur auberge a vu passer de gastronomes. On vient à l’auberge du Viscos parfois pour profiter du paysage (l’hôtel compte sept chambres et deux suites) mais surtout pour déguster les spécialités pyrénéennes qui ponctuent la carte. Car, comme dit Jean-Pierre : « Un cuisinier, c’est un paysan qui a mal tourné ! ». Et les produits du terroir ne manquent pas dans sa cuisine : porc noir de Bigorre, poule noire d'Astarac-Bigorre, haricots tarbais, le légume emblématique de la région, authentique garbure bigourdane aux haricots tarbais avec comme ingrédients de base : une potée de choux, haricots tarbais, haut de jambon séché, poitrine de porc hachée… Un plat complet et revigorant qui se mange, comme le pot-au-feu, en plusieurs services : d’abord la soupe, trempée de pain de campagne. Puis les légumes et la viande. Dans sa version luxe, on peut y ajouter au dernier moment une escalope de foie gras de canard. À l’auberge Le Viscos, on cuisine aussi le délicieux agneau des Pyrénées et le mouton AOC de Barèges-Gavarnie. Nourries tout l’été dans les estives de thym, serpolet et autres herbes des Pyrénées, les bêtes offrent une viande parfumée à souhait que l’on sert en gigots ou en grillades avec un peu de genièvre écrasé pour exhausser encore les saveurs. Le foie gras version pyrénéenne ne se sert pas qu’avec la garbure : on peut le cuire au torchon avec du Jurançon, le vin du terroir tout proche. À essayer aussi avec un chutney et un peu de miel d’acacia. Le Madiran, également un vin de la région, se marie très bien avec la douceur du foie gras, dans une version pochée. Enfin, les skieurs, randonneurs ou simples curieux peuvent tenter les virils petits déjeuners locaux : un œuf frit avec de la ventrèche de porc noir de Bigorre, ou une omelette au saucisson noir ! À l’auberge l’on peut déguster bien d’autres spécialités comme un carré de porc noir de Bigorre poêlé ou un confit d’oignons de Trébons au Pacherenc. « Avec Alexis nous cuisinons à quatre mains : en équilibre entre les nouvelles techniques de préparation, de cuisson, de cuisiner et le respect de notre terroir, de nos produits, de notre histoire, du fait maison. » Jean-Pierre a poursuivi une aventure familiale débutée en 1840 ! « Comme souvent dans nos contrées rurales, s’amuse-t-il, ce type de commerce réunissait café, auberge, épicerie, tabac et s’adossait à une ferme. » En 1957, son père structurait l’affaire qui, aujourd’hui, demeure une étape gourmande incontournable dans cette vallée entre les cols mythiques d’Aubisque et du Tourmalet. Si un « Bib Gourmand MICHELIN » est accroché à la porte d’entrée du restaurant et si le patron est une des figures emblématiques des Maîtres Cuisiniers de France, c’est que la table est de qualité. Une réussite exemplaire pour ce maître de la cuisine traditionnelle pyrénéenne. Et un soulagement encore plus grand pour Jean-Pierre : que ses deux fils s’apprêtent à lui succéder. L’un en cuisine et l’autre côté gestion. De ses études culinaires à Tarbes, le Chef avait gardé de solides amitiés avec des copains restaurateurs gersois. À commencer par Bernard Ramouneda et bien sûr André Daguin, décédé en 2019, qui avait fait beaucoup pour la profession en général. Un Gers auquel Jean-Pierre est attaché, aussi, pour son art de vivre et son Armagnac. « Je suis Gascon avant tout, s’exclame-t-il. Alors vous pensez bien que j’apprécie cette eau-de-vie. » Que l’on retrouve dans sa cuisine, surtout en période de gibier mais aussi pour flamber des écrevisses. Dans ses desserts Jean-Pierre glisse aussi le breuvage des Mousquetaires. Notamment dans un éclair mousse de pruneau et armagnac ! Quant à sa carte, elle propose un chou à la gasconne et homard, où l’eau-de-vie a droit de citer. Alors, lorsque le Bureau National Interprofessionnel de l'Armagnac (BNIA) l’a sollicité pour présider le concours « Les Talents de l’Armagnac 2017 », à Eauze, le chef du Viscos n’avait pas hésité un instant. Alexis, son fils, a fait un tour de France des compagnons cuisiniers avant de revenir dans la maison mère, dans le village de Saint-Savin. Avec Alexis, la 7e génération aux commandes du Viscos, ils ont le don de marier la cuisine traditionnelle avec un accent de modernité. S’ils aiment à dorer le succulent porc noir gascon ou le traditionnel foie gras, c’est toujours en innovant, inspiré de leurs voyages et de leurs expériences gastronomiques à l’étranger. Porte-drapeaux de la cuisine traditionnelle bigourdane, et d’une cuisine du grand Sud-Ouest, entre tradition et modernité, Jean-Pierre et son fils Alexis auront su conquérir les gourmands et proposer une table raffinée et gouteuse, où manger la cuisine de nos deux grands Chefs, dans ce beau village de Saint-Savin, est un vrai régal et un grand moment de convivialité.
Jean-Pierre SAINT-MARTIN, né en 1950 à Saint-Savin est le Chef du restaurant Le Viscos, à Saint-Savin, un village plein de charme, perché sur son piton rocheux, et le délégué d’Occitanie des Maîtres Cuisiniers de France. Depuis la terrasse fleurie du lieu, on a une superbe vue sur toute la vallée d'Argelès-Gazost. En plein cœur des Pyrénées, ce paradis du palais est idéalement situé. Les lecteurs de l'écrivain brésilien Paulo Coelho connaissent Saint-Savin, ce délicieux village figé dans le temps et dans la pierre. Ils y sont venus avec Pilar, en lisant « Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j’ai pleuré... » Si après 50 ans passés aux fourneaux, Jean-Pierre a passé la main à son fils Alexis et Maria sa belle-fille, la septième génération au « piano » du restaurant, il garde néanmoins l’œil sur tout, en cuisine comme en salle, et continue à faire le tour des tables dans un souci d’offrir du plaisir à ses clients fins gourmets. Il apparaît en salle et explique avec passion l’origine des produits et des arrivages et tout commence par une écoute attentive du maître qui vous conte le menu. Puis, vous entrez en dégustation, savourez ce plat relevé aux délicats parfums des herbes de montagne. Son grand restaurant connu du Pays Basque au Midi Toulousain, réputé pour sa délicieuse cuisine à la fois créative et traditionnelle du terroir serait presque le centre gastronomique de la Bigorre tant le chef y explore les saveurs de produits du terroir local : « la garbure qu'on ne trouve nulle part ailleurs, le foie poêlé et les pieds de cochon... ». Le chef fait avec son talent de véritables petites merveilles. Maître Cuisinier de France, souvent cité par les médias spécialisés, il propose cet art de la gastronomie inspiré par ses origines paysannes et un grand-oncle au talent reconnu, qui avait travaillé pour le comte de Paris, l’ambassade d’Espagne et divers palaces. Pour poursuivre une visite en Haute-Bigorre, rien de tel que la maison de Jean-Pierre. L’adresse est un voyage d’histoire et d’émotions, où les assiettes du terroir se mêlent aux époques et souvenirs conservés du temps. Et face aux immortelles montagnes pyrénéennes, on savoure son velouté de châtaignes et sa raviole de boudin aux épices, ses coustous laqués, ses gnocchis de topinambour et son émulsion au wasabi doux, sa brioche mousseline façon pain perdu à la pomme. Jean-Pierre et Alexis vous accueillent chez eux, dans leur restaurant, véritable institution locale. La table est gourmande. Il affiche 2 toques au Gault & Millau, qui le qualifie comme l'institution locale. Dans son village typiquement pyrénéen, entouré de hautes montagnes, Jean-Pierre aime s'inspirer des vieilles recettes où se mêlent les saveurs des plantes de montagne, de porc noir de Bigorre, mais aussi du moelleux haricot tarbais ou de l'oignon doux de Trébons. Les Saint-Martin sont restaurateurs de père en fils depuis sept générations. C’est dire combien leur auberge a vu passer de gastronomes. On vient à l’auberge du Viscos parfois pour profiter du paysage (l’hôtel compte sept chambres et deux suites) mais surtout pour déguster les spécialités pyrénéennes qui ponctuent la carte. Car, comme dit Jean-Pierre : « Un cuisinier, c’est un paysan qui a mal tourné ! ». Et les produits du terroir ne manquent pas dans sa cuisine : porc noir de Bigorre, poule noire d'Astarac-Bigorre, haricots tarbais, le légume emblématique de la région, authentique garbure bigourdane aux haricots tarbais avec comme ingrédients de base : une potée de choux, haricots tarbais, haut de jambon séché, poitrine de porc hachée… Un plat complet et revigorant qui se mange, comme le pot-au-feu, en plusieurs services : d’abord la soupe, trempée de pain de campagne. Puis les légumes et la viande. Dans sa version luxe, on peut y ajouter au dernier moment une escalope de foie gras de canard. À l’auberge Le Viscos, on cuisine aussi le délicieux agneau des Pyrénées et le mouton AOC de Barèges-Gavarnie. Nourries tout l’été dans les estives de thym, serpolet et autres herbes des Pyrénées, les bêtes offrent une viande parfumée à souhait que l’on sert en gigots ou en grillades avec un peu de genièvre écrasé pour exhausser encore les saveurs. Le foie gras version pyrénéenne ne se sert pas qu’avec la garbure : on peut le cuire au torchon avec du Jurançon, le vin du terroir tout proche. À essayer aussi avec un chutney et un peu de miel d’acacia. Le Madiran, également un vin de la région, se marie très bien avec la douceur du foie gras, dans une version pochée. Enfin, les skieurs, randonneurs ou simples curieux peuvent tenter les virils petits déjeuners locaux : un œuf frit avec de la ventrèche de porc noir de Bigorre, ou une omelette au saucisson noir ! À l’auberge l’on peut déguster bien d’autres spécialités comme un carré de porc noir de Bigorre poêlé ou un confit d’oignons de Trébons au Pacherenc. « Avec Alexis nous cuisinons à quatre mains : en équilibre entre les nouvelles techniques de préparation, de cuisson, de cuisiner et le respect de notre terroir, de nos produits, de notre histoire, du fait maison. » Jean-Pierre a poursuivi une aventure familiale débutée en 1840 ! « Comme souvent dans nos contrées rurales, s’amuse-t-il, ce type de commerce réunissait café, auberge, épicerie, tabac et s’adossait à une ferme. » En 1957, son père structurait l’affaire qui, aujourd’hui, demeure une étape gourmande incontournable dans cette vallée entre les cols mythiques d’Aubisque et du Tourmalet. Si un « Bib Gourmand MICHELIN » est accroché à la porte d’entrée du restaurant et si le patron est une des figures emblématiques des Maîtres Cuisiniers de France, c’est que la table est de qualité. Une réussite exemplaire pour ce maître de la cuisine traditionnelle pyrénéenne. Et un soulagement encore plus grand pour Jean-Pierre : que ses deux fils s’apprêtent à lui succéder. L’un en cuisine et l’autre côté gestion. De ses études culinaires à Tarbes, le Chef avait gardé de solides amitiés avec des copains restaurateurs gersois. À commencer par Bernard Ramouneda et bien sûr André Daguin, décédé en 2019, qui avait fait beaucoup pour la profession en général. Un Gers auquel Jean-Pierre est attaché, aussi, pour son art de vivre et son Armagnac. « Je suis Gascon avant tout, s’exclame-t-il. Alors vous pensez bien que j’apprécie cette eau-de-vie. » Que l’on retrouve dans sa cuisine, surtout en période de gibier mais aussi pour flamber des écrevisses. Dans ses desserts Jean-Pierre glisse aussi le breuvage des Mousquetaires. Notamment dans un éclair mousse de pruneau et armagnac ! Quant à sa carte, elle propose un chou à la gasconne et homard, où l’eau-de-vie a droit de citer. Alors, lorsque le Bureau National Interprofessionnel de l'Armagnac (BNIA) l’a sollicité pour présider le concours « Les Talents de l’Armagnac 2017 », à Eauze, le chef du Viscos n’avait pas hésité un instant. Alexis, son fils, a fait un tour de France des compagnons cuisiniers avant de revenir dans la maison mère, dans le village de Saint-Savin. Avec Alexis, la 7e génération aux commandes du Viscos, ils ont le don de marier la cuisine traditionnelle avec un accent de modernité. S’ils aiment à dorer le succulent porc noir gascon ou le traditionnel foie gras, c’est toujours en innovant, inspiré de leurs voyages et de leurs expériences gastronomiques à l’étranger. Porte-drapeaux de la cuisine traditionnelle bigourdane, et d’une cuisine du grand Sud-Ouest, entre tradition et modernité, Jean-Pierre et son fils Alexis auront su conquérir les gourmands et proposer une table raffinée et gouteuse, où manger la cuisine de nos deux grands Chefs, dans ce beau village de Saint-Savin, est un vrai régal et un grand moment de convivialité.
 Jean-Pierre SAINT-MARTIN, né en 1950 à Saint-Savin est le Chef du restaurant Le Viscos, à Saint-Savin, un village plein de charme, perché sur son piton rocheux, et le délégué d’Occitanie des Maîtres Cuisiniers de France. Depuis la terrasse fleurie du lieu, on a une superbe vue sur toute la vallée d'Argelès-Gazost. En plein cœur des Pyrénées, ce paradis du palais est idéalement situé. Les lecteurs de l'écrivain brésilien Paulo Coelho connaissent Saint-Savin, ce délicieux village figé dans le temps et dans la pierre. Ils y sont venus avec Pilar, en lisant « Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j’ai pleuré... » Si après 50 ans passés aux fourneaux, Jean-Pierre a passé la main à son fils Alexis et Maria sa belle-fille, la septième génération au « piano » du restaurant, il garde néanmoins l’œil sur tout, en cuisine comme en salle, et continue à faire le tour des tables dans un souci d’offrir du plaisir à ses clients fins gourmets. Il apparaît en salle et explique avec passion l’origine des produits et des arrivages et tout commence par une écoute attentive du maître qui vous conte le menu. Puis, vous entrez en dégustation, savourez ce plat relevé aux délicats parfums des herbes de montagne. Son grand restaurant connu du Pays Basque au Midi Toulousain, réputé pour sa délicieuse cuisine à la fois créative et traditionnelle du terroir serait presque le centre gastronomique de la Bigorre tant le chef y explore les saveurs de produits du terroir local : « la garbure qu'on ne trouve nulle part ailleurs, le foie poêlé et les pieds de cochon... ». Le chef fait avec son talent de véritables petites merveilles. Maître Cuisinier de France, souvent cité par les médias spécialisés, il propose cet art de la gastronomie inspiré par ses origines paysannes et un grand-oncle au talent reconnu, qui avait travaillé pour le comte de Paris, l’ambassade d’Espagne et divers palaces. Pour poursuivre une visite en Haute-Bigorre, rien de tel que la maison de Jean-Pierre. L’adresse est un voyage d’histoire et d’émotions, où les assiettes du terroir se mêlent aux époques et souvenirs conservés du temps. Et face aux immortelles montagnes pyrénéennes, on savoure son velouté de châtaignes et sa raviole de boudin aux épices, ses coustous laqués, ses gnocchis de topinambour et son émulsion au wasabi doux, sa brioche mousseline façon pain perdu à la pomme. Jean-Pierre et Alexis vous accueillent chez eux, dans leur restaurant, véritable institution locale. La table est gourmande. Il affiche 2 toques au Gault & Millau, qui le qualifie comme l'institution locale. Dans son village typiquement pyrénéen, entouré de hautes montagnes, Jean-Pierre aime s'inspirer des vieilles recettes où se mêlent les saveurs des plantes de montagne, de porc noir de Bigorre, mais aussi du moelleux haricot tarbais ou de l'oignon doux de Trébons. Les Saint-Martin sont restaurateurs de père en fils depuis sept générations. C’est dire combien leur auberge a vu passer de gastronomes. On vient à l’auberge du Viscos parfois pour profiter du paysage (l’hôtel compte sept chambres et deux suites) mais surtout pour déguster les spécialités pyrénéennes qui ponctuent la carte. Car, comme dit Jean-Pierre : « Un cuisinier, c’est un paysan qui a mal tourné ! ». Et les produits du terroir ne manquent pas dans sa cuisine : porc noir de Bigorre, poule noire d'Astarac-Bigorre, haricots tarbais, le légume emblématique de la région, authentique garbure bigourdane aux haricots tarbais avec comme ingrédients de base : une potée de choux, haricots tarbais, haut de jambon séché, poitrine de porc hachée… Un plat complet et revigorant qui se mange, comme le pot-au-feu, en plusieurs services : d’abord la soupe, trempée de pain de campagne. Puis les légumes et la viande. Dans sa version luxe, on peut y ajouter au dernier moment une escalope de foie gras de canard. À l’auberge Le Viscos, on cuisine aussi le délicieux agneau des Pyrénées et le mouton AOC de Barèges-Gavarnie. Nourries tout l’été dans les estives de thym, serpolet et autres herbes des Pyrénées, les bêtes offrent une viande parfumée à souhait que l’on sert en gigots ou en grillades avec un peu de genièvre écrasé pour exhausser encore les saveurs. Le foie gras version pyrénéenne ne se sert pas qu’avec la garbure : on peut le cuire au torchon avec du Jurançon, le vin du terroir tout proche. À essayer aussi avec un chutney et un peu de miel d’acacia. Le Madiran, également un vin de la région, se marie très bien avec la douceur du foie gras, dans une version pochée. Enfin, les skieurs, randonneurs ou simples curieux peuvent tenter les virils petits déjeuners locaux : un œuf frit avec de la ventrèche de porc noir de Bigorre, ou une omelette au saucisson noir ! À l’auberge l’on peut déguster bien d’autres spécialités comme un carré de porc noir de Bigorre poêlé ou un confit d’oignons de Trébons au Pacherenc. « Avec Alexis nous cuisinons à quatre mains : en équilibre entre les nouvelles techniques de préparation, de cuisson, de cuisiner et le respect de notre terroir, de nos produits, de notre histoire, du fait maison. » Jean-Pierre a poursuivi une aventure familiale débutée en 1840 ! « Comme souvent dans nos contrées rurales, s’amuse-t-il, ce type de commerce réunissait café, auberge, épicerie, tabac et s’adossait à une ferme. » En 1957, son père structurait l’affaire qui, aujourd’hui, demeure une étape gourmande incontournable dans cette vallée entre les cols mythiques d’Aubisque et du Tourmalet. Si un « Bib Gourmand MICHELIN » est accroché à la porte d’entrée du restaurant et si le patron est une des figures emblématiques des Maîtres Cuisiniers de France, c’est que la table est de qualité. Une réussite exemplaire pour ce maître de la cuisine traditionnelle pyrénéenne. Et un soulagement encore plus grand pour Jean-Pierre : que ses deux fils s’apprêtent à lui succéder. L’un en cuisine et l’autre côté gestion. De ses études culinaires à Tarbes, le Chef avait gardé de solides amitiés avec des copains restaurateurs gersois. À commencer par Bernard Ramouneda et bien sûr André Daguin, décédé en 2019, qui avait fait beaucoup pour la profession en général. Un Gers auquel Jean-Pierre est attaché, aussi, pour son art de vivre et son Armagnac. « Je suis Gascon avant tout, s’exclame-t-il. Alors vous pensez bien que j’apprécie cette eau-de-vie. » Que l’on retrouve dans sa cuisine, surtout en période de gibier mais aussi pour flamber des écrevisses. Dans ses desserts Jean-Pierre glisse aussi le breuvage des Mousquetaires. Notamment dans un éclair mousse de pruneau et armagnac ! Quant à sa carte, elle propose un chou à la gasconne et homard, où l’eau-de-vie a droit de citer. Alors, lorsque le Bureau National Interprofessionnel de l'Armagnac (BNIA) l’a sollicité pour présider le concours « Les Talents de l’Armagnac 2017 », à Eauze, le chef du Viscos n’avait pas hésité un instant. Alexis, son fils, a fait un tour de France des compagnons cuisiniers avant de revenir dans la maison mère, dans le village de Saint-Savin. Avec Alexis, la 7e génération aux commandes du Viscos, ils ont le don de marier la cuisine traditionnelle avec un accent de modernité. S’ils aiment à dorer le succulent porc noir gascon ou le traditionnel foie gras, c’est toujours en innovant, inspiré de leurs voyages et de leurs expériences gastronomiques à l’étranger. Porte-drapeaux de la cuisine traditionnelle bigourdane, et d’une cuisine du grand Sud-Ouest, entre tradition et modernité, Jean-Pierre et son fils Alexis auront su conquérir les gourmands et proposer une table raffinée et gouteuse, où manger la cuisine de nos deux grands Chefs, dans ce beau village de Saint-Savin, est un vrai régal et un grand moment de convivialité.
Jean-Pierre SAINT-MARTIN, né en 1950 à Saint-Savin est le Chef du restaurant Le Viscos, à Saint-Savin, un village plein de charme, perché sur son piton rocheux, et le délégué d’Occitanie des Maîtres Cuisiniers de France. Depuis la terrasse fleurie du lieu, on a une superbe vue sur toute la vallée d'Argelès-Gazost. En plein cœur des Pyrénées, ce paradis du palais est idéalement situé. Les lecteurs de l'écrivain brésilien Paulo Coelho connaissent Saint-Savin, ce délicieux village figé dans le temps et dans la pierre. Ils y sont venus avec Pilar, en lisant « Sur le bord de la rivière Piedra, je me suis assise et j’ai pleuré... » Si après 50 ans passés aux fourneaux, Jean-Pierre a passé la main à son fils Alexis et Maria sa belle-fille, la septième génération au « piano » du restaurant, il garde néanmoins l’œil sur tout, en cuisine comme en salle, et continue à faire le tour des tables dans un souci d’offrir du plaisir à ses clients fins gourmets. Il apparaît en salle et explique avec passion l’origine des produits et des arrivages et tout commence par une écoute attentive du maître qui vous conte le menu. Puis, vous entrez en dégustation, savourez ce plat relevé aux délicats parfums des herbes de montagne. Son grand restaurant connu du Pays Basque au Midi Toulousain, réputé pour sa délicieuse cuisine à la fois créative et traditionnelle du terroir serait presque le centre gastronomique de la Bigorre tant le chef y explore les saveurs de produits du terroir local : « la garbure qu'on ne trouve nulle part ailleurs, le foie poêlé et les pieds de cochon... ». Le chef fait avec son talent de véritables petites merveilles. Maître Cuisinier de France, souvent cité par les médias spécialisés, il propose cet art de la gastronomie inspiré par ses origines paysannes et un grand-oncle au talent reconnu, qui avait travaillé pour le comte de Paris, l’ambassade d’Espagne et divers palaces. Pour poursuivre une visite en Haute-Bigorre, rien de tel que la maison de Jean-Pierre. L’adresse est un voyage d’histoire et d’émotions, où les assiettes du terroir se mêlent aux époques et souvenirs conservés du temps. Et face aux immortelles montagnes pyrénéennes, on savoure son velouté de châtaignes et sa raviole de boudin aux épices, ses coustous laqués, ses gnocchis de topinambour et son émulsion au wasabi doux, sa brioche mousseline façon pain perdu à la pomme. Jean-Pierre et Alexis vous accueillent chez eux, dans leur restaurant, véritable institution locale. La table est gourmande. Il affiche 2 toques au Gault & Millau, qui le qualifie comme l'institution locale. Dans son village typiquement pyrénéen, entouré de hautes montagnes, Jean-Pierre aime s'inspirer des vieilles recettes où se mêlent les saveurs des plantes de montagne, de porc noir de Bigorre, mais aussi du moelleux haricot tarbais ou de l'oignon doux de Trébons. Les Saint-Martin sont restaurateurs de père en fils depuis sept générations. C’est dire combien leur auberge a vu passer de gastronomes. On vient à l’auberge du Viscos parfois pour profiter du paysage (l’hôtel compte sept chambres et deux suites) mais surtout pour déguster les spécialités pyrénéennes qui ponctuent la carte. Car, comme dit Jean-Pierre : « Un cuisinier, c’est un paysan qui a mal tourné ! ». Et les produits du terroir ne manquent pas dans sa cuisine : porc noir de Bigorre, poule noire d'Astarac-Bigorre, haricots tarbais, le légume emblématique de la région, authentique garbure bigourdane aux haricots tarbais avec comme ingrédients de base : une potée de choux, haricots tarbais, haut de jambon séché, poitrine de porc hachée… Un plat complet et revigorant qui se mange, comme le pot-au-feu, en plusieurs services : d’abord la soupe, trempée de pain de campagne. Puis les légumes et la viande. Dans sa version luxe, on peut y ajouter au dernier moment une escalope de foie gras de canard. À l’auberge Le Viscos, on cuisine aussi le délicieux agneau des Pyrénées et le mouton AOC de Barèges-Gavarnie. Nourries tout l’été dans les estives de thym, serpolet et autres herbes des Pyrénées, les bêtes offrent une viande parfumée à souhait que l’on sert en gigots ou en grillades avec un peu de genièvre écrasé pour exhausser encore les saveurs. Le foie gras version pyrénéenne ne se sert pas qu’avec la garbure : on peut le cuire au torchon avec du Jurançon, le vin du terroir tout proche. À essayer aussi avec un chutney et un peu de miel d’acacia. Le Madiran, également un vin de la région, se marie très bien avec la douceur du foie gras, dans une version pochée. Enfin, les skieurs, randonneurs ou simples curieux peuvent tenter les virils petits déjeuners locaux : un œuf frit avec de la ventrèche de porc noir de Bigorre, ou une omelette au saucisson noir ! À l’auberge l’on peut déguster bien d’autres spécialités comme un carré de porc noir de Bigorre poêlé ou un confit d’oignons de Trébons au Pacherenc. « Avec Alexis nous cuisinons à quatre mains : en équilibre entre les nouvelles techniques de préparation, de cuisson, de cuisiner et le respect de notre terroir, de nos produits, de notre histoire, du fait maison. » Jean-Pierre a poursuivi une aventure familiale débutée en 1840 ! « Comme souvent dans nos contrées rurales, s’amuse-t-il, ce type de commerce réunissait café, auberge, épicerie, tabac et s’adossait à une ferme. » En 1957, son père structurait l’affaire qui, aujourd’hui, demeure une étape gourmande incontournable dans cette vallée entre les cols mythiques d’Aubisque et du Tourmalet. Si un « Bib Gourmand MICHELIN » est accroché à la porte d’entrée du restaurant et si le patron est une des figures emblématiques des Maîtres Cuisiniers de France, c’est que la table est de qualité. Une réussite exemplaire pour ce maître de la cuisine traditionnelle pyrénéenne. Et un soulagement encore plus grand pour Jean-Pierre : que ses deux fils s’apprêtent à lui succéder. L’un en cuisine et l’autre côté gestion. De ses études culinaires à Tarbes, le Chef avait gardé de solides amitiés avec des copains restaurateurs gersois. À commencer par Bernard Ramouneda et bien sûr André Daguin, décédé en 2019, qui avait fait beaucoup pour la profession en général. Un Gers auquel Jean-Pierre est attaché, aussi, pour son art de vivre et son Armagnac. « Je suis Gascon avant tout, s’exclame-t-il. Alors vous pensez bien que j’apprécie cette eau-de-vie. » Que l’on retrouve dans sa cuisine, surtout en période de gibier mais aussi pour flamber des écrevisses. Dans ses desserts Jean-Pierre glisse aussi le breuvage des Mousquetaires. Notamment dans un éclair mousse de pruneau et armagnac ! Quant à sa carte, elle propose un chou à la gasconne et homard, où l’eau-de-vie a droit de citer. Alors, lorsque le Bureau National Interprofessionnel de l'Armagnac (BNIA) l’a sollicité pour présider le concours « Les Talents de l’Armagnac 2017 », à Eauze, le chef du Viscos n’avait pas hésité un instant. Alexis, son fils, a fait un tour de France des compagnons cuisiniers avant de revenir dans la maison mère, dans le village de Saint-Savin. Avec Alexis, la 7e génération aux commandes du Viscos, ils ont le don de marier la cuisine traditionnelle avec un accent de modernité. S’ils aiment à dorer le succulent porc noir gascon ou le traditionnel foie gras, c’est toujours en innovant, inspiré de leurs voyages et de leurs expériences gastronomiques à l’étranger. Porte-drapeaux de la cuisine traditionnelle bigourdane, et d’une cuisine du grand Sud-Ouest, entre tradition et modernité, Jean-Pierre et son fils Alexis auront su conquérir les gourmands et proposer une table raffinée et gouteuse, où manger la cuisine de nos deux grands Chefs, dans ce beau village de Saint-Savin, est un vrai régal et un grand moment de convivialité.SAVIGNON André (1875-1947)
Journaliste, écrivain, lauréat du prix Goncourt
 André SAVIGNON, né à Tarbes le 1er janvier 1875 et mort à Londres le 10 janvier 1947, à l’âge de 72 ans. Il effectue de nombreux séjours en Angleterre à Plymouth, notamment de 1908 à 1914. Après l'armistice de 1918, il s'installe à Saint-Malo. Il fut envoyé de nombreuses fois en Angleterre par les journaux pour lesquels il travaillait. Il s'y trouvait lorsqu'éclata la Seconde Guerre mondiale et il dut y rester. Écrivain, il a obtenu le prix Goncourt en 1912 pour son roman « Filles de la pluie », publié aux Éditions Grasset. Il a obtenu ce prix par six voix contre cinq à Julien Benda. Ce roman publié en 1912 et récompensé par le prix Goncourt, suscita à cette époque, quelques polémiques. Il lui était reproché des généralisations un peu hâtives, lorsqu'il décrivait les mœurs des Ouessantines. Il faut y voir une protestation contre un état des choses que l'auteur jugeait funeste à l'île lointaine et si belle : la présence d'hommes de troupe lâchés sans contrôle au milieu de filles innocentes, avec les conséquences que l'on devine... Le 29 juillet 1902, il a épousé Marie-Josèphe Monzelun à Paris, puis Berthe Desgranges le 27 septembre 1919 à Ambérac. Il est resté sans descendance. Il fut promu chevalier de la Légion d'honneur. Il fut un être d'une extraordinaire complexité. Journaliste, nouvelliste et feuilletoniste, il eut des difficultés à s'imposer dans le domaine littéraire et c'est par un tour de passe-passe qu'il obtint le prix Goncourt 1912. Il connut alors un certain lustre bien que son style âpre et devancier pour l'époque ne plut pas aux écrivains et lecteurs traditionnels. Ce qu'il décrivait, s'il convenait aux amateurs de folklore, offensa les Bretons qui lui reprochèrent des outrances. La carrière qu'il ne pourrait réussir en France en raison de son caractère d'écorché vif, il l'obtint en Angleterre grâce à sa parfaite connaissance de la langue et des mœurs. Cette vie indépendante outre-Manche, y compris en son privé, lui convint. Il parvint en quelques années à devenir un correspondant économique et politique de premier plan. Il y multiplia aussi les tentatives littéraires mais n'obtint que des succès mitigés. La guerre de 40 qui le bloqua en Angleterre le traumatisa et lui fit éprouver des sentiments contradictoires. Il écrivit d'énormes mémoires dans lesquels défilent toutes les personnalités de l'époque. Ce témoignage très sulfureux n'a été jusqu’ici que très partiellement publié. N'ayant jamais hésité à fréquenter à la fois le ruisseau et le palais, il fut avant tout un grand témoin de son époque. Journaliste consacré par ses livres, tous inspirés de reportages, où il se révèle un des meilleurs écrivains de l’insolite quotidien, correspondant en Grande-Bretagne depuis plus de trente ans lorsqu’il se retrouve à Plymouth où il a déjà vécu, c’est un familier de la langue et de la société anglaises, qui observe et note le comportement des Britanniques dans « Le Feu du ciel » journal d’un Français dans la bataille d’Angleterre, celui du « Blitz » de Plymouth, un des plus meurtriers de l’été 1940 au printemps 1941. Il est l’auteur de nombreux livres parmi lesquels : « Les Vigies des mers », Fayard, 1908 ; « Filles de la pluie : scènes de la vie ouessantine », Grasset, 1912 (Prix Goncourt 1912) ; « Une femme dans chaque port », Flammarion, 1918 ; « Le Secret des eaux », Calmann-Lévy, 1923 ; « La Tristesse d’Elsie », Calmann-Lévy, 1924 ; « La Dame de la Sainte-Alice », Calmann-Lévy, 1926 ; « Tous les trois », Calmann-Lévy, 1928 ; « Saint-Malo, nid de Corsaire », La Renaissance du Livre, 1931 ; « Au petit bateau », La Renaissance du Livre, 1932 ; « Occupation », Édition de France, 1938 ; « Le Feu du ciel, Plymouth 1940-1941 », Le Cercle d’or, 1984 ; « Dans ma prison de Londres (1939-1946) », Ketel, 1962. Le 10 janvier 1947, il meurt à l'hôpital français de Londres à la suite d'une pneumonie (sans avoir revu la France). Il est enterré dans le petit cimetière marin du Rosais, l'un des plus beaux cimetières marins de la Côte d’Émeraude, face au barrage de la Rance.
André SAVIGNON, né à Tarbes le 1er janvier 1875 et mort à Londres le 10 janvier 1947, à l’âge de 72 ans. Il effectue de nombreux séjours en Angleterre à Plymouth, notamment de 1908 à 1914. Après l'armistice de 1918, il s'installe à Saint-Malo. Il fut envoyé de nombreuses fois en Angleterre par les journaux pour lesquels il travaillait. Il s'y trouvait lorsqu'éclata la Seconde Guerre mondiale et il dut y rester. Écrivain, il a obtenu le prix Goncourt en 1912 pour son roman « Filles de la pluie », publié aux Éditions Grasset. Il a obtenu ce prix par six voix contre cinq à Julien Benda. Ce roman publié en 1912 et récompensé par le prix Goncourt, suscita à cette époque, quelques polémiques. Il lui était reproché des généralisations un peu hâtives, lorsqu'il décrivait les mœurs des Ouessantines. Il faut y voir une protestation contre un état des choses que l'auteur jugeait funeste à l'île lointaine et si belle : la présence d'hommes de troupe lâchés sans contrôle au milieu de filles innocentes, avec les conséquences que l'on devine... Le 29 juillet 1902, il a épousé Marie-Josèphe Monzelun à Paris, puis Berthe Desgranges le 27 septembre 1919 à Ambérac. Il est resté sans descendance. Il fut promu chevalier de la Légion d'honneur. Il fut un être d'une extraordinaire complexité. Journaliste, nouvelliste et feuilletoniste, il eut des difficultés à s'imposer dans le domaine littéraire et c'est par un tour de passe-passe qu'il obtint le prix Goncourt 1912. Il connut alors un certain lustre bien que son style âpre et devancier pour l'époque ne plut pas aux écrivains et lecteurs traditionnels. Ce qu'il décrivait, s'il convenait aux amateurs de folklore, offensa les Bretons qui lui reprochèrent des outrances. La carrière qu'il ne pourrait réussir en France en raison de son caractère d'écorché vif, il l'obtint en Angleterre grâce à sa parfaite connaissance de la langue et des mœurs. Cette vie indépendante outre-Manche, y compris en son privé, lui convint. Il parvint en quelques années à devenir un correspondant économique et politique de premier plan. Il y multiplia aussi les tentatives littéraires mais n'obtint que des succès mitigés. La guerre de 40 qui le bloqua en Angleterre le traumatisa et lui fit éprouver des sentiments contradictoires. Il écrivit d'énormes mémoires dans lesquels défilent toutes les personnalités de l'époque. Ce témoignage très sulfureux n'a été jusqu’ici que très partiellement publié. N'ayant jamais hésité à fréquenter à la fois le ruisseau et le palais, il fut avant tout un grand témoin de son époque. Journaliste consacré par ses livres, tous inspirés de reportages, où il se révèle un des meilleurs écrivains de l’insolite quotidien, correspondant en Grande-Bretagne depuis plus de trente ans lorsqu’il se retrouve à Plymouth où il a déjà vécu, c’est un familier de la langue et de la société anglaises, qui observe et note le comportement des Britanniques dans « Le Feu du ciel » journal d’un Français dans la bataille d’Angleterre, celui du « Blitz » de Plymouth, un des plus meurtriers de l’été 1940 au printemps 1941. Il est l’auteur de nombreux livres parmi lesquels : « Les Vigies des mers », Fayard, 1908 ; « Filles de la pluie : scènes de la vie ouessantine », Grasset, 1912 (Prix Goncourt 1912) ; « Une femme dans chaque port », Flammarion, 1918 ; « Le Secret des eaux », Calmann-Lévy, 1923 ; « La Tristesse d’Elsie », Calmann-Lévy, 1924 ; « La Dame de la Sainte-Alice », Calmann-Lévy, 1926 ; « Tous les trois », Calmann-Lévy, 1928 ; « Saint-Malo, nid de Corsaire », La Renaissance du Livre, 1931 ; « Au petit bateau », La Renaissance du Livre, 1932 ; « Occupation », Édition de France, 1938 ; « Le Feu du ciel, Plymouth 1940-1941 », Le Cercle d’or, 1984 ; « Dans ma prison de Londres (1939-1946) », Ketel, 1962. Le 10 janvier 1947, il meurt à l'hôpital français de Londres à la suite d'une pneumonie (sans avoir revu la France). Il est enterré dans le petit cimetière marin du Rosais, l'un des plus beaux cimetières marins de la Côte d’Émeraude, face au barrage de la Rance.
 André SAVIGNON, né à Tarbes le 1er janvier 1875 et mort à Londres le 10 janvier 1947, à l’âge de 72 ans. Il effectue de nombreux séjours en Angleterre à Plymouth, notamment de 1908 à 1914. Après l'armistice de 1918, il s'installe à Saint-Malo. Il fut envoyé de nombreuses fois en Angleterre par les journaux pour lesquels il travaillait. Il s'y trouvait lorsqu'éclata la Seconde Guerre mondiale et il dut y rester. Écrivain, il a obtenu le prix Goncourt en 1912 pour son roman « Filles de la pluie », publié aux Éditions Grasset. Il a obtenu ce prix par six voix contre cinq à Julien Benda. Ce roman publié en 1912 et récompensé par le prix Goncourt, suscita à cette époque, quelques polémiques. Il lui était reproché des généralisations un peu hâtives, lorsqu'il décrivait les mœurs des Ouessantines. Il faut y voir une protestation contre un état des choses que l'auteur jugeait funeste à l'île lointaine et si belle : la présence d'hommes de troupe lâchés sans contrôle au milieu de filles innocentes, avec les conséquences que l'on devine... Le 29 juillet 1902, il a épousé Marie-Josèphe Monzelun à Paris, puis Berthe Desgranges le 27 septembre 1919 à Ambérac. Il est resté sans descendance. Il fut promu chevalier de la Légion d'honneur. Il fut un être d'une extraordinaire complexité. Journaliste, nouvelliste et feuilletoniste, il eut des difficultés à s'imposer dans le domaine littéraire et c'est par un tour de passe-passe qu'il obtint le prix Goncourt 1912. Il connut alors un certain lustre bien que son style âpre et devancier pour l'époque ne plut pas aux écrivains et lecteurs traditionnels. Ce qu'il décrivait, s'il convenait aux amateurs de folklore, offensa les Bretons qui lui reprochèrent des outrances. La carrière qu'il ne pourrait réussir en France en raison de son caractère d'écorché vif, il l'obtint en Angleterre grâce à sa parfaite connaissance de la langue et des mœurs. Cette vie indépendante outre-Manche, y compris en son privé, lui convint. Il parvint en quelques années à devenir un correspondant économique et politique de premier plan. Il y multiplia aussi les tentatives littéraires mais n'obtint que des succès mitigés. La guerre de 40 qui le bloqua en Angleterre le traumatisa et lui fit éprouver des sentiments contradictoires. Il écrivit d'énormes mémoires dans lesquels défilent toutes les personnalités de l'époque. Ce témoignage très sulfureux n'a été jusqu’ici que très partiellement publié. N'ayant jamais hésité à fréquenter à la fois le ruisseau et le palais, il fut avant tout un grand témoin de son époque. Journaliste consacré par ses livres, tous inspirés de reportages, où il se révèle un des meilleurs écrivains de l’insolite quotidien, correspondant en Grande-Bretagne depuis plus de trente ans lorsqu’il se retrouve à Plymouth où il a déjà vécu, c’est un familier de la langue et de la société anglaises, qui observe et note le comportement des Britanniques dans « Le Feu du ciel » journal d’un Français dans la bataille d’Angleterre, celui du « Blitz » de Plymouth, un des plus meurtriers de l’été 1940 au printemps 1941. Il est l’auteur de nombreux livres parmi lesquels : « Les Vigies des mers », Fayard, 1908 ; « Filles de la pluie : scènes de la vie ouessantine », Grasset, 1912 (Prix Goncourt 1912) ; « Une femme dans chaque port », Flammarion, 1918 ; « Le Secret des eaux », Calmann-Lévy, 1923 ; « La Tristesse d’Elsie », Calmann-Lévy, 1924 ; « La Dame de la Sainte-Alice », Calmann-Lévy, 1926 ; « Tous les trois », Calmann-Lévy, 1928 ; « Saint-Malo, nid de Corsaire », La Renaissance du Livre, 1931 ; « Au petit bateau », La Renaissance du Livre, 1932 ; « Occupation », Édition de France, 1938 ; « Le Feu du ciel, Plymouth 1940-1941 », Le Cercle d’or, 1984 ; « Dans ma prison de Londres (1939-1946) », Ketel, 1962. Le 10 janvier 1947, il meurt à l'hôpital français de Londres à la suite d'une pneumonie (sans avoir revu la France). Il est enterré dans le petit cimetière marin du Rosais, l'un des plus beaux cimetières marins de la Côte d’Émeraude, face au barrage de la Rance.
André SAVIGNON, né à Tarbes le 1er janvier 1875 et mort à Londres le 10 janvier 1947, à l’âge de 72 ans. Il effectue de nombreux séjours en Angleterre à Plymouth, notamment de 1908 à 1914. Après l'armistice de 1918, il s'installe à Saint-Malo. Il fut envoyé de nombreuses fois en Angleterre par les journaux pour lesquels il travaillait. Il s'y trouvait lorsqu'éclata la Seconde Guerre mondiale et il dut y rester. Écrivain, il a obtenu le prix Goncourt en 1912 pour son roman « Filles de la pluie », publié aux Éditions Grasset. Il a obtenu ce prix par six voix contre cinq à Julien Benda. Ce roman publié en 1912 et récompensé par le prix Goncourt, suscita à cette époque, quelques polémiques. Il lui était reproché des généralisations un peu hâtives, lorsqu'il décrivait les mœurs des Ouessantines. Il faut y voir une protestation contre un état des choses que l'auteur jugeait funeste à l'île lointaine et si belle : la présence d'hommes de troupe lâchés sans contrôle au milieu de filles innocentes, avec les conséquences que l'on devine... Le 29 juillet 1902, il a épousé Marie-Josèphe Monzelun à Paris, puis Berthe Desgranges le 27 septembre 1919 à Ambérac. Il est resté sans descendance. Il fut promu chevalier de la Légion d'honneur. Il fut un être d'une extraordinaire complexité. Journaliste, nouvelliste et feuilletoniste, il eut des difficultés à s'imposer dans le domaine littéraire et c'est par un tour de passe-passe qu'il obtint le prix Goncourt 1912. Il connut alors un certain lustre bien que son style âpre et devancier pour l'époque ne plut pas aux écrivains et lecteurs traditionnels. Ce qu'il décrivait, s'il convenait aux amateurs de folklore, offensa les Bretons qui lui reprochèrent des outrances. La carrière qu'il ne pourrait réussir en France en raison de son caractère d'écorché vif, il l'obtint en Angleterre grâce à sa parfaite connaissance de la langue et des mœurs. Cette vie indépendante outre-Manche, y compris en son privé, lui convint. Il parvint en quelques années à devenir un correspondant économique et politique de premier plan. Il y multiplia aussi les tentatives littéraires mais n'obtint que des succès mitigés. La guerre de 40 qui le bloqua en Angleterre le traumatisa et lui fit éprouver des sentiments contradictoires. Il écrivit d'énormes mémoires dans lesquels défilent toutes les personnalités de l'époque. Ce témoignage très sulfureux n'a été jusqu’ici que très partiellement publié. N'ayant jamais hésité à fréquenter à la fois le ruisseau et le palais, il fut avant tout un grand témoin de son époque. Journaliste consacré par ses livres, tous inspirés de reportages, où il se révèle un des meilleurs écrivains de l’insolite quotidien, correspondant en Grande-Bretagne depuis plus de trente ans lorsqu’il se retrouve à Plymouth où il a déjà vécu, c’est un familier de la langue et de la société anglaises, qui observe et note le comportement des Britanniques dans « Le Feu du ciel » journal d’un Français dans la bataille d’Angleterre, celui du « Blitz » de Plymouth, un des plus meurtriers de l’été 1940 au printemps 1941. Il est l’auteur de nombreux livres parmi lesquels : « Les Vigies des mers », Fayard, 1908 ; « Filles de la pluie : scènes de la vie ouessantine », Grasset, 1912 (Prix Goncourt 1912) ; « Une femme dans chaque port », Flammarion, 1918 ; « Le Secret des eaux », Calmann-Lévy, 1923 ; « La Tristesse d’Elsie », Calmann-Lévy, 1924 ; « La Dame de la Sainte-Alice », Calmann-Lévy, 1926 ; « Tous les trois », Calmann-Lévy, 1928 ; « Saint-Malo, nid de Corsaire », La Renaissance du Livre, 1931 ; « Au petit bateau », La Renaissance du Livre, 1932 ; « Occupation », Édition de France, 1938 ; « Le Feu du ciel, Plymouth 1940-1941 », Le Cercle d’or, 1984 ; « Dans ma prison de Londres (1939-1946) », Ketel, 1962. Le 10 janvier 1947, il meurt à l'hôpital français de Londres à la suite d'une pneumonie (sans avoir revu la France). Il est enterré dans le petit cimetière marin du Rosais, l'un des plus beaux cimetières marins de la Côte d’Émeraude, face au barrage de la Rance.SENDERENS Jean-Baptiste (1856-1937)
Chimiste, fondateur de l'École supérieure des sciences de l'Institut catholique de Toulouse, membre correspondant de l'Académie des sciences de Paris, grand oublié du prix Nobel 1912 de chimie qui couronnait Paul Sabatier en même temps que Victor Grignard
 Jean-Baptiste SENDERENS (L’abbé), né le 27 janvier 1856, et mort le 26 septembre 1937 à Barbachen, dans le canton de Rabastens-de-Bigorre est un grand chimiste et prêtre. Il a été l'un des pionniers de la chimie catalytique et un co-découvreur de l'hydrogénation catalytique, un procédé utilisé commercialement pour fabriquer de la margarine. Docteur ès sciences, il fut le collaborateur de Paul Sabatier, lors de ses études déterminantes sur la catalyse. Professeur à l'Institut catholique de Toulouse et directeur de l'École supérieure des sciences, il était aussi docteur en philosophie. Il écrivit deux ouvrages sur l'apologie chrétienne. Il participa activement au dialogue science-foi. Jean-Baptiste Senderens, fut d’abord élève au noviciat de Notre-Dame de Pouey-Laün à Arrens-Marsous. En 1856, les Pères de Notre-Dame de Garaison ouvrirent un collège religieux au sanctuaire de Pouey-Laün, qui donna au diocèse une cinquantaine de prêtres en 15 ans. En 1871, le pensionnat sera supprimé et remplacé par le Noviciat et le Scolasticat de la Congrégation de la Félicitation de Notre-Dame de Lourdes. Un noviciat pour des élèves se destinant à une carrière ecclésiastique avant leur entrée au Grand Séminaire de Tarbes. En 1913, le noviciat sera fermé et remplacé pour quelques années par une école ménagère. Scolarisé au collège des Missionnaires de l'Immaculée Conception à Garaison à partir de la classe de 4e, Senderens manifesta un intérêt très fort pour les sciences, intérêt que sa hiérarchie devait encourager par la suite à cette époque où l’Église catholique estimait nécessaire de s’investir dans les disciplines scientifiques. Ordonné prêtre du diocèse de Tarbes fin 1880, il suivit simultanément à Toulouse des études de lettres à l’Institut catholique et des études de chimie à la Faculté des sciences. Édouard Filhol (1814-1883), titulaire de la chaire de chimie à la faculté des sciences de Toulouse, depuis 1854, l’accueillit dans son laboratoire, où il commença à préparer une thèse. Jean-Baptiste Senderens est devenu chimiste, chanoine et docteur en sciences et philosophie. En 1881, il commença à enseigner la chimie à l'École Supérieure des Sciences de l'Institut catholique de Toulouse et publia cette année-là ses premières notes pour le compte de l'Académie des sciences. À la mort de Filhol en 1883, Sabatier lui succéda et accompagna l’abbé Senderens jusqu’à la soutenance de sa thèse de doctorat en 1892 ; comme on peut en juger, le titre de ce travail − Action du soufre sur les oxydes et les sels en présence d’eau – porte la marque de son nouveau maître ! Paul Sabatier présida son jury de soutenance le 2 février 1892. Dans son discours on peut admirer combien Sabatier était fier que Senderens ait choisi Toulouse plutôt que Paris (la Sorbonne) pour la soutenance de thèse. Le grade scientifique ainsi acquis venait s’ajouter à celui de docteur en philosophie que l’abbé avait obtenu en 1888, probablement à l'université Grégorienne de Rome ; il l'obtint « plenis suffragiis favorabilibus ». À 38 ans, après son grade de docteur ès sciences, il est fait chanoine honoraire par l’évêque de Tarbes Prosper Marie Billère et, tout auréolé de ces grades et récompenses, arrive au bon moment pour poursuivre ce que l’on appellerait aujourd’hui un post-doc, sur le nouveau sujet que lui propose Sabatier. Après dix ans de collaboration avec Filhol, il entama donc une collaboration d'égale durée avec Paul Sabatier, le successeur de Filhol, si proche qu'il est impossible de distinguer le travail de l'un ou de l'autre. Ils travaillèrent ensemble, l’un dans le laboratoire de l’État, l’autre dans celui de l’Institut catholique mais sur des sujets identiques. Les premiers articles communs datent de 1892. Ce furent d’abord des recherches sur les oxydes de l’azote, oxyde azotique, oxyde azoteux et peroxyde d’azote, dont ils comparèrent l’action sur certains métaux ou oxydes métalliques. En effet, ils voulurent comparer ces réactions peu étudiées à celles de l’oxyde de carbone avec les métaux. Ils y préparèrent les métaux et certains oxydes en chauffant les oxydes supérieurs en présence d’hydrogène et observèrent de façon méthodique la réaction des trois gaz azotés sur ces métaux (par exemple le nickel) et les oxydes obtenus. Mais la grande surprise vint d’une expérience non plus sur ces composés azotés, mais avec l’éthylène. La dernière expérience décrite sur le nickel et l’éthylène date du 26 mars 1897. En 1897, Sabatier mit au point, avec Jean-Baptiste Senderens, le procédé d'hydrogénation catalytique des huiles, ce qui lui a permis de réaliser la synthèse de nombreux hydrocarbures. Ils ont publié conjointement 38 notes pour le compte de l'Académie des sciences (CRHAS), 18 mémoires dans le Bulletin de la Société française de chimie et 2 mémoires conjoints aux Annales de chimie et de physique. L’évolution de cette collaboration eut deux apogées en 1895 et 1902. Pendant ces périodes, Sabatier et Senderens publièrent, individuellement, sur des thématiques qui leur furent propres. En novembre 1899, Mgr. Zéphirin Carrière était étudiant à l'Université catholique de Toulouse, où Senderens enseignait la chimie. Carrière rappelle que Senderens avait un laboratoire avec deux sections, une pour la physique et une pour la chimie. Sabatier lui a fait confiance pour préparer les catalyseurs métalliques qu'ils avaient décidé d'utiliser dans leurs expériences de chimie organique. Les réactions de méthanation de COx ont été découvertes pour la première fois par Paul Sabatier et Senderens en 1902. Sabatier et Senderens ont partagé le prix Jecker de l'Académie des sciences en 1905 pour leur découverte du processus Sabatier-Senderens. Il s'agit d'une méthode de synthèse organique utilisant l'hydrogénation et un catalyseur au nickel chauffé. Le procédé est utilisé aujourd'hui pour convertir les huiles végétales insaturées en margarine. Vers 1904-1905, les rapports entre les deux chimistes toulousains commencèrent à se dégrader, ce que l’on peut attribuer à plusieurs causes : – l’arrivée dans l’équipe d’un nouvel élève, Alphonse Mailhe, que Senderens ne semblait pas apprécier ; – l’application de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, qui ne permettait plus à l’abbé de venir en soutane au laboratoire de la Faculté des sciences ; – enseignant à l’Institut catholique de Toulouse (ICT), dont il était directeur de l’École supérieure des sciences depuis 1883, il y poursuivait ses propres recherches dans un laboratoire très bien équipé, ce qui l’éloignait de son maître, à la différence de Mailhe installé à la Faculté des sciences, plus proche géographiquement ; – la perte pour Senderens du traitement d’ecclésiastique qu’il recevait de l’État avant 1905, ce qui l’amena à rechercher des compensations pécuniaires. Il trouva des contrats de recherches industriels, en particulier auprès de l’industriel Camille Poulenc avec la société duquel il travailla longtemps ; – et, peut-être ? − un différend idéologique avec Paul Sabatier qui, bien que catholique pratiquant, était franc-maçon, membre de la loge « Les vrais amis réunis ». On peut alors s’expliquer que la collaboration entre les deux chimistes s’arrêta en 1907, date à partir de laquelle on ne trouve plus de publications communes. Au préalable et malgré cela, en 1905, c’est ensemble qu’ils furent récompensés par l’Académie des sciences qui leur décerna le prix Jecker (doté de 10 000 francs-or), tandis que l’abbé recevait aussi la Médaille Berthelot. Sabatier poursuivit donc ses recherches essentiellement avec Mailhe, avec qui il continua d’appliquer l’hydrogénation catalytique à de nombreux autres composés. En 1912, le prix Nobel de chimie fut attribué à Paul Sabatier en même temps qu’à Victor Grignard. La décision du jury fut justifiée ainsi : « pour sa méthode d’hydrogénation des combinaisons organiques en présence de métaux finement réduits, méthode qui a fait faire de grands progrès à la chimie organique. » Dans son discours de récipiendaire Sabatier mentionne son coauteur Senderens pas moins de six fois. Mais Senderens n’apprécia pas du tout de n’avoir pas été associé à cette récompense ! Pour mieux comprendre sa rancœur, il faut revenir en arrière, le 13 mai 1911, à Berlin, où Paul Sabatier avait été invité à prononcer une conférence devant l’Académie de chimie et où il indiquait en commençant : « Je vais vous entretenir de la méthode générale d’hydrogénation directe par les métaux divisés, que j’ai instituée depuis une dizaine d’années avec la collaboration de mes élèves, M. Senderens d’abord, puis M. Mailhe… » Être traité d’élève accompagnant le « j’ai » réducteur fit réagir le chanoine qui écrivit une réclamation à l’ensemble de la communauté des chimistes français et à l’Académie royale de Stockholm sous la forme d’un dossier où il expliquait sa longue collaboration avec le lauréat en précisant : qu’il n’était pas « l’élève » de Sabatier et « M. Sabatier a une tendance assez prononcée à se faire le seul auteur de ces méthodes. » Sabatier réagit aussitôt. Malgré la correction que le doyen fit paraître dans le même journal allemand qui avait publié sa conférence : « Certains passages de mon exposé concernant la participation de M. Senderens aux méthodes tracées par moi, pourraient recevoir une interprétation qui est totalement opposée au sens voulu par moi. Je tiens à préciser qu’il était absolument loin de moi de minimiser les mérites de M. Senderens, bien connus, dans la découverte en mon laboratoire des méthodes des hydrogénations et déhydrogénations par catalyse. Ces méthodes, comme cela est communément exprimé par la formulation habituelle procédé Sabatier-Senderens, sont élaborées par un travail qui nous est commun », le mal était fait et le chanoine dut passer sa colère en écrivant trois volumineux articles de revue sur la catalyse où il mettait en valeur sa contribution personnelle à la découverte : un article, paru en octobre 1912, dans la revue des questions scientifiques, deux articles dans les annales de physique et de chimie en 1912 et 1913. Dans ces articles, il mit en valeur le procédé Sabatier-Senderens et sa part importante et originale. La polémique dure encore et les scientifiques s’interrogeront toujours sur ce qui aurait dû être fait. Sans prendre position, nous nous contenterons de rapporter ce que Victor Grignard, co-lauréat du prix Nobel, écrivit à son collègue et ami Meunier en réponse aux félicitations de celui-ci : « À vrai dire et entre nous, j’aurais préféré, quitte à attendre encore un peu, voir partager le prix entre Sabatier et Senderens et le partager ensuite moi-même avec Barbier. » Senderens continua de publier, tout le reste de sa vie, des articles scientifiques (sauf pendant la grande guerre) alors que Sabatier s’arrêta vers 1920. Senderens entreprit une collaboration avec la société Poulenc frères, devenue ensuite Rhône-Poulenc, à Toulouse dans son laboratoire de l’Institut catholique, puis à Vitry-sur-Seine, de 1911 à 1920. « Ce fut pour bénéficier d’un excellent chef de fabrication que Poulenc, en 1908, s’attacha Senderens à titre d’ingénieur et le chargea de fournir les laboratoires de l’industrie de produits chimiques organiques. La fabrication se faisait à l’Institut. Sous les ordres de Senderens travaillèrent trois ou quatre chimistes, sur des appareils disséminés dans les salles qu’occupent actuellement les laboratoires de chimie, de physique, de mécanique appliquée, la salle de mathématiques et, encore, dans le dépôt de matériel qui borde le jardin. En 1912, l’Institut ne pouvant céder d’autres locaux pour l’extension projetée de ses laboratoires, la firme Poulenc transporta à Paris son matériel et son personnel, ingénieurs compris » Dans les années 1920, à 64 ans, il arrêta de travailler à Vitry-sur-Seine (tout en faisant son enseignement à l’ICT) ; les Poulenc lui firent construire un laboratoire à Barbachen, chez lui. En 1925, il fut directeur de recherche à la Caisse nationale des sciences. Une sombre d’histoire d’argent le sépara violemment de l’Institut Catholique de Toulouse : il avait reçu 25.000 francs sur les fonds de la journée Pasteur distribués par l’Académie des sciences, cet argent lui fut disputé. Il démissionna de l’ICT sans que sa démission fût acceptée. Il mourut, le 26 septembre 1937, dans son village natal de Barbachen, en Hautes-Pyrénées. Sabatier lui survécut quatre ans, mais ce dernier ne se déplaça pas aux obsèques du chanoine alors que quelques académiciens y figurèrent. Il paraît que nos deux chimistes s’étaient, tout de même, précédemment réconciliés dans les couloirs de l’Académie où Senderens rentra, finalement, en 1922 comme membre correspondant. « Un jour vint où ils se rencontrèrent face à face, à l’Académie, croyons-nous. Sabatier tendit la main, que Senderens reçut avec un large sourire. » Jean-Baptiste Senderens travailla essentiellement sur les déshydratations et hydrogénations catalytiques ; pendant la guerre, il dirigea dans les établissements Poulenc les laboratoires de catalyse appliquée à la fabrication des poudres et gaz asphyxiants et continua à publier jusqu’à sa mort en 1937. Membre correspondant de l’Académie des sciences en 1922, il écrivit pendant toute sa carrière plus de 170 publications. En 1923, il fut fait chevalier de la Légion d'honneur pour sa contribution à la fabrication de matériel de guerre par Poulenc. Il fonda aussi des bourses d’étude pour de futurs prêtres. Si la collaboration de Senderens avec Sabatier s’arrêta, ce ne fut pas à cause des événements sur la laïcité de la République, mais de l’arrivée d’un nouveau collaborateur, Alphonse Mailhe (Mailhe et Senderens ne s’entendirent pas, le plus âgé jalousait un peu le plus jeune) et aussi de la suppression de son traitement de prêtre rémunéré par l’État. Il faut noter que Senderens n’était pas un de ces rares ecclésiastiques favorables à la séparation (qui donnait la liberté à l’Église de France), mais il était attaché au concordat napoléonien (qui en faisait une Église de fonctionnaires au service de l’État). Pourtant, il avait su, dans sa collaboration scientifique, faire fi de ces contingences politiques. Sabatier et Senderens ont certes mis au point un procédé qui a permis de faire progresser considérablement la chimie organique, mais aussi imaginaient une laïcité qui permettait à l’Institut catholique de Toulouse de collaborer très productivement avec une faculté d’État, une laïcité positive où la spiritualité n’est pas considérée comme étant l’ennemie de la raison. Un mont fut baptisé de son nom : Le Mont Senderens (coordonnées 54°50′S 36°7′W) est une montagne de 1315 m (4314 pieds), située tout près au sud du mont Sabatier et à 1 mille marin (1,9 km) au nord de Rogged Bay à l'extrémité sud de la Géorgie du Sud. Il a été étudié par le South Georgia Survey dans la période 1951-57, et nommé par le United Kingdom Antarctic Place-Names Committee (UK-APC) pour Jean-Baptiste Senderens (1856-1937), chimiste français, dont le travail avec Paul Sabatier a conduit à l'introduction vers 1907 du procédé d'hydrogénation pour durcir l'huile de baleine. Senderens est par ailleurs l’auteur d’ouvrages : Analyse des nouvelles sources minérales de Bagnères-de-Bigorre (Ed.1883), Apologie scientifique de la foi chrétienne (Ed.1921), Création et Évolution (Ed.1928), d’amicales contraintes en 1928 et 1934. Dans ces deux derniers ouvrages, il aime à citer les grands savants chrétiens de Pascal à Pasteur et à démontrer que les tenants de la lutte antichrétienne du courant de pensée d’Auguste Comte, ne sont pas fondés dans leur critique exacerbée de la religion.
Jean-Baptiste SENDERENS (L’abbé), né le 27 janvier 1856, et mort le 26 septembre 1937 à Barbachen, dans le canton de Rabastens-de-Bigorre est un grand chimiste et prêtre. Il a été l'un des pionniers de la chimie catalytique et un co-découvreur de l'hydrogénation catalytique, un procédé utilisé commercialement pour fabriquer de la margarine. Docteur ès sciences, il fut le collaborateur de Paul Sabatier, lors de ses études déterminantes sur la catalyse. Professeur à l'Institut catholique de Toulouse et directeur de l'École supérieure des sciences, il était aussi docteur en philosophie. Il écrivit deux ouvrages sur l'apologie chrétienne. Il participa activement au dialogue science-foi. Jean-Baptiste Senderens, fut d’abord élève au noviciat de Notre-Dame de Pouey-Laün à Arrens-Marsous. En 1856, les Pères de Notre-Dame de Garaison ouvrirent un collège religieux au sanctuaire de Pouey-Laün, qui donna au diocèse une cinquantaine de prêtres en 15 ans. En 1871, le pensionnat sera supprimé et remplacé par le Noviciat et le Scolasticat de la Congrégation de la Félicitation de Notre-Dame de Lourdes. Un noviciat pour des élèves se destinant à une carrière ecclésiastique avant leur entrée au Grand Séminaire de Tarbes. En 1913, le noviciat sera fermé et remplacé pour quelques années par une école ménagère. Scolarisé au collège des Missionnaires de l'Immaculée Conception à Garaison à partir de la classe de 4e, Senderens manifesta un intérêt très fort pour les sciences, intérêt que sa hiérarchie devait encourager par la suite à cette époque où l’Église catholique estimait nécessaire de s’investir dans les disciplines scientifiques. Ordonné prêtre du diocèse de Tarbes fin 1880, il suivit simultanément à Toulouse des études de lettres à l’Institut catholique et des études de chimie à la Faculté des sciences. Édouard Filhol (1814-1883), titulaire de la chaire de chimie à la faculté des sciences de Toulouse, depuis 1854, l’accueillit dans son laboratoire, où il commença à préparer une thèse. Jean-Baptiste Senderens est devenu chimiste, chanoine et docteur en sciences et philosophie. En 1881, il commença à enseigner la chimie à l'École Supérieure des Sciences de l'Institut catholique de Toulouse et publia cette année-là ses premières notes pour le compte de l'Académie des sciences. À la mort de Filhol en 1883, Sabatier lui succéda et accompagna l’abbé Senderens jusqu’à la soutenance de sa thèse de doctorat en 1892 ; comme on peut en juger, le titre de ce travail − Action du soufre sur les oxydes et les sels en présence d’eau – porte la marque de son nouveau maître ! Paul Sabatier présida son jury de soutenance le 2 février 1892. Dans son discours on peut admirer combien Sabatier était fier que Senderens ait choisi Toulouse plutôt que Paris (la Sorbonne) pour la soutenance de thèse. Le grade scientifique ainsi acquis venait s’ajouter à celui de docteur en philosophie que l’abbé avait obtenu en 1888, probablement à l'université Grégorienne de Rome ; il l'obtint « plenis suffragiis favorabilibus ». À 38 ans, après son grade de docteur ès sciences, il est fait chanoine honoraire par l’évêque de Tarbes Prosper Marie Billère et, tout auréolé de ces grades et récompenses, arrive au bon moment pour poursuivre ce que l’on appellerait aujourd’hui un post-doc, sur le nouveau sujet que lui propose Sabatier. Après dix ans de collaboration avec Filhol, il entama donc une collaboration d'égale durée avec Paul Sabatier, le successeur de Filhol, si proche qu'il est impossible de distinguer le travail de l'un ou de l'autre. Ils travaillèrent ensemble, l’un dans le laboratoire de l’État, l’autre dans celui de l’Institut catholique mais sur des sujets identiques. Les premiers articles communs datent de 1892. Ce furent d’abord des recherches sur les oxydes de l’azote, oxyde azotique, oxyde azoteux et peroxyde d’azote, dont ils comparèrent l’action sur certains métaux ou oxydes métalliques. En effet, ils voulurent comparer ces réactions peu étudiées à celles de l’oxyde de carbone avec les métaux. Ils y préparèrent les métaux et certains oxydes en chauffant les oxydes supérieurs en présence d’hydrogène et observèrent de façon méthodique la réaction des trois gaz azotés sur ces métaux (par exemple le nickel) et les oxydes obtenus. Mais la grande surprise vint d’une expérience non plus sur ces composés azotés, mais avec l’éthylène. La dernière expérience décrite sur le nickel et l’éthylène date du 26 mars 1897. En 1897, Sabatier mit au point, avec Jean-Baptiste Senderens, le procédé d'hydrogénation catalytique des huiles, ce qui lui a permis de réaliser la synthèse de nombreux hydrocarbures. Ils ont publié conjointement 38 notes pour le compte de l'Académie des sciences (CRHAS), 18 mémoires dans le Bulletin de la Société française de chimie et 2 mémoires conjoints aux Annales de chimie et de physique. L’évolution de cette collaboration eut deux apogées en 1895 et 1902. Pendant ces périodes, Sabatier et Senderens publièrent, individuellement, sur des thématiques qui leur furent propres. En novembre 1899, Mgr. Zéphirin Carrière était étudiant à l'Université catholique de Toulouse, où Senderens enseignait la chimie. Carrière rappelle que Senderens avait un laboratoire avec deux sections, une pour la physique et une pour la chimie. Sabatier lui a fait confiance pour préparer les catalyseurs métalliques qu'ils avaient décidé d'utiliser dans leurs expériences de chimie organique. Les réactions de méthanation de COx ont été découvertes pour la première fois par Paul Sabatier et Senderens en 1902. Sabatier et Senderens ont partagé le prix Jecker de l'Académie des sciences en 1905 pour leur découverte du processus Sabatier-Senderens. Il s'agit d'une méthode de synthèse organique utilisant l'hydrogénation et un catalyseur au nickel chauffé. Le procédé est utilisé aujourd'hui pour convertir les huiles végétales insaturées en margarine. Vers 1904-1905, les rapports entre les deux chimistes toulousains commencèrent à se dégrader, ce que l’on peut attribuer à plusieurs causes : – l’arrivée dans l’équipe d’un nouvel élève, Alphonse Mailhe, que Senderens ne semblait pas apprécier ; – l’application de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, qui ne permettait plus à l’abbé de venir en soutane au laboratoire de la Faculté des sciences ; – enseignant à l’Institut catholique de Toulouse (ICT), dont il était directeur de l’École supérieure des sciences depuis 1883, il y poursuivait ses propres recherches dans un laboratoire très bien équipé, ce qui l’éloignait de son maître, à la différence de Mailhe installé à la Faculté des sciences, plus proche géographiquement ; – la perte pour Senderens du traitement d’ecclésiastique qu’il recevait de l’État avant 1905, ce qui l’amena à rechercher des compensations pécuniaires. Il trouva des contrats de recherches industriels, en particulier auprès de l’industriel Camille Poulenc avec la société duquel il travailla longtemps ; – et, peut-être ? − un différend idéologique avec Paul Sabatier qui, bien que catholique pratiquant, était franc-maçon, membre de la loge « Les vrais amis réunis ». On peut alors s’expliquer que la collaboration entre les deux chimistes s’arrêta en 1907, date à partir de laquelle on ne trouve plus de publications communes. Au préalable et malgré cela, en 1905, c’est ensemble qu’ils furent récompensés par l’Académie des sciences qui leur décerna le prix Jecker (doté de 10 000 francs-or), tandis que l’abbé recevait aussi la Médaille Berthelot. Sabatier poursuivit donc ses recherches essentiellement avec Mailhe, avec qui il continua d’appliquer l’hydrogénation catalytique à de nombreux autres composés. En 1912, le prix Nobel de chimie fut attribué à Paul Sabatier en même temps qu’à Victor Grignard. La décision du jury fut justifiée ainsi : « pour sa méthode d’hydrogénation des combinaisons organiques en présence de métaux finement réduits, méthode qui a fait faire de grands progrès à la chimie organique. » Dans son discours de récipiendaire Sabatier mentionne son coauteur Senderens pas moins de six fois. Mais Senderens n’apprécia pas du tout de n’avoir pas été associé à cette récompense ! Pour mieux comprendre sa rancœur, il faut revenir en arrière, le 13 mai 1911, à Berlin, où Paul Sabatier avait été invité à prononcer une conférence devant l’Académie de chimie et où il indiquait en commençant : « Je vais vous entretenir de la méthode générale d’hydrogénation directe par les métaux divisés, que j’ai instituée depuis une dizaine d’années avec la collaboration de mes élèves, M. Senderens d’abord, puis M. Mailhe… » Être traité d’élève accompagnant le « j’ai » réducteur fit réagir le chanoine qui écrivit une réclamation à l’ensemble de la communauté des chimistes français et à l’Académie royale de Stockholm sous la forme d’un dossier où il expliquait sa longue collaboration avec le lauréat en précisant : qu’il n’était pas « l’élève » de Sabatier et « M. Sabatier a une tendance assez prononcée à se faire le seul auteur de ces méthodes. » Sabatier réagit aussitôt. Malgré la correction que le doyen fit paraître dans le même journal allemand qui avait publié sa conférence : « Certains passages de mon exposé concernant la participation de M. Senderens aux méthodes tracées par moi, pourraient recevoir une interprétation qui est totalement opposée au sens voulu par moi. Je tiens à préciser qu’il était absolument loin de moi de minimiser les mérites de M. Senderens, bien connus, dans la découverte en mon laboratoire des méthodes des hydrogénations et déhydrogénations par catalyse. Ces méthodes, comme cela est communément exprimé par la formulation habituelle procédé Sabatier-Senderens, sont élaborées par un travail qui nous est commun », le mal était fait et le chanoine dut passer sa colère en écrivant trois volumineux articles de revue sur la catalyse où il mettait en valeur sa contribution personnelle à la découverte : un article, paru en octobre 1912, dans la revue des questions scientifiques, deux articles dans les annales de physique et de chimie en 1912 et 1913. Dans ces articles, il mit en valeur le procédé Sabatier-Senderens et sa part importante et originale. La polémique dure encore et les scientifiques s’interrogeront toujours sur ce qui aurait dû être fait. Sans prendre position, nous nous contenterons de rapporter ce que Victor Grignard, co-lauréat du prix Nobel, écrivit à son collègue et ami Meunier en réponse aux félicitations de celui-ci : « À vrai dire et entre nous, j’aurais préféré, quitte à attendre encore un peu, voir partager le prix entre Sabatier et Senderens et le partager ensuite moi-même avec Barbier. » Senderens continua de publier, tout le reste de sa vie, des articles scientifiques (sauf pendant la grande guerre) alors que Sabatier s’arrêta vers 1920. Senderens entreprit une collaboration avec la société Poulenc frères, devenue ensuite Rhône-Poulenc, à Toulouse dans son laboratoire de l’Institut catholique, puis à Vitry-sur-Seine, de 1911 à 1920. « Ce fut pour bénéficier d’un excellent chef de fabrication que Poulenc, en 1908, s’attacha Senderens à titre d’ingénieur et le chargea de fournir les laboratoires de l’industrie de produits chimiques organiques. La fabrication se faisait à l’Institut. Sous les ordres de Senderens travaillèrent trois ou quatre chimistes, sur des appareils disséminés dans les salles qu’occupent actuellement les laboratoires de chimie, de physique, de mécanique appliquée, la salle de mathématiques et, encore, dans le dépôt de matériel qui borde le jardin. En 1912, l’Institut ne pouvant céder d’autres locaux pour l’extension projetée de ses laboratoires, la firme Poulenc transporta à Paris son matériel et son personnel, ingénieurs compris » Dans les années 1920, à 64 ans, il arrêta de travailler à Vitry-sur-Seine (tout en faisant son enseignement à l’ICT) ; les Poulenc lui firent construire un laboratoire à Barbachen, chez lui. En 1925, il fut directeur de recherche à la Caisse nationale des sciences. Une sombre d’histoire d’argent le sépara violemment de l’Institut Catholique de Toulouse : il avait reçu 25.000 francs sur les fonds de la journée Pasteur distribués par l’Académie des sciences, cet argent lui fut disputé. Il démissionna de l’ICT sans que sa démission fût acceptée. Il mourut, le 26 septembre 1937, dans son village natal de Barbachen, en Hautes-Pyrénées. Sabatier lui survécut quatre ans, mais ce dernier ne se déplaça pas aux obsèques du chanoine alors que quelques académiciens y figurèrent. Il paraît que nos deux chimistes s’étaient, tout de même, précédemment réconciliés dans les couloirs de l’Académie où Senderens rentra, finalement, en 1922 comme membre correspondant. « Un jour vint où ils se rencontrèrent face à face, à l’Académie, croyons-nous. Sabatier tendit la main, que Senderens reçut avec un large sourire. » Jean-Baptiste Senderens travailla essentiellement sur les déshydratations et hydrogénations catalytiques ; pendant la guerre, il dirigea dans les établissements Poulenc les laboratoires de catalyse appliquée à la fabrication des poudres et gaz asphyxiants et continua à publier jusqu’à sa mort en 1937. Membre correspondant de l’Académie des sciences en 1922, il écrivit pendant toute sa carrière plus de 170 publications. En 1923, il fut fait chevalier de la Légion d'honneur pour sa contribution à la fabrication de matériel de guerre par Poulenc. Il fonda aussi des bourses d’étude pour de futurs prêtres. Si la collaboration de Senderens avec Sabatier s’arrêta, ce ne fut pas à cause des événements sur la laïcité de la République, mais de l’arrivée d’un nouveau collaborateur, Alphonse Mailhe (Mailhe et Senderens ne s’entendirent pas, le plus âgé jalousait un peu le plus jeune) et aussi de la suppression de son traitement de prêtre rémunéré par l’État. Il faut noter que Senderens n’était pas un de ces rares ecclésiastiques favorables à la séparation (qui donnait la liberté à l’Église de France), mais il était attaché au concordat napoléonien (qui en faisait une Église de fonctionnaires au service de l’État). Pourtant, il avait su, dans sa collaboration scientifique, faire fi de ces contingences politiques. Sabatier et Senderens ont certes mis au point un procédé qui a permis de faire progresser considérablement la chimie organique, mais aussi imaginaient une laïcité qui permettait à l’Institut catholique de Toulouse de collaborer très productivement avec une faculté d’État, une laïcité positive où la spiritualité n’est pas considérée comme étant l’ennemie de la raison. Un mont fut baptisé de son nom : Le Mont Senderens (coordonnées 54°50′S 36°7′W) est une montagne de 1315 m (4314 pieds), située tout près au sud du mont Sabatier et à 1 mille marin (1,9 km) au nord de Rogged Bay à l'extrémité sud de la Géorgie du Sud. Il a été étudié par le South Georgia Survey dans la période 1951-57, et nommé par le United Kingdom Antarctic Place-Names Committee (UK-APC) pour Jean-Baptiste Senderens (1856-1937), chimiste français, dont le travail avec Paul Sabatier a conduit à l'introduction vers 1907 du procédé d'hydrogénation pour durcir l'huile de baleine. Senderens est par ailleurs l’auteur d’ouvrages : Analyse des nouvelles sources minérales de Bagnères-de-Bigorre (Ed.1883), Apologie scientifique de la foi chrétienne (Ed.1921), Création et Évolution (Ed.1928), d’amicales contraintes en 1928 et 1934. Dans ces deux derniers ouvrages, il aime à citer les grands savants chrétiens de Pascal à Pasteur et à démontrer que les tenants de la lutte antichrétienne du courant de pensée d’Auguste Comte, ne sont pas fondés dans leur critique exacerbée de la religion.
 Jean-Baptiste SENDERENS (L’abbé), né le 27 janvier 1856, et mort le 26 septembre 1937 à Barbachen, dans le canton de Rabastens-de-Bigorre est un grand chimiste et prêtre. Il a été l'un des pionniers de la chimie catalytique et un co-découvreur de l'hydrogénation catalytique, un procédé utilisé commercialement pour fabriquer de la margarine. Docteur ès sciences, il fut le collaborateur de Paul Sabatier, lors de ses études déterminantes sur la catalyse. Professeur à l'Institut catholique de Toulouse et directeur de l'École supérieure des sciences, il était aussi docteur en philosophie. Il écrivit deux ouvrages sur l'apologie chrétienne. Il participa activement au dialogue science-foi. Jean-Baptiste Senderens, fut d’abord élève au noviciat de Notre-Dame de Pouey-Laün à Arrens-Marsous. En 1856, les Pères de Notre-Dame de Garaison ouvrirent un collège religieux au sanctuaire de Pouey-Laün, qui donna au diocèse une cinquantaine de prêtres en 15 ans. En 1871, le pensionnat sera supprimé et remplacé par le Noviciat et le Scolasticat de la Congrégation de la Félicitation de Notre-Dame de Lourdes. Un noviciat pour des élèves se destinant à une carrière ecclésiastique avant leur entrée au Grand Séminaire de Tarbes. En 1913, le noviciat sera fermé et remplacé pour quelques années par une école ménagère. Scolarisé au collège des Missionnaires de l'Immaculée Conception à Garaison à partir de la classe de 4e, Senderens manifesta un intérêt très fort pour les sciences, intérêt que sa hiérarchie devait encourager par la suite à cette époque où l’Église catholique estimait nécessaire de s’investir dans les disciplines scientifiques. Ordonné prêtre du diocèse de Tarbes fin 1880, il suivit simultanément à Toulouse des études de lettres à l’Institut catholique et des études de chimie à la Faculté des sciences. Édouard Filhol (1814-1883), titulaire de la chaire de chimie à la faculté des sciences de Toulouse, depuis 1854, l’accueillit dans son laboratoire, où il commença à préparer une thèse. Jean-Baptiste Senderens est devenu chimiste, chanoine et docteur en sciences et philosophie. En 1881, il commença à enseigner la chimie à l'École Supérieure des Sciences de l'Institut catholique de Toulouse et publia cette année-là ses premières notes pour le compte de l'Académie des sciences. À la mort de Filhol en 1883, Sabatier lui succéda et accompagna l’abbé Senderens jusqu’à la soutenance de sa thèse de doctorat en 1892 ; comme on peut en juger, le titre de ce travail − Action du soufre sur les oxydes et les sels en présence d’eau – porte la marque de son nouveau maître ! Paul Sabatier présida son jury de soutenance le 2 février 1892. Dans son discours on peut admirer combien Sabatier était fier que Senderens ait choisi Toulouse plutôt que Paris (la Sorbonne) pour la soutenance de thèse. Le grade scientifique ainsi acquis venait s’ajouter à celui de docteur en philosophie que l’abbé avait obtenu en 1888, probablement à l'université Grégorienne de Rome ; il l'obtint « plenis suffragiis favorabilibus ». À 38 ans, après son grade de docteur ès sciences, il est fait chanoine honoraire par l’évêque de Tarbes Prosper Marie Billère et, tout auréolé de ces grades et récompenses, arrive au bon moment pour poursuivre ce que l’on appellerait aujourd’hui un post-doc, sur le nouveau sujet que lui propose Sabatier. Après dix ans de collaboration avec Filhol, il entama donc une collaboration d'égale durée avec Paul Sabatier, le successeur de Filhol, si proche qu'il est impossible de distinguer le travail de l'un ou de l'autre. Ils travaillèrent ensemble, l’un dans le laboratoire de l’État, l’autre dans celui de l’Institut catholique mais sur des sujets identiques. Les premiers articles communs datent de 1892. Ce furent d’abord des recherches sur les oxydes de l’azote, oxyde azotique, oxyde azoteux et peroxyde d’azote, dont ils comparèrent l’action sur certains métaux ou oxydes métalliques. En effet, ils voulurent comparer ces réactions peu étudiées à celles de l’oxyde de carbone avec les métaux. Ils y préparèrent les métaux et certains oxydes en chauffant les oxydes supérieurs en présence d’hydrogène et observèrent de façon méthodique la réaction des trois gaz azotés sur ces métaux (par exemple le nickel) et les oxydes obtenus. Mais la grande surprise vint d’une expérience non plus sur ces composés azotés, mais avec l’éthylène. La dernière expérience décrite sur le nickel et l’éthylène date du 26 mars 1897. En 1897, Sabatier mit au point, avec Jean-Baptiste Senderens, le procédé d'hydrogénation catalytique des huiles, ce qui lui a permis de réaliser la synthèse de nombreux hydrocarbures. Ils ont publié conjointement 38 notes pour le compte de l'Académie des sciences (CRHAS), 18 mémoires dans le Bulletin de la Société française de chimie et 2 mémoires conjoints aux Annales de chimie et de physique. L’évolution de cette collaboration eut deux apogées en 1895 et 1902. Pendant ces périodes, Sabatier et Senderens publièrent, individuellement, sur des thématiques qui leur furent propres. En novembre 1899, Mgr. Zéphirin Carrière était étudiant à l'Université catholique de Toulouse, où Senderens enseignait la chimie. Carrière rappelle que Senderens avait un laboratoire avec deux sections, une pour la physique et une pour la chimie. Sabatier lui a fait confiance pour préparer les catalyseurs métalliques qu'ils avaient décidé d'utiliser dans leurs expériences de chimie organique. Les réactions de méthanation de COx ont été découvertes pour la première fois par Paul Sabatier et Senderens en 1902. Sabatier et Senderens ont partagé le prix Jecker de l'Académie des sciences en 1905 pour leur découverte du processus Sabatier-Senderens. Il s'agit d'une méthode de synthèse organique utilisant l'hydrogénation et un catalyseur au nickel chauffé. Le procédé est utilisé aujourd'hui pour convertir les huiles végétales insaturées en margarine. Vers 1904-1905, les rapports entre les deux chimistes toulousains commencèrent à se dégrader, ce que l’on peut attribuer à plusieurs causes : – l’arrivée dans l’équipe d’un nouvel élève, Alphonse Mailhe, que Senderens ne semblait pas apprécier ; – l’application de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, qui ne permettait plus à l’abbé de venir en soutane au laboratoire de la Faculté des sciences ; – enseignant à l’Institut catholique de Toulouse (ICT), dont il était directeur de l’École supérieure des sciences depuis 1883, il y poursuivait ses propres recherches dans un laboratoire très bien équipé, ce qui l’éloignait de son maître, à la différence de Mailhe installé à la Faculté des sciences, plus proche géographiquement ; – la perte pour Senderens du traitement d’ecclésiastique qu’il recevait de l’État avant 1905, ce qui l’amena à rechercher des compensations pécuniaires. Il trouva des contrats de recherches industriels, en particulier auprès de l’industriel Camille Poulenc avec la société duquel il travailla longtemps ; – et, peut-être ? − un différend idéologique avec Paul Sabatier qui, bien que catholique pratiquant, était franc-maçon, membre de la loge « Les vrais amis réunis ». On peut alors s’expliquer que la collaboration entre les deux chimistes s’arrêta en 1907, date à partir de laquelle on ne trouve plus de publications communes. Au préalable et malgré cela, en 1905, c’est ensemble qu’ils furent récompensés par l’Académie des sciences qui leur décerna le prix Jecker (doté de 10 000 francs-or), tandis que l’abbé recevait aussi la Médaille Berthelot. Sabatier poursuivit donc ses recherches essentiellement avec Mailhe, avec qui il continua d’appliquer l’hydrogénation catalytique à de nombreux autres composés. En 1912, le prix Nobel de chimie fut attribué à Paul Sabatier en même temps qu’à Victor Grignard. La décision du jury fut justifiée ainsi : « pour sa méthode d’hydrogénation des combinaisons organiques en présence de métaux finement réduits, méthode qui a fait faire de grands progrès à la chimie organique. » Dans son discours de récipiendaire Sabatier mentionne son coauteur Senderens pas moins de six fois. Mais Senderens n’apprécia pas du tout de n’avoir pas été associé à cette récompense ! Pour mieux comprendre sa rancœur, il faut revenir en arrière, le 13 mai 1911, à Berlin, où Paul Sabatier avait été invité à prononcer une conférence devant l’Académie de chimie et où il indiquait en commençant : « Je vais vous entretenir de la méthode générale d’hydrogénation directe par les métaux divisés, que j’ai instituée depuis une dizaine d’années avec la collaboration de mes élèves, M. Senderens d’abord, puis M. Mailhe… » Être traité d’élève accompagnant le « j’ai » réducteur fit réagir le chanoine qui écrivit une réclamation à l’ensemble de la communauté des chimistes français et à l’Académie royale de Stockholm sous la forme d’un dossier où il expliquait sa longue collaboration avec le lauréat en précisant : qu’il n’était pas « l’élève » de Sabatier et « M. Sabatier a une tendance assez prononcée à se faire le seul auteur de ces méthodes. » Sabatier réagit aussitôt. Malgré la correction que le doyen fit paraître dans le même journal allemand qui avait publié sa conférence : « Certains passages de mon exposé concernant la participation de M. Senderens aux méthodes tracées par moi, pourraient recevoir une interprétation qui est totalement opposée au sens voulu par moi. Je tiens à préciser qu’il était absolument loin de moi de minimiser les mérites de M. Senderens, bien connus, dans la découverte en mon laboratoire des méthodes des hydrogénations et déhydrogénations par catalyse. Ces méthodes, comme cela est communément exprimé par la formulation habituelle procédé Sabatier-Senderens, sont élaborées par un travail qui nous est commun », le mal était fait et le chanoine dut passer sa colère en écrivant trois volumineux articles de revue sur la catalyse où il mettait en valeur sa contribution personnelle à la découverte : un article, paru en octobre 1912, dans la revue des questions scientifiques, deux articles dans les annales de physique et de chimie en 1912 et 1913. Dans ces articles, il mit en valeur le procédé Sabatier-Senderens et sa part importante et originale. La polémique dure encore et les scientifiques s’interrogeront toujours sur ce qui aurait dû être fait. Sans prendre position, nous nous contenterons de rapporter ce que Victor Grignard, co-lauréat du prix Nobel, écrivit à son collègue et ami Meunier en réponse aux félicitations de celui-ci : « À vrai dire et entre nous, j’aurais préféré, quitte à attendre encore un peu, voir partager le prix entre Sabatier et Senderens et le partager ensuite moi-même avec Barbier. » Senderens continua de publier, tout le reste de sa vie, des articles scientifiques (sauf pendant la grande guerre) alors que Sabatier s’arrêta vers 1920. Senderens entreprit une collaboration avec la société Poulenc frères, devenue ensuite Rhône-Poulenc, à Toulouse dans son laboratoire de l’Institut catholique, puis à Vitry-sur-Seine, de 1911 à 1920. « Ce fut pour bénéficier d’un excellent chef de fabrication que Poulenc, en 1908, s’attacha Senderens à titre d’ingénieur et le chargea de fournir les laboratoires de l’industrie de produits chimiques organiques. La fabrication se faisait à l’Institut. Sous les ordres de Senderens travaillèrent trois ou quatre chimistes, sur des appareils disséminés dans les salles qu’occupent actuellement les laboratoires de chimie, de physique, de mécanique appliquée, la salle de mathématiques et, encore, dans le dépôt de matériel qui borde le jardin. En 1912, l’Institut ne pouvant céder d’autres locaux pour l’extension projetée de ses laboratoires, la firme Poulenc transporta à Paris son matériel et son personnel, ingénieurs compris » Dans les années 1920, à 64 ans, il arrêta de travailler à Vitry-sur-Seine (tout en faisant son enseignement à l’ICT) ; les Poulenc lui firent construire un laboratoire à Barbachen, chez lui. En 1925, il fut directeur de recherche à la Caisse nationale des sciences. Une sombre d’histoire d’argent le sépara violemment de l’Institut Catholique de Toulouse : il avait reçu 25.000 francs sur les fonds de la journée Pasteur distribués par l’Académie des sciences, cet argent lui fut disputé. Il démissionna de l’ICT sans que sa démission fût acceptée. Il mourut, le 26 septembre 1937, dans son village natal de Barbachen, en Hautes-Pyrénées. Sabatier lui survécut quatre ans, mais ce dernier ne se déplaça pas aux obsèques du chanoine alors que quelques académiciens y figurèrent. Il paraît que nos deux chimistes s’étaient, tout de même, précédemment réconciliés dans les couloirs de l’Académie où Senderens rentra, finalement, en 1922 comme membre correspondant. « Un jour vint où ils se rencontrèrent face à face, à l’Académie, croyons-nous. Sabatier tendit la main, que Senderens reçut avec un large sourire. » Jean-Baptiste Senderens travailla essentiellement sur les déshydratations et hydrogénations catalytiques ; pendant la guerre, il dirigea dans les établissements Poulenc les laboratoires de catalyse appliquée à la fabrication des poudres et gaz asphyxiants et continua à publier jusqu’à sa mort en 1937. Membre correspondant de l’Académie des sciences en 1922, il écrivit pendant toute sa carrière plus de 170 publications. En 1923, il fut fait chevalier de la Légion d'honneur pour sa contribution à la fabrication de matériel de guerre par Poulenc. Il fonda aussi des bourses d’étude pour de futurs prêtres. Si la collaboration de Senderens avec Sabatier s’arrêta, ce ne fut pas à cause des événements sur la laïcité de la République, mais de l’arrivée d’un nouveau collaborateur, Alphonse Mailhe (Mailhe et Senderens ne s’entendirent pas, le plus âgé jalousait un peu le plus jeune) et aussi de la suppression de son traitement de prêtre rémunéré par l’État. Il faut noter que Senderens n’était pas un de ces rares ecclésiastiques favorables à la séparation (qui donnait la liberté à l’Église de France), mais il était attaché au concordat napoléonien (qui en faisait une Église de fonctionnaires au service de l’État). Pourtant, il avait su, dans sa collaboration scientifique, faire fi de ces contingences politiques. Sabatier et Senderens ont certes mis au point un procédé qui a permis de faire progresser considérablement la chimie organique, mais aussi imaginaient une laïcité qui permettait à l’Institut catholique de Toulouse de collaborer très productivement avec une faculté d’État, une laïcité positive où la spiritualité n’est pas considérée comme étant l’ennemie de la raison. Un mont fut baptisé de son nom : Le Mont Senderens (coordonnées 54°50′S 36°7′W) est une montagne de 1315 m (4314 pieds), située tout près au sud du mont Sabatier et à 1 mille marin (1,9 km) au nord de Rogged Bay à l'extrémité sud de la Géorgie du Sud. Il a été étudié par le South Georgia Survey dans la période 1951-57, et nommé par le United Kingdom Antarctic Place-Names Committee (UK-APC) pour Jean-Baptiste Senderens (1856-1937), chimiste français, dont le travail avec Paul Sabatier a conduit à l'introduction vers 1907 du procédé d'hydrogénation pour durcir l'huile de baleine. Senderens est par ailleurs l’auteur d’ouvrages : Analyse des nouvelles sources minérales de Bagnères-de-Bigorre (Ed.1883), Apologie scientifique de la foi chrétienne (Ed.1921), Création et Évolution (Ed.1928), d’amicales contraintes en 1928 et 1934. Dans ces deux derniers ouvrages, il aime à citer les grands savants chrétiens de Pascal à Pasteur et à démontrer que les tenants de la lutte antichrétienne du courant de pensée d’Auguste Comte, ne sont pas fondés dans leur critique exacerbée de la religion.
Jean-Baptiste SENDERENS (L’abbé), né le 27 janvier 1856, et mort le 26 septembre 1937 à Barbachen, dans le canton de Rabastens-de-Bigorre est un grand chimiste et prêtre. Il a été l'un des pionniers de la chimie catalytique et un co-découvreur de l'hydrogénation catalytique, un procédé utilisé commercialement pour fabriquer de la margarine. Docteur ès sciences, il fut le collaborateur de Paul Sabatier, lors de ses études déterminantes sur la catalyse. Professeur à l'Institut catholique de Toulouse et directeur de l'École supérieure des sciences, il était aussi docteur en philosophie. Il écrivit deux ouvrages sur l'apologie chrétienne. Il participa activement au dialogue science-foi. Jean-Baptiste Senderens, fut d’abord élève au noviciat de Notre-Dame de Pouey-Laün à Arrens-Marsous. En 1856, les Pères de Notre-Dame de Garaison ouvrirent un collège religieux au sanctuaire de Pouey-Laün, qui donna au diocèse une cinquantaine de prêtres en 15 ans. En 1871, le pensionnat sera supprimé et remplacé par le Noviciat et le Scolasticat de la Congrégation de la Félicitation de Notre-Dame de Lourdes. Un noviciat pour des élèves se destinant à une carrière ecclésiastique avant leur entrée au Grand Séminaire de Tarbes. En 1913, le noviciat sera fermé et remplacé pour quelques années par une école ménagère. Scolarisé au collège des Missionnaires de l'Immaculée Conception à Garaison à partir de la classe de 4e, Senderens manifesta un intérêt très fort pour les sciences, intérêt que sa hiérarchie devait encourager par la suite à cette époque où l’Église catholique estimait nécessaire de s’investir dans les disciplines scientifiques. Ordonné prêtre du diocèse de Tarbes fin 1880, il suivit simultanément à Toulouse des études de lettres à l’Institut catholique et des études de chimie à la Faculté des sciences. Édouard Filhol (1814-1883), titulaire de la chaire de chimie à la faculté des sciences de Toulouse, depuis 1854, l’accueillit dans son laboratoire, où il commença à préparer une thèse. Jean-Baptiste Senderens est devenu chimiste, chanoine et docteur en sciences et philosophie. En 1881, il commença à enseigner la chimie à l'École Supérieure des Sciences de l'Institut catholique de Toulouse et publia cette année-là ses premières notes pour le compte de l'Académie des sciences. À la mort de Filhol en 1883, Sabatier lui succéda et accompagna l’abbé Senderens jusqu’à la soutenance de sa thèse de doctorat en 1892 ; comme on peut en juger, le titre de ce travail − Action du soufre sur les oxydes et les sels en présence d’eau – porte la marque de son nouveau maître ! Paul Sabatier présida son jury de soutenance le 2 février 1892. Dans son discours on peut admirer combien Sabatier était fier que Senderens ait choisi Toulouse plutôt que Paris (la Sorbonne) pour la soutenance de thèse. Le grade scientifique ainsi acquis venait s’ajouter à celui de docteur en philosophie que l’abbé avait obtenu en 1888, probablement à l'université Grégorienne de Rome ; il l'obtint « plenis suffragiis favorabilibus ». À 38 ans, après son grade de docteur ès sciences, il est fait chanoine honoraire par l’évêque de Tarbes Prosper Marie Billère et, tout auréolé de ces grades et récompenses, arrive au bon moment pour poursuivre ce que l’on appellerait aujourd’hui un post-doc, sur le nouveau sujet que lui propose Sabatier. Après dix ans de collaboration avec Filhol, il entama donc une collaboration d'égale durée avec Paul Sabatier, le successeur de Filhol, si proche qu'il est impossible de distinguer le travail de l'un ou de l'autre. Ils travaillèrent ensemble, l’un dans le laboratoire de l’État, l’autre dans celui de l’Institut catholique mais sur des sujets identiques. Les premiers articles communs datent de 1892. Ce furent d’abord des recherches sur les oxydes de l’azote, oxyde azotique, oxyde azoteux et peroxyde d’azote, dont ils comparèrent l’action sur certains métaux ou oxydes métalliques. En effet, ils voulurent comparer ces réactions peu étudiées à celles de l’oxyde de carbone avec les métaux. Ils y préparèrent les métaux et certains oxydes en chauffant les oxydes supérieurs en présence d’hydrogène et observèrent de façon méthodique la réaction des trois gaz azotés sur ces métaux (par exemple le nickel) et les oxydes obtenus. Mais la grande surprise vint d’une expérience non plus sur ces composés azotés, mais avec l’éthylène. La dernière expérience décrite sur le nickel et l’éthylène date du 26 mars 1897. En 1897, Sabatier mit au point, avec Jean-Baptiste Senderens, le procédé d'hydrogénation catalytique des huiles, ce qui lui a permis de réaliser la synthèse de nombreux hydrocarbures. Ils ont publié conjointement 38 notes pour le compte de l'Académie des sciences (CRHAS), 18 mémoires dans le Bulletin de la Société française de chimie et 2 mémoires conjoints aux Annales de chimie et de physique. L’évolution de cette collaboration eut deux apogées en 1895 et 1902. Pendant ces périodes, Sabatier et Senderens publièrent, individuellement, sur des thématiques qui leur furent propres. En novembre 1899, Mgr. Zéphirin Carrière était étudiant à l'Université catholique de Toulouse, où Senderens enseignait la chimie. Carrière rappelle que Senderens avait un laboratoire avec deux sections, une pour la physique et une pour la chimie. Sabatier lui a fait confiance pour préparer les catalyseurs métalliques qu'ils avaient décidé d'utiliser dans leurs expériences de chimie organique. Les réactions de méthanation de COx ont été découvertes pour la première fois par Paul Sabatier et Senderens en 1902. Sabatier et Senderens ont partagé le prix Jecker de l'Académie des sciences en 1905 pour leur découverte du processus Sabatier-Senderens. Il s'agit d'une méthode de synthèse organique utilisant l'hydrogénation et un catalyseur au nickel chauffé. Le procédé est utilisé aujourd'hui pour convertir les huiles végétales insaturées en margarine. Vers 1904-1905, les rapports entre les deux chimistes toulousains commencèrent à se dégrader, ce que l’on peut attribuer à plusieurs causes : – l’arrivée dans l’équipe d’un nouvel élève, Alphonse Mailhe, que Senderens ne semblait pas apprécier ; – l’application de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, qui ne permettait plus à l’abbé de venir en soutane au laboratoire de la Faculté des sciences ; – enseignant à l’Institut catholique de Toulouse (ICT), dont il était directeur de l’École supérieure des sciences depuis 1883, il y poursuivait ses propres recherches dans un laboratoire très bien équipé, ce qui l’éloignait de son maître, à la différence de Mailhe installé à la Faculté des sciences, plus proche géographiquement ; – la perte pour Senderens du traitement d’ecclésiastique qu’il recevait de l’État avant 1905, ce qui l’amena à rechercher des compensations pécuniaires. Il trouva des contrats de recherches industriels, en particulier auprès de l’industriel Camille Poulenc avec la société duquel il travailla longtemps ; – et, peut-être ? − un différend idéologique avec Paul Sabatier qui, bien que catholique pratiquant, était franc-maçon, membre de la loge « Les vrais amis réunis ». On peut alors s’expliquer que la collaboration entre les deux chimistes s’arrêta en 1907, date à partir de laquelle on ne trouve plus de publications communes. Au préalable et malgré cela, en 1905, c’est ensemble qu’ils furent récompensés par l’Académie des sciences qui leur décerna le prix Jecker (doté de 10 000 francs-or), tandis que l’abbé recevait aussi la Médaille Berthelot. Sabatier poursuivit donc ses recherches essentiellement avec Mailhe, avec qui il continua d’appliquer l’hydrogénation catalytique à de nombreux autres composés. En 1912, le prix Nobel de chimie fut attribué à Paul Sabatier en même temps qu’à Victor Grignard. La décision du jury fut justifiée ainsi : « pour sa méthode d’hydrogénation des combinaisons organiques en présence de métaux finement réduits, méthode qui a fait faire de grands progrès à la chimie organique. » Dans son discours de récipiendaire Sabatier mentionne son coauteur Senderens pas moins de six fois. Mais Senderens n’apprécia pas du tout de n’avoir pas été associé à cette récompense ! Pour mieux comprendre sa rancœur, il faut revenir en arrière, le 13 mai 1911, à Berlin, où Paul Sabatier avait été invité à prononcer une conférence devant l’Académie de chimie et où il indiquait en commençant : « Je vais vous entretenir de la méthode générale d’hydrogénation directe par les métaux divisés, que j’ai instituée depuis une dizaine d’années avec la collaboration de mes élèves, M. Senderens d’abord, puis M. Mailhe… » Être traité d’élève accompagnant le « j’ai » réducteur fit réagir le chanoine qui écrivit une réclamation à l’ensemble de la communauté des chimistes français et à l’Académie royale de Stockholm sous la forme d’un dossier où il expliquait sa longue collaboration avec le lauréat en précisant : qu’il n’était pas « l’élève » de Sabatier et « M. Sabatier a une tendance assez prononcée à se faire le seul auteur de ces méthodes. » Sabatier réagit aussitôt. Malgré la correction que le doyen fit paraître dans le même journal allemand qui avait publié sa conférence : « Certains passages de mon exposé concernant la participation de M. Senderens aux méthodes tracées par moi, pourraient recevoir une interprétation qui est totalement opposée au sens voulu par moi. Je tiens à préciser qu’il était absolument loin de moi de minimiser les mérites de M. Senderens, bien connus, dans la découverte en mon laboratoire des méthodes des hydrogénations et déhydrogénations par catalyse. Ces méthodes, comme cela est communément exprimé par la formulation habituelle procédé Sabatier-Senderens, sont élaborées par un travail qui nous est commun », le mal était fait et le chanoine dut passer sa colère en écrivant trois volumineux articles de revue sur la catalyse où il mettait en valeur sa contribution personnelle à la découverte : un article, paru en octobre 1912, dans la revue des questions scientifiques, deux articles dans les annales de physique et de chimie en 1912 et 1913. Dans ces articles, il mit en valeur le procédé Sabatier-Senderens et sa part importante et originale. La polémique dure encore et les scientifiques s’interrogeront toujours sur ce qui aurait dû être fait. Sans prendre position, nous nous contenterons de rapporter ce que Victor Grignard, co-lauréat du prix Nobel, écrivit à son collègue et ami Meunier en réponse aux félicitations de celui-ci : « À vrai dire et entre nous, j’aurais préféré, quitte à attendre encore un peu, voir partager le prix entre Sabatier et Senderens et le partager ensuite moi-même avec Barbier. » Senderens continua de publier, tout le reste de sa vie, des articles scientifiques (sauf pendant la grande guerre) alors que Sabatier s’arrêta vers 1920. Senderens entreprit une collaboration avec la société Poulenc frères, devenue ensuite Rhône-Poulenc, à Toulouse dans son laboratoire de l’Institut catholique, puis à Vitry-sur-Seine, de 1911 à 1920. « Ce fut pour bénéficier d’un excellent chef de fabrication que Poulenc, en 1908, s’attacha Senderens à titre d’ingénieur et le chargea de fournir les laboratoires de l’industrie de produits chimiques organiques. La fabrication se faisait à l’Institut. Sous les ordres de Senderens travaillèrent trois ou quatre chimistes, sur des appareils disséminés dans les salles qu’occupent actuellement les laboratoires de chimie, de physique, de mécanique appliquée, la salle de mathématiques et, encore, dans le dépôt de matériel qui borde le jardin. En 1912, l’Institut ne pouvant céder d’autres locaux pour l’extension projetée de ses laboratoires, la firme Poulenc transporta à Paris son matériel et son personnel, ingénieurs compris » Dans les années 1920, à 64 ans, il arrêta de travailler à Vitry-sur-Seine (tout en faisant son enseignement à l’ICT) ; les Poulenc lui firent construire un laboratoire à Barbachen, chez lui. En 1925, il fut directeur de recherche à la Caisse nationale des sciences. Une sombre d’histoire d’argent le sépara violemment de l’Institut Catholique de Toulouse : il avait reçu 25.000 francs sur les fonds de la journée Pasteur distribués par l’Académie des sciences, cet argent lui fut disputé. Il démissionna de l’ICT sans que sa démission fût acceptée. Il mourut, le 26 septembre 1937, dans son village natal de Barbachen, en Hautes-Pyrénées. Sabatier lui survécut quatre ans, mais ce dernier ne se déplaça pas aux obsèques du chanoine alors que quelques académiciens y figurèrent. Il paraît que nos deux chimistes s’étaient, tout de même, précédemment réconciliés dans les couloirs de l’Académie où Senderens rentra, finalement, en 1922 comme membre correspondant. « Un jour vint où ils se rencontrèrent face à face, à l’Académie, croyons-nous. Sabatier tendit la main, que Senderens reçut avec un large sourire. » Jean-Baptiste Senderens travailla essentiellement sur les déshydratations et hydrogénations catalytiques ; pendant la guerre, il dirigea dans les établissements Poulenc les laboratoires de catalyse appliquée à la fabrication des poudres et gaz asphyxiants et continua à publier jusqu’à sa mort en 1937. Membre correspondant de l’Académie des sciences en 1922, il écrivit pendant toute sa carrière plus de 170 publications. En 1923, il fut fait chevalier de la Légion d'honneur pour sa contribution à la fabrication de matériel de guerre par Poulenc. Il fonda aussi des bourses d’étude pour de futurs prêtres. Si la collaboration de Senderens avec Sabatier s’arrêta, ce ne fut pas à cause des événements sur la laïcité de la République, mais de l’arrivée d’un nouveau collaborateur, Alphonse Mailhe (Mailhe et Senderens ne s’entendirent pas, le plus âgé jalousait un peu le plus jeune) et aussi de la suppression de son traitement de prêtre rémunéré par l’État. Il faut noter que Senderens n’était pas un de ces rares ecclésiastiques favorables à la séparation (qui donnait la liberté à l’Église de France), mais il était attaché au concordat napoléonien (qui en faisait une Église de fonctionnaires au service de l’État). Pourtant, il avait su, dans sa collaboration scientifique, faire fi de ces contingences politiques. Sabatier et Senderens ont certes mis au point un procédé qui a permis de faire progresser considérablement la chimie organique, mais aussi imaginaient une laïcité qui permettait à l’Institut catholique de Toulouse de collaborer très productivement avec une faculté d’État, une laïcité positive où la spiritualité n’est pas considérée comme étant l’ennemie de la raison. Un mont fut baptisé de son nom : Le Mont Senderens (coordonnées 54°50′S 36°7′W) est une montagne de 1315 m (4314 pieds), située tout près au sud du mont Sabatier et à 1 mille marin (1,9 km) au nord de Rogged Bay à l'extrémité sud de la Géorgie du Sud. Il a été étudié par le South Georgia Survey dans la période 1951-57, et nommé par le United Kingdom Antarctic Place-Names Committee (UK-APC) pour Jean-Baptiste Senderens (1856-1937), chimiste français, dont le travail avec Paul Sabatier a conduit à l'introduction vers 1907 du procédé d'hydrogénation pour durcir l'huile de baleine. Senderens est par ailleurs l’auteur d’ouvrages : Analyse des nouvelles sources minérales de Bagnères-de-Bigorre (Ed.1883), Apologie scientifique de la foi chrétienne (Ed.1921), Création et Évolution (Ed.1928), d’amicales contraintes en 1928 et 1934. Dans ces deux derniers ouvrages, il aime à citer les grands savants chrétiens de Pascal à Pasteur et à démontrer que les tenants de la lutte antichrétienne du courant de pensée d’Auguste Comte, ne sont pas fondés dans leur critique exacerbée de la religion.SERVAT Gilles (1945-XXXX)
Auteur-compositeur-interprète d'expression française et bretonne
 Gilles SERVAT, né le 1er février 1945 à Tarbes. Son père est d'origine nantaise et sa mère du Croisic. Son arrière-grand-père ariégois est montreur d'ours. La famille déménage de Tarbes à Nantes trois mois après sa naissance, puis s'installe rapidement à Cholet dans le Maine-et-Loire. Son père ayant obtenu un poste de chef du personnel à l'usine Ernault-Batignolles. Il passe son enfance à Cholet, où il obtient un baccalauréat littéraire, et effectue ses études supérieures à l'école des Beaux-Arts d'Angers. Il étudie la sculpture, la peinture, le dessin, la gravure et se destine au professorat. Il passe quatre ans à Angers puis deux ans à Paris, où il travaille quelques mois au service des redevances de l'ORTF. Il commence à écrire en 1967, pour s'exprimer librement et créer son répertoire. En mai 1968, il découvre en profondeur les problèmes politiques bretons, grâce notamment au Groisillon Serge Bihan rencontré à Angers. En 1969, c'est lors d'un séjour sur l'île de Groix dans le Morbihan que Gilles Servat prend conscience de sa celtitude. C'est le coup de foudre. Gilles Servat s'intéresse alors au renouveau de la musique celtique incarné par Alan Stivell ou Glenmor. À l'approche de l'automne, Gilles Servat part ensuite à Paris comme fonctionnaire aux PTT, tout en commençant à composer. Il se produit alors très régulièrement à Paris, par exemple à La Ville de Guingamp (dans le quartier du Montparnasse). Yvon Ollitraut, le patron du célèbre « café national breton » Ti-Jos, le découvre et l'invite à s'y produire. Gilles lâche finalement les PTT pour les aléas d'une vie d'artiste. Pendant plus de deux ans, il fait la manche en se produisant tous les soirs au restaurant Ti-Jos, lieu de rendez-vous des Bretons de Paris. L'année 1970, emporté par la vague musicale des années soixante-dix, il décide de s'engager dans la chanson, trouvant ainsi à s'exprimer. C'est au restaurant Ti-Jos à Paris qu'en 1970, il chante « La Blanche Hermine » pour la première fois. Il séduit son auditoire en particulier avec cette chanson. Dès le début des années 70, il fonde la maison d’édition Kelenn, qui produit des artistes tels que les Tri Yann. Lorsqu'elle sera revendue à la firme Phonogram, il crée son label nommé Kalondour. En 1972, il y édite son premier disque, « La Blanche Hermine », dont le titre éponyme deviendra au fil du temps, une sorte d'hymne officieux de la Bretagne, faisant de son auteur un activiste engagé. Ce premier 33 tours, devient disque d'or avec 100 000 exemplaires vendus et lance la carrière de Gilles Servat. La même année, il accepte de vendre le catalogue de Kelenn à Phonogram. Il entre ainsi, avec les Tri Yann et Alan Stivell, dans le circuit de la grande distribution. Portée par le succès de La Blanche Hermine, sa discographie va se développer de manière régulière. Parallèlement, il consacre beaucoup de son temps à donner des concerts tant en France qu’à l’étranger. Dans la décennie des années 1970, il sort quasiment un album par an. Entre poésie et militantisme, Gilles Servat colle bien à la tonalité des années soixante-dix, marquées par une naïveté baba-cool pleine de bons sentiments. Ki Du (1973), L'Hirondelle (1974), La Liberté Brille dans la Nuit (1975), Le Pouvoir des Mots (1976), Chantez la Vie, l'Amour, et la Mort (1977) jalonnent une décennie où Gilles Servat enchaîne albums et concerts. À partir de 1980, il prend du recul avec le militantisme, en quittant l'UDB et en écrivant des textes moins engagés et plus contemplatifs. Les années quatre-vingt sont moins trépidantes. En 1981, il propose un album en concert et en 1982, « Je ne hurlerai pas avec les loups » renoue avec la chanson poétique, tout en continuant d'exprimer son refus de tout manichéisme, notamment dans le texte principal qui dure seize minutes. En 1984 et 1985, il participe aux activités du Théâtre de la Chimère de Michel Ecoffard. En 1988, Mad in Sérénité rafle le Grand Prix de l’Académie Charles-Cros et le Prix du Conseil Régional de Bretagne. L’album Le Fleuve sorti en 1992 fait l’objet d’un spectacle, présenté aux Tombées de la nuit, festival rennais. À partir de 1993, il rejoint Dan Ar Braz pour l’aventure de l’Héritage des Celtes, un projet qui ambitionne de présenter la richesse de la musique celtique dans toute sa diversité. Il retrouve entre autres, Elaine Morgan, Nollaig Casey, Karen Matheson (chanteuse du groupe Capercaillie), Yann-Fañch Kemener, Donald Shaw. Il participe à l’enregistrement des quatre albums : Héritage des Celtes (1994), En concert (1995), Finisterres (1997) et le Zénith (concert en 1998), et aux tournées qui en découlent. En 1999, il est présent sur la réunion des Bretagnes à Bercy avec, outre les artistes de « L’Héritage des Celtes », Armens, Alan Stivell et Tri Yann. Sur les Quais de Dublin en 1996 marque une volonté de rencontre avec les artistes irlandais, toujours dans l'optique d'un syncrétisme de la musique celte. Il est aussi sculpteur de formation, dessinateur et graveur (il présenta ses œuvres en 1986, à Morlaix). En 1993, Gilles Servat, qui n'avait plus joué avec Dan Ar Braz depuis 1991, participe à l'expérience de l'Héritage des Celtes, aux côtés de 74 autres musiciens (dont Yann-Fañch Kemener, Didier Squiban...). Il sera présent sur les quatre premiers albums de cette nouvelle formation. Gilles Servat fait donc, à nouveau, son entrée dans le circuit de la grande distribution, en signant chez Sony Music un nouvel album : Sur Les Quais de Dublin. En 1998, le révolté de Loctudy attrape un coup de sang lorsqu'il se rend compte que sa « Blanche Hermine » est reprise dans les meetings du Front National. Sa riposte ne tarde pas, sous la forme d'un album : « Touche pas à ma blanche hermine ». En 1999, il participe à BretagneS, un album enregistré en live à Bercy devant 18 000 spectateurs, et qui sera aussi disque d'or. Forcément marqué par le naufrage du pétrolier Erika au large de la Bretagne en 1999, Gilles Servat sort en 2000 Comme Je Voudrai !, où il fait part de son indignation. En 2001, il réalise une création spéciale pour le festival des Vieilles Charrues, intitulée Bretagne, nous te ferons. En 2003 à Saint-Malo, il reçoit le collier de l’Ordre de l'Hermine, qui récompense les personnalités qui œuvrent pour le rayonnement de la Bretagne. Le 19 mai 2005, il sort un nouvel album : Sous le ciel de cuivre et d'eau qui contient notamment une chanson à la mémoire de Polig Monjarret intitulée Le Général des Binious, surnom du fondateur de la Bodadeg ar Sonerion. À l'occasion de ses trente-cinq ans de carrière, Gilles Servat sort en 2006 l'enregistrement en public Je Vous Emporte dans Mon Cœur, dont les trente-six titres ont été choisis par son public. Le 12 novembre 2006, il donne un concert anniversaire à l’Olympia en compagnie de Nolwenn Korbell et de l'Ensemble choral du Bout du Monde. Pour fêter ses cinquante-cinq ans, le chanteur Renaud l'invite au Zénith de Nantes, en duo sur Dans la jungle (écrite pour Ingrid Betancourt, dont un couplet est en breton) et La Blanche Hermine. En 2009, Gilles Servat témoigne et apporte son soutien à six jeunes militants pour la réunification de la Bretagne, inculpés pour des actions de désobéissance civile. En 2011, le chanteur sort un nouvel album studio intitulé Ailes et Îles, chanté en breton, français, et asturien. Avec des membres des Goristes, en octobre 2013, il sort C'est ça qu'on aime vivre avec. Gilles Servat renouvelle ses engagements de toujours en 2011 avec Ailes et Îles, chanté en breton, français, et asturien. En 2019, une nouvelle étape dans la carrière de Gilles Servat avec un spectacle inédit « À Cordes déployées », rencontre entre son univers et celui de la musique classique. En 2020, Gilles Servat a enregistré avec trois musiciens un album acoustique dont la sortie est prévue après l’été. Le chanteur était accompagné de Mathilde Chevrel au violoncelle, Philippe Turbin au piano à queue et Floriane Le Pottier au violon. Gilles Servat est aussi écrivain, il signe une fascinante épopée de science-fiction en cinq volumes, Les Chroniques d'Arcturus, qui sait faire revivre l'épopée celte et la réalité de la Bretagne armoricaine. Aussi bien reconnu par la qualité de ses textes que par sa voix grave et chaleureuse, Gilles Servat, qui incarne la révolte bretonne des années 70, est aussi un poète sensible qui reste l’un des auteurs-compositeurs majeurs de Bretagne. Connu dans toute la francophonie depuis 1972, date à laquelle il écrit La Blanche Hermine, le public ne l’a jamais quitté. Toutes ces années il aura été un ardent défenseur de la culture bretonne armoricaine et d'expression bretonne et française, mais également des autres langues celtiques.
Gilles SERVAT, né le 1er février 1945 à Tarbes. Son père est d'origine nantaise et sa mère du Croisic. Son arrière-grand-père ariégois est montreur d'ours. La famille déménage de Tarbes à Nantes trois mois après sa naissance, puis s'installe rapidement à Cholet dans le Maine-et-Loire. Son père ayant obtenu un poste de chef du personnel à l'usine Ernault-Batignolles. Il passe son enfance à Cholet, où il obtient un baccalauréat littéraire, et effectue ses études supérieures à l'école des Beaux-Arts d'Angers. Il étudie la sculpture, la peinture, le dessin, la gravure et se destine au professorat. Il passe quatre ans à Angers puis deux ans à Paris, où il travaille quelques mois au service des redevances de l'ORTF. Il commence à écrire en 1967, pour s'exprimer librement et créer son répertoire. En mai 1968, il découvre en profondeur les problèmes politiques bretons, grâce notamment au Groisillon Serge Bihan rencontré à Angers. En 1969, c'est lors d'un séjour sur l'île de Groix dans le Morbihan que Gilles Servat prend conscience de sa celtitude. C'est le coup de foudre. Gilles Servat s'intéresse alors au renouveau de la musique celtique incarné par Alan Stivell ou Glenmor. À l'approche de l'automne, Gilles Servat part ensuite à Paris comme fonctionnaire aux PTT, tout en commençant à composer. Il se produit alors très régulièrement à Paris, par exemple à La Ville de Guingamp (dans le quartier du Montparnasse). Yvon Ollitraut, le patron du célèbre « café national breton » Ti-Jos, le découvre et l'invite à s'y produire. Gilles lâche finalement les PTT pour les aléas d'une vie d'artiste. Pendant plus de deux ans, il fait la manche en se produisant tous les soirs au restaurant Ti-Jos, lieu de rendez-vous des Bretons de Paris. L'année 1970, emporté par la vague musicale des années soixante-dix, il décide de s'engager dans la chanson, trouvant ainsi à s'exprimer. C'est au restaurant Ti-Jos à Paris qu'en 1970, il chante « La Blanche Hermine » pour la première fois. Il séduit son auditoire en particulier avec cette chanson. Dès le début des années 70, il fonde la maison d’édition Kelenn, qui produit des artistes tels que les Tri Yann. Lorsqu'elle sera revendue à la firme Phonogram, il crée son label nommé Kalondour. En 1972, il y édite son premier disque, « La Blanche Hermine », dont le titre éponyme deviendra au fil du temps, une sorte d'hymne officieux de la Bretagne, faisant de son auteur un activiste engagé. Ce premier 33 tours, devient disque d'or avec 100 000 exemplaires vendus et lance la carrière de Gilles Servat. La même année, il accepte de vendre le catalogue de Kelenn à Phonogram. Il entre ainsi, avec les Tri Yann et Alan Stivell, dans le circuit de la grande distribution. Portée par le succès de La Blanche Hermine, sa discographie va se développer de manière régulière. Parallèlement, il consacre beaucoup de son temps à donner des concerts tant en France qu’à l’étranger. Dans la décennie des années 1970, il sort quasiment un album par an. Entre poésie et militantisme, Gilles Servat colle bien à la tonalité des années soixante-dix, marquées par une naïveté baba-cool pleine de bons sentiments. Ki Du (1973), L'Hirondelle (1974), La Liberté Brille dans la Nuit (1975), Le Pouvoir des Mots (1976), Chantez la Vie, l'Amour, et la Mort (1977) jalonnent une décennie où Gilles Servat enchaîne albums et concerts. À partir de 1980, il prend du recul avec le militantisme, en quittant l'UDB et en écrivant des textes moins engagés et plus contemplatifs. Les années quatre-vingt sont moins trépidantes. En 1981, il propose un album en concert et en 1982, « Je ne hurlerai pas avec les loups » renoue avec la chanson poétique, tout en continuant d'exprimer son refus de tout manichéisme, notamment dans le texte principal qui dure seize minutes. En 1984 et 1985, il participe aux activités du Théâtre de la Chimère de Michel Ecoffard. En 1988, Mad in Sérénité rafle le Grand Prix de l’Académie Charles-Cros et le Prix du Conseil Régional de Bretagne. L’album Le Fleuve sorti en 1992 fait l’objet d’un spectacle, présenté aux Tombées de la nuit, festival rennais. À partir de 1993, il rejoint Dan Ar Braz pour l’aventure de l’Héritage des Celtes, un projet qui ambitionne de présenter la richesse de la musique celtique dans toute sa diversité. Il retrouve entre autres, Elaine Morgan, Nollaig Casey, Karen Matheson (chanteuse du groupe Capercaillie), Yann-Fañch Kemener, Donald Shaw. Il participe à l’enregistrement des quatre albums : Héritage des Celtes (1994), En concert (1995), Finisterres (1997) et le Zénith (concert en 1998), et aux tournées qui en découlent. En 1999, il est présent sur la réunion des Bretagnes à Bercy avec, outre les artistes de « L’Héritage des Celtes », Armens, Alan Stivell et Tri Yann. Sur les Quais de Dublin en 1996 marque une volonté de rencontre avec les artistes irlandais, toujours dans l'optique d'un syncrétisme de la musique celte. Il est aussi sculpteur de formation, dessinateur et graveur (il présenta ses œuvres en 1986, à Morlaix). En 1993, Gilles Servat, qui n'avait plus joué avec Dan Ar Braz depuis 1991, participe à l'expérience de l'Héritage des Celtes, aux côtés de 74 autres musiciens (dont Yann-Fañch Kemener, Didier Squiban...). Il sera présent sur les quatre premiers albums de cette nouvelle formation. Gilles Servat fait donc, à nouveau, son entrée dans le circuit de la grande distribution, en signant chez Sony Music un nouvel album : Sur Les Quais de Dublin. En 1998, le révolté de Loctudy attrape un coup de sang lorsqu'il se rend compte que sa « Blanche Hermine » est reprise dans les meetings du Front National. Sa riposte ne tarde pas, sous la forme d'un album : « Touche pas à ma blanche hermine ». En 1999, il participe à BretagneS, un album enregistré en live à Bercy devant 18 000 spectateurs, et qui sera aussi disque d'or. Forcément marqué par le naufrage du pétrolier Erika au large de la Bretagne en 1999, Gilles Servat sort en 2000 Comme Je Voudrai !, où il fait part de son indignation. En 2001, il réalise une création spéciale pour le festival des Vieilles Charrues, intitulée Bretagne, nous te ferons. En 2003 à Saint-Malo, il reçoit le collier de l’Ordre de l'Hermine, qui récompense les personnalités qui œuvrent pour le rayonnement de la Bretagne. Le 19 mai 2005, il sort un nouvel album : Sous le ciel de cuivre et d'eau qui contient notamment une chanson à la mémoire de Polig Monjarret intitulée Le Général des Binious, surnom du fondateur de la Bodadeg ar Sonerion. À l'occasion de ses trente-cinq ans de carrière, Gilles Servat sort en 2006 l'enregistrement en public Je Vous Emporte dans Mon Cœur, dont les trente-six titres ont été choisis par son public. Le 12 novembre 2006, il donne un concert anniversaire à l’Olympia en compagnie de Nolwenn Korbell et de l'Ensemble choral du Bout du Monde. Pour fêter ses cinquante-cinq ans, le chanteur Renaud l'invite au Zénith de Nantes, en duo sur Dans la jungle (écrite pour Ingrid Betancourt, dont un couplet est en breton) et La Blanche Hermine. En 2009, Gilles Servat témoigne et apporte son soutien à six jeunes militants pour la réunification de la Bretagne, inculpés pour des actions de désobéissance civile. En 2011, le chanteur sort un nouvel album studio intitulé Ailes et Îles, chanté en breton, français, et asturien. Avec des membres des Goristes, en octobre 2013, il sort C'est ça qu'on aime vivre avec. Gilles Servat renouvelle ses engagements de toujours en 2011 avec Ailes et Îles, chanté en breton, français, et asturien. En 2019, une nouvelle étape dans la carrière de Gilles Servat avec un spectacle inédit « À Cordes déployées », rencontre entre son univers et celui de la musique classique. En 2020, Gilles Servat a enregistré avec trois musiciens un album acoustique dont la sortie est prévue après l’été. Le chanteur était accompagné de Mathilde Chevrel au violoncelle, Philippe Turbin au piano à queue et Floriane Le Pottier au violon. Gilles Servat est aussi écrivain, il signe une fascinante épopée de science-fiction en cinq volumes, Les Chroniques d'Arcturus, qui sait faire revivre l'épopée celte et la réalité de la Bretagne armoricaine. Aussi bien reconnu par la qualité de ses textes que par sa voix grave et chaleureuse, Gilles Servat, qui incarne la révolte bretonne des années 70, est aussi un poète sensible qui reste l’un des auteurs-compositeurs majeurs de Bretagne. Connu dans toute la francophonie depuis 1972, date à laquelle il écrit La Blanche Hermine, le public ne l’a jamais quitté. Toutes ces années il aura été un ardent défenseur de la culture bretonne armoricaine et d'expression bretonne et française, mais également des autres langues celtiques.
 Gilles SERVAT, né le 1er février 1945 à Tarbes. Son père est d'origine nantaise et sa mère du Croisic. Son arrière-grand-père ariégois est montreur d'ours. La famille déménage de Tarbes à Nantes trois mois après sa naissance, puis s'installe rapidement à Cholet dans le Maine-et-Loire. Son père ayant obtenu un poste de chef du personnel à l'usine Ernault-Batignolles. Il passe son enfance à Cholet, où il obtient un baccalauréat littéraire, et effectue ses études supérieures à l'école des Beaux-Arts d'Angers. Il étudie la sculpture, la peinture, le dessin, la gravure et se destine au professorat. Il passe quatre ans à Angers puis deux ans à Paris, où il travaille quelques mois au service des redevances de l'ORTF. Il commence à écrire en 1967, pour s'exprimer librement et créer son répertoire. En mai 1968, il découvre en profondeur les problèmes politiques bretons, grâce notamment au Groisillon Serge Bihan rencontré à Angers. En 1969, c'est lors d'un séjour sur l'île de Groix dans le Morbihan que Gilles Servat prend conscience de sa celtitude. C'est le coup de foudre. Gilles Servat s'intéresse alors au renouveau de la musique celtique incarné par Alan Stivell ou Glenmor. À l'approche de l'automne, Gilles Servat part ensuite à Paris comme fonctionnaire aux PTT, tout en commençant à composer. Il se produit alors très régulièrement à Paris, par exemple à La Ville de Guingamp (dans le quartier du Montparnasse). Yvon Ollitraut, le patron du célèbre « café national breton » Ti-Jos, le découvre et l'invite à s'y produire. Gilles lâche finalement les PTT pour les aléas d'une vie d'artiste. Pendant plus de deux ans, il fait la manche en se produisant tous les soirs au restaurant Ti-Jos, lieu de rendez-vous des Bretons de Paris. L'année 1970, emporté par la vague musicale des années soixante-dix, il décide de s'engager dans la chanson, trouvant ainsi à s'exprimer. C'est au restaurant Ti-Jos à Paris qu'en 1970, il chante « La Blanche Hermine » pour la première fois. Il séduit son auditoire en particulier avec cette chanson. Dès le début des années 70, il fonde la maison d’édition Kelenn, qui produit des artistes tels que les Tri Yann. Lorsqu'elle sera revendue à la firme Phonogram, il crée son label nommé Kalondour. En 1972, il y édite son premier disque, « La Blanche Hermine », dont le titre éponyme deviendra au fil du temps, une sorte d'hymne officieux de la Bretagne, faisant de son auteur un activiste engagé. Ce premier 33 tours, devient disque d'or avec 100 000 exemplaires vendus et lance la carrière de Gilles Servat. La même année, il accepte de vendre le catalogue de Kelenn à Phonogram. Il entre ainsi, avec les Tri Yann et Alan Stivell, dans le circuit de la grande distribution. Portée par le succès de La Blanche Hermine, sa discographie va se développer de manière régulière. Parallèlement, il consacre beaucoup de son temps à donner des concerts tant en France qu’à l’étranger. Dans la décennie des années 1970, il sort quasiment un album par an. Entre poésie et militantisme, Gilles Servat colle bien à la tonalité des années soixante-dix, marquées par une naïveté baba-cool pleine de bons sentiments. Ki Du (1973), L'Hirondelle (1974), La Liberté Brille dans la Nuit (1975), Le Pouvoir des Mots (1976), Chantez la Vie, l'Amour, et la Mort (1977) jalonnent une décennie où Gilles Servat enchaîne albums et concerts. À partir de 1980, il prend du recul avec le militantisme, en quittant l'UDB et en écrivant des textes moins engagés et plus contemplatifs. Les années quatre-vingt sont moins trépidantes. En 1981, il propose un album en concert et en 1982, « Je ne hurlerai pas avec les loups » renoue avec la chanson poétique, tout en continuant d'exprimer son refus de tout manichéisme, notamment dans le texte principal qui dure seize minutes. En 1984 et 1985, il participe aux activités du Théâtre de la Chimère de Michel Ecoffard. En 1988, Mad in Sérénité rafle le Grand Prix de l’Académie Charles-Cros et le Prix du Conseil Régional de Bretagne. L’album Le Fleuve sorti en 1992 fait l’objet d’un spectacle, présenté aux Tombées de la nuit, festival rennais. À partir de 1993, il rejoint Dan Ar Braz pour l’aventure de l’Héritage des Celtes, un projet qui ambitionne de présenter la richesse de la musique celtique dans toute sa diversité. Il retrouve entre autres, Elaine Morgan, Nollaig Casey, Karen Matheson (chanteuse du groupe Capercaillie), Yann-Fañch Kemener, Donald Shaw. Il participe à l’enregistrement des quatre albums : Héritage des Celtes (1994), En concert (1995), Finisterres (1997) et le Zénith (concert en 1998), et aux tournées qui en découlent. En 1999, il est présent sur la réunion des Bretagnes à Bercy avec, outre les artistes de « L’Héritage des Celtes », Armens, Alan Stivell et Tri Yann. Sur les Quais de Dublin en 1996 marque une volonté de rencontre avec les artistes irlandais, toujours dans l'optique d'un syncrétisme de la musique celte. Il est aussi sculpteur de formation, dessinateur et graveur (il présenta ses œuvres en 1986, à Morlaix). En 1993, Gilles Servat, qui n'avait plus joué avec Dan Ar Braz depuis 1991, participe à l'expérience de l'Héritage des Celtes, aux côtés de 74 autres musiciens (dont Yann-Fañch Kemener, Didier Squiban...). Il sera présent sur les quatre premiers albums de cette nouvelle formation. Gilles Servat fait donc, à nouveau, son entrée dans le circuit de la grande distribution, en signant chez Sony Music un nouvel album : Sur Les Quais de Dublin. En 1998, le révolté de Loctudy attrape un coup de sang lorsqu'il se rend compte que sa « Blanche Hermine » est reprise dans les meetings du Front National. Sa riposte ne tarde pas, sous la forme d'un album : « Touche pas à ma blanche hermine ». En 1999, il participe à BretagneS, un album enregistré en live à Bercy devant 18 000 spectateurs, et qui sera aussi disque d'or. Forcément marqué par le naufrage du pétrolier Erika au large de la Bretagne en 1999, Gilles Servat sort en 2000 Comme Je Voudrai !, où il fait part de son indignation. En 2001, il réalise une création spéciale pour le festival des Vieilles Charrues, intitulée Bretagne, nous te ferons. En 2003 à Saint-Malo, il reçoit le collier de l’Ordre de l'Hermine, qui récompense les personnalités qui œuvrent pour le rayonnement de la Bretagne. Le 19 mai 2005, il sort un nouvel album : Sous le ciel de cuivre et d'eau qui contient notamment une chanson à la mémoire de Polig Monjarret intitulée Le Général des Binious, surnom du fondateur de la Bodadeg ar Sonerion. À l'occasion de ses trente-cinq ans de carrière, Gilles Servat sort en 2006 l'enregistrement en public Je Vous Emporte dans Mon Cœur, dont les trente-six titres ont été choisis par son public. Le 12 novembre 2006, il donne un concert anniversaire à l’Olympia en compagnie de Nolwenn Korbell et de l'Ensemble choral du Bout du Monde. Pour fêter ses cinquante-cinq ans, le chanteur Renaud l'invite au Zénith de Nantes, en duo sur Dans la jungle (écrite pour Ingrid Betancourt, dont un couplet est en breton) et La Blanche Hermine. En 2009, Gilles Servat témoigne et apporte son soutien à six jeunes militants pour la réunification de la Bretagne, inculpés pour des actions de désobéissance civile. En 2011, le chanteur sort un nouvel album studio intitulé Ailes et Îles, chanté en breton, français, et asturien. Avec des membres des Goristes, en octobre 2013, il sort C'est ça qu'on aime vivre avec. Gilles Servat renouvelle ses engagements de toujours en 2011 avec Ailes et Îles, chanté en breton, français, et asturien. En 2019, une nouvelle étape dans la carrière de Gilles Servat avec un spectacle inédit « À Cordes déployées », rencontre entre son univers et celui de la musique classique. En 2020, Gilles Servat a enregistré avec trois musiciens un album acoustique dont la sortie est prévue après l’été. Le chanteur était accompagné de Mathilde Chevrel au violoncelle, Philippe Turbin au piano à queue et Floriane Le Pottier au violon. Gilles Servat est aussi écrivain, il signe une fascinante épopée de science-fiction en cinq volumes, Les Chroniques d'Arcturus, qui sait faire revivre l'épopée celte et la réalité de la Bretagne armoricaine. Aussi bien reconnu par la qualité de ses textes que par sa voix grave et chaleureuse, Gilles Servat, qui incarne la révolte bretonne des années 70, est aussi un poète sensible qui reste l’un des auteurs-compositeurs majeurs de Bretagne. Connu dans toute la francophonie depuis 1972, date à laquelle il écrit La Blanche Hermine, le public ne l’a jamais quitté. Toutes ces années il aura été un ardent défenseur de la culture bretonne armoricaine et d'expression bretonne et française, mais également des autres langues celtiques.
Gilles SERVAT, né le 1er février 1945 à Tarbes. Son père est d'origine nantaise et sa mère du Croisic. Son arrière-grand-père ariégois est montreur d'ours. La famille déménage de Tarbes à Nantes trois mois après sa naissance, puis s'installe rapidement à Cholet dans le Maine-et-Loire. Son père ayant obtenu un poste de chef du personnel à l'usine Ernault-Batignolles. Il passe son enfance à Cholet, où il obtient un baccalauréat littéraire, et effectue ses études supérieures à l'école des Beaux-Arts d'Angers. Il étudie la sculpture, la peinture, le dessin, la gravure et se destine au professorat. Il passe quatre ans à Angers puis deux ans à Paris, où il travaille quelques mois au service des redevances de l'ORTF. Il commence à écrire en 1967, pour s'exprimer librement et créer son répertoire. En mai 1968, il découvre en profondeur les problèmes politiques bretons, grâce notamment au Groisillon Serge Bihan rencontré à Angers. En 1969, c'est lors d'un séjour sur l'île de Groix dans le Morbihan que Gilles Servat prend conscience de sa celtitude. C'est le coup de foudre. Gilles Servat s'intéresse alors au renouveau de la musique celtique incarné par Alan Stivell ou Glenmor. À l'approche de l'automne, Gilles Servat part ensuite à Paris comme fonctionnaire aux PTT, tout en commençant à composer. Il se produit alors très régulièrement à Paris, par exemple à La Ville de Guingamp (dans le quartier du Montparnasse). Yvon Ollitraut, le patron du célèbre « café national breton » Ti-Jos, le découvre et l'invite à s'y produire. Gilles lâche finalement les PTT pour les aléas d'une vie d'artiste. Pendant plus de deux ans, il fait la manche en se produisant tous les soirs au restaurant Ti-Jos, lieu de rendez-vous des Bretons de Paris. L'année 1970, emporté par la vague musicale des années soixante-dix, il décide de s'engager dans la chanson, trouvant ainsi à s'exprimer. C'est au restaurant Ti-Jos à Paris qu'en 1970, il chante « La Blanche Hermine » pour la première fois. Il séduit son auditoire en particulier avec cette chanson. Dès le début des années 70, il fonde la maison d’édition Kelenn, qui produit des artistes tels que les Tri Yann. Lorsqu'elle sera revendue à la firme Phonogram, il crée son label nommé Kalondour. En 1972, il y édite son premier disque, « La Blanche Hermine », dont le titre éponyme deviendra au fil du temps, une sorte d'hymne officieux de la Bretagne, faisant de son auteur un activiste engagé. Ce premier 33 tours, devient disque d'or avec 100 000 exemplaires vendus et lance la carrière de Gilles Servat. La même année, il accepte de vendre le catalogue de Kelenn à Phonogram. Il entre ainsi, avec les Tri Yann et Alan Stivell, dans le circuit de la grande distribution. Portée par le succès de La Blanche Hermine, sa discographie va se développer de manière régulière. Parallèlement, il consacre beaucoup de son temps à donner des concerts tant en France qu’à l’étranger. Dans la décennie des années 1970, il sort quasiment un album par an. Entre poésie et militantisme, Gilles Servat colle bien à la tonalité des années soixante-dix, marquées par une naïveté baba-cool pleine de bons sentiments. Ki Du (1973), L'Hirondelle (1974), La Liberté Brille dans la Nuit (1975), Le Pouvoir des Mots (1976), Chantez la Vie, l'Amour, et la Mort (1977) jalonnent une décennie où Gilles Servat enchaîne albums et concerts. À partir de 1980, il prend du recul avec le militantisme, en quittant l'UDB et en écrivant des textes moins engagés et plus contemplatifs. Les années quatre-vingt sont moins trépidantes. En 1981, il propose un album en concert et en 1982, « Je ne hurlerai pas avec les loups » renoue avec la chanson poétique, tout en continuant d'exprimer son refus de tout manichéisme, notamment dans le texte principal qui dure seize minutes. En 1984 et 1985, il participe aux activités du Théâtre de la Chimère de Michel Ecoffard. En 1988, Mad in Sérénité rafle le Grand Prix de l’Académie Charles-Cros et le Prix du Conseil Régional de Bretagne. L’album Le Fleuve sorti en 1992 fait l’objet d’un spectacle, présenté aux Tombées de la nuit, festival rennais. À partir de 1993, il rejoint Dan Ar Braz pour l’aventure de l’Héritage des Celtes, un projet qui ambitionne de présenter la richesse de la musique celtique dans toute sa diversité. Il retrouve entre autres, Elaine Morgan, Nollaig Casey, Karen Matheson (chanteuse du groupe Capercaillie), Yann-Fañch Kemener, Donald Shaw. Il participe à l’enregistrement des quatre albums : Héritage des Celtes (1994), En concert (1995), Finisterres (1997) et le Zénith (concert en 1998), et aux tournées qui en découlent. En 1999, il est présent sur la réunion des Bretagnes à Bercy avec, outre les artistes de « L’Héritage des Celtes », Armens, Alan Stivell et Tri Yann. Sur les Quais de Dublin en 1996 marque une volonté de rencontre avec les artistes irlandais, toujours dans l'optique d'un syncrétisme de la musique celte. Il est aussi sculpteur de formation, dessinateur et graveur (il présenta ses œuvres en 1986, à Morlaix). En 1993, Gilles Servat, qui n'avait plus joué avec Dan Ar Braz depuis 1991, participe à l'expérience de l'Héritage des Celtes, aux côtés de 74 autres musiciens (dont Yann-Fañch Kemener, Didier Squiban...). Il sera présent sur les quatre premiers albums de cette nouvelle formation. Gilles Servat fait donc, à nouveau, son entrée dans le circuit de la grande distribution, en signant chez Sony Music un nouvel album : Sur Les Quais de Dublin. En 1998, le révolté de Loctudy attrape un coup de sang lorsqu'il se rend compte que sa « Blanche Hermine » est reprise dans les meetings du Front National. Sa riposte ne tarde pas, sous la forme d'un album : « Touche pas à ma blanche hermine ». En 1999, il participe à BretagneS, un album enregistré en live à Bercy devant 18 000 spectateurs, et qui sera aussi disque d'or. Forcément marqué par le naufrage du pétrolier Erika au large de la Bretagne en 1999, Gilles Servat sort en 2000 Comme Je Voudrai !, où il fait part de son indignation. En 2001, il réalise une création spéciale pour le festival des Vieilles Charrues, intitulée Bretagne, nous te ferons. En 2003 à Saint-Malo, il reçoit le collier de l’Ordre de l'Hermine, qui récompense les personnalités qui œuvrent pour le rayonnement de la Bretagne. Le 19 mai 2005, il sort un nouvel album : Sous le ciel de cuivre et d'eau qui contient notamment une chanson à la mémoire de Polig Monjarret intitulée Le Général des Binious, surnom du fondateur de la Bodadeg ar Sonerion. À l'occasion de ses trente-cinq ans de carrière, Gilles Servat sort en 2006 l'enregistrement en public Je Vous Emporte dans Mon Cœur, dont les trente-six titres ont été choisis par son public. Le 12 novembre 2006, il donne un concert anniversaire à l’Olympia en compagnie de Nolwenn Korbell et de l'Ensemble choral du Bout du Monde. Pour fêter ses cinquante-cinq ans, le chanteur Renaud l'invite au Zénith de Nantes, en duo sur Dans la jungle (écrite pour Ingrid Betancourt, dont un couplet est en breton) et La Blanche Hermine. En 2009, Gilles Servat témoigne et apporte son soutien à six jeunes militants pour la réunification de la Bretagne, inculpés pour des actions de désobéissance civile. En 2011, le chanteur sort un nouvel album studio intitulé Ailes et Îles, chanté en breton, français, et asturien. Avec des membres des Goristes, en octobre 2013, il sort C'est ça qu'on aime vivre avec. Gilles Servat renouvelle ses engagements de toujours en 2011 avec Ailes et Îles, chanté en breton, français, et asturien. En 2019, une nouvelle étape dans la carrière de Gilles Servat avec un spectacle inédit « À Cordes déployées », rencontre entre son univers et celui de la musique classique. En 2020, Gilles Servat a enregistré avec trois musiciens un album acoustique dont la sortie est prévue après l’été. Le chanteur était accompagné de Mathilde Chevrel au violoncelle, Philippe Turbin au piano à queue et Floriane Le Pottier au violon. Gilles Servat est aussi écrivain, il signe une fascinante épopée de science-fiction en cinq volumes, Les Chroniques d'Arcturus, qui sait faire revivre l'épopée celte et la réalité de la Bretagne armoricaine. Aussi bien reconnu par la qualité de ses textes que par sa voix grave et chaleureuse, Gilles Servat, qui incarne la révolte bretonne des années 70, est aussi un poète sensible qui reste l’un des auteurs-compositeurs majeurs de Bretagne. Connu dans toute la francophonie depuis 1972, date à laquelle il écrit La Blanche Hermine, le public ne l’a jamais quitté. Toutes ces années il aura été un ardent défenseur de la culture bretonne armoricaine et d'expression bretonne et française, mais également des autres langues celtiques.SIM (1926-2009)
Comédien, humoriste et écrivain
 SIM, de son vrai nom Simon Jacques Eugène Berryer, né le 21 juillet 1926 à Cauterets et mort le 6 septembre 2009, à l’âge de 83 ans à Fréjus, est un humoriste qui aura fait rire des millions de Français séduits par ses mimiques et son humour. Grande figure du théâtre et de la télévision, les débuts ne furent pas faciles pour ce fils d’ingénieur électricien, originaire des Hautes-Pyrénées, qui s’était lancé à la conquête de la capitale. Il débuta sa carrière en 1946 comme opérateur de cinéma, avant de faire le tour des cabarets comme comique. L’humoriste se moquait volontiers de son physique très éloigné des canons de beauté et de sa « petite tronche ». « L’erreur est humaine, regardez-moi », aimait-il à dire. « J’ai touché à tout : au porte-à-porte, à l’immobilier, puis à l’armée, jusqu’au jour où je me suis regardé dans une glace. Je me suis rendu compte que ma tête était un fonds de commerce possible », se souvenait-il. Son talent pour les grimaces et son humour lui ouvrirent les portes des cabarets de Paris, où il présenta à partir de 1953 un tour de chant comique. Il joua ses sketches dans tous les cabarets en compagnie de Fernand Raynaud, Philippe Clay, Gilbert Bécaud ou Charles Aznavour. Au début des années 60, il travailla pour le petit écran comme animateur dans des programmes jeunesse, mais il en bava jusqu’en 1965, avouera-t-il plus tard. Cet artiste à l’humour fantaisiste s’illustra aussi au cinéma dans une multitude de petits rôles. Il tourna notamment avec Michel Audiard, dont il appréciait les dialogues pleins d’humour. On le voit ainsi aux génériques de « Cartouche » (Philippe de Broca, 1963), « Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais... elle cause ! » (Michel Audiard, 1969) ou encore « Les Mariés de l’an II » (Jean-Paul Rappeneau, 1971) et « Pinot simple flic » (Gérard Jugnot, 1984). Il avait également tourné dans des œuvres plus intimistes comme « La Voce della luna » de Federico Fellini (1990). Cette véritable "gueule", qui joue à fond de son étonnant physique, est connue pour être la plus ancienne "grosse tête" aux côtés de Philippe Bouvard sur RTL dans les années 1970 et pour avoir incarné le personnage du vieillard Agecanonix dans l’adaptation de « Astérix et Obélix aux Jeux olympiques » de Thomas Langmann et Frédéric Forestier (2008). Depuis quelques années, il limitait ses engagements à la série Louis la Brocante, aux côtés de Victor Lanoux. Le dernier épisode, auquel il aura participé fut diffusé en 2009. Il connaissait bien Victor Lanoux et il avait joué dans deux de ses pièces, « Le Tourniquet » (1987) et « La Ritournelle » (1989). C’est bien la télévision et la radio qui feront de lui l’un des comiques français les plus populaires. Découvert par Jean Nohain, l’un des pionniers de la télévision, il sera un fidèle de l’émission "36 chandelles". Surtout, « la Baronne de la Tronche en biais », personnage burlesque qu’il incarna travesti en femme et avec force mimiques, fera se tordre de rire les téléspectateurs. Il assurait qu’il "n’aimait pas les rires gras" et qu’il était "contre les mots orduriers". Marié deux fois, ce père de deux enfants avait également écrit et publié des livres de souvenirs ou d’humour, notamment « Elle est chouette ma gueule » (1983, prix Scarron), « Pour l’humour de Dieu » (1985), « Elles sont chouettes mes femmes » (1986, prix Alphonse Allais) et « le Petit Simon » (1994). Il avait aussi enregistré trois disques : « J’aime pas les rhododendrons » (1970), « Ma chemise grise » (1978, disque d’or et grand prix disco-humour) et « Quoi, ma gueule » (1980, écoutez le morceau). Sa propre pièce, « Une cloche en or », qu’il mit en scène et interprétera plus de 350 fois à Paris et en province rencontrera également un très grand succès sur les planches. Personnage comique et populaire, il se voulait « un rigolo qui réfléchit ». S’il avait eu une carrière pas facile au début, petit à petit il avait obtenu la notoriété et était devenu un grand acteur et un grand comique en jouant de son physique et surtout de sa « gueule ».
SIM, de son vrai nom Simon Jacques Eugène Berryer, né le 21 juillet 1926 à Cauterets et mort le 6 septembre 2009, à l’âge de 83 ans à Fréjus, est un humoriste qui aura fait rire des millions de Français séduits par ses mimiques et son humour. Grande figure du théâtre et de la télévision, les débuts ne furent pas faciles pour ce fils d’ingénieur électricien, originaire des Hautes-Pyrénées, qui s’était lancé à la conquête de la capitale. Il débuta sa carrière en 1946 comme opérateur de cinéma, avant de faire le tour des cabarets comme comique. L’humoriste se moquait volontiers de son physique très éloigné des canons de beauté et de sa « petite tronche ». « L’erreur est humaine, regardez-moi », aimait-il à dire. « J’ai touché à tout : au porte-à-porte, à l’immobilier, puis à l’armée, jusqu’au jour où je me suis regardé dans une glace. Je me suis rendu compte que ma tête était un fonds de commerce possible », se souvenait-il. Son talent pour les grimaces et son humour lui ouvrirent les portes des cabarets de Paris, où il présenta à partir de 1953 un tour de chant comique. Il joua ses sketches dans tous les cabarets en compagnie de Fernand Raynaud, Philippe Clay, Gilbert Bécaud ou Charles Aznavour. Au début des années 60, il travailla pour le petit écran comme animateur dans des programmes jeunesse, mais il en bava jusqu’en 1965, avouera-t-il plus tard. Cet artiste à l’humour fantaisiste s’illustra aussi au cinéma dans une multitude de petits rôles. Il tourna notamment avec Michel Audiard, dont il appréciait les dialogues pleins d’humour. On le voit ainsi aux génériques de « Cartouche » (Philippe de Broca, 1963), « Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais... elle cause ! » (Michel Audiard, 1969) ou encore « Les Mariés de l’an II » (Jean-Paul Rappeneau, 1971) et « Pinot simple flic » (Gérard Jugnot, 1984). Il avait également tourné dans des œuvres plus intimistes comme « La Voce della luna » de Federico Fellini (1990). Cette véritable "gueule", qui joue à fond de son étonnant physique, est connue pour être la plus ancienne "grosse tête" aux côtés de Philippe Bouvard sur RTL dans les années 1970 et pour avoir incarné le personnage du vieillard Agecanonix dans l’adaptation de « Astérix et Obélix aux Jeux olympiques » de Thomas Langmann et Frédéric Forestier (2008). Depuis quelques années, il limitait ses engagements à la série Louis la Brocante, aux côtés de Victor Lanoux. Le dernier épisode, auquel il aura participé fut diffusé en 2009. Il connaissait bien Victor Lanoux et il avait joué dans deux de ses pièces, « Le Tourniquet » (1987) et « La Ritournelle » (1989). C’est bien la télévision et la radio qui feront de lui l’un des comiques français les plus populaires. Découvert par Jean Nohain, l’un des pionniers de la télévision, il sera un fidèle de l’émission "36 chandelles". Surtout, « la Baronne de la Tronche en biais », personnage burlesque qu’il incarna travesti en femme et avec force mimiques, fera se tordre de rire les téléspectateurs. Il assurait qu’il "n’aimait pas les rires gras" et qu’il était "contre les mots orduriers". Marié deux fois, ce père de deux enfants avait également écrit et publié des livres de souvenirs ou d’humour, notamment « Elle est chouette ma gueule » (1983, prix Scarron), « Pour l’humour de Dieu » (1985), « Elles sont chouettes mes femmes » (1986, prix Alphonse Allais) et « le Petit Simon » (1994). Il avait aussi enregistré trois disques : « J’aime pas les rhododendrons » (1970), « Ma chemise grise » (1978, disque d’or et grand prix disco-humour) et « Quoi, ma gueule » (1980, écoutez le morceau). Sa propre pièce, « Une cloche en or », qu’il mit en scène et interprétera plus de 350 fois à Paris et en province rencontrera également un très grand succès sur les planches. Personnage comique et populaire, il se voulait « un rigolo qui réfléchit ». S’il avait eu une carrière pas facile au début, petit à petit il avait obtenu la notoriété et était devenu un grand acteur et un grand comique en jouant de son physique et surtout de sa « gueule ».
 SIM, de son vrai nom Simon Jacques Eugène Berryer, né le 21 juillet 1926 à Cauterets et mort le 6 septembre 2009, à l’âge de 83 ans à Fréjus, est un humoriste qui aura fait rire des millions de Français séduits par ses mimiques et son humour. Grande figure du théâtre et de la télévision, les débuts ne furent pas faciles pour ce fils d’ingénieur électricien, originaire des Hautes-Pyrénées, qui s’était lancé à la conquête de la capitale. Il débuta sa carrière en 1946 comme opérateur de cinéma, avant de faire le tour des cabarets comme comique. L’humoriste se moquait volontiers de son physique très éloigné des canons de beauté et de sa « petite tronche ». « L’erreur est humaine, regardez-moi », aimait-il à dire. « J’ai touché à tout : au porte-à-porte, à l’immobilier, puis à l’armée, jusqu’au jour où je me suis regardé dans une glace. Je me suis rendu compte que ma tête était un fonds de commerce possible », se souvenait-il. Son talent pour les grimaces et son humour lui ouvrirent les portes des cabarets de Paris, où il présenta à partir de 1953 un tour de chant comique. Il joua ses sketches dans tous les cabarets en compagnie de Fernand Raynaud, Philippe Clay, Gilbert Bécaud ou Charles Aznavour. Au début des années 60, il travailla pour le petit écran comme animateur dans des programmes jeunesse, mais il en bava jusqu’en 1965, avouera-t-il plus tard. Cet artiste à l’humour fantaisiste s’illustra aussi au cinéma dans une multitude de petits rôles. Il tourna notamment avec Michel Audiard, dont il appréciait les dialogues pleins d’humour. On le voit ainsi aux génériques de « Cartouche » (Philippe de Broca, 1963), « Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais... elle cause ! » (Michel Audiard, 1969) ou encore « Les Mariés de l’an II » (Jean-Paul Rappeneau, 1971) et « Pinot simple flic » (Gérard Jugnot, 1984). Il avait également tourné dans des œuvres plus intimistes comme « La Voce della luna » de Federico Fellini (1990). Cette véritable "gueule", qui joue à fond de son étonnant physique, est connue pour être la plus ancienne "grosse tête" aux côtés de Philippe Bouvard sur RTL dans les années 1970 et pour avoir incarné le personnage du vieillard Agecanonix dans l’adaptation de « Astérix et Obélix aux Jeux olympiques » de Thomas Langmann et Frédéric Forestier (2008). Depuis quelques années, il limitait ses engagements à la série Louis la Brocante, aux côtés de Victor Lanoux. Le dernier épisode, auquel il aura participé fut diffusé en 2009. Il connaissait bien Victor Lanoux et il avait joué dans deux de ses pièces, « Le Tourniquet » (1987) et « La Ritournelle » (1989). C’est bien la télévision et la radio qui feront de lui l’un des comiques français les plus populaires. Découvert par Jean Nohain, l’un des pionniers de la télévision, il sera un fidèle de l’émission "36 chandelles". Surtout, « la Baronne de la Tronche en biais », personnage burlesque qu’il incarna travesti en femme et avec force mimiques, fera se tordre de rire les téléspectateurs. Il assurait qu’il "n’aimait pas les rires gras" et qu’il était "contre les mots orduriers". Marié deux fois, ce père de deux enfants avait également écrit et publié des livres de souvenirs ou d’humour, notamment « Elle est chouette ma gueule » (1983, prix Scarron), « Pour l’humour de Dieu » (1985), « Elles sont chouettes mes femmes » (1986, prix Alphonse Allais) et « le Petit Simon » (1994). Il avait aussi enregistré trois disques : « J’aime pas les rhododendrons » (1970), « Ma chemise grise » (1978, disque d’or et grand prix disco-humour) et « Quoi, ma gueule » (1980, écoutez le morceau). Sa propre pièce, « Une cloche en or », qu’il mit en scène et interprétera plus de 350 fois à Paris et en province rencontrera également un très grand succès sur les planches. Personnage comique et populaire, il se voulait « un rigolo qui réfléchit ». S’il avait eu une carrière pas facile au début, petit à petit il avait obtenu la notoriété et était devenu un grand acteur et un grand comique en jouant de son physique et surtout de sa « gueule ».
SIM, de son vrai nom Simon Jacques Eugène Berryer, né le 21 juillet 1926 à Cauterets et mort le 6 septembre 2009, à l’âge de 83 ans à Fréjus, est un humoriste qui aura fait rire des millions de Français séduits par ses mimiques et son humour. Grande figure du théâtre et de la télévision, les débuts ne furent pas faciles pour ce fils d’ingénieur électricien, originaire des Hautes-Pyrénées, qui s’était lancé à la conquête de la capitale. Il débuta sa carrière en 1946 comme opérateur de cinéma, avant de faire le tour des cabarets comme comique. L’humoriste se moquait volontiers de son physique très éloigné des canons de beauté et de sa « petite tronche ». « L’erreur est humaine, regardez-moi », aimait-il à dire. « J’ai touché à tout : au porte-à-porte, à l’immobilier, puis à l’armée, jusqu’au jour où je me suis regardé dans une glace. Je me suis rendu compte que ma tête était un fonds de commerce possible », se souvenait-il. Son talent pour les grimaces et son humour lui ouvrirent les portes des cabarets de Paris, où il présenta à partir de 1953 un tour de chant comique. Il joua ses sketches dans tous les cabarets en compagnie de Fernand Raynaud, Philippe Clay, Gilbert Bécaud ou Charles Aznavour. Au début des années 60, il travailla pour le petit écran comme animateur dans des programmes jeunesse, mais il en bava jusqu’en 1965, avouera-t-il plus tard. Cet artiste à l’humour fantaisiste s’illustra aussi au cinéma dans une multitude de petits rôles. Il tourna notamment avec Michel Audiard, dont il appréciait les dialogues pleins d’humour. On le voit ainsi aux génériques de « Cartouche » (Philippe de Broca, 1963), « Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais... elle cause ! » (Michel Audiard, 1969) ou encore « Les Mariés de l’an II » (Jean-Paul Rappeneau, 1971) et « Pinot simple flic » (Gérard Jugnot, 1984). Il avait également tourné dans des œuvres plus intimistes comme « La Voce della luna » de Federico Fellini (1990). Cette véritable "gueule", qui joue à fond de son étonnant physique, est connue pour être la plus ancienne "grosse tête" aux côtés de Philippe Bouvard sur RTL dans les années 1970 et pour avoir incarné le personnage du vieillard Agecanonix dans l’adaptation de « Astérix et Obélix aux Jeux olympiques » de Thomas Langmann et Frédéric Forestier (2008). Depuis quelques années, il limitait ses engagements à la série Louis la Brocante, aux côtés de Victor Lanoux. Le dernier épisode, auquel il aura participé fut diffusé en 2009. Il connaissait bien Victor Lanoux et il avait joué dans deux de ses pièces, « Le Tourniquet » (1987) et « La Ritournelle » (1989). C’est bien la télévision et la radio qui feront de lui l’un des comiques français les plus populaires. Découvert par Jean Nohain, l’un des pionniers de la télévision, il sera un fidèle de l’émission "36 chandelles". Surtout, « la Baronne de la Tronche en biais », personnage burlesque qu’il incarna travesti en femme et avec force mimiques, fera se tordre de rire les téléspectateurs. Il assurait qu’il "n’aimait pas les rires gras" et qu’il était "contre les mots orduriers". Marié deux fois, ce père de deux enfants avait également écrit et publié des livres de souvenirs ou d’humour, notamment « Elle est chouette ma gueule » (1983, prix Scarron), « Pour l’humour de Dieu » (1985), « Elles sont chouettes mes femmes » (1986, prix Alphonse Allais) et « le Petit Simon » (1994). Il avait aussi enregistré trois disques : « J’aime pas les rhododendrons » (1970), « Ma chemise grise » (1978, disque d’or et grand prix disco-humour) et « Quoi, ma gueule » (1980, écoutez le morceau). Sa propre pièce, « Une cloche en or », qu’il mit en scène et interprétera plus de 350 fois à Paris et en province rencontrera également un très grand succès sur les planches. Personnage comique et populaire, il se voulait « un rigolo qui réfléchit ». S’il avait eu une carrière pas facile au début, petit à petit il avait obtenu la notoriété et était devenu un grand acteur et un grand comique en jouant de son physique et surtout de sa « gueule ».SOUBIROUS Bernadette (1844-1879)
Sainte catholique
 Bernadette SOUBIROUS, de son vrai nom Marie-Bernarde Soubirous (Maria Bernada Sobeirons), est née le 7 janvier 1844 au Moulin de Boly à Lourdes et décédée le 16 avril 1879 à Nevers, à l’âge de 35 ans. Elle est célèbre pour avoir vu des apparitions de la Vierge dans la grotte de Massabielle, de sa ville natale. Ses parents, François Soubirous (1807-1871) et Louise Castérot (1825-1866), exploitent le moulin de Boly, où elle est née, jusqu’en 1854. Les Soubirous qui avaient, dit-on, fait un mariage d’amour, ont eu au total neuf enfants dont cinq sont morts en bas-âge. Bernadette est l’aînée. À cette date, l’entreprise familiale est ruinée (trop artisanale pour cette époque d’industrialisation, et sans doute mal gérée). Bernadette connaît la faim et la maladie, elle sait à peine lire et écrire. De santé fragile, notamment asthmatique, elle paraît moins que son âge. Elle est par ailleurs jolie fille, selon les témoignages de l’époque et comme en attestent les photographies qui ont été prises d’elle. Son sentiment religieux est déjà très fort même si elle ignore à peu près tout du catéchisme (« si la Sainte Vierge m’a choisie, c’est parce que j’étais la plus ignorante ! » dira-t-elle plus tard). En février 1857, les Soubirous déménagent pour une cellule de l’ancienne prison de la rue Haute, surnommée « Le cachot » (que l’on peut visiter actuellement), et où ils logent à six dans 3,77 x 4,40m. En mars 1857, François Soubirous est accusé, et apparemment à tort, du vol de deux sacs de farine. Il est envoyé en prison. La famille Soubirous est dans une période de détresse noire. Bernadette, qui a déjà treize ans, sait à peine lire et écrire. Sa santé est encore fragilisée par la faim et la misère et ses parents décident de l’envoyer chez sa marraine et tante, Bernarde Castérot (1823-1907), qui l’emploie comme servante à la maison et au comptoir de son cabaret. Elle séjournera aussi longuement à Bartrès (situé à 5 km de Lourdes), chez Marie Laguë, une fermière amie de la famille. De septembre 1857 à janvier 1858, Bernadette y veille sur deux jeunes enfants, assure le ménage, les corvées d’eau et de bois et garde les moutons. À quatorze ans, ne sachant toujours ni lire ni écrire, elle demande à son père l’autorisation de quitter Bartrès pour revenir au « cachot », afin de suivre à Lourdes les leçons du catéchisme paroissial pour pouvoir au plus tôt recevoir la communion. Le 21 janvier 1858, Bernadette revient au « cachot » à Lourdes retrouver les siens. À partir de janvier, elle ira à l’Hospice des sœurs, qui font aussi école (les sœurs de l’instruction chrétienne de Nevers). Elle fera sa première communion le 3 juin 1858 durant les apparitions. Bernadette témoigne d’apparitions de la Vierge à partir de 1858. Lors de sa neuvième apparition, elle suit les indications de la Vierge et découvre une source d’eau au pied de la grotte de Massabielle, à Lourdes. Entre le 11 février et le 16 juillet 1858, la Vierge lui apparaîtra dix-huit fois.
Bernadette SOUBIROUS, de son vrai nom Marie-Bernarde Soubirous (Maria Bernada Sobeirons), est née le 7 janvier 1844 au Moulin de Boly à Lourdes et décédée le 16 avril 1879 à Nevers, à l’âge de 35 ans. Elle est célèbre pour avoir vu des apparitions de la Vierge dans la grotte de Massabielle, de sa ville natale. Ses parents, François Soubirous (1807-1871) et Louise Castérot (1825-1866), exploitent le moulin de Boly, où elle est née, jusqu’en 1854. Les Soubirous qui avaient, dit-on, fait un mariage d’amour, ont eu au total neuf enfants dont cinq sont morts en bas-âge. Bernadette est l’aînée. À cette date, l’entreprise familiale est ruinée (trop artisanale pour cette époque d’industrialisation, et sans doute mal gérée). Bernadette connaît la faim et la maladie, elle sait à peine lire et écrire. De santé fragile, notamment asthmatique, elle paraît moins que son âge. Elle est par ailleurs jolie fille, selon les témoignages de l’époque et comme en attestent les photographies qui ont été prises d’elle. Son sentiment religieux est déjà très fort même si elle ignore à peu près tout du catéchisme (« si la Sainte Vierge m’a choisie, c’est parce que j’étais la plus ignorante ! » dira-t-elle plus tard). En février 1857, les Soubirous déménagent pour une cellule de l’ancienne prison de la rue Haute, surnommée « Le cachot » (que l’on peut visiter actuellement), et où ils logent à six dans 3,77 x 4,40m. En mars 1857, François Soubirous est accusé, et apparemment à tort, du vol de deux sacs de farine. Il est envoyé en prison. La famille Soubirous est dans une période de détresse noire. Bernadette, qui a déjà treize ans, sait à peine lire et écrire. Sa santé est encore fragilisée par la faim et la misère et ses parents décident de l’envoyer chez sa marraine et tante, Bernarde Castérot (1823-1907), qui l’emploie comme servante à la maison et au comptoir de son cabaret. Elle séjournera aussi longuement à Bartrès (situé à 5 km de Lourdes), chez Marie Laguë, une fermière amie de la famille. De septembre 1857 à janvier 1858, Bernadette y veille sur deux jeunes enfants, assure le ménage, les corvées d’eau et de bois et garde les moutons. À quatorze ans, ne sachant toujours ni lire ni écrire, elle demande à son père l’autorisation de quitter Bartrès pour revenir au « cachot », afin de suivre à Lourdes les leçons du catéchisme paroissial pour pouvoir au plus tôt recevoir la communion. Le 21 janvier 1858, Bernadette revient au « cachot » à Lourdes retrouver les siens. À partir de janvier, elle ira à l’Hospice des sœurs, qui font aussi école (les sœurs de l’instruction chrétienne de Nevers). Elle fera sa première communion le 3 juin 1858 durant les apparitions. Bernadette témoigne d’apparitions de la Vierge à partir de 1858. Lors de sa neuvième apparition, elle suit les indications de la Vierge et découvre une source d’eau au pied de la grotte de Massabielle, à Lourdes. Entre le 11 février et le 16 juillet 1858, la Vierge lui apparaîtra dix-huit fois.
Apparitions :
1. Jeudi 11 février 1858. Avec sa sœur Marie (1846-1892), dite Toinette et une amie Jeanne Abadie, Bernadette se rend le long du Gave pour ramasser des os et du bois mort, afin d’acheter un peu de pain pour survivre. Du fait de sa santé précaire, elle hésite à traverser le gave, gelée, comme sa sœur et son amie. Elle est alors surprise par un bruit et lève la tête vers la grotte de Massabielle : « J’aperçus une dame vêtue de blanc : elle portait une robe blanche, un voile blanc également, une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied ». Bernadette récite une prière, la dame disparaît.
2. Dimanche 14 février 1858. Ses parents interdisent à Bernadette de retourner à la grotte. Elle insiste et ils cèdent. Sur place, elle récite des chapelets et voit apparaître la dame. Elle lui jette de l’eau bénite. La dame sourit, incline la tête et disparaît.
3. Jeudi 18 février 1858. Bernadette, sous la pression d’une dame de la bourgeoisie lourdaise, demande à la dame de lui écrire son nom. Celle-ci lui répond : « Ce n’est pas nécessaire ». Puis elle ajoute « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde mais dans l’autre. Voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant quinze jours ? »
4. Vendredi 19 février 1858. Bernadette vient à la Grotte avec un cierge béni et allumé (ce qui est devenu, depuis, une coutume). La dame apparaît brièvement.
5. Samedi 20 février 1858. La dame apprend une prière personnelle à Bernadette qui, à la fin de sa vision, est saisie d’une grande tristesse.
6. Dimanche 21 février 1858. Une centaine de personnes accompagnent Bernadette. La dame se présente (à Bernadette seule) et le commissaire de police Jacomet l’interroge sur ce qu’elle a vu. Bernadette se contente de répéter : « aquerò » (cela).
7. Mardi 23 février 1858. Accompagnée de cent cinquante personnes, Bernadette se rend à la grotte où l’apparition lui révèle un secret « rien que pour elle ».
8. Mercredi 24 février 1858. La dame transmet un message à Bernadette : « Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! Priez Dieu pour les pécheurs ! Allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs ! ».
9. Jeudi 25 février 1858. Trois cents personnes sont présentes. Bernadette explique que la dame lui demande de boire à la source : « Allez boire à la fontaine et vous y laver. Vous mangerez de cette herbe qui est là. ». Bernadette racontera plus tard : « Je ne trouvai qu’un peu d’eau vaseuse. Au quatrième essai je pus boire. ». La foule l’accuse d’être folle et elle répond : « C’est pour les pécheurs ».
10. Samedi 27 février 1858. Huit cents personnes accompagnent Bernadette. L’Apparition reste silencieuse, Bernadette boit l’eau.
11. Dimanche 28 février 1858. Deux mille personnes assistent à l’extase de Bernadette, qui prie, baise la terre et rampe sur les genoux. Le juge Ribes la menace de prison.
12. Lundi 1er mars 1858. Mille cinq cents personnes accompagnent Bernadette, dont, pour la première fois, un prêtre. La même nuit, Catherine Latapie, une amie de Bernadette, se rend à la Grotte et trempe son bras déboîté dans l’eau de la source : son bras et sa main retrouvent toute leur souplesse.
13. Mardi 2 mars 1858. La foule est très importante. La dame demande à Bernadette : « Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici en procession et qu’on y bâtisse une chapelle ». L’abbé Peyramale, curé de Lourdes, veut connaître le nom de la dame et exige en sus une preuve précise : il veut voir fleurir le rosier/églantier de la Grotte en plein hiver.
14. Mercredi 3 mars 1858. Trois mille personnes accompagnent Bernadette. La vision ne vient pas. Plus tard, Bernadette se sent appelée et retourne à la grotte où elle demande son nom à la Dame qui lui répond par un sourire. Le curé Peyramale insiste : « Si la Dame désire vraiment une chapelle, qu’elle dise son nom et qu’elle fasse fleurir le rosier de la Grotte ».
15. Jeudi 4 mars 1858. Environ huit mille personnes attendent un miracle à la grotte. La vision est silencieuse. Pendant vingt jours, Bernadette ne ressent plus l’invitation à se rendre à la grotte.
16. Jeudi 25 mars 1858. L’apparition se montre à Bernadette et dit en Gascon bigourdan — la langue que parlait Bernadette —, levant les yeux au ciel et joignant ses mains : « Que soy era immaculada councepciou ». Bernadette retient ces mots, qu’elle ne comprend pas, et court les dire au curé, qui est troublé : quatre ans plus tôt, le pape Pie IX a fait de l’"Immaculée Conception de Marie" un dogme et Bernadette dit ignorer qu’elle désigne la Vierge. Le rosier n’a toujours pas fleuri.
17. Mercredi 7 avril 1858. Le docteur Douzous constate que la flamme du cierge que tient Bernadette pendant l’apparition entoure sa main sans la brûler.
18. Jeudi 16 juillet 1858. C’est la dernière apparition. Une palissade interdit l’accès à la grotte. Bernadette franchit le gave et voit la vierge exactement comme si elle se trouvait devant la grotte.
Le 28 juillet 1858, soit douze jours seulement après la dernière apparition, Mgr Laurence, évêque de Tarbes, réunit une commission d’enquête destinée à établir le crédit que l’Église doit apporter aux affirmations de Bernadette Soubirous. Cette commission est chargée de vérifier la validité des « miracles » annoncés, en recueillant des témoignages divers et les avis de scientifiques ou de gens d’Église. Elle est aussi chargée d’interroger Bernadette, dont la sincérité semblera « incontestable » à l’évêque : « Qui n’admire, en l’approchant, la simplicité, la candeur, la modestie de cette enfant ? Elle ne parle que quand on l’interroge; alors elle raconte tout sans affectation, avec une ingénuité touchante, et, aux nombreuses questions qu’on lui adresse, elle fait, sans hésiter, des réponses nettes, précises, pleines d’à-propos, empreintes d’une forte conviction ». Le fait que la jeune fille répète des mots dits par la Vierge qu’elle ne pouvait (pense-t-on alors) pas connaître eu égard à son manque d’instruction, sera un argument décisif.
Entre-temps, la foule des pèlerins venant voir la grotte et y demander de l’aide à Marie ne cesse de croître. Il vient des gens de toute l’Europe et de nouveaux témoignages de miracles s’accumulent. « Si l’on doit juger l’arbre par ses fruits, nous pouvons dire que l’apparition racontée par la jeune fille est surnaturelle et divine; car elle a produit des effets surnaturels et divins ».
Quatre ans plus tard, le 18 janvier 1862, l’évêque rend son avis — favorable : « Nous jugeons que l’Immaculée Marie, Mère de Dieu, a réellement apparu à Bernadette Soubirous, le 11 février 1858 et les jours suivants, au nombre de dix-huit fois, dans la grotte de Massabielle, près de la ville de Lourdes; que cette apparition revêt tous les caractères de la vérité, et que les fidèles sont fondés à la croire certaine. Nous soumettons humblement notre jugement au Jugement du Souverain Pontife, qui est chargé de gouverner l’Église universelle ». Bernadette avait 14 ans, lors des Apparitions.
C’est ainsi que Lourdes, modeste chef-lieu des Pyrénées, soigneusement évité par le tourisme thermal alors en pleine explosion — son eau n’avait pas les propriétés curatives attribuées à celles de Luchon, Cauterets ou Bagnères-de-Bigorre — est vite devenue la ville touristique la plus fréquentée de la région. Un fait souvent oublié : à Garaison (aujourd’hui, Monléon-Magnoac, à 70 km de Lourdes), une jeune fille nommée Anglèze de Sagasan avait affirmé avoir entendu la vierge lui demander de construire une chapelle près de la source. Cela se passait vers 1520. La chapelle a bien été construite et la ville a été un lieu de dévotion et de tourisme religieux aux siècles suivants.
Bernadette souhaitait faire sa communion et pour cela, elle devait apprendre à lire et à écrire en français. Elle est donc admise à "l’école des indigents", à l’hospice de Lourdes, tenu depuis 1836 par les Sœurs de la Charité de Nevers. Là, elle s’instruit, apprend à lire et apprend le catéchisme et un métier. Les observateurs de l’époque notent que son recueillement en prière est impressionnant, mais qu’elle est aussi gaie, enjouée, espiègle et plutôt autoritaire avec ses compagnes — qui l’apprécient néanmoins beaucoup. Après réflexion, elle choisit la congrégation des Sœurs de la charité de Nevers pour vivre son désir de vie religieuse. La Maison-Mère de la congrégation est à Nevers. Avec ses supérieures, elle est d’une obéissance à toute épreuve, comme en témoigne une anecdote : on avait interdit à Bernadette de retourner à la grotte et on lui demanda : « Si la Vierge t’ordonnait d’y aller, que ferais-tu ? ». Bernadette répondit : « Je reviendrais demander la permission à Monsieur le Curé ».
À l’extérieur, on commence à rendre un inquiétant culte à la jeune bigourdane. Sa photo s’achète, les journaux parlent d’elle, on veut la voir. Le plus sage est de l’éloigner de Lourdes. Certaines personnes, comme l’essayiste britannique Ruth Harris (Lourdes. La grande histoire des apparitions, des pèlerinages et des guérisons, Jean-Claude Lattès, 2001), n’hésitent pas à affirmer que Bernadette devait en quelque sorte « disparaître » de son vivant afin que l’Église puisse maîtriser totalement la capitalisation des miracles lourdais.
Pour une jeune fille sans dot, la vie de sœur était difficilement envisageable, mais Bernadette est désormais célèbre et divers couvents sont prêts à l’accueillir.
Elle quitte donc les Pyrénées, qu’elle ne reverra jamais. Elle rejoint le 7 juillet 1866, la congrégation des Sœurs de la Charité à Nevers. Elle y reste treize années pendant lesquelles elle sera traitée sans égards spéciaux. Elle occupe les postes d’aide-infirmière, de responsable de l’infirmerie et de sacristine. Les quatre dernières années, elle est surtout malade.
Atteinte d’une tuberculose osseuse et souffrant de son asthme chronique contracté à l’âge de 11 ans, lors de la grande épidémie de choléra dans les Hautes-Pyrénées, elle meurt le 16 avril 1879 à Nevers, à l’âge de 35 ans.
Pour les besoins du procès en canonisation, son corps doit être reconnu. Son cercueil sera ouvert 3 fois et son corps retrouvé intact.
Elle repose depuis 1925 dans une châsse de verre et de bronze dans la chapelle de l’Espace Bernadette à Nevers. Lors des exhumations, son corps fut lavé et le contact avec les "détergents" avait noirci sa peau : le corps de la vénérable Bernadette est intact, le squelette complet, les muscles atrophiés mais bien conservés; la peau parcheminée paraît seule avoir subi l’humidité du cercueil. Elle a pris une teinte grisâtre et est recouverte de quelques moisissures et d’une certaine quantité de cristaux de sels calcaires (…) (Dr Talon et Dr Comte, chargés de l’examen du corps après 1923), cités par Dominique Lormier dans Bernadette Soubirous, éd. CMD, 1999. Dans le même livre, on apprend que quelques années plus tard, la peau de Bernadette a noirci. Le visage de Bernadette et ses mains ont donc été recouverts d’un très fin masque de cire pour la présentation publique.
Bernadette Soubirous a été béatifiée le 14 juin 1925 puis canonisée le 8 décembre 1933 par le pape Pie XI. Le sanctuaire de Lourdes accueille environ six millions de personnes chaque année.
 Bernadette SOUBIROUS, de son vrai nom Marie-Bernarde Soubirous (Maria Bernada Sobeirons), est née le 7 janvier 1844 au Moulin de Boly à Lourdes et décédée le 16 avril 1879 à Nevers, à l’âge de 35 ans. Elle est célèbre pour avoir vu des apparitions de la Vierge dans la grotte de Massabielle, de sa ville natale. Ses parents, François Soubirous (1807-1871) et Louise Castérot (1825-1866), exploitent le moulin de Boly, où elle est née, jusqu’en 1854. Les Soubirous qui avaient, dit-on, fait un mariage d’amour, ont eu au total neuf enfants dont cinq sont morts en bas-âge. Bernadette est l’aînée. À cette date, l’entreprise familiale est ruinée (trop artisanale pour cette époque d’industrialisation, et sans doute mal gérée). Bernadette connaît la faim et la maladie, elle sait à peine lire et écrire. De santé fragile, notamment asthmatique, elle paraît moins que son âge. Elle est par ailleurs jolie fille, selon les témoignages de l’époque et comme en attestent les photographies qui ont été prises d’elle. Son sentiment religieux est déjà très fort même si elle ignore à peu près tout du catéchisme (« si la Sainte Vierge m’a choisie, c’est parce que j’étais la plus ignorante ! » dira-t-elle plus tard). En février 1857, les Soubirous déménagent pour une cellule de l’ancienne prison de la rue Haute, surnommée « Le cachot » (que l’on peut visiter actuellement), et où ils logent à six dans 3,77 x 4,40m. En mars 1857, François Soubirous est accusé, et apparemment à tort, du vol de deux sacs de farine. Il est envoyé en prison. La famille Soubirous est dans une période de détresse noire. Bernadette, qui a déjà treize ans, sait à peine lire et écrire. Sa santé est encore fragilisée par la faim et la misère et ses parents décident de l’envoyer chez sa marraine et tante, Bernarde Castérot (1823-1907), qui l’emploie comme servante à la maison et au comptoir de son cabaret. Elle séjournera aussi longuement à Bartrès (situé à 5 km de Lourdes), chez Marie Laguë, une fermière amie de la famille. De septembre 1857 à janvier 1858, Bernadette y veille sur deux jeunes enfants, assure le ménage, les corvées d’eau et de bois et garde les moutons. À quatorze ans, ne sachant toujours ni lire ni écrire, elle demande à son père l’autorisation de quitter Bartrès pour revenir au « cachot », afin de suivre à Lourdes les leçons du catéchisme paroissial pour pouvoir au plus tôt recevoir la communion. Le 21 janvier 1858, Bernadette revient au « cachot » à Lourdes retrouver les siens. À partir de janvier, elle ira à l’Hospice des sœurs, qui font aussi école (les sœurs de l’instruction chrétienne de Nevers). Elle fera sa première communion le 3 juin 1858 durant les apparitions. Bernadette témoigne d’apparitions de la Vierge à partir de 1858. Lors de sa neuvième apparition, elle suit les indications de la Vierge et découvre une source d’eau au pied de la grotte de Massabielle, à Lourdes. Entre le 11 février et le 16 juillet 1858, la Vierge lui apparaîtra dix-huit fois.
Bernadette SOUBIROUS, de son vrai nom Marie-Bernarde Soubirous (Maria Bernada Sobeirons), est née le 7 janvier 1844 au Moulin de Boly à Lourdes et décédée le 16 avril 1879 à Nevers, à l’âge de 35 ans. Elle est célèbre pour avoir vu des apparitions de la Vierge dans la grotte de Massabielle, de sa ville natale. Ses parents, François Soubirous (1807-1871) et Louise Castérot (1825-1866), exploitent le moulin de Boly, où elle est née, jusqu’en 1854. Les Soubirous qui avaient, dit-on, fait un mariage d’amour, ont eu au total neuf enfants dont cinq sont morts en bas-âge. Bernadette est l’aînée. À cette date, l’entreprise familiale est ruinée (trop artisanale pour cette époque d’industrialisation, et sans doute mal gérée). Bernadette connaît la faim et la maladie, elle sait à peine lire et écrire. De santé fragile, notamment asthmatique, elle paraît moins que son âge. Elle est par ailleurs jolie fille, selon les témoignages de l’époque et comme en attestent les photographies qui ont été prises d’elle. Son sentiment religieux est déjà très fort même si elle ignore à peu près tout du catéchisme (« si la Sainte Vierge m’a choisie, c’est parce que j’étais la plus ignorante ! » dira-t-elle plus tard). En février 1857, les Soubirous déménagent pour une cellule de l’ancienne prison de la rue Haute, surnommée « Le cachot » (que l’on peut visiter actuellement), et où ils logent à six dans 3,77 x 4,40m. En mars 1857, François Soubirous est accusé, et apparemment à tort, du vol de deux sacs de farine. Il est envoyé en prison. La famille Soubirous est dans une période de détresse noire. Bernadette, qui a déjà treize ans, sait à peine lire et écrire. Sa santé est encore fragilisée par la faim et la misère et ses parents décident de l’envoyer chez sa marraine et tante, Bernarde Castérot (1823-1907), qui l’emploie comme servante à la maison et au comptoir de son cabaret. Elle séjournera aussi longuement à Bartrès (situé à 5 km de Lourdes), chez Marie Laguë, une fermière amie de la famille. De septembre 1857 à janvier 1858, Bernadette y veille sur deux jeunes enfants, assure le ménage, les corvées d’eau et de bois et garde les moutons. À quatorze ans, ne sachant toujours ni lire ni écrire, elle demande à son père l’autorisation de quitter Bartrès pour revenir au « cachot », afin de suivre à Lourdes les leçons du catéchisme paroissial pour pouvoir au plus tôt recevoir la communion. Le 21 janvier 1858, Bernadette revient au « cachot » à Lourdes retrouver les siens. À partir de janvier, elle ira à l’Hospice des sœurs, qui font aussi école (les sœurs de l’instruction chrétienne de Nevers). Elle fera sa première communion le 3 juin 1858 durant les apparitions. Bernadette témoigne d’apparitions de la Vierge à partir de 1858. Lors de sa neuvième apparition, elle suit les indications de la Vierge et découvre une source d’eau au pied de la grotte de Massabielle, à Lourdes. Entre le 11 février et le 16 juillet 1858, la Vierge lui apparaîtra dix-huit fois.Apparitions :
1. Jeudi 11 février 1858. Avec sa sœur Marie (1846-1892), dite Toinette et une amie Jeanne Abadie, Bernadette se rend le long du Gave pour ramasser des os et du bois mort, afin d’acheter un peu de pain pour survivre. Du fait de sa santé précaire, elle hésite à traverser le gave, gelée, comme sa sœur et son amie. Elle est alors surprise par un bruit et lève la tête vers la grotte de Massabielle : « J’aperçus une dame vêtue de blanc : elle portait une robe blanche, un voile blanc également, une ceinture bleue et une rose jaune sur chaque pied ». Bernadette récite une prière, la dame disparaît.
2. Dimanche 14 février 1858. Ses parents interdisent à Bernadette de retourner à la grotte. Elle insiste et ils cèdent. Sur place, elle récite des chapelets et voit apparaître la dame. Elle lui jette de l’eau bénite. La dame sourit, incline la tête et disparaît.
3. Jeudi 18 février 1858. Bernadette, sous la pression d’une dame de la bourgeoisie lourdaise, demande à la dame de lui écrire son nom. Celle-ci lui répond : « Ce n’est pas nécessaire ». Puis elle ajoute « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde mais dans l’autre. Voulez-vous avoir la grâce de venir ici pendant quinze jours ? »
4. Vendredi 19 février 1858. Bernadette vient à la Grotte avec un cierge béni et allumé (ce qui est devenu, depuis, une coutume). La dame apparaît brièvement.
5. Samedi 20 février 1858. La dame apprend une prière personnelle à Bernadette qui, à la fin de sa vision, est saisie d’une grande tristesse.
6. Dimanche 21 février 1858. Une centaine de personnes accompagnent Bernadette. La dame se présente (à Bernadette seule) et le commissaire de police Jacomet l’interroge sur ce qu’elle a vu. Bernadette se contente de répéter : « aquerò » (cela).
7. Mardi 23 février 1858. Accompagnée de cent cinquante personnes, Bernadette se rend à la grotte où l’apparition lui révèle un secret « rien que pour elle ».
8. Mercredi 24 février 1858. La dame transmet un message à Bernadette : « Pénitence ! Pénitence ! Pénitence ! Priez Dieu pour les pécheurs ! Allez baiser la terre en pénitence pour les pécheurs ! ».
9. Jeudi 25 février 1858. Trois cents personnes sont présentes. Bernadette explique que la dame lui demande de boire à la source : « Allez boire à la fontaine et vous y laver. Vous mangerez de cette herbe qui est là. ». Bernadette racontera plus tard : « Je ne trouvai qu’un peu d’eau vaseuse. Au quatrième essai je pus boire. ». La foule l’accuse d’être folle et elle répond : « C’est pour les pécheurs ».
10. Samedi 27 février 1858. Huit cents personnes accompagnent Bernadette. L’Apparition reste silencieuse, Bernadette boit l’eau.
11. Dimanche 28 février 1858. Deux mille personnes assistent à l’extase de Bernadette, qui prie, baise la terre et rampe sur les genoux. Le juge Ribes la menace de prison.
12. Lundi 1er mars 1858. Mille cinq cents personnes accompagnent Bernadette, dont, pour la première fois, un prêtre. La même nuit, Catherine Latapie, une amie de Bernadette, se rend à la Grotte et trempe son bras déboîté dans l’eau de la source : son bras et sa main retrouvent toute leur souplesse.
13. Mardi 2 mars 1858. La foule est très importante. La dame demande à Bernadette : « Allez dire aux prêtres qu’on vienne ici en procession et qu’on y bâtisse une chapelle ». L’abbé Peyramale, curé de Lourdes, veut connaître le nom de la dame et exige en sus une preuve précise : il veut voir fleurir le rosier/églantier de la Grotte en plein hiver.
14. Mercredi 3 mars 1858. Trois mille personnes accompagnent Bernadette. La vision ne vient pas. Plus tard, Bernadette se sent appelée et retourne à la grotte où elle demande son nom à la Dame qui lui répond par un sourire. Le curé Peyramale insiste : « Si la Dame désire vraiment une chapelle, qu’elle dise son nom et qu’elle fasse fleurir le rosier de la Grotte ».
15. Jeudi 4 mars 1858. Environ huit mille personnes attendent un miracle à la grotte. La vision est silencieuse. Pendant vingt jours, Bernadette ne ressent plus l’invitation à se rendre à la grotte.
16. Jeudi 25 mars 1858. L’apparition se montre à Bernadette et dit en Gascon bigourdan — la langue que parlait Bernadette —, levant les yeux au ciel et joignant ses mains : « Que soy era immaculada councepciou ». Bernadette retient ces mots, qu’elle ne comprend pas, et court les dire au curé, qui est troublé : quatre ans plus tôt, le pape Pie IX a fait de l’"Immaculée Conception de Marie" un dogme et Bernadette dit ignorer qu’elle désigne la Vierge. Le rosier n’a toujours pas fleuri.
17. Mercredi 7 avril 1858. Le docteur Douzous constate que la flamme du cierge que tient Bernadette pendant l’apparition entoure sa main sans la brûler.
18. Jeudi 16 juillet 1858. C’est la dernière apparition. Une palissade interdit l’accès à la grotte. Bernadette franchit le gave et voit la vierge exactement comme si elle se trouvait devant la grotte.
Le 28 juillet 1858, soit douze jours seulement après la dernière apparition, Mgr Laurence, évêque de Tarbes, réunit une commission d’enquête destinée à établir le crédit que l’Église doit apporter aux affirmations de Bernadette Soubirous. Cette commission est chargée de vérifier la validité des « miracles » annoncés, en recueillant des témoignages divers et les avis de scientifiques ou de gens d’Église. Elle est aussi chargée d’interroger Bernadette, dont la sincérité semblera « incontestable » à l’évêque : « Qui n’admire, en l’approchant, la simplicité, la candeur, la modestie de cette enfant ? Elle ne parle que quand on l’interroge; alors elle raconte tout sans affectation, avec une ingénuité touchante, et, aux nombreuses questions qu’on lui adresse, elle fait, sans hésiter, des réponses nettes, précises, pleines d’à-propos, empreintes d’une forte conviction ». Le fait que la jeune fille répète des mots dits par la Vierge qu’elle ne pouvait (pense-t-on alors) pas connaître eu égard à son manque d’instruction, sera un argument décisif.
Entre-temps, la foule des pèlerins venant voir la grotte et y demander de l’aide à Marie ne cesse de croître. Il vient des gens de toute l’Europe et de nouveaux témoignages de miracles s’accumulent. « Si l’on doit juger l’arbre par ses fruits, nous pouvons dire que l’apparition racontée par la jeune fille est surnaturelle et divine; car elle a produit des effets surnaturels et divins ».
Quatre ans plus tard, le 18 janvier 1862, l’évêque rend son avis — favorable : « Nous jugeons que l’Immaculée Marie, Mère de Dieu, a réellement apparu à Bernadette Soubirous, le 11 février 1858 et les jours suivants, au nombre de dix-huit fois, dans la grotte de Massabielle, près de la ville de Lourdes; que cette apparition revêt tous les caractères de la vérité, et que les fidèles sont fondés à la croire certaine. Nous soumettons humblement notre jugement au Jugement du Souverain Pontife, qui est chargé de gouverner l’Église universelle ». Bernadette avait 14 ans, lors des Apparitions.
C’est ainsi que Lourdes, modeste chef-lieu des Pyrénées, soigneusement évité par le tourisme thermal alors en pleine explosion — son eau n’avait pas les propriétés curatives attribuées à celles de Luchon, Cauterets ou Bagnères-de-Bigorre — est vite devenue la ville touristique la plus fréquentée de la région. Un fait souvent oublié : à Garaison (aujourd’hui, Monléon-Magnoac, à 70 km de Lourdes), une jeune fille nommée Anglèze de Sagasan avait affirmé avoir entendu la vierge lui demander de construire une chapelle près de la source. Cela se passait vers 1520. La chapelle a bien été construite et la ville a été un lieu de dévotion et de tourisme religieux aux siècles suivants.
Bernadette souhaitait faire sa communion et pour cela, elle devait apprendre à lire et à écrire en français. Elle est donc admise à "l’école des indigents", à l’hospice de Lourdes, tenu depuis 1836 par les Sœurs de la Charité de Nevers. Là, elle s’instruit, apprend à lire et apprend le catéchisme et un métier. Les observateurs de l’époque notent que son recueillement en prière est impressionnant, mais qu’elle est aussi gaie, enjouée, espiègle et plutôt autoritaire avec ses compagnes — qui l’apprécient néanmoins beaucoup. Après réflexion, elle choisit la congrégation des Sœurs de la charité de Nevers pour vivre son désir de vie religieuse. La Maison-Mère de la congrégation est à Nevers. Avec ses supérieures, elle est d’une obéissance à toute épreuve, comme en témoigne une anecdote : on avait interdit à Bernadette de retourner à la grotte et on lui demanda : « Si la Vierge t’ordonnait d’y aller, que ferais-tu ? ». Bernadette répondit : « Je reviendrais demander la permission à Monsieur le Curé ».
À l’extérieur, on commence à rendre un inquiétant culte à la jeune bigourdane. Sa photo s’achète, les journaux parlent d’elle, on veut la voir. Le plus sage est de l’éloigner de Lourdes. Certaines personnes, comme l’essayiste britannique Ruth Harris (Lourdes. La grande histoire des apparitions, des pèlerinages et des guérisons, Jean-Claude Lattès, 2001), n’hésitent pas à affirmer que Bernadette devait en quelque sorte « disparaître » de son vivant afin que l’Église puisse maîtriser totalement la capitalisation des miracles lourdais.
Pour une jeune fille sans dot, la vie de sœur était difficilement envisageable, mais Bernadette est désormais célèbre et divers couvents sont prêts à l’accueillir.
Elle quitte donc les Pyrénées, qu’elle ne reverra jamais. Elle rejoint le 7 juillet 1866, la congrégation des Sœurs de la Charité à Nevers. Elle y reste treize années pendant lesquelles elle sera traitée sans égards spéciaux. Elle occupe les postes d’aide-infirmière, de responsable de l’infirmerie et de sacristine. Les quatre dernières années, elle est surtout malade.
Atteinte d’une tuberculose osseuse et souffrant de son asthme chronique contracté à l’âge de 11 ans, lors de la grande épidémie de choléra dans les Hautes-Pyrénées, elle meurt le 16 avril 1879 à Nevers, à l’âge de 35 ans.
Pour les besoins du procès en canonisation, son corps doit être reconnu. Son cercueil sera ouvert 3 fois et son corps retrouvé intact.
Elle repose depuis 1925 dans une châsse de verre et de bronze dans la chapelle de l’Espace Bernadette à Nevers. Lors des exhumations, son corps fut lavé et le contact avec les "détergents" avait noirci sa peau : le corps de la vénérable Bernadette est intact, le squelette complet, les muscles atrophiés mais bien conservés; la peau parcheminée paraît seule avoir subi l’humidité du cercueil. Elle a pris une teinte grisâtre et est recouverte de quelques moisissures et d’une certaine quantité de cristaux de sels calcaires (…) (Dr Talon et Dr Comte, chargés de l’examen du corps après 1923), cités par Dominique Lormier dans Bernadette Soubirous, éd. CMD, 1999. Dans le même livre, on apprend que quelques années plus tard, la peau de Bernadette a noirci. Le visage de Bernadette et ses mains ont donc été recouverts d’un très fin masque de cire pour la présentation publique.
Bernadette Soubirous a été béatifiée le 14 juin 1925 puis canonisée le 8 décembre 1933 par le pape Pie XI. Le sanctuaire de Lourdes accueille environ six millions de personnes chaque année.
TAILHADE Laurent (1854-1919)
Écrivain, poète satirique et libertaire, journaliste
 Laurent TAILHADE, né à Tarbes le 16 avril 1854, rue Brauhauban, et mort le 2 novembre 1919 à Combs-la-Ville (Seine-et-Oise), cet artiste pamphlétaire et anarchiste défraya souvent la chronique par ses écrits audacieux. Il grandit entre son père, Félix Tailhade, magistrat conservateur, et sa mère, la pieuse Ernestine Jacomet. Durant sa vie il usa de nombreux pseudonymes : Azède, El Cachetero, Dom Junipérien, Lorenzaccio, Patte-Pelue, Renzi, Tybalt. Monarchiste avant de devenir anarchiste, anticlérical et dreyfusard, il a été mis en prison pour un article contre le tsar Nicolas II. Personnalité fracassante du Paris des Lettres de l’avant-guerre, il était l’ami de Verlaine, Mallarmé, Jaurès, Sacha Guitry. Il fut un écrivain influencé par les Parnassiens. Menant une vie de bohême à Paris, il devint l'ami de Jean Moréas ou encore Samain. Ses textes polémiques ne cachent pas ses opinions anarchistes et anticléricales. Il se fait connaître, en 1893, en proclamant, à travers un poème, son admiration pour l'attentat anarchiste de Vaillant, ce qui ne manqua pas de scandaliser la bourgeoisie parisienne. Ses recueils les plus célèbres sont : Au Pays du mufle (1891) et Imbéciles et gredins (1900). Il est aussi l'auteur de La Noire Idole, publié aux éditions Mille et Une nuits en 2001. 1er mai 1865 - Laurent Tailhade entre au collège Sainte-Marie de Toulouse (aujourd'hui Le Caousou) tenu par les jésuites. 1870-1873 - Études classiques au lycée de Pau. 1873-1874 - Études au lycée de Tarbes. Dans la cour de récréation, surveillée par le pion Théophile Delcassé, futur ministre de la IIIe République, Tailhade croise le jeune Jules Laforgue, de six ans son cadet. 1873 - Tailhade est couronné une première fois aux Jeux Floraux : il obtient une violette pour " Les Citharistes de la rue ". 1874 - Obtention du baccalauréat après des études plutôt médiocres. Seconde distinction aux Jeux Floraux pour " Vers l'infini " et " Le Bouquet de violettes ". Tailhade entre à la faculté de Droit de Toulouse où il se lie avec Etienne Bladé puis avec son père, Jean-François Bladé. Influencé par son professeur, Ernest Constans, futur ministre de l'Intérieur, il est alors républicain. 1875-1876 - Avec son ami Henri Maigrot, le futur caricaturiste Henriot et père du poète Émile Henriot, il est l'un des deux piliers de L'Echo des Trouvères, élégant hebdomadaire littéraire de Toulouse. 1877 - Tailhade rencontre le Baron René Toussaint, alors officier, qui fera une carrière dans le journalisme et la littérature sous le pseudonyme de René Maizeroy. Il servira de modèle à son ami Guy de Maupassant pour le Duroy de Bel-Ami. 1878 - Premier séjour à Paris, où Armand Silvestre le présente à Théodore de Banville. 6 janvier 1879 - Il épouse Marie-Agathe Eugénie de Gourcuff. Le couple s'installe à Bagnères-de-Bigorre, tandis que Tailhade poursuit de timides études à Toulouse. 16 septembre 1879 - Naissance de leur fils Léopold, qui ne survit que cinq mois. Avril 1880 - Parution chez Alphonse Lemerre, l'éditeur des Parnassiens, de son premier volume de vers, " Le Jardin des Rêves ". Dédié à Armand Silvestre, il est préfacé par Théodore de Banville. Tailhade demeure alors à Paris jusqu'en mai de cette année. Il approche alors Heredia, Coppée et Louis-Xavier de Ricard. Juin 1880 - De retour à Bagnères-de-Bigorre, Tailhade fréquente les milieux monarchistes de la ville. Il se pose en défenseur de l'Église catholique et commence à collaborer au journal conservateur " L'Écho des Vallées " sous le pseudonyme de Lorenzaccio. 1881-1883 - Il côtoie de loin le milieu des Hydropathes. Collaboration à L'Artiste, à La Jeune France. 1882 - Un Dizain de Sonnets ", plaquette publiée chez Alphonse Lemerre. 20 septembre 1882 - Premier duel connu de Laurent Tailhade avec l'un des responsables du Casino de Bagnères-de-Bigorre. Le premier d'une longue série qui approchera les 30 ! Tailhade flambe alors énormément au casino. 29 janvier 1883 - Décès de la jeune épouse de Tailhade. Elle n'a pas 25 ans. 1883 - Tailhade s'installe à Paris. Il fréquente Le Chat Noir, les Félibres parisiens et se lie d'amitié avec Joseph Gayda qui l'entraîne dans le cercle des Zutistes, à la Maison de Bois, située rue de Rennes. Là, il rencontre Charles Cros, le gourou des lieux, ainsi que toute la jeune bohème littéraire : Alphonse Allais, Louis Marsolleau, Charles Vignier, Jean Moréas, Edmond Haraucourt, Jean Ajalbert, Marie Krysinska, Fernand Icres, Georges d'Esparbès, Léo Trézenik et encore Ernest Raynaud, l'un de ses amis les plus fidèles. 1884-1885 - Il s'installe à l'hôtel Foyot. Il rencontre Verlaine et Mallarmé. Ses meilleurs amis sont alors Jean Lorrain, Jean Moréas, Stanislas de Guaita et Maurice Barrès. Viendront bientôt s'ajouter Victor Margueritte, Oscar Méténier et Félix Fénéon, Il collabore alors à Lutèce, au Chat Noir et à La Revue Indépendante. 1886-1887 - Son père, qui lui a coupé les vivres, l'oblige à rentrer à Bagnères-de-Bigorre, où sa famille lui a trouvé un nouveau parti en la personne de Mélanie Maruéjouls. Le mariage est célébré le 2 février 1886. C'est un véritable désastre. Tailhade, qui est devenu farouchement anticlérical, menace, avec un revolver, son épouse qui veut se rendre à la messe. La cohabitation ne tient pas un an. Le divorce est prononcé cinq ans plus tard. Été 1886 - Tailhade rédige seul une gazette intitulée " Le Courrier de la Saison ", puis " Le Paillasson ". La même année, il reprend la plupart de ses textes publiés ici et là dans " Bagnères - Thermal ". 1887 - Le 4 février 1887, Tailhade est initié en franc-maçonnerie à la loge L'Indépendance Française du Grand Orient de France à Toulouse, où il a repris des études de droit. Il regroupe alors autour de lui un cercle de disciples, parmi lesquels on trouve P.-B. Gheusi et Georges Fourest. 1888 - Tailhade revient définitivement à Paris. Parangon du poète décadent depuis Lutèce et " Les Déliquescences d'Adoré Floupette ", il collabore tout naturellement au Décadent d'Anatole Baju. Il y publie les premiers faux-Rimbaud avec la complicité de Raynaud et de Du Plessys. 1889-1890 - Il est l'un des premiers collaborateurs de La Plume, du Mercure de France et de L'Ermitage. Il fréquente Léon Bloy, Papus, Edouard Dubus, Henry d'Argis, Fernand Clerget, Mme Prévost-Roqueplan, la comtesse Diane de Beausacq, Marie de Maleissye... Le 12 juin 1889, en compagnie d'Albert Samain, il est le témoin du mariage de Rachilde avec Alfred Vallette. 1890 - Tailhade est incarcéré quatre jours à la prison de Sainte-Pélagie, suite à l'action intentée en justice par Gisèle d'Estoc. Georges Desplas, son avocat, le sort de ce mauvais pas. 1891 - Tailhade publie " Vitraux " chez Lemerre et " Au Pays du Mufle " chez Léon Vanier. Ce dernier recueil reprend ses ballades les plus assassines publiées au Mercure. 1892 - Début de l'amitié avec Edward Sansot. Le caractère homosexuel de leurs relations ne fait aucun doute. Cette même année, il est admis à la loge parisienne Les Amis Inséparables, dont il devient secrétaire l'année suivante. 1893 - Intense activité de conférencier (La Bodinière, Salle des Capucines, Salle des Sociétés Savantes...). Le 10 novembre il réitère sa conférence de la veille avant la représentation d' "Un Ennemi du Peuple" d'Ibsen au théâtre de l'œuvre. Ce petit chef d'œuvre de provocation déchaîne une véritable tempête dans la salle. Heureusement, ses partisans sont là pour le soutenir : Stéphane Mallarmé, Octave Mirbeau, Maurice Barrès, José-Maria de Heredia, Saint-Pol Roux, Rachilde, Paul Gauguin, Henry de Groux, Maurice Denis, Roger Marx, Francis Vielé-Griffin ... Le 9 décembre, au banquet de La Plume, apprenant l'attentat de Vaillant à la Chambre des Députés, il déclare au journaliste venu l'interroger : " Qu'importent les victimes si le geste est beau ! ". Il soulève un tollé général dans la presse. 1894 - Le 4 avril, une bombe, placée par une main anonyme sur le rebord d'une fenêtre, blesse grièvement Laurent Tailhade dînant au restaurant Foyot en compagnie de Julia Mialhe, qui partage alors sa vie. Il devra se faire énucléer quelques années plus tard. La presse se gausse de sa mésaventure et salue cette " bombe intelligente ". Seul Léon Bloy, Alfred Vallette et Jean Carrère montent au créneau pour prendre sa défense. Son maître, Stéphane Mallarmé, se précipite à son chevet, à l'hôpital de La Charité, où il demeure six semaines. A peine sorti de l'hôpital, Tailhade veut en découdre avec tous ceux qui l'ont insulté tandis qu'il était alité. Il expédie ses témoins, Stanislas de Guaita et Marcel Schwob aux quatre coins des rédactions de la presse parisienne. Afin d'affirmer publiquement son amitié à Tailhade, Sarah Bernhardt l'engage pour donner une conférence avant l'ultime représentation de Phèdre que la divine donne au théâtre de la Renaissance. A peine quinze jours après être sorti de l'hôpital, Tailhade déchaîne à nouveau la salle par ses provocations. Alfred Jarry est là qui jubile : il transcrira ces hauts faits dans un chapitre des " Gestes et Opinions du docteur Faustroll, pataphysicien ".
Laurent TAILHADE, né à Tarbes le 16 avril 1854, rue Brauhauban, et mort le 2 novembre 1919 à Combs-la-Ville (Seine-et-Oise), cet artiste pamphlétaire et anarchiste défraya souvent la chronique par ses écrits audacieux. Il grandit entre son père, Félix Tailhade, magistrat conservateur, et sa mère, la pieuse Ernestine Jacomet. Durant sa vie il usa de nombreux pseudonymes : Azède, El Cachetero, Dom Junipérien, Lorenzaccio, Patte-Pelue, Renzi, Tybalt. Monarchiste avant de devenir anarchiste, anticlérical et dreyfusard, il a été mis en prison pour un article contre le tsar Nicolas II. Personnalité fracassante du Paris des Lettres de l’avant-guerre, il était l’ami de Verlaine, Mallarmé, Jaurès, Sacha Guitry. Il fut un écrivain influencé par les Parnassiens. Menant une vie de bohême à Paris, il devint l'ami de Jean Moréas ou encore Samain. Ses textes polémiques ne cachent pas ses opinions anarchistes et anticléricales. Il se fait connaître, en 1893, en proclamant, à travers un poème, son admiration pour l'attentat anarchiste de Vaillant, ce qui ne manqua pas de scandaliser la bourgeoisie parisienne. Ses recueils les plus célèbres sont : Au Pays du mufle (1891) et Imbéciles et gredins (1900). Il est aussi l'auteur de La Noire Idole, publié aux éditions Mille et Une nuits en 2001. 1er mai 1865 - Laurent Tailhade entre au collège Sainte-Marie de Toulouse (aujourd'hui Le Caousou) tenu par les jésuites. 1870-1873 - Études classiques au lycée de Pau. 1873-1874 - Études au lycée de Tarbes. Dans la cour de récréation, surveillée par le pion Théophile Delcassé, futur ministre de la IIIe République, Tailhade croise le jeune Jules Laforgue, de six ans son cadet. 1873 - Tailhade est couronné une première fois aux Jeux Floraux : il obtient une violette pour " Les Citharistes de la rue ". 1874 - Obtention du baccalauréat après des études plutôt médiocres. Seconde distinction aux Jeux Floraux pour " Vers l'infini " et " Le Bouquet de violettes ". Tailhade entre à la faculté de Droit de Toulouse où il se lie avec Etienne Bladé puis avec son père, Jean-François Bladé. Influencé par son professeur, Ernest Constans, futur ministre de l'Intérieur, il est alors républicain. 1875-1876 - Avec son ami Henri Maigrot, le futur caricaturiste Henriot et père du poète Émile Henriot, il est l'un des deux piliers de L'Echo des Trouvères, élégant hebdomadaire littéraire de Toulouse. 1877 - Tailhade rencontre le Baron René Toussaint, alors officier, qui fera une carrière dans le journalisme et la littérature sous le pseudonyme de René Maizeroy. Il servira de modèle à son ami Guy de Maupassant pour le Duroy de Bel-Ami. 1878 - Premier séjour à Paris, où Armand Silvestre le présente à Théodore de Banville. 6 janvier 1879 - Il épouse Marie-Agathe Eugénie de Gourcuff. Le couple s'installe à Bagnères-de-Bigorre, tandis que Tailhade poursuit de timides études à Toulouse. 16 septembre 1879 - Naissance de leur fils Léopold, qui ne survit que cinq mois. Avril 1880 - Parution chez Alphonse Lemerre, l'éditeur des Parnassiens, de son premier volume de vers, " Le Jardin des Rêves ". Dédié à Armand Silvestre, il est préfacé par Théodore de Banville. Tailhade demeure alors à Paris jusqu'en mai de cette année. Il approche alors Heredia, Coppée et Louis-Xavier de Ricard. Juin 1880 - De retour à Bagnères-de-Bigorre, Tailhade fréquente les milieux monarchistes de la ville. Il se pose en défenseur de l'Église catholique et commence à collaborer au journal conservateur " L'Écho des Vallées " sous le pseudonyme de Lorenzaccio. 1881-1883 - Il côtoie de loin le milieu des Hydropathes. Collaboration à L'Artiste, à La Jeune France. 1882 - Un Dizain de Sonnets ", plaquette publiée chez Alphonse Lemerre. 20 septembre 1882 - Premier duel connu de Laurent Tailhade avec l'un des responsables du Casino de Bagnères-de-Bigorre. Le premier d'une longue série qui approchera les 30 ! Tailhade flambe alors énormément au casino. 29 janvier 1883 - Décès de la jeune épouse de Tailhade. Elle n'a pas 25 ans. 1883 - Tailhade s'installe à Paris. Il fréquente Le Chat Noir, les Félibres parisiens et se lie d'amitié avec Joseph Gayda qui l'entraîne dans le cercle des Zutistes, à la Maison de Bois, située rue de Rennes. Là, il rencontre Charles Cros, le gourou des lieux, ainsi que toute la jeune bohème littéraire : Alphonse Allais, Louis Marsolleau, Charles Vignier, Jean Moréas, Edmond Haraucourt, Jean Ajalbert, Marie Krysinska, Fernand Icres, Georges d'Esparbès, Léo Trézenik et encore Ernest Raynaud, l'un de ses amis les plus fidèles. 1884-1885 - Il s'installe à l'hôtel Foyot. Il rencontre Verlaine et Mallarmé. Ses meilleurs amis sont alors Jean Lorrain, Jean Moréas, Stanislas de Guaita et Maurice Barrès. Viendront bientôt s'ajouter Victor Margueritte, Oscar Méténier et Félix Fénéon, Il collabore alors à Lutèce, au Chat Noir et à La Revue Indépendante. 1886-1887 - Son père, qui lui a coupé les vivres, l'oblige à rentrer à Bagnères-de-Bigorre, où sa famille lui a trouvé un nouveau parti en la personne de Mélanie Maruéjouls. Le mariage est célébré le 2 février 1886. C'est un véritable désastre. Tailhade, qui est devenu farouchement anticlérical, menace, avec un revolver, son épouse qui veut se rendre à la messe. La cohabitation ne tient pas un an. Le divorce est prononcé cinq ans plus tard. Été 1886 - Tailhade rédige seul une gazette intitulée " Le Courrier de la Saison ", puis " Le Paillasson ". La même année, il reprend la plupart de ses textes publiés ici et là dans " Bagnères - Thermal ". 1887 - Le 4 février 1887, Tailhade est initié en franc-maçonnerie à la loge L'Indépendance Française du Grand Orient de France à Toulouse, où il a repris des études de droit. Il regroupe alors autour de lui un cercle de disciples, parmi lesquels on trouve P.-B. Gheusi et Georges Fourest. 1888 - Tailhade revient définitivement à Paris. Parangon du poète décadent depuis Lutèce et " Les Déliquescences d'Adoré Floupette ", il collabore tout naturellement au Décadent d'Anatole Baju. Il y publie les premiers faux-Rimbaud avec la complicité de Raynaud et de Du Plessys. 1889-1890 - Il est l'un des premiers collaborateurs de La Plume, du Mercure de France et de L'Ermitage. Il fréquente Léon Bloy, Papus, Edouard Dubus, Henry d'Argis, Fernand Clerget, Mme Prévost-Roqueplan, la comtesse Diane de Beausacq, Marie de Maleissye... Le 12 juin 1889, en compagnie d'Albert Samain, il est le témoin du mariage de Rachilde avec Alfred Vallette. 1890 - Tailhade est incarcéré quatre jours à la prison de Sainte-Pélagie, suite à l'action intentée en justice par Gisèle d'Estoc. Georges Desplas, son avocat, le sort de ce mauvais pas. 1891 - Tailhade publie " Vitraux " chez Lemerre et " Au Pays du Mufle " chez Léon Vanier. Ce dernier recueil reprend ses ballades les plus assassines publiées au Mercure. 1892 - Début de l'amitié avec Edward Sansot. Le caractère homosexuel de leurs relations ne fait aucun doute. Cette même année, il est admis à la loge parisienne Les Amis Inséparables, dont il devient secrétaire l'année suivante. 1893 - Intense activité de conférencier (La Bodinière, Salle des Capucines, Salle des Sociétés Savantes...). Le 10 novembre il réitère sa conférence de la veille avant la représentation d' "Un Ennemi du Peuple" d'Ibsen au théâtre de l'œuvre. Ce petit chef d'œuvre de provocation déchaîne une véritable tempête dans la salle. Heureusement, ses partisans sont là pour le soutenir : Stéphane Mallarmé, Octave Mirbeau, Maurice Barrès, José-Maria de Heredia, Saint-Pol Roux, Rachilde, Paul Gauguin, Henry de Groux, Maurice Denis, Roger Marx, Francis Vielé-Griffin ... Le 9 décembre, au banquet de La Plume, apprenant l'attentat de Vaillant à la Chambre des Députés, il déclare au journaliste venu l'interroger : " Qu'importent les victimes si le geste est beau ! ". Il soulève un tollé général dans la presse. 1894 - Le 4 avril, une bombe, placée par une main anonyme sur le rebord d'une fenêtre, blesse grièvement Laurent Tailhade dînant au restaurant Foyot en compagnie de Julia Mialhe, qui partage alors sa vie. Il devra se faire énucléer quelques années plus tard. La presse se gausse de sa mésaventure et salue cette " bombe intelligente ". Seul Léon Bloy, Alfred Vallette et Jean Carrère montent au créneau pour prendre sa défense. Son maître, Stéphane Mallarmé, se précipite à son chevet, à l'hôpital de La Charité, où il demeure six semaines. A peine sorti de l'hôpital, Tailhade veut en découdre avec tous ceux qui l'ont insulté tandis qu'il était alité. Il expédie ses témoins, Stanislas de Guaita et Marcel Schwob aux quatre coins des rédactions de la presse parisienne. Afin d'affirmer publiquement son amitié à Tailhade, Sarah Bernhardt l'engage pour donner une conférence avant l'ultime représentation de Phèdre que la divine donne au théâtre de la Renaissance. A peine quinze jours après être sorti de l'hôpital, Tailhade déchaîne à nouveau la salle par ses provocations. Alfred Jarry est là qui jubile : il transcrira ces hauts faits dans un chapitre des " Gestes et Opinions du docteur Faustroll, pataphysicien ".
1895 - Grâce à son ami Henry Bauër, Tailhade entre à L'Écho de Paris, où il signe ses articles du pseudonyme de Tybalt. Il y restera jusqu'en février 1897. Dans un article il dénonce l'antisémitisme des étudiants ; ce qui déchaîne une manifestation desdits grimauds devant son domicile. Par chance, il est absent. Il suit alors l'une des innombrables cures de démorphinisation qui feront de son existence un véritable calvaire. Suite à cet article, il se bat en duel le 29 juin contre Renaud d'Elissagaray, journaliste à L'Antijuif et à la Libre Parole. Tailhade est sérieusement blessé à la main. Huit jours auparavant il s'est battu contre Jules Bois qui deviendra peu après son ami. Le 2 juillet, il retourne sur le pré contre le président de l'Association des étudiants. 1896 - Collaboration au Voltaire, à La Revue Rouge et au Libertaire. Il fréquente très assidûment Madame Prévost-Roqueplan et sa fille Juliette à Montfort l'Amaury, où il retrouve avec déplaisir son rival Jehan Rictus. 1897 - Il quitte L'Écho de Paris, qui est devenu antidreyfusard, après avoir fait condamner le journal à une somme astronomique, suite à l'un de ses articles dénonçant la pédophilie de l'ensemble du clergé haut-pyrénéen. Il séjourne alors à Toulouse, où débute sa liaison avec Anne Osmont, poétesse, féministe et célèbre occultiste. Il collabore régulièrement à La Dépêche. L'été, comme souvent, il se rend à Saint-Sébastien pour assister aux corridas, spectacle dont il est très friand. 1898 - Tailhade entre dans le combat dreyfusard au côté de son maître Zola, qui ne fut pourtant pas toujours l'une de ses admirations. Il écrit dans L'Aurore et dans Les Droits de l'Homme. Les duels alors s'enchaînent sans répit. Le 8 juillet contre Raphaël Viau qui s'était payé sa tête dans La Libre Parole après l'altercation qui avait conduit la nationaliste Marie-Anne de Bovet à gifler Tailhade et ce dernier à lui répliquer en lui crachant au visage. Et surtout le 17 octobre, où un duel furieux l'opposa à son ancien compagnon, Maurice Barrès. Tailhade fut gravement blessé au bras par l'épée de Barrès. Cette même année, Yvette Guibert lui commande des chansons qu'il ne lui fera jamais. Publication de " Terre Latine " chez Lemerre. 1899 - Hospitalisé une nouvelle fois, Tailhade reçoit la visite d'Anatole France et d'Émile Zola qui tentent de lui trouver une situation stable dans la presse. La combinaison pour le faire entrer au Figaro échoue. Il collabore au Journal du Peuple, puis commence à écrire à La Petite République, journal socialiste, où il se lie d'amitié avec Jean Jaurès. Publication d' "A travers les Grouins" chez Stock. Les ballades sont féroces : elles rappellent les hauts faits de la lutte dreyfusiste menée par Tailhade et ses amis. 1900 - Collaboration au Petit Sou. Publication d' "Imbéciles et Gredins" à la Maison d'Art. 1901 - Le 17 janvier, Tailhade épouse Eugénie Pochon, sœur de son ami, Fernand Kolney. La mariée a vingt-deux ans de moins que l'époux. Les témoins sont Raoul d'Audiffret, Jacques de Boisjolin et Jean Jaurès. Publication de " la touffe de sauge " aux éditions de la Plume. Tailhade collabore au Français et à La Raison, périodique anticlérical. Mais c'est son article du Libertaire paru le 15 septembre 1901, intitulé " Le Triomphe de la Domesticité ", véritable appel au meurtre sur la personne du tsar, qui l'envoie tout droit à la prison de la Santé pour un an. La campagne menée par ses amis, Zola, Kahn, France, Mirbeau, Boès, Sembat, etc. abrègera son séjour de moitié. En prison, il termine sa traduction du « Satyricon de Pétrone » qui paraît chez Fasquelle l'année suivante. 1902 - Parution de " Discours Civiques " chez Stock. Différend matrimonial avec Ninette, sa femme, dans lequel Mme Prévost-Roqueplan joue un rôle que ne lui pardonnera pas Tailhade et qui sera à l'origine de la parution, deux ans plus tard, du " Salon de Madame Truphot " que l'électron libre Fernand Kolney commettra pensant servir - à tort - son beau-frère. Tailhade reçoit chez lui Fernand Desprès et Miguel Almereyda, le futur père du cinéaste Jean Vigo. Il reprend sa collaboration à L'Aurore et à La Raison. Cette même année, lors des obsèques d'Émile Zola, il en prononce le panégyrique, en reconnaissance que ce dernier soit venu le défendre, au nom de la défense de la liberté de la presse, à la barre du tribunal l'année précédente, lorsqu'il était poursuivi pour avoir écrit dans Le Libertaire un article incendiaire constituant un véritable appel au meurtre à l'encontre du tsar Nicolas II qui faisait en 1901 sa seconde visite en France. 1903 - Tailhade Collabore très régulièrement à L'Action, un quotidien farouchement anticlérical. Il y restera jusqu'à la fin de l'année 1905. Il signe aussi plusieurs textes dans L'Assiette au Beurre. Le 28 avril, Ninette donne naissance à sa fille Laurence. Séjournant à Camaret en région Bretagne, durant la fin de l'été, il donne des articles à L'Action qui dénoncent l'alcoolisme de la population. De provocation en provocation, il ligue la population contre lui et c'est protégé par des gendarmes à cheval qu'il doit battre en retraite le 29 août. D'opinion libertaire, de mœurs libres, il y fit scandale en partageant sa chambre à l'Hôtel de France à la fois avec sa femme et un ami peintre. Un autre scandale du 15 août 1903 est resté longtemps célèbre à Camaret, où dans un geste de provocation, il verse le contenu d'un vase de nuit par la fenêtre de sa chambre, située au premier étage, sur une procession de la Fête de la bénédiction de la mer et des bateaux. 1800 Camarétois feront le siège de l'Hôtel de France, menaçant d'enfoncer la porte d'entrée, criant « À mort Tailhade ! À mort l'anarchie ! », et menaçant de jeter Tailhade dans la vase du port. La chanson paillarde « Les Filles de Camaret » a d'ailleurs probablement aussi été écrite anonymement par Laurent Tailhade pour se venger des Camarétois. 1904 - Collaboration à L'Humanité que vient de fonder Jaurès et à L'Internationale. Publication des " Poèmes Aristophanesques " au Mercure de France et des " Lettres Familières " à La librairie de La Raison. 1905 - Tailhade commence à prendre ses distances avec les libres-penseurs. Il signe des articles vengeurs dans Le Figaro sous le pseudonyme d'Azède. L'utilisation, sans son consentement, de son nom comme signataire de la fameuse affiche rouge antimilitariste qui encourageait les soldats à abattre leurs officiers, provoque une véritable rupture avec ses anciens compagnons de lutte. En octobre 1905, une affiche de l’Association internationale antimilitariste (AIA) intitulée « Appel aux conscrits » est placardée sur les murs de Paris. Le texte, violemment antimilitariste et antipatriote, appelle les conscrits à tourner leurs fusils vers les « soudards galonnés » plutôt que vers les grévistes, et appelle à la « grève immédiate » et à l’« insurrection » au jour d’une éventuelle déclaration de guerre. L’affiche est signée de 31 noms dont Laurent Tailhade. À l'issue du procès qui se déroule du 26 au 30 décembre 1905, deux prévenus sont acquittés et les 26 autres condamnés chacun à 100 francs d’amende et à des peines de prison allant de 6 mois à 4 ans. Publication chez Flammarion de sa traduction de " Trois comédies " de Plaute. 1906 - Poussé par le très réactionnaire Aristide Bruant, que Tailhade fréquente alors, il écrit deux lettres publiques de reniement, l'une à Arthur Meyer, que Le Gaulois publie le 22 janvier ; l'autre à Edouard Drumont que dévoile La Libre Parole du 29 janvier. Pourtant ce reniement sera sans lendemain. Ce simple mouvement d'humeur lui coûtera cher, car c'est celui qu'on retiendra dans sa vie parmi d'autres plus glorieux, pour l'accuser au mieux de versatilité, au pire de traîtrise. Cette année-là, il donne de nombreux textes à La Nouvelle Revue que dirige son fidèle P.-B. Gheusi. Le 15 février 1906, il quitte la franc-maçonnerie. 1907 - Publication de " Poèmes élégiaques " au Mercure de France. Il commence à collaborer à l'hebdomadaire Je Dis Tout dirigé par Jacques Landau, où il prend la défense de Matha, Sébastien Faure ou encore Malato. Le 14 août, il est le témoin du mariage de son ami Sacha Guitry avec Charlotte Lysés. 1908 - Séjours fréquents en Belgique pour des conférences (Bruxelles, Ostende, Anvers). Amitié avec James Ensor que lui a présenté son amie Emma Lambotte. Le 4 avril, il donne une conférence au Théâtre Fémina pour présenter un jeune poète de dix-huit ans nommé Jean Cocteau. 1909 - Collaboration à la revue Akademos. Publication chez Messein de sa traduction de " La Farce de la Marmite " de Plaute. Le 18 novembre il se bat en duel contre Gustave Téry, directeur de L'Œuvre, alors antisémite. A 55 ans, malade, saturé de morphine, borgne et pour ainsi dire manchot, Tailhade trouve encore la force d'embrocher son adversaire à la cinquième reprise. Quatre jours plus tard, le 22 novembre, c'est Urbain Gohier qui le traîne sur le pré. Tandis que son adversaire ajustera deux balles dans sa direction, Tailhade chevaleresque, ne fera pas usage de son arme. 1910 - Le 13 février, répétition générale, à l'Opéra, de son drame musical en deux actes "La Forêt". Les bénéfices vont aux victimes des inondations qui accablent alors Paris. Tailhade fait la connaissance de Neel Doff chez Emma Lambotte. Enthousiasmé par "Jours de famine et de détresse", il se fait le héraut du talent de la jeune femme. Malgré l'appui de Mirbeau, Descaves et Geffroy, il ne parviendra pas à lui faire attribuer le prix Goncourt, l'année suivante. 1911 - Tailhade commence à collaborer à Comœdia. Il y donnera des articles jusqu'en août 1914. 1912 - 3 janvier, duel au pistolet avec Sylvain Bonmariage. 1913 - Publication de " Plâtres et Marbres " chez Figuière. 1914 - Publication des " Commérages de Tybalt " chez Georges Crès. A la déclaration de guerre, Prenant exemple sur Anatole France, Tailhade se porte volontaire pour être engagé le 2 octobre 1914. On lui reprochera plus tard ce côté va-t-en-guerre, oubliant le trouble de tous ces chenus littérateurs devant la douleur de perdre leurs jeunes confrères. 1915 - Tailhade se replie sur Nice, accueilli par son ami Émile Vitta. Il y retrouve Xavier Privas et Marguerite Moreno. Il a des contacts avec les écrivains anglais qui s'intéressent à son œuvre : Wilfried Owen, Richard Aldington, ou encore Ezra Pound. 1916 - 1917 - Collaboration à L'Œuvre et au Pays. 1917-1919 - Collaboration à La Vérité. Tailhade y écrit des articles pacifistes et, en opposant de toujours au régime tsariste qu'il est resté, il salue la Révolution bolchévique. 1919 - Épuisé par ses congestions pulmonaires à répétition, Tailhade s'éteint le 1er novembre 1919 à Combs-la-Ville (Seine-et-Oise), laissant sa femme et sa fille dans un certain dénuement. Une souscription, en grande partie alimentée par Sacha Guitry, le sauvera de la fosse commune le 20 février 1921, et permettra à cet éternel enragé et à cet anticlérical fou furieux de trouver une petite place dans le cimetière du Montparnasse, où il repose encore aujourd’hui. Le nom « Tailhade » était devenu pendant une bonne partie du XXe siècle dans le parler local un nom commun synonyme de « personnage grossier, mal élevé », même si ce mot est désormais tombé en désuétude. Sa fille fut l'épouse du journaliste Pierre Châtelain-Tailhade, journaliste au « Canard enchaîné ».
 Laurent TAILHADE, né à Tarbes le 16 avril 1854, rue Brauhauban, et mort le 2 novembre 1919 à Combs-la-Ville (Seine-et-Oise), cet artiste pamphlétaire et anarchiste défraya souvent la chronique par ses écrits audacieux. Il grandit entre son père, Félix Tailhade, magistrat conservateur, et sa mère, la pieuse Ernestine Jacomet. Durant sa vie il usa de nombreux pseudonymes : Azède, El Cachetero, Dom Junipérien, Lorenzaccio, Patte-Pelue, Renzi, Tybalt. Monarchiste avant de devenir anarchiste, anticlérical et dreyfusard, il a été mis en prison pour un article contre le tsar Nicolas II. Personnalité fracassante du Paris des Lettres de l’avant-guerre, il était l’ami de Verlaine, Mallarmé, Jaurès, Sacha Guitry. Il fut un écrivain influencé par les Parnassiens. Menant une vie de bohême à Paris, il devint l'ami de Jean Moréas ou encore Samain. Ses textes polémiques ne cachent pas ses opinions anarchistes et anticléricales. Il se fait connaître, en 1893, en proclamant, à travers un poème, son admiration pour l'attentat anarchiste de Vaillant, ce qui ne manqua pas de scandaliser la bourgeoisie parisienne. Ses recueils les plus célèbres sont : Au Pays du mufle (1891) et Imbéciles et gredins (1900). Il est aussi l'auteur de La Noire Idole, publié aux éditions Mille et Une nuits en 2001. 1er mai 1865 - Laurent Tailhade entre au collège Sainte-Marie de Toulouse (aujourd'hui Le Caousou) tenu par les jésuites. 1870-1873 - Études classiques au lycée de Pau. 1873-1874 - Études au lycée de Tarbes. Dans la cour de récréation, surveillée par le pion Théophile Delcassé, futur ministre de la IIIe République, Tailhade croise le jeune Jules Laforgue, de six ans son cadet. 1873 - Tailhade est couronné une première fois aux Jeux Floraux : il obtient une violette pour " Les Citharistes de la rue ". 1874 - Obtention du baccalauréat après des études plutôt médiocres. Seconde distinction aux Jeux Floraux pour " Vers l'infini " et " Le Bouquet de violettes ". Tailhade entre à la faculté de Droit de Toulouse où il se lie avec Etienne Bladé puis avec son père, Jean-François Bladé. Influencé par son professeur, Ernest Constans, futur ministre de l'Intérieur, il est alors républicain. 1875-1876 - Avec son ami Henri Maigrot, le futur caricaturiste Henriot et père du poète Émile Henriot, il est l'un des deux piliers de L'Echo des Trouvères, élégant hebdomadaire littéraire de Toulouse. 1877 - Tailhade rencontre le Baron René Toussaint, alors officier, qui fera une carrière dans le journalisme et la littérature sous le pseudonyme de René Maizeroy. Il servira de modèle à son ami Guy de Maupassant pour le Duroy de Bel-Ami. 1878 - Premier séjour à Paris, où Armand Silvestre le présente à Théodore de Banville. 6 janvier 1879 - Il épouse Marie-Agathe Eugénie de Gourcuff. Le couple s'installe à Bagnères-de-Bigorre, tandis que Tailhade poursuit de timides études à Toulouse. 16 septembre 1879 - Naissance de leur fils Léopold, qui ne survit que cinq mois. Avril 1880 - Parution chez Alphonse Lemerre, l'éditeur des Parnassiens, de son premier volume de vers, " Le Jardin des Rêves ". Dédié à Armand Silvestre, il est préfacé par Théodore de Banville. Tailhade demeure alors à Paris jusqu'en mai de cette année. Il approche alors Heredia, Coppée et Louis-Xavier de Ricard. Juin 1880 - De retour à Bagnères-de-Bigorre, Tailhade fréquente les milieux monarchistes de la ville. Il se pose en défenseur de l'Église catholique et commence à collaborer au journal conservateur " L'Écho des Vallées " sous le pseudonyme de Lorenzaccio. 1881-1883 - Il côtoie de loin le milieu des Hydropathes. Collaboration à L'Artiste, à La Jeune France. 1882 - Un Dizain de Sonnets ", plaquette publiée chez Alphonse Lemerre. 20 septembre 1882 - Premier duel connu de Laurent Tailhade avec l'un des responsables du Casino de Bagnères-de-Bigorre. Le premier d'une longue série qui approchera les 30 ! Tailhade flambe alors énormément au casino. 29 janvier 1883 - Décès de la jeune épouse de Tailhade. Elle n'a pas 25 ans. 1883 - Tailhade s'installe à Paris. Il fréquente Le Chat Noir, les Félibres parisiens et se lie d'amitié avec Joseph Gayda qui l'entraîne dans le cercle des Zutistes, à la Maison de Bois, située rue de Rennes. Là, il rencontre Charles Cros, le gourou des lieux, ainsi que toute la jeune bohème littéraire : Alphonse Allais, Louis Marsolleau, Charles Vignier, Jean Moréas, Edmond Haraucourt, Jean Ajalbert, Marie Krysinska, Fernand Icres, Georges d'Esparbès, Léo Trézenik et encore Ernest Raynaud, l'un de ses amis les plus fidèles. 1884-1885 - Il s'installe à l'hôtel Foyot. Il rencontre Verlaine et Mallarmé. Ses meilleurs amis sont alors Jean Lorrain, Jean Moréas, Stanislas de Guaita et Maurice Barrès. Viendront bientôt s'ajouter Victor Margueritte, Oscar Méténier et Félix Fénéon, Il collabore alors à Lutèce, au Chat Noir et à La Revue Indépendante. 1886-1887 - Son père, qui lui a coupé les vivres, l'oblige à rentrer à Bagnères-de-Bigorre, où sa famille lui a trouvé un nouveau parti en la personne de Mélanie Maruéjouls. Le mariage est célébré le 2 février 1886. C'est un véritable désastre. Tailhade, qui est devenu farouchement anticlérical, menace, avec un revolver, son épouse qui veut se rendre à la messe. La cohabitation ne tient pas un an. Le divorce est prononcé cinq ans plus tard. Été 1886 - Tailhade rédige seul une gazette intitulée " Le Courrier de la Saison ", puis " Le Paillasson ". La même année, il reprend la plupart de ses textes publiés ici et là dans " Bagnères - Thermal ". 1887 - Le 4 février 1887, Tailhade est initié en franc-maçonnerie à la loge L'Indépendance Française du Grand Orient de France à Toulouse, où il a repris des études de droit. Il regroupe alors autour de lui un cercle de disciples, parmi lesquels on trouve P.-B. Gheusi et Georges Fourest. 1888 - Tailhade revient définitivement à Paris. Parangon du poète décadent depuis Lutèce et " Les Déliquescences d'Adoré Floupette ", il collabore tout naturellement au Décadent d'Anatole Baju. Il y publie les premiers faux-Rimbaud avec la complicité de Raynaud et de Du Plessys. 1889-1890 - Il est l'un des premiers collaborateurs de La Plume, du Mercure de France et de L'Ermitage. Il fréquente Léon Bloy, Papus, Edouard Dubus, Henry d'Argis, Fernand Clerget, Mme Prévost-Roqueplan, la comtesse Diane de Beausacq, Marie de Maleissye... Le 12 juin 1889, en compagnie d'Albert Samain, il est le témoin du mariage de Rachilde avec Alfred Vallette. 1890 - Tailhade est incarcéré quatre jours à la prison de Sainte-Pélagie, suite à l'action intentée en justice par Gisèle d'Estoc. Georges Desplas, son avocat, le sort de ce mauvais pas. 1891 - Tailhade publie " Vitraux " chez Lemerre et " Au Pays du Mufle " chez Léon Vanier. Ce dernier recueil reprend ses ballades les plus assassines publiées au Mercure. 1892 - Début de l'amitié avec Edward Sansot. Le caractère homosexuel de leurs relations ne fait aucun doute. Cette même année, il est admis à la loge parisienne Les Amis Inséparables, dont il devient secrétaire l'année suivante. 1893 - Intense activité de conférencier (La Bodinière, Salle des Capucines, Salle des Sociétés Savantes...). Le 10 novembre il réitère sa conférence de la veille avant la représentation d' "Un Ennemi du Peuple" d'Ibsen au théâtre de l'œuvre. Ce petit chef d'œuvre de provocation déchaîne une véritable tempête dans la salle. Heureusement, ses partisans sont là pour le soutenir : Stéphane Mallarmé, Octave Mirbeau, Maurice Barrès, José-Maria de Heredia, Saint-Pol Roux, Rachilde, Paul Gauguin, Henry de Groux, Maurice Denis, Roger Marx, Francis Vielé-Griffin ... Le 9 décembre, au banquet de La Plume, apprenant l'attentat de Vaillant à la Chambre des Députés, il déclare au journaliste venu l'interroger : " Qu'importent les victimes si le geste est beau ! ". Il soulève un tollé général dans la presse. 1894 - Le 4 avril, une bombe, placée par une main anonyme sur le rebord d'une fenêtre, blesse grièvement Laurent Tailhade dînant au restaurant Foyot en compagnie de Julia Mialhe, qui partage alors sa vie. Il devra se faire énucléer quelques années plus tard. La presse se gausse de sa mésaventure et salue cette " bombe intelligente ". Seul Léon Bloy, Alfred Vallette et Jean Carrère montent au créneau pour prendre sa défense. Son maître, Stéphane Mallarmé, se précipite à son chevet, à l'hôpital de La Charité, où il demeure six semaines. A peine sorti de l'hôpital, Tailhade veut en découdre avec tous ceux qui l'ont insulté tandis qu'il était alité. Il expédie ses témoins, Stanislas de Guaita et Marcel Schwob aux quatre coins des rédactions de la presse parisienne. Afin d'affirmer publiquement son amitié à Tailhade, Sarah Bernhardt l'engage pour donner une conférence avant l'ultime représentation de Phèdre que la divine donne au théâtre de la Renaissance. A peine quinze jours après être sorti de l'hôpital, Tailhade déchaîne à nouveau la salle par ses provocations. Alfred Jarry est là qui jubile : il transcrira ces hauts faits dans un chapitre des " Gestes et Opinions du docteur Faustroll, pataphysicien ".
Laurent TAILHADE, né à Tarbes le 16 avril 1854, rue Brauhauban, et mort le 2 novembre 1919 à Combs-la-Ville (Seine-et-Oise), cet artiste pamphlétaire et anarchiste défraya souvent la chronique par ses écrits audacieux. Il grandit entre son père, Félix Tailhade, magistrat conservateur, et sa mère, la pieuse Ernestine Jacomet. Durant sa vie il usa de nombreux pseudonymes : Azède, El Cachetero, Dom Junipérien, Lorenzaccio, Patte-Pelue, Renzi, Tybalt. Monarchiste avant de devenir anarchiste, anticlérical et dreyfusard, il a été mis en prison pour un article contre le tsar Nicolas II. Personnalité fracassante du Paris des Lettres de l’avant-guerre, il était l’ami de Verlaine, Mallarmé, Jaurès, Sacha Guitry. Il fut un écrivain influencé par les Parnassiens. Menant une vie de bohême à Paris, il devint l'ami de Jean Moréas ou encore Samain. Ses textes polémiques ne cachent pas ses opinions anarchistes et anticléricales. Il se fait connaître, en 1893, en proclamant, à travers un poème, son admiration pour l'attentat anarchiste de Vaillant, ce qui ne manqua pas de scandaliser la bourgeoisie parisienne. Ses recueils les plus célèbres sont : Au Pays du mufle (1891) et Imbéciles et gredins (1900). Il est aussi l'auteur de La Noire Idole, publié aux éditions Mille et Une nuits en 2001. 1er mai 1865 - Laurent Tailhade entre au collège Sainte-Marie de Toulouse (aujourd'hui Le Caousou) tenu par les jésuites. 1870-1873 - Études classiques au lycée de Pau. 1873-1874 - Études au lycée de Tarbes. Dans la cour de récréation, surveillée par le pion Théophile Delcassé, futur ministre de la IIIe République, Tailhade croise le jeune Jules Laforgue, de six ans son cadet. 1873 - Tailhade est couronné une première fois aux Jeux Floraux : il obtient une violette pour " Les Citharistes de la rue ". 1874 - Obtention du baccalauréat après des études plutôt médiocres. Seconde distinction aux Jeux Floraux pour " Vers l'infini " et " Le Bouquet de violettes ". Tailhade entre à la faculté de Droit de Toulouse où il se lie avec Etienne Bladé puis avec son père, Jean-François Bladé. Influencé par son professeur, Ernest Constans, futur ministre de l'Intérieur, il est alors républicain. 1875-1876 - Avec son ami Henri Maigrot, le futur caricaturiste Henriot et père du poète Émile Henriot, il est l'un des deux piliers de L'Echo des Trouvères, élégant hebdomadaire littéraire de Toulouse. 1877 - Tailhade rencontre le Baron René Toussaint, alors officier, qui fera une carrière dans le journalisme et la littérature sous le pseudonyme de René Maizeroy. Il servira de modèle à son ami Guy de Maupassant pour le Duroy de Bel-Ami. 1878 - Premier séjour à Paris, où Armand Silvestre le présente à Théodore de Banville. 6 janvier 1879 - Il épouse Marie-Agathe Eugénie de Gourcuff. Le couple s'installe à Bagnères-de-Bigorre, tandis que Tailhade poursuit de timides études à Toulouse. 16 septembre 1879 - Naissance de leur fils Léopold, qui ne survit que cinq mois. Avril 1880 - Parution chez Alphonse Lemerre, l'éditeur des Parnassiens, de son premier volume de vers, " Le Jardin des Rêves ". Dédié à Armand Silvestre, il est préfacé par Théodore de Banville. Tailhade demeure alors à Paris jusqu'en mai de cette année. Il approche alors Heredia, Coppée et Louis-Xavier de Ricard. Juin 1880 - De retour à Bagnères-de-Bigorre, Tailhade fréquente les milieux monarchistes de la ville. Il se pose en défenseur de l'Église catholique et commence à collaborer au journal conservateur " L'Écho des Vallées " sous le pseudonyme de Lorenzaccio. 1881-1883 - Il côtoie de loin le milieu des Hydropathes. Collaboration à L'Artiste, à La Jeune France. 1882 - Un Dizain de Sonnets ", plaquette publiée chez Alphonse Lemerre. 20 septembre 1882 - Premier duel connu de Laurent Tailhade avec l'un des responsables du Casino de Bagnères-de-Bigorre. Le premier d'une longue série qui approchera les 30 ! Tailhade flambe alors énormément au casino. 29 janvier 1883 - Décès de la jeune épouse de Tailhade. Elle n'a pas 25 ans. 1883 - Tailhade s'installe à Paris. Il fréquente Le Chat Noir, les Félibres parisiens et se lie d'amitié avec Joseph Gayda qui l'entraîne dans le cercle des Zutistes, à la Maison de Bois, située rue de Rennes. Là, il rencontre Charles Cros, le gourou des lieux, ainsi que toute la jeune bohème littéraire : Alphonse Allais, Louis Marsolleau, Charles Vignier, Jean Moréas, Edmond Haraucourt, Jean Ajalbert, Marie Krysinska, Fernand Icres, Georges d'Esparbès, Léo Trézenik et encore Ernest Raynaud, l'un de ses amis les plus fidèles. 1884-1885 - Il s'installe à l'hôtel Foyot. Il rencontre Verlaine et Mallarmé. Ses meilleurs amis sont alors Jean Lorrain, Jean Moréas, Stanislas de Guaita et Maurice Barrès. Viendront bientôt s'ajouter Victor Margueritte, Oscar Méténier et Félix Fénéon, Il collabore alors à Lutèce, au Chat Noir et à La Revue Indépendante. 1886-1887 - Son père, qui lui a coupé les vivres, l'oblige à rentrer à Bagnères-de-Bigorre, où sa famille lui a trouvé un nouveau parti en la personne de Mélanie Maruéjouls. Le mariage est célébré le 2 février 1886. C'est un véritable désastre. Tailhade, qui est devenu farouchement anticlérical, menace, avec un revolver, son épouse qui veut se rendre à la messe. La cohabitation ne tient pas un an. Le divorce est prononcé cinq ans plus tard. Été 1886 - Tailhade rédige seul une gazette intitulée " Le Courrier de la Saison ", puis " Le Paillasson ". La même année, il reprend la plupart de ses textes publiés ici et là dans " Bagnères - Thermal ". 1887 - Le 4 février 1887, Tailhade est initié en franc-maçonnerie à la loge L'Indépendance Française du Grand Orient de France à Toulouse, où il a repris des études de droit. Il regroupe alors autour de lui un cercle de disciples, parmi lesquels on trouve P.-B. Gheusi et Georges Fourest. 1888 - Tailhade revient définitivement à Paris. Parangon du poète décadent depuis Lutèce et " Les Déliquescences d'Adoré Floupette ", il collabore tout naturellement au Décadent d'Anatole Baju. Il y publie les premiers faux-Rimbaud avec la complicité de Raynaud et de Du Plessys. 1889-1890 - Il est l'un des premiers collaborateurs de La Plume, du Mercure de France et de L'Ermitage. Il fréquente Léon Bloy, Papus, Edouard Dubus, Henry d'Argis, Fernand Clerget, Mme Prévost-Roqueplan, la comtesse Diane de Beausacq, Marie de Maleissye... Le 12 juin 1889, en compagnie d'Albert Samain, il est le témoin du mariage de Rachilde avec Alfred Vallette. 1890 - Tailhade est incarcéré quatre jours à la prison de Sainte-Pélagie, suite à l'action intentée en justice par Gisèle d'Estoc. Georges Desplas, son avocat, le sort de ce mauvais pas. 1891 - Tailhade publie " Vitraux " chez Lemerre et " Au Pays du Mufle " chez Léon Vanier. Ce dernier recueil reprend ses ballades les plus assassines publiées au Mercure. 1892 - Début de l'amitié avec Edward Sansot. Le caractère homosexuel de leurs relations ne fait aucun doute. Cette même année, il est admis à la loge parisienne Les Amis Inséparables, dont il devient secrétaire l'année suivante. 1893 - Intense activité de conférencier (La Bodinière, Salle des Capucines, Salle des Sociétés Savantes...). Le 10 novembre il réitère sa conférence de la veille avant la représentation d' "Un Ennemi du Peuple" d'Ibsen au théâtre de l'œuvre. Ce petit chef d'œuvre de provocation déchaîne une véritable tempête dans la salle. Heureusement, ses partisans sont là pour le soutenir : Stéphane Mallarmé, Octave Mirbeau, Maurice Barrès, José-Maria de Heredia, Saint-Pol Roux, Rachilde, Paul Gauguin, Henry de Groux, Maurice Denis, Roger Marx, Francis Vielé-Griffin ... Le 9 décembre, au banquet de La Plume, apprenant l'attentat de Vaillant à la Chambre des Députés, il déclare au journaliste venu l'interroger : " Qu'importent les victimes si le geste est beau ! ". Il soulève un tollé général dans la presse. 1894 - Le 4 avril, une bombe, placée par une main anonyme sur le rebord d'une fenêtre, blesse grièvement Laurent Tailhade dînant au restaurant Foyot en compagnie de Julia Mialhe, qui partage alors sa vie. Il devra se faire énucléer quelques années plus tard. La presse se gausse de sa mésaventure et salue cette " bombe intelligente ". Seul Léon Bloy, Alfred Vallette et Jean Carrère montent au créneau pour prendre sa défense. Son maître, Stéphane Mallarmé, se précipite à son chevet, à l'hôpital de La Charité, où il demeure six semaines. A peine sorti de l'hôpital, Tailhade veut en découdre avec tous ceux qui l'ont insulté tandis qu'il était alité. Il expédie ses témoins, Stanislas de Guaita et Marcel Schwob aux quatre coins des rédactions de la presse parisienne. Afin d'affirmer publiquement son amitié à Tailhade, Sarah Bernhardt l'engage pour donner une conférence avant l'ultime représentation de Phèdre que la divine donne au théâtre de la Renaissance. A peine quinze jours après être sorti de l'hôpital, Tailhade déchaîne à nouveau la salle par ses provocations. Alfred Jarry est là qui jubile : il transcrira ces hauts faits dans un chapitre des " Gestes et Opinions du docteur Faustroll, pataphysicien ".1895 - Grâce à son ami Henry Bauër, Tailhade entre à L'Écho de Paris, où il signe ses articles du pseudonyme de Tybalt. Il y restera jusqu'en février 1897. Dans un article il dénonce l'antisémitisme des étudiants ; ce qui déchaîne une manifestation desdits grimauds devant son domicile. Par chance, il est absent. Il suit alors l'une des innombrables cures de démorphinisation qui feront de son existence un véritable calvaire. Suite à cet article, il se bat en duel le 29 juin contre Renaud d'Elissagaray, journaliste à L'Antijuif et à la Libre Parole. Tailhade est sérieusement blessé à la main. Huit jours auparavant il s'est battu contre Jules Bois qui deviendra peu après son ami. Le 2 juillet, il retourne sur le pré contre le président de l'Association des étudiants. 1896 - Collaboration au Voltaire, à La Revue Rouge et au Libertaire. Il fréquente très assidûment Madame Prévost-Roqueplan et sa fille Juliette à Montfort l'Amaury, où il retrouve avec déplaisir son rival Jehan Rictus. 1897 - Il quitte L'Écho de Paris, qui est devenu antidreyfusard, après avoir fait condamner le journal à une somme astronomique, suite à l'un de ses articles dénonçant la pédophilie de l'ensemble du clergé haut-pyrénéen. Il séjourne alors à Toulouse, où débute sa liaison avec Anne Osmont, poétesse, féministe et célèbre occultiste. Il collabore régulièrement à La Dépêche. L'été, comme souvent, il se rend à Saint-Sébastien pour assister aux corridas, spectacle dont il est très friand. 1898 - Tailhade entre dans le combat dreyfusard au côté de son maître Zola, qui ne fut pourtant pas toujours l'une de ses admirations. Il écrit dans L'Aurore et dans Les Droits de l'Homme. Les duels alors s'enchaînent sans répit. Le 8 juillet contre Raphaël Viau qui s'était payé sa tête dans La Libre Parole après l'altercation qui avait conduit la nationaliste Marie-Anne de Bovet à gifler Tailhade et ce dernier à lui répliquer en lui crachant au visage. Et surtout le 17 octobre, où un duel furieux l'opposa à son ancien compagnon, Maurice Barrès. Tailhade fut gravement blessé au bras par l'épée de Barrès. Cette même année, Yvette Guibert lui commande des chansons qu'il ne lui fera jamais. Publication de " Terre Latine " chez Lemerre. 1899 - Hospitalisé une nouvelle fois, Tailhade reçoit la visite d'Anatole France et d'Émile Zola qui tentent de lui trouver une situation stable dans la presse. La combinaison pour le faire entrer au Figaro échoue. Il collabore au Journal du Peuple, puis commence à écrire à La Petite République, journal socialiste, où il se lie d'amitié avec Jean Jaurès. Publication d' "A travers les Grouins" chez Stock. Les ballades sont féroces : elles rappellent les hauts faits de la lutte dreyfusiste menée par Tailhade et ses amis. 1900 - Collaboration au Petit Sou. Publication d' "Imbéciles et Gredins" à la Maison d'Art. 1901 - Le 17 janvier, Tailhade épouse Eugénie Pochon, sœur de son ami, Fernand Kolney. La mariée a vingt-deux ans de moins que l'époux. Les témoins sont Raoul d'Audiffret, Jacques de Boisjolin et Jean Jaurès. Publication de " la touffe de sauge " aux éditions de la Plume. Tailhade collabore au Français et à La Raison, périodique anticlérical. Mais c'est son article du Libertaire paru le 15 septembre 1901, intitulé " Le Triomphe de la Domesticité ", véritable appel au meurtre sur la personne du tsar, qui l'envoie tout droit à la prison de la Santé pour un an. La campagne menée par ses amis, Zola, Kahn, France, Mirbeau, Boès, Sembat, etc. abrègera son séjour de moitié. En prison, il termine sa traduction du « Satyricon de Pétrone » qui paraît chez Fasquelle l'année suivante. 1902 - Parution de " Discours Civiques " chez Stock. Différend matrimonial avec Ninette, sa femme, dans lequel Mme Prévost-Roqueplan joue un rôle que ne lui pardonnera pas Tailhade et qui sera à l'origine de la parution, deux ans plus tard, du " Salon de Madame Truphot " que l'électron libre Fernand Kolney commettra pensant servir - à tort - son beau-frère. Tailhade reçoit chez lui Fernand Desprès et Miguel Almereyda, le futur père du cinéaste Jean Vigo. Il reprend sa collaboration à L'Aurore et à La Raison. Cette même année, lors des obsèques d'Émile Zola, il en prononce le panégyrique, en reconnaissance que ce dernier soit venu le défendre, au nom de la défense de la liberté de la presse, à la barre du tribunal l'année précédente, lorsqu'il était poursuivi pour avoir écrit dans Le Libertaire un article incendiaire constituant un véritable appel au meurtre à l'encontre du tsar Nicolas II qui faisait en 1901 sa seconde visite en France. 1903 - Tailhade Collabore très régulièrement à L'Action, un quotidien farouchement anticlérical. Il y restera jusqu'à la fin de l'année 1905. Il signe aussi plusieurs textes dans L'Assiette au Beurre. Le 28 avril, Ninette donne naissance à sa fille Laurence. Séjournant à Camaret en région Bretagne, durant la fin de l'été, il donne des articles à L'Action qui dénoncent l'alcoolisme de la population. De provocation en provocation, il ligue la population contre lui et c'est protégé par des gendarmes à cheval qu'il doit battre en retraite le 29 août. D'opinion libertaire, de mœurs libres, il y fit scandale en partageant sa chambre à l'Hôtel de France à la fois avec sa femme et un ami peintre. Un autre scandale du 15 août 1903 est resté longtemps célèbre à Camaret, où dans un geste de provocation, il verse le contenu d'un vase de nuit par la fenêtre de sa chambre, située au premier étage, sur une procession de la Fête de la bénédiction de la mer et des bateaux. 1800 Camarétois feront le siège de l'Hôtel de France, menaçant d'enfoncer la porte d'entrée, criant « À mort Tailhade ! À mort l'anarchie ! », et menaçant de jeter Tailhade dans la vase du port. La chanson paillarde « Les Filles de Camaret » a d'ailleurs probablement aussi été écrite anonymement par Laurent Tailhade pour se venger des Camarétois. 1904 - Collaboration à L'Humanité que vient de fonder Jaurès et à L'Internationale. Publication des " Poèmes Aristophanesques " au Mercure de France et des " Lettres Familières " à La librairie de La Raison. 1905 - Tailhade commence à prendre ses distances avec les libres-penseurs. Il signe des articles vengeurs dans Le Figaro sous le pseudonyme d'Azède. L'utilisation, sans son consentement, de son nom comme signataire de la fameuse affiche rouge antimilitariste qui encourageait les soldats à abattre leurs officiers, provoque une véritable rupture avec ses anciens compagnons de lutte. En octobre 1905, une affiche de l’Association internationale antimilitariste (AIA) intitulée « Appel aux conscrits » est placardée sur les murs de Paris. Le texte, violemment antimilitariste et antipatriote, appelle les conscrits à tourner leurs fusils vers les « soudards galonnés » plutôt que vers les grévistes, et appelle à la « grève immédiate » et à l’« insurrection » au jour d’une éventuelle déclaration de guerre. L’affiche est signée de 31 noms dont Laurent Tailhade. À l'issue du procès qui se déroule du 26 au 30 décembre 1905, deux prévenus sont acquittés et les 26 autres condamnés chacun à 100 francs d’amende et à des peines de prison allant de 6 mois à 4 ans. Publication chez Flammarion de sa traduction de " Trois comédies " de Plaute. 1906 - Poussé par le très réactionnaire Aristide Bruant, que Tailhade fréquente alors, il écrit deux lettres publiques de reniement, l'une à Arthur Meyer, que Le Gaulois publie le 22 janvier ; l'autre à Edouard Drumont que dévoile La Libre Parole du 29 janvier. Pourtant ce reniement sera sans lendemain. Ce simple mouvement d'humeur lui coûtera cher, car c'est celui qu'on retiendra dans sa vie parmi d'autres plus glorieux, pour l'accuser au mieux de versatilité, au pire de traîtrise. Cette année-là, il donne de nombreux textes à La Nouvelle Revue que dirige son fidèle P.-B. Gheusi. Le 15 février 1906, il quitte la franc-maçonnerie. 1907 - Publication de " Poèmes élégiaques " au Mercure de France. Il commence à collaborer à l'hebdomadaire Je Dis Tout dirigé par Jacques Landau, où il prend la défense de Matha, Sébastien Faure ou encore Malato. Le 14 août, il est le témoin du mariage de son ami Sacha Guitry avec Charlotte Lysés. 1908 - Séjours fréquents en Belgique pour des conférences (Bruxelles, Ostende, Anvers). Amitié avec James Ensor que lui a présenté son amie Emma Lambotte. Le 4 avril, il donne une conférence au Théâtre Fémina pour présenter un jeune poète de dix-huit ans nommé Jean Cocteau. 1909 - Collaboration à la revue Akademos. Publication chez Messein de sa traduction de " La Farce de la Marmite " de Plaute. Le 18 novembre il se bat en duel contre Gustave Téry, directeur de L'Œuvre, alors antisémite. A 55 ans, malade, saturé de morphine, borgne et pour ainsi dire manchot, Tailhade trouve encore la force d'embrocher son adversaire à la cinquième reprise. Quatre jours plus tard, le 22 novembre, c'est Urbain Gohier qui le traîne sur le pré. Tandis que son adversaire ajustera deux balles dans sa direction, Tailhade chevaleresque, ne fera pas usage de son arme. 1910 - Le 13 février, répétition générale, à l'Opéra, de son drame musical en deux actes "La Forêt". Les bénéfices vont aux victimes des inondations qui accablent alors Paris. Tailhade fait la connaissance de Neel Doff chez Emma Lambotte. Enthousiasmé par "Jours de famine et de détresse", il se fait le héraut du talent de la jeune femme. Malgré l'appui de Mirbeau, Descaves et Geffroy, il ne parviendra pas à lui faire attribuer le prix Goncourt, l'année suivante. 1911 - Tailhade commence à collaborer à Comœdia. Il y donnera des articles jusqu'en août 1914. 1912 - 3 janvier, duel au pistolet avec Sylvain Bonmariage. 1913 - Publication de " Plâtres et Marbres " chez Figuière. 1914 - Publication des " Commérages de Tybalt " chez Georges Crès. A la déclaration de guerre, Prenant exemple sur Anatole France, Tailhade se porte volontaire pour être engagé le 2 octobre 1914. On lui reprochera plus tard ce côté va-t-en-guerre, oubliant le trouble de tous ces chenus littérateurs devant la douleur de perdre leurs jeunes confrères. 1915 - Tailhade se replie sur Nice, accueilli par son ami Émile Vitta. Il y retrouve Xavier Privas et Marguerite Moreno. Il a des contacts avec les écrivains anglais qui s'intéressent à son œuvre : Wilfried Owen, Richard Aldington, ou encore Ezra Pound. 1916 - 1917 - Collaboration à L'Œuvre et au Pays. 1917-1919 - Collaboration à La Vérité. Tailhade y écrit des articles pacifistes et, en opposant de toujours au régime tsariste qu'il est resté, il salue la Révolution bolchévique. 1919 - Épuisé par ses congestions pulmonaires à répétition, Tailhade s'éteint le 1er novembre 1919 à Combs-la-Ville (Seine-et-Oise), laissant sa femme et sa fille dans un certain dénuement. Une souscription, en grande partie alimentée par Sacha Guitry, le sauvera de la fosse commune le 20 février 1921, et permettra à cet éternel enragé et à cet anticlérical fou furieux de trouver une petite place dans le cimetière du Montparnasse, où il repose encore aujourd’hui. Le nom « Tailhade » était devenu pendant une bonne partie du XXe siècle dans le parler local un nom commun synonyme de « personnage grossier, mal élevé », même si ce mot est désormais tombé en désuétude. Sa fille fut l'épouse du journaliste Pierre Châtelain-Tailhade, journaliste au « Canard enchaîné ».
THÉALLET Sophie
Styliste de renommée internationale
 Sophie THÉALLET, née en 1964 à Bagnères-de-Bigorre, établie à New York, est une styliste très honorée de voir ses vêtements portés par Michèle Obama, la Première dame des États-Unis, pendant ses 8 années à la Maison Blanche et aussi par tout le gotha américain. À 18 ans, Sophie s'installe à Paris pour intégrer au début des années 1980, le Studio Berçot, une école de stylisme. Elle se fait remarquer en 1984 avec une collection pour le Printemps qui a connu un grand succès. Elle reçoit le prix Printemps du Jeune Designer. Repérée et embauchée par le déjà très influent Jean-Paul Gaultier, elle apprend chez lui à donner libre court à sa fantaisie, à jouer avec les couleurs. Elle rejoint ensuite durant une décennie le grand couturier franco-tunisien, Azzedine Alaïa, avant de déménager à New York pour suivre son mari canadien, qui vivait à New York. Et c'est avec Azzedine qu’elle dit avoir tout appris. Le créateur qui sait sublimer comme nul autre les courbes féminines par la précision de ses coupes et qui lui apprend la rigueur et la couture, confiera-t-elle. Elle vit à Brooklyn Heights, au troisième étage d'un immeuble art-déco non loin du pont de Brooklyn, qu'elle a transformé en atelier. Son atelier est aussi l'appartement où elle vit et travaille avec son mari Steven Francoeur, un ancien mannequin québécois et Léon leur petit garçon. Après avoir déménagé à New York, elle a continué à travailler avec Alaïa à temps partiel, tout en travaillant en freelance pour différentes marques américaines. En 2005, elle lance une petite ligne resort, Motu Tane. En 2007, elle lance sa propre marque, Sophie Theallet, à New York. Le rêve américain commence vraiment en 2009 pour la styliste, lorsque ses créations féminines et gaies, destinées à habiller une femme élégante en perpétuel mouvement, attirent l'œil de Michelle Obama, Première dame américaine et nouvelle icône mondiale de la mode. Elle n'a alors lancé sa marque que depuis deux ans et travaille encore avec son mari depuis chez elle à Brooklyn. Consacrée par la Première dame, elle se voit ouvrir, outre les portes de la Maison Blanche, où elle est invitée, celles des salons de la haute société américaine. En novembre 2009, elle est lauréate du 1er prix CFDA/Vogue Fashion Fund Awards du meilleur créateur de l'année aux États-Unis et aussi du magazine américain Vogue, l'une des récompenses les plus prestigieuses dans la mode aux États-Unis. Elle est encensée aussi par le New York Times. Les stars affluent et avec elles une importante clientèle fortunée. Le magazine Vogue écrit assez régulièrement sur ses défilés. En juillet 2012, elle est la lauréate de l’International Woolmark Prize. En novembre 2016, très attachée à la présidence Obama, dans une lettre ouverte publiée sur Twitter elle explique pourquoi elle n'habillera pas Melania, la future Première dame des États-Unis, épouse de Donald Trump. Car écrit-elle « la rhétorique raciste, sexiste et xénophobe de la campagne de son mari sont incompatibles avec son travail ». Plus qu'un plaidoyer pour Michèle Obama, ce texte participe d'une campagne contre Donald Trump. Et elle demande même à ses confrères et les autres designers d'en faire de même. Elle termine sa lettre ouverte par un message digne d'un slogan : « L'intégrité est notre seule vraie devise ». À défaut d’habiller la future Première dame, elle a donc taillé un costard au futur Président des États-Unis. Quelques jours plus tard, le styliste américain Tommy Hilfiger a répondu à sa lettre en disant que Melania était une très belle femme et qu'il pensait que n'importe quel designer serait très fier de l'habiller. Cette lettre de Sophie, publiée sur les réseaux sociaux, a fait grand bruit. Pendant des mois, elle en a subi les contrecoups, recevant des critiques et des menaces par téléphone, par courriel et sur les réseaux sociaux. Sophie avait séduit les Américains par son style « bohémien chic ». Chiffon, froncé, plissé, coupes en biais, les vêtements sont fluides. Ce style évoquait parfois l'Afrique du nord et ses caftans, parfois l'Afrique noire et ses cotons de couleur vive, parfois d'autres horizons. La créatrice osait les mélanges de couleurs inattendus, souvent travaillés dans des imprimés ethniques. Des tenues faciles à porter, intemporelles et destinées aux femmes de tous âges. Les créations Sophie Théallet se vendaient désormais dans une dizaine de pays, surtout aux États-Unis et au Canada, en Australie, en Russie et au Moyen-Orient. Mais pas en France, où elle ne désespérait pas de vendre aussi ses créations. « On aimerait la voir arriver en France un jour peut-être », avait déclaré Cécilia Attias, l'ex-épouse de Nicolas Sarkozy. Parce qu'être reconnue et vendue sur sa terre natale, « ce serait cool ». Elle a été distribuée dans une vingtaine de magasins américains dont Barneys à New York et à Beverly Hills, mais aussi à Londres et à Koweit City. Établie à New York pendant de nombreuses années, la designer française Sophie Theallet était une habituée des passerelles et des tapis rouges. Michelle Obama, Oprah Winfrey, Jennifer Lopez et Kim Kardashian ne sont que quelques-unes des femmes qui ont porté ses créations. Puis, elle en a eu assez. Assez de tous les artifices qui entourent la haute couture. Assez aussi du climat politique américain. Sophie, son mari (et partenaire d’affaires) Steve Francoeur et leur fils ont débarqué en 2018 à Montréal sans tambour ni trompette, à cause bien sûr du contexte politique aux États-Unis. Installée désormais à Montréal, elle vient de lancer Room 502, une nouvelle marque de luxe éthique qui est en phase avec ses convictions. Une marque qui tire son nom de l’appartement de l’hôtel Chelsea où ont vécu Sophie et Steve à leur arrivée à New York. Room 502 mise plutôt sur de petites séries, produites en quantité limitée et renouvelées tous les trois ou quatre mois. L’idée étant de produire moins et de produire bien et également de rendre plus accessibles les vêtements de luxe. La marque Sophie Theallet, qui s’était bien établie dans le monde de la mode depuis son lancement en 2007 aux Etats-Unis, a alors été mise en veilleuse. Sophie est la fille du Dr Jean Claude Théallet, fort connu à Bagnères-de-Bigorre et de son épouse née Burgué, ex championne de ski et de tennis, et qui ont eu six enfants dont cinq garçons et une fille, Sophie. En 2010, dans les salons de la mairie de Bagnères-de-Bigorre, le maire Roland Castells lui a remis la médaille d’honneur de la ville de Bagnères-de-Bigorre. Son attachement à la richesse artisanale de la mode, à la finesse d'exécution d'un patron et à l'art du détail, lui avait valu un bel accueil aux États-Unis. Pour la production de ses prochaines séries au Canada, qui comprendront robes, écharpes, chemisiers et pantalons, la designer fera appel à des ateliers montréalais, new-yorkais et, éventuellement, européens puisqu’elle décrit son entreprise comme «citoyenne du monde».
Sophie THÉALLET, née en 1964 à Bagnères-de-Bigorre, établie à New York, est une styliste très honorée de voir ses vêtements portés par Michèle Obama, la Première dame des États-Unis, pendant ses 8 années à la Maison Blanche et aussi par tout le gotha américain. À 18 ans, Sophie s'installe à Paris pour intégrer au début des années 1980, le Studio Berçot, une école de stylisme. Elle se fait remarquer en 1984 avec une collection pour le Printemps qui a connu un grand succès. Elle reçoit le prix Printemps du Jeune Designer. Repérée et embauchée par le déjà très influent Jean-Paul Gaultier, elle apprend chez lui à donner libre court à sa fantaisie, à jouer avec les couleurs. Elle rejoint ensuite durant une décennie le grand couturier franco-tunisien, Azzedine Alaïa, avant de déménager à New York pour suivre son mari canadien, qui vivait à New York. Et c'est avec Azzedine qu’elle dit avoir tout appris. Le créateur qui sait sublimer comme nul autre les courbes féminines par la précision de ses coupes et qui lui apprend la rigueur et la couture, confiera-t-elle. Elle vit à Brooklyn Heights, au troisième étage d'un immeuble art-déco non loin du pont de Brooklyn, qu'elle a transformé en atelier. Son atelier est aussi l'appartement où elle vit et travaille avec son mari Steven Francoeur, un ancien mannequin québécois et Léon leur petit garçon. Après avoir déménagé à New York, elle a continué à travailler avec Alaïa à temps partiel, tout en travaillant en freelance pour différentes marques américaines. En 2005, elle lance une petite ligne resort, Motu Tane. En 2007, elle lance sa propre marque, Sophie Theallet, à New York. Le rêve américain commence vraiment en 2009 pour la styliste, lorsque ses créations féminines et gaies, destinées à habiller une femme élégante en perpétuel mouvement, attirent l'œil de Michelle Obama, Première dame américaine et nouvelle icône mondiale de la mode. Elle n'a alors lancé sa marque que depuis deux ans et travaille encore avec son mari depuis chez elle à Brooklyn. Consacrée par la Première dame, elle se voit ouvrir, outre les portes de la Maison Blanche, où elle est invitée, celles des salons de la haute société américaine. En novembre 2009, elle est lauréate du 1er prix CFDA/Vogue Fashion Fund Awards du meilleur créateur de l'année aux États-Unis et aussi du magazine américain Vogue, l'une des récompenses les plus prestigieuses dans la mode aux États-Unis. Elle est encensée aussi par le New York Times. Les stars affluent et avec elles une importante clientèle fortunée. Le magazine Vogue écrit assez régulièrement sur ses défilés. En juillet 2012, elle est la lauréate de l’International Woolmark Prize. En novembre 2016, très attachée à la présidence Obama, dans une lettre ouverte publiée sur Twitter elle explique pourquoi elle n'habillera pas Melania, la future Première dame des États-Unis, épouse de Donald Trump. Car écrit-elle « la rhétorique raciste, sexiste et xénophobe de la campagne de son mari sont incompatibles avec son travail ». Plus qu'un plaidoyer pour Michèle Obama, ce texte participe d'une campagne contre Donald Trump. Et elle demande même à ses confrères et les autres designers d'en faire de même. Elle termine sa lettre ouverte par un message digne d'un slogan : « L'intégrité est notre seule vraie devise ». À défaut d’habiller la future Première dame, elle a donc taillé un costard au futur Président des États-Unis. Quelques jours plus tard, le styliste américain Tommy Hilfiger a répondu à sa lettre en disant que Melania était une très belle femme et qu'il pensait que n'importe quel designer serait très fier de l'habiller. Cette lettre de Sophie, publiée sur les réseaux sociaux, a fait grand bruit. Pendant des mois, elle en a subi les contrecoups, recevant des critiques et des menaces par téléphone, par courriel et sur les réseaux sociaux. Sophie avait séduit les Américains par son style « bohémien chic ». Chiffon, froncé, plissé, coupes en biais, les vêtements sont fluides. Ce style évoquait parfois l'Afrique du nord et ses caftans, parfois l'Afrique noire et ses cotons de couleur vive, parfois d'autres horizons. La créatrice osait les mélanges de couleurs inattendus, souvent travaillés dans des imprimés ethniques. Des tenues faciles à porter, intemporelles et destinées aux femmes de tous âges. Les créations Sophie Théallet se vendaient désormais dans une dizaine de pays, surtout aux États-Unis et au Canada, en Australie, en Russie et au Moyen-Orient. Mais pas en France, où elle ne désespérait pas de vendre aussi ses créations. « On aimerait la voir arriver en France un jour peut-être », avait déclaré Cécilia Attias, l'ex-épouse de Nicolas Sarkozy. Parce qu'être reconnue et vendue sur sa terre natale, « ce serait cool ». Elle a été distribuée dans une vingtaine de magasins américains dont Barneys à New York et à Beverly Hills, mais aussi à Londres et à Koweit City. Établie à New York pendant de nombreuses années, la designer française Sophie Theallet était une habituée des passerelles et des tapis rouges. Michelle Obama, Oprah Winfrey, Jennifer Lopez et Kim Kardashian ne sont que quelques-unes des femmes qui ont porté ses créations. Puis, elle en a eu assez. Assez de tous les artifices qui entourent la haute couture. Assez aussi du climat politique américain. Sophie, son mari (et partenaire d’affaires) Steve Francoeur et leur fils ont débarqué en 2018 à Montréal sans tambour ni trompette, à cause bien sûr du contexte politique aux États-Unis. Installée désormais à Montréal, elle vient de lancer Room 502, une nouvelle marque de luxe éthique qui est en phase avec ses convictions. Une marque qui tire son nom de l’appartement de l’hôtel Chelsea où ont vécu Sophie et Steve à leur arrivée à New York. Room 502 mise plutôt sur de petites séries, produites en quantité limitée et renouvelées tous les trois ou quatre mois. L’idée étant de produire moins et de produire bien et également de rendre plus accessibles les vêtements de luxe. La marque Sophie Theallet, qui s’était bien établie dans le monde de la mode depuis son lancement en 2007 aux Etats-Unis, a alors été mise en veilleuse. Sophie est la fille du Dr Jean Claude Théallet, fort connu à Bagnères-de-Bigorre et de son épouse née Burgué, ex championne de ski et de tennis, et qui ont eu six enfants dont cinq garçons et une fille, Sophie. En 2010, dans les salons de la mairie de Bagnères-de-Bigorre, le maire Roland Castells lui a remis la médaille d’honneur de la ville de Bagnères-de-Bigorre. Son attachement à la richesse artisanale de la mode, à la finesse d'exécution d'un patron et à l'art du détail, lui avait valu un bel accueil aux États-Unis. Pour la production de ses prochaines séries au Canada, qui comprendront robes, écharpes, chemisiers et pantalons, la designer fera appel à des ateliers montréalais, new-yorkais et, éventuellement, européens puisqu’elle décrit son entreprise comme «citoyenne du monde».
 Sophie THÉALLET, née en 1964 à Bagnères-de-Bigorre, établie à New York, est une styliste très honorée de voir ses vêtements portés par Michèle Obama, la Première dame des États-Unis, pendant ses 8 années à la Maison Blanche et aussi par tout le gotha américain. À 18 ans, Sophie s'installe à Paris pour intégrer au début des années 1980, le Studio Berçot, une école de stylisme. Elle se fait remarquer en 1984 avec une collection pour le Printemps qui a connu un grand succès. Elle reçoit le prix Printemps du Jeune Designer. Repérée et embauchée par le déjà très influent Jean-Paul Gaultier, elle apprend chez lui à donner libre court à sa fantaisie, à jouer avec les couleurs. Elle rejoint ensuite durant une décennie le grand couturier franco-tunisien, Azzedine Alaïa, avant de déménager à New York pour suivre son mari canadien, qui vivait à New York. Et c'est avec Azzedine qu’elle dit avoir tout appris. Le créateur qui sait sublimer comme nul autre les courbes féminines par la précision de ses coupes et qui lui apprend la rigueur et la couture, confiera-t-elle. Elle vit à Brooklyn Heights, au troisième étage d'un immeuble art-déco non loin du pont de Brooklyn, qu'elle a transformé en atelier. Son atelier est aussi l'appartement où elle vit et travaille avec son mari Steven Francoeur, un ancien mannequin québécois et Léon leur petit garçon. Après avoir déménagé à New York, elle a continué à travailler avec Alaïa à temps partiel, tout en travaillant en freelance pour différentes marques américaines. En 2005, elle lance une petite ligne resort, Motu Tane. En 2007, elle lance sa propre marque, Sophie Theallet, à New York. Le rêve américain commence vraiment en 2009 pour la styliste, lorsque ses créations féminines et gaies, destinées à habiller une femme élégante en perpétuel mouvement, attirent l'œil de Michelle Obama, Première dame américaine et nouvelle icône mondiale de la mode. Elle n'a alors lancé sa marque que depuis deux ans et travaille encore avec son mari depuis chez elle à Brooklyn. Consacrée par la Première dame, elle se voit ouvrir, outre les portes de la Maison Blanche, où elle est invitée, celles des salons de la haute société américaine. En novembre 2009, elle est lauréate du 1er prix CFDA/Vogue Fashion Fund Awards du meilleur créateur de l'année aux États-Unis et aussi du magazine américain Vogue, l'une des récompenses les plus prestigieuses dans la mode aux États-Unis. Elle est encensée aussi par le New York Times. Les stars affluent et avec elles une importante clientèle fortunée. Le magazine Vogue écrit assez régulièrement sur ses défilés. En juillet 2012, elle est la lauréate de l’International Woolmark Prize. En novembre 2016, très attachée à la présidence Obama, dans une lettre ouverte publiée sur Twitter elle explique pourquoi elle n'habillera pas Melania, la future Première dame des États-Unis, épouse de Donald Trump. Car écrit-elle « la rhétorique raciste, sexiste et xénophobe de la campagne de son mari sont incompatibles avec son travail ». Plus qu'un plaidoyer pour Michèle Obama, ce texte participe d'une campagne contre Donald Trump. Et elle demande même à ses confrères et les autres designers d'en faire de même. Elle termine sa lettre ouverte par un message digne d'un slogan : « L'intégrité est notre seule vraie devise ». À défaut d’habiller la future Première dame, elle a donc taillé un costard au futur Président des États-Unis. Quelques jours plus tard, le styliste américain Tommy Hilfiger a répondu à sa lettre en disant que Melania était une très belle femme et qu'il pensait que n'importe quel designer serait très fier de l'habiller. Cette lettre de Sophie, publiée sur les réseaux sociaux, a fait grand bruit. Pendant des mois, elle en a subi les contrecoups, recevant des critiques et des menaces par téléphone, par courriel et sur les réseaux sociaux. Sophie avait séduit les Américains par son style « bohémien chic ». Chiffon, froncé, plissé, coupes en biais, les vêtements sont fluides. Ce style évoquait parfois l'Afrique du nord et ses caftans, parfois l'Afrique noire et ses cotons de couleur vive, parfois d'autres horizons. La créatrice osait les mélanges de couleurs inattendus, souvent travaillés dans des imprimés ethniques. Des tenues faciles à porter, intemporelles et destinées aux femmes de tous âges. Les créations Sophie Théallet se vendaient désormais dans une dizaine de pays, surtout aux États-Unis et au Canada, en Australie, en Russie et au Moyen-Orient. Mais pas en France, où elle ne désespérait pas de vendre aussi ses créations. « On aimerait la voir arriver en France un jour peut-être », avait déclaré Cécilia Attias, l'ex-épouse de Nicolas Sarkozy. Parce qu'être reconnue et vendue sur sa terre natale, « ce serait cool ». Elle a été distribuée dans une vingtaine de magasins américains dont Barneys à New York et à Beverly Hills, mais aussi à Londres et à Koweit City. Établie à New York pendant de nombreuses années, la designer française Sophie Theallet était une habituée des passerelles et des tapis rouges. Michelle Obama, Oprah Winfrey, Jennifer Lopez et Kim Kardashian ne sont que quelques-unes des femmes qui ont porté ses créations. Puis, elle en a eu assez. Assez de tous les artifices qui entourent la haute couture. Assez aussi du climat politique américain. Sophie, son mari (et partenaire d’affaires) Steve Francoeur et leur fils ont débarqué en 2018 à Montréal sans tambour ni trompette, à cause bien sûr du contexte politique aux États-Unis. Installée désormais à Montréal, elle vient de lancer Room 502, une nouvelle marque de luxe éthique qui est en phase avec ses convictions. Une marque qui tire son nom de l’appartement de l’hôtel Chelsea où ont vécu Sophie et Steve à leur arrivée à New York. Room 502 mise plutôt sur de petites séries, produites en quantité limitée et renouvelées tous les trois ou quatre mois. L’idée étant de produire moins et de produire bien et également de rendre plus accessibles les vêtements de luxe. La marque Sophie Theallet, qui s’était bien établie dans le monde de la mode depuis son lancement en 2007 aux Etats-Unis, a alors été mise en veilleuse. Sophie est la fille du Dr Jean Claude Théallet, fort connu à Bagnères-de-Bigorre et de son épouse née Burgué, ex championne de ski et de tennis, et qui ont eu six enfants dont cinq garçons et une fille, Sophie. En 2010, dans les salons de la mairie de Bagnères-de-Bigorre, le maire Roland Castells lui a remis la médaille d’honneur de la ville de Bagnères-de-Bigorre. Son attachement à la richesse artisanale de la mode, à la finesse d'exécution d'un patron et à l'art du détail, lui avait valu un bel accueil aux États-Unis. Pour la production de ses prochaines séries au Canada, qui comprendront robes, écharpes, chemisiers et pantalons, la designer fera appel à des ateliers montréalais, new-yorkais et, éventuellement, européens puisqu’elle décrit son entreprise comme «citoyenne du monde».
Sophie THÉALLET, née en 1964 à Bagnères-de-Bigorre, établie à New York, est une styliste très honorée de voir ses vêtements portés par Michèle Obama, la Première dame des États-Unis, pendant ses 8 années à la Maison Blanche et aussi par tout le gotha américain. À 18 ans, Sophie s'installe à Paris pour intégrer au début des années 1980, le Studio Berçot, une école de stylisme. Elle se fait remarquer en 1984 avec une collection pour le Printemps qui a connu un grand succès. Elle reçoit le prix Printemps du Jeune Designer. Repérée et embauchée par le déjà très influent Jean-Paul Gaultier, elle apprend chez lui à donner libre court à sa fantaisie, à jouer avec les couleurs. Elle rejoint ensuite durant une décennie le grand couturier franco-tunisien, Azzedine Alaïa, avant de déménager à New York pour suivre son mari canadien, qui vivait à New York. Et c'est avec Azzedine qu’elle dit avoir tout appris. Le créateur qui sait sublimer comme nul autre les courbes féminines par la précision de ses coupes et qui lui apprend la rigueur et la couture, confiera-t-elle. Elle vit à Brooklyn Heights, au troisième étage d'un immeuble art-déco non loin du pont de Brooklyn, qu'elle a transformé en atelier. Son atelier est aussi l'appartement où elle vit et travaille avec son mari Steven Francoeur, un ancien mannequin québécois et Léon leur petit garçon. Après avoir déménagé à New York, elle a continué à travailler avec Alaïa à temps partiel, tout en travaillant en freelance pour différentes marques américaines. En 2005, elle lance une petite ligne resort, Motu Tane. En 2007, elle lance sa propre marque, Sophie Theallet, à New York. Le rêve américain commence vraiment en 2009 pour la styliste, lorsque ses créations féminines et gaies, destinées à habiller une femme élégante en perpétuel mouvement, attirent l'œil de Michelle Obama, Première dame américaine et nouvelle icône mondiale de la mode. Elle n'a alors lancé sa marque que depuis deux ans et travaille encore avec son mari depuis chez elle à Brooklyn. Consacrée par la Première dame, elle se voit ouvrir, outre les portes de la Maison Blanche, où elle est invitée, celles des salons de la haute société américaine. En novembre 2009, elle est lauréate du 1er prix CFDA/Vogue Fashion Fund Awards du meilleur créateur de l'année aux États-Unis et aussi du magazine américain Vogue, l'une des récompenses les plus prestigieuses dans la mode aux États-Unis. Elle est encensée aussi par le New York Times. Les stars affluent et avec elles une importante clientèle fortunée. Le magazine Vogue écrit assez régulièrement sur ses défilés. En juillet 2012, elle est la lauréate de l’International Woolmark Prize. En novembre 2016, très attachée à la présidence Obama, dans une lettre ouverte publiée sur Twitter elle explique pourquoi elle n'habillera pas Melania, la future Première dame des États-Unis, épouse de Donald Trump. Car écrit-elle « la rhétorique raciste, sexiste et xénophobe de la campagne de son mari sont incompatibles avec son travail ». Plus qu'un plaidoyer pour Michèle Obama, ce texte participe d'une campagne contre Donald Trump. Et elle demande même à ses confrères et les autres designers d'en faire de même. Elle termine sa lettre ouverte par un message digne d'un slogan : « L'intégrité est notre seule vraie devise ». À défaut d’habiller la future Première dame, elle a donc taillé un costard au futur Président des États-Unis. Quelques jours plus tard, le styliste américain Tommy Hilfiger a répondu à sa lettre en disant que Melania était une très belle femme et qu'il pensait que n'importe quel designer serait très fier de l'habiller. Cette lettre de Sophie, publiée sur les réseaux sociaux, a fait grand bruit. Pendant des mois, elle en a subi les contrecoups, recevant des critiques et des menaces par téléphone, par courriel et sur les réseaux sociaux. Sophie avait séduit les Américains par son style « bohémien chic ». Chiffon, froncé, plissé, coupes en biais, les vêtements sont fluides. Ce style évoquait parfois l'Afrique du nord et ses caftans, parfois l'Afrique noire et ses cotons de couleur vive, parfois d'autres horizons. La créatrice osait les mélanges de couleurs inattendus, souvent travaillés dans des imprimés ethniques. Des tenues faciles à porter, intemporelles et destinées aux femmes de tous âges. Les créations Sophie Théallet se vendaient désormais dans une dizaine de pays, surtout aux États-Unis et au Canada, en Australie, en Russie et au Moyen-Orient. Mais pas en France, où elle ne désespérait pas de vendre aussi ses créations. « On aimerait la voir arriver en France un jour peut-être », avait déclaré Cécilia Attias, l'ex-épouse de Nicolas Sarkozy. Parce qu'être reconnue et vendue sur sa terre natale, « ce serait cool ». Elle a été distribuée dans une vingtaine de magasins américains dont Barneys à New York et à Beverly Hills, mais aussi à Londres et à Koweit City. Établie à New York pendant de nombreuses années, la designer française Sophie Theallet était une habituée des passerelles et des tapis rouges. Michelle Obama, Oprah Winfrey, Jennifer Lopez et Kim Kardashian ne sont que quelques-unes des femmes qui ont porté ses créations. Puis, elle en a eu assez. Assez de tous les artifices qui entourent la haute couture. Assez aussi du climat politique américain. Sophie, son mari (et partenaire d’affaires) Steve Francoeur et leur fils ont débarqué en 2018 à Montréal sans tambour ni trompette, à cause bien sûr du contexte politique aux États-Unis. Installée désormais à Montréal, elle vient de lancer Room 502, une nouvelle marque de luxe éthique qui est en phase avec ses convictions. Une marque qui tire son nom de l’appartement de l’hôtel Chelsea où ont vécu Sophie et Steve à leur arrivée à New York. Room 502 mise plutôt sur de petites séries, produites en quantité limitée et renouvelées tous les trois ou quatre mois. L’idée étant de produire moins et de produire bien et également de rendre plus accessibles les vêtements de luxe. La marque Sophie Theallet, qui s’était bien établie dans le monde de la mode depuis son lancement en 2007 aux Etats-Unis, a alors été mise en veilleuse. Sophie est la fille du Dr Jean Claude Théallet, fort connu à Bagnères-de-Bigorre et de son épouse née Burgué, ex championne de ski et de tennis, et qui ont eu six enfants dont cinq garçons et une fille, Sophie. En 2010, dans les salons de la mairie de Bagnères-de-Bigorre, le maire Roland Castells lui a remis la médaille d’honneur de la ville de Bagnères-de-Bigorre. Son attachement à la richesse artisanale de la mode, à la finesse d'exécution d'un patron et à l'art du détail, lui avait valu un bel accueil aux États-Unis. Pour la production de ses prochaines séries au Canada, qui comprendront robes, écharpes, chemisiers et pantalons, la designer fera appel à des ateliers montréalais, new-yorkais et, éventuellement, européens puisqu’elle décrit son entreprise comme «citoyenne du monde».TOUYA Anne-Lise (1981-XXXX)
Championne d'escrime dans la catégorie du sabre médaillée olympique
 Anne-Lise TOUYA, née le 19 octobre 1981 à Tarbes est la benjamine d'une fratrie d'escrimeurs : en 2004, l'aîné Gaël, fut médaillé d’or olympique à Athènes avec l'équipe de France de sabre, tout comme son deuxième frère, Damien, de 2 ans son cadet, qui lui fut également champion du monde en individuel en 1999 et surtout médaillé de bronze olympique à Atlanta en 1996. Après les Jeux de 2004, ses frères renoncent à leur carrière sportive. Sœur cadette, Anne-Lise a commencé par faire du fleuret puis s'est mise au sabre car l'école de Tarbes était plus performante dans cette discipline et elle rejoindra en 1998, le Creps de Châtenay-Malabry. En 2001, après deux Coupes du monde, elle remporte le titre mondial individuel de sabre à Nîmes, dominant son adversaire, l'Italienne Ilaria Bianco, sur un score de 15-3. En 2005, aux mondiaux de Leipzig, elle remporte son deuxième titre mondial individuel, quatre ans après son premier, en battant en finale (15-13), la Russe Sophia Velikaia. Sélectionnée pour les Jeux olympiques de 2008 à Pékin, elle est éliminée dès son entrée en lice, face à la Hongroise Orsolya Nagy. Elle s’y classera 4e avec l'équipe de France dans l'épreuve du sabre féminin par équipes, battues par les États-Unis pour la médaille de bronze. À la fin de l'année 2008, à 27 ans, elle décide de mettre fin de sa carrière sportive et de s'investir dans sa vie professionnelle et familiale. Double championne du monde individuelle de sabre, deux fois championne du monde par équipes (2006-2007), deux fois championne d’Europe par équipes et une fois en individuel, diplômée de management de l'École supérieure de commerce de Paris en 2006, elle travaille aujourd’hui comme cadre RH chez Bouygues Construction.
Anne-Lise TOUYA, née le 19 octobre 1981 à Tarbes est la benjamine d'une fratrie d'escrimeurs : en 2004, l'aîné Gaël, fut médaillé d’or olympique à Athènes avec l'équipe de France de sabre, tout comme son deuxième frère, Damien, de 2 ans son cadet, qui lui fut également champion du monde en individuel en 1999 et surtout médaillé de bronze olympique à Atlanta en 1996. Après les Jeux de 2004, ses frères renoncent à leur carrière sportive. Sœur cadette, Anne-Lise a commencé par faire du fleuret puis s'est mise au sabre car l'école de Tarbes était plus performante dans cette discipline et elle rejoindra en 1998, le Creps de Châtenay-Malabry. En 2001, après deux Coupes du monde, elle remporte le titre mondial individuel de sabre à Nîmes, dominant son adversaire, l'Italienne Ilaria Bianco, sur un score de 15-3. En 2005, aux mondiaux de Leipzig, elle remporte son deuxième titre mondial individuel, quatre ans après son premier, en battant en finale (15-13), la Russe Sophia Velikaia. Sélectionnée pour les Jeux olympiques de 2008 à Pékin, elle est éliminée dès son entrée en lice, face à la Hongroise Orsolya Nagy. Elle s’y classera 4e avec l'équipe de France dans l'épreuve du sabre féminin par équipes, battues par les États-Unis pour la médaille de bronze. À la fin de l'année 2008, à 27 ans, elle décide de mettre fin de sa carrière sportive et de s'investir dans sa vie professionnelle et familiale. Double championne du monde individuelle de sabre, deux fois championne du monde par équipes (2006-2007), deux fois championne d’Europe par équipes et une fois en individuel, diplômée de management de l'École supérieure de commerce de Paris en 2006, elle travaille aujourd’hui comme cadre RH chez Bouygues Construction.
 Anne-Lise TOUYA, née le 19 octobre 1981 à Tarbes est la benjamine d'une fratrie d'escrimeurs : en 2004, l'aîné Gaël, fut médaillé d’or olympique à Athènes avec l'équipe de France de sabre, tout comme son deuxième frère, Damien, de 2 ans son cadet, qui lui fut également champion du monde en individuel en 1999 et surtout médaillé de bronze olympique à Atlanta en 1996. Après les Jeux de 2004, ses frères renoncent à leur carrière sportive. Sœur cadette, Anne-Lise a commencé par faire du fleuret puis s'est mise au sabre car l'école de Tarbes était plus performante dans cette discipline et elle rejoindra en 1998, le Creps de Châtenay-Malabry. En 2001, après deux Coupes du monde, elle remporte le titre mondial individuel de sabre à Nîmes, dominant son adversaire, l'Italienne Ilaria Bianco, sur un score de 15-3. En 2005, aux mondiaux de Leipzig, elle remporte son deuxième titre mondial individuel, quatre ans après son premier, en battant en finale (15-13), la Russe Sophia Velikaia. Sélectionnée pour les Jeux olympiques de 2008 à Pékin, elle est éliminée dès son entrée en lice, face à la Hongroise Orsolya Nagy. Elle s’y classera 4e avec l'équipe de France dans l'épreuve du sabre féminin par équipes, battues par les États-Unis pour la médaille de bronze. À la fin de l'année 2008, à 27 ans, elle décide de mettre fin de sa carrière sportive et de s'investir dans sa vie professionnelle et familiale. Double championne du monde individuelle de sabre, deux fois championne du monde par équipes (2006-2007), deux fois championne d’Europe par équipes et une fois en individuel, diplômée de management de l'École supérieure de commerce de Paris en 2006, elle travaille aujourd’hui comme cadre RH chez Bouygues Construction.
Anne-Lise TOUYA, née le 19 octobre 1981 à Tarbes est la benjamine d'une fratrie d'escrimeurs : en 2004, l'aîné Gaël, fut médaillé d’or olympique à Athènes avec l'équipe de France de sabre, tout comme son deuxième frère, Damien, de 2 ans son cadet, qui lui fut également champion du monde en individuel en 1999 et surtout médaillé de bronze olympique à Atlanta en 1996. Après les Jeux de 2004, ses frères renoncent à leur carrière sportive. Sœur cadette, Anne-Lise a commencé par faire du fleuret puis s'est mise au sabre car l'école de Tarbes était plus performante dans cette discipline et elle rejoindra en 1998, le Creps de Châtenay-Malabry. En 2001, après deux Coupes du monde, elle remporte le titre mondial individuel de sabre à Nîmes, dominant son adversaire, l'Italienne Ilaria Bianco, sur un score de 15-3. En 2005, aux mondiaux de Leipzig, elle remporte son deuxième titre mondial individuel, quatre ans après son premier, en battant en finale (15-13), la Russe Sophia Velikaia. Sélectionnée pour les Jeux olympiques de 2008 à Pékin, elle est éliminée dès son entrée en lice, face à la Hongroise Orsolya Nagy. Elle s’y classera 4e avec l'équipe de France dans l'épreuve du sabre féminin par équipes, battues par les États-Unis pour la médaille de bronze. À la fin de l'année 2008, à 27 ans, elle décide de mettre fin de sa carrière sportive et de s'investir dans sa vie professionnelle et familiale. Double championne du monde individuelle de sabre, deux fois championne du monde par équipes (2006-2007), deux fois championne d’Europe par équipes et une fois en individuel, diplômée de management de l'École supérieure de commerce de Paris en 2006, elle travaille aujourd’hui comme cadre RH chez Bouygues Construction.TOUYA Damien (1975-XXXX)
Escrimeur médaillé olympique
 Damien TOUYA, né le 23 avril 1975 à La Rochelle, est un escrimeur, pratiquant le sabre. Formé à l'Amicale tarbaise d'escrime (ATE), il a été champion du monde en individuel et par équipes, dont l'un des autres membres est son frère Gaël. Ensemble ils remportent le titre olympique par équipe lors des Jeux olympiques 2004 à Athènes. Issu d'une famille de sportifs, dont le père entraîneur et mentor est vice-président à la Fédération française d'escrime, il rejoint en 1993 son frère Gaël à L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) à Paris, qui regroupe l'élite de l'escrime français. Après un titre mondial junior en 1995, il fait ses débuts dans les compétitions seniors, remportant un premier titre lors des championnats d'Europe. Il est ensuite intégré à l'équipe de France qui se rend aux Jeux olympiques 1996 d’Atlanta. Bien qu'il n'ait que 21 ans, dans une arme considérée jusqu'alors comme privilégiant l'expérience, il remporte une médaille de bronze lors de la compétition individuelle. En 1997, l'équipe de France dont il fait partie avec son frère Gaël, remporte le titre mondial lors des championnats du monde d'escrime. En 1998, il remporte une médaille d’argent par équipe lors de championnats du monde. À cette compétition, son frère Gaël, aujourd'hui professeur d'EPS à l'Université Paul Sabatier à Toulouse, occupait le poste de remplaçant. En 1999, lors des championnats du monde de Séoul, il remporte le titre mondial en individuel. Puis, il remporte une deuxième médaille d'or en gagnant la compétition par équipe, composée de Matthieu Gourdain, Jean-Philippe Daurelle et Julien Pillet. Il se présente ainsi comme l'un des principaux favoris de l'épreuve individuelle du sabre aux Jeux olympiques 2000 à Sydney. Lors de celle-ci, il échoue en quart de finale face au roumain Mihai Covaliu, qui remportera ensuite le titre face à un autre Français Matthieu Gourdain, et qui sera sacré champion olympique au sabre aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Dans la compétition par équipe, composée de Gourdain, Pillet et Cédric Seguin, la France remportera la médaille d'argent. Pour l'édition suivante des Jeux olympiques 2004 à Athènes, il retrouve son frère lors de la compétition par équipe ; le troisième tireur est Julien Pillet, le rôle de remplaçant étant occupé par Boris Sanson. Après avoir éliminé la Chine, l'équipe de France se voit opposée aux États-Unis en demi-finale. Damien a la responsabilité d'être le dernier relayeur français. Lors de ce dernier relais, sa main est transpercée par la lame de l'Américain Keeth Smart lors de l'assaut pour la 45e et dernière touche. Après dix minutes de soins, le sabreur reprend son gant et se présente pour un contre victorieux qui allait conduire les Tricolores en finale. Après la pause le séparant de la finale, il convainc l'encadrement qu'il peut tenir sa place face aux Italiens. Lors de celle-ci, les Français prennent rapidement l'avantage, menant 25 à 18 avant le deuxième relais de Damien Touya. Celui-ci l'oppose à Aldo Montano, qui remet son équipe dans le match en recollant à 30 à 29. Damien Touya, qui a la responsabilité du dernier assaut, débute celui-ci sur le score de 40 à 39 pour les Italiens. Lors de celui-ci, Touya domine Luigi Tarantino et termine la rencontre sur le score 45 à 42. Peu après le tournoi olympique, il annonce, tout comme son frère, la fin de sa carrière, laissant à leur sœur Anne-Lise Touya, sabreuse, qui est la dernière représentante de la famille à encore pratiquer l'escrime de haut niveau en compétition, le soin de porter les couleurs de la famille. Elle a à son actif notamment, un titre de championne d'Europe, deux titres de championne du monde consécutifs, un titre de championne du monde par équipe. Damien est papa d'une petite fille prénommée Clara et est entraîneur dans un club de sabre toulousain. Il a aussi un poste à la Fédération française d'escrime (FFE), où il travaille en tant que conseiller technique sportif pour la région Midi-Pyrénées. « C'est déjà beau de participer aux JO. C'est encore plus beau de le faire avec un membre de sa famille. Nous avions écrit l'histoire de cette discipline (le sabre) et le faire avec son frère, c'est un moment inoubliable. » Son palmarès : Médaille d'or par équipe aux jeux Olympiques d’été 2004 à Athènes ; Médaille d'argent par équipe aux Jeux olympiques d’été 2000 à Sydney ; Médaille de bronze individuelle aux Jeux olympiques d’été 1996 à Atlanta ; Médaille d’or aux Championnats du monde d'escrime en 1999 ; Médaille d'or par équipe aux Championnats du monde d'escrime en 1999 ; Médaille d'or par équipe aux Championnats du monde d'escrime en 1997 ; Médaille d'argent par équipe aux Championnats du monde d'escrime en 1998 ; Médaille de bronze aux Championnats du monde d'escrime en 1997 ; Médaille d'or par équipe aux Championnats d'Europe d'escrime en 1999 ; Médaille d'or aux Championnats d'Europe d'escrime en 1996. Il possède la plus haute distinction française, puisque qu’il a été fait Chevalier de la Légion d'honneur. Damien Touya, auréolé de très nombreux titres prestigieux est toujours heureux de témoigner auprès des jeunes de ses expériences sportives internationales. Autant de victoires qui consacrèrent l'excellence de l'escrime en France, grand pourvoyeur de médailles mondiales et olympiques, mais aussi le travail effectué depuis des années à Tarbes par un club et une famille pyrénéenne hors du commun.
Damien TOUYA, né le 23 avril 1975 à La Rochelle, est un escrimeur, pratiquant le sabre. Formé à l'Amicale tarbaise d'escrime (ATE), il a été champion du monde en individuel et par équipes, dont l'un des autres membres est son frère Gaël. Ensemble ils remportent le titre olympique par équipe lors des Jeux olympiques 2004 à Athènes. Issu d'une famille de sportifs, dont le père entraîneur et mentor est vice-président à la Fédération française d'escrime, il rejoint en 1993 son frère Gaël à L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) à Paris, qui regroupe l'élite de l'escrime français. Après un titre mondial junior en 1995, il fait ses débuts dans les compétitions seniors, remportant un premier titre lors des championnats d'Europe. Il est ensuite intégré à l'équipe de France qui se rend aux Jeux olympiques 1996 d’Atlanta. Bien qu'il n'ait que 21 ans, dans une arme considérée jusqu'alors comme privilégiant l'expérience, il remporte une médaille de bronze lors de la compétition individuelle. En 1997, l'équipe de France dont il fait partie avec son frère Gaël, remporte le titre mondial lors des championnats du monde d'escrime. En 1998, il remporte une médaille d’argent par équipe lors de championnats du monde. À cette compétition, son frère Gaël, aujourd'hui professeur d'EPS à l'Université Paul Sabatier à Toulouse, occupait le poste de remplaçant. En 1999, lors des championnats du monde de Séoul, il remporte le titre mondial en individuel. Puis, il remporte une deuxième médaille d'or en gagnant la compétition par équipe, composée de Matthieu Gourdain, Jean-Philippe Daurelle et Julien Pillet. Il se présente ainsi comme l'un des principaux favoris de l'épreuve individuelle du sabre aux Jeux olympiques 2000 à Sydney. Lors de celle-ci, il échoue en quart de finale face au roumain Mihai Covaliu, qui remportera ensuite le titre face à un autre Français Matthieu Gourdain, et qui sera sacré champion olympique au sabre aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Dans la compétition par équipe, composée de Gourdain, Pillet et Cédric Seguin, la France remportera la médaille d'argent. Pour l'édition suivante des Jeux olympiques 2004 à Athènes, il retrouve son frère lors de la compétition par équipe ; le troisième tireur est Julien Pillet, le rôle de remplaçant étant occupé par Boris Sanson. Après avoir éliminé la Chine, l'équipe de France se voit opposée aux États-Unis en demi-finale. Damien a la responsabilité d'être le dernier relayeur français. Lors de ce dernier relais, sa main est transpercée par la lame de l'Américain Keeth Smart lors de l'assaut pour la 45e et dernière touche. Après dix minutes de soins, le sabreur reprend son gant et se présente pour un contre victorieux qui allait conduire les Tricolores en finale. Après la pause le séparant de la finale, il convainc l'encadrement qu'il peut tenir sa place face aux Italiens. Lors de celle-ci, les Français prennent rapidement l'avantage, menant 25 à 18 avant le deuxième relais de Damien Touya. Celui-ci l'oppose à Aldo Montano, qui remet son équipe dans le match en recollant à 30 à 29. Damien Touya, qui a la responsabilité du dernier assaut, débute celui-ci sur le score de 40 à 39 pour les Italiens. Lors de celui-ci, Touya domine Luigi Tarantino et termine la rencontre sur le score 45 à 42. Peu après le tournoi olympique, il annonce, tout comme son frère, la fin de sa carrière, laissant à leur sœur Anne-Lise Touya, sabreuse, qui est la dernière représentante de la famille à encore pratiquer l'escrime de haut niveau en compétition, le soin de porter les couleurs de la famille. Elle a à son actif notamment, un titre de championne d'Europe, deux titres de championne du monde consécutifs, un titre de championne du monde par équipe. Damien est papa d'une petite fille prénommée Clara et est entraîneur dans un club de sabre toulousain. Il a aussi un poste à la Fédération française d'escrime (FFE), où il travaille en tant que conseiller technique sportif pour la région Midi-Pyrénées. « C'est déjà beau de participer aux JO. C'est encore plus beau de le faire avec un membre de sa famille. Nous avions écrit l'histoire de cette discipline (le sabre) et le faire avec son frère, c'est un moment inoubliable. » Son palmarès : Médaille d'or par équipe aux jeux Olympiques d’été 2004 à Athènes ; Médaille d'argent par équipe aux Jeux olympiques d’été 2000 à Sydney ; Médaille de bronze individuelle aux Jeux olympiques d’été 1996 à Atlanta ; Médaille d’or aux Championnats du monde d'escrime en 1999 ; Médaille d'or par équipe aux Championnats du monde d'escrime en 1999 ; Médaille d'or par équipe aux Championnats du monde d'escrime en 1997 ; Médaille d'argent par équipe aux Championnats du monde d'escrime en 1998 ; Médaille de bronze aux Championnats du monde d'escrime en 1997 ; Médaille d'or par équipe aux Championnats d'Europe d'escrime en 1999 ; Médaille d'or aux Championnats d'Europe d'escrime en 1996. Il possède la plus haute distinction française, puisque qu’il a été fait Chevalier de la Légion d'honneur. Damien Touya, auréolé de très nombreux titres prestigieux est toujours heureux de témoigner auprès des jeunes de ses expériences sportives internationales. Autant de victoires qui consacrèrent l'excellence de l'escrime en France, grand pourvoyeur de médailles mondiales et olympiques, mais aussi le travail effectué depuis des années à Tarbes par un club et une famille pyrénéenne hors du commun.
 Damien TOUYA, né le 23 avril 1975 à La Rochelle, est un escrimeur, pratiquant le sabre. Formé à l'Amicale tarbaise d'escrime (ATE), il a été champion du monde en individuel et par équipes, dont l'un des autres membres est son frère Gaël. Ensemble ils remportent le titre olympique par équipe lors des Jeux olympiques 2004 à Athènes. Issu d'une famille de sportifs, dont le père entraîneur et mentor est vice-président à la Fédération française d'escrime, il rejoint en 1993 son frère Gaël à L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) à Paris, qui regroupe l'élite de l'escrime français. Après un titre mondial junior en 1995, il fait ses débuts dans les compétitions seniors, remportant un premier titre lors des championnats d'Europe. Il est ensuite intégré à l'équipe de France qui se rend aux Jeux olympiques 1996 d’Atlanta. Bien qu'il n'ait que 21 ans, dans une arme considérée jusqu'alors comme privilégiant l'expérience, il remporte une médaille de bronze lors de la compétition individuelle. En 1997, l'équipe de France dont il fait partie avec son frère Gaël, remporte le titre mondial lors des championnats du monde d'escrime. En 1998, il remporte une médaille d’argent par équipe lors de championnats du monde. À cette compétition, son frère Gaël, aujourd'hui professeur d'EPS à l'Université Paul Sabatier à Toulouse, occupait le poste de remplaçant. En 1999, lors des championnats du monde de Séoul, il remporte le titre mondial en individuel. Puis, il remporte une deuxième médaille d'or en gagnant la compétition par équipe, composée de Matthieu Gourdain, Jean-Philippe Daurelle et Julien Pillet. Il se présente ainsi comme l'un des principaux favoris de l'épreuve individuelle du sabre aux Jeux olympiques 2000 à Sydney. Lors de celle-ci, il échoue en quart de finale face au roumain Mihai Covaliu, qui remportera ensuite le titre face à un autre Français Matthieu Gourdain, et qui sera sacré champion olympique au sabre aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Dans la compétition par équipe, composée de Gourdain, Pillet et Cédric Seguin, la France remportera la médaille d'argent. Pour l'édition suivante des Jeux olympiques 2004 à Athènes, il retrouve son frère lors de la compétition par équipe ; le troisième tireur est Julien Pillet, le rôle de remplaçant étant occupé par Boris Sanson. Après avoir éliminé la Chine, l'équipe de France se voit opposée aux États-Unis en demi-finale. Damien a la responsabilité d'être le dernier relayeur français. Lors de ce dernier relais, sa main est transpercée par la lame de l'Américain Keeth Smart lors de l'assaut pour la 45e et dernière touche. Après dix minutes de soins, le sabreur reprend son gant et se présente pour un contre victorieux qui allait conduire les Tricolores en finale. Après la pause le séparant de la finale, il convainc l'encadrement qu'il peut tenir sa place face aux Italiens. Lors de celle-ci, les Français prennent rapidement l'avantage, menant 25 à 18 avant le deuxième relais de Damien Touya. Celui-ci l'oppose à Aldo Montano, qui remet son équipe dans le match en recollant à 30 à 29. Damien Touya, qui a la responsabilité du dernier assaut, débute celui-ci sur le score de 40 à 39 pour les Italiens. Lors de celui-ci, Touya domine Luigi Tarantino et termine la rencontre sur le score 45 à 42. Peu après le tournoi olympique, il annonce, tout comme son frère, la fin de sa carrière, laissant à leur sœur Anne-Lise Touya, sabreuse, qui est la dernière représentante de la famille à encore pratiquer l'escrime de haut niveau en compétition, le soin de porter les couleurs de la famille. Elle a à son actif notamment, un titre de championne d'Europe, deux titres de championne du monde consécutifs, un titre de championne du monde par équipe. Damien est papa d'une petite fille prénommée Clara et est entraîneur dans un club de sabre toulousain. Il a aussi un poste à la Fédération française d'escrime (FFE), où il travaille en tant que conseiller technique sportif pour la région Midi-Pyrénées. « C'est déjà beau de participer aux JO. C'est encore plus beau de le faire avec un membre de sa famille. Nous avions écrit l'histoire de cette discipline (le sabre) et le faire avec son frère, c'est un moment inoubliable. » Son palmarès : Médaille d'or par équipe aux jeux Olympiques d’été 2004 à Athènes ; Médaille d'argent par équipe aux Jeux olympiques d’été 2000 à Sydney ; Médaille de bronze individuelle aux Jeux olympiques d’été 1996 à Atlanta ; Médaille d’or aux Championnats du monde d'escrime en 1999 ; Médaille d'or par équipe aux Championnats du monde d'escrime en 1999 ; Médaille d'or par équipe aux Championnats du monde d'escrime en 1997 ; Médaille d'argent par équipe aux Championnats du monde d'escrime en 1998 ; Médaille de bronze aux Championnats du monde d'escrime en 1997 ; Médaille d'or par équipe aux Championnats d'Europe d'escrime en 1999 ; Médaille d'or aux Championnats d'Europe d'escrime en 1996. Il possède la plus haute distinction française, puisque qu’il a été fait Chevalier de la Légion d'honneur. Damien Touya, auréolé de très nombreux titres prestigieux est toujours heureux de témoigner auprès des jeunes de ses expériences sportives internationales. Autant de victoires qui consacrèrent l'excellence de l'escrime en France, grand pourvoyeur de médailles mondiales et olympiques, mais aussi le travail effectué depuis des années à Tarbes par un club et une famille pyrénéenne hors du commun.
Damien TOUYA, né le 23 avril 1975 à La Rochelle, est un escrimeur, pratiquant le sabre. Formé à l'Amicale tarbaise d'escrime (ATE), il a été champion du monde en individuel et par équipes, dont l'un des autres membres est son frère Gaël. Ensemble ils remportent le titre olympique par équipe lors des Jeux olympiques 2004 à Athènes. Issu d'une famille de sportifs, dont le père entraîneur et mentor est vice-président à la Fédération française d'escrime, il rejoint en 1993 son frère Gaël à L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) à Paris, qui regroupe l'élite de l'escrime français. Après un titre mondial junior en 1995, il fait ses débuts dans les compétitions seniors, remportant un premier titre lors des championnats d'Europe. Il est ensuite intégré à l'équipe de France qui se rend aux Jeux olympiques 1996 d’Atlanta. Bien qu'il n'ait que 21 ans, dans une arme considérée jusqu'alors comme privilégiant l'expérience, il remporte une médaille de bronze lors de la compétition individuelle. En 1997, l'équipe de France dont il fait partie avec son frère Gaël, remporte le titre mondial lors des championnats du monde d'escrime. En 1998, il remporte une médaille d’argent par équipe lors de championnats du monde. À cette compétition, son frère Gaël, aujourd'hui professeur d'EPS à l'Université Paul Sabatier à Toulouse, occupait le poste de remplaçant. En 1999, lors des championnats du monde de Séoul, il remporte le titre mondial en individuel. Puis, il remporte une deuxième médaille d'or en gagnant la compétition par équipe, composée de Matthieu Gourdain, Jean-Philippe Daurelle et Julien Pillet. Il se présente ainsi comme l'un des principaux favoris de l'épreuve individuelle du sabre aux Jeux olympiques 2000 à Sydney. Lors de celle-ci, il échoue en quart de finale face au roumain Mihai Covaliu, qui remportera ensuite le titre face à un autre Français Matthieu Gourdain, et qui sera sacré champion olympique au sabre aux Jeux olympiques de Sydney en 2000. Dans la compétition par équipe, composée de Gourdain, Pillet et Cédric Seguin, la France remportera la médaille d'argent. Pour l'édition suivante des Jeux olympiques 2004 à Athènes, il retrouve son frère lors de la compétition par équipe ; le troisième tireur est Julien Pillet, le rôle de remplaçant étant occupé par Boris Sanson. Après avoir éliminé la Chine, l'équipe de France se voit opposée aux États-Unis en demi-finale. Damien a la responsabilité d'être le dernier relayeur français. Lors de ce dernier relais, sa main est transpercée par la lame de l'Américain Keeth Smart lors de l'assaut pour la 45e et dernière touche. Après dix minutes de soins, le sabreur reprend son gant et se présente pour un contre victorieux qui allait conduire les Tricolores en finale. Après la pause le séparant de la finale, il convainc l'encadrement qu'il peut tenir sa place face aux Italiens. Lors de celle-ci, les Français prennent rapidement l'avantage, menant 25 à 18 avant le deuxième relais de Damien Touya. Celui-ci l'oppose à Aldo Montano, qui remet son équipe dans le match en recollant à 30 à 29. Damien Touya, qui a la responsabilité du dernier assaut, débute celui-ci sur le score de 40 à 39 pour les Italiens. Lors de celui-ci, Touya domine Luigi Tarantino et termine la rencontre sur le score 45 à 42. Peu après le tournoi olympique, il annonce, tout comme son frère, la fin de sa carrière, laissant à leur sœur Anne-Lise Touya, sabreuse, qui est la dernière représentante de la famille à encore pratiquer l'escrime de haut niveau en compétition, le soin de porter les couleurs de la famille. Elle a à son actif notamment, un titre de championne d'Europe, deux titres de championne du monde consécutifs, un titre de championne du monde par équipe. Damien est papa d'une petite fille prénommée Clara et est entraîneur dans un club de sabre toulousain. Il a aussi un poste à la Fédération française d'escrime (FFE), où il travaille en tant que conseiller technique sportif pour la région Midi-Pyrénées. « C'est déjà beau de participer aux JO. C'est encore plus beau de le faire avec un membre de sa famille. Nous avions écrit l'histoire de cette discipline (le sabre) et le faire avec son frère, c'est un moment inoubliable. » Son palmarès : Médaille d'or par équipe aux jeux Olympiques d’été 2004 à Athènes ; Médaille d'argent par équipe aux Jeux olympiques d’été 2000 à Sydney ; Médaille de bronze individuelle aux Jeux olympiques d’été 1996 à Atlanta ; Médaille d’or aux Championnats du monde d'escrime en 1999 ; Médaille d'or par équipe aux Championnats du monde d'escrime en 1999 ; Médaille d'or par équipe aux Championnats du monde d'escrime en 1997 ; Médaille d'argent par équipe aux Championnats du monde d'escrime en 1998 ; Médaille de bronze aux Championnats du monde d'escrime en 1997 ; Médaille d'or par équipe aux Championnats d'Europe d'escrime en 1999 ; Médaille d'or aux Championnats d'Europe d'escrime en 1996. Il possède la plus haute distinction française, puisque qu’il a été fait Chevalier de la Légion d'honneur. Damien Touya, auréolé de très nombreux titres prestigieux est toujours heureux de témoigner auprès des jeunes de ses expériences sportives internationales. Autant de victoires qui consacrèrent l'excellence de l'escrime en France, grand pourvoyeur de médailles mondiales et olympiques, mais aussi le travail effectué depuis des années à Tarbes par un club et une famille pyrénéenne hors du commun.TRÉLUT Maurice (1881-1945)
Vétérinaire, maire de Tarbes, résistant, déporté à Buchenwald
 Maurice TRÉLUT, né le 30 juillet 1881 à Ossun et mort en déportation le 15 février 1945 à Buchenwald, est un héros de la Résistance en Bigorre. Le 3 juillet 1912, à l'issue de l'assemblée constitutive du comité de rugby Armagnac-Bigorre, il devient le premier président de ce comité regroupant les départements du Gers et des Hautes-Pyrénées. Il est mobilisé en 1914 en tant que vétérinaire au 14e d'artillerie. Le journal Les Pyrénées du 23 août 1917 cite : Notre compatriote, M. Maurice Trélut, vétérinaire au 14e d'artillerie, vient d'obtenir la belle citation suivante : "Maurice Trélut, excellent praticien, d'une haute valeur morale et de la plus haute conscience professionnelle, au front depuis le début de la campagne, a demandé à rester avec le régiment alors que son âge lui permettait d'être désigné pour un poste de l'intérieur, a fait preuve devant V. , le 4 juin 1916, d'une belle crânerie en s'offrant volontairement pour guider jusqu'aux premières lignes malgré un bombardement continu un médecin appelé à donner des soins à des blessés, a contribué en plusieurs circonstances en l'absence de médecins à leur donner les premiers soins." Il se lance dans la vie publique en 1926 et créé la Ligue pour le relèvement de la moralité publique. Son élection comme maire de Tarbes en 1935 donna lieu à une manifestation "antifasciste" (le secrétaire du comité organisateur sera fusillé après la Libération). Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier en juin 1940 par les troupes allemandes. Libéré en 1941 pour recevoir le maréchal Pétain, il retrouve son fauteuil de maire de Tarbes. Maire de Tarbes de 1935 à 1944 (année de son arrestation par la Gestapo et de sa déportation sans retour à Buchenwald), il met en place le réseau de sauvetage de l’hôpital mixte de Tarbes tenu par des religieuses. Maurice Trélut envoyait les pourchassés à la mère supérieure des Filles de la Charité, Anne-Marie Llobet, qui se chargeait ensuite de les cacher dans l’hôpital. Les Juifs qui ne parlaient pas le français étaient admis à l’hôpital en tant que sourds-muets ou hospitalisés dans le service des contagieux, tandis que les blessés et les malades étaient pris en charge par les sœurs. Marcel Billières, directeur de l'hôpital mixte et futur maire de Tarbes (1953), les sœurs Anne-Marie Llobet, Marie-Antoinette Ricard et Maurice Trélut, ont ainsi tout mis en œuvre pour soustraire les Juifs de la déportation et pour sauver les personnes en fuite pourchassées par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Mère Anne-Marie Llobet plaçait les fugitifs dans l'aile des contagieux, où les Allemands n'aimaient guère pénétrer. Néanmoins, le risque d'être découvert restait grand et quiconque aidait les Juifs était passible de peines extrêmement lourdes, pouvant aller jusqu'à la déportation. Nombre d’évadés de guerre, de réfractaires du STO (service du travail obligatoire) lui doivent des papiers qui leur permettront de se cacher de l’occupant. Dès novembre 1942 et pendant l’occupation de la ville de Tarbes, il va s’opposer aux autorités allemandes, au sein même de ses services municipaux. Résistant et anti-nazi, il n’hésitera pas à mettre sa vie en jeu pour aider ses administrés. Le 10 juin 1944, à quelques jours de la Libération, il proteste énergiquement contre le bombardement de la ville de Tarbes par cinq avions allemands et refuse de signer le communiqué de la Kommandantur imputant le raid "à des avions inconnus arborant les marques de la Luftwaffe", comme l’y obligeait l’armée d’occupation. Surveillé et se sentant en danger, il demande le soutien du docteur Mouniq, qui anime un réseau de passage en Espagne. Mais son état de santé ne lui permettra pas de prendre la route pour franchir la frontière et reviendra à Tarbes. Il est arrêté par la Gestapo en juillet 1944 et déporté sans retour en septembre 1944 à Buchenwald, où il meurt d’épuisement le 15 février 1945, payant de sa vie son courage et sa générosité. Son action est reconnue et récompensée le 2 novembre 1994, lorsque lui est décernée la médaille de Juste parmi les Nations. Son nom est gravé sur le mur d’honneur du mémorial de la Shoah de Yad Vashem à Jérusalem. Dans sa jeunesse, il fut également joueur de rugby à XV au Stadoceste tarbais. À Tarbes, le stade Maurice-Trélut, attitré du Stado Tarbes Pyrénées rugby, qui peut accueillir 15.000 spectateurs, dont 6.000 places assises, a été baptisé du nom de Maurice Trélut, en son souvenir. Et un monument à l'entrée du stade, daté de 1949, permet de garder en mémoire qui était Maurice Trélut. Un square à Tarbes porte aussi son nom. Il laisse le souvenir indélébile d’un de ces Bigourdans les plus importants. Un de ceux qui firent changer le cours de l’histoire par un acte de bravoure. Ancien joueur de rugby au stadoceste tarbais, il fut le premier président du Comité Armagnac-Bigorre (en 1912). Il fut surtout maire de Tarbes de 1935 à 1944. Héros de la Résistance, il est mort en déportation dans le camp de concentration de Buchenwald. La libération de Tarbes et du département se fit les 18 et 19 août 1944, en quatre « points chauds » : la gare, l’Arsenal, l’hôtel le Moderne, puis la caserne Larrey. La libération du département se scella dans la journée du 20 août 1944. Cette grande figure de la Résistance, qui organisa un réseau au sein d'un hôpital tarbais, se sera opposé avec courage à l’autorité allemande et en mourut, déporté à Buchenwald.
Maurice TRÉLUT, né le 30 juillet 1881 à Ossun et mort en déportation le 15 février 1945 à Buchenwald, est un héros de la Résistance en Bigorre. Le 3 juillet 1912, à l'issue de l'assemblée constitutive du comité de rugby Armagnac-Bigorre, il devient le premier président de ce comité regroupant les départements du Gers et des Hautes-Pyrénées. Il est mobilisé en 1914 en tant que vétérinaire au 14e d'artillerie. Le journal Les Pyrénées du 23 août 1917 cite : Notre compatriote, M. Maurice Trélut, vétérinaire au 14e d'artillerie, vient d'obtenir la belle citation suivante : "Maurice Trélut, excellent praticien, d'une haute valeur morale et de la plus haute conscience professionnelle, au front depuis le début de la campagne, a demandé à rester avec le régiment alors que son âge lui permettait d'être désigné pour un poste de l'intérieur, a fait preuve devant V. , le 4 juin 1916, d'une belle crânerie en s'offrant volontairement pour guider jusqu'aux premières lignes malgré un bombardement continu un médecin appelé à donner des soins à des blessés, a contribué en plusieurs circonstances en l'absence de médecins à leur donner les premiers soins." Il se lance dans la vie publique en 1926 et créé la Ligue pour le relèvement de la moralité publique. Son élection comme maire de Tarbes en 1935 donna lieu à une manifestation "antifasciste" (le secrétaire du comité organisateur sera fusillé après la Libération). Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier en juin 1940 par les troupes allemandes. Libéré en 1941 pour recevoir le maréchal Pétain, il retrouve son fauteuil de maire de Tarbes. Maire de Tarbes de 1935 à 1944 (année de son arrestation par la Gestapo et de sa déportation sans retour à Buchenwald), il met en place le réseau de sauvetage de l’hôpital mixte de Tarbes tenu par des religieuses. Maurice Trélut envoyait les pourchassés à la mère supérieure des Filles de la Charité, Anne-Marie Llobet, qui se chargeait ensuite de les cacher dans l’hôpital. Les Juifs qui ne parlaient pas le français étaient admis à l’hôpital en tant que sourds-muets ou hospitalisés dans le service des contagieux, tandis que les blessés et les malades étaient pris en charge par les sœurs. Marcel Billières, directeur de l'hôpital mixte et futur maire de Tarbes (1953), les sœurs Anne-Marie Llobet, Marie-Antoinette Ricard et Maurice Trélut, ont ainsi tout mis en œuvre pour soustraire les Juifs de la déportation et pour sauver les personnes en fuite pourchassées par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Mère Anne-Marie Llobet plaçait les fugitifs dans l'aile des contagieux, où les Allemands n'aimaient guère pénétrer. Néanmoins, le risque d'être découvert restait grand et quiconque aidait les Juifs était passible de peines extrêmement lourdes, pouvant aller jusqu'à la déportation. Nombre d’évadés de guerre, de réfractaires du STO (service du travail obligatoire) lui doivent des papiers qui leur permettront de se cacher de l’occupant. Dès novembre 1942 et pendant l’occupation de la ville de Tarbes, il va s’opposer aux autorités allemandes, au sein même de ses services municipaux. Résistant et anti-nazi, il n’hésitera pas à mettre sa vie en jeu pour aider ses administrés. Le 10 juin 1944, à quelques jours de la Libération, il proteste énergiquement contre le bombardement de la ville de Tarbes par cinq avions allemands et refuse de signer le communiqué de la Kommandantur imputant le raid "à des avions inconnus arborant les marques de la Luftwaffe", comme l’y obligeait l’armée d’occupation. Surveillé et se sentant en danger, il demande le soutien du docteur Mouniq, qui anime un réseau de passage en Espagne. Mais son état de santé ne lui permettra pas de prendre la route pour franchir la frontière et reviendra à Tarbes. Il est arrêté par la Gestapo en juillet 1944 et déporté sans retour en septembre 1944 à Buchenwald, où il meurt d’épuisement le 15 février 1945, payant de sa vie son courage et sa générosité. Son action est reconnue et récompensée le 2 novembre 1994, lorsque lui est décernée la médaille de Juste parmi les Nations. Son nom est gravé sur le mur d’honneur du mémorial de la Shoah de Yad Vashem à Jérusalem. Dans sa jeunesse, il fut également joueur de rugby à XV au Stadoceste tarbais. À Tarbes, le stade Maurice-Trélut, attitré du Stado Tarbes Pyrénées rugby, qui peut accueillir 15.000 spectateurs, dont 6.000 places assises, a été baptisé du nom de Maurice Trélut, en son souvenir. Et un monument à l'entrée du stade, daté de 1949, permet de garder en mémoire qui était Maurice Trélut. Un square à Tarbes porte aussi son nom. Il laisse le souvenir indélébile d’un de ces Bigourdans les plus importants. Un de ceux qui firent changer le cours de l’histoire par un acte de bravoure. Ancien joueur de rugby au stadoceste tarbais, il fut le premier président du Comité Armagnac-Bigorre (en 1912). Il fut surtout maire de Tarbes de 1935 à 1944. Héros de la Résistance, il est mort en déportation dans le camp de concentration de Buchenwald. La libération de Tarbes et du département se fit les 18 et 19 août 1944, en quatre « points chauds » : la gare, l’Arsenal, l’hôtel le Moderne, puis la caserne Larrey. La libération du département se scella dans la journée du 20 août 1944. Cette grande figure de la Résistance, qui organisa un réseau au sein d'un hôpital tarbais, se sera opposé avec courage à l’autorité allemande et en mourut, déporté à Buchenwald.
 Maurice TRÉLUT, né le 30 juillet 1881 à Ossun et mort en déportation le 15 février 1945 à Buchenwald, est un héros de la Résistance en Bigorre. Le 3 juillet 1912, à l'issue de l'assemblée constitutive du comité de rugby Armagnac-Bigorre, il devient le premier président de ce comité regroupant les départements du Gers et des Hautes-Pyrénées. Il est mobilisé en 1914 en tant que vétérinaire au 14e d'artillerie. Le journal Les Pyrénées du 23 août 1917 cite : Notre compatriote, M. Maurice Trélut, vétérinaire au 14e d'artillerie, vient d'obtenir la belle citation suivante : "Maurice Trélut, excellent praticien, d'une haute valeur morale et de la plus haute conscience professionnelle, au front depuis le début de la campagne, a demandé à rester avec le régiment alors que son âge lui permettait d'être désigné pour un poste de l'intérieur, a fait preuve devant V. , le 4 juin 1916, d'une belle crânerie en s'offrant volontairement pour guider jusqu'aux premières lignes malgré un bombardement continu un médecin appelé à donner des soins à des blessés, a contribué en plusieurs circonstances en l'absence de médecins à leur donner les premiers soins." Il se lance dans la vie publique en 1926 et créé la Ligue pour le relèvement de la moralité publique. Son élection comme maire de Tarbes en 1935 donna lieu à une manifestation "antifasciste" (le secrétaire du comité organisateur sera fusillé après la Libération). Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier en juin 1940 par les troupes allemandes. Libéré en 1941 pour recevoir le maréchal Pétain, il retrouve son fauteuil de maire de Tarbes. Maire de Tarbes de 1935 à 1944 (année de son arrestation par la Gestapo et de sa déportation sans retour à Buchenwald), il met en place le réseau de sauvetage de l’hôpital mixte de Tarbes tenu par des religieuses. Maurice Trélut envoyait les pourchassés à la mère supérieure des Filles de la Charité, Anne-Marie Llobet, qui se chargeait ensuite de les cacher dans l’hôpital. Les Juifs qui ne parlaient pas le français étaient admis à l’hôpital en tant que sourds-muets ou hospitalisés dans le service des contagieux, tandis que les blessés et les malades étaient pris en charge par les sœurs. Marcel Billières, directeur de l'hôpital mixte et futur maire de Tarbes (1953), les sœurs Anne-Marie Llobet, Marie-Antoinette Ricard et Maurice Trélut, ont ainsi tout mis en œuvre pour soustraire les Juifs de la déportation et pour sauver les personnes en fuite pourchassées par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Mère Anne-Marie Llobet plaçait les fugitifs dans l'aile des contagieux, où les Allemands n'aimaient guère pénétrer. Néanmoins, le risque d'être découvert restait grand et quiconque aidait les Juifs était passible de peines extrêmement lourdes, pouvant aller jusqu'à la déportation. Nombre d’évadés de guerre, de réfractaires du STO (service du travail obligatoire) lui doivent des papiers qui leur permettront de se cacher de l’occupant. Dès novembre 1942 et pendant l’occupation de la ville de Tarbes, il va s’opposer aux autorités allemandes, au sein même de ses services municipaux. Résistant et anti-nazi, il n’hésitera pas à mettre sa vie en jeu pour aider ses administrés. Le 10 juin 1944, à quelques jours de la Libération, il proteste énergiquement contre le bombardement de la ville de Tarbes par cinq avions allemands et refuse de signer le communiqué de la Kommandantur imputant le raid "à des avions inconnus arborant les marques de la Luftwaffe", comme l’y obligeait l’armée d’occupation. Surveillé et se sentant en danger, il demande le soutien du docteur Mouniq, qui anime un réseau de passage en Espagne. Mais son état de santé ne lui permettra pas de prendre la route pour franchir la frontière et reviendra à Tarbes. Il est arrêté par la Gestapo en juillet 1944 et déporté sans retour en septembre 1944 à Buchenwald, où il meurt d’épuisement le 15 février 1945, payant de sa vie son courage et sa générosité. Son action est reconnue et récompensée le 2 novembre 1994, lorsque lui est décernée la médaille de Juste parmi les Nations. Son nom est gravé sur le mur d’honneur du mémorial de la Shoah de Yad Vashem à Jérusalem. Dans sa jeunesse, il fut également joueur de rugby à XV au Stadoceste tarbais. À Tarbes, le stade Maurice-Trélut, attitré du Stado Tarbes Pyrénées rugby, qui peut accueillir 15.000 spectateurs, dont 6.000 places assises, a été baptisé du nom de Maurice Trélut, en son souvenir. Et un monument à l'entrée du stade, daté de 1949, permet de garder en mémoire qui était Maurice Trélut. Un square à Tarbes porte aussi son nom. Il laisse le souvenir indélébile d’un de ces Bigourdans les plus importants. Un de ceux qui firent changer le cours de l’histoire par un acte de bravoure. Ancien joueur de rugby au stadoceste tarbais, il fut le premier président du Comité Armagnac-Bigorre (en 1912). Il fut surtout maire de Tarbes de 1935 à 1944. Héros de la Résistance, il est mort en déportation dans le camp de concentration de Buchenwald. La libération de Tarbes et du département se fit les 18 et 19 août 1944, en quatre « points chauds » : la gare, l’Arsenal, l’hôtel le Moderne, puis la caserne Larrey. La libération du département se scella dans la journée du 20 août 1944. Cette grande figure de la Résistance, qui organisa un réseau au sein d'un hôpital tarbais, se sera opposé avec courage à l’autorité allemande et en mourut, déporté à Buchenwald.
Maurice TRÉLUT, né le 30 juillet 1881 à Ossun et mort en déportation le 15 février 1945 à Buchenwald, est un héros de la Résistance en Bigorre. Le 3 juillet 1912, à l'issue de l'assemblée constitutive du comité de rugby Armagnac-Bigorre, il devient le premier président de ce comité regroupant les départements du Gers et des Hautes-Pyrénées. Il est mobilisé en 1914 en tant que vétérinaire au 14e d'artillerie. Le journal Les Pyrénées du 23 août 1917 cite : Notre compatriote, M. Maurice Trélut, vétérinaire au 14e d'artillerie, vient d'obtenir la belle citation suivante : "Maurice Trélut, excellent praticien, d'une haute valeur morale et de la plus haute conscience professionnelle, au front depuis le début de la campagne, a demandé à rester avec le régiment alors que son âge lui permettait d'être désigné pour un poste de l'intérieur, a fait preuve devant V. , le 4 juin 1916, d'une belle crânerie en s'offrant volontairement pour guider jusqu'aux premières lignes malgré un bombardement continu un médecin appelé à donner des soins à des blessés, a contribué en plusieurs circonstances en l'absence de médecins à leur donner les premiers soins." Il se lance dans la vie publique en 1926 et créé la Ligue pour le relèvement de la moralité publique. Son élection comme maire de Tarbes en 1935 donna lieu à une manifestation "antifasciste" (le secrétaire du comité organisateur sera fusillé après la Libération). Mobilisé en 1939, il est fait prisonnier en juin 1940 par les troupes allemandes. Libéré en 1941 pour recevoir le maréchal Pétain, il retrouve son fauteuil de maire de Tarbes. Maire de Tarbes de 1935 à 1944 (année de son arrestation par la Gestapo et de sa déportation sans retour à Buchenwald), il met en place le réseau de sauvetage de l’hôpital mixte de Tarbes tenu par des religieuses. Maurice Trélut envoyait les pourchassés à la mère supérieure des Filles de la Charité, Anne-Marie Llobet, qui se chargeait ensuite de les cacher dans l’hôpital. Les Juifs qui ne parlaient pas le français étaient admis à l’hôpital en tant que sourds-muets ou hospitalisés dans le service des contagieux, tandis que les blessés et les malades étaient pris en charge par les sœurs. Marcel Billières, directeur de l'hôpital mixte et futur maire de Tarbes (1953), les sœurs Anne-Marie Llobet, Marie-Antoinette Ricard et Maurice Trélut, ont ainsi tout mis en œuvre pour soustraire les Juifs de la déportation et pour sauver les personnes en fuite pourchassées par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale. Mère Anne-Marie Llobet plaçait les fugitifs dans l'aile des contagieux, où les Allemands n'aimaient guère pénétrer. Néanmoins, le risque d'être découvert restait grand et quiconque aidait les Juifs était passible de peines extrêmement lourdes, pouvant aller jusqu'à la déportation. Nombre d’évadés de guerre, de réfractaires du STO (service du travail obligatoire) lui doivent des papiers qui leur permettront de se cacher de l’occupant. Dès novembre 1942 et pendant l’occupation de la ville de Tarbes, il va s’opposer aux autorités allemandes, au sein même de ses services municipaux. Résistant et anti-nazi, il n’hésitera pas à mettre sa vie en jeu pour aider ses administrés. Le 10 juin 1944, à quelques jours de la Libération, il proteste énergiquement contre le bombardement de la ville de Tarbes par cinq avions allemands et refuse de signer le communiqué de la Kommandantur imputant le raid "à des avions inconnus arborant les marques de la Luftwaffe", comme l’y obligeait l’armée d’occupation. Surveillé et se sentant en danger, il demande le soutien du docteur Mouniq, qui anime un réseau de passage en Espagne. Mais son état de santé ne lui permettra pas de prendre la route pour franchir la frontière et reviendra à Tarbes. Il est arrêté par la Gestapo en juillet 1944 et déporté sans retour en septembre 1944 à Buchenwald, où il meurt d’épuisement le 15 février 1945, payant de sa vie son courage et sa générosité. Son action est reconnue et récompensée le 2 novembre 1994, lorsque lui est décernée la médaille de Juste parmi les Nations. Son nom est gravé sur le mur d’honneur du mémorial de la Shoah de Yad Vashem à Jérusalem. Dans sa jeunesse, il fut également joueur de rugby à XV au Stadoceste tarbais. À Tarbes, le stade Maurice-Trélut, attitré du Stado Tarbes Pyrénées rugby, qui peut accueillir 15.000 spectateurs, dont 6.000 places assises, a été baptisé du nom de Maurice Trélut, en son souvenir. Et un monument à l'entrée du stade, daté de 1949, permet de garder en mémoire qui était Maurice Trélut. Un square à Tarbes porte aussi son nom. Il laisse le souvenir indélébile d’un de ces Bigourdans les plus importants. Un de ceux qui firent changer le cours de l’histoire par un acte de bravoure. Ancien joueur de rugby au stadoceste tarbais, il fut le premier président du Comité Armagnac-Bigorre (en 1912). Il fut surtout maire de Tarbes de 1935 à 1944. Héros de la Résistance, il est mort en déportation dans le camp de concentration de Buchenwald. La libération de Tarbes et du département se fit les 18 et 19 août 1944, en quatre « points chauds » : la gare, l’Arsenal, l’hôtel le Moderne, puis la caserne Larrey. La libération du département se scella dans la journée du 20 août 1944. Cette grande figure de la Résistance, qui organisa un réseau au sein d'un hôpital tarbais, se sera opposé avec courage à l’autorité allemande et en mourut, déporté à Buchenwald.TSEKOVA Polina (1968-XXXX)
Basketteuse internationale
 Polina TSEKOVA, alias Poli, née le 30 avril 1968 à Pleven en Bulgarie, est une basketteuse internationale d’origine bulgare et naturalisée française, évoluant au poste de pivot et mesurant 1,95 m. Elle est considérée comme l'une des meilleures joueuses de basket-ball que le pays ait jamais eu. Elle a représenté l'équipe nationale féminine de basket-ball de Bulgarie, avec une moyenne de 18,5 points pour l'équipe. En 1996, elle participe à la victoire en Coupe d’Europe L. Ronchetti, le sacre européen de Tarbes Gespe Bigorre. En 1999, Tzekova a signé avec les Houston Comets au sein de la National Basketball Association (NBA) et faisait partie de la formation qui a remporté le titre à la fin de la saison 1999 de la WNBA. Elle avait également participé au tournoi féminin aux Jeux olympiques d'été de 1988. L'équipe tarbaise compte dans ses rangs une joueuse de classe internationale, Polina Tzekova, 1m95, avec un curriculum vitae à faire rêver bien des basketteuses. Cette joueuse a participé à toutes les compétitions possibles avec l'équipe nationale bulgare (Jeux olympiques, championnat du monde, championnat d'Europe) et en club (WNBA, Coupe Ronchetti, Euroligue, Coupe de France, tournoi de la Fédération), sans oublier toutes les distinctions acquises en tant que MVP étrangère, meilleure marqueuse, meilleure rebondeuse, meilleure évaluation de la Ligue. Cette joueuse écrase les rencontres de sa présence, avec classe et modestie, forçant le respect des adversaires ravis d'avoir eu l'opportunité de rencontrer une telle joueuse. Considérée comme une véritable icône du basket féminin dans son pays natal, elle n’a jamais quitté la Bigorre depuis qu’elle a pris sa retraite sportive en 2010 après le titre national. À 19 ans elle avait déjà été élue dans les dix meilleures joueuses européennes. Elle est un des rares pivots à être capable de shooter à 3 points. Elle quitte son pays en 1991 et jouera à Priolo en Italie pendant quatre ans avant de rejoindre en 1995, le TGB. Et chaque fois elle adoptera la langue du pays dans lequel elle vit, puisqu’elle parle couramment anglais, italien et français. Depuis maintenant quelques années, la Ligue Occitanie de basket a mis en œuvre l'académie régionale de basket, sous le modèle de l'académie fédérale. Il s'agit de mettre à l'honneur, au moment de l'assemblée générale de la Ligue, cinq personnalités qui ont mis en lumière notre basket local, qui ont eu un palmarès ou un parcours hors norme. Pour 2019, c’est Francis Jordane, qui est le parrain de la promotion, où sont à l’honneur cinq académiciens prestigieux pour le basket français : Pierre Galle, Maurice Boulois, Florence Roussel, Polina Tzekova, et Christophe Soulé. Et, parmi les lauréats de la promotion Francis-Jordane, grande figure du coaching français, on retrouvait une grande dame du basket bien connu des Tarbais : Polina Tzekova. Véritable icône du basket dans son pays natal, l'ancienne intérieure franco-bulgare possède l'un des plus beaux palmarès d'Europe : titres nationaux en Bulgarie avec le Lokomotiv Sofia et en France avec le Tarbes Gespe Basket (TGB), victoire en Coupe d'Europe Liliana-Ronchetti, trois Coupes de France et un titre de champion WNBA avec les Houston Comets en tant que pivot titulaire. Poli s'est imposée au fil des saisons comme l'une des meilleures intérieures d'Europe, glanant bon nombre de distinctions individuelles sur son passage qui lui ont permis d'être élue pour les 20 ans de la Ligue Féminine de Basketball (LFB) dans le meilleur cinq étranger 2018. Depuis qu'elle a posé les pieds sur le sol tarbais en 1995 pour rejoindre le TGB, après un passage par Priolo, en Italie, Poli n'a jamais quitté la Bigorre, et ce même pendant sa période mourenxoise, entre 2005 et 2008. Depuis sa retraite sportive en 2010 après le titre national avec le TGB, Poli s'est dirigée vers le coaching en prenant des jeunes sous son aile, dans un premier temps, avant de se retrouver à la tête de l'équipe fanion du TUB, avec une montée en pré-nationale au bout d'une saison réussie. Après en avoir fait rêver et s'enthousiasmer plus d'un lorsqu'elle était sur les parquets, Poli transmet maintenant sa passion qui l'anime depuis tant d'années comme un véritable trait d'union entre les générations. Et c'est bien là que se trouve l'essence même de la distinction qui lui a été donnée le 22 juin 2019 à Labège. Aussi discrète qu'elle est grande, Poli n'aime pas être mise en avant et pourtant, ce trophée n'est qu'une juste récompense pour tout ce que cette grande dame a fait et fait encore pour le basket occitan. Elle avait participé aux JO de Séoul 88 avec l'équipe de Bulgarie, qui avait terminé 5ème du tournoi, quand elle s’était rompu un ligament du genou dès le premier match. En 1985, lors du championnat d'Europe en Italie, où son équipe gagna la médaille d'argent, elle était la plus jeune de l'équipe. Elle finira sa carrière à Tarbes, car le TGB l'a beaucoup aidée. À une époque, elle était prête à arrêter le basket, et si elle a pu jouer très longtemps c'est grâce au TGB et, jusqu'au bout, elle a donné tout ce qu’elle pouvait pour ce club. « Avant, le TGB était un club très fort et j'aimerais que le club ait retrouvé ce niveau quand j'arrêterai. Après je resterai à Tarbes. J'ai comme on dit "mon moitié", du côté de ma vie privée et cela s'arrange super bien. Ce n'est pas facile d'être comme tu veux dans la vie quand tu es connue, moi je voulais rencontrer quelqu'un qui aime Poli et pas Polina Tzekova, je crois que je suis bien tombée. J'ai un diplôme équivalent au BE1, et j'aimerais bien rester dans le monde du sport mais plutôt avec des enfants. J’apprécierais être maman ! Je suis une basketteuse mais je suis avant tout une femme, je crois qu'il y a des choses qui passent avant la carrière et je pense que la fierté d'une femme c'est d'être mère ! Et je suis capable de faire une croix sur ce qui a dirigé ma vie depuis le début, le basket, pour l'être ! » Mais, cette travailleuse infatigable n’a jamais quitté les parquets puisqu’elle s’est ensuite dirigé vers le coaching des jeunes de la région et est aussi sur le banc des U15 du CTC Ossun-Tarbes. D’ailleurs, Poli revenait parfois au TGB pour y jouer bénévolement, car son envie de revenir sur les parquets étant plus forte que tout. De plus, elle cumulera sa vie de basketteuse avec son travail au sein du Conservatoire de Tarbes, où elle travaillait depuis quelques années. Son palmarès : 1990-1991 : Championne de Bulgarie avec le Lokomotiv Sofia ; 1991-1992 : Finaliste de la Coupe d’Europe L. Ronchetti avec Priolo ; 1995-1996 : Vainqueur de la Coupe d’Europe L. Ronchetti avec Tarbes ; 1996-1997 : Vainqueur de la Coupe de France Joe Jaunay ; 1997-1998 : Vainqueur de la Coupe de France Joe Jaunay ; 1999 : Championne WNBA avec Houston ; 2001-2002 : Finaliste de la Coupe d’Europe L. Ronchetti avec Tarbes ; 2002-2003 : 3e du Championnat de France LFB ; 2003-2004 : 4e du Championnat de France LFB ; 2018-2019 montée en pré-national masculine avec Tarbes Union Basket 65. Ses distinctions : 1997-1998 : Élue 2e meilleure joueuse étrangère de NF1A ; 1998-1999 : Élue MVP étrangère du Championnat de France LFB ; 1999-2000 : Élue MVP étrangère du Championnat de France LFB. Sa carrière : 1977–1987 Pleven (Bulgarie) ; 1987–1991 Lokomotiv Sofia ; 1991–1995 ISAB Energy Priolo ; 1995–2002 Tarbes Gespe Bigorre (TGB) ; 1999 Comets de Houston ; 2003–2005 Tarbes Gespe Bigorre ; 2005–2008 Mourenx BC ; 2008–2009 Tarbes Gespe Bigorre ; 2× French League MVP (1999, 2000). Elle fut une des meilleures joueuses de Tarbes, qui a conquis la Coupe Ronchetti et la Coupe de France sous les couleurs Violettes.
Polina TSEKOVA, alias Poli, née le 30 avril 1968 à Pleven en Bulgarie, est une basketteuse internationale d’origine bulgare et naturalisée française, évoluant au poste de pivot et mesurant 1,95 m. Elle est considérée comme l'une des meilleures joueuses de basket-ball que le pays ait jamais eu. Elle a représenté l'équipe nationale féminine de basket-ball de Bulgarie, avec une moyenne de 18,5 points pour l'équipe. En 1996, elle participe à la victoire en Coupe d’Europe L. Ronchetti, le sacre européen de Tarbes Gespe Bigorre. En 1999, Tzekova a signé avec les Houston Comets au sein de la National Basketball Association (NBA) et faisait partie de la formation qui a remporté le titre à la fin de la saison 1999 de la WNBA. Elle avait également participé au tournoi féminin aux Jeux olympiques d'été de 1988. L'équipe tarbaise compte dans ses rangs une joueuse de classe internationale, Polina Tzekova, 1m95, avec un curriculum vitae à faire rêver bien des basketteuses. Cette joueuse a participé à toutes les compétitions possibles avec l'équipe nationale bulgare (Jeux olympiques, championnat du monde, championnat d'Europe) et en club (WNBA, Coupe Ronchetti, Euroligue, Coupe de France, tournoi de la Fédération), sans oublier toutes les distinctions acquises en tant que MVP étrangère, meilleure marqueuse, meilleure rebondeuse, meilleure évaluation de la Ligue. Cette joueuse écrase les rencontres de sa présence, avec classe et modestie, forçant le respect des adversaires ravis d'avoir eu l'opportunité de rencontrer une telle joueuse. Considérée comme une véritable icône du basket féminin dans son pays natal, elle n’a jamais quitté la Bigorre depuis qu’elle a pris sa retraite sportive en 2010 après le titre national. À 19 ans elle avait déjà été élue dans les dix meilleures joueuses européennes. Elle est un des rares pivots à être capable de shooter à 3 points. Elle quitte son pays en 1991 et jouera à Priolo en Italie pendant quatre ans avant de rejoindre en 1995, le TGB. Et chaque fois elle adoptera la langue du pays dans lequel elle vit, puisqu’elle parle couramment anglais, italien et français. Depuis maintenant quelques années, la Ligue Occitanie de basket a mis en œuvre l'académie régionale de basket, sous le modèle de l'académie fédérale. Il s'agit de mettre à l'honneur, au moment de l'assemblée générale de la Ligue, cinq personnalités qui ont mis en lumière notre basket local, qui ont eu un palmarès ou un parcours hors norme. Pour 2019, c’est Francis Jordane, qui est le parrain de la promotion, où sont à l’honneur cinq académiciens prestigieux pour le basket français : Pierre Galle, Maurice Boulois, Florence Roussel, Polina Tzekova, et Christophe Soulé. Et, parmi les lauréats de la promotion Francis-Jordane, grande figure du coaching français, on retrouvait une grande dame du basket bien connu des Tarbais : Polina Tzekova. Véritable icône du basket dans son pays natal, l'ancienne intérieure franco-bulgare possède l'un des plus beaux palmarès d'Europe : titres nationaux en Bulgarie avec le Lokomotiv Sofia et en France avec le Tarbes Gespe Basket (TGB), victoire en Coupe d'Europe Liliana-Ronchetti, trois Coupes de France et un titre de champion WNBA avec les Houston Comets en tant que pivot titulaire. Poli s'est imposée au fil des saisons comme l'une des meilleures intérieures d'Europe, glanant bon nombre de distinctions individuelles sur son passage qui lui ont permis d'être élue pour les 20 ans de la Ligue Féminine de Basketball (LFB) dans le meilleur cinq étranger 2018. Depuis qu'elle a posé les pieds sur le sol tarbais en 1995 pour rejoindre le TGB, après un passage par Priolo, en Italie, Poli n'a jamais quitté la Bigorre, et ce même pendant sa période mourenxoise, entre 2005 et 2008. Depuis sa retraite sportive en 2010 après le titre national avec le TGB, Poli s'est dirigée vers le coaching en prenant des jeunes sous son aile, dans un premier temps, avant de se retrouver à la tête de l'équipe fanion du TUB, avec une montée en pré-nationale au bout d'une saison réussie. Après en avoir fait rêver et s'enthousiasmer plus d'un lorsqu'elle était sur les parquets, Poli transmet maintenant sa passion qui l'anime depuis tant d'années comme un véritable trait d'union entre les générations. Et c'est bien là que se trouve l'essence même de la distinction qui lui a été donnée le 22 juin 2019 à Labège. Aussi discrète qu'elle est grande, Poli n'aime pas être mise en avant et pourtant, ce trophée n'est qu'une juste récompense pour tout ce que cette grande dame a fait et fait encore pour le basket occitan. Elle avait participé aux JO de Séoul 88 avec l'équipe de Bulgarie, qui avait terminé 5ème du tournoi, quand elle s’était rompu un ligament du genou dès le premier match. En 1985, lors du championnat d'Europe en Italie, où son équipe gagna la médaille d'argent, elle était la plus jeune de l'équipe. Elle finira sa carrière à Tarbes, car le TGB l'a beaucoup aidée. À une époque, elle était prête à arrêter le basket, et si elle a pu jouer très longtemps c'est grâce au TGB et, jusqu'au bout, elle a donné tout ce qu’elle pouvait pour ce club. « Avant, le TGB était un club très fort et j'aimerais que le club ait retrouvé ce niveau quand j'arrêterai. Après je resterai à Tarbes. J'ai comme on dit "mon moitié", du côté de ma vie privée et cela s'arrange super bien. Ce n'est pas facile d'être comme tu veux dans la vie quand tu es connue, moi je voulais rencontrer quelqu'un qui aime Poli et pas Polina Tzekova, je crois que je suis bien tombée. J'ai un diplôme équivalent au BE1, et j'aimerais bien rester dans le monde du sport mais plutôt avec des enfants. J’apprécierais être maman ! Je suis une basketteuse mais je suis avant tout une femme, je crois qu'il y a des choses qui passent avant la carrière et je pense que la fierté d'une femme c'est d'être mère ! Et je suis capable de faire une croix sur ce qui a dirigé ma vie depuis le début, le basket, pour l'être ! » Mais, cette travailleuse infatigable n’a jamais quitté les parquets puisqu’elle s’est ensuite dirigé vers le coaching des jeunes de la région et est aussi sur le banc des U15 du CTC Ossun-Tarbes. D’ailleurs, Poli revenait parfois au TGB pour y jouer bénévolement, car son envie de revenir sur les parquets étant plus forte que tout. De plus, elle cumulera sa vie de basketteuse avec son travail au sein du Conservatoire de Tarbes, où elle travaillait depuis quelques années. Son palmarès : 1990-1991 : Championne de Bulgarie avec le Lokomotiv Sofia ; 1991-1992 : Finaliste de la Coupe d’Europe L. Ronchetti avec Priolo ; 1995-1996 : Vainqueur de la Coupe d’Europe L. Ronchetti avec Tarbes ; 1996-1997 : Vainqueur de la Coupe de France Joe Jaunay ; 1997-1998 : Vainqueur de la Coupe de France Joe Jaunay ; 1999 : Championne WNBA avec Houston ; 2001-2002 : Finaliste de la Coupe d’Europe L. Ronchetti avec Tarbes ; 2002-2003 : 3e du Championnat de France LFB ; 2003-2004 : 4e du Championnat de France LFB ; 2018-2019 montée en pré-national masculine avec Tarbes Union Basket 65. Ses distinctions : 1997-1998 : Élue 2e meilleure joueuse étrangère de NF1A ; 1998-1999 : Élue MVP étrangère du Championnat de France LFB ; 1999-2000 : Élue MVP étrangère du Championnat de France LFB. Sa carrière : 1977–1987 Pleven (Bulgarie) ; 1987–1991 Lokomotiv Sofia ; 1991–1995 ISAB Energy Priolo ; 1995–2002 Tarbes Gespe Bigorre (TGB) ; 1999 Comets de Houston ; 2003–2005 Tarbes Gespe Bigorre ; 2005–2008 Mourenx BC ; 2008–2009 Tarbes Gespe Bigorre ; 2× French League MVP (1999, 2000). Elle fut une des meilleures joueuses de Tarbes, qui a conquis la Coupe Ronchetti et la Coupe de France sous les couleurs Violettes.
 Polina TSEKOVA, alias Poli, née le 30 avril 1968 à Pleven en Bulgarie, est une basketteuse internationale d’origine bulgare et naturalisée française, évoluant au poste de pivot et mesurant 1,95 m. Elle est considérée comme l'une des meilleures joueuses de basket-ball que le pays ait jamais eu. Elle a représenté l'équipe nationale féminine de basket-ball de Bulgarie, avec une moyenne de 18,5 points pour l'équipe. En 1996, elle participe à la victoire en Coupe d’Europe L. Ronchetti, le sacre européen de Tarbes Gespe Bigorre. En 1999, Tzekova a signé avec les Houston Comets au sein de la National Basketball Association (NBA) et faisait partie de la formation qui a remporté le titre à la fin de la saison 1999 de la WNBA. Elle avait également participé au tournoi féminin aux Jeux olympiques d'été de 1988. L'équipe tarbaise compte dans ses rangs une joueuse de classe internationale, Polina Tzekova, 1m95, avec un curriculum vitae à faire rêver bien des basketteuses. Cette joueuse a participé à toutes les compétitions possibles avec l'équipe nationale bulgare (Jeux olympiques, championnat du monde, championnat d'Europe) et en club (WNBA, Coupe Ronchetti, Euroligue, Coupe de France, tournoi de la Fédération), sans oublier toutes les distinctions acquises en tant que MVP étrangère, meilleure marqueuse, meilleure rebondeuse, meilleure évaluation de la Ligue. Cette joueuse écrase les rencontres de sa présence, avec classe et modestie, forçant le respect des adversaires ravis d'avoir eu l'opportunité de rencontrer une telle joueuse. Considérée comme une véritable icône du basket féminin dans son pays natal, elle n’a jamais quitté la Bigorre depuis qu’elle a pris sa retraite sportive en 2010 après le titre national. À 19 ans elle avait déjà été élue dans les dix meilleures joueuses européennes. Elle est un des rares pivots à être capable de shooter à 3 points. Elle quitte son pays en 1991 et jouera à Priolo en Italie pendant quatre ans avant de rejoindre en 1995, le TGB. Et chaque fois elle adoptera la langue du pays dans lequel elle vit, puisqu’elle parle couramment anglais, italien et français. Depuis maintenant quelques années, la Ligue Occitanie de basket a mis en œuvre l'académie régionale de basket, sous le modèle de l'académie fédérale. Il s'agit de mettre à l'honneur, au moment de l'assemblée générale de la Ligue, cinq personnalités qui ont mis en lumière notre basket local, qui ont eu un palmarès ou un parcours hors norme. Pour 2019, c’est Francis Jordane, qui est le parrain de la promotion, où sont à l’honneur cinq académiciens prestigieux pour le basket français : Pierre Galle, Maurice Boulois, Florence Roussel, Polina Tzekova, et Christophe Soulé. Et, parmi les lauréats de la promotion Francis-Jordane, grande figure du coaching français, on retrouvait une grande dame du basket bien connu des Tarbais : Polina Tzekova. Véritable icône du basket dans son pays natal, l'ancienne intérieure franco-bulgare possède l'un des plus beaux palmarès d'Europe : titres nationaux en Bulgarie avec le Lokomotiv Sofia et en France avec le Tarbes Gespe Basket (TGB), victoire en Coupe d'Europe Liliana-Ronchetti, trois Coupes de France et un titre de champion WNBA avec les Houston Comets en tant que pivot titulaire. Poli s'est imposée au fil des saisons comme l'une des meilleures intérieures d'Europe, glanant bon nombre de distinctions individuelles sur son passage qui lui ont permis d'être élue pour les 20 ans de la Ligue Féminine de Basketball (LFB) dans le meilleur cinq étranger 2018. Depuis qu'elle a posé les pieds sur le sol tarbais en 1995 pour rejoindre le TGB, après un passage par Priolo, en Italie, Poli n'a jamais quitté la Bigorre, et ce même pendant sa période mourenxoise, entre 2005 et 2008. Depuis sa retraite sportive en 2010 après le titre national avec le TGB, Poli s'est dirigée vers le coaching en prenant des jeunes sous son aile, dans un premier temps, avant de se retrouver à la tête de l'équipe fanion du TUB, avec une montée en pré-nationale au bout d'une saison réussie. Après en avoir fait rêver et s'enthousiasmer plus d'un lorsqu'elle était sur les parquets, Poli transmet maintenant sa passion qui l'anime depuis tant d'années comme un véritable trait d'union entre les générations. Et c'est bien là que se trouve l'essence même de la distinction qui lui a été donnée le 22 juin 2019 à Labège. Aussi discrète qu'elle est grande, Poli n'aime pas être mise en avant et pourtant, ce trophée n'est qu'une juste récompense pour tout ce que cette grande dame a fait et fait encore pour le basket occitan. Elle avait participé aux JO de Séoul 88 avec l'équipe de Bulgarie, qui avait terminé 5ème du tournoi, quand elle s’était rompu un ligament du genou dès le premier match. En 1985, lors du championnat d'Europe en Italie, où son équipe gagna la médaille d'argent, elle était la plus jeune de l'équipe. Elle finira sa carrière à Tarbes, car le TGB l'a beaucoup aidée. À une époque, elle était prête à arrêter le basket, et si elle a pu jouer très longtemps c'est grâce au TGB et, jusqu'au bout, elle a donné tout ce qu’elle pouvait pour ce club. « Avant, le TGB était un club très fort et j'aimerais que le club ait retrouvé ce niveau quand j'arrêterai. Après je resterai à Tarbes. J'ai comme on dit "mon moitié", du côté de ma vie privée et cela s'arrange super bien. Ce n'est pas facile d'être comme tu veux dans la vie quand tu es connue, moi je voulais rencontrer quelqu'un qui aime Poli et pas Polina Tzekova, je crois que je suis bien tombée. J'ai un diplôme équivalent au BE1, et j'aimerais bien rester dans le monde du sport mais plutôt avec des enfants. J’apprécierais être maman ! Je suis une basketteuse mais je suis avant tout une femme, je crois qu'il y a des choses qui passent avant la carrière et je pense que la fierté d'une femme c'est d'être mère ! Et je suis capable de faire une croix sur ce qui a dirigé ma vie depuis le début, le basket, pour l'être ! » Mais, cette travailleuse infatigable n’a jamais quitté les parquets puisqu’elle s’est ensuite dirigé vers le coaching des jeunes de la région et est aussi sur le banc des U15 du CTC Ossun-Tarbes. D’ailleurs, Poli revenait parfois au TGB pour y jouer bénévolement, car son envie de revenir sur les parquets étant plus forte que tout. De plus, elle cumulera sa vie de basketteuse avec son travail au sein du Conservatoire de Tarbes, où elle travaillait depuis quelques années. Son palmarès : 1990-1991 : Championne de Bulgarie avec le Lokomotiv Sofia ; 1991-1992 : Finaliste de la Coupe d’Europe L. Ronchetti avec Priolo ; 1995-1996 : Vainqueur de la Coupe d’Europe L. Ronchetti avec Tarbes ; 1996-1997 : Vainqueur de la Coupe de France Joe Jaunay ; 1997-1998 : Vainqueur de la Coupe de France Joe Jaunay ; 1999 : Championne WNBA avec Houston ; 2001-2002 : Finaliste de la Coupe d’Europe L. Ronchetti avec Tarbes ; 2002-2003 : 3e du Championnat de France LFB ; 2003-2004 : 4e du Championnat de France LFB ; 2018-2019 montée en pré-national masculine avec Tarbes Union Basket 65. Ses distinctions : 1997-1998 : Élue 2e meilleure joueuse étrangère de NF1A ; 1998-1999 : Élue MVP étrangère du Championnat de France LFB ; 1999-2000 : Élue MVP étrangère du Championnat de France LFB. Sa carrière : 1977–1987 Pleven (Bulgarie) ; 1987–1991 Lokomotiv Sofia ; 1991–1995 ISAB Energy Priolo ; 1995–2002 Tarbes Gespe Bigorre (TGB) ; 1999 Comets de Houston ; 2003–2005 Tarbes Gespe Bigorre ; 2005–2008 Mourenx BC ; 2008–2009 Tarbes Gespe Bigorre ; 2× French League MVP (1999, 2000). Elle fut une des meilleures joueuses de Tarbes, qui a conquis la Coupe Ronchetti et la Coupe de France sous les couleurs Violettes.
Polina TSEKOVA, alias Poli, née le 30 avril 1968 à Pleven en Bulgarie, est une basketteuse internationale d’origine bulgare et naturalisée française, évoluant au poste de pivot et mesurant 1,95 m. Elle est considérée comme l'une des meilleures joueuses de basket-ball que le pays ait jamais eu. Elle a représenté l'équipe nationale féminine de basket-ball de Bulgarie, avec une moyenne de 18,5 points pour l'équipe. En 1996, elle participe à la victoire en Coupe d’Europe L. Ronchetti, le sacre européen de Tarbes Gespe Bigorre. En 1999, Tzekova a signé avec les Houston Comets au sein de la National Basketball Association (NBA) et faisait partie de la formation qui a remporté le titre à la fin de la saison 1999 de la WNBA. Elle avait également participé au tournoi féminin aux Jeux olympiques d'été de 1988. L'équipe tarbaise compte dans ses rangs une joueuse de classe internationale, Polina Tzekova, 1m95, avec un curriculum vitae à faire rêver bien des basketteuses. Cette joueuse a participé à toutes les compétitions possibles avec l'équipe nationale bulgare (Jeux olympiques, championnat du monde, championnat d'Europe) et en club (WNBA, Coupe Ronchetti, Euroligue, Coupe de France, tournoi de la Fédération), sans oublier toutes les distinctions acquises en tant que MVP étrangère, meilleure marqueuse, meilleure rebondeuse, meilleure évaluation de la Ligue. Cette joueuse écrase les rencontres de sa présence, avec classe et modestie, forçant le respect des adversaires ravis d'avoir eu l'opportunité de rencontrer une telle joueuse. Considérée comme une véritable icône du basket féminin dans son pays natal, elle n’a jamais quitté la Bigorre depuis qu’elle a pris sa retraite sportive en 2010 après le titre national. À 19 ans elle avait déjà été élue dans les dix meilleures joueuses européennes. Elle est un des rares pivots à être capable de shooter à 3 points. Elle quitte son pays en 1991 et jouera à Priolo en Italie pendant quatre ans avant de rejoindre en 1995, le TGB. Et chaque fois elle adoptera la langue du pays dans lequel elle vit, puisqu’elle parle couramment anglais, italien et français. Depuis maintenant quelques années, la Ligue Occitanie de basket a mis en œuvre l'académie régionale de basket, sous le modèle de l'académie fédérale. Il s'agit de mettre à l'honneur, au moment de l'assemblée générale de la Ligue, cinq personnalités qui ont mis en lumière notre basket local, qui ont eu un palmarès ou un parcours hors norme. Pour 2019, c’est Francis Jordane, qui est le parrain de la promotion, où sont à l’honneur cinq académiciens prestigieux pour le basket français : Pierre Galle, Maurice Boulois, Florence Roussel, Polina Tzekova, et Christophe Soulé. Et, parmi les lauréats de la promotion Francis-Jordane, grande figure du coaching français, on retrouvait une grande dame du basket bien connu des Tarbais : Polina Tzekova. Véritable icône du basket dans son pays natal, l'ancienne intérieure franco-bulgare possède l'un des plus beaux palmarès d'Europe : titres nationaux en Bulgarie avec le Lokomotiv Sofia et en France avec le Tarbes Gespe Basket (TGB), victoire en Coupe d'Europe Liliana-Ronchetti, trois Coupes de France et un titre de champion WNBA avec les Houston Comets en tant que pivot titulaire. Poli s'est imposée au fil des saisons comme l'une des meilleures intérieures d'Europe, glanant bon nombre de distinctions individuelles sur son passage qui lui ont permis d'être élue pour les 20 ans de la Ligue Féminine de Basketball (LFB) dans le meilleur cinq étranger 2018. Depuis qu'elle a posé les pieds sur le sol tarbais en 1995 pour rejoindre le TGB, après un passage par Priolo, en Italie, Poli n'a jamais quitté la Bigorre, et ce même pendant sa période mourenxoise, entre 2005 et 2008. Depuis sa retraite sportive en 2010 après le titre national avec le TGB, Poli s'est dirigée vers le coaching en prenant des jeunes sous son aile, dans un premier temps, avant de se retrouver à la tête de l'équipe fanion du TUB, avec une montée en pré-nationale au bout d'une saison réussie. Après en avoir fait rêver et s'enthousiasmer plus d'un lorsqu'elle était sur les parquets, Poli transmet maintenant sa passion qui l'anime depuis tant d'années comme un véritable trait d'union entre les générations. Et c'est bien là que se trouve l'essence même de la distinction qui lui a été donnée le 22 juin 2019 à Labège. Aussi discrète qu'elle est grande, Poli n'aime pas être mise en avant et pourtant, ce trophée n'est qu'une juste récompense pour tout ce que cette grande dame a fait et fait encore pour le basket occitan. Elle avait participé aux JO de Séoul 88 avec l'équipe de Bulgarie, qui avait terminé 5ème du tournoi, quand elle s’était rompu un ligament du genou dès le premier match. En 1985, lors du championnat d'Europe en Italie, où son équipe gagna la médaille d'argent, elle était la plus jeune de l'équipe. Elle finira sa carrière à Tarbes, car le TGB l'a beaucoup aidée. À une époque, elle était prête à arrêter le basket, et si elle a pu jouer très longtemps c'est grâce au TGB et, jusqu'au bout, elle a donné tout ce qu’elle pouvait pour ce club. « Avant, le TGB était un club très fort et j'aimerais que le club ait retrouvé ce niveau quand j'arrêterai. Après je resterai à Tarbes. J'ai comme on dit "mon moitié", du côté de ma vie privée et cela s'arrange super bien. Ce n'est pas facile d'être comme tu veux dans la vie quand tu es connue, moi je voulais rencontrer quelqu'un qui aime Poli et pas Polina Tzekova, je crois que je suis bien tombée. J'ai un diplôme équivalent au BE1, et j'aimerais bien rester dans le monde du sport mais plutôt avec des enfants. J’apprécierais être maman ! Je suis une basketteuse mais je suis avant tout une femme, je crois qu'il y a des choses qui passent avant la carrière et je pense que la fierté d'une femme c'est d'être mère ! Et je suis capable de faire une croix sur ce qui a dirigé ma vie depuis le début, le basket, pour l'être ! » Mais, cette travailleuse infatigable n’a jamais quitté les parquets puisqu’elle s’est ensuite dirigé vers le coaching des jeunes de la région et est aussi sur le banc des U15 du CTC Ossun-Tarbes. D’ailleurs, Poli revenait parfois au TGB pour y jouer bénévolement, car son envie de revenir sur les parquets étant plus forte que tout. De plus, elle cumulera sa vie de basketteuse avec son travail au sein du Conservatoire de Tarbes, où elle travaillait depuis quelques années. Son palmarès : 1990-1991 : Championne de Bulgarie avec le Lokomotiv Sofia ; 1991-1992 : Finaliste de la Coupe d’Europe L. Ronchetti avec Priolo ; 1995-1996 : Vainqueur de la Coupe d’Europe L. Ronchetti avec Tarbes ; 1996-1997 : Vainqueur de la Coupe de France Joe Jaunay ; 1997-1998 : Vainqueur de la Coupe de France Joe Jaunay ; 1999 : Championne WNBA avec Houston ; 2001-2002 : Finaliste de la Coupe d’Europe L. Ronchetti avec Tarbes ; 2002-2003 : 3e du Championnat de France LFB ; 2003-2004 : 4e du Championnat de France LFB ; 2018-2019 montée en pré-national masculine avec Tarbes Union Basket 65. Ses distinctions : 1997-1998 : Élue 2e meilleure joueuse étrangère de NF1A ; 1998-1999 : Élue MVP étrangère du Championnat de France LFB ; 1999-2000 : Élue MVP étrangère du Championnat de France LFB. Sa carrière : 1977–1987 Pleven (Bulgarie) ; 1987–1991 Lokomotiv Sofia ; 1991–1995 ISAB Energy Priolo ; 1995–2002 Tarbes Gespe Bigorre (TGB) ; 1999 Comets de Houston ; 2003–2005 Tarbes Gespe Bigorre ; 2005–2008 Mourenx BC ; 2008–2009 Tarbes Gespe Bigorre ; 2× French League MVP (1999, 2000). Elle fut une des meilleures joueuses de Tarbes, qui a conquis la Coupe Ronchetti et la Coupe de France sous les couleurs Violettes.VAUCLAIR Sylvie (1946-XXXX)
Astrophysicienne, Bigourdane d'adoption
 Sylvie VAUCLAIR, née le 7 mars 1946 à Saint Germain en Laye est astrophysicienne à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie et professeur émérite à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, où elle a enseigné pendant plus de 30 ans après avoir enseigné une dizaine d'années à l'Université Paris 7. Elle est membre honoraire de l'Institut universitaire de France, membre de l'Académie de l’air et de l’espace et de l'Academia Europaea. Après deux thèses sous la direction d’Hubert Reeves puis d’Evry Schatzman, ses travaux scientifiques ont d’abord porté sur la formation et l'évolution des éléments chimiques qui composent la matière dans l'Univers : Soleil, Étoiles, Univers primordial. Elle a particulièrement étudié l'importance de la diffusion sélective des atomes dans les conditions stellaires et ses conséquences pour leur structure et leur évolution. Elle a montré les répercussions de ces processus sur l'évolution de la matière dans l'univers depuis le Big-Bang. Un colloque international a été organisé en son honneur en 2013, sur le sujet des interactions entre les phénomènes microscopiques (atomiques) et macroscopiques (hydrodynamiques) intervenant dans les étoiles. C’est un sujet auquel elle a beaucoup contribué au cours de sa carrière, dans le but de mieux comprendre la structure et l’évolution des étoiles. Depuis quelques années, cette spécialiste du Soleil s’intéresse particulièrement à l’astérosismologie, c’est-à-dire aux vibrations des étoiles, ainsi qu’aux systèmes planétaires extra-solaires (exoplanètes). Musicienne diplômée du professorat, elle s'intéresse aux relations entre la philosophie, l'art et la science et participe à de nombreuses manifestations transdisciplinaires. Elle participe souvent à des débats de société. Sa carrière est jalonnée d’ouvrages à destination du grand public, alliant souvent la science et la musique. Elle a notamment écrit et publié « La Symphonie des étoiles (1997) », « La chanson du Soleil (2002) », « La Naissance des éléments (2006) », "La Terre, l’espace et au-delà (2009)", et avec Claude-Samuel Lévine, « La Nouvelle musique des sphères (2013) », « Dialogues avec l’Univers (2015) », « De l’origine de l’Univers à l’origine de la Vie: Une virgule dans l'espace-temps (2017) », aux Éditions Odile Jacob, « Le soleil ne se cachera pas pour mourir (2017) » avec Jean-Pierre Alaux, chez Privat, autant de livres qui ont été récompensés par plusieurs prix. Elle est Chevalier de la Légion d’honneur, Officier dans l'Ordre national du Mérite et Officier des Palmes académiques. Élue 1ère femme de Midi-Pyrénées « Version Femina » en 2003. Elle anime de nombreux cours et conférences de tous niveaux, souvent à destination d’un très large public. Ses actions et ouvrages ont été couronnés par l'Alpha d'Or de l'Espace (1998), le Prix du Cercle d'Oc (1999), le Prix du Livre Scientifique d’Orsay (2002), le Prix de L’Académie d’Occitanie (2007), le Grand Prix des Amis de la Cité de l’Espace (2009), le Grand Prix du Livre Scientifique des Gourmets de Lettres (Académie des Jeux Floraux) (2015). Elle intervient souvent dans les médias et tient actuellement une chronique astrophysique hebdomadaire sur radio présence. Depuis quelques années, le petit village de Gaillagos, dans les Hautes-Pyrénées, accueille « Festi’Val d’Azun, de la Terre aux Étoiles », une manifestation d'envergure, où l'on parle astronomie et climat, avec des pointures du monde scientifique. Ce festival est le fruit de la rencontre entre deux scientifiques résidant partiellement dans ce village pyrénéen. Le climatologue Hervé Le Treut, directeur de l'Institut Pierre-Simon-Laplace à Guyancourt, professeur à l'École polytechnique et à l'École normale supérieure (ENS), membre de l'Académie des sciences et l'astrophysicienne Sylvie Vauclair, qui ont tous deux un pied-à-terre à Gaillagos. On leur doit ce rendez-vous atypique du mois d’août. En 2019, Jean-Jacques Favier, l’astronaute scientifique français envoyé dans l'espace en 1996, en fut l’invité de marque de la conférence donnée sur le thème : « S'installer sur la lune, un demi-siècle après Apollo ».
Sylvie VAUCLAIR, née le 7 mars 1946 à Saint Germain en Laye est astrophysicienne à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie et professeur émérite à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, où elle a enseigné pendant plus de 30 ans après avoir enseigné une dizaine d'années à l'Université Paris 7. Elle est membre honoraire de l'Institut universitaire de France, membre de l'Académie de l’air et de l’espace et de l'Academia Europaea. Après deux thèses sous la direction d’Hubert Reeves puis d’Evry Schatzman, ses travaux scientifiques ont d’abord porté sur la formation et l'évolution des éléments chimiques qui composent la matière dans l'Univers : Soleil, Étoiles, Univers primordial. Elle a particulièrement étudié l'importance de la diffusion sélective des atomes dans les conditions stellaires et ses conséquences pour leur structure et leur évolution. Elle a montré les répercussions de ces processus sur l'évolution de la matière dans l'univers depuis le Big-Bang. Un colloque international a été organisé en son honneur en 2013, sur le sujet des interactions entre les phénomènes microscopiques (atomiques) et macroscopiques (hydrodynamiques) intervenant dans les étoiles. C’est un sujet auquel elle a beaucoup contribué au cours de sa carrière, dans le but de mieux comprendre la structure et l’évolution des étoiles. Depuis quelques années, cette spécialiste du Soleil s’intéresse particulièrement à l’astérosismologie, c’est-à-dire aux vibrations des étoiles, ainsi qu’aux systèmes planétaires extra-solaires (exoplanètes). Musicienne diplômée du professorat, elle s'intéresse aux relations entre la philosophie, l'art et la science et participe à de nombreuses manifestations transdisciplinaires. Elle participe souvent à des débats de société. Sa carrière est jalonnée d’ouvrages à destination du grand public, alliant souvent la science et la musique. Elle a notamment écrit et publié « La Symphonie des étoiles (1997) », « La chanson du Soleil (2002) », « La Naissance des éléments (2006) », "La Terre, l’espace et au-delà (2009)", et avec Claude-Samuel Lévine, « La Nouvelle musique des sphères (2013) », « Dialogues avec l’Univers (2015) », « De l’origine de l’Univers à l’origine de la Vie: Une virgule dans l'espace-temps (2017) », aux Éditions Odile Jacob, « Le soleil ne se cachera pas pour mourir (2017) » avec Jean-Pierre Alaux, chez Privat, autant de livres qui ont été récompensés par plusieurs prix. Elle est Chevalier de la Légion d’honneur, Officier dans l'Ordre national du Mérite et Officier des Palmes académiques. Élue 1ère femme de Midi-Pyrénées « Version Femina » en 2003. Elle anime de nombreux cours et conférences de tous niveaux, souvent à destination d’un très large public. Ses actions et ouvrages ont été couronnés par l'Alpha d'Or de l'Espace (1998), le Prix du Cercle d'Oc (1999), le Prix du Livre Scientifique d’Orsay (2002), le Prix de L’Académie d’Occitanie (2007), le Grand Prix des Amis de la Cité de l’Espace (2009), le Grand Prix du Livre Scientifique des Gourmets de Lettres (Académie des Jeux Floraux) (2015). Elle intervient souvent dans les médias et tient actuellement une chronique astrophysique hebdomadaire sur radio présence. Depuis quelques années, le petit village de Gaillagos, dans les Hautes-Pyrénées, accueille « Festi’Val d’Azun, de la Terre aux Étoiles », une manifestation d'envergure, où l'on parle astronomie et climat, avec des pointures du monde scientifique. Ce festival est le fruit de la rencontre entre deux scientifiques résidant partiellement dans ce village pyrénéen. Le climatologue Hervé Le Treut, directeur de l'Institut Pierre-Simon-Laplace à Guyancourt, professeur à l'École polytechnique et à l'École normale supérieure (ENS), membre de l'Académie des sciences et l'astrophysicienne Sylvie Vauclair, qui ont tous deux un pied-à-terre à Gaillagos. On leur doit ce rendez-vous atypique du mois d’août. En 2019, Jean-Jacques Favier, l’astronaute scientifique français envoyé dans l'espace en 1996, en fut l’invité de marque de la conférence donnée sur le thème : « S'installer sur la lune, un demi-siècle après Apollo ».
 Sylvie VAUCLAIR, née le 7 mars 1946 à Saint Germain en Laye est astrophysicienne à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie et professeur émérite à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, où elle a enseigné pendant plus de 30 ans après avoir enseigné une dizaine d'années à l'Université Paris 7. Elle est membre honoraire de l'Institut universitaire de France, membre de l'Académie de l’air et de l’espace et de l'Academia Europaea. Après deux thèses sous la direction d’Hubert Reeves puis d’Evry Schatzman, ses travaux scientifiques ont d’abord porté sur la formation et l'évolution des éléments chimiques qui composent la matière dans l'Univers : Soleil, Étoiles, Univers primordial. Elle a particulièrement étudié l'importance de la diffusion sélective des atomes dans les conditions stellaires et ses conséquences pour leur structure et leur évolution. Elle a montré les répercussions de ces processus sur l'évolution de la matière dans l'univers depuis le Big-Bang. Un colloque international a été organisé en son honneur en 2013, sur le sujet des interactions entre les phénomènes microscopiques (atomiques) et macroscopiques (hydrodynamiques) intervenant dans les étoiles. C’est un sujet auquel elle a beaucoup contribué au cours de sa carrière, dans le but de mieux comprendre la structure et l’évolution des étoiles. Depuis quelques années, cette spécialiste du Soleil s’intéresse particulièrement à l’astérosismologie, c’est-à-dire aux vibrations des étoiles, ainsi qu’aux systèmes planétaires extra-solaires (exoplanètes). Musicienne diplômée du professorat, elle s'intéresse aux relations entre la philosophie, l'art et la science et participe à de nombreuses manifestations transdisciplinaires. Elle participe souvent à des débats de société. Sa carrière est jalonnée d’ouvrages à destination du grand public, alliant souvent la science et la musique. Elle a notamment écrit et publié « La Symphonie des étoiles (1997) », « La chanson du Soleil (2002) », « La Naissance des éléments (2006) », "La Terre, l’espace et au-delà (2009)", et avec Claude-Samuel Lévine, « La Nouvelle musique des sphères (2013) », « Dialogues avec l’Univers (2015) », « De l’origine de l’Univers à l’origine de la Vie: Une virgule dans l'espace-temps (2017) », aux Éditions Odile Jacob, « Le soleil ne se cachera pas pour mourir (2017) » avec Jean-Pierre Alaux, chez Privat, autant de livres qui ont été récompensés par plusieurs prix. Elle est Chevalier de la Légion d’honneur, Officier dans l'Ordre national du Mérite et Officier des Palmes académiques. Élue 1ère femme de Midi-Pyrénées « Version Femina » en 2003. Elle anime de nombreux cours et conférences de tous niveaux, souvent à destination d’un très large public. Ses actions et ouvrages ont été couronnés par l'Alpha d'Or de l'Espace (1998), le Prix du Cercle d'Oc (1999), le Prix du Livre Scientifique d’Orsay (2002), le Prix de L’Académie d’Occitanie (2007), le Grand Prix des Amis de la Cité de l’Espace (2009), le Grand Prix du Livre Scientifique des Gourmets de Lettres (Académie des Jeux Floraux) (2015). Elle intervient souvent dans les médias et tient actuellement une chronique astrophysique hebdomadaire sur radio présence. Depuis quelques années, le petit village de Gaillagos, dans les Hautes-Pyrénées, accueille « Festi’Val d’Azun, de la Terre aux Étoiles », une manifestation d'envergure, où l'on parle astronomie et climat, avec des pointures du monde scientifique. Ce festival est le fruit de la rencontre entre deux scientifiques résidant partiellement dans ce village pyrénéen. Le climatologue Hervé Le Treut, directeur de l'Institut Pierre-Simon-Laplace à Guyancourt, professeur à l'École polytechnique et à l'École normale supérieure (ENS), membre de l'Académie des sciences et l'astrophysicienne Sylvie Vauclair, qui ont tous deux un pied-à-terre à Gaillagos. On leur doit ce rendez-vous atypique du mois d’août. En 2019, Jean-Jacques Favier, l’astronaute scientifique français envoyé dans l'espace en 1996, en fut l’invité de marque de la conférence donnée sur le thème : « S'installer sur la lune, un demi-siècle après Apollo ».
Sylvie VAUCLAIR, née le 7 mars 1946 à Saint Germain en Laye est astrophysicienne à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie et professeur émérite à l'Université Paul Sabatier de Toulouse, où elle a enseigné pendant plus de 30 ans après avoir enseigné une dizaine d'années à l'Université Paris 7. Elle est membre honoraire de l'Institut universitaire de France, membre de l'Académie de l’air et de l’espace et de l'Academia Europaea. Après deux thèses sous la direction d’Hubert Reeves puis d’Evry Schatzman, ses travaux scientifiques ont d’abord porté sur la formation et l'évolution des éléments chimiques qui composent la matière dans l'Univers : Soleil, Étoiles, Univers primordial. Elle a particulièrement étudié l'importance de la diffusion sélective des atomes dans les conditions stellaires et ses conséquences pour leur structure et leur évolution. Elle a montré les répercussions de ces processus sur l'évolution de la matière dans l'univers depuis le Big-Bang. Un colloque international a été organisé en son honneur en 2013, sur le sujet des interactions entre les phénomènes microscopiques (atomiques) et macroscopiques (hydrodynamiques) intervenant dans les étoiles. C’est un sujet auquel elle a beaucoup contribué au cours de sa carrière, dans le but de mieux comprendre la structure et l’évolution des étoiles. Depuis quelques années, cette spécialiste du Soleil s’intéresse particulièrement à l’astérosismologie, c’est-à-dire aux vibrations des étoiles, ainsi qu’aux systèmes planétaires extra-solaires (exoplanètes). Musicienne diplômée du professorat, elle s'intéresse aux relations entre la philosophie, l'art et la science et participe à de nombreuses manifestations transdisciplinaires. Elle participe souvent à des débats de société. Sa carrière est jalonnée d’ouvrages à destination du grand public, alliant souvent la science et la musique. Elle a notamment écrit et publié « La Symphonie des étoiles (1997) », « La chanson du Soleil (2002) », « La Naissance des éléments (2006) », "La Terre, l’espace et au-delà (2009)", et avec Claude-Samuel Lévine, « La Nouvelle musique des sphères (2013) », « Dialogues avec l’Univers (2015) », « De l’origine de l’Univers à l’origine de la Vie: Une virgule dans l'espace-temps (2017) », aux Éditions Odile Jacob, « Le soleil ne se cachera pas pour mourir (2017) » avec Jean-Pierre Alaux, chez Privat, autant de livres qui ont été récompensés par plusieurs prix. Elle est Chevalier de la Légion d’honneur, Officier dans l'Ordre national du Mérite et Officier des Palmes académiques. Élue 1ère femme de Midi-Pyrénées « Version Femina » en 2003. Elle anime de nombreux cours et conférences de tous niveaux, souvent à destination d’un très large public. Ses actions et ouvrages ont été couronnés par l'Alpha d'Or de l'Espace (1998), le Prix du Cercle d'Oc (1999), le Prix du Livre Scientifique d’Orsay (2002), le Prix de L’Académie d’Occitanie (2007), le Grand Prix des Amis de la Cité de l’Espace (2009), le Grand Prix du Livre Scientifique des Gourmets de Lettres (Académie des Jeux Floraux) (2015). Elle intervient souvent dans les médias et tient actuellement une chronique astrophysique hebdomadaire sur radio présence. Depuis quelques années, le petit village de Gaillagos, dans les Hautes-Pyrénées, accueille « Festi’Val d’Azun, de la Terre aux Étoiles », une manifestation d'envergure, où l'on parle astronomie et climat, avec des pointures du monde scientifique. Ce festival est le fruit de la rencontre entre deux scientifiques résidant partiellement dans ce village pyrénéen. Le climatologue Hervé Le Treut, directeur de l'Institut Pierre-Simon-Laplace à Guyancourt, professeur à l'École polytechnique et à l'École normale supérieure (ENS), membre de l'Académie des sciences et l'astrophysicienne Sylvie Vauclair, qui ont tous deux un pied-à-terre à Gaillagos. On leur doit ce rendez-vous atypique du mois d’août. En 2019, Jean-Jacques Favier, l’astronaute scientifique français envoyé dans l'espace en 1996, en fut l’invité de marque de la conférence donnée sur le thème : « S'installer sur la lune, un demi-siècle après Apollo ».VIGNOLE François (1914-1992)
Prodige du ski dès ses 11ans et plus grand skieur pyrénéen des années 1930
 François VIGNOLE, né le 8 juillet 1914 à Lau-Balagnas près d’Argelès-Gazost et mort le 1er avril 1992 à Lannemezan, se révèlera dans les années 1930 comme un des meilleurs skieurs alpins français. Il est un des pionniers du ski pyrénéen, mais il est également connu pour sa participation à la résistance et au sauvetage en montagne, ce qui lui valut la Légion d'honneur décernée le 28 janvier 1970 au titre de 3 ministères : ministère de l'Intérieur pour le secours en montagne, ministère des Armées pour ses actes de résistance, et ministère de la Jeunesse et des Sports pour ses résultats sportifs. Il a également entraîné la championne de ski Isabelle Mir, et est à l'origine de la station de ski de Saint-Lary-Soulan, dont il sera le premier directeur technique. Les parents du jeune garçon vivent dans une ferme au-dessus de Barèges, sur la route du col du Tourmalet. Et tous les jours François doit livrer un bidon de lait au village pour quelques pièces. Les hivers fortement enneigés à cette altitude, il n’est pas facile pour François de descendre à Barèges. Mais qu'à cela ne tienne. Équipé d’une vieille paire de skis en bois, l’un plus long que l’autre et de galoches fixées avec des lanières en cuir, il dévale les pentes, enchaînant des figures, et en veillant à ne pas renverser le bidon de lait. En 1925, son instituteur et instructeur à Barèges, Urbain Cazaux, qui deviendra le futur maire et créateur de la station de Barèges, qui a repéré le prodige, l’inscrit au championnat des Pyrénées à Cauterets. N’ayant pas l’argent du billet de bus et de tramway pour s’y rendre, le garçon part seul en ski à 2 heures du matin depuis la ferme familiale. Arrivé à Cauterets au petit matin, il obtient sa première victoire en ski de fond au Pont d’Espagne sans avoir mangé. L’après-midi, il remporte les épreuves de saut et de slalom. Puis il repart en sens inverse dans la soirée et regagne la ferme Vignole à 4 heures du matin, 20 heures après en être parti. Il avait à peine 11 ans ! Très polyvalent François Vignole développe son style dans les 4 disciplines du ski : fond, descente, slalom et saut. Son premier succès national est le championnat de France Cadets-Juniors de 1929 lors du Concours international de slalom à Superbagnères. À l’époque, on connaît surtout le fond, le grand fond et le saut. Le slalom s’imposera ensuite comme l’épreuve reine où on se grise de vitesse. François le casse-cou y excelle. Le jeune Barégeois, âgé de 15 ans, remporte le titre de champion de France dans la catégorie Cadets-Juniors. Il y rencontre d’autres jeunes surdoués de sa génération : Robert Villecampe, les frères René et Maurice Lafforgue. Par la suite, il deviendra un des skieurs les plus prometteurs de sa génération. En février1931, à Villard-de-Lans, François, Robert, René et Maurice, les quatre juniors pyrénéens raflent les quatre premières places. Le 12 février 1934, Chamonix organise sa première course internationale de descente. Autrichiens et Suisses prennent les quatre premières places, la cinquième à l’arrivée est pour François Vignole, chaussé d’une très rustique paire de skis en bois de frêne, fabriquée par un artisan menuisier de Luz-Saint-Sauveur, un certain Palasset. Sa carrière internationale progresse rapidement jusqu’en 1935. Élu meilleur skieur international, en 1935 le skieur de Barèges remporte à Chamonix le titre de champion de France international en slalom et en combiné descente et il termine troisième en descente, au nez et à la barbe des Alpins. Le champion de France 1935 arrache lors de la saison 1934/1935 une médaille de bronze en slalom hommes aux Mondiaux de Mürrens en Suisse. La seule de sa carrière. Fort de ses succès, François Vignole est pressenti pour représenter la France aux Jeux olympiques de février 1936 à Garmish-Partenkirchen, en Allemagne nazie, aux côtés de l’Alpin Émile Allais. À 21 ans, il doit renoncer la mort dans l’âme. Après une nuit glaciale passée en montagne, sa jambe droite s’est infectée. Une blessure mal soignée et c’est la paralysie et le début de la poliomyélite. Diminué par la maladie, il mettra un terme à sa carrière internationale. En raison de la guerre, les prochains Jeux olympiques ne reprendront qu’en 1948. Malgré des séquelles à la jambe droite, il continue sa carrière nationale de 1942 jusqu'en 1949, mais plus jamais il n’atteindra son meilleur niveau. Émile Allais dira d'ailleurs de lui qu'il aurait sûrement été un grand champion s’il n’avait pas été amoindri. Un exemple de longévité sportive malgré les coups du sort. En 1939, les séquelles de sa poliomyélite l'empêchent d'être mobilisé dans l’armée. Toutefois, pendant la guerre et l'occupation, il s'engage dans le réseau d’évasion Édouard, animé par Gaston Hêches (Thomas). Et, à partir de l'occupation de la zone libre en 1942, François, au péril de sa vie, fait passer régulièrement le courrier et des aviateurs anglais ou américains en Espagne, assurant la liberté de femmes et d’hommes fuyant Vichy et le nazisme. Sur l'ensemble de la filière du réseau Édouard, il gère la dernière étape, celle du passage de la frontière par la montagne, les plus hauts sommets et cols, dont il a une parfaite connaissance. Sur un parcours de 60 km avec un fort dénivelé, ce serait près de 500 exilés qu’il aurait guidés et confiés à son frère Marc qui prenait la relève dans la vallée de Piñeta. Grand champion de ski, François est aussi, l’un des plus grands chasseurs d’isards de son époque, un nemrod. Pris en flagrant délit de braconnage par un douanier, en haute vallée d’Aure, il est reconnu. Jetant à terre les deux isards tués, il détale à toutes jambes et traverse de nuit le massif du Néouvielle à pied et rejoint son domicile à Barèges. Au petit matin, les gendarmes goguenards, venus constater son absence, sont accueillis par Madame Vignole ; « François, lève-toi vite, ces messieurs veulent te voir… ». Les Barégeois interrogés certifient avoir vu ce jour-là Vignole jouer à la belote au bistrot du village. À Saint-Lary, on honore le style Vignole et depuis 2022, une piste rouge un brin technique porte son nom. Nom emblématique qui remporta l’unanimité tant pour honorer ses qualités de skieur, son implication à la station de St Lary, que son courage de résistant pendant le dernier conflit mondial. Une plaque rappelle la vie de ce pionnier du ski français qui fut actif aussi lors de la création de la station. À Saint-Lary-Soulan, François Vignole fut chargé de la formation technique d’une toute jeune skieuse, Isabelle Mir. Comme entraîneur, il fut déterminant dans la carrière de la championne olympique de descente. Elle fera une carrière exceptionnelle : 9 victoires en Coupe du monde et médaille d’argent aux Jeux olympiques d’hiver de Grenoble en 1968. Très douée, elle entrera au sein de l’équipe de France. Elle dira de lui : "C’était une libellule sur la neige. Les deux pieds serrés, un véritable oiseau. Il avait une idée fixe en tête, la vitesse… ». François Vignole aura participé à plus de 200 sauvetages en montagne, et assumé la responsabilité des secours en montagne pour les vallées d'Aure et du Louron. Cette activité, débutée dès 1937 a été une excellente couverture pendant la guerre. Dans les années 1930, les skieurs pyrénéens auront fait jeu égal avec leurs homologues alpins. François Vignole, l'homme aux semelles de vent, avait lui un style skis aux pieds inimitable. « Bras levés comme des ailes grandes ouvertes, il passait, il fonçait, il demeurait le plus ahurissant de tous » a écrit Marcellin Bérot, auteur d’une histoire du ski dans les Pyrénées. François Vignole est décédé à Lannemezan le 1er avril 1992 à l’âge de 77 ans.
François VIGNOLE, né le 8 juillet 1914 à Lau-Balagnas près d’Argelès-Gazost et mort le 1er avril 1992 à Lannemezan, se révèlera dans les années 1930 comme un des meilleurs skieurs alpins français. Il est un des pionniers du ski pyrénéen, mais il est également connu pour sa participation à la résistance et au sauvetage en montagne, ce qui lui valut la Légion d'honneur décernée le 28 janvier 1970 au titre de 3 ministères : ministère de l'Intérieur pour le secours en montagne, ministère des Armées pour ses actes de résistance, et ministère de la Jeunesse et des Sports pour ses résultats sportifs. Il a également entraîné la championne de ski Isabelle Mir, et est à l'origine de la station de ski de Saint-Lary-Soulan, dont il sera le premier directeur technique. Les parents du jeune garçon vivent dans une ferme au-dessus de Barèges, sur la route du col du Tourmalet. Et tous les jours François doit livrer un bidon de lait au village pour quelques pièces. Les hivers fortement enneigés à cette altitude, il n’est pas facile pour François de descendre à Barèges. Mais qu'à cela ne tienne. Équipé d’une vieille paire de skis en bois, l’un plus long que l’autre et de galoches fixées avec des lanières en cuir, il dévale les pentes, enchaînant des figures, et en veillant à ne pas renverser le bidon de lait. En 1925, son instituteur et instructeur à Barèges, Urbain Cazaux, qui deviendra le futur maire et créateur de la station de Barèges, qui a repéré le prodige, l’inscrit au championnat des Pyrénées à Cauterets. N’ayant pas l’argent du billet de bus et de tramway pour s’y rendre, le garçon part seul en ski à 2 heures du matin depuis la ferme familiale. Arrivé à Cauterets au petit matin, il obtient sa première victoire en ski de fond au Pont d’Espagne sans avoir mangé. L’après-midi, il remporte les épreuves de saut et de slalom. Puis il repart en sens inverse dans la soirée et regagne la ferme Vignole à 4 heures du matin, 20 heures après en être parti. Il avait à peine 11 ans ! Très polyvalent François Vignole développe son style dans les 4 disciplines du ski : fond, descente, slalom et saut. Son premier succès national est le championnat de France Cadets-Juniors de 1929 lors du Concours international de slalom à Superbagnères. À l’époque, on connaît surtout le fond, le grand fond et le saut. Le slalom s’imposera ensuite comme l’épreuve reine où on se grise de vitesse. François le casse-cou y excelle. Le jeune Barégeois, âgé de 15 ans, remporte le titre de champion de France dans la catégorie Cadets-Juniors. Il y rencontre d’autres jeunes surdoués de sa génération : Robert Villecampe, les frères René et Maurice Lafforgue. Par la suite, il deviendra un des skieurs les plus prometteurs de sa génération. En février1931, à Villard-de-Lans, François, Robert, René et Maurice, les quatre juniors pyrénéens raflent les quatre premières places. Le 12 février 1934, Chamonix organise sa première course internationale de descente. Autrichiens et Suisses prennent les quatre premières places, la cinquième à l’arrivée est pour François Vignole, chaussé d’une très rustique paire de skis en bois de frêne, fabriquée par un artisan menuisier de Luz-Saint-Sauveur, un certain Palasset. Sa carrière internationale progresse rapidement jusqu’en 1935. Élu meilleur skieur international, en 1935 le skieur de Barèges remporte à Chamonix le titre de champion de France international en slalom et en combiné descente et il termine troisième en descente, au nez et à la barbe des Alpins. Le champion de France 1935 arrache lors de la saison 1934/1935 une médaille de bronze en slalom hommes aux Mondiaux de Mürrens en Suisse. La seule de sa carrière. Fort de ses succès, François Vignole est pressenti pour représenter la France aux Jeux olympiques de février 1936 à Garmish-Partenkirchen, en Allemagne nazie, aux côtés de l’Alpin Émile Allais. À 21 ans, il doit renoncer la mort dans l’âme. Après une nuit glaciale passée en montagne, sa jambe droite s’est infectée. Une blessure mal soignée et c’est la paralysie et le début de la poliomyélite. Diminué par la maladie, il mettra un terme à sa carrière internationale. En raison de la guerre, les prochains Jeux olympiques ne reprendront qu’en 1948. Malgré des séquelles à la jambe droite, il continue sa carrière nationale de 1942 jusqu'en 1949, mais plus jamais il n’atteindra son meilleur niveau. Émile Allais dira d'ailleurs de lui qu'il aurait sûrement été un grand champion s’il n’avait pas été amoindri. Un exemple de longévité sportive malgré les coups du sort. En 1939, les séquelles de sa poliomyélite l'empêchent d'être mobilisé dans l’armée. Toutefois, pendant la guerre et l'occupation, il s'engage dans le réseau d’évasion Édouard, animé par Gaston Hêches (Thomas). Et, à partir de l'occupation de la zone libre en 1942, François, au péril de sa vie, fait passer régulièrement le courrier et des aviateurs anglais ou américains en Espagne, assurant la liberté de femmes et d’hommes fuyant Vichy et le nazisme. Sur l'ensemble de la filière du réseau Édouard, il gère la dernière étape, celle du passage de la frontière par la montagne, les plus hauts sommets et cols, dont il a une parfaite connaissance. Sur un parcours de 60 km avec un fort dénivelé, ce serait près de 500 exilés qu’il aurait guidés et confiés à son frère Marc qui prenait la relève dans la vallée de Piñeta. Grand champion de ski, François est aussi, l’un des plus grands chasseurs d’isards de son époque, un nemrod. Pris en flagrant délit de braconnage par un douanier, en haute vallée d’Aure, il est reconnu. Jetant à terre les deux isards tués, il détale à toutes jambes et traverse de nuit le massif du Néouvielle à pied et rejoint son domicile à Barèges. Au petit matin, les gendarmes goguenards, venus constater son absence, sont accueillis par Madame Vignole ; « François, lève-toi vite, ces messieurs veulent te voir… ». Les Barégeois interrogés certifient avoir vu ce jour-là Vignole jouer à la belote au bistrot du village. À Saint-Lary, on honore le style Vignole et depuis 2022, une piste rouge un brin technique porte son nom. Nom emblématique qui remporta l’unanimité tant pour honorer ses qualités de skieur, son implication à la station de St Lary, que son courage de résistant pendant le dernier conflit mondial. Une plaque rappelle la vie de ce pionnier du ski français qui fut actif aussi lors de la création de la station. À Saint-Lary-Soulan, François Vignole fut chargé de la formation technique d’une toute jeune skieuse, Isabelle Mir. Comme entraîneur, il fut déterminant dans la carrière de la championne olympique de descente. Elle fera une carrière exceptionnelle : 9 victoires en Coupe du monde et médaille d’argent aux Jeux olympiques d’hiver de Grenoble en 1968. Très douée, elle entrera au sein de l’équipe de France. Elle dira de lui : "C’était une libellule sur la neige. Les deux pieds serrés, un véritable oiseau. Il avait une idée fixe en tête, la vitesse… ». François Vignole aura participé à plus de 200 sauvetages en montagne, et assumé la responsabilité des secours en montagne pour les vallées d'Aure et du Louron. Cette activité, débutée dès 1937 a été une excellente couverture pendant la guerre. Dans les années 1930, les skieurs pyrénéens auront fait jeu égal avec leurs homologues alpins. François Vignole, l'homme aux semelles de vent, avait lui un style skis aux pieds inimitable. « Bras levés comme des ailes grandes ouvertes, il passait, il fonçait, il demeurait le plus ahurissant de tous » a écrit Marcellin Bérot, auteur d’une histoire du ski dans les Pyrénées. François Vignole est décédé à Lannemezan le 1er avril 1992 à l’âge de 77 ans.
 François VIGNOLE, né le 8 juillet 1914 à Lau-Balagnas près d’Argelès-Gazost et mort le 1er avril 1992 à Lannemezan, se révèlera dans les années 1930 comme un des meilleurs skieurs alpins français. Il est un des pionniers du ski pyrénéen, mais il est également connu pour sa participation à la résistance et au sauvetage en montagne, ce qui lui valut la Légion d'honneur décernée le 28 janvier 1970 au titre de 3 ministères : ministère de l'Intérieur pour le secours en montagne, ministère des Armées pour ses actes de résistance, et ministère de la Jeunesse et des Sports pour ses résultats sportifs. Il a également entraîné la championne de ski Isabelle Mir, et est à l'origine de la station de ski de Saint-Lary-Soulan, dont il sera le premier directeur technique. Les parents du jeune garçon vivent dans une ferme au-dessus de Barèges, sur la route du col du Tourmalet. Et tous les jours François doit livrer un bidon de lait au village pour quelques pièces. Les hivers fortement enneigés à cette altitude, il n’est pas facile pour François de descendre à Barèges. Mais qu'à cela ne tienne. Équipé d’une vieille paire de skis en bois, l’un plus long que l’autre et de galoches fixées avec des lanières en cuir, il dévale les pentes, enchaînant des figures, et en veillant à ne pas renverser le bidon de lait. En 1925, son instituteur et instructeur à Barèges, Urbain Cazaux, qui deviendra le futur maire et créateur de la station de Barèges, qui a repéré le prodige, l’inscrit au championnat des Pyrénées à Cauterets. N’ayant pas l’argent du billet de bus et de tramway pour s’y rendre, le garçon part seul en ski à 2 heures du matin depuis la ferme familiale. Arrivé à Cauterets au petit matin, il obtient sa première victoire en ski de fond au Pont d’Espagne sans avoir mangé. L’après-midi, il remporte les épreuves de saut et de slalom. Puis il repart en sens inverse dans la soirée et regagne la ferme Vignole à 4 heures du matin, 20 heures après en être parti. Il avait à peine 11 ans ! Très polyvalent François Vignole développe son style dans les 4 disciplines du ski : fond, descente, slalom et saut. Son premier succès national est le championnat de France Cadets-Juniors de 1929 lors du Concours international de slalom à Superbagnères. À l’époque, on connaît surtout le fond, le grand fond et le saut. Le slalom s’imposera ensuite comme l’épreuve reine où on se grise de vitesse. François le casse-cou y excelle. Le jeune Barégeois, âgé de 15 ans, remporte le titre de champion de France dans la catégorie Cadets-Juniors. Il y rencontre d’autres jeunes surdoués de sa génération : Robert Villecampe, les frères René et Maurice Lafforgue. Par la suite, il deviendra un des skieurs les plus prometteurs de sa génération. En février1931, à Villard-de-Lans, François, Robert, René et Maurice, les quatre juniors pyrénéens raflent les quatre premières places. Le 12 février 1934, Chamonix organise sa première course internationale de descente. Autrichiens et Suisses prennent les quatre premières places, la cinquième à l’arrivée est pour François Vignole, chaussé d’une très rustique paire de skis en bois de frêne, fabriquée par un artisan menuisier de Luz-Saint-Sauveur, un certain Palasset. Sa carrière internationale progresse rapidement jusqu’en 1935. Élu meilleur skieur international, en 1935 le skieur de Barèges remporte à Chamonix le titre de champion de France international en slalom et en combiné descente et il termine troisième en descente, au nez et à la barbe des Alpins. Le champion de France 1935 arrache lors de la saison 1934/1935 une médaille de bronze en slalom hommes aux Mondiaux de Mürrens en Suisse. La seule de sa carrière. Fort de ses succès, François Vignole est pressenti pour représenter la France aux Jeux olympiques de février 1936 à Garmish-Partenkirchen, en Allemagne nazie, aux côtés de l’Alpin Émile Allais. À 21 ans, il doit renoncer la mort dans l’âme. Après une nuit glaciale passée en montagne, sa jambe droite s’est infectée. Une blessure mal soignée et c’est la paralysie et le début de la poliomyélite. Diminué par la maladie, il mettra un terme à sa carrière internationale. En raison de la guerre, les prochains Jeux olympiques ne reprendront qu’en 1948. Malgré des séquelles à la jambe droite, il continue sa carrière nationale de 1942 jusqu'en 1949, mais plus jamais il n’atteindra son meilleur niveau. Émile Allais dira d'ailleurs de lui qu'il aurait sûrement été un grand champion s’il n’avait pas été amoindri. Un exemple de longévité sportive malgré les coups du sort. En 1939, les séquelles de sa poliomyélite l'empêchent d'être mobilisé dans l’armée. Toutefois, pendant la guerre et l'occupation, il s'engage dans le réseau d’évasion Édouard, animé par Gaston Hêches (Thomas). Et, à partir de l'occupation de la zone libre en 1942, François, au péril de sa vie, fait passer régulièrement le courrier et des aviateurs anglais ou américains en Espagne, assurant la liberté de femmes et d’hommes fuyant Vichy et le nazisme. Sur l'ensemble de la filière du réseau Édouard, il gère la dernière étape, celle du passage de la frontière par la montagne, les plus hauts sommets et cols, dont il a une parfaite connaissance. Sur un parcours de 60 km avec un fort dénivelé, ce serait près de 500 exilés qu’il aurait guidés et confiés à son frère Marc qui prenait la relève dans la vallée de Piñeta. Grand champion de ski, François est aussi, l’un des plus grands chasseurs d’isards de son époque, un nemrod. Pris en flagrant délit de braconnage par un douanier, en haute vallée d’Aure, il est reconnu. Jetant à terre les deux isards tués, il détale à toutes jambes et traverse de nuit le massif du Néouvielle à pied et rejoint son domicile à Barèges. Au petit matin, les gendarmes goguenards, venus constater son absence, sont accueillis par Madame Vignole ; « François, lève-toi vite, ces messieurs veulent te voir… ». Les Barégeois interrogés certifient avoir vu ce jour-là Vignole jouer à la belote au bistrot du village. À Saint-Lary, on honore le style Vignole et depuis 2022, une piste rouge un brin technique porte son nom. Nom emblématique qui remporta l’unanimité tant pour honorer ses qualités de skieur, son implication à la station de St Lary, que son courage de résistant pendant le dernier conflit mondial. Une plaque rappelle la vie de ce pionnier du ski français qui fut actif aussi lors de la création de la station. À Saint-Lary-Soulan, François Vignole fut chargé de la formation technique d’une toute jeune skieuse, Isabelle Mir. Comme entraîneur, il fut déterminant dans la carrière de la championne olympique de descente. Elle fera une carrière exceptionnelle : 9 victoires en Coupe du monde et médaille d’argent aux Jeux olympiques d’hiver de Grenoble en 1968. Très douée, elle entrera au sein de l’équipe de France. Elle dira de lui : "C’était une libellule sur la neige. Les deux pieds serrés, un véritable oiseau. Il avait une idée fixe en tête, la vitesse… ». François Vignole aura participé à plus de 200 sauvetages en montagne, et assumé la responsabilité des secours en montagne pour les vallées d'Aure et du Louron. Cette activité, débutée dès 1937 a été une excellente couverture pendant la guerre. Dans les années 1930, les skieurs pyrénéens auront fait jeu égal avec leurs homologues alpins. François Vignole, l'homme aux semelles de vent, avait lui un style skis aux pieds inimitable. « Bras levés comme des ailes grandes ouvertes, il passait, il fonçait, il demeurait le plus ahurissant de tous » a écrit Marcellin Bérot, auteur d’une histoire du ski dans les Pyrénées. François Vignole est décédé à Lannemezan le 1er avril 1992 à l’âge de 77 ans.
François VIGNOLE, né le 8 juillet 1914 à Lau-Balagnas près d’Argelès-Gazost et mort le 1er avril 1992 à Lannemezan, se révèlera dans les années 1930 comme un des meilleurs skieurs alpins français. Il est un des pionniers du ski pyrénéen, mais il est également connu pour sa participation à la résistance et au sauvetage en montagne, ce qui lui valut la Légion d'honneur décernée le 28 janvier 1970 au titre de 3 ministères : ministère de l'Intérieur pour le secours en montagne, ministère des Armées pour ses actes de résistance, et ministère de la Jeunesse et des Sports pour ses résultats sportifs. Il a également entraîné la championne de ski Isabelle Mir, et est à l'origine de la station de ski de Saint-Lary-Soulan, dont il sera le premier directeur technique. Les parents du jeune garçon vivent dans une ferme au-dessus de Barèges, sur la route du col du Tourmalet. Et tous les jours François doit livrer un bidon de lait au village pour quelques pièces. Les hivers fortement enneigés à cette altitude, il n’est pas facile pour François de descendre à Barèges. Mais qu'à cela ne tienne. Équipé d’une vieille paire de skis en bois, l’un plus long que l’autre et de galoches fixées avec des lanières en cuir, il dévale les pentes, enchaînant des figures, et en veillant à ne pas renverser le bidon de lait. En 1925, son instituteur et instructeur à Barèges, Urbain Cazaux, qui deviendra le futur maire et créateur de la station de Barèges, qui a repéré le prodige, l’inscrit au championnat des Pyrénées à Cauterets. N’ayant pas l’argent du billet de bus et de tramway pour s’y rendre, le garçon part seul en ski à 2 heures du matin depuis la ferme familiale. Arrivé à Cauterets au petit matin, il obtient sa première victoire en ski de fond au Pont d’Espagne sans avoir mangé. L’après-midi, il remporte les épreuves de saut et de slalom. Puis il repart en sens inverse dans la soirée et regagne la ferme Vignole à 4 heures du matin, 20 heures après en être parti. Il avait à peine 11 ans ! Très polyvalent François Vignole développe son style dans les 4 disciplines du ski : fond, descente, slalom et saut. Son premier succès national est le championnat de France Cadets-Juniors de 1929 lors du Concours international de slalom à Superbagnères. À l’époque, on connaît surtout le fond, le grand fond et le saut. Le slalom s’imposera ensuite comme l’épreuve reine où on se grise de vitesse. François le casse-cou y excelle. Le jeune Barégeois, âgé de 15 ans, remporte le titre de champion de France dans la catégorie Cadets-Juniors. Il y rencontre d’autres jeunes surdoués de sa génération : Robert Villecampe, les frères René et Maurice Lafforgue. Par la suite, il deviendra un des skieurs les plus prometteurs de sa génération. En février1931, à Villard-de-Lans, François, Robert, René et Maurice, les quatre juniors pyrénéens raflent les quatre premières places. Le 12 février 1934, Chamonix organise sa première course internationale de descente. Autrichiens et Suisses prennent les quatre premières places, la cinquième à l’arrivée est pour François Vignole, chaussé d’une très rustique paire de skis en bois de frêne, fabriquée par un artisan menuisier de Luz-Saint-Sauveur, un certain Palasset. Sa carrière internationale progresse rapidement jusqu’en 1935. Élu meilleur skieur international, en 1935 le skieur de Barèges remporte à Chamonix le titre de champion de France international en slalom et en combiné descente et il termine troisième en descente, au nez et à la barbe des Alpins. Le champion de France 1935 arrache lors de la saison 1934/1935 une médaille de bronze en slalom hommes aux Mondiaux de Mürrens en Suisse. La seule de sa carrière. Fort de ses succès, François Vignole est pressenti pour représenter la France aux Jeux olympiques de février 1936 à Garmish-Partenkirchen, en Allemagne nazie, aux côtés de l’Alpin Émile Allais. À 21 ans, il doit renoncer la mort dans l’âme. Après une nuit glaciale passée en montagne, sa jambe droite s’est infectée. Une blessure mal soignée et c’est la paralysie et le début de la poliomyélite. Diminué par la maladie, il mettra un terme à sa carrière internationale. En raison de la guerre, les prochains Jeux olympiques ne reprendront qu’en 1948. Malgré des séquelles à la jambe droite, il continue sa carrière nationale de 1942 jusqu'en 1949, mais plus jamais il n’atteindra son meilleur niveau. Émile Allais dira d'ailleurs de lui qu'il aurait sûrement été un grand champion s’il n’avait pas été amoindri. Un exemple de longévité sportive malgré les coups du sort. En 1939, les séquelles de sa poliomyélite l'empêchent d'être mobilisé dans l’armée. Toutefois, pendant la guerre et l'occupation, il s'engage dans le réseau d’évasion Édouard, animé par Gaston Hêches (Thomas). Et, à partir de l'occupation de la zone libre en 1942, François, au péril de sa vie, fait passer régulièrement le courrier et des aviateurs anglais ou américains en Espagne, assurant la liberté de femmes et d’hommes fuyant Vichy et le nazisme. Sur l'ensemble de la filière du réseau Édouard, il gère la dernière étape, celle du passage de la frontière par la montagne, les plus hauts sommets et cols, dont il a une parfaite connaissance. Sur un parcours de 60 km avec un fort dénivelé, ce serait près de 500 exilés qu’il aurait guidés et confiés à son frère Marc qui prenait la relève dans la vallée de Piñeta. Grand champion de ski, François est aussi, l’un des plus grands chasseurs d’isards de son époque, un nemrod. Pris en flagrant délit de braconnage par un douanier, en haute vallée d’Aure, il est reconnu. Jetant à terre les deux isards tués, il détale à toutes jambes et traverse de nuit le massif du Néouvielle à pied et rejoint son domicile à Barèges. Au petit matin, les gendarmes goguenards, venus constater son absence, sont accueillis par Madame Vignole ; « François, lève-toi vite, ces messieurs veulent te voir… ». Les Barégeois interrogés certifient avoir vu ce jour-là Vignole jouer à la belote au bistrot du village. À Saint-Lary, on honore le style Vignole et depuis 2022, une piste rouge un brin technique porte son nom. Nom emblématique qui remporta l’unanimité tant pour honorer ses qualités de skieur, son implication à la station de St Lary, que son courage de résistant pendant le dernier conflit mondial. Une plaque rappelle la vie de ce pionnier du ski français qui fut actif aussi lors de la création de la station. À Saint-Lary-Soulan, François Vignole fut chargé de la formation technique d’une toute jeune skieuse, Isabelle Mir. Comme entraîneur, il fut déterminant dans la carrière de la championne olympique de descente. Elle fera une carrière exceptionnelle : 9 victoires en Coupe du monde et médaille d’argent aux Jeux olympiques d’hiver de Grenoble en 1968. Très douée, elle entrera au sein de l’équipe de France. Elle dira de lui : "C’était une libellule sur la neige. Les deux pieds serrés, un véritable oiseau. Il avait une idée fixe en tête, la vitesse… ». François Vignole aura participé à plus de 200 sauvetages en montagne, et assumé la responsabilité des secours en montagne pour les vallées d'Aure et du Louron. Cette activité, débutée dès 1937 a été une excellente couverture pendant la guerre. Dans les années 1930, les skieurs pyrénéens auront fait jeu égal avec leurs homologues alpins. François Vignole, l'homme aux semelles de vent, avait lui un style skis aux pieds inimitable. « Bras levés comme des ailes grandes ouvertes, il passait, il fonçait, il demeurait le plus ahurissant de tous » a écrit Marcellin Bérot, auteur d’une histoire du ski dans les Pyrénées. François Vignole est décédé à Lannemezan le 1er avril 1992 à l’âge de 77 ans.