Par Henri Goursau100 célébrités
des Hautes-Pyrénées
Découvrez les biographies de 100 célébrités des Hautes-Pyrénées.
100 célébrités des Hautes-Pyrénées
Il y a 11 noms dans ce répertoire commençant par la lettre B.
BARBARA (1930-1997)
Auteure-compositrice-interprète
 Barbara, née Monique Andrée Serf le 9 juin 1930 près du square des Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris et décédée le 24 novembre 1997 à Neuilly-sur-Seine. Elle est le deuxième enfant d’une famille qui en compte quatre. Elle a marqué la chanson française de sa musique poétique et passionnelle. Nombre de ses chansons sont devenues des classiques, notamment : « Dis, quand reviendras-tu ? », « Nantes », « Au bois de Saint-Amand », « Göttingen », « La solitude », « Une petite cantate », « La Dame brune », « L'Aigle noir », « Marienbad », « Ma plus belle histoire d’amour », « Pierre », « Le mal de vivre », « Vienne », « Drouot » ou encore « Si la photo est bonne ». Elle a joué dans trois films pour le cinéma « Aussi loin que l’amour » en 1971, « Franz » en 1972, « L’oiseau rare » en 1973 et dans deux pièces musicales sur scène : « Madame » en 1970, et « Lily passion » avec Gérard Depardieu en 1985. Depuis 2010, le « prix Barbara » récompense chaque année une jeune chanteuse francophone. Elle est la fille de Jacques Serf, un Juif alsacien, représentant de commerce en peaux et fourrures et d’Esther Brodsky, Juive née à Tiraspol (Moldavie), fonctionnaire à la préfecture de Paris. Monique Serf passe les premières années de sa vie dans ce coin des Batignolles, avec ses parents, sa grand-mère maternelle Hava Poustilnikov, née à Zlatopil (en Ukraine), et son frère aîné Jean, né en 1928. Sa jeunesse est marquée par des déménagements successifs, notamment en 1937, à Marseille, première étape d’un itinéraire sinueux, 1938, au 26, rue Mulsant à Roanne (Loire), où naît sa sœur Régine en août de la même année, en 1939, la famille quitte Roanne pour Le Vésinet dans la banlieue ouest de la capitale, où réside Jeanne Spire, la tante de Monsieur Serf. En septembre 1939 la guerre éclate et son père rejoint le front. Jeanne Spire, Jean et Monique rejoignent Poitiers, où un médecin les héberge. En 1940, sa mère travaille à la préfecture de Blois. Les deux aînés et leur grand-tante l’y rejoignent. Un bombardement de la ville s’annonce. Les deux enfants partent en train avec Jeanne Spire. Une attaque de l’aviation allemande vise le convoi en rase campagne. Les voyageurs resteront bloqués dans le train durant plusieurs jours. L’école communale de Préaux (Indre) accueille les réfugiés du train. Jeanne Spire loue deux chambres au-dessus du café Lanchais sur la place du village. Les deux enfants et Jeanne Spire resteront plus d’un an à Préaux. Ils s’intègrent à la vie du village, Monique et Jean vont à l’école communale. Fin 1941, par l’intermédiaire de la mairie de Préaux, leur grand-tante apprend que les parents résident à Tarbes, où Monsieur Serf est démobilisé. La famille se recompose immédiatement à Tarbes (Hautes-Pyrénées), au 3 bis, rue des Carmes. La tante Jeanne reste quelques mois avec eux. Claude, le jeune frère de Monique naît en mars 1942. Monique fréquente l’école communale. Mais la famille doit quitter rapidement Tarbes : un dénonciateur a informé la police qu’une famille juive vit rue des Carmes. Une menace de rafle dont les parents ont été informés. C'est la tante Jeanne qui avait été prévenue la veille du départ. Les déménagements redoublent sous l’Occupation pour fuir la traque nazie faite aux juifs. S’y ajoutent les séparations pour déjouer les dénonciations. De 1943 à octobre 1945, la famille se cache près de Chasseneuil-sur-Bonnieure en Charente, puis à Grenoble et à Saint-Marcellin en Isère. À la Libération, les membres de la famille quittent Saint-Marcellin pour Paris, d’abord au 131, rue Marcadet, puis dans un appartement rue Notre-Dame-de-Nazareth, puis dans un autre hôtel rue de Vaugirard, où ils se retrouvent tous. Barbara subira le comportement incestueux de son père pendant son enfance. Après Blois, Préaux, la voilà donc fin 1941 à Tarbes. Qui rêve spectacles, déguise ses voisins de la cour « et la petite fille de la propriétaire qui était rudement jolie et qui intéressait diablement mon frère Jean », se souvient-elle. Mais c'est un quotidien de cauchemar que vit la petite fille juive dans « une assez grande maison, 3 bis, rue des Carmes ». Son frère est premier en tout au lycée Théophile-Gautier. Elle est « très indisciplinée », « frondeuse », « désobéissante », disent ses livrets scolaires de la communale. Son père ne manque jamais une occasion de l'humilier. Sauf quand ils sont seuls tous les deux. Elle n'écrira jamais le mot. Mais « le soir, lorsque j'entends claquer le grand portail vert et les pas de mon père résonner dans la cour, je me prends à trembler ». Et les larmes lui viennent, confie-t-elle en révélant sans le dire l'inceste. Rappelant simplement « les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire ». C’est à Tarbes, alors qu'elle a à peine onze ans et demi, que son père abuse d'elle pour la première fois. "Un soir, à Tarbes, mon univers bascule dans l'horreur", écrit-elle. Personne ne dénonce l'inceste dans sa famille. Elle tente bien de s'adresser à une gendarmerie, au soir d'une fugue en Bretagne. On l'écoute mais sa plainte n'est pas enregistrée. Son père revient la chercher et laisse entendre qu'elle affabule. En 1949, alors qu'elle n'a que dix-neuf ans, le départ définitif du foyer familial de son père marque l'interruption de leurs rapports, mais elle n'en fait le récit que très tard, dans ses mémoires interrompus par sa mort en 1997, sans toutefois se décider à dire les mots de « viol » et d'« inceste ». « Tarbes a toujours été un souvenir très dur pour Barbara », confiera à la Dépêche du Midi, Marie Chaix, la secrétaire et biographe de la chanteuse Barbara. « Je ne chanterai pas à Tarbes », disait-elle. Plus tard, elle donnera un concert, finalement, mais à Ibos, au Parvis. C’est donc à Tarbes qu’elle vécut les pires moments de sa vie qui lui inspirèrent plus tard, la chanson « L’Aigle noir ». Beaucoup de personnes se sont interrogées sur le sens réel des paroles de « L'Aigle noir ». De son vivant, Barbara se dérobait à chaque fois, prétextant que cela ne concernait qu'elle : "Ce ne sont pas les paroles qui sont importantes...", disait-elle. Selon le chanteur Patrick Bruel, qui a repris le titre en 2015, ces paroles seraient une référence à l'emblème du Troisième Reich et à la vie d'errance et de danger durant l'enfance de la chanteuse. Le journaliste Pierre Adrian commente : "Après l'interprétation psychanalytique, voici l'interprétation historique". En 1946, la famille Self s’installe au Vésinet (Yvelines) à la pension des Trois Marroniers au 31 bis, rue Ernest-André, où la future Barbara prend ses premiers cours de chant chez Madame Madeleine Thomas-Dusséqué. À son contact, elle apprend le chant, le solfège et le piano, avant d'emménager au 50, rue de Vitruve dans le 20e arrondissement de Paris. Madame Dusséqué quitte le Vésinet pour Paris. Elle donne des cours salle Pleyel. Le 30 décembre 1946, sa grand-mère maternelle Hava Poustilnikov décède à Paris à son domicile 131, rue Marcadet, à l’âge de 66 ans. Cette femme comptait beaucoup pour Monique. Peu attirée par les études, elle ambitionne depuis longtemps de devenir pianiste mais son rêve est brisé depuis 1944, un kyste à la main droite ayant obligé les médecins de Grenoble à intervenir à sept reprises et sectionner les tendons. Ses parents promettent de lui offrir des cours de chant. Elle s’inscrit à ceux de Mme Dusséqué. Sa vie en est changée. Au bout de quelques leçons, sa professeure la présente à maître Paulet, enseignant au Conservatoire de Paris, qui la prend comme élève en 1947. Dans le nouvel appartement, un piano loué par son père est installé ; Monique en joue d’instinct, sans prendre de leçons. La jeune fille entre au Conservatoire comme auditrice, mais au répertoire de chant classique, qui l'ennuie, elle préfère celui de la chanson populaire, ayant rencontré à l'ABC l'univers de Piaf. Elle arrête les cours en 1948. La même année, après avoir passé une audition au théâtre Mogador, elle est engagée comme mannequin-choriste dans l’opérette « Violettes impériales ». Un jour de 1949, son père abandonne soudainement le foyer, pour ne plus revenir. Bientôt, la même année, la location du piano ne peut plus être honorée. Contrainte de s’en séparer, elle vit un déchirement. Voulant à tout prix concrétiser son rêve, devenir "pianiste chantante", elle quitte Paris en février 1950. Grâce à l’argent prêté par une amie, elle s’exile à Bruxelles chez un cousin, Sacha Piroutsky, qu’elle quitte au bout de deux mois car il devenait violent. Sans ressources ni connaissances, la vie est difficile. Au hasard d’une rencontre, elle rejoint une communauté d’artistes à Charleroi, qui se réunissent dans un local appelé La Mansarde. Là, elle trouve de l’aide et commence à chanter dans des cabarets sous le nom de Barbara Brodi (en l'honneur d'une de ses aïeules ukrainiennes appelée Varvara, ou de sa grand-mère Hava Brodsky). Son répertoire est constitué de chansons d’Édith Piaf, Marianne Oswald, Germaine Montero, Juliette Gréco. Chaque fois, le public la siffle copieusement. En 1950, elle rencontre Jacques Brel qui, comme elle, tente de percer en se produisant dans divers cabarets. Elle ajoute à son répertoire les premières chansons de cet auteur-compositeur en herbe avec qui elle va se lier d'une très grande amitié discrète mais indéfectible, pleine de complicité et d'admiration mutuelle. Plus tard, tandis que Barbara ne chante encore que des chansons écrites par d'autres, Brel l'encourage à écrire elle-même ses propres chansons ; il sera donc le premier à qui elle fera découvrir ses premiers textes, dont ses premiers succès. Brel dira « Barbara, c'est une fille bien. Elle a un grain, mais un beau grain. On est un peu amoureux, comme ça, depuis longtemps ». En 1971, il lui offrira un premier rôle dans son film Franz. À partir de 1981, soit trois ans après la mort de Brel, La Valse de Franz, composée par Brel, sera jouée dans tous les spectacles de Barbara, En 1990, elle créera au théâtre Mogador la chanson Gauguin (Lettre à Jacques Brel). Fin 1951, elle retourne vivre chez son oncle au 131, rue Marcadet à Paris pour des auditions sans lendemain, dont une au cabaret La Fontaine des Quatre-Saisons dont la programmation est déjà faite et où on lui propose une place de plongeuse pour un an. Elle peut toutefois y rencontrer et observer, sans jamais chanter, Boris Vian avec Henri Crolla et Louis Bessières ou encore Mouloudji. Elle revient à Bruxelles où un ami du groupe de Charleroi lui donne l’occasion de chanter. Elle est mise en relation avec Ethery Rouchadze, pianiste géorgienne qui accepte de l’accompagner et auprès de qui elle se perfectionnera au piano. Cette dernière lui présente Claude Sluys, jeune avocat. Habitué des lieux de spectacles, il se pique d’écrire quelques chansons. Fin 1952, il déniche le « théâtre du Cheval blanc » et use de ses relations pour y ouvrir un cabaret afin qu’elle s’y produise sous le nom de Barbara. Elle monte pour la première fois sur scène accompagnée de son piano, vêtue d’un châle noir et maquillée de khôl. Ainsi commence à se construire le personnage de la « dame en noir ». Le bouche à oreille aidant, le succès ne se fait pas attendre. Le 31 octobre 1953, Barbara épouse Claude Sluys. Au début de l’année 1955, elle enregistre deux chansons chez Decca : « Mon pote le gitan » et « L'œillet blanc » (parfois noté « L'œillet rouge »), diffusées en 78 tours et 45 tours. En 1955, les époux se séparent. À la fin de l'année, Barbara retourne à Paris où elle chante dans de petits cabarets : La Rose rouge en 1956, Chez Moineau en 1957, puis en 1958 à L’Écluse, où elle a déjà chanté pour de courts engagements. En 1958, elle réussit à s’imposer, sous le surnom de La Chanteuse de minuit, si bien que sa notoriété grandit et lui attire un public de fidèles, en particulier parmi les étudiants du Quartier latin. C’est sous le nom de « Barbara » qu’elle effectue son premier passage à la télévision, le 12 juillet 1958, sur l’unique chaîne de la RTF, dans l’émission Cabaret du Soir, où la présentatrice la compare à Yvette Guilbert et lui assure "qu’elle deviendra certainement une grande vedette". À cette époque, poussée par son ami Brel, elle commence à écrire. Remarquée et engagée par Pathé-Marconi, elle enregistre, sous le label « La Voix de son Maître », son premier Super 45 tours, « La Chanteuse de minuit », avec deux de ses propres chansons : « J’ai troqué » et « J’ai tué l’amour », et au printemps 1959 son premier 33 tours « Barbara à L’Écluse ». En décembre 1959, apprenant que son père, qui avait fui sur les routes pour noyer son crime dans le vagabondage et la déchéance, est mourant et la réclame auprès de lui à Nantes (Loire-Atlantique), elle s'y précipite, mais arrive trop tard. À la vue de son corps, à la morgue, ses sentiments oscillent entre fascination, panique, mépris, haine, d'une part, et un immense désespoir d'autre part. Au lendemain de l’enterrement, elle commence l’écriture de la chanson « Nantes », qu’elle achève quatre ans plus tard, quelques heures avant son passage au théâtre des Capucines, le 5 novembre 1963 ; ce sera l'une de ses plus grandes chansons. En 1960, elle change de maison de disque pour signer chez Odéon. Elle enregistre « Barbara chante Brassens » puis « Barbara chante Jacques Brel » : le premier de ces albums est couronné par l’Académie Charles-Cros dans la catégorie « Meilleure interprète ». En 1961, elle décroche un tour de chant du 9 au 20 février, en première partie de Félix Marten à Bobino. Sa performance est peu appréciée, sa présentation jugée austère, à l’évidence pas encore prête pour les grandes scènes. Loin de se décourager, elle reprend ses récitals à L’Écluse. La même année, elle se rend à Abidjan, où elle retrouve son amant, le diplomate Hubert Ballay ; elle lui écrira « Dis, quand reviendras-tu ? », avant de le quitter. Deux années plus tard, les mardis de novembre et décembre 1963, au théâtre des Capucines, elle retient et capte l’attention avec un répertoire nouveau comprenant deux de ses chansons : « Nantes » et « Dis, quand reviendras-tu ? ». Le succès est tel que la maison Philips va donner un véritable élan à sa carrière en lui signant un contrat. Séduit, Georges Brassens lui propose la première partie de son prochain spectacle à Bobino. En attendant, le 4 juillet 1964, elle se rend sans enthousiasme en Allemagne de l'Ouest, en réponse à l’invitation de Hans-Gunther Klein, directeur du Junges Theater de la ville universitaire de Göttingen. Agréablement surprise et touchée par l’accueil chaleureux qu’elle reçoit, elle prolonge son séjour d’une semaine. L'avant-veille de son départ, elle offre au public la chanson « Göttingen », qu’elle a écrite d’un trait dans les jardins du théâtre. En mai 1967, elle sera à Hambourg pour l’enregistrer, avec neuf autres titres, traduits en allemand, pour le 33 tours « Barbara singt Barbara », et retournera chanter à Göttingen le 4 octobre. Dans les années 1980, les hommes politiques se saisiront de la chanson pour promouvoir l'amitié franco-allemande. En 1988, Barbara recevra la Médaille d’honneur de Göttingen et l'ordre du Mérite fédéral. En 1992, à la veille d'un référendum, François Mitterrand choisira ce titre pour terminer un entretien télévisé. En 2002, Xavier Darcos, alors ministre délégué à l’enseignement scolaire, inscrira cette chanson aux programmes officiels des classes de l'école primaire : la chanson sera reprise dans les écoles en 2003 à l'occasion de la commémoration du quarantième anniversaire du traité d'amitié franco-allemand, dit traité de l'Élysée. Comme convenu, elle chante à Bobino avec Georges Brassens en « vedette » du 21 octobre au 9 novembre 1964. Le public est conquis et les critiques sont unanimes pour saluer sa prestation. Paris-presse, L’Intransigeant écrit qu’elle "fait presque oublier Brassens", L'Humanité : "Un faux pas de Brassens, une prouesse de Barbara." Le 14 mars 1965, sort son premier album Philips, « Barbara chante Barbara ». Il obtient le prix de l’Académie Charles-Cros et un réel succès commercial. Lors de la cérémonie, au palais d’Orsay, Barbara déchire son prix en quatre pour le distribuer aux techniciens, en témoignage de sa gratitude. La même année, elle obtient un grand succès à Bobino. Le 15 septembre, jour de la première, France Inter organise une journée Barbara sur ses ondes. La chanteuse est si profondément marquée par cette première qu’elle l'immortalise peu après dans l’une de ses plus grandes chansons : Ma plus belle histoire d’amour. « Ce fut, un soir, en septembre / Vous étiez venus m’attendre / Ici même, vous en souvenez-vous ? … ». En décembre 1966, Barbara se produit à nouveau à Bobino, où elle interprète notamment « Au cœur de la nuit » (titre que jamais plus elle n'inscrira à son tour de chant). Trois ans avant « L'Aigle noir », elle y évoque "un bruissement d'ailes qui effleure son visage", évoque la mort de son père et le pardon "pour qu'enfin tu puisses dormir, pour qu'enfin ton cœur repose, que tu finisses de mourir sous tes paupières déjà closes" (voir les albums Ma plus belle histoire d'amour, Bobino 1967). En 1967, elle écrit avec Georges Moustaki, « La Dame brune », chanson d'amour qu'ils interprètent en duo. Elle dira à son sujet : "Moustaki, c'est ma tendresse". Le 6 novembre 1967, alors en tournée en Italie, elle apprend la mort de sa mère. Elle a vécu au 14, rue de Rémusat de 1961 à 1967, date à laquelle elle quitte l'immeuble à la suite du décès de sa mère, ce qui lui inspire quelques années plus tard, en 1972, la chanson Rémusat, où elle évoque ce double départ. En février 1969, Barbara est à l’Olympia. À la fin de la dernière représentation, à la stupeur générale, elle annonce qu’elle arrête le tour de chant. Mais elle respecte ses engagements passés jusqu’en 1971. Toutefois, cet arrêt ne sera pas définitif. Elle a d'ailleurs déclaré qu'elle n'avait jamais fait d'adieux, mais qu'elle avait pris ses distances. La chanteuse reviendra sur les scènes du music-hall après trois ans d'absence. Début 1970, elle est au théâtre de la Renaissance dans « Madame », une pièce musicale, écrite par Rémo Forlani, dont elle signe la musique. Le rocking-chair du décor la suivra désormais dans tous ses tours de chant. Elle interprète une "tenancière de lupanar en Afrique". « Madame » est un échec, mais Barbara remet rapidement le pied à l’étrier grâce au succès de l’album studio L'Aigle noir, dont la chanson homonyme est l’un des plus gros succès discographiques de l’année. Barbara a dit de cette chanson qu'elle l'avait rêvée, "un rêve plus beau que la chanson elle-même". À la suite de la publication de ses mémoires en 1998, une interprétation bien plus sombre de « L'Aigle noir » fut supposée. En février 1972, Barbara est avec son ami Jacques Brel à l'affiche de « Franz ». Elle joue Léonie, femme laide, incapable de vivre l’amour dont elle rêve. Ce premier film réalisé par le chanteur obtient peu de succès. Deux ans plus tard, elle joue la diva délaissée du film « L'Oiseau rare », réalisé par Jean-Claude Brialy. Le danseur et chorégraphe Maurice Béjart, qui appréciait Barbara énormément, la fait tourner dans « Je suis né à Venise ». Dans ce film, qui ne sera diffusé qu’à la télévision, Barbara tient deux rôles : celui d'une chanteuse (elle interprète trois titres : L’Amour magicien, L’Homme en habit rouge et La Mort) et celui de La Dame de la nuit. Sa carrière musicale demeure active dans les années 1970 : à la télévision, en 1972, elle interprète un duo avec Johnny Hallyday, « Toi mon ombre, toi ma lumière ». Elle tourne au Japon, au Canada, en Belgique, en Israël, aux Pays-Bas et en Suisse. Barbara réalisera ses plus grands passages de sa carrière à la télévision pendant ses années ORTF, entre 1958 et 1974. En 1973, Barbara s'installe à Précy-sur-Marne, à trente kilomètres à l'est de Paris, dans une ancienne ferme villageoise au 2, rue de Verdun. Pour ses répétitions avant chaque spectacle, elle fait transformer la grange en théâtre, lui donnant le nom de « Grange au loup ». Dans le jardin enserré par les bâtiments de la ferme, elle découvre le plaisir de jardiner. Au petit matin du 5 juin 1974, les pompiers de Meaux découvrent son corps inanimé. Dans le coma, elle est conduite en urgence à l'hôpital. Plus tard, dans plusieurs entretiens, elle relate l'événement en expliquant que, n'arrivant pas à trouver le sommeil, elle a absorbé les cachets qu'elle avait sous la main. Lors d'un concert à Avignon, elle déclare : "Je n'ai pas voulu mourir, j'ai voulu dormir". Par décision, elle interrompt ses apparitions audiovisuelles en 1974. À partir de cette période, ses textes et ses choix musicaux évoluent en profondeur, et ses concerts de 1974, 1975 et 1978 accueillent de nouveaux titres importants. La chanson de 1974, « L’homme en habit rouge », évoque le souvenir de sa liaison avec son parolier de l’album La Louve, François Wertheimer, auquel Barbara avait offert le parfum Habit rouge de Guerlain. Pour cet album de 1973, Barbara demande à William Sheller de faire les orchestrations. De cette collaboration naît une amitié entre William et la Duchesse, comme celui-ci la surnomme affectueusement. C'est elle qui pousse alors William à devenir chanteur. Entre 1975 et 1976, elle a une aventure avec le comédien Pierre Arditi, de quatorze ans son cadet. Celui-ci se souvient d'avoir été comme "un adolescent énamouré" dans une liaison qu'il décrit comme "pas très longue mais marquante". Après leur séparation, ils sont restés très bons amis. En 1978, elle fait un retour remarqué à l'Olympia. Son album Seule est l’une des meilleures ventes de 1981. Son plus grand succès sur scène est celui qu’elle présente à l'automne de la même année à l’hippodrome de Pantin. Plus que de simples concerts, ses représentations sont, selon Jérôme Garcin, de véritables messes dont les rappels ininterrompus se prolongent jusque tard dans la nuit. Elle y interprète notamment « Regarde », chanson militante qu'elle a composée et chantée pour la campagne présidentielle de François Mitterrand, pour qui elle appela à voter, à partir du 8 avril 1981. C’est lors de ce spectacle que la voix de la chanteuse, pour la première fois, et irrémédiablement, se brise. Si au départ elle s'en affole, par la suite elle ne cherchera pas à le cacher mais saura au contraire se servir de cette voix, désormais "au crépuscule", pour renforcer l’aspect dramatique et authentique de son interprétation. Se renouvelant sans cesse, la chanteuse continue d’attirer un public très jeune. L’année suivante, elle reçoit le Grand prix national de la chanson en reconnaissance de sa contribution à la culture française. Par ailleurs, elle développe une relation de travail et d’amitié avec la vedette cinématographique montante Gérard Depardieu et son épouse Élisabeth. En 1985, elle coécrit avec Luc Plamondon la musique et le texte de la pièce Lily Passion, où elle joue et chante avec Gérard Depardieu. Sorte d’autobiographie romancée, c’est l’histoire d’une chanteuse qui voue toute sa vie à son public. La première représentation a lieu au Zénith de Paris, le 21 janvier 1986. L’été venu, elle est invitée sur la scène du Metropolitan Opera de New York pour un Gala Performance, donné le 8 juillet. Elle accompagne au piano son ami le danseur étoile Mikhaïl Barychnikov qui danse sur deux de ses chansons « Pierre » et « Le Mal de vivre ». À cette période, elle s'investit dans la collecte de fonds pour le traitement du Sida. Elle rend visite aux malades dans les hôpitaux et dans les prisons. Lors de ses concerts, elle met des corbeilles de préservatifs à la disposition des personnes venues l’écouter ; engagement dont témoigne artistiquement le titre « Sid’Amour à mort ». En 1987, elle monte pour la première fois sur la scène du théâtre du Châtelet, à Paris, pour une série de récitals pendant les mois de septembre et octobre, suivis d'une tournée en France, en Suisse, en Belgique, au Japon, au Canada et en Israël qui se termine en 1988. En 1988, elle est promue chevalier de la Légion d'honneur par le Président de la République François Mitterrand. L'année suivante, elle chante au théâtre Mogador à Paris de février à avril. Suivra une tournée en France et au Japon jusqu'en 1991. En 1991, elle enregistre « Lettres à un jeune poète » de Rainer Maria Rilke pour les Éditions Claudine Ducaté. Elle dédicacera cet enregistrement dans une librairie parisienne, la même année. En novembre et décembre 1993, Barbara est à nouveau sur la scène parisienne du théâtre du Châtelet, mais des problèmes de santé la contraignent à interrompre les représentations. Après quelques jours de repos, elle retrouve son public, le temps d’enregistrer le spectacle, puis renonce à poursuivre et annule les dernières représentations. En 1994, elle obtient la Victoire de l'artiste interprète féminine de l'année aux Victoires de la musique (une récompense qu'elle obtiendra une seconde fois en 1997). Son ultime tournée débute à Dijon, le 1er février. Sa dernière apparition sur scène a lieu le soir du samedi 26 mars 1994 au Centre de Congrès Vinci de la ville de Tours. Après seize années passées loin des studios, elle enregistre douze nouvelles chansons durant l'été 1996. Pour ce disque, Jean-Louis Aubert signe le texte « Vivant poème » et Guillaume Depardieu celui de « À force de ». Sorti le 6 novembre, cet album sobrement intitulé « Barbara » est son chant du cygne. Epuisée par les stimulants, les médicaments pris en dose massive pour soigner son angoisse ou les corticoïdes pour ses cordes vocales, affaiblie par une alimentation hasardeuse, elle consacre son temps à la rédaction de ses mémoires. Le 24 novembre 1997, elle est hospitalisée pour une pneumonie que les rumeurs transforment en mystère. Elle meurt à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine à l’âge de 67 ans, victime d’une infection respiratoire foudroyante. Elle disparaît juste après la sortie de « Femme Piano », regroupant ses plus belles chansons. Elle est enterrée trois jours plus tard au cimetière de Bagneux, entourée d’une foule d’amis et de fans. Allant totalement à l’encontre des modes de son temps, tant musicales que physiques, Barbara a pourtant su se faire sa place et s’imposer sur la scène de la chanson française. Toute son œuvre fut intimement liée à sa vie personnelle. Les mémoires posthumes de Barbara, « Il était un piano noir », révélèrent une déchirure d’enfance, un lourd secret à porter. Même si cela transpire tout au long de son œuvre, l’artiste ne pourra jamais l’aborder franchement sinon par des allusions très voilées, qui permettront à ses proches de sentir cette fêlure ineffaçable.
Barbara, née Monique Andrée Serf le 9 juin 1930 près du square des Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris et décédée le 24 novembre 1997 à Neuilly-sur-Seine. Elle est le deuxième enfant d’une famille qui en compte quatre. Elle a marqué la chanson française de sa musique poétique et passionnelle. Nombre de ses chansons sont devenues des classiques, notamment : « Dis, quand reviendras-tu ? », « Nantes », « Au bois de Saint-Amand », « Göttingen », « La solitude », « Une petite cantate », « La Dame brune », « L'Aigle noir », « Marienbad », « Ma plus belle histoire d’amour », « Pierre », « Le mal de vivre », « Vienne », « Drouot » ou encore « Si la photo est bonne ». Elle a joué dans trois films pour le cinéma « Aussi loin que l’amour » en 1971, « Franz » en 1972, « L’oiseau rare » en 1973 et dans deux pièces musicales sur scène : « Madame » en 1970, et « Lily passion » avec Gérard Depardieu en 1985. Depuis 2010, le « prix Barbara » récompense chaque année une jeune chanteuse francophone. Elle est la fille de Jacques Serf, un Juif alsacien, représentant de commerce en peaux et fourrures et d’Esther Brodsky, Juive née à Tiraspol (Moldavie), fonctionnaire à la préfecture de Paris. Monique Serf passe les premières années de sa vie dans ce coin des Batignolles, avec ses parents, sa grand-mère maternelle Hava Poustilnikov, née à Zlatopil (en Ukraine), et son frère aîné Jean, né en 1928. Sa jeunesse est marquée par des déménagements successifs, notamment en 1937, à Marseille, première étape d’un itinéraire sinueux, 1938, au 26, rue Mulsant à Roanne (Loire), où naît sa sœur Régine en août de la même année, en 1939, la famille quitte Roanne pour Le Vésinet dans la banlieue ouest de la capitale, où réside Jeanne Spire, la tante de Monsieur Serf. En septembre 1939 la guerre éclate et son père rejoint le front. Jeanne Spire, Jean et Monique rejoignent Poitiers, où un médecin les héberge. En 1940, sa mère travaille à la préfecture de Blois. Les deux aînés et leur grand-tante l’y rejoignent. Un bombardement de la ville s’annonce. Les deux enfants partent en train avec Jeanne Spire. Une attaque de l’aviation allemande vise le convoi en rase campagne. Les voyageurs resteront bloqués dans le train durant plusieurs jours. L’école communale de Préaux (Indre) accueille les réfugiés du train. Jeanne Spire loue deux chambres au-dessus du café Lanchais sur la place du village. Les deux enfants et Jeanne Spire resteront plus d’un an à Préaux. Ils s’intègrent à la vie du village, Monique et Jean vont à l’école communale. Fin 1941, par l’intermédiaire de la mairie de Préaux, leur grand-tante apprend que les parents résident à Tarbes, où Monsieur Serf est démobilisé. La famille se recompose immédiatement à Tarbes (Hautes-Pyrénées), au 3 bis, rue des Carmes. La tante Jeanne reste quelques mois avec eux. Claude, le jeune frère de Monique naît en mars 1942. Monique fréquente l’école communale. Mais la famille doit quitter rapidement Tarbes : un dénonciateur a informé la police qu’une famille juive vit rue des Carmes. Une menace de rafle dont les parents ont été informés. C'est la tante Jeanne qui avait été prévenue la veille du départ. Les déménagements redoublent sous l’Occupation pour fuir la traque nazie faite aux juifs. S’y ajoutent les séparations pour déjouer les dénonciations. De 1943 à octobre 1945, la famille se cache près de Chasseneuil-sur-Bonnieure en Charente, puis à Grenoble et à Saint-Marcellin en Isère. À la Libération, les membres de la famille quittent Saint-Marcellin pour Paris, d’abord au 131, rue Marcadet, puis dans un appartement rue Notre-Dame-de-Nazareth, puis dans un autre hôtel rue de Vaugirard, où ils se retrouvent tous. Barbara subira le comportement incestueux de son père pendant son enfance. Après Blois, Préaux, la voilà donc fin 1941 à Tarbes. Qui rêve spectacles, déguise ses voisins de la cour « et la petite fille de la propriétaire qui était rudement jolie et qui intéressait diablement mon frère Jean », se souvient-elle. Mais c'est un quotidien de cauchemar que vit la petite fille juive dans « une assez grande maison, 3 bis, rue des Carmes ». Son frère est premier en tout au lycée Théophile-Gautier. Elle est « très indisciplinée », « frondeuse », « désobéissante », disent ses livrets scolaires de la communale. Son père ne manque jamais une occasion de l'humilier. Sauf quand ils sont seuls tous les deux. Elle n'écrira jamais le mot. Mais « le soir, lorsque j'entends claquer le grand portail vert et les pas de mon père résonner dans la cour, je me prends à trembler ». Et les larmes lui viennent, confie-t-elle en révélant sans le dire l'inceste. Rappelant simplement « les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire ». C’est à Tarbes, alors qu'elle a à peine onze ans et demi, que son père abuse d'elle pour la première fois. "Un soir, à Tarbes, mon univers bascule dans l'horreur", écrit-elle. Personne ne dénonce l'inceste dans sa famille. Elle tente bien de s'adresser à une gendarmerie, au soir d'une fugue en Bretagne. On l'écoute mais sa plainte n'est pas enregistrée. Son père revient la chercher et laisse entendre qu'elle affabule. En 1949, alors qu'elle n'a que dix-neuf ans, le départ définitif du foyer familial de son père marque l'interruption de leurs rapports, mais elle n'en fait le récit que très tard, dans ses mémoires interrompus par sa mort en 1997, sans toutefois se décider à dire les mots de « viol » et d'« inceste ». « Tarbes a toujours été un souvenir très dur pour Barbara », confiera à la Dépêche du Midi, Marie Chaix, la secrétaire et biographe de la chanteuse Barbara. « Je ne chanterai pas à Tarbes », disait-elle. Plus tard, elle donnera un concert, finalement, mais à Ibos, au Parvis. C’est donc à Tarbes qu’elle vécut les pires moments de sa vie qui lui inspirèrent plus tard, la chanson « L’Aigle noir ». Beaucoup de personnes se sont interrogées sur le sens réel des paroles de « L'Aigle noir ». De son vivant, Barbara se dérobait à chaque fois, prétextant que cela ne concernait qu'elle : "Ce ne sont pas les paroles qui sont importantes...", disait-elle. Selon le chanteur Patrick Bruel, qui a repris le titre en 2015, ces paroles seraient une référence à l'emblème du Troisième Reich et à la vie d'errance et de danger durant l'enfance de la chanteuse. Le journaliste Pierre Adrian commente : "Après l'interprétation psychanalytique, voici l'interprétation historique". En 1946, la famille Self s’installe au Vésinet (Yvelines) à la pension des Trois Marroniers au 31 bis, rue Ernest-André, où la future Barbara prend ses premiers cours de chant chez Madame Madeleine Thomas-Dusséqué. À son contact, elle apprend le chant, le solfège et le piano, avant d'emménager au 50, rue de Vitruve dans le 20e arrondissement de Paris. Madame Dusséqué quitte le Vésinet pour Paris. Elle donne des cours salle Pleyel. Le 30 décembre 1946, sa grand-mère maternelle Hava Poustilnikov décède à Paris à son domicile 131, rue Marcadet, à l’âge de 66 ans. Cette femme comptait beaucoup pour Monique. Peu attirée par les études, elle ambitionne depuis longtemps de devenir pianiste mais son rêve est brisé depuis 1944, un kyste à la main droite ayant obligé les médecins de Grenoble à intervenir à sept reprises et sectionner les tendons. Ses parents promettent de lui offrir des cours de chant. Elle s’inscrit à ceux de Mme Dusséqué. Sa vie en est changée. Au bout de quelques leçons, sa professeure la présente à maître Paulet, enseignant au Conservatoire de Paris, qui la prend comme élève en 1947. Dans le nouvel appartement, un piano loué par son père est installé ; Monique en joue d’instinct, sans prendre de leçons. La jeune fille entre au Conservatoire comme auditrice, mais au répertoire de chant classique, qui l'ennuie, elle préfère celui de la chanson populaire, ayant rencontré à l'ABC l'univers de Piaf. Elle arrête les cours en 1948. La même année, après avoir passé une audition au théâtre Mogador, elle est engagée comme mannequin-choriste dans l’opérette « Violettes impériales ». Un jour de 1949, son père abandonne soudainement le foyer, pour ne plus revenir. Bientôt, la même année, la location du piano ne peut plus être honorée. Contrainte de s’en séparer, elle vit un déchirement. Voulant à tout prix concrétiser son rêve, devenir "pianiste chantante", elle quitte Paris en février 1950. Grâce à l’argent prêté par une amie, elle s’exile à Bruxelles chez un cousin, Sacha Piroutsky, qu’elle quitte au bout de deux mois car il devenait violent. Sans ressources ni connaissances, la vie est difficile. Au hasard d’une rencontre, elle rejoint une communauté d’artistes à Charleroi, qui se réunissent dans un local appelé La Mansarde. Là, elle trouve de l’aide et commence à chanter dans des cabarets sous le nom de Barbara Brodi (en l'honneur d'une de ses aïeules ukrainiennes appelée Varvara, ou de sa grand-mère Hava Brodsky). Son répertoire est constitué de chansons d’Édith Piaf, Marianne Oswald, Germaine Montero, Juliette Gréco. Chaque fois, le public la siffle copieusement. En 1950, elle rencontre Jacques Brel qui, comme elle, tente de percer en se produisant dans divers cabarets. Elle ajoute à son répertoire les premières chansons de cet auteur-compositeur en herbe avec qui elle va se lier d'une très grande amitié discrète mais indéfectible, pleine de complicité et d'admiration mutuelle. Plus tard, tandis que Barbara ne chante encore que des chansons écrites par d'autres, Brel l'encourage à écrire elle-même ses propres chansons ; il sera donc le premier à qui elle fera découvrir ses premiers textes, dont ses premiers succès. Brel dira « Barbara, c'est une fille bien. Elle a un grain, mais un beau grain. On est un peu amoureux, comme ça, depuis longtemps ». En 1971, il lui offrira un premier rôle dans son film Franz. À partir de 1981, soit trois ans après la mort de Brel, La Valse de Franz, composée par Brel, sera jouée dans tous les spectacles de Barbara, En 1990, elle créera au théâtre Mogador la chanson Gauguin (Lettre à Jacques Brel). Fin 1951, elle retourne vivre chez son oncle au 131, rue Marcadet à Paris pour des auditions sans lendemain, dont une au cabaret La Fontaine des Quatre-Saisons dont la programmation est déjà faite et où on lui propose une place de plongeuse pour un an. Elle peut toutefois y rencontrer et observer, sans jamais chanter, Boris Vian avec Henri Crolla et Louis Bessières ou encore Mouloudji. Elle revient à Bruxelles où un ami du groupe de Charleroi lui donne l’occasion de chanter. Elle est mise en relation avec Ethery Rouchadze, pianiste géorgienne qui accepte de l’accompagner et auprès de qui elle se perfectionnera au piano. Cette dernière lui présente Claude Sluys, jeune avocat. Habitué des lieux de spectacles, il se pique d’écrire quelques chansons. Fin 1952, il déniche le « théâtre du Cheval blanc » et use de ses relations pour y ouvrir un cabaret afin qu’elle s’y produise sous le nom de Barbara. Elle monte pour la première fois sur scène accompagnée de son piano, vêtue d’un châle noir et maquillée de khôl. Ainsi commence à se construire le personnage de la « dame en noir ». Le bouche à oreille aidant, le succès ne se fait pas attendre. Le 31 octobre 1953, Barbara épouse Claude Sluys. Au début de l’année 1955, elle enregistre deux chansons chez Decca : « Mon pote le gitan » et « L'œillet blanc » (parfois noté « L'œillet rouge »), diffusées en 78 tours et 45 tours. En 1955, les époux se séparent. À la fin de l'année, Barbara retourne à Paris où elle chante dans de petits cabarets : La Rose rouge en 1956, Chez Moineau en 1957, puis en 1958 à L’Écluse, où elle a déjà chanté pour de courts engagements. En 1958, elle réussit à s’imposer, sous le surnom de La Chanteuse de minuit, si bien que sa notoriété grandit et lui attire un public de fidèles, en particulier parmi les étudiants du Quartier latin. C’est sous le nom de « Barbara » qu’elle effectue son premier passage à la télévision, le 12 juillet 1958, sur l’unique chaîne de la RTF, dans l’émission Cabaret du Soir, où la présentatrice la compare à Yvette Guilbert et lui assure "qu’elle deviendra certainement une grande vedette". À cette époque, poussée par son ami Brel, elle commence à écrire. Remarquée et engagée par Pathé-Marconi, elle enregistre, sous le label « La Voix de son Maître », son premier Super 45 tours, « La Chanteuse de minuit », avec deux de ses propres chansons : « J’ai troqué » et « J’ai tué l’amour », et au printemps 1959 son premier 33 tours « Barbara à L’Écluse ». En décembre 1959, apprenant que son père, qui avait fui sur les routes pour noyer son crime dans le vagabondage et la déchéance, est mourant et la réclame auprès de lui à Nantes (Loire-Atlantique), elle s'y précipite, mais arrive trop tard. À la vue de son corps, à la morgue, ses sentiments oscillent entre fascination, panique, mépris, haine, d'une part, et un immense désespoir d'autre part. Au lendemain de l’enterrement, elle commence l’écriture de la chanson « Nantes », qu’elle achève quatre ans plus tard, quelques heures avant son passage au théâtre des Capucines, le 5 novembre 1963 ; ce sera l'une de ses plus grandes chansons. En 1960, elle change de maison de disque pour signer chez Odéon. Elle enregistre « Barbara chante Brassens » puis « Barbara chante Jacques Brel » : le premier de ces albums est couronné par l’Académie Charles-Cros dans la catégorie « Meilleure interprète ». En 1961, elle décroche un tour de chant du 9 au 20 février, en première partie de Félix Marten à Bobino. Sa performance est peu appréciée, sa présentation jugée austère, à l’évidence pas encore prête pour les grandes scènes. Loin de se décourager, elle reprend ses récitals à L’Écluse. La même année, elle se rend à Abidjan, où elle retrouve son amant, le diplomate Hubert Ballay ; elle lui écrira « Dis, quand reviendras-tu ? », avant de le quitter. Deux années plus tard, les mardis de novembre et décembre 1963, au théâtre des Capucines, elle retient et capte l’attention avec un répertoire nouveau comprenant deux de ses chansons : « Nantes » et « Dis, quand reviendras-tu ? ». Le succès est tel que la maison Philips va donner un véritable élan à sa carrière en lui signant un contrat. Séduit, Georges Brassens lui propose la première partie de son prochain spectacle à Bobino. En attendant, le 4 juillet 1964, elle se rend sans enthousiasme en Allemagne de l'Ouest, en réponse à l’invitation de Hans-Gunther Klein, directeur du Junges Theater de la ville universitaire de Göttingen. Agréablement surprise et touchée par l’accueil chaleureux qu’elle reçoit, elle prolonge son séjour d’une semaine. L'avant-veille de son départ, elle offre au public la chanson « Göttingen », qu’elle a écrite d’un trait dans les jardins du théâtre. En mai 1967, elle sera à Hambourg pour l’enregistrer, avec neuf autres titres, traduits en allemand, pour le 33 tours « Barbara singt Barbara », et retournera chanter à Göttingen le 4 octobre. Dans les années 1980, les hommes politiques se saisiront de la chanson pour promouvoir l'amitié franco-allemande. En 1988, Barbara recevra la Médaille d’honneur de Göttingen et l'ordre du Mérite fédéral. En 1992, à la veille d'un référendum, François Mitterrand choisira ce titre pour terminer un entretien télévisé. En 2002, Xavier Darcos, alors ministre délégué à l’enseignement scolaire, inscrira cette chanson aux programmes officiels des classes de l'école primaire : la chanson sera reprise dans les écoles en 2003 à l'occasion de la commémoration du quarantième anniversaire du traité d'amitié franco-allemand, dit traité de l'Élysée. Comme convenu, elle chante à Bobino avec Georges Brassens en « vedette » du 21 octobre au 9 novembre 1964. Le public est conquis et les critiques sont unanimes pour saluer sa prestation. Paris-presse, L’Intransigeant écrit qu’elle "fait presque oublier Brassens", L'Humanité : "Un faux pas de Brassens, une prouesse de Barbara." Le 14 mars 1965, sort son premier album Philips, « Barbara chante Barbara ». Il obtient le prix de l’Académie Charles-Cros et un réel succès commercial. Lors de la cérémonie, au palais d’Orsay, Barbara déchire son prix en quatre pour le distribuer aux techniciens, en témoignage de sa gratitude. La même année, elle obtient un grand succès à Bobino. Le 15 septembre, jour de la première, France Inter organise une journée Barbara sur ses ondes. La chanteuse est si profondément marquée par cette première qu’elle l'immortalise peu après dans l’une de ses plus grandes chansons : Ma plus belle histoire d’amour. « Ce fut, un soir, en septembre / Vous étiez venus m’attendre / Ici même, vous en souvenez-vous ? … ». En décembre 1966, Barbara se produit à nouveau à Bobino, où elle interprète notamment « Au cœur de la nuit » (titre que jamais plus elle n'inscrira à son tour de chant). Trois ans avant « L'Aigle noir », elle y évoque "un bruissement d'ailes qui effleure son visage", évoque la mort de son père et le pardon "pour qu'enfin tu puisses dormir, pour qu'enfin ton cœur repose, que tu finisses de mourir sous tes paupières déjà closes" (voir les albums Ma plus belle histoire d'amour, Bobino 1967). En 1967, elle écrit avec Georges Moustaki, « La Dame brune », chanson d'amour qu'ils interprètent en duo. Elle dira à son sujet : "Moustaki, c'est ma tendresse". Le 6 novembre 1967, alors en tournée en Italie, elle apprend la mort de sa mère. Elle a vécu au 14, rue de Rémusat de 1961 à 1967, date à laquelle elle quitte l'immeuble à la suite du décès de sa mère, ce qui lui inspire quelques années plus tard, en 1972, la chanson Rémusat, où elle évoque ce double départ. En février 1969, Barbara est à l’Olympia. À la fin de la dernière représentation, à la stupeur générale, elle annonce qu’elle arrête le tour de chant. Mais elle respecte ses engagements passés jusqu’en 1971. Toutefois, cet arrêt ne sera pas définitif. Elle a d'ailleurs déclaré qu'elle n'avait jamais fait d'adieux, mais qu'elle avait pris ses distances. La chanteuse reviendra sur les scènes du music-hall après trois ans d'absence. Début 1970, elle est au théâtre de la Renaissance dans « Madame », une pièce musicale, écrite par Rémo Forlani, dont elle signe la musique. Le rocking-chair du décor la suivra désormais dans tous ses tours de chant. Elle interprète une "tenancière de lupanar en Afrique". « Madame » est un échec, mais Barbara remet rapidement le pied à l’étrier grâce au succès de l’album studio L'Aigle noir, dont la chanson homonyme est l’un des plus gros succès discographiques de l’année. Barbara a dit de cette chanson qu'elle l'avait rêvée, "un rêve plus beau que la chanson elle-même". À la suite de la publication de ses mémoires en 1998, une interprétation bien plus sombre de « L'Aigle noir » fut supposée. En février 1972, Barbara est avec son ami Jacques Brel à l'affiche de « Franz ». Elle joue Léonie, femme laide, incapable de vivre l’amour dont elle rêve. Ce premier film réalisé par le chanteur obtient peu de succès. Deux ans plus tard, elle joue la diva délaissée du film « L'Oiseau rare », réalisé par Jean-Claude Brialy. Le danseur et chorégraphe Maurice Béjart, qui appréciait Barbara énormément, la fait tourner dans « Je suis né à Venise ». Dans ce film, qui ne sera diffusé qu’à la télévision, Barbara tient deux rôles : celui d'une chanteuse (elle interprète trois titres : L’Amour magicien, L’Homme en habit rouge et La Mort) et celui de La Dame de la nuit. Sa carrière musicale demeure active dans les années 1970 : à la télévision, en 1972, elle interprète un duo avec Johnny Hallyday, « Toi mon ombre, toi ma lumière ». Elle tourne au Japon, au Canada, en Belgique, en Israël, aux Pays-Bas et en Suisse. Barbara réalisera ses plus grands passages de sa carrière à la télévision pendant ses années ORTF, entre 1958 et 1974. En 1973, Barbara s'installe à Précy-sur-Marne, à trente kilomètres à l'est de Paris, dans une ancienne ferme villageoise au 2, rue de Verdun. Pour ses répétitions avant chaque spectacle, elle fait transformer la grange en théâtre, lui donnant le nom de « Grange au loup ». Dans le jardin enserré par les bâtiments de la ferme, elle découvre le plaisir de jardiner. Au petit matin du 5 juin 1974, les pompiers de Meaux découvrent son corps inanimé. Dans le coma, elle est conduite en urgence à l'hôpital. Plus tard, dans plusieurs entretiens, elle relate l'événement en expliquant que, n'arrivant pas à trouver le sommeil, elle a absorbé les cachets qu'elle avait sous la main. Lors d'un concert à Avignon, elle déclare : "Je n'ai pas voulu mourir, j'ai voulu dormir". Par décision, elle interrompt ses apparitions audiovisuelles en 1974. À partir de cette période, ses textes et ses choix musicaux évoluent en profondeur, et ses concerts de 1974, 1975 et 1978 accueillent de nouveaux titres importants. La chanson de 1974, « L’homme en habit rouge », évoque le souvenir de sa liaison avec son parolier de l’album La Louve, François Wertheimer, auquel Barbara avait offert le parfum Habit rouge de Guerlain. Pour cet album de 1973, Barbara demande à William Sheller de faire les orchestrations. De cette collaboration naît une amitié entre William et la Duchesse, comme celui-ci la surnomme affectueusement. C'est elle qui pousse alors William à devenir chanteur. Entre 1975 et 1976, elle a une aventure avec le comédien Pierre Arditi, de quatorze ans son cadet. Celui-ci se souvient d'avoir été comme "un adolescent énamouré" dans une liaison qu'il décrit comme "pas très longue mais marquante". Après leur séparation, ils sont restés très bons amis. En 1978, elle fait un retour remarqué à l'Olympia. Son album Seule est l’une des meilleures ventes de 1981. Son plus grand succès sur scène est celui qu’elle présente à l'automne de la même année à l’hippodrome de Pantin. Plus que de simples concerts, ses représentations sont, selon Jérôme Garcin, de véritables messes dont les rappels ininterrompus se prolongent jusque tard dans la nuit. Elle y interprète notamment « Regarde », chanson militante qu'elle a composée et chantée pour la campagne présidentielle de François Mitterrand, pour qui elle appela à voter, à partir du 8 avril 1981. C’est lors de ce spectacle que la voix de la chanteuse, pour la première fois, et irrémédiablement, se brise. Si au départ elle s'en affole, par la suite elle ne cherchera pas à le cacher mais saura au contraire se servir de cette voix, désormais "au crépuscule", pour renforcer l’aspect dramatique et authentique de son interprétation. Se renouvelant sans cesse, la chanteuse continue d’attirer un public très jeune. L’année suivante, elle reçoit le Grand prix national de la chanson en reconnaissance de sa contribution à la culture française. Par ailleurs, elle développe une relation de travail et d’amitié avec la vedette cinématographique montante Gérard Depardieu et son épouse Élisabeth. En 1985, elle coécrit avec Luc Plamondon la musique et le texte de la pièce Lily Passion, où elle joue et chante avec Gérard Depardieu. Sorte d’autobiographie romancée, c’est l’histoire d’une chanteuse qui voue toute sa vie à son public. La première représentation a lieu au Zénith de Paris, le 21 janvier 1986. L’été venu, elle est invitée sur la scène du Metropolitan Opera de New York pour un Gala Performance, donné le 8 juillet. Elle accompagne au piano son ami le danseur étoile Mikhaïl Barychnikov qui danse sur deux de ses chansons « Pierre » et « Le Mal de vivre ». À cette période, elle s'investit dans la collecte de fonds pour le traitement du Sida. Elle rend visite aux malades dans les hôpitaux et dans les prisons. Lors de ses concerts, elle met des corbeilles de préservatifs à la disposition des personnes venues l’écouter ; engagement dont témoigne artistiquement le titre « Sid’Amour à mort ». En 1987, elle monte pour la première fois sur la scène du théâtre du Châtelet, à Paris, pour une série de récitals pendant les mois de septembre et octobre, suivis d'une tournée en France, en Suisse, en Belgique, au Japon, au Canada et en Israël qui se termine en 1988. En 1988, elle est promue chevalier de la Légion d'honneur par le Président de la République François Mitterrand. L'année suivante, elle chante au théâtre Mogador à Paris de février à avril. Suivra une tournée en France et au Japon jusqu'en 1991. En 1991, elle enregistre « Lettres à un jeune poète » de Rainer Maria Rilke pour les Éditions Claudine Ducaté. Elle dédicacera cet enregistrement dans une librairie parisienne, la même année. En novembre et décembre 1993, Barbara est à nouveau sur la scène parisienne du théâtre du Châtelet, mais des problèmes de santé la contraignent à interrompre les représentations. Après quelques jours de repos, elle retrouve son public, le temps d’enregistrer le spectacle, puis renonce à poursuivre et annule les dernières représentations. En 1994, elle obtient la Victoire de l'artiste interprète féminine de l'année aux Victoires de la musique (une récompense qu'elle obtiendra une seconde fois en 1997). Son ultime tournée débute à Dijon, le 1er février. Sa dernière apparition sur scène a lieu le soir du samedi 26 mars 1994 au Centre de Congrès Vinci de la ville de Tours. Après seize années passées loin des studios, elle enregistre douze nouvelles chansons durant l'été 1996. Pour ce disque, Jean-Louis Aubert signe le texte « Vivant poème » et Guillaume Depardieu celui de « À force de ». Sorti le 6 novembre, cet album sobrement intitulé « Barbara » est son chant du cygne. Epuisée par les stimulants, les médicaments pris en dose massive pour soigner son angoisse ou les corticoïdes pour ses cordes vocales, affaiblie par une alimentation hasardeuse, elle consacre son temps à la rédaction de ses mémoires. Le 24 novembre 1997, elle est hospitalisée pour une pneumonie que les rumeurs transforment en mystère. Elle meurt à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine à l’âge de 67 ans, victime d’une infection respiratoire foudroyante. Elle disparaît juste après la sortie de « Femme Piano », regroupant ses plus belles chansons. Elle est enterrée trois jours plus tard au cimetière de Bagneux, entourée d’une foule d’amis et de fans. Allant totalement à l’encontre des modes de son temps, tant musicales que physiques, Barbara a pourtant su se faire sa place et s’imposer sur la scène de la chanson française. Toute son œuvre fut intimement liée à sa vie personnelle. Les mémoires posthumes de Barbara, « Il était un piano noir », révélèrent une déchirure d’enfance, un lourd secret à porter. Même si cela transpire tout au long de son œuvre, l’artiste ne pourra jamais l’aborder franchement sinon par des allusions très voilées, qui permettront à ses proches de sentir cette fêlure ineffaçable.
 Barbara, née Monique Andrée Serf le 9 juin 1930 près du square des Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris et décédée le 24 novembre 1997 à Neuilly-sur-Seine. Elle est le deuxième enfant d’une famille qui en compte quatre. Elle a marqué la chanson française de sa musique poétique et passionnelle. Nombre de ses chansons sont devenues des classiques, notamment : « Dis, quand reviendras-tu ? », « Nantes », « Au bois de Saint-Amand », « Göttingen », « La solitude », « Une petite cantate », « La Dame brune », « L'Aigle noir », « Marienbad », « Ma plus belle histoire d’amour », « Pierre », « Le mal de vivre », « Vienne », « Drouot » ou encore « Si la photo est bonne ». Elle a joué dans trois films pour le cinéma « Aussi loin que l’amour » en 1971, « Franz » en 1972, « L’oiseau rare » en 1973 et dans deux pièces musicales sur scène : « Madame » en 1970, et « Lily passion » avec Gérard Depardieu en 1985. Depuis 2010, le « prix Barbara » récompense chaque année une jeune chanteuse francophone. Elle est la fille de Jacques Serf, un Juif alsacien, représentant de commerce en peaux et fourrures et d’Esther Brodsky, Juive née à Tiraspol (Moldavie), fonctionnaire à la préfecture de Paris. Monique Serf passe les premières années de sa vie dans ce coin des Batignolles, avec ses parents, sa grand-mère maternelle Hava Poustilnikov, née à Zlatopil (en Ukraine), et son frère aîné Jean, né en 1928. Sa jeunesse est marquée par des déménagements successifs, notamment en 1937, à Marseille, première étape d’un itinéraire sinueux, 1938, au 26, rue Mulsant à Roanne (Loire), où naît sa sœur Régine en août de la même année, en 1939, la famille quitte Roanne pour Le Vésinet dans la banlieue ouest de la capitale, où réside Jeanne Spire, la tante de Monsieur Serf. En septembre 1939 la guerre éclate et son père rejoint le front. Jeanne Spire, Jean et Monique rejoignent Poitiers, où un médecin les héberge. En 1940, sa mère travaille à la préfecture de Blois. Les deux aînés et leur grand-tante l’y rejoignent. Un bombardement de la ville s’annonce. Les deux enfants partent en train avec Jeanne Spire. Une attaque de l’aviation allemande vise le convoi en rase campagne. Les voyageurs resteront bloqués dans le train durant plusieurs jours. L’école communale de Préaux (Indre) accueille les réfugiés du train. Jeanne Spire loue deux chambres au-dessus du café Lanchais sur la place du village. Les deux enfants et Jeanne Spire resteront plus d’un an à Préaux. Ils s’intègrent à la vie du village, Monique et Jean vont à l’école communale. Fin 1941, par l’intermédiaire de la mairie de Préaux, leur grand-tante apprend que les parents résident à Tarbes, où Monsieur Serf est démobilisé. La famille se recompose immédiatement à Tarbes (Hautes-Pyrénées), au 3 bis, rue des Carmes. La tante Jeanne reste quelques mois avec eux. Claude, le jeune frère de Monique naît en mars 1942. Monique fréquente l’école communale. Mais la famille doit quitter rapidement Tarbes : un dénonciateur a informé la police qu’une famille juive vit rue des Carmes. Une menace de rafle dont les parents ont été informés. C'est la tante Jeanne qui avait été prévenue la veille du départ. Les déménagements redoublent sous l’Occupation pour fuir la traque nazie faite aux juifs. S’y ajoutent les séparations pour déjouer les dénonciations. De 1943 à octobre 1945, la famille se cache près de Chasseneuil-sur-Bonnieure en Charente, puis à Grenoble et à Saint-Marcellin en Isère. À la Libération, les membres de la famille quittent Saint-Marcellin pour Paris, d’abord au 131, rue Marcadet, puis dans un appartement rue Notre-Dame-de-Nazareth, puis dans un autre hôtel rue de Vaugirard, où ils se retrouvent tous. Barbara subira le comportement incestueux de son père pendant son enfance. Après Blois, Préaux, la voilà donc fin 1941 à Tarbes. Qui rêve spectacles, déguise ses voisins de la cour « et la petite fille de la propriétaire qui était rudement jolie et qui intéressait diablement mon frère Jean », se souvient-elle. Mais c'est un quotidien de cauchemar que vit la petite fille juive dans « une assez grande maison, 3 bis, rue des Carmes ». Son frère est premier en tout au lycée Théophile-Gautier. Elle est « très indisciplinée », « frondeuse », « désobéissante », disent ses livrets scolaires de la communale. Son père ne manque jamais une occasion de l'humilier. Sauf quand ils sont seuls tous les deux. Elle n'écrira jamais le mot. Mais « le soir, lorsque j'entends claquer le grand portail vert et les pas de mon père résonner dans la cour, je me prends à trembler ». Et les larmes lui viennent, confie-t-elle en révélant sans le dire l'inceste. Rappelant simplement « les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire ». C’est à Tarbes, alors qu'elle a à peine onze ans et demi, que son père abuse d'elle pour la première fois. "Un soir, à Tarbes, mon univers bascule dans l'horreur", écrit-elle. Personne ne dénonce l'inceste dans sa famille. Elle tente bien de s'adresser à une gendarmerie, au soir d'une fugue en Bretagne. On l'écoute mais sa plainte n'est pas enregistrée. Son père revient la chercher et laisse entendre qu'elle affabule. En 1949, alors qu'elle n'a que dix-neuf ans, le départ définitif du foyer familial de son père marque l'interruption de leurs rapports, mais elle n'en fait le récit que très tard, dans ses mémoires interrompus par sa mort en 1997, sans toutefois se décider à dire les mots de « viol » et d'« inceste ». « Tarbes a toujours été un souvenir très dur pour Barbara », confiera à la Dépêche du Midi, Marie Chaix, la secrétaire et biographe de la chanteuse Barbara. « Je ne chanterai pas à Tarbes », disait-elle. Plus tard, elle donnera un concert, finalement, mais à Ibos, au Parvis. C’est donc à Tarbes qu’elle vécut les pires moments de sa vie qui lui inspirèrent plus tard, la chanson « L’Aigle noir ». Beaucoup de personnes se sont interrogées sur le sens réel des paroles de « L'Aigle noir ». De son vivant, Barbara se dérobait à chaque fois, prétextant que cela ne concernait qu'elle : "Ce ne sont pas les paroles qui sont importantes...", disait-elle. Selon le chanteur Patrick Bruel, qui a repris le titre en 2015, ces paroles seraient une référence à l'emblème du Troisième Reich et à la vie d'errance et de danger durant l'enfance de la chanteuse. Le journaliste Pierre Adrian commente : "Après l'interprétation psychanalytique, voici l'interprétation historique". En 1946, la famille Self s’installe au Vésinet (Yvelines) à la pension des Trois Marroniers au 31 bis, rue Ernest-André, où la future Barbara prend ses premiers cours de chant chez Madame Madeleine Thomas-Dusséqué. À son contact, elle apprend le chant, le solfège et le piano, avant d'emménager au 50, rue de Vitruve dans le 20e arrondissement de Paris. Madame Dusséqué quitte le Vésinet pour Paris. Elle donne des cours salle Pleyel. Le 30 décembre 1946, sa grand-mère maternelle Hava Poustilnikov décède à Paris à son domicile 131, rue Marcadet, à l’âge de 66 ans. Cette femme comptait beaucoup pour Monique. Peu attirée par les études, elle ambitionne depuis longtemps de devenir pianiste mais son rêve est brisé depuis 1944, un kyste à la main droite ayant obligé les médecins de Grenoble à intervenir à sept reprises et sectionner les tendons. Ses parents promettent de lui offrir des cours de chant. Elle s’inscrit à ceux de Mme Dusséqué. Sa vie en est changée. Au bout de quelques leçons, sa professeure la présente à maître Paulet, enseignant au Conservatoire de Paris, qui la prend comme élève en 1947. Dans le nouvel appartement, un piano loué par son père est installé ; Monique en joue d’instinct, sans prendre de leçons. La jeune fille entre au Conservatoire comme auditrice, mais au répertoire de chant classique, qui l'ennuie, elle préfère celui de la chanson populaire, ayant rencontré à l'ABC l'univers de Piaf. Elle arrête les cours en 1948. La même année, après avoir passé une audition au théâtre Mogador, elle est engagée comme mannequin-choriste dans l’opérette « Violettes impériales ». Un jour de 1949, son père abandonne soudainement le foyer, pour ne plus revenir. Bientôt, la même année, la location du piano ne peut plus être honorée. Contrainte de s’en séparer, elle vit un déchirement. Voulant à tout prix concrétiser son rêve, devenir "pianiste chantante", elle quitte Paris en février 1950. Grâce à l’argent prêté par une amie, elle s’exile à Bruxelles chez un cousin, Sacha Piroutsky, qu’elle quitte au bout de deux mois car il devenait violent. Sans ressources ni connaissances, la vie est difficile. Au hasard d’une rencontre, elle rejoint une communauté d’artistes à Charleroi, qui se réunissent dans un local appelé La Mansarde. Là, elle trouve de l’aide et commence à chanter dans des cabarets sous le nom de Barbara Brodi (en l'honneur d'une de ses aïeules ukrainiennes appelée Varvara, ou de sa grand-mère Hava Brodsky). Son répertoire est constitué de chansons d’Édith Piaf, Marianne Oswald, Germaine Montero, Juliette Gréco. Chaque fois, le public la siffle copieusement. En 1950, elle rencontre Jacques Brel qui, comme elle, tente de percer en se produisant dans divers cabarets. Elle ajoute à son répertoire les premières chansons de cet auteur-compositeur en herbe avec qui elle va se lier d'une très grande amitié discrète mais indéfectible, pleine de complicité et d'admiration mutuelle. Plus tard, tandis que Barbara ne chante encore que des chansons écrites par d'autres, Brel l'encourage à écrire elle-même ses propres chansons ; il sera donc le premier à qui elle fera découvrir ses premiers textes, dont ses premiers succès. Brel dira « Barbara, c'est une fille bien. Elle a un grain, mais un beau grain. On est un peu amoureux, comme ça, depuis longtemps ». En 1971, il lui offrira un premier rôle dans son film Franz. À partir de 1981, soit trois ans après la mort de Brel, La Valse de Franz, composée par Brel, sera jouée dans tous les spectacles de Barbara, En 1990, elle créera au théâtre Mogador la chanson Gauguin (Lettre à Jacques Brel). Fin 1951, elle retourne vivre chez son oncle au 131, rue Marcadet à Paris pour des auditions sans lendemain, dont une au cabaret La Fontaine des Quatre-Saisons dont la programmation est déjà faite et où on lui propose une place de plongeuse pour un an. Elle peut toutefois y rencontrer et observer, sans jamais chanter, Boris Vian avec Henri Crolla et Louis Bessières ou encore Mouloudji. Elle revient à Bruxelles où un ami du groupe de Charleroi lui donne l’occasion de chanter. Elle est mise en relation avec Ethery Rouchadze, pianiste géorgienne qui accepte de l’accompagner et auprès de qui elle se perfectionnera au piano. Cette dernière lui présente Claude Sluys, jeune avocat. Habitué des lieux de spectacles, il se pique d’écrire quelques chansons. Fin 1952, il déniche le « théâtre du Cheval blanc » et use de ses relations pour y ouvrir un cabaret afin qu’elle s’y produise sous le nom de Barbara. Elle monte pour la première fois sur scène accompagnée de son piano, vêtue d’un châle noir et maquillée de khôl. Ainsi commence à se construire le personnage de la « dame en noir ». Le bouche à oreille aidant, le succès ne se fait pas attendre. Le 31 octobre 1953, Barbara épouse Claude Sluys. Au début de l’année 1955, elle enregistre deux chansons chez Decca : « Mon pote le gitan » et « L'œillet blanc » (parfois noté « L'œillet rouge »), diffusées en 78 tours et 45 tours. En 1955, les époux se séparent. À la fin de l'année, Barbara retourne à Paris où elle chante dans de petits cabarets : La Rose rouge en 1956, Chez Moineau en 1957, puis en 1958 à L’Écluse, où elle a déjà chanté pour de courts engagements. En 1958, elle réussit à s’imposer, sous le surnom de La Chanteuse de minuit, si bien que sa notoriété grandit et lui attire un public de fidèles, en particulier parmi les étudiants du Quartier latin. C’est sous le nom de « Barbara » qu’elle effectue son premier passage à la télévision, le 12 juillet 1958, sur l’unique chaîne de la RTF, dans l’émission Cabaret du Soir, où la présentatrice la compare à Yvette Guilbert et lui assure "qu’elle deviendra certainement une grande vedette". À cette époque, poussée par son ami Brel, elle commence à écrire. Remarquée et engagée par Pathé-Marconi, elle enregistre, sous le label « La Voix de son Maître », son premier Super 45 tours, « La Chanteuse de minuit », avec deux de ses propres chansons : « J’ai troqué » et « J’ai tué l’amour », et au printemps 1959 son premier 33 tours « Barbara à L’Écluse ». En décembre 1959, apprenant que son père, qui avait fui sur les routes pour noyer son crime dans le vagabondage et la déchéance, est mourant et la réclame auprès de lui à Nantes (Loire-Atlantique), elle s'y précipite, mais arrive trop tard. À la vue de son corps, à la morgue, ses sentiments oscillent entre fascination, panique, mépris, haine, d'une part, et un immense désespoir d'autre part. Au lendemain de l’enterrement, elle commence l’écriture de la chanson « Nantes », qu’elle achève quatre ans plus tard, quelques heures avant son passage au théâtre des Capucines, le 5 novembre 1963 ; ce sera l'une de ses plus grandes chansons. En 1960, elle change de maison de disque pour signer chez Odéon. Elle enregistre « Barbara chante Brassens » puis « Barbara chante Jacques Brel » : le premier de ces albums est couronné par l’Académie Charles-Cros dans la catégorie « Meilleure interprète ». En 1961, elle décroche un tour de chant du 9 au 20 février, en première partie de Félix Marten à Bobino. Sa performance est peu appréciée, sa présentation jugée austère, à l’évidence pas encore prête pour les grandes scènes. Loin de se décourager, elle reprend ses récitals à L’Écluse. La même année, elle se rend à Abidjan, où elle retrouve son amant, le diplomate Hubert Ballay ; elle lui écrira « Dis, quand reviendras-tu ? », avant de le quitter. Deux années plus tard, les mardis de novembre et décembre 1963, au théâtre des Capucines, elle retient et capte l’attention avec un répertoire nouveau comprenant deux de ses chansons : « Nantes » et « Dis, quand reviendras-tu ? ». Le succès est tel que la maison Philips va donner un véritable élan à sa carrière en lui signant un contrat. Séduit, Georges Brassens lui propose la première partie de son prochain spectacle à Bobino. En attendant, le 4 juillet 1964, elle se rend sans enthousiasme en Allemagne de l'Ouest, en réponse à l’invitation de Hans-Gunther Klein, directeur du Junges Theater de la ville universitaire de Göttingen. Agréablement surprise et touchée par l’accueil chaleureux qu’elle reçoit, elle prolonge son séjour d’une semaine. L'avant-veille de son départ, elle offre au public la chanson « Göttingen », qu’elle a écrite d’un trait dans les jardins du théâtre. En mai 1967, elle sera à Hambourg pour l’enregistrer, avec neuf autres titres, traduits en allemand, pour le 33 tours « Barbara singt Barbara », et retournera chanter à Göttingen le 4 octobre. Dans les années 1980, les hommes politiques se saisiront de la chanson pour promouvoir l'amitié franco-allemande. En 1988, Barbara recevra la Médaille d’honneur de Göttingen et l'ordre du Mérite fédéral. En 1992, à la veille d'un référendum, François Mitterrand choisira ce titre pour terminer un entretien télévisé. En 2002, Xavier Darcos, alors ministre délégué à l’enseignement scolaire, inscrira cette chanson aux programmes officiels des classes de l'école primaire : la chanson sera reprise dans les écoles en 2003 à l'occasion de la commémoration du quarantième anniversaire du traité d'amitié franco-allemand, dit traité de l'Élysée. Comme convenu, elle chante à Bobino avec Georges Brassens en « vedette » du 21 octobre au 9 novembre 1964. Le public est conquis et les critiques sont unanimes pour saluer sa prestation. Paris-presse, L’Intransigeant écrit qu’elle "fait presque oublier Brassens", L'Humanité : "Un faux pas de Brassens, une prouesse de Barbara." Le 14 mars 1965, sort son premier album Philips, « Barbara chante Barbara ». Il obtient le prix de l’Académie Charles-Cros et un réel succès commercial. Lors de la cérémonie, au palais d’Orsay, Barbara déchire son prix en quatre pour le distribuer aux techniciens, en témoignage de sa gratitude. La même année, elle obtient un grand succès à Bobino. Le 15 septembre, jour de la première, France Inter organise une journée Barbara sur ses ondes. La chanteuse est si profondément marquée par cette première qu’elle l'immortalise peu après dans l’une de ses plus grandes chansons : Ma plus belle histoire d’amour. « Ce fut, un soir, en septembre / Vous étiez venus m’attendre / Ici même, vous en souvenez-vous ? … ». En décembre 1966, Barbara se produit à nouveau à Bobino, où elle interprète notamment « Au cœur de la nuit » (titre que jamais plus elle n'inscrira à son tour de chant). Trois ans avant « L'Aigle noir », elle y évoque "un bruissement d'ailes qui effleure son visage", évoque la mort de son père et le pardon "pour qu'enfin tu puisses dormir, pour qu'enfin ton cœur repose, que tu finisses de mourir sous tes paupières déjà closes" (voir les albums Ma plus belle histoire d'amour, Bobino 1967). En 1967, elle écrit avec Georges Moustaki, « La Dame brune », chanson d'amour qu'ils interprètent en duo. Elle dira à son sujet : "Moustaki, c'est ma tendresse". Le 6 novembre 1967, alors en tournée en Italie, elle apprend la mort de sa mère. Elle a vécu au 14, rue de Rémusat de 1961 à 1967, date à laquelle elle quitte l'immeuble à la suite du décès de sa mère, ce qui lui inspire quelques années plus tard, en 1972, la chanson Rémusat, où elle évoque ce double départ. En février 1969, Barbara est à l’Olympia. À la fin de la dernière représentation, à la stupeur générale, elle annonce qu’elle arrête le tour de chant. Mais elle respecte ses engagements passés jusqu’en 1971. Toutefois, cet arrêt ne sera pas définitif. Elle a d'ailleurs déclaré qu'elle n'avait jamais fait d'adieux, mais qu'elle avait pris ses distances. La chanteuse reviendra sur les scènes du music-hall après trois ans d'absence. Début 1970, elle est au théâtre de la Renaissance dans « Madame », une pièce musicale, écrite par Rémo Forlani, dont elle signe la musique. Le rocking-chair du décor la suivra désormais dans tous ses tours de chant. Elle interprète une "tenancière de lupanar en Afrique". « Madame » est un échec, mais Barbara remet rapidement le pied à l’étrier grâce au succès de l’album studio L'Aigle noir, dont la chanson homonyme est l’un des plus gros succès discographiques de l’année. Barbara a dit de cette chanson qu'elle l'avait rêvée, "un rêve plus beau que la chanson elle-même". À la suite de la publication de ses mémoires en 1998, une interprétation bien plus sombre de « L'Aigle noir » fut supposée. En février 1972, Barbara est avec son ami Jacques Brel à l'affiche de « Franz ». Elle joue Léonie, femme laide, incapable de vivre l’amour dont elle rêve. Ce premier film réalisé par le chanteur obtient peu de succès. Deux ans plus tard, elle joue la diva délaissée du film « L'Oiseau rare », réalisé par Jean-Claude Brialy. Le danseur et chorégraphe Maurice Béjart, qui appréciait Barbara énormément, la fait tourner dans « Je suis né à Venise ». Dans ce film, qui ne sera diffusé qu’à la télévision, Barbara tient deux rôles : celui d'une chanteuse (elle interprète trois titres : L’Amour magicien, L’Homme en habit rouge et La Mort) et celui de La Dame de la nuit. Sa carrière musicale demeure active dans les années 1970 : à la télévision, en 1972, elle interprète un duo avec Johnny Hallyday, « Toi mon ombre, toi ma lumière ». Elle tourne au Japon, au Canada, en Belgique, en Israël, aux Pays-Bas et en Suisse. Barbara réalisera ses plus grands passages de sa carrière à la télévision pendant ses années ORTF, entre 1958 et 1974. En 1973, Barbara s'installe à Précy-sur-Marne, à trente kilomètres à l'est de Paris, dans une ancienne ferme villageoise au 2, rue de Verdun. Pour ses répétitions avant chaque spectacle, elle fait transformer la grange en théâtre, lui donnant le nom de « Grange au loup ». Dans le jardin enserré par les bâtiments de la ferme, elle découvre le plaisir de jardiner. Au petit matin du 5 juin 1974, les pompiers de Meaux découvrent son corps inanimé. Dans le coma, elle est conduite en urgence à l'hôpital. Plus tard, dans plusieurs entretiens, elle relate l'événement en expliquant que, n'arrivant pas à trouver le sommeil, elle a absorbé les cachets qu'elle avait sous la main. Lors d'un concert à Avignon, elle déclare : "Je n'ai pas voulu mourir, j'ai voulu dormir". Par décision, elle interrompt ses apparitions audiovisuelles en 1974. À partir de cette période, ses textes et ses choix musicaux évoluent en profondeur, et ses concerts de 1974, 1975 et 1978 accueillent de nouveaux titres importants. La chanson de 1974, « L’homme en habit rouge », évoque le souvenir de sa liaison avec son parolier de l’album La Louve, François Wertheimer, auquel Barbara avait offert le parfum Habit rouge de Guerlain. Pour cet album de 1973, Barbara demande à William Sheller de faire les orchestrations. De cette collaboration naît une amitié entre William et la Duchesse, comme celui-ci la surnomme affectueusement. C'est elle qui pousse alors William à devenir chanteur. Entre 1975 et 1976, elle a une aventure avec le comédien Pierre Arditi, de quatorze ans son cadet. Celui-ci se souvient d'avoir été comme "un adolescent énamouré" dans une liaison qu'il décrit comme "pas très longue mais marquante". Après leur séparation, ils sont restés très bons amis. En 1978, elle fait un retour remarqué à l'Olympia. Son album Seule est l’une des meilleures ventes de 1981. Son plus grand succès sur scène est celui qu’elle présente à l'automne de la même année à l’hippodrome de Pantin. Plus que de simples concerts, ses représentations sont, selon Jérôme Garcin, de véritables messes dont les rappels ininterrompus se prolongent jusque tard dans la nuit. Elle y interprète notamment « Regarde », chanson militante qu'elle a composée et chantée pour la campagne présidentielle de François Mitterrand, pour qui elle appela à voter, à partir du 8 avril 1981. C’est lors de ce spectacle que la voix de la chanteuse, pour la première fois, et irrémédiablement, se brise. Si au départ elle s'en affole, par la suite elle ne cherchera pas à le cacher mais saura au contraire se servir de cette voix, désormais "au crépuscule", pour renforcer l’aspect dramatique et authentique de son interprétation. Se renouvelant sans cesse, la chanteuse continue d’attirer un public très jeune. L’année suivante, elle reçoit le Grand prix national de la chanson en reconnaissance de sa contribution à la culture française. Par ailleurs, elle développe une relation de travail et d’amitié avec la vedette cinématographique montante Gérard Depardieu et son épouse Élisabeth. En 1985, elle coécrit avec Luc Plamondon la musique et le texte de la pièce Lily Passion, où elle joue et chante avec Gérard Depardieu. Sorte d’autobiographie romancée, c’est l’histoire d’une chanteuse qui voue toute sa vie à son public. La première représentation a lieu au Zénith de Paris, le 21 janvier 1986. L’été venu, elle est invitée sur la scène du Metropolitan Opera de New York pour un Gala Performance, donné le 8 juillet. Elle accompagne au piano son ami le danseur étoile Mikhaïl Barychnikov qui danse sur deux de ses chansons « Pierre » et « Le Mal de vivre ». À cette période, elle s'investit dans la collecte de fonds pour le traitement du Sida. Elle rend visite aux malades dans les hôpitaux et dans les prisons. Lors de ses concerts, elle met des corbeilles de préservatifs à la disposition des personnes venues l’écouter ; engagement dont témoigne artistiquement le titre « Sid’Amour à mort ». En 1987, elle monte pour la première fois sur la scène du théâtre du Châtelet, à Paris, pour une série de récitals pendant les mois de septembre et octobre, suivis d'une tournée en France, en Suisse, en Belgique, au Japon, au Canada et en Israël qui se termine en 1988. En 1988, elle est promue chevalier de la Légion d'honneur par le Président de la République François Mitterrand. L'année suivante, elle chante au théâtre Mogador à Paris de février à avril. Suivra une tournée en France et au Japon jusqu'en 1991. En 1991, elle enregistre « Lettres à un jeune poète » de Rainer Maria Rilke pour les Éditions Claudine Ducaté. Elle dédicacera cet enregistrement dans une librairie parisienne, la même année. En novembre et décembre 1993, Barbara est à nouveau sur la scène parisienne du théâtre du Châtelet, mais des problèmes de santé la contraignent à interrompre les représentations. Après quelques jours de repos, elle retrouve son public, le temps d’enregistrer le spectacle, puis renonce à poursuivre et annule les dernières représentations. En 1994, elle obtient la Victoire de l'artiste interprète féminine de l'année aux Victoires de la musique (une récompense qu'elle obtiendra une seconde fois en 1997). Son ultime tournée débute à Dijon, le 1er février. Sa dernière apparition sur scène a lieu le soir du samedi 26 mars 1994 au Centre de Congrès Vinci de la ville de Tours. Après seize années passées loin des studios, elle enregistre douze nouvelles chansons durant l'été 1996. Pour ce disque, Jean-Louis Aubert signe le texte « Vivant poème » et Guillaume Depardieu celui de « À force de ». Sorti le 6 novembre, cet album sobrement intitulé « Barbara » est son chant du cygne. Epuisée par les stimulants, les médicaments pris en dose massive pour soigner son angoisse ou les corticoïdes pour ses cordes vocales, affaiblie par une alimentation hasardeuse, elle consacre son temps à la rédaction de ses mémoires. Le 24 novembre 1997, elle est hospitalisée pour une pneumonie que les rumeurs transforment en mystère. Elle meurt à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine à l’âge de 67 ans, victime d’une infection respiratoire foudroyante. Elle disparaît juste après la sortie de « Femme Piano », regroupant ses plus belles chansons. Elle est enterrée trois jours plus tard au cimetière de Bagneux, entourée d’une foule d’amis et de fans. Allant totalement à l’encontre des modes de son temps, tant musicales que physiques, Barbara a pourtant su se faire sa place et s’imposer sur la scène de la chanson française. Toute son œuvre fut intimement liée à sa vie personnelle. Les mémoires posthumes de Barbara, « Il était un piano noir », révélèrent une déchirure d’enfance, un lourd secret à porter. Même si cela transpire tout au long de son œuvre, l’artiste ne pourra jamais l’aborder franchement sinon par des allusions très voilées, qui permettront à ses proches de sentir cette fêlure ineffaçable.
Barbara, née Monique Andrée Serf le 9 juin 1930 près du square des Batignolles dans le 17e arrondissement de Paris et décédée le 24 novembre 1997 à Neuilly-sur-Seine. Elle est le deuxième enfant d’une famille qui en compte quatre. Elle a marqué la chanson française de sa musique poétique et passionnelle. Nombre de ses chansons sont devenues des classiques, notamment : « Dis, quand reviendras-tu ? », « Nantes », « Au bois de Saint-Amand », « Göttingen », « La solitude », « Une petite cantate », « La Dame brune », « L'Aigle noir », « Marienbad », « Ma plus belle histoire d’amour », « Pierre », « Le mal de vivre », « Vienne », « Drouot » ou encore « Si la photo est bonne ». Elle a joué dans trois films pour le cinéma « Aussi loin que l’amour » en 1971, « Franz » en 1972, « L’oiseau rare » en 1973 et dans deux pièces musicales sur scène : « Madame » en 1970, et « Lily passion » avec Gérard Depardieu en 1985. Depuis 2010, le « prix Barbara » récompense chaque année une jeune chanteuse francophone. Elle est la fille de Jacques Serf, un Juif alsacien, représentant de commerce en peaux et fourrures et d’Esther Brodsky, Juive née à Tiraspol (Moldavie), fonctionnaire à la préfecture de Paris. Monique Serf passe les premières années de sa vie dans ce coin des Batignolles, avec ses parents, sa grand-mère maternelle Hava Poustilnikov, née à Zlatopil (en Ukraine), et son frère aîné Jean, né en 1928. Sa jeunesse est marquée par des déménagements successifs, notamment en 1937, à Marseille, première étape d’un itinéraire sinueux, 1938, au 26, rue Mulsant à Roanne (Loire), où naît sa sœur Régine en août de la même année, en 1939, la famille quitte Roanne pour Le Vésinet dans la banlieue ouest de la capitale, où réside Jeanne Spire, la tante de Monsieur Serf. En septembre 1939 la guerre éclate et son père rejoint le front. Jeanne Spire, Jean et Monique rejoignent Poitiers, où un médecin les héberge. En 1940, sa mère travaille à la préfecture de Blois. Les deux aînés et leur grand-tante l’y rejoignent. Un bombardement de la ville s’annonce. Les deux enfants partent en train avec Jeanne Spire. Une attaque de l’aviation allemande vise le convoi en rase campagne. Les voyageurs resteront bloqués dans le train durant plusieurs jours. L’école communale de Préaux (Indre) accueille les réfugiés du train. Jeanne Spire loue deux chambres au-dessus du café Lanchais sur la place du village. Les deux enfants et Jeanne Spire resteront plus d’un an à Préaux. Ils s’intègrent à la vie du village, Monique et Jean vont à l’école communale. Fin 1941, par l’intermédiaire de la mairie de Préaux, leur grand-tante apprend que les parents résident à Tarbes, où Monsieur Serf est démobilisé. La famille se recompose immédiatement à Tarbes (Hautes-Pyrénées), au 3 bis, rue des Carmes. La tante Jeanne reste quelques mois avec eux. Claude, le jeune frère de Monique naît en mars 1942. Monique fréquente l’école communale. Mais la famille doit quitter rapidement Tarbes : un dénonciateur a informé la police qu’une famille juive vit rue des Carmes. Une menace de rafle dont les parents ont été informés. C'est la tante Jeanne qui avait été prévenue la veille du départ. Les déménagements redoublent sous l’Occupation pour fuir la traque nazie faite aux juifs. S’y ajoutent les séparations pour déjouer les dénonciations. De 1943 à octobre 1945, la famille se cache près de Chasseneuil-sur-Bonnieure en Charente, puis à Grenoble et à Saint-Marcellin en Isère. À la Libération, les membres de la famille quittent Saint-Marcellin pour Paris, d’abord au 131, rue Marcadet, puis dans un appartement rue Notre-Dame-de-Nazareth, puis dans un autre hôtel rue de Vaugirard, où ils se retrouvent tous. Barbara subira le comportement incestueux de son père pendant son enfance. Après Blois, Préaux, la voilà donc fin 1941 à Tarbes. Qui rêve spectacles, déguise ses voisins de la cour « et la petite fille de la propriétaire qui était rudement jolie et qui intéressait diablement mon frère Jean », se souvient-elle. Mais c'est un quotidien de cauchemar que vit la petite fille juive dans « une assez grande maison, 3 bis, rue des Carmes ». Son frère est premier en tout au lycée Théophile-Gautier. Elle est « très indisciplinée », « frondeuse », « désobéissante », disent ses livrets scolaires de la communale. Son père ne manque jamais une occasion de l'humilier. Sauf quand ils sont seuls tous les deux. Elle n'écrira jamais le mot. Mais « le soir, lorsque j'entends claquer le grand portail vert et les pas de mon père résonner dans la cour, je me prends à trembler ». Et les larmes lui viennent, confie-t-elle en révélant sans le dire l'inceste. Rappelant simplement « les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire ». C’est à Tarbes, alors qu'elle a à peine onze ans et demi, que son père abuse d'elle pour la première fois. "Un soir, à Tarbes, mon univers bascule dans l'horreur", écrit-elle. Personne ne dénonce l'inceste dans sa famille. Elle tente bien de s'adresser à une gendarmerie, au soir d'une fugue en Bretagne. On l'écoute mais sa plainte n'est pas enregistrée. Son père revient la chercher et laisse entendre qu'elle affabule. En 1949, alors qu'elle n'a que dix-neuf ans, le départ définitif du foyer familial de son père marque l'interruption de leurs rapports, mais elle n'en fait le récit que très tard, dans ses mémoires interrompus par sa mort en 1997, sans toutefois se décider à dire les mots de « viol » et d'« inceste ». « Tarbes a toujours été un souvenir très dur pour Barbara », confiera à la Dépêche du Midi, Marie Chaix, la secrétaire et biographe de la chanteuse Barbara. « Je ne chanterai pas à Tarbes », disait-elle. Plus tard, elle donnera un concert, finalement, mais à Ibos, au Parvis. C’est donc à Tarbes qu’elle vécut les pires moments de sa vie qui lui inspirèrent plus tard, la chanson « L’Aigle noir ». Beaucoup de personnes se sont interrogées sur le sens réel des paroles de « L'Aigle noir ». De son vivant, Barbara se dérobait à chaque fois, prétextant que cela ne concernait qu'elle : "Ce ne sont pas les paroles qui sont importantes...", disait-elle. Selon le chanteur Patrick Bruel, qui a repris le titre en 2015, ces paroles seraient une référence à l'emblème du Troisième Reich et à la vie d'errance et de danger durant l'enfance de la chanteuse. Le journaliste Pierre Adrian commente : "Après l'interprétation psychanalytique, voici l'interprétation historique". En 1946, la famille Self s’installe au Vésinet (Yvelines) à la pension des Trois Marroniers au 31 bis, rue Ernest-André, où la future Barbara prend ses premiers cours de chant chez Madame Madeleine Thomas-Dusséqué. À son contact, elle apprend le chant, le solfège et le piano, avant d'emménager au 50, rue de Vitruve dans le 20e arrondissement de Paris. Madame Dusséqué quitte le Vésinet pour Paris. Elle donne des cours salle Pleyel. Le 30 décembre 1946, sa grand-mère maternelle Hava Poustilnikov décède à Paris à son domicile 131, rue Marcadet, à l’âge de 66 ans. Cette femme comptait beaucoup pour Monique. Peu attirée par les études, elle ambitionne depuis longtemps de devenir pianiste mais son rêve est brisé depuis 1944, un kyste à la main droite ayant obligé les médecins de Grenoble à intervenir à sept reprises et sectionner les tendons. Ses parents promettent de lui offrir des cours de chant. Elle s’inscrit à ceux de Mme Dusséqué. Sa vie en est changée. Au bout de quelques leçons, sa professeure la présente à maître Paulet, enseignant au Conservatoire de Paris, qui la prend comme élève en 1947. Dans le nouvel appartement, un piano loué par son père est installé ; Monique en joue d’instinct, sans prendre de leçons. La jeune fille entre au Conservatoire comme auditrice, mais au répertoire de chant classique, qui l'ennuie, elle préfère celui de la chanson populaire, ayant rencontré à l'ABC l'univers de Piaf. Elle arrête les cours en 1948. La même année, après avoir passé une audition au théâtre Mogador, elle est engagée comme mannequin-choriste dans l’opérette « Violettes impériales ». Un jour de 1949, son père abandonne soudainement le foyer, pour ne plus revenir. Bientôt, la même année, la location du piano ne peut plus être honorée. Contrainte de s’en séparer, elle vit un déchirement. Voulant à tout prix concrétiser son rêve, devenir "pianiste chantante", elle quitte Paris en février 1950. Grâce à l’argent prêté par une amie, elle s’exile à Bruxelles chez un cousin, Sacha Piroutsky, qu’elle quitte au bout de deux mois car il devenait violent. Sans ressources ni connaissances, la vie est difficile. Au hasard d’une rencontre, elle rejoint une communauté d’artistes à Charleroi, qui se réunissent dans un local appelé La Mansarde. Là, elle trouve de l’aide et commence à chanter dans des cabarets sous le nom de Barbara Brodi (en l'honneur d'une de ses aïeules ukrainiennes appelée Varvara, ou de sa grand-mère Hava Brodsky). Son répertoire est constitué de chansons d’Édith Piaf, Marianne Oswald, Germaine Montero, Juliette Gréco. Chaque fois, le public la siffle copieusement. En 1950, elle rencontre Jacques Brel qui, comme elle, tente de percer en se produisant dans divers cabarets. Elle ajoute à son répertoire les premières chansons de cet auteur-compositeur en herbe avec qui elle va se lier d'une très grande amitié discrète mais indéfectible, pleine de complicité et d'admiration mutuelle. Plus tard, tandis que Barbara ne chante encore que des chansons écrites par d'autres, Brel l'encourage à écrire elle-même ses propres chansons ; il sera donc le premier à qui elle fera découvrir ses premiers textes, dont ses premiers succès. Brel dira « Barbara, c'est une fille bien. Elle a un grain, mais un beau grain. On est un peu amoureux, comme ça, depuis longtemps ». En 1971, il lui offrira un premier rôle dans son film Franz. À partir de 1981, soit trois ans après la mort de Brel, La Valse de Franz, composée par Brel, sera jouée dans tous les spectacles de Barbara, En 1990, elle créera au théâtre Mogador la chanson Gauguin (Lettre à Jacques Brel). Fin 1951, elle retourne vivre chez son oncle au 131, rue Marcadet à Paris pour des auditions sans lendemain, dont une au cabaret La Fontaine des Quatre-Saisons dont la programmation est déjà faite et où on lui propose une place de plongeuse pour un an. Elle peut toutefois y rencontrer et observer, sans jamais chanter, Boris Vian avec Henri Crolla et Louis Bessières ou encore Mouloudji. Elle revient à Bruxelles où un ami du groupe de Charleroi lui donne l’occasion de chanter. Elle est mise en relation avec Ethery Rouchadze, pianiste géorgienne qui accepte de l’accompagner et auprès de qui elle se perfectionnera au piano. Cette dernière lui présente Claude Sluys, jeune avocat. Habitué des lieux de spectacles, il se pique d’écrire quelques chansons. Fin 1952, il déniche le « théâtre du Cheval blanc » et use de ses relations pour y ouvrir un cabaret afin qu’elle s’y produise sous le nom de Barbara. Elle monte pour la première fois sur scène accompagnée de son piano, vêtue d’un châle noir et maquillée de khôl. Ainsi commence à se construire le personnage de la « dame en noir ». Le bouche à oreille aidant, le succès ne se fait pas attendre. Le 31 octobre 1953, Barbara épouse Claude Sluys. Au début de l’année 1955, elle enregistre deux chansons chez Decca : « Mon pote le gitan » et « L'œillet blanc » (parfois noté « L'œillet rouge »), diffusées en 78 tours et 45 tours. En 1955, les époux se séparent. À la fin de l'année, Barbara retourne à Paris où elle chante dans de petits cabarets : La Rose rouge en 1956, Chez Moineau en 1957, puis en 1958 à L’Écluse, où elle a déjà chanté pour de courts engagements. En 1958, elle réussit à s’imposer, sous le surnom de La Chanteuse de minuit, si bien que sa notoriété grandit et lui attire un public de fidèles, en particulier parmi les étudiants du Quartier latin. C’est sous le nom de « Barbara » qu’elle effectue son premier passage à la télévision, le 12 juillet 1958, sur l’unique chaîne de la RTF, dans l’émission Cabaret du Soir, où la présentatrice la compare à Yvette Guilbert et lui assure "qu’elle deviendra certainement une grande vedette". À cette époque, poussée par son ami Brel, elle commence à écrire. Remarquée et engagée par Pathé-Marconi, elle enregistre, sous le label « La Voix de son Maître », son premier Super 45 tours, « La Chanteuse de minuit », avec deux de ses propres chansons : « J’ai troqué » et « J’ai tué l’amour », et au printemps 1959 son premier 33 tours « Barbara à L’Écluse ». En décembre 1959, apprenant que son père, qui avait fui sur les routes pour noyer son crime dans le vagabondage et la déchéance, est mourant et la réclame auprès de lui à Nantes (Loire-Atlantique), elle s'y précipite, mais arrive trop tard. À la vue de son corps, à la morgue, ses sentiments oscillent entre fascination, panique, mépris, haine, d'une part, et un immense désespoir d'autre part. Au lendemain de l’enterrement, elle commence l’écriture de la chanson « Nantes », qu’elle achève quatre ans plus tard, quelques heures avant son passage au théâtre des Capucines, le 5 novembre 1963 ; ce sera l'une de ses plus grandes chansons. En 1960, elle change de maison de disque pour signer chez Odéon. Elle enregistre « Barbara chante Brassens » puis « Barbara chante Jacques Brel » : le premier de ces albums est couronné par l’Académie Charles-Cros dans la catégorie « Meilleure interprète ». En 1961, elle décroche un tour de chant du 9 au 20 février, en première partie de Félix Marten à Bobino. Sa performance est peu appréciée, sa présentation jugée austère, à l’évidence pas encore prête pour les grandes scènes. Loin de se décourager, elle reprend ses récitals à L’Écluse. La même année, elle se rend à Abidjan, où elle retrouve son amant, le diplomate Hubert Ballay ; elle lui écrira « Dis, quand reviendras-tu ? », avant de le quitter. Deux années plus tard, les mardis de novembre et décembre 1963, au théâtre des Capucines, elle retient et capte l’attention avec un répertoire nouveau comprenant deux de ses chansons : « Nantes » et « Dis, quand reviendras-tu ? ». Le succès est tel que la maison Philips va donner un véritable élan à sa carrière en lui signant un contrat. Séduit, Georges Brassens lui propose la première partie de son prochain spectacle à Bobino. En attendant, le 4 juillet 1964, elle se rend sans enthousiasme en Allemagne de l'Ouest, en réponse à l’invitation de Hans-Gunther Klein, directeur du Junges Theater de la ville universitaire de Göttingen. Agréablement surprise et touchée par l’accueil chaleureux qu’elle reçoit, elle prolonge son séjour d’une semaine. L'avant-veille de son départ, elle offre au public la chanson « Göttingen », qu’elle a écrite d’un trait dans les jardins du théâtre. En mai 1967, elle sera à Hambourg pour l’enregistrer, avec neuf autres titres, traduits en allemand, pour le 33 tours « Barbara singt Barbara », et retournera chanter à Göttingen le 4 octobre. Dans les années 1980, les hommes politiques se saisiront de la chanson pour promouvoir l'amitié franco-allemande. En 1988, Barbara recevra la Médaille d’honneur de Göttingen et l'ordre du Mérite fédéral. En 1992, à la veille d'un référendum, François Mitterrand choisira ce titre pour terminer un entretien télévisé. En 2002, Xavier Darcos, alors ministre délégué à l’enseignement scolaire, inscrira cette chanson aux programmes officiels des classes de l'école primaire : la chanson sera reprise dans les écoles en 2003 à l'occasion de la commémoration du quarantième anniversaire du traité d'amitié franco-allemand, dit traité de l'Élysée. Comme convenu, elle chante à Bobino avec Georges Brassens en « vedette » du 21 octobre au 9 novembre 1964. Le public est conquis et les critiques sont unanimes pour saluer sa prestation. Paris-presse, L’Intransigeant écrit qu’elle "fait presque oublier Brassens", L'Humanité : "Un faux pas de Brassens, une prouesse de Barbara." Le 14 mars 1965, sort son premier album Philips, « Barbara chante Barbara ». Il obtient le prix de l’Académie Charles-Cros et un réel succès commercial. Lors de la cérémonie, au palais d’Orsay, Barbara déchire son prix en quatre pour le distribuer aux techniciens, en témoignage de sa gratitude. La même année, elle obtient un grand succès à Bobino. Le 15 septembre, jour de la première, France Inter organise une journée Barbara sur ses ondes. La chanteuse est si profondément marquée par cette première qu’elle l'immortalise peu après dans l’une de ses plus grandes chansons : Ma plus belle histoire d’amour. « Ce fut, un soir, en septembre / Vous étiez venus m’attendre / Ici même, vous en souvenez-vous ? … ». En décembre 1966, Barbara se produit à nouveau à Bobino, où elle interprète notamment « Au cœur de la nuit » (titre que jamais plus elle n'inscrira à son tour de chant). Trois ans avant « L'Aigle noir », elle y évoque "un bruissement d'ailes qui effleure son visage", évoque la mort de son père et le pardon "pour qu'enfin tu puisses dormir, pour qu'enfin ton cœur repose, que tu finisses de mourir sous tes paupières déjà closes" (voir les albums Ma plus belle histoire d'amour, Bobino 1967). En 1967, elle écrit avec Georges Moustaki, « La Dame brune », chanson d'amour qu'ils interprètent en duo. Elle dira à son sujet : "Moustaki, c'est ma tendresse". Le 6 novembre 1967, alors en tournée en Italie, elle apprend la mort de sa mère. Elle a vécu au 14, rue de Rémusat de 1961 à 1967, date à laquelle elle quitte l'immeuble à la suite du décès de sa mère, ce qui lui inspire quelques années plus tard, en 1972, la chanson Rémusat, où elle évoque ce double départ. En février 1969, Barbara est à l’Olympia. À la fin de la dernière représentation, à la stupeur générale, elle annonce qu’elle arrête le tour de chant. Mais elle respecte ses engagements passés jusqu’en 1971. Toutefois, cet arrêt ne sera pas définitif. Elle a d'ailleurs déclaré qu'elle n'avait jamais fait d'adieux, mais qu'elle avait pris ses distances. La chanteuse reviendra sur les scènes du music-hall après trois ans d'absence. Début 1970, elle est au théâtre de la Renaissance dans « Madame », une pièce musicale, écrite par Rémo Forlani, dont elle signe la musique. Le rocking-chair du décor la suivra désormais dans tous ses tours de chant. Elle interprète une "tenancière de lupanar en Afrique". « Madame » est un échec, mais Barbara remet rapidement le pied à l’étrier grâce au succès de l’album studio L'Aigle noir, dont la chanson homonyme est l’un des plus gros succès discographiques de l’année. Barbara a dit de cette chanson qu'elle l'avait rêvée, "un rêve plus beau que la chanson elle-même". À la suite de la publication de ses mémoires en 1998, une interprétation bien plus sombre de « L'Aigle noir » fut supposée. En février 1972, Barbara est avec son ami Jacques Brel à l'affiche de « Franz ». Elle joue Léonie, femme laide, incapable de vivre l’amour dont elle rêve. Ce premier film réalisé par le chanteur obtient peu de succès. Deux ans plus tard, elle joue la diva délaissée du film « L'Oiseau rare », réalisé par Jean-Claude Brialy. Le danseur et chorégraphe Maurice Béjart, qui appréciait Barbara énormément, la fait tourner dans « Je suis né à Venise ». Dans ce film, qui ne sera diffusé qu’à la télévision, Barbara tient deux rôles : celui d'une chanteuse (elle interprète trois titres : L’Amour magicien, L’Homme en habit rouge et La Mort) et celui de La Dame de la nuit. Sa carrière musicale demeure active dans les années 1970 : à la télévision, en 1972, elle interprète un duo avec Johnny Hallyday, « Toi mon ombre, toi ma lumière ». Elle tourne au Japon, au Canada, en Belgique, en Israël, aux Pays-Bas et en Suisse. Barbara réalisera ses plus grands passages de sa carrière à la télévision pendant ses années ORTF, entre 1958 et 1974. En 1973, Barbara s'installe à Précy-sur-Marne, à trente kilomètres à l'est de Paris, dans une ancienne ferme villageoise au 2, rue de Verdun. Pour ses répétitions avant chaque spectacle, elle fait transformer la grange en théâtre, lui donnant le nom de « Grange au loup ». Dans le jardin enserré par les bâtiments de la ferme, elle découvre le plaisir de jardiner. Au petit matin du 5 juin 1974, les pompiers de Meaux découvrent son corps inanimé. Dans le coma, elle est conduite en urgence à l'hôpital. Plus tard, dans plusieurs entretiens, elle relate l'événement en expliquant que, n'arrivant pas à trouver le sommeil, elle a absorbé les cachets qu'elle avait sous la main. Lors d'un concert à Avignon, elle déclare : "Je n'ai pas voulu mourir, j'ai voulu dormir". Par décision, elle interrompt ses apparitions audiovisuelles en 1974. À partir de cette période, ses textes et ses choix musicaux évoluent en profondeur, et ses concerts de 1974, 1975 et 1978 accueillent de nouveaux titres importants. La chanson de 1974, « L’homme en habit rouge », évoque le souvenir de sa liaison avec son parolier de l’album La Louve, François Wertheimer, auquel Barbara avait offert le parfum Habit rouge de Guerlain. Pour cet album de 1973, Barbara demande à William Sheller de faire les orchestrations. De cette collaboration naît une amitié entre William et la Duchesse, comme celui-ci la surnomme affectueusement. C'est elle qui pousse alors William à devenir chanteur. Entre 1975 et 1976, elle a une aventure avec le comédien Pierre Arditi, de quatorze ans son cadet. Celui-ci se souvient d'avoir été comme "un adolescent énamouré" dans une liaison qu'il décrit comme "pas très longue mais marquante". Après leur séparation, ils sont restés très bons amis. En 1978, elle fait un retour remarqué à l'Olympia. Son album Seule est l’une des meilleures ventes de 1981. Son plus grand succès sur scène est celui qu’elle présente à l'automne de la même année à l’hippodrome de Pantin. Plus que de simples concerts, ses représentations sont, selon Jérôme Garcin, de véritables messes dont les rappels ininterrompus se prolongent jusque tard dans la nuit. Elle y interprète notamment « Regarde », chanson militante qu'elle a composée et chantée pour la campagne présidentielle de François Mitterrand, pour qui elle appela à voter, à partir du 8 avril 1981. C’est lors de ce spectacle que la voix de la chanteuse, pour la première fois, et irrémédiablement, se brise. Si au départ elle s'en affole, par la suite elle ne cherchera pas à le cacher mais saura au contraire se servir de cette voix, désormais "au crépuscule", pour renforcer l’aspect dramatique et authentique de son interprétation. Se renouvelant sans cesse, la chanteuse continue d’attirer un public très jeune. L’année suivante, elle reçoit le Grand prix national de la chanson en reconnaissance de sa contribution à la culture française. Par ailleurs, elle développe une relation de travail et d’amitié avec la vedette cinématographique montante Gérard Depardieu et son épouse Élisabeth. En 1985, elle coécrit avec Luc Plamondon la musique et le texte de la pièce Lily Passion, où elle joue et chante avec Gérard Depardieu. Sorte d’autobiographie romancée, c’est l’histoire d’une chanteuse qui voue toute sa vie à son public. La première représentation a lieu au Zénith de Paris, le 21 janvier 1986. L’été venu, elle est invitée sur la scène du Metropolitan Opera de New York pour un Gala Performance, donné le 8 juillet. Elle accompagne au piano son ami le danseur étoile Mikhaïl Barychnikov qui danse sur deux de ses chansons « Pierre » et « Le Mal de vivre ». À cette période, elle s'investit dans la collecte de fonds pour le traitement du Sida. Elle rend visite aux malades dans les hôpitaux et dans les prisons. Lors de ses concerts, elle met des corbeilles de préservatifs à la disposition des personnes venues l’écouter ; engagement dont témoigne artistiquement le titre « Sid’Amour à mort ». En 1987, elle monte pour la première fois sur la scène du théâtre du Châtelet, à Paris, pour une série de récitals pendant les mois de septembre et octobre, suivis d'une tournée en France, en Suisse, en Belgique, au Japon, au Canada et en Israël qui se termine en 1988. En 1988, elle est promue chevalier de la Légion d'honneur par le Président de la République François Mitterrand. L'année suivante, elle chante au théâtre Mogador à Paris de février à avril. Suivra une tournée en France et au Japon jusqu'en 1991. En 1991, elle enregistre « Lettres à un jeune poète » de Rainer Maria Rilke pour les Éditions Claudine Ducaté. Elle dédicacera cet enregistrement dans une librairie parisienne, la même année. En novembre et décembre 1993, Barbara est à nouveau sur la scène parisienne du théâtre du Châtelet, mais des problèmes de santé la contraignent à interrompre les représentations. Après quelques jours de repos, elle retrouve son public, le temps d’enregistrer le spectacle, puis renonce à poursuivre et annule les dernières représentations. En 1994, elle obtient la Victoire de l'artiste interprète féminine de l'année aux Victoires de la musique (une récompense qu'elle obtiendra une seconde fois en 1997). Son ultime tournée débute à Dijon, le 1er février. Sa dernière apparition sur scène a lieu le soir du samedi 26 mars 1994 au Centre de Congrès Vinci de la ville de Tours. Après seize années passées loin des studios, elle enregistre douze nouvelles chansons durant l'été 1996. Pour ce disque, Jean-Louis Aubert signe le texte « Vivant poème » et Guillaume Depardieu celui de « À force de ». Sorti le 6 novembre, cet album sobrement intitulé « Barbara » est son chant du cygne. Epuisée par les stimulants, les médicaments pris en dose massive pour soigner son angoisse ou les corticoïdes pour ses cordes vocales, affaiblie par une alimentation hasardeuse, elle consacre son temps à la rédaction de ses mémoires. Le 24 novembre 1997, elle est hospitalisée pour une pneumonie que les rumeurs transforment en mystère. Elle meurt à l’hôpital américain de Neuilly-sur-Seine à l’âge de 67 ans, victime d’une infection respiratoire foudroyante. Elle disparaît juste après la sortie de « Femme Piano », regroupant ses plus belles chansons. Elle est enterrée trois jours plus tard au cimetière de Bagneux, entourée d’une foule d’amis et de fans. Allant totalement à l’encontre des modes de son temps, tant musicales que physiques, Barbara a pourtant su se faire sa place et s’imposer sur la scène de la chanson française. Toute son œuvre fut intimement liée à sa vie personnelle. Les mémoires posthumes de Barbara, « Il était un piano noir », révélèrent une déchirure d’enfance, un lourd secret à porter. Même si cela transpire tout au long de son œuvre, l’artiste ne pourra jamais l’aborder franchement sinon par des allusions très voilées, qui permettront à ses proches de sentir cette fêlure ineffaçable.BARÈRE Bertrand (1755-1841)
Avocat et homme politique de la Révolution française
 Bertrand BARÈRE, dit Bertrand Barère de Vieuzac, né le 10 septembre 1755 à Tarbes et mort le 13 janvier 1841, à l’âge de 85 ans. Il était le fils d’un procureur du roi qui avait été maire de Tarbes et président du Tiers État aux assemblées de Bigorre. Il fera son droit en 1770-1771 à l’université de Toulouse et le 8 juillet 1775 il prêtera son serment d’avocat. Par la suite, il deviendra mainteneur des Jeux floraux et rentrera à la loge maçonnique L’Encyclopédique de Toulouse. Avocat de profession, député du Tiers État aux États généraux en 1789, il deviendra un des hommes politiques les plus importants pendant la Convention nationale en 1793-1794. En 1775, il deviendra avocat au Parlement de Toulouse, puis conseiller de la sénéchaussée de Bigorre. En 1782, il ajoutera à son nom de famille le nom de Vieuzac, une très petite seigneurie (de Vieuzac-Argelès) lui appartenant. En avril 1789, il sera élu député aux États généraux. Il siègera alors parmi les députés appelés constitutionnels qui veulent une monarchie constitutionnelle et deux assemblées se partageant le pouvoir législatif (le bicaméralisme). Il créera Le Point du Jour, un journal qui rend compte des débats et des décrets de l’Assemblée constituante. Il fréquentera le club politique modéré des Feuillants et les milieux liés à la coterie du duc d’Orléans, cousin du roi. Il sera favorable à l’égalité des droits entre les blancs et les hommes libres de couleur à Haïti (colonie française). Pendant l’été 1792, il sera élu député des Hautes-Pyrénées à la Convention. Député du centre, il se rapprochera des députés montagnards. En décembre 1792, comme président de la Convention, il présidera le début du procès de Louis XVI. Son attitude convaincra les députés du centre (la Plaine) de soutenir les Montagnards. Il votera la mort du roi, sans appel ni sursis. En avril 1793, il sera le député le mieux élu au Comité de Salut public. Il sera réélu en juillet 1793. Il s’occupera des relations diplomatiques et de l’instruction. Grand travailleur, esprit clair, brillant orateur, il sera chargé des rapports quotidiens que le comité fait à la Convention. Il fera décréter que la « Terreur est à l’ordre du jour ». Il sera un adversaire des Hébertistes ou Exagérés. Cependant il traînera derrière lui son passé de modéré. Pour éviter les ennuis il doit se montrer ferme partisan des mesures extrêmes. En thermidor an II (juillet 1794), il ne soutiendra pas Robespierre quand celui-ci est accusé de dictature. Pendant la réaction thermidorienne, il sera exclu dès septembre 1794 du Comité de Salut public. Il sera arrêté en mars 1795. Pendant son procès il défendra l’œuvre collective accomplie par le gouvernement révolutionnaire afin de sauver la République. Il échappera de peu à la guillotine et sera condamné à la déportation à Cayenne en mars 1795, mais parviendra à rester en France. S’évadant de la prison de Saintes, il se cachera pendant cinq ans à Bordeaux. En 1797, il sera élu au Conseil des Cinq-Cents, mais son élection sera invalidée. Il sera amnistié après le coup d’État du 18 brumaire de Napoléon Bonaparte. Il sera alors subventionné pour rédiger des écrits favorables à Bonaparte comme des rapports périodiques sur l’état de l’opinion publique et il sera mis à contribution pour la rédaction d’un journal intitulé "Mémorial anti-britannique", qui paraissait tous les deux jours. Pendant les Cent-Jours, Napoléon Ier le nommera membre de la Chambre des représentants. Comme régicide lors de la seconde Restauration, il devra s’exiler en Belgique en 1816, et ne reviendra en France qu’après la Révolution de 1830. Pratiquement dépourvu de revenus, il vivra alors très modestement et s’en retournera en 1832 dans le département des Hautes-Pyrénées, qu’il avait contribué à créer. En 1833, il sera élu au Conseil général de Tarbes Sud où il s’occupera de questions d’éclairage public et de canalisations urbaines. De nouveau élu député des Hautes-Pyrénées en 1834, son élection sera une nouvelle fois annulée. Il démissionnera en 1840 du Conseil général des Hautes-Pyrénées et mourra un an après. À Tarbes il fit un rapport sur l’économie locale et, visionnaire, un autre sur l’urbanisme de la ville pour l’an 2000. Lors de la création des départements, il se battit pour que la Bigorre, de trop petite taille et menacée par les exigences du Béarn et de l’Armagnac, devienne le département des Hautes-Pyrénées, en prenant le complément de superficie aux alentours et pour que Tarbes en soit le chef-lieu. Tarbes lui dédia quand même une avenue face à la gare. L’« Anacréon de la guillotine », tel fut l’un des nombreux surnoms de Barère de Vieuzac. En 1994, la Société Académique remplaça la plaque posée sur sa maison natale en ne retenant pour l’histoire que « promoteur du département » et non l’« Anacréon de la guillotine ».
Bertrand BARÈRE, dit Bertrand Barère de Vieuzac, né le 10 septembre 1755 à Tarbes et mort le 13 janvier 1841, à l’âge de 85 ans. Il était le fils d’un procureur du roi qui avait été maire de Tarbes et président du Tiers État aux assemblées de Bigorre. Il fera son droit en 1770-1771 à l’université de Toulouse et le 8 juillet 1775 il prêtera son serment d’avocat. Par la suite, il deviendra mainteneur des Jeux floraux et rentrera à la loge maçonnique L’Encyclopédique de Toulouse. Avocat de profession, député du Tiers État aux États généraux en 1789, il deviendra un des hommes politiques les plus importants pendant la Convention nationale en 1793-1794. En 1775, il deviendra avocat au Parlement de Toulouse, puis conseiller de la sénéchaussée de Bigorre. En 1782, il ajoutera à son nom de famille le nom de Vieuzac, une très petite seigneurie (de Vieuzac-Argelès) lui appartenant. En avril 1789, il sera élu député aux États généraux. Il siègera alors parmi les députés appelés constitutionnels qui veulent une monarchie constitutionnelle et deux assemblées se partageant le pouvoir législatif (le bicaméralisme). Il créera Le Point du Jour, un journal qui rend compte des débats et des décrets de l’Assemblée constituante. Il fréquentera le club politique modéré des Feuillants et les milieux liés à la coterie du duc d’Orléans, cousin du roi. Il sera favorable à l’égalité des droits entre les blancs et les hommes libres de couleur à Haïti (colonie française). Pendant l’été 1792, il sera élu député des Hautes-Pyrénées à la Convention. Député du centre, il se rapprochera des députés montagnards. En décembre 1792, comme président de la Convention, il présidera le début du procès de Louis XVI. Son attitude convaincra les députés du centre (la Plaine) de soutenir les Montagnards. Il votera la mort du roi, sans appel ni sursis. En avril 1793, il sera le député le mieux élu au Comité de Salut public. Il sera réélu en juillet 1793. Il s’occupera des relations diplomatiques et de l’instruction. Grand travailleur, esprit clair, brillant orateur, il sera chargé des rapports quotidiens que le comité fait à la Convention. Il fera décréter que la « Terreur est à l’ordre du jour ». Il sera un adversaire des Hébertistes ou Exagérés. Cependant il traînera derrière lui son passé de modéré. Pour éviter les ennuis il doit se montrer ferme partisan des mesures extrêmes. En thermidor an II (juillet 1794), il ne soutiendra pas Robespierre quand celui-ci est accusé de dictature. Pendant la réaction thermidorienne, il sera exclu dès septembre 1794 du Comité de Salut public. Il sera arrêté en mars 1795. Pendant son procès il défendra l’œuvre collective accomplie par le gouvernement révolutionnaire afin de sauver la République. Il échappera de peu à la guillotine et sera condamné à la déportation à Cayenne en mars 1795, mais parviendra à rester en France. S’évadant de la prison de Saintes, il se cachera pendant cinq ans à Bordeaux. En 1797, il sera élu au Conseil des Cinq-Cents, mais son élection sera invalidée. Il sera amnistié après le coup d’État du 18 brumaire de Napoléon Bonaparte. Il sera alors subventionné pour rédiger des écrits favorables à Bonaparte comme des rapports périodiques sur l’état de l’opinion publique et il sera mis à contribution pour la rédaction d’un journal intitulé "Mémorial anti-britannique", qui paraissait tous les deux jours. Pendant les Cent-Jours, Napoléon Ier le nommera membre de la Chambre des représentants. Comme régicide lors de la seconde Restauration, il devra s’exiler en Belgique en 1816, et ne reviendra en France qu’après la Révolution de 1830. Pratiquement dépourvu de revenus, il vivra alors très modestement et s’en retournera en 1832 dans le département des Hautes-Pyrénées, qu’il avait contribué à créer. En 1833, il sera élu au Conseil général de Tarbes Sud où il s’occupera de questions d’éclairage public et de canalisations urbaines. De nouveau élu député des Hautes-Pyrénées en 1834, son élection sera une nouvelle fois annulée. Il démissionnera en 1840 du Conseil général des Hautes-Pyrénées et mourra un an après. À Tarbes il fit un rapport sur l’économie locale et, visionnaire, un autre sur l’urbanisme de la ville pour l’an 2000. Lors de la création des départements, il se battit pour que la Bigorre, de trop petite taille et menacée par les exigences du Béarn et de l’Armagnac, devienne le département des Hautes-Pyrénées, en prenant le complément de superficie aux alentours et pour que Tarbes en soit le chef-lieu. Tarbes lui dédia quand même une avenue face à la gare. L’« Anacréon de la guillotine », tel fut l’un des nombreux surnoms de Barère de Vieuzac. En 1994, la Société Académique remplaça la plaque posée sur sa maison natale en ne retenant pour l’histoire que « promoteur du département » et non l’« Anacréon de la guillotine ».
 Bertrand BARÈRE, dit Bertrand Barère de Vieuzac, né le 10 septembre 1755 à Tarbes et mort le 13 janvier 1841, à l’âge de 85 ans. Il était le fils d’un procureur du roi qui avait été maire de Tarbes et président du Tiers État aux assemblées de Bigorre. Il fera son droit en 1770-1771 à l’université de Toulouse et le 8 juillet 1775 il prêtera son serment d’avocat. Par la suite, il deviendra mainteneur des Jeux floraux et rentrera à la loge maçonnique L’Encyclopédique de Toulouse. Avocat de profession, député du Tiers État aux États généraux en 1789, il deviendra un des hommes politiques les plus importants pendant la Convention nationale en 1793-1794. En 1775, il deviendra avocat au Parlement de Toulouse, puis conseiller de la sénéchaussée de Bigorre. En 1782, il ajoutera à son nom de famille le nom de Vieuzac, une très petite seigneurie (de Vieuzac-Argelès) lui appartenant. En avril 1789, il sera élu député aux États généraux. Il siègera alors parmi les députés appelés constitutionnels qui veulent une monarchie constitutionnelle et deux assemblées se partageant le pouvoir législatif (le bicaméralisme). Il créera Le Point du Jour, un journal qui rend compte des débats et des décrets de l’Assemblée constituante. Il fréquentera le club politique modéré des Feuillants et les milieux liés à la coterie du duc d’Orléans, cousin du roi. Il sera favorable à l’égalité des droits entre les blancs et les hommes libres de couleur à Haïti (colonie française). Pendant l’été 1792, il sera élu député des Hautes-Pyrénées à la Convention. Député du centre, il se rapprochera des députés montagnards. En décembre 1792, comme président de la Convention, il présidera le début du procès de Louis XVI. Son attitude convaincra les députés du centre (la Plaine) de soutenir les Montagnards. Il votera la mort du roi, sans appel ni sursis. En avril 1793, il sera le député le mieux élu au Comité de Salut public. Il sera réélu en juillet 1793. Il s’occupera des relations diplomatiques et de l’instruction. Grand travailleur, esprit clair, brillant orateur, il sera chargé des rapports quotidiens que le comité fait à la Convention. Il fera décréter que la « Terreur est à l’ordre du jour ». Il sera un adversaire des Hébertistes ou Exagérés. Cependant il traînera derrière lui son passé de modéré. Pour éviter les ennuis il doit se montrer ferme partisan des mesures extrêmes. En thermidor an II (juillet 1794), il ne soutiendra pas Robespierre quand celui-ci est accusé de dictature. Pendant la réaction thermidorienne, il sera exclu dès septembre 1794 du Comité de Salut public. Il sera arrêté en mars 1795. Pendant son procès il défendra l’œuvre collective accomplie par le gouvernement révolutionnaire afin de sauver la République. Il échappera de peu à la guillotine et sera condamné à la déportation à Cayenne en mars 1795, mais parviendra à rester en France. S’évadant de la prison de Saintes, il se cachera pendant cinq ans à Bordeaux. En 1797, il sera élu au Conseil des Cinq-Cents, mais son élection sera invalidée. Il sera amnistié après le coup d’État du 18 brumaire de Napoléon Bonaparte. Il sera alors subventionné pour rédiger des écrits favorables à Bonaparte comme des rapports périodiques sur l’état de l’opinion publique et il sera mis à contribution pour la rédaction d’un journal intitulé "Mémorial anti-britannique", qui paraissait tous les deux jours. Pendant les Cent-Jours, Napoléon Ier le nommera membre de la Chambre des représentants. Comme régicide lors de la seconde Restauration, il devra s’exiler en Belgique en 1816, et ne reviendra en France qu’après la Révolution de 1830. Pratiquement dépourvu de revenus, il vivra alors très modestement et s’en retournera en 1832 dans le département des Hautes-Pyrénées, qu’il avait contribué à créer. En 1833, il sera élu au Conseil général de Tarbes Sud où il s’occupera de questions d’éclairage public et de canalisations urbaines. De nouveau élu député des Hautes-Pyrénées en 1834, son élection sera une nouvelle fois annulée. Il démissionnera en 1840 du Conseil général des Hautes-Pyrénées et mourra un an après. À Tarbes il fit un rapport sur l’économie locale et, visionnaire, un autre sur l’urbanisme de la ville pour l’an 2000. Lors de la création des départements, il se battit pour que la Bigorre, de trop petite taille et menacée par les exigences du Béarn et de l’Armagnac, devienne le département des Hautes-Pyrénées, en prenant le complément de superficie aux alentours et pour que Tarbes en soit le chef-lieu. Tarbes lui dédia quand même une avenue face à la gare. L’« Anacréon de la guillotine », tel fut l’un des nombreux surnoms de Barère de Vieuzac. En 1994, la Société Académique remplaça la plaque posée sur sa maison natale en ne retenant pour l’histoire que « promoteur du département » et non l’« Anacréon de la guillotine ».
Bertrand BARÈRE, dit Bertrand Barère de Vieuzac, né le 10 septembre 1755 à Tarbes et mort le 13 janvier 1841, à l’âge de 85 ans. Il était le fils d’un procureur du roi qui avait été maire de Tarbes et président du Tiers État aux assemblées de Bigorre. Il fera son droit en 1770-1771 à l’université de Toulouse et le 8 juillet 1775 il prêtera son serment d’avocat. Par la suite, il deviendra mainteneur des Jeux floraux et rentrera à la loge maçonnique L’Encyclopédique de Toulouse. Avocat de profession, député du Tiers État aux États généraux en 1789, il deviendra un des hommes politiques les plus importants pendant la Convention nationale en 1793-1794. En 1775, il deviendra avocat au Parlement de Toulouse, puis conseiller de la sénéchaussée de Bigorre. En 1782, il ajoutera à son nom de famille le nom de Vieuzac, une très petite seigneurie (de Vieuzac-Argelès) lui appartenant. En avril 1789, il sera élu député aux États généraux. Il siègera alors parmi les députés appelés constitutionnels qui veulent une monarchie constitutionnelle et deux assemblées se partageant le pouvoir législatif (le bicaméralisme). Il créera Le Point du Jour, un journal qui rend compte des débats et des décrets de l’Assemblée constituante. Il fréquentera le club politique modéré des Feuillants et les milieux liés à la coterie du duc d’Orléans, cousin du roi. Il sera favorable à l’égalité des droits entre les blancs et les hommes libres de couleur à Haïti (colonie française). Pendant l’été 1792, il sera élu député des Hautes-Pyrénées à la Convention. Député du centre, il se rapprochera des députés montagnards. En décembre 1792, comme président de la Convention, il présidera le début du procès de Louis XVI. Son attitude convaincra les députés du centre (la Plaine) de soutenir les Montagnards. Il votera la mort du roi, sans appel ni sursis. En avril 1793, il sera le député le mieux élu au Comité de Salut public. Il sera réélu en juillet 1793. Il s’occupera des relations diplomatiques et de l’instruction. Grand travailleur, esprit clair, brillant orateur, il sera chargé des rapports quotidiens que le comité fait à la Convention. Il fera décréter que la « Terreur est à l’ordre du jour ». Il sera un adversaire des Hébertistes ou Exagérés. Cependant il traînera derrière lui son passé de modéré. Pour éviter les ennuis il doit se montrer ferme partisan des mesures extrêmes. En thermidor an II (juillet 1794), il ne soutiendra pas Robespierre quand celui-ci est accusé de dictature. Pendant la réaction thermidorienne, il sera exclu dès septembre 1794 du Comité de Salut public. Il sera arrêté en mars 1795. Pendant son procès il défendra l’œuvre collective accomplie par le gouvernement révolutionnaire afin de sauver la République. Il échappera de peu à la guillotine et sera condamné à la déportation à Cayenne en mars 1795, mais parviendra à rester en France. S’évadant de la prison de Saintes, il se cachera pendant cinq ans à Bordeaux. En 1797, il sera élu au Conseil des Cinq-Cents, mais son élection sera invalidée. Il sera amnistié après le coup d’État du 18 brumaire de Napoléon Bonaparte. Il sera alors subventionné pour rédiger des écrits favorables à Bonaparte comme des rapports périodiques sur l’état de l’opinion publique et il sera mis à contribution pour la rédaction d’un journal intitulé "Mémorial anti-britannique", qui paraissait tous les deux jours. Pendant les Cent-Jours, Napoléon Ier le nommera membre de la Chambre des représentants. Comme régicide lors de la seconde Restauration, il devra s’exiler en Belgique en 1816, et ne reviendra en France qu’après la Révolution de 1830. Pratiquement dépourvu de revenus, il vivra alors très modestement et s’en retournera en 1832 dans le département des Hautes-Pyrénées, qu’il avait contribué à créer. En 1833, il sera élu au Conseil général de Tarbes Sud où il s’occupera de questions d’éclairage public et de canalisations urbaines. De nouveau élu député des Hautes-Pyrénées en 1834, son élection sera une nouvelle fois annulée. Il démissionnera en 1840 du Conseil général des Hautes-Pyrénées et mourra un an après. À Tarbes il fit un rapport sur l’économie locale et, visionnaire, un autre sur l’urbanisme de la ville pour l’an 2000. Lors de la création des départements, il se battit pour que la Bigorre, de trop petite taille et menacée par les exigences du Béarn et de l’Armagnac, devienne le département des Hautes-Pyrénées, en prenant le complément de superficie aux alentours et pour que Tarbes en soit le chef-lieu. Tarbes lui dédia quand même une avenue face à la gare. L’« Anacréon de la guillotine », tel fut l’un des nombreux surnoms de Barère de Vieuzac. En 1994, la Société Académique remplaça la plaque posée sur sa maison natale en ne retenant pour l’histoire que « promoteur du département » et non l’« Anacréon de la guillotine ».BARTHE Jean (1932-2017)
Capitaine du XV de France puis du XIII de France
 Jean BARTHE, surnommé « Jeanjean », né le 22 juillet 1932 à Lourdes et mort le 2 décembre 2017 à Villemoustaussou, à l’âge de 85 ans. Il était un athlète (1,90 m, 90kg) comme jamais le XV de France n’en avait connu avant lui. Initié au rugby dans la cour de récréation de l’école primaire, il devint rapidement le premier choix des sélectionneurs à l’aile de la troisième-ligne sous l’ère Jean Prat (1954-1955), puis aux côtés de Lucien Mias (1958-1959), avant d’être nommé capitaine à son tour et de porter le brassard en 1959, face à l’Angleterre à Twickenham, pour un partage des points (3-3). Mais il n’était pas fait pour commander : servir les autres lui convenait parfaitement. 22 fois sélectionné dans l’équipe de France à XIII, avec laquelle il disputa la Coupe du monde en 1960, il reste aujourd’hui encore le seul joueur à avoir été capitaine de la sélection nationale dans les deux codes. Nous sommes dans les années cinquante. Celles du grand Lourdes de Jean Prat, avec lequel il fut champion de France en 1956, 1957 et 1958, enlevant trois Brennus avec les quinzistes lourdais. Rapide, inépuisable, solide à l’impact, à la fois rude défenseur et parfait soutien offensif à l’intérieur de ses trois-quarts, il fut le parfait pendant de « Monsieur Rugby ». En 1959, à 27 ans, en pleine gloire et après seulement 26 sélections en équipe de France, il signera des contrats lucratifs chez les treizistes (Roanne, Saint-Gaudens, Carcassonne), histoire de faire fructifier son renom. Il sera champion de France avec Roanne en 1960, puis avec l’AS Carcassonne en 1966 et 1967. Il remporta aussi la coupe de France : une fois avec Roanne (1962) et deux fois avec l’AS Carcassonne (1967, 1968). Il est considéré, avec Max Rousié, Puig-Aubert et Jean Galia, comme l’un des grands transfuges français du XV au XIII. Sa force herculéenne et sa gueule d’archange, qu’il avait plaisir à se faire cabosser irradiaient tous les terrains. Altruiste, toujours au service du collectif, infatigable quelle que soit la tâche à accomplir, il ne rechignait pas aussi à monter en deuxième-ligne, « dans la cage », pour dépanner et souffrir en silence. A XIII, il passera même pilier. Plus le match était rugueux plus il élevait son niveau de jeu. Ainsi fut-il brave entre tous à Pretoria, en 1958, contre le Northern Transvaal, lors de la tournée du XV de France en Afrique du Sud. « Dans un enfer de violence », reconnaîtra-t-il. Lors de cette tournée historique en Afrique du Sud, un fait d’armes est resté à la postérité. Alors que le XV de France a décroché un match nul méritoire face aux Springboks au Cap (3-3) et qu’il mène (5-9) à quelques minutes de la fin du second match, l’ailier sud-africain John Prinsloo fonce, décalé, vers l’en-but français. Au bout de sa course l’essai promis. Il va sceller la défaite tricolore. Mais surgissant de nulle part, Jeanjean plaque Prinsloo et le sort en touche. L’action est immortalisée par un tableau, dans la salle de réception de l’Ellis Park de Johannesbourg, théâtre de l’exploit français : remporter pour la première fois de son histoire une série de tests en Afrique du Sud ! Sur la fin de sa carrière, c’est à Carcassonne que Jean Barthe et son épouse décideront de s’établir. Il avait longtemps tenu, avec son épouse Denise, le bar « Le Rugby », boulevard de Varsovie à Carcassonne. Son palmarès : champion de France en 1949 ; champion de France senior deuxième série avec Biscarosse, où il débuta ; finaliste du championnat de France en 1955 ; triple champion de France avec Lourdes en 1956, 1957 et 1958 et détenteur du Challenge Yves du Manoir en 1956 ; vingt-six fois international sous le maillot bleu, il est considéré entre 1953 et 1968 comme l’un des meilleurs 3e ligne au monde. Il fut capitaine du XIII de France pendant la Coupe du monde disputée en Angleterre en 1960, soldée par trois échecs : Grande-Bretagne (33-7), Nouvelle-Zélande (9-0), Australie (13-12). Une vie bien remplie pour ce champion, qui restera une figure légendaire à XV et à XIII. Il a fini sa carrière à Saint-Jacques XIII, équipe avec laquelle il remporta en 1972, un ultime titre de champion de France de Nationale 2. Le stade de Villemoustaussou (Aude) porte son nom depuis 2009.
Jean BARTHE, surnommé « Jeanjean », né le 22 juillet 1932 à Lourdes et mort le 2 décembre 2017 à Villemoustaussou, à l’âge de 85 ans. Il était un athlète (1,90 m, 90kg) comme jamais le XV de France n’en avait connu avant lui. Initié au rugby dans la cour de récréation de l’école primaire, il devint rapidement le premier choix des sélectionneurs à l’aile de la troisième-ligne sous l’ère Jean Prat (1954-1955), puis aux côtés de Lucien Mias (1958-1959), avant d’être nommé capitaine à son tour et de porter le brassard en 1959, face à l’Angleterre à Twickenham, pour un partage des points (3-3). Mais il n’était pas fait pour commander : servir les autres lui convenait parfaitement. 22 fois sélectionné dans l’équipe de France à XIII, avec laquelle il disputa la Coupe du monde en 1960, il reste aujourd’hui encore le seul joueur à avoir été capitaine de la sélection nationale dans les deux codes. Nous sommes dans les années cinquante. Celles du grand Lourdes de Jean Prat, avec lequel il fut champion de France en 1956, 1957 et 1958, enlevant trois Brennus avec les quinzistes lourdais. Rapide, inépuisable, solide à l’impact, à la fois rude défenseur et parfait soutien offensif à l’intérieur de ses trois-quarts, il fut le parfait pendant de « Monsieur Rugby ». En 1959, à 27 ans, en pleine gloire et après seulement 26 sélections en équipe de France, il signera des contrats lucratifs chez les treizistes (Roanne, Saint-Gaudens, Carcassonne), histoire de faire fructifier son renom. Il sera champion de France avec Roanne en 1960, puis avec l’AS Carcassonne en 1966 et 1967. Il remporta aussi la coupe de France : une fois avec Roanne (1962) et deux fois avec l’AS Carcassonne (1967, 1968). Il est considéré, avec Max Rousié, Puig-Aubert et Jean Galia, comme l’un des grands transfuges français du XV au XIII. Sa force herculéenne et sa gueule d’archange, qu’il avait plaisir à se faire cabosser irradiaient tous les terrains. Altruiste, toujours au service du collectif, infatigable quelle que soit la tâche à accomplir, il ne rechignait pas aussi à monter en deuxième-ligne, « dans la cage », pour dépanner et souffrir en silence. A XIII, il passera même pilier. Plus le match était rugueux plus il élevait son niveau de jeu. Ainsi fut-il brave entre tous à Pretoria, en 1958, contre le Northern Transvaal, lors de la tournée du XV de France en Afrique du Sud. « Dans un enfer de violence », reconnaîtra-t-il. Lors de cette tournée historique en Afrique du Sud, un fait d’armes est resté à la postérité. Alors que le XV de France a décroché un match nul méritoire face aux Springboks au Cap (3-3) et qu’il mène (5-9) à quelques minutes de la fin du second match, l’ailier sud-africain John Prinsloo fonce, décalé, vers l’en-but français. Au bout de sa course l’essai promis. Il va sceller la défaite tricolore. Mais surgissant de nulle part, Jeanjean plaque Prinsloo et le sort en touche. L’action est immortalisée par un tableau, dans la salle de réception de l’Ellis Park de Johannesbourg, théâtre de l’exploit français : remporter pour la première fois de son histoire une série de tests en Afrique du Sud ! Sur la fin de sa carrière, c’est à Carcassonne que Jean Barthe et son épouse décideront de s’établir. Il avait longtemps tenu, avec son épouse Denise, le bar « Le Rugby », boulevard de Varsovie à Carcassonne. Son palmarès : champion de France en 1949 ; champion de France senior deuxième série avec Biscarosse, où il débuta ; finaliste du championnat de France en 1955 ; triple champion de France avec Lourdes en 1956, 1957 et 1958 et détenteur du Challenge Yves du Manoir en 1956 ; vingt-six fois international sous le maillot bleu, il est considéré entre 1953 et 1968 comme l’un des meilleurs 3e ligne au monde. Il fut capitaine du XIII de France pendant la Coupe du monde disputée en Angleterre en 1960, soldée par trois échecs : Grande-Bretagne (33-7), Nouvelle-Zélande (9-0), Australie (13-12). Une vie bien remplie pour ce champion, qui restera une figure légendaire à XV et à XIII. Il a fini sa carrière à Saint-Jacques XIII, équipe avec laquelle il remporta en 1972, un ultime titre de champion de France de Nationale 2. Le stade de Villemoustaussou (Aude) porte son nom depuis 2009.
 Jean BARTHE, surnommé « Jeanjean », né le 22 juillet 1932 à Lourdes et mort le 2 décembre 2017 à Villemoustaussou, à l’âge de 85 ans. Il était un athlète (1,90 m, 90kg) comme jamais le XV de France n’en avait connu avant lui. Initié au rugby dans la cour de récréation de l’école primaire, il devint rapidement le premier choix des sélectionneurs à l’aile de la troisième-ligne sous l’ère Jean Prat (1954-1955), puis aux côtés de Lucien Mias (1958-1959), avant d’être nommé capitaine à son tour et de porter le brassard en 1959, face à l’Angleterre à Twickenham, pour un partage des points (3-3). Mais il n’était pas fait pour commander : servir les autres lui convenait parfaitement. 22 fois sélectionné dans l’équipe de France à XIII, avec laquelle il disputa la Coupe du monde en 1960, il reste aujourd’hui encore le seul joueur à avoir été capitaine de la sélection nationale dans les deux codes. Nous sommes dans les années cinquante. Celles du grand Lourdes de Jean Prat, avec lequel il fut champion de France en 1956, 1957 et 1958, enlevant trois Brennus avec les quinzistes lourdais. Rapide, inépuisable, solide à l’impact, à la fois rude défenseur et parfait soutien offensif à l’intérieur de ses trois-quarts, il fut le parfait pendant de « Monsieur Rugby ». En 1959, à 27 ans, en pleine gloire et après seulement 26 sélections en équipe de France, il signera des contrats lucratifs chez les treizistes (Roanne, Saint-Gaudens, Carcassonne), histoire de faire fructifier son renom. Il sera champion de France avec Roanne en 1960, puis avec l’AS Carcassonne en 1966 et 1967. Il remporta aussi la coupe de France : une fois avec Roanne (1962) et deux fois avec l’AS Carcassonne (1967, 1968). Il est considéré, avec Max Rousié, Puig-Aubert et Jean Galia, comme l’un des grands transfuges français du XV au XIII. Sa force herculéenne et sa gueule d’archange, qu’il avait plaisir à se faire cabosser irradiaient tous les terrains. Altruiste, toujours au service du collectif, infatigable quelle que soit la tâche à accomplir, il ne rechignait pas aussi à monter en deuxième-ligne, « dans la cage », pour dépanner et souffrir en silence. A XIII, il passera même pilier. Plus le match était rugueux plus il élevait son niveau de jeu. Ainsi fut-il brave entre tous à Pretoria, en 1958, contre le Northern Transvaal, lors de la tournée du XV de France en Afrique du Sud. « Dans un enfer de violence », reconnaîtra-t-il. Lors de cette tournée historique en Afrique du Sud, un fait d’armes est resté à la postérité. Alors que le XV de France a décroché un match nul méritoire face aux Springboks au Cap (3-3) et qu’il mène (5-9) à quelques minutes de la fin du second match, l’ailier sud-africain John Prinsloo fonce, décalé, vers l’en-but français. Au bout de sa course l’essai promis. Il va sceller la défaite tricolore. Mais surgissant de nulle part, Jeanjean plaque Prinsloo et le sort en touche. L’action est immortalisée par un tableau, dans la salle de réception de l’Ellis Park de Johannesbourg, théâtre de l’exploit français : remporter pour la première fois de son histoire une série de tests en Afrique du Sud ! Sur la fin de sa carrière, c’est à Carcassonne que Jean Barthe et son épouse décideront de s’établir. Il avait longtemps tenu, avec son épouse Denise, le bar « Le Rugby », boulevard de Varsovie à Carcassonne. Son palmarès : champion de France en 1949 ; champion de France senior deuxième série avec Biscarosse, où il débuta ; finaliste du championnat de France en 1955 ; triple champion de France avec Lourdes en 1956, 1957 et 1958 et détenteur du Challenge Yves du Manoir en 1956 ; vingt-six fois international sous le maillot bleu, il est considéré entre 1953 et 1968 comme l’un des meilleurs 3e ligne au monde. Il fut capitaine du XIII de France pendant la Coupe du monde disputée en Angleterre en 1960, soldée par trois échecs : Grande-Bretagne (33-7), Nouvelle-Zélande (9-0), Australie (13-12). Une vie bien remplie pour ce champion, qui restera une figure légendaire à XV et à XIII. Il a fini sa carrière à Saint-Jacques XIII, équipe avec laquelle il remporta en 1972, un ultime titre de champion de France de Nationale 2. Le stade de Villemoustaussou (Aude) porte son nom depuis 2009.
Jean BARTHE, surnommé « Jeanjean », né le 22 juillet 1932 à Lourdes et mort le 2 décembre 2017 à Villemoustaussou, à l’âge de 85 ans. Il était un athlète (1,90 m, 90kg) comme jamais le XV de France n’en avait connu avant lui. Initié au rugby dans la cour de récréation de l’école primaire, il devint rapidement le premier choix des sélectionneurs à l’aile de la troisième-ligne sous l’ère Jean Prat (1954-1955), puis aux côtés de Lucien Mias (1958-1959), avant d’être nommé capitaine à son tour et de porter le brassard en 1959, face à l’Angleterre à Twickenham, pour un partage des points (3-3). Mais il n’était pas fait pour commander : servir les autres lui convenait parfaitement. 22 fois sélectionné dans l’équipe de France à XIII, avec laquelle il disputa la Coupe du monde en 1960, il reste aujourd’hui encore le seul joueur à avoir été capitaine de la sélection nationale dans les deux codes. Nous sommes dans les années cinquante. Celles du grand Lourdes de Jean Prat, avec lequel il fut champion de France en 1956, 1957 et 1958, enlevant trois Brennus avec les quinzistes lourdais. Rapide, inépuisable, solide à l’impact, à la fois rude défenseur et parfait soutien offensif à l’intérieur de ses trois-quarts, il fut le parfait pendant de « Monsieur Rugby ». En 1959, à 27 ans, en pleine gloire et après seulement 26 sélections en équipe de France, il signera des contrats lucratifs chez les treizistes (Roanne, Saint-Gaudens, Carcassonne), histoire de faire fructifier son renom. Il sera champion de France avec Roanne en 1960, puis avec l’AS Carcassonne en 1966 et 1967. Il remporta aussi la coupe de France : une fois avec Roanne (1962) et deux fois avec l’AS Carcassonne (1967, 1968). Il est considéré, avec Max Rousié, Puig-Aubert et Jean Galia, comme l’un des grands transfuges français du XV au XIII. Sa force herculéenne et sa gueule d’archange, qu’il avait plaisir à se faire cabosser irradiaient tous les terrains. Altruiste, toujours au service du collectif, infatigable quelle que soit la tâche à accomplir, il ne rechignait pas aussi à monter en deuxième-ligne, « dans la cage », pour dépanner et souffrir en silence. A XIII, il passera même pilier. Plus le match était rugueux plus il élevait son niveau de jeu. Ainsi fut-il brave entre tous à Pretoria, en 1958, contre le Northern Transvaal, lors de la tournée du XV de France en Afrique du Sud. « Dans un enfer de violence », reconnaîtra-t-il. Lors de cette tournée historique en Afrique du Sud, un fait d’armes est resté à la postérité. Alors que le XV de France a décroché un match nul méritoire face aux Springboks au Cap (3-3) et qu’il mène (5-9) à quelques minutes de la fin du second match, l’ailier sud-africain John Prinsloo fonce, décalé, vers l’en-but français. Au bout de sa course l’essai promis. Il va sceller la défaite tricolore. Mais surgissant de nulle part, Jeanjean plaque Prinsloo et le sort en touche. L’action est immortalisée par un tableau, dans la salle de réception de l’Ellis Park de Johannesbourg, théâtre de l’exploit français : remporter pour la première fois de son histoire une série de tests en Afrique du Sud ! Sur la fin de sa carrière, c’est à Carcassonne que Jean Barthe et son épouse décideront de s’établir. Il avait longtemps tenu, avec son épouse Denise, le bar « Le Rugby », boulevard de Varsovie à Carcassonne. Son palmarès : champion de France en 1949 ; champion de France senior deuxième série avec Biscarosse, où il débuta ; finaliste du championnat de France en 1955 ; triple champion de France avec Lourdes en 1956, 1957 et 1958 et détenteur du Challenge Yves du Manoir en 1956 ; vingt-six fois international sous le maillot bleu, il est considéré entre 1953 et 1968 comme l’un des meilleurs 3e ligne au monde. Il fut capitaine du XIII de France pendant la Coupe du monde disputée en Angleterre en 1960, soldée par trois échecs : Grande-Bretagne (33-7), Nouvelle-Zélande (9-0), Australie (13-12). Une vie bien remplie pour ce champion, qui restera une figure légendaire à XV et à XIII. Il a fini sa carrière à Saint-Jacques XIII, équipe avec laquelle il remporta en 1972, un ultime titre de champion de France de Nationale 2. Le stade de Villemoustaussou (Aude) porte son nom depuis 2009.BILLERES René (1910-2004)
Homme politique - sénateur et député - ministre de l'Éducation nationale
 René BILLERES, né le 29 août 1910 à Ger et décédé le 2 octobre 2004 à Lourdes, à l’âge de 94 ans. Il est le fils de Charles Billères, commis-greffier et de Jeanne Davant, institutrice. Il s’est marié en 1937 avec Marie-Laure Saintourens et eurent une fille, qu'ils appelèrent Françoise. Orphelin de père à l’âge de 12 ans, il ira à l’école primaire à Ger, puis poursuit ses études au lycée de Tarbes, où il est boursier et interne. En 1927, il obtient le deuxième prix de version grecque au Concours général. Il fait une hypokhâgne au lycée de Toulouse en 1929-1930, puis une khâgne au lycée Lakanal à Sceaux, et en 1931, il entre à l’École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Condisciple de Georges Pompidou et de Jacques Soustelle à l’École normale supérieure, il est agrégé de lettres classiques en 1934, puis en 1935, il entame à Mont-de-Marsan et poursuit à Tarbes, une carrière de professeur de lettres que la Libération va interrompre pour le lancer dans l’arène politique sous les couleurs valoisiennes. En 1936, il est candidat aux élections législatives. En 1939, il est mobilisé, blessé et fait prisonnier. Il reste cinq ans dans un camp, à Lübben en Allemagne jusqu’en avril 1945. Député radical-socialiste de la première circonscription des Hautes-Pyrénées à la deuxième Assemblée nationale constituante, puis à l'Assemblée nationale de 1946 à 1973, il préside la Commission de l'Éducation nationale de 1948 à 1954. Il devient ensuite ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports dans plusieurs gouvernements successifs. La suppression des devoirs à domicile fut décidée pendant cette période ainsi que la prolongation de la scolarité obligatoire et la réforme de l'enseignement public qui comporte la revalorisation de l'enseignement technique. Pendant ces années, les moyens de l'Éducation nationale ont augmenté de 50 %. Billères vote l'investiture du général de Gaulle en 1958. En qualité de président du Parti radical-socialiste de 1965 à 1969, il contribue à l'Union de la gauche (première candidature de François Mitterrand à la présidence en 1965, puis fondation de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste). Dans le contre-gouvernement fictif élaboré en 1966 par François Mitterrand, René Billères est présenté comme pouvant être ministre de l'Éducation nationale d'un gouvernement de gauche. Radical de gauche, il est élu au Sénat en 1974 et y siégea jusqu'en 1983 dans le groupe de la Gauche démocratique. Il sera membre de la commission des affaires culturelles et membre de la Formation des sénateurs radicaux de Gauche rattachée administrativement au groupe de la Gauche démocratique. Il est à l’origine de la création en 1956 d’un lycée mixte de plein air à vocation climatique (accueil de jeunes souffrant de problèmes respiratoires ou d’affections asthmatiques) à Argelès-Gazost, sous-préfecture des Hautes-Pyrénées, où il posséda une résidence. En 2006, le lycée climatique fut rebaptisé en son honneur lycée climatique René-Billères (date du cinquantenaire). Ses fonctions gouvernementales seront successivement : secrétaire d'État à la Présidence du Conseil, chargé des relations avec les Assemblées et de la Fonction publique du gouvernement Pierre Mendès France (du 12 novembre 1954 au 23 février 1955) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Guy Mollet (du 1er février au 22 juin 1956) ; ministre d'État de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Guy Mollet (du 22 juin 1956 au 13 juin 1957) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Maurice Bourgès-Maunoury (du 13 juin au 6 novembre 1957) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Félix Gaillard (du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958). Ses mandats locaux seront successivement : député des Hautes-Pyrénées - Radical et radical-socialiste (1946, 1946-1951, 1951-1955, 1956-1958) ; député de la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées (1958-1962, 1962-1967, 1967-1968, 1968-1973) ; sénateur des Hautes-Pyrénées (1974-1983). René Billères était commandeur des Palmes académiques, des Arts et lettres et du Mérite sportif, Croix de guerre 1939-1945, et chevalier de la Légion d'honneur. Il fut un catholique pratiquant et, en politique, un laïque fervent, avec une morale rigoureuse, une intelligence claire et une extrême sensibilité. Ses partenaires de la Fédération de la Gauche vantent sa loyauté, sa lucidité et son courage. Parmi les autres mesures novatrices à son actif dans l’enseignement, on notera celle de la suppression de l’examen d’entrée en 6ème et la création d’un examen spécial d’entrée en Faculté pour les non-bacheliers, qui sont toujours en vigueur. Il aura semé des idées qui ont germé, lancé des formules qui ont été reprises et mises en œuvre par ses successeurs comme Alain Peyrefitte, ministre de l'Éducation nationale (1967-1968). Il sera candidat malheureux en 1961 à la présidence du Parti radical contre Maurice Faure. Quarante ans de vie militante, plus de vingt ans de mandat parlementaire et de responsabilités. Cependant il ne sera jamais un notable local, ni maire, ni conseiller général. En 1959, il échoue à conquérir la mairie de Tarbes, et en 1967, à récupérer le siège de conseiller général de Lannemezan, après la mort du docteur Baratgin. Le 14 mai 1983, il annonce son retrait définitif de la politique, et abandonne en septembre suivant son siège de sénateur à François Abadie. A compter de sa retraite, il ne livre que de rares témoignages sur sa longue carrière politique, et s'éteint le 2 octobre 2004. Il a été inhumé dans le cimetière de son village natal de Ger.
René BILLERES, né le 29 août 1910 à Ger et décédé le 2 octobre 2004 à Lourdes, à l’âge de 94 ans. Il est le fils de Charles Billères, commis-greffier et de Jeanne Davant, institutrice. Il s’est marié en 1937 avec Marie-Laure Saintourens et eurent une fille, qu'ils appelèrent Françoise. Orphelin de père à l’âge de 12 ans, il ira à l’école primaire à Ger, puis poursuit ses études au lycée de Tarbes, où il est boursier et interne. En 1927, il obtient le deuxième prix de version grecque au Concours général. Il fait une hypokhâgne au lycée de Toulouse en 1929-1930, puis une khâgne au lycée Lakanal à Sceaux, et en 1931, il entre à l’École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Condisciple de Georges Pompidou et de Jacques Soustelle à l’École normale supérieure, il est agrégé de lettres classiques en 1934, puis en 1935, il entame à Mont-de-Marsan et poursuit à Tarbes, une carrière de professeur de lettres que la Libération va interrompre pour le lancer dans l’arène politique sous les couleurs valoisiennes. En 1936, il est candidat aux élections législatives. En 1939, il est mobilisé, blessé et fait prisonnier. Il reste cinq ans dans un camp, à Lübben en Allemagne jusqu’en avril 1945. Député radical-socialiste de la première circonscription des Hautes-Pyrénées à la deuxième Assemblée nationale constituante, puis à l'Assemblée nationale de 1946 à 1973, il préside la Commission de l'Éducation nationale de 1948 à 1954. Il devient ensuite ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports dans plusieurs gouvernements successifs. La suppression des devoirs à domicile fut décidée pendant cette période ainsi que la prolongation de la scolarité obligatoire et la réforme de l'enseignement public qui comporte la revalorisation de l'enseignement technique. Pendant ces années, les moyens de l'Éducation nationale ont augmenté de 50 %. Billères vote l'investiture du général de Gaulle en 1958. En qualité de président du Parti radical-socialiste de 1965 à 1969, il contribue à l'Union de la gauche (première candidature de François Mitterrand à la présidence en 1965, puis fondation de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste). Dans le contre-gouvernement fictif élaboré en 1966 par François Mitterrand, René Billères est présenté comme pouvant être ministre de l'Éducation nationale d'un gouvernement de gauche. Radical de gauche, il est élu au Sénat en 1974 et y siégea jusqu'en 1983 dans le groupe de la Gauche démocratique. Il sera membre de la commission des affaires culturelles et membre de la Formation des sénateurs radicaux de Gauche rattachée administrativement au groupe de la Gauche démocratique. Il est à l’origine de la création en 1956 d’un lycée mixte de plein air à vocation climatique (accueil de jeunes souffrant de problèmes respiratoires ou d’affections asthmatiques) à Argelès-Gazost, sous-préfecture des Hautes-Pyrénées, où il posséda une résidence. En 2006, le lycée climatique fut rebaptisé en son honneur lycée climatique René-Billères (date du cinquantenaire). Ses fonctions gouvernementales seront successivement : secrétaire d'État à la Présidence du Conseil, chargé des relations avec les Assemblées et de la Fonction publique du gouvernement Pierre Mendès France (du 12 novembre 1954 au 23 février 1955) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Guy Mollet (du 1er février au 22 juin 1956) ; ministre d'État de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Guy Mollet (du 22 juin 1956 au 13 juin 1957) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Maurice Bourgès-Maunoury (du 13 juin au 6 novembre 1957) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Félix Gaillard (du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958). Ses mandats locaux seront successivement : député des Hautes-Pyrénées - Radical et radical-socialiste (1946, 1946-1951, 1951-1955, 1956-1958) ; député de la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées (1958-1962, 1962-1967, 1967-1968, 1968-1973) ; sénateur des Hautes-Pyrénées (1974-1983). René Billères était commandeur des Palmes académiques, des Arts et lettres et du Mérite sportif, Croix de guerre 1939-1945, et chevalier de la Légion d'honneur. Il fut un catholique pratiquant et, en politique, un laïque fervent, avec une morale rigoureuse, une intelligence claire et une extrême sensibilité. Ses partenaires de la Fédération de la Gauche vantent sa loyauté, sa lucidité et son courage. Parmi les autres mesures novatrices à son actif dans l’enseignement, on notera celle de la suppression de l’examen d’entrée en 6ème et la création d’un examen spécial d’entrée en Faculté pour les non-bacheliers, qui sont toujours en vigueur. Il aura semé des idées qui ont germé, lancé des formules qui ont été reprises et mises en œuvre par ses successeurs comme Alain Peyrefitte, ministre de l'Éducation nationale (1967-1968). Il sera candidat malheureux en 1961 à la présidence du Parti radical contre Maurice Faure. Quarante ans de vie militante, plus de vingt ans de mandat parlementaire et de responsabilités. Cependant il ne sera jamais un notable local, ni maire, ni conseiller général. En 1959, il échoue à conquérir la mairie de Tarbes, et en 1967, à récupérer le siège de conseiller général de Lannemezan, après la mort du docteur Baratgin. Le 14 mai 1983, il annonce son retrait définitif de la politique, et abandonne en septembre suivant son siège de sénateur à François Abadie. A compter de sa retraite, il ne livre que de rares témoignages sur sa longue carrière politique, et s'éteint le 2 octobre 2004. Il a été inhumé dans le cimetière de son village natal de Ger.
 René BILLERES, né le 29 août 1910 à Ger et décédé le 2 octobre 2004 à Lourdes, à l’âge de 94 ans. Il est le fils de Charles Billères, commis-greffier et de Jeanne Davant, institutrice. Il s’est marié en 1937 avec Marie-Laure Saintourens et eurent une fille, qu'ils appelèrent Françoise. Orphelin de père à l’âge de 12 ans, il ira à l’école primaire à Ger, puis poursuit ses études au lycée de Tarbes, où il est boursier et interne. En 1927, il obtient le deuxième prix de version grecque au Concours général. Il fait une hypokhâgne au lycée de Toulouse en 1929-1930, puis une khâgne au lycée Lakanal à Sceaux, et en 1931, il entre à l’École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Condisciple de Georges Pompidou et de Jacques Soustelle à l’École normale supérieure, il est agrégé de lettres classiques en 1934, puis en 1935, il entame à Mont-de-Marsan et poursuit à Tarbes, une carrière de professeur de lettres que la Libération va interrompre pour le lancer dans l’arène politique sous les couleurs valoisiennes. En 1936, il est candidat aux élections législatives. En 1939, il est mobilisé, blessé et fait prisonnier. Il reste cinq ans dans un camp, à Lübben en Allemagne jusqu’en avril 1945. Député radical-socialiste de la première circonscription des Hautes-Pyrénées à la deuxième Assemblée nationale constituante, puis à l'Assemblée nationale de 1946 à 1973, il préside la Commission de l'Éducation nationale de 1948 à 1954. Il devient ensuite ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports dans plusieurs gouvernements successifs. La suppression des devoirs à domicile fut décidée pendant cette période ainsi que la prolongation de la scolarité obligatoire et la réforme de l'enseignement public qui comporte la revalorisation de l'enseignement technique. Pendant ces années, les moyens de l'Éducation nationale ont augmenté de 50 %. Billères vote l'investiture du général de Gaulle en 1958. En qualité de président du Parti radical-socialiste de 1965 à 1969, il contribue à l'Union de la gauche (première candidature de François Mitterrand à la présidence en 1965, puis fondation de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste). Dans le contre-gouvernement fictif élaboré en 1966 par François Mitterrand, René Billères est présenté comme pouvant être ministre de l'Éducation nationale d'un gouvernement de gauche. Radical de gauche, il est élu au Sénat en 1974 et y siégea jusqu'en 1983 dans le groupe de la Gauche démocratique. Il sera membre de la commission des affaires culturelles et membre de la Formation des sénateurs radicaux de Gauche rattachée administrativement au groupe de la Gauche démocratique. Il est à l’origine de la création en 1956 d’un lycée mixte de plein air à vocation climatique (accueil de jeunes souffrant de problèmes respiratoires ou d’affections asthmatiques) à Argelès-Gazost, sous-préfecture des Hautes-Pyrénées, où il posséda une résidence. En 2006, le lycée climatique fut rebaptisé en son honneur lycée climatique René-Billères (date du cinquantenaire). Ses fonctions gouvernementales seront successivement : secrétaire d'État à la Présidence du Conseil, chargé des relations avec les Assemblées et de la Fonction publique du gouvernement Pierre Mendès France (du 12 novembre 1954 au 23 février 1955) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Guy Mollet (du 1er février au 22 juin 1956) ; ministre d'État de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Guy Mollet (du 22 juin 1956 au 13 juin 1957) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Maurice Bourgès-Maunoury (du 13 juin au 6 novembre 1957) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Félix Gaillard (du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958). Ses mandats locaux seront successivement : député des Hautes-Pyrénées - Radical et radical-socialiste (1946, 1946-1951, 1951-1955, 1956-1958) ; député de la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées (1958-1962, 1962-1967, 1967-1968, 1968-1973) ; sénateur des Hautes-Pyrénées (1974-1983). René Billères était commandeur des Palmes académiques, des Arts et lettres et du Mérite sportif, Croix de guerre 1939-1945, et chevalier de la Légion d'honneur. Il fut un catholique pratiquant et, en politique, un laïque fervent, avec une morale rigoureuse, une intelligence claire et une extrême sensibilité. Ses partenaires de la Fédération de la Gauche vantent sa loyauté, sa lucidité et son courage. Parmi les autres mesures novatrices à son actif dans l’enseignement, on notera celle de la suppression de l’examen d’entrée en 6ème et la création d’un examen spécial d’entrée en Faculté pour les non-bacheliers, qui sont toujours en vigueur. Il aura semé des idées qui ont germé, lancé des formules qui ont été reprises et mises en œuvre par ses successeurs comme Alain Peyrefitte, ministre de l'Éducation nationale (1967-1968). Il sera candidat malheureux en 1961 à la présidence du Parti radical contre Maurice Faure. Quarante ans de vie militante, plus de vingt ans de mandat parlementaire et de responsabilités. Cependant il ne sera jamais un notable local, ni maire, ni conseiller général. En 1959, il échoue à conquérir la mairie de Tarbes, et en 1967, à récupérer le siège de conseiller général de Lannemezan, après la mort du docteur Baratgin. Le 14 mai 1983, il annonce son retrait définitif de la politique, et abandonne en septembre suivant son siège de sénateur à François Abadie. A compter de sa retraite, il ne livre que de rares témoignages sur sa longue carrière politique, et s'éteint le 2 octobre 2004. Il a été inhumé dans le cimetière de son village natal de Ger.
René BILLERES, né le 29 août 1910 à Ger et décédé le 2 octobre 2004 à Lourdes, à l’âge de 94 ans. Il est le fils de Charles Billères, commis-greffier et de Jeanne Davant, institutrice. Il s’est marié en 1937 avec Marie-Laure Saintourens et eurent une fille, qu'ils appelèrent Françoise. Orphelin de père à l’âge de 12 ans, il ira à l’école primaire à Ger, puis poursuit ses études au lycée de Tarbes, où il est boursier et interne. En 1927, il obtient le deuxième prix de version grecque au Concours général. Il fait une hypokhâgne au lycée de Toulouse en 1929-1930, puis une khâgne au lycée Lakanal à Sceaux, et en 1931, il entre à l’École normale supérieure de la rue d'Ulm à Paris. Condisciple de Georges Pompidou et de Jacques Soustelle à l’École normale supérieure, il est agrégé de lettres classiques en 1934, puis en 1935, il entame à Mont-de-Marsan et poursuit à Tarbes, une carrière de professeur de lettres que la Libération va interrompre pour le lancer dans l’arène politique sous les couleurs valoisiennes. En 1936, il est candidat aux élections législatives. En 1939, il est mobilisé, blessé et fait prisonnier. Il reste cinq ans dans un camp, à Lübben en Allemagne jusqu’en avril 1945. Député radical-socialiste de la première circonscription des Hautes-Pyrénées à la deuxième Assemblée nationale constituante, puis à l'Assemblée nationale de 1946 à 1973, il préside la Commission de l'Éducation nationale de 1948 à 1954. Il devient ensuite ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports dans plusieurs gouvernements successifs. La suppression des devoirs à domicile fut décidée pendant cette période ainsi que la prolongation de la scolarité obligatoire et la réforme de l'enseignement public qui comporte la revalorisation de l'enseignement technique. Pendant ces années, les moyens de l'Éducation nationale ont augmenté de 50 %. Billères vote l'investiture du général de Gaulle en 1958. En qualité de président du Parti radical-socialiste de 1965 à 1969, il contribue à l'Union de la gauche (première candidature de François Mitterrand à la présidence en 1965, puis fondation de la Fédération de la gauche démocrate et socialiste). Dans le contre-gouvernement fictif élaboré en 1966 par François Mitterrand, René Billères est présenté comme pouvant être ministre de l'Éducation nationale d'un gouvernement de gauche. Radical de gauche, il est élu au Sénat en 1974 et y siégea jusqu'en 1983 dans le groupe de la Gauche démocratique. Il sera membre de la commission des affaires culturelles et membre de la Formation des sénateurs radicaux de Gauche rattachée administrativement au groupe de la Gauche démocratique. Il est à l’origine de la création en 1956 d’un lycée mixte de plein air à vocation climatique (accueil de jeunes souffrant de problèmes respiratoires ou d’affections asthmatiques) à Argelès-Gazost, sous-préfecture des Hautes-Pyrénées, où il posséda une résidence. En 2006, le lycée climatique fut rebaptisé en son honneur lycée climatique René-Billères (date du cinquantenaire). Ses fonctions gouvernementales seront successivement : secrétaire d'État à la Présidence du Conseil, chargé des relations avec les Assemblées et de la Fonction publique du gouvernement Pierre Mendès France (du 12 novembre 1954 au 23 février 1955) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Guy Mollet (du 1er février au 22 juin 1956) ; ministre d'État de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Guy Mollet (du 22 juin 1956 au 13 juin 1957) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Maurice Bourgès-Maunoury (du 13 juin au 6 novembre 1957) ; ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports du gouvernement Félix Gaillard (du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958). Ses mandats locaux seront successivement : député des Hautes-Pyrénées - Radical et radical-socialiste (1946, 1946-1951, 1951-1955, 1956-1958) ; député de la 1ère circonscription des Hautes-Pyrénées (1958-1962, 1962-1967, 1967-1968, 1968-1973) ; sénateur des Hautes-Pyrénées (1974-1983). René Billères était commandeur des Palmes académiques, des Arts et lettres et du Mérite sportif, Croix de guerre 1939-1945, et chevalier de la Légion d'honneur. Il fut un catholique pratiquant et, en politique, un laïque fervent, avec une morale rigoureuse, une intelligence claire et une extrême sensibilité. Ses partenaires de la Fédération de la Gauche vantent sa loyauté, sa lucidité et son courage. Parmi les autres mesures novatrices à son actif dans l’enseignement, on notera celle de la suppression de l’examen d’entrée en 6ème et la création d’un examen spécial d’entrée en Faculté pour les non-bacheliers, qui sont toujours en vigueur. Il aura semé des idées qui ont germé, lancé des formules qui ont été reprises et mises en œuvre par ses successeurs comme Alain Peyrefitte, ministre de l'Éducation nationale (1967-1968). Il sera candidat malheureux en 1961 à la présidence du Parti radical contre Maurice Faure. Quarante ans de vie militante, plus de vingt ans de mandat parlementaire et de responsabilités. Cependant il ne sera jamais un notable local, ni maire, ni conseiller général. En 1959, il échoue à conquérir la mairie de Tarbes, et en 1967, à récupérer le siège de conseiller général de Lannemezan, après la mort du docteur Baratgin. Le 14 mai 1983, il annonce son retrait définitif de la politique, et abandonne en septembre suivant son siège de sénateur à François Abadie. A compter de sa retraite, il ne livre que de rares témoignages sur sa longue carrière politique, et s'éteint le 2 octobre 2004. Il a été inhumé dans le cimetière de son village natal de Ger.BLANC Christian (1942-XXXX)
Homme politique, chef d’entreprise, préfet des Hautes-Pyrénées
 Christian BLANC, né le 17 mai 1942 à Talence en Gironde, est un haut fonctionnaire, chef d'entreprise et homme politique français. Il effectue ses études à Bordeaux, au lycée Montesquieu, puis intègre l'Institut d'études politiques (IAE) de Bordeaux. Il est préfet des Hautes-Pyrénées en 1983 et préfet de Seine-et-Marne en 1985, puis il est l’artisan en 1988 de la mission du dialogue en Nouvelle-Calédonie, qui se conclut par les accords de Matignon. Il a travaillé dans le monde de l'entreprise, dirigeant la RATP de 1989 à 1992, Air France de 1993 à 1997, qu'il sauve de la faillite et la banque Merrill Lynch France de 2000 à 2002. Il fut également administrateur de Middle East Airlines (1998-1999), de Carrefour, de Capgemini (2004), de la Chancellerie des Universités de Paris (1998-2001), d'Action contre la faim (ACF) et président du Comité de sélection pour le recrutement d'inspecteurs des finances au tour extérieur (2000). Proche de Michel Rocard, et d'Edgard Pisani, il fonda en 2001 le think tank "l’Ami public " et en 2002, le mouvement politique Énergies démocrates (2002-2007). En 2002, il est élu député apparenté UDF de la 3e circonscription des Yvelines. Il rejoint le groupe parlementaire Nouveau Centre de 2002 à 2008. Réélu député en 2007, celui que l'on a surnommé « l'homme des missions impossibles » entre au gouvernement le 18 mars 2008 comme secrétaire d’État chargé du Développement de la région capitale, et travaille sur le Grand Paris. À la demande de Nicolas Sarkozy et François Fillon, il annonce sa démission du gouvernement le 4 juillet 2010. Après deux mandats de député, il ne se représente pas une troisième fois. En septembre 2014, la compagnie aérienne tunisienne Syphax Airlines recrute Christian Blanc au poste de PDG, dont il démissionne deux mois plus tard. En 2015, il publie aux Éditions Odile Jacob "Paris Ville monde", un livre dans lequel il explique sa stratégie pour permettre à la France de retrouver sa place dans l'économie mondiale. Présent au World Trade Center de New York le 11 septembre 2001, il échappa aux attentats, car il était sorti fumer un cigare hors du bâtiment.
Christian BLANC, né le 17 mai 1942 à Talence en Gironde, est un haut fonctionnaire, chef d'entreprise et homme politique français. Il effectue ses études à Bordeaux, au lycée Montesquieu, puis intègre l'Institut d'études politiques (IAE) de Bordeaux. Il est préfet des Hautes-Pyrénées en 1983 et préfet de Seine-et-Marne en 1985, puis il est l’artisan en 1988 de la mission du dialogue en Nouvelle-Calédonie, qui se conclut par les accords de Matignon. Il a travaillé dans le monde de l'entreprise, dirigeant la RATP de 1989 à 1992, Air France de 1993 à 1997, qu'il sauve de la faillite et la banque Merrill Lynch France de 2000 à 2002. Il fut également administrateur de Middle East Airlines (1998-1999), de Carrefour, de Capgemini (2004), de la Chancellerie des Universités de Paris (1998-2001), d'Action contre la faim (ACF) et président du Comité de sélection pour le recrutement d'inspecteurs des finances au tour extérieur (2000). Proche de Michel Rocard, et d'Edgard Pisani, il fonda en 2001 le think tank "l’Ami public " et en 2002, le mouvement politique Énergies démocrates (2002-2007). En 2002, il est élu député apparenté UDF de la 3e circonscription des Yvelines. Il rejoint le groupe parlementaire Nouveau Centre de 2002 à 2008. Réélu député en 2007, celui que l'on a surnommé « l'homme des missions impossibles » entre au gouvernement le 18 mars 2008 comme secrétaire d’État chargé du Développement de la région capitale, et travaille sur le Grand Paris. À la demande de Nicolas Sarkozy et François Fillon, il annonce sa démission du gouvernement le 4 juillet 2010. Après deux mandats de député, il ne se représente pas une troisième fois. En septembre 2014, la compagnie aérienne tunisienne Syphax Airlines recrute Christian Blanc au poste de PDG, dont il démissionne deux mois plus tard. En 2015, il publie aux Éditions Odile Jacob "Paris Ville monde", un livre dans lequel il explique sa stratégie pour permettre à la France de retrouver sa place dans l'économie mondiale. Présent au World Trade Center de New York le 11 septembre 2001, il échappa aux attentats, car il était sorti fumer un cigare hors du bâtiment.
 Christian BLANC, né le 17 mai 1942 à Talence en Gironde, est un haut fonctionnaire, chef d'entreprise et homme politique français. Il effectue ses études à Bordeaux, au lycée Montesquieu, puis intègre l'Institut d'études politiques (IAE) de Bordeaux. Il est préfet des Hautes-Pyrénées en 1983 et préfet de Seine-et-Marne en 1985, puis il est l’artisan en 1988 de la mission du dialogue en Nouvelle-Calédonie, qui se conclut par les accords de Matignon. Il a travaillé dans le monde de l'entreprise, dirigeant la RATP de 1989 à 1992, Air France de 1993 à 1997, qu'il sauve de la faillite et la banque Merrill Lynch France de 2000 à 2002. Il fut également administrateur de Middle East Airlines (1998-1999), de Carrefour, de Capgemini (2004), de la Chancellerie des Universités de Paris (1998-2001), d'Action contre la faim (ACF) et président du Comité de sélection pour le recrutement d'inspecteurs des finances au tour extérieur (2000). Proche de Michel Rocard, et d'Edgard Pisani, il fonda en 2001 le think tank "l’Ami public " et en 2002, le mouvement politique Énergies démocrates (2002-2007). En 2002, il est élu député apparenté UDF de la 3e circonscription des Yvelines. Il rejoint le groupe parlementaire Nouveau Centre de 2002 à 2008. Réélu député en 2007, celui que l'on a surnommé « l'homme des missions impossibles » entre au gouvernement le 18 mars 2008 comme secrétaire d’État chargé du Développement de la région capitale, et travaille sur le Grand Paris. À la demande de Nicolas Sarkozy et François Fillon, il annonce sa démission du gouvernement le 4 juillet 2010. Après deux mandats de député, il ne se représente pas une troisième fois. En septembre 2014, la compagnie aérienne tunisienne Syphax Airlines recrute Christian Blanc au poste de PDG, dont il démissionne deux mois plus tard. En 2015, il publie aux Éditions Odile Jacob "Paris Ville monde", un livre dans lequel il explique sa stratégie pour permettre à la France de retrouver sa place dans l'économie mondiale. Présent au World Trade Center de New York le 11 septembre 2001, il échappa aux attentats, car il était sorti fumer un cigare hors du bâtiment.
Christian BLANC, né le 17 mai 1942 à Talence en Gironde, est un haut fonctionnaire, chef d'entreprise et homme politique français. Il effectue ses études à Bordeaux, au lycée Montesquieu, puis intègre l'Institut d'études politiques (IAE) de Bordeaux. Il est préfet des Hautes-Pyrénées en 1983 et préfet de Seine-et-Marne en 1985, puis il est l’artisan en 1988 de la mission du dialogue en Nouvelle-Calédonie, qui se conclut par les accords de Matignon. Il a travaillé dans le monde de l'entreprise, dirigeant la RATP de 1989 à 1992, Air France de 1993 à 1997, qu'il sauve de la faillite et la banque Merrill Lynch France de 2000 à 2002. Il fut également administrateur de Middle East Airlines (1998-1999), de Carrefour, de Capgemini (2004), de la Chancellerie des Universités de Paris (1998-2001), d'Action contre la faim (ACF) et président du Comité de sélection pour le recrutement d'inspecteurs des finances au tour extérieur (2000). Proche de Michel Rocard, et d'Edgard Pisani, il fonda en 2001 le think tank "l’Ami public " et en 2002, le mouvement politique Énergies démocrates (2002-2007). En 2002, il est élu député apparenté UDF de la 3e circonscription des Yvelines. Il rejoint le groupe parlementaire Nouveau Centre de 2002 à 2008. Réélu député en 2007, celui que l'on a surnommé « l'homme des missions impossibles » entre au gouvernement le 18 mars 2008 comme secrétaire d’État chargé du Développement de la région capitale, et travaille sur le Grand Paris. À la demande de Nicolas Sarkozy et François Fillon, il annonce sa démission du gouvernement le 4 juillet 2010. Après deux mandats de député, il ne se représente pas une troisième fois. En septembre 2014, la compagnie aérienne tunisienne Syphax Airlines recrute Christian Blanc au poste de PDG, dont il démissionne deux mois plus tard. En 2015, il publie aux Éditions Odile Jacob "Paris Ville monde", un livre dans lequel il explique sa stratégie pour permettre à la France de retrouver sa place dans l'économie mondiale. Présent au World Trade Center de New York le 11 septembre 2001, il échappa aux attentats, car il était sorti fumer un cigare hors du bâtiment.BLÉRIOT Louis (1872-1936)
Ingénieur, inventeur, constructeur d’avions et avant tout premier aviateur à avoir traversé la Manche en aéroplane le 25 juillet 1909 à bord du Blériot XI, Bigourdan par alliance
 Louis Charles Joseph BLÉRIOT, né le 1er juillet 1872 à Cambrai et mort subitement le 1er août 1936 à Paris, à l’âge de 64 ans, est un constructeur de lanternes d’automobiles, d’avions, de motocyclettes et de chars à voile, et un pilote précurseur et pionnier de l’aviation française. À ses débuts, comme ingénieur diplômé de l’École Centrale des Arts et Manufactures (promotion 1895), il entre chez Baguès, une société d’ingénierie électrique à Paris, puis effectue son service militaire dans l’artillerie à Tarbes au 24e régiment d’artillerie comme sous-lieutenant puis lieutenant de réserve au 36e régiment d’artillerie. Les Établissements Louis Blériot, qu’il a créés en 1903, connaissent un succès certain dans la fabrication de phares à acétylène pour l’industrie automobile alors en pleine expansion. On lui doit l’appellation « phare » pour les éclairages de voitures. Et après avoir fait fortune dans les phares pour automobiles, entre 1905 et 1909, il se lance dans la grande aventure aéronautique et produit une série de 11 prototypes : le Blériot I, le Blériot II, le Blériot III … jusqu’au Blériot XI, qui est celui de la traversée de la Manche. Après plusieurs années de recherches et pas mal de casse, il est parvenu à réaliser un aéroplane léger, solide et fiable. Le Blériot XI est un appareil monoplan à fuselage partiellement entoilé, long de 8 mètres, avec une envergure de 7,20 mètres et qui pèse 310 kilogrammes. Son hélice Chauvière bipale est entraînée par un moteur Anzani à trois cylindres en étoile développant 25ch. Répondant au défi lancé en 1908 par le Daily Mail (journal britannique), Blériot se lance dans l’aventure de la première traversée de la Manche, Et voilà comment, le 25 juillet 1909, Louis Blériot et Hubert Latham, deux pionniers français de l’aviation, se retrouvent au petit matin, prêts à partir de Calais pour une course aérienne France-Angleterre. Et c’est Latham qui paraît avoir les meilleures chances de remporter le pactole de 1000 livres du Daily Mail. Mais, Hubert Latham, son concurrent direct, est victime d’une panne, et c’est Blériot qui gagne (suite à des problèmes techniques, Latham ne réussira à décoller que le 27 juillet avant d’échouer à 500 mètres du but). C’est à Pau que Louis Blériot s’est préparé à ce grand exploit et après un dernier vol d’essai de 11 minutes effectué à 4h15 du matin au-dessus des Baraques, le 25 juillet 1909, le temps semble idéal, Le vent est tombé durant la nuit, et à 4h41 du matin, Louis Blériot s’envole pour l’Angleterre. Très vite, à 4h48, il dépasse le contre-torpilleur accompagnateur Escopette, où son épouse se trouve à bord, guettant son mari dans les airs avec ses jumelles, et 37 minutes après et 35 kilomètres de vol, la Manche est traversée. Ce qui donne une vitesse moyenne d’environ 57 km/h à une altitude de vol de 100 mètres. Ainsi, ce 25 juillet 1909, Louis Blériot est le premier à traverser la Manche par les airs, en décollant au lever du soleil, condition exigée par le Daily Mail, qui est à l’origine du défi et qui lui remettra la somme de 25.000 Francs-or mise en jeu. Malgré une blessure au pied, et ne sachant pas nager, il effectue la traversée, ralliant le lieu-dit Les Baraques près de Calais à Douvres en Angleterre, aux commandes du Blériot XI qu’il a conçu en collaboration avec Raymond Saulnier. La visibilité étant moyenne au départ, il s’oriente sans boussole en s’aidant de la trajectoire des bateaux reliant la France et la Grande-Bretagne, avant de pouvoir distinguer les falaises près de Douvres. La puissance de son moteur lui permet à peine de monter plus haut que ces dernières. Après un virage vers l’est, il revient à l’ouest pour finalement trouver le champ et atterrir sur les côtes anglaises, où l’attend le journaliste français Charles Fontaine muni d’un grand drapeau tricolore qu’il agite, et son photographe Marcel Marmier. À 5h12, après un virage, c’est chose faite : Blériot coupe le moteur sur le sol anglais. En une trentaine de minutes, la traversée a été réalisée mais fidèle à son habitude, Louis Blériot endommage le train de son appareil à l’atterrissage et une pale de l’hélice a été brisée, mais Blériot est sorti indemne. Désormais l’Angleterre n’est plus une île ! La Manche venait d’être vaincue par un plus lourd que l’air. La capitale britannique salue l’exploit de Louis Blériot, devenu mondialement célèbre, avant son retour en France. Un vol qui fera sa gloire, abondamment relayé par la presse de l’époque. Les jours qui suivent ne seront qu’honneurs, réceptions et fêtes. L’événement a un retentissement mondial. Pour Blériot, c’était la consécration mais aussi le soulagement car depuis quelques années, il avait dépensé la quasi-totalité de sa fortune pour concevoir et construire une dizaine de prototypes aux destins plus ou moins heureux. Cette réussite va le propulser et lui éviter la faillite. Du jour au lendemain, les commandes de son Blériot XI affluent du monde entier et l’armée commence sérieusement à s’intéresser à ce nouveau mode de déplacement. La traversée de la Manche réussie, le fidèle Alfred Leblanc lui avance les fonds pour lancer rapidement la fabrication en série du modèle de cette traversée. L’ingénieur va se lancer dans la production, s’installant sur le terrain de Buc, en région parisienne, non loin de Toussus-le-Noble. Après son exploit, le 24 novembre 1909, Blériot crée une école de pilotage à Pau (dont le plus prestigieux élève fut Guynemer) qui fonctionnera jusqu’en novembre 1913. Ville choisie à cause de sa situation tout à fait exceptionnelle et parce qu’il y règne une température idéale, et qu’il a connue lors de son service militaire à Tarbes, et où il s’est marié non loin à Bagnères. Le terrain qu’il choisit est situé sur les landes de Pont-Long à 10 km au nord de Pau, à Lescar. C’est un terrain vague à peu près rectangulaire, long de 1800 mètres et large de 500 mètres environ, couvert d’ajoncs, d’où les eaux s’écoulaient vers le nord-ouest. Il y avait jalonné une ligne médiane via deux pylônes espacés de 1250 mètres, et dégagé, entre cette médiane et les limites du terrain, une piste large de 100 mètres devant les hangars, réduite à 25 mètres vers les extrémités et se refermant sur elle-même en contournant les pylônes. Après l’exploit qui le rendit célèbre dans le monde entier, Blériot participe à la Grande Semaine d’Aviation de la Champagne fin août 1909. Le 28 août 1909, il bat le record du monde de vitesse au Meeting de Champagne à Reims, sur Blériot XI. Le 7 octobre 1909, le gouvernement décide de décerner à 16 pionniers de l’aviation un brevet de pilote. La délivrance de ces brevets est effectuée par ordre alphabétique et Louis Blériot bénéficie ainsi au brevet n°1. L’instauration du brevet de pilote intervient le 1er janvier 1910. Le 10 octobre 1909, Louis Blériot fonde la Compagnie Générale Transaérienne (CGT). Le 30 octobre 1909, le Français Louis Blériot effectue le premier vol en avion à Bucarest en Roumanie. L’appareil avec lequel il avait accompli son exploit, et qui portait désormais le nom de Calais-Douvres, fut cédé au journal Le Matin pour la somme de 10.000 Francs représentant son prix de construction. Le 13 octobre 1909, le journal Le Matin offre cet aéroplane au Conservatoire des arts et métiers qu’il n’a depuis jamais quitté. La carrière de Blériot en tant que pilote se termina, en décembre 1909, d’une façon assez tragique. Au cours d’une démonstration sur le Blériot XII, exécutée à Constantinople, il se trouva pris dans de violentes rafales de vent, qui le plaquèrent au sol. Le pionnier français victime de son 32e accident (accidents qui lui ont valu le surnom de « roi de la casse » ou « l’homme qui tombe toujours » par la presse), s’en tira avec quelques côtes enfoncées et de nombreuses contusions. Sa décision était prise. Désormais, il ne volera plus que sporadiquement pour se concentrer sur le développement et l’industrialisation de ses machines. En août 1914, Louis Blériot et d’autres industriels reprennent les actifs de la Société de Production des Avions Déperdussin (SPAD), tombée en faillite, pour en faire la Société Pour l’Aviation et ses Dérivés (SPAD). L’ingénieur en charge du bureau d’études, Louis Béchereau, développera plusieurs avions de chasse dont les fameux SPAD S.VII et SPAD S.XIII qui équiperont un grand nombre d’escadrilles françaises. En 1917, les Établissements Blériot aéronautique et SPAD assurent 10% de la production d’avions en France. Blériot achète des sites industriels hors de Paris comme à Suresnes. Pendant la guerre, ce sont des milliers d’avions qui sortiront des ateliers Blériot de Suresnes et, en particulier, plus de 11.000 chasseurs SPAD, essentiellement dotés de moteurs Gnome et Rhône. Blériot devient le banquier de ses sociétés et fait des placements considérables dans l’industrie des loisirs, en particulier à Monte-Carlo. Louis Blériot devient donc un important industriel dans le domaine aéronautique, avec ses usines à Suresnes. Après la guerre, il se lance dans la fabrication de motos, avec un succès très mitigé. Il continue de fabriquer des avions, les avions SPAD, mais comptant sur les commandes de l’État, lequel révisa le contrat à la baisse, Blériot dû bientôt fermer ses usines. En 1936, le gouvernement nationalise les usines Blériot. La Société Blériot aéronautique est absorbée par la Société Nationale des Constructions Aéronautiques du Sud-Ouest (SNCASO). Louis Blériot ne supporta pas cette décision et cinq jours après la date effective, terrassé par le chagrin, il meurt précocement le 1er août 1936, à son domicile au 288, boulevard Saint-Germain, emporté par une crise cardiaque. La France rendra hommage à l’homme de la traversée de la Manche par des funérailles nationales le 5 août 1936, en l’église Saint-Louis des Invalides. Les honneurs militaires lui seront rendus par un détachement du 34e régiment d’Aviation du Bourget. L’éloge funèbre étant prononcé par le ministre de l’Air, Pierre Cot. Il sera inhumé au cimetière des Gonards à Versailles, dans le caveau de famille. Parmi ces nombreux « fous volants » de l’époque, qui éblouissaient le public, en particulier en France, Blériot se distingue comme le « père de l’aéronautique ». Ayant fait fortune en inventant les phares pour permettre aux automobiles de rouler la nuit, il aura réinvesti tous ses bénéfices dans des prototypes qu’il améliore avec le « manche à balai ». Blériot est à l’origine de la « cloche », ancêtre du manche à balai centralisant les commandes et permettant de contrôler l’altitude et le cap de l’avion. Il a aussi eu l’idée d’un « Salon de la Locomotion Aérienne ». Il sera le premier à fabriquer en série des avions, qui serviront à l’aéropostale, au transport aérien, puis... à la Première Guerre mondiale. Et ensuite seulement viendront les lignes commerciales et les applications civiles... Louis Blériot aura fait notablement progresser la construction et l’expérimentation des aéroplanes. En 1911, l’Aéro-club français fera installer une stèle commémorant l’événement du 25 juillet 1909, au lieu-dit « Les Baraques-Plage », pas très loin de la zone de l’envol. Depuis le décès le 1er août 1936 de Louis Blériot, « Les Baraques-Plage » se nomme « Blériot-Plage ». Le monument se trouve actuellement à l’angle de la rue Guynemer, prolongée par la rue Sémaphore, et du CD 940 reliant Calais à Sangatte. La médaille Louis Blériot est délivrée en l’honneur d’un événement en rapport avec l’aviation décernée par la Fédération aéronautique internationale (FAI) depuis 1936 en l’honneur de Louis Blériot. L’avion qui a été utilisé dans la traversée de la Manche est aujourd’hui conservé au Musée des Arts et Métiers à Paris. En mai 1927, Blériot, le pionnier de la Manche, est la première personne que Charles Lindbergh demandera à voir à l’issue de sa traversée de l’Atlantique Nord à bord de son avion Spirit of Saint Louis. Louis Blériot était très attaché aux Hautes-Pyrénées puisqu’il s’éprit de Jeanne Alicia Védère, née en 1883, fille de colonel à la retraite, originaire de Gerde, qu’il épousa le 21 février 1901 à Bagnères-de-Bigorre, alors âgés respectivement de 18 et 29 ans et dont il avait fait la connaissance à Tarbes, lors de son service militaire. Installés boulevard Maillot à Neuilly-sur-Seine, ils vont avoir six enfants, trois garçons, Louis, Marcel, Jean et trois filles, Simone, Ginette et Nelly. Louis est taciturne et renfermé, Alicia, son épouse est bavarde, enthousiaste et pleine d’entrain : un couple complémentaire. Il fut tout de suite adopté en Bigorre, où il effectua de nombreuses visites dans le secteur de Bagnères et de Cauterets. Les aviateurs de son école de pilotage de Pau l’accompagnaient souvent. Les pilotes des avions Blériot survoleront régulièrement le département des Hautes-Pyrénées en 1910 et 1911. Le 3 février 1911, Blériot fait un atterrissage remarqué entre les villages de Gerde et Asté, tout à côté de Bagnères. De quoi donner de nouvelles idées à notre ingénieur Pierre-Georges Latécoère, centralien comme lui, né à Bagnères-de-Bigorre en 1883 ! Malgré des conditions météo épouvantables en ce mois de février, Blériot réussit son atterrissage. Son épouse, les aviateurs Leblanc et Aubrun l’attendaient. C’est ensuite Leblanc qui, dix minutes après, montait sur l’oiseau mécanique et regagnait Pau par la voie des airs. Blériot et sa femme sont rentrés à Bagnères-de-Bigorre en automobile, longuement ovationnés sur leur parcours. En 1913, Louis Blériot et son épouse se sont essayés à la luge et au bobsleigh à Cauterets. Sur une maison de la rue Saint-Blaise à Bagnères-de-Bigorre, est accrochée cette plaque : « L’aviateur Louis Blériot (1872-1936) a habité cette maison avec sa famille Bagnéraise. » Madame Louis Blériot décèdera le 13 mars 1963. Madame Louis Blériot fut de toutes les manifestations et inaugurations aux côtés de son héroïque mari, l’accompagnant ainsi jusqu’en 1936 et le représentant très dignement après sa mort. C’était une jolie femme, toujours vêtue très élégamment et coiffée d’un large chapeau à la mode de l’époque. À cela s’ajoutait son immuable sourire qui la rendait agréable à regarder. Elle se disait la mascotte de son ingénieur, inventeur et pilote aviateur. Il la faisait frémir de peur à chacun de ses essais en vol, par ses nombreuses chutes parfois très sérieuses qui le faisaient appeler "l’homme qui tombe toujours". Madame Louis Blériot s’était rendue à Blériot-Plage le 25 juillet 1959 à l’occasion du cinquantenaire de la traversée de la Manche. Ce sera là sa dernière visite sur les terres qui ont vu le décollage de son illustre mari. Le 13 mars 1963, elle décédait à l’âge de quatre-vingt ans, en son domicile parisien, entourée de l’affection de ses enfants et petits-enfants. Le père Grignon qui avait abrité le Blériot XI de la traversée avait eu ces mots : "Madame Blériot fut, pendant les jours qui ont précédé le départ, une aide précieuse pour son mari avec lequel elle venait chaque jour aux Baraques, se montrant aussi convaincue que lui de sa réussite, croyant en lui et en ses rêves. "
Louis Charles Joseph BLÉRIOT, né le 1er juillet 1872 à Cambrai et mort subitement le 1er août 1936 à Paris, à l’âge de 64 ans, est un constructeur de lanternes d’automobiles, d’avions, de motocyclettes et de chars à voile, et un pilote précurseur et pionnier de l’aviation française. À ses débuts, comme ingénieur diplômé de l’École Centrale des Arts et Manufactures (promotion 1895), il entre chez Baguès, une société d’ingénierie électrique à Paris, puis effectue son service militaire dans l’artillerie à Tarbes au 24e régiment d’artillerie comme sous-lieutenant puis lieutenant de réserve au 36e régiment d’artillerie. Les Établissements Louis Blériot, qu’il a créés en 1903, connaissent un succès certain dans la fabrication de phares à acétylène pour l’industrie automobile alors en pleine expansion. On lui doit l’appellation « phare » pour les éclairages de voitures. Et après avoir fait fortune dans les phares pour automobiles, entre 1905 et 1909, il se lance dans la grande aventure aéronautique et produit une série de 11 prototypes : le Blériot I, le Blériot II, le Blériot III … jusqu’au Blériot XI, qui est celui de la traversée de la Manche. Après plusieurs années de recherches et pas mal de casse, il est parvenu à réaliser un aéroplane léger, solide et fiable. Le Blériot XI est un appareil monoplan à fuselage partiellement entoilé, long de 8 mètres, avec une envergure de 7,20 mètres et qui pèse 310 kilogrammes. Son hélice Chauvière bipale est entraînée par un moteur Anzani à trois cylindres en étoile développant 25ch. Répondant au défi lancé en 1908 par le Daily Mail (journal britannique), Blériot se lance dans l’aventure de la première traversée de la Manche, Et voilà comment, le 25 juillet 1909, Louis Blériot et Hubert Latham, deux pionniers français de l’aviation, se retrouvent au petit matin, prêts à partir de Calais pour une course aérienne France-Angleterre. Et c’est Latham qui paraît avoir les meilleures chances de remporter le pactole de 1000 livres du Daily Mail. Mais, Hubert Latham, son concurrent direct, est victime d’une panne, et c’est Blériot qui gagne (suite à des problèmes techniques, Latham ne réussira à décoller que le 27 juillet avant d’échouer à 500 mètres du but). C’est à Pau que Louis Blériot s’est préparé à ce grand exploit et après un dernier vol d’essai de 11 minutes effectué à 4h15 du matin au-dessus des Baraques, le 25 juillet 1909, le temps semble idéal, Le vent est tombé durant la nuit, et à 4h41 du matin, Louis Blériot s’envole pour l’Angleterre. Très vite, à 4h48, il dépasse le contre-torpilleur accompagnateur Escopette, où son épouse se trouve à bord, guettant son mari dans les airs avec ses jumelles, et 37 minutes après et 35 kilomètres de vol, la Manche est traversée. Ce qui donne une vitesse moyenne d’environ 57 km/h à une altitude de vol de 100 mètres. Ainsi, ce 25 juillet 1909, Louis Blériot est le premier à traverser la Manche par les airs, en décollant au lever du soleil, condition exigée par le Daily Mail, qui est à l’origine du défi et qui lui remettra la somme de 25.000 Francs-or mise en jeu. Malgré une blessure au pied, et ne sachant pas nager, il effectue la traversée, ralliant le lieu-dit Les Baraques près de Calais à Douvres en Angleterre, aux commandes du Blériot XI qu’il a conçu en collaboration avec Raymond Saulnier. La visibilité étant moyenne au départ, il s’oriente sans boussole en s’aidant de la trajectoire des bateaux reliant la France et la Grande-Bretagne, avant de pouvoir distinguer les falaises près de Douvres. La puissance de son moteur lui permet à peine de monter plus haut que ces dernières. Après un virage vers l’est, il revient à l’ouest pour finalement trouver le champ et atterrir sur les côtes anglaises, où l’attend le journaliste français Charles Fontaine muni d’un grand drapeau tricolore qu’il agite, et son photographe Marcel Marmier. À 5h12, après un virage, c’est chose faite : Blériot coupe le moteur sur le sol anglais. En une trentaine de minutes, la traversée a été réalisée mais fidèle à son habitude, Louis Blériot endommage le train de son appareil à l’atterrissage et une pale de l’hélice a été brisée, mais Blériot est sorti indemne. Désormais l’Angleterre n’est plus une île ! La Manche venait d’être vaincue par un plus lourd que l’air. La capitale britannique salue l’exploit de Louis Blériot, devenu mondialement célèbre, avant son retour en France. Un vol qui fera sa gloire, abondamment relayé par la presse de l’époque. Les jours qui suivent ne seront qu’honneurs, réceptions et fêtes. L’événement a un retentissement mondial. Pour Blériot, c’était la consécration mais aussi le soulagement car depuis quelques années, il avait dépensé la quasi-totalité de sa fortune pour concevoir et construire une dizaine de prototypes aux destins plus ou moins heureux. Cette réussite va le propulser et lui éviter la faillite. Du jour au lendemain, les commandes de son Blériot XI affluent du monde entier et l’armée commence sérieusement à s’intéresser à ce nouveau mode de déplacement. La traversée de la Manche réussie, le fidèle Alfred Leblanc lui avance les fonds pour lancer rapidement la fabrication en série du modèle de cette traversée. L’ingénieur va se lancer dans la production, s’installant sur le terrain de Buc, en région parisienne, non loin de Toussus-le-Noble. Après son exploit, le 24 novembre 1909, Blériot crée une école de pilotage à Pau (dont le plus prestigieux élève fut Guynemer) qui fonctionnera jusqu’en novembre 1913. Ville choisie à cause de sa situation tout à fait exceptionnelle et parce qu’il y règne une température idéale, et qu’il a connue lors de son service militaire à Tarbes, et où il s’est marié non loin à Bagnères. Le terrain qu’il choisit est situé sur les landes de Pont-Long à 10 km au nord de Pau, à Lescar. C’est un terrain vague à peu près rectangulaire, long de 1800 mètres et large de 500 mètres environ, couvert d’ajoncs, d’où les eaux s’écoulaient vers le nord-ouest. Il y avait jalonné une ligne médiane via deux pylônes espacés de 1250 mètres, et dégagé, entre cette médiane et les limites du terrain, une piste large de 100 mètres devant les hangars, réduite à 25 mètres vers les extrémités et se refermant sur elle-même en contournant les pylônes. Après l’exploit qui le rendit célèbre dans le monde entier, Blériot participe à la Grande Semaine d’Aviation de la Champagne fin août 1909. Le 28 août 1909, il bat le record du monde de vitesse au Meeting de Champagne à Reims, sur Blériot XI. Le 7 octobre 1909, le gouvernement décide de décerner à 16 pionniers de l’aviation un brevet de pilote. La délivrance de ces brevets est effectuée par ordre alphabétique et Louis Blériot bénéficie ainsi au brevet n°1. L’instauration du brevet de pilote intervient le 1er janvier 1910. Le 10 octobre 1909, Louis Blériot fonde la Compagnie Générale Transaérienne (CGT). Le 30 octobre 1909, le Français Louis Blériot effectue le premier vol en avion à Bucarest en Roumanie. L’appareil avec lequel il avait accompli son exploit, et qui portait désormais le nom de Calais-Douvres, fut cédé au journal Le Matin pour la somme de 10.000 Francs représentant son prix de construction. Le 13 octobre 1909, le journal Le Matin offre cet aéroplane au Conservatoire des arts et métiers qu’il n’a depuis jamais quitté. La carrière de Blériot en tant que pilote se termina, en décembre 1909, d’une façon assez tragique. Au cours d’une démonstration sur le Blériot XII, exécutée à Constantinople, il se trouva pris dans de violentes rafales de vent, qui le plaquèrent au sol. Le pionnier français victime de son 32e accident (accidents qui lui ont valu le surnom de « roi de la casse » ou « l’homme qui tombe toujours » par la presse), s’en tira avec quelques côtes enfoncées et de nombreuses contusions. Sa décision était prise. Désormais, il ne volera plus que sporadiquement pour se concentrer sur le développement et l’industrialisation de ses machines. En août 1914, Louis Blériot et d’autres industriels reprennent les actifs de la Société de Production des Avions Déperdussin (SPAD), tombée en faillite, pour en faire la Société Pour l’Aviation et ses Dérivés (SPAD). L’ingénieur en charge du bureau d’études, Louis Béchereau, développera plusieurs avions de chasse dont les fameux SPAD S.VII et SPAD S.XIII qui équiperont un grand nombre d’escadrilles françaises. En 1917, les Établissements Blériot aéronautique et SPAD assurent 10% de la production d’avions en France. Blériot achète des sites industriels hors de Paris comme à Suresnes. Pendant la guerre, ce sont des milliers d’avions qui sortiront des ateliers Blériot de Suresnes et, en particulier, plus de 11.000 chasseurs SPAD, essentiellement dotés de moteurs Gnome et Rhône. Blériot devient le banquier de ses sociétés et fait des placements considérables dans l’industrie des loisirs, en particulier à Monte-Carlo. Louis Blériot devient donc un important industriel dans le domaine aéronautique, avec ses usines à Suresnes. Après la guerre, il se lance dans la fabrication de motos, avec un succès très mitigé. Il continue de fabriquer des avions, les avions SPAD, mais comptant sur les commandes de l’État, lequel révisa le contrat à la baisse, Blériot dû bientôt fermer ses usines. En 1936, le gouvernement nationalise les usines Blériot. La Société Blériot aéronautique est absorbée par la Société Nationale des Constructions Aéronautiques du Sud-Ouest (SNCASO). Louis Blériot ne supporta pas cette décision et cinq jours après la date effective, terrassé par le chagrin, il meurt précocement le 1er août 1936, à son domicile au 288, boulevard Saint-Germain, emporté par une crise cardiaque. La France rendra hommage à l’homme de la traversée de la Manche par des funérailles nationales le 5 août 1936, en l’église Saint-Louis des Invalides. Les honneurs militaires lui seront rendus par un détachement du 34e régiment d’Aviation du Bourget. L’éloge funèbre étant prononcé par le ministre de l’Air, Pierre Cot. Il sera inhumé au cimetière des Gonards à Versailles, dans le caveau de famille. Parmi ces nombreux « fous volants » de l’époque, qui éblouissaient le public, en particulier en France, Blériot se distingue comme le « père de l’aéronautique ». Ayant fait fortune en inventant les phares pour permettre aux automobiles de rouler la nuit, il aura réinvesti tous ses bénéfices dans des prototypes qu’il améliore avec le « manche à balai ». Blériot est à l’origine de la « cloche », ancêtre du manche à balai centralisant les commandes et permettant de contrôler l’altitude et le cap de l’avion. Il a aussi eu l’idée d’un « Salon de la Locomotion Aérienne ». Il sera le premier à fabriquer en série des avions, qui serviront à l’aéropostale, au transport aérien, puis... à la Première Guerre mondiale. Et ensuite seulement viendront les lignes commerciales et les applications civiles... Louis Blériot aura fait notablement progresser la construction et l’expérimentation des aéroplanes. En 1911, l’Aéro-club français fera installer une stèle commémorant l’événement du 25 juillet 1909, au lieu-dit « Les Baraques-Plage », pas très loin de la zone de l’envol. Depuis le décès le 1er août 1936 de Louis Blériot, « Les Baraques-Plage » se nomme « Blériot-Plage ». Le monument se trouve actuellement à l’angle de la rue Guynemer, prolongée par la rue Sémaphore, et du CD 940 reliant Calais à Sangatte. La médaille Louis Blériot est délivrée en l’honneur d’un événement en rapport avec l’aviation décernée par la Fédération aéronautique internationale (FAI) depuis 1936 en l’honneur de Louis Blériot. L’avion qui a été utilisé dans la traversée de la Manche est aujourd’hui conservé au Musée des Arts et Métiers à Paris. En mai 1927, Blériot, le pionnier de la Manche, est la première personne que Charles Lindbergh demandera à voir à l’issue de sa traversée de l’Atlantique Nord à bord de son avion Spirit of Saint Louis. Louis Blériot était très attaché aux Hautes-Pyrénées puisqu’il s’éprit de Jeanne Alicia Védère, née en 1883, fille de colonel à la retraite, originaire de Gerde, qu’il épousa le 21 février 1901 à Bagnères-de-Bigorre, alors âgés respectivement de 18 et 29 ans et dont il avait fait la connaissance à Tarbes, lors de son service militaire. Installés boulevard Maillot à Neuilly-sur-Seine, ils vont avoir six enfants, trois garçons, Louis, Marcel, Jean et trois filles, Simone, Ginette et Nelly. Louis est taciturne et renfermé, Alicia, son épouse est bavarde, enthousiaste et pleine d’entrain : un couple complémentaire. Il fut tout de suite adopté en Bigorre, où il effectua de nombreuses visites dans le secteur de Bagnères et de Cauterets. Les aviateurs de son école de pilotage de Pau l’accompagnaient souvent. Les pilotes des avions Blériot survoleront régulièrement le département des Hautes-Pyrénées en 1910 et 1911. Le 3 février 1911, Blériot fait un atterrissage remarqué entre les villages de Gerde et Asté, tout à côté de Bagnères. De quoi donner de nouvelles idées à notre ingénieur Pierre-Georges Latécoère, centralien comme lui, né à Bagnères-de-Bigorre en 1883 ! Malgré des conditions météo épouvantables en ce mois de février, Blériot réussit son atterrissage. Son épouse, les aviateurs Leblanc et Aubrun l’attendaient. C’est ensuite Leblanc qui, dix minutes après, montait sur l’oiseau mécanique et regagnait Pau par la voie des airs. Blériot et sa femme sont rentrés à Bagnères-de-Bigorre en automobile, longuement ovationnés sur leur parcours. En 1913, Louis Blériot et son épouse se sont essayés à la luge et au bobsleigh à Cauterets. Sur une maison de la rue Saint-Blaise à Bagnères-de-Bigorre, est accrochée cette plaque : « L’aviateur Louis Blériot (1872-1936) a habité cette maison avec sa famille Bagnéraise. » Madame Louis Blériot décèdera le 13 mars 1963. Madame Louis Blériot fut de toutes les manifestations et inaugurations aux côtés de son héroïque mari, l’accompagnant ainsi jusqu’en 1936 et le représentant très dignement après sa mort. C’était une jolie femme, toujours vêtue très élégamment et coiffée d’un large chapeau à la mode de l’époque. À cela s’ajoutait son immuable sourire qui la rendait agréable à regarder. Elle se disait la mascotte de son ingénieur, inventeur et pilote aviateur. Il la faisait frémir de peur à chacun de ses essais en vol, par ses nombreuses chutes parfois très sérieuses qui le faisaient appeler "l’homme qui tombe toujours". Madame Louis Blériot s’était rendue à Blériot-Plage le 25 juillet 1959 à l’occasion du cinquantenaire de la traversée de la Manche. Ce sera là sa dernière visite sur les terres qui ont vu le décollage de son illustre mari. Le 13 mars 1963, elle décédait à l’âge de quatre-vingt ans, en son domicile parisien, entourée de l’affection de ses enfants et petits-enfants. Le père Grignon qui avait abrité le Blériot XI de la traversée avait eu ces mots : "Madame Blériot fut, pendant les jours qui ont précédé le départ, une aide précieuse pour son mari avec lequel elle venait chaque jour aux Baraques, se montrant aussi convaincue que lui de sa réussite, croyant en lui et en ses rêves. "
 Louis Charles Joseph BLÉRIOT, né le 1er juillet 1872 à Cambrai et mort subitement le 1er août 1936 à Paris, à l’âge de 64 ans, est un constructeur de lanternes d’automobiles, d’avions, de motocyclettes et de chars à voile, et un pilote précurseur et pionnier de l’aviation française. À ses débuts, comme ingénieur diplômé de l’École Centrale des Arts et Manufactures (promotion 1895), il entre chez Baguès, une société d’ingénierie électrique à Paris, puis effectue son service militaire dans l’artillerie à Tarbes au 24e régiment d’artillerie comme sous-lieutenant puis lieutenant de réserve au 36e régiment d’artillerie. Les Établissements Louis Blériot, qu’il a créés en 1903, connaissent un succès certain dans la fabrication de phares à acétylène pour l’industrie automobile alors en pleine expansion. On lui doit l’appellation « phare » pour les éclairages de voitures. Et après avoir fait fortune dans les phares pour automobiles, entre 1905 et 1909, il se lance dans la grande aventure aéronautique et produit une série de 11 prototypes : le Blériot I, le Blériot II, le Blériot III … jusqu’au Blériot XI, qui est celui de la traversée de la Manche. Après plusieurs années de recherches et pas mal de casse, il est parvenu à réaliser un aéroplane léger, solide et fiable. Le Blériot XI est un appareil monoplan à fuselage partiellement entoilé, long de 8 mètres, avec une envergure de 7,20 mètres et qui pèse 310 kilogrammes. Son hélice Chauvière bipale est entraînée par un moteur Anzani à trois cylindres en étoile développant 25ch. Répondant au défi lancé en 1908 par le Daily Mail (journal britannique), Blériot se lance dans l’aventure de la première traversée de la Manche, Et voilà comment, le 25 juillet 1909, Louis Blériot et Hubert Latham, deux pionniers français de l’aviation, se retrouvent au petit matin, prêts à partir de Calais pour une course aérienne France-Angleterre. Et c’est Latham qui paraît avoir les meilleures chances de remporter le pactole de 1000 livres du Daily Mail. Mais, Hubert Latham, son concurrent direct, est victime d’une panne, et c’est Blériot qui gagne (suite à des problèmes techniques, Latham ne réussira à décoller que le 27 juillet avant d’échouer à 500 mètres du but). C’est à Pau que Louis Blériot s’est préparé à ce grand exploit et après un dernier vol d’essai de 11 minutes effectué à 4h15 du matin au-dessus des Baraques, le 25 juillet 1909, le temps semble idéal, Le vent est tombé durant la nuit, et à 4h41 du matin, Louis Blériot s’envole pour l’Angleterre. Très vite, à 4h48, il dépasse le contre-torpilleur accompagnateur Escopette, où son épouse se trouve à bord, guettant son mari dans les airs avec ses jumelles, et 37 minutes après et 35 kilomètres de vol, la Manche est traversée. Ce qui donne une vitesse moyenne d’environ 57 km/h à une altitude de vol de 100 mètres. Ainsi, ce 25 juillet 1909, Louis Blériot est le premier à traverser la Manche par les airs, en décollant au lever du soleil, condition exigée par le Daily Mail, qui est à l’origine du défi et qui lui remettra la somme de 25.000 Francs-or mise en jeu. Malgré une blessure au pied, et ne sachant pas nager, il effectue la traversée, ralliant le lieu-dit Les Baraques près de Calais à Douvres en Angleterre, aux commandes du Blériot XI qu’il a conçu en collaboration avec Raymond Saulnier. La visibilité étant moyenne au départ, il s’oriente sans boussole en s’aidant de la trajectoire des bateaux reliant la France et la Grande-Bretagne, avant de pouvoir distinguer les falaises près de Douvres. La puissance de son moteur lui permet à peine de monter plus haut que ces dernières. Après un virage vers l’est, il revient à l’ouest pour finalement trouver le champ et atterrir sur les côtes anglaises, où l’attend le journaliste français Charles Fontaine muni d’un grand drapeau tricolore qu’il agite, et son photographe Marcel Marmier. À 5h12, après un virage, c’est chose faite : Blériot coupe le moteur sur le sol anglais. En une trentaine de minutes, la traversée a été réalisée mais fidèle à son habitude, Louis Blériot endommage le train de son appareil à l’atterrissage et une pale de l’hélice a été brisée, mais Blériot est sorti indemne. Désormais l’Angleterre n’est plus une île ! La Manche venait d’être vaincue par un plus lourd que l’air. La capitale britannique salue l’exploit de Louis Blériot, devenu mondialement célèbre, avant son retour en France. Un vol qui fera sa gloire, abondamment relayé par la presse de l’époque. Les jours qui suivent ne seront qu’honneurs, réceptions et fêtes. L’événement a un retentissement mondial. Pour Blériot, c’était la consécration mais aussi le soulagement car depuis quelques années, il avait dépensé la quasi-totalité de sa fortune pour concevoir et construire une dizaine de prototypes aux destins plus ou moins heureux. Cette réussite va le propulser et lui éviter la faillite. Du jour au lendemain, les commandes de son Blériot XI affluent du monde entier et l’armée commence sérieusement à s’intéresser à ce nouveau mode de déplacement. La traversée de la Manche réussie, le fidèle Alfred Leblanc lui avance les fonds pour lancer rapidement la fabrication en série du modèle de cette traversée. L’ingénieur va se lancer dans la production, s’installant sur le terrain de Buc, en région parisienne, non loin de Toussus-le-Noble. Après son exploit, le 24 novembre 1909, Blériot crée une école de pilotage à Pau (dont le plus prestigieux élève fut Guynemer) qui fonctionnera jusqu’en novembre 1913. Ville choisie à cause de sa situation tout à fait exceptionnelle et parce qu’il y règne une température idéale, et qu’il a connue lors de son service militaire à Tarbes, et où il s’est marié non loin à Bagnères. Le terrain qu’il choisit est situé sur les landes de Pont-Long à 10 km au nord de Pau, à Lescar. C’est un terrain vague à peu près rectangulaire, long de 1800 mètres et large de 500 mètres environ, couvert d’ajoncs, d’où les eaux s’écoulaient vers le nord-ouest. Il y avait jalonné une ligne médiane via deux pylônes espacés de 1250 mètres, et dégagé, entre cette médiane et les limites du terrain, une piste large de 100 mètres devant les hangars, réduite à 25 mètres vers les extrémités et se refermant sur elle-même en contournant les pylônes. Après l’exploit qui le rendit célèbre dans le monde entier, Blériot participe à la Grande Semaine d’Aviation de la Champagne fin août 1909. Le 28 août 1909, il bat le record du monde de vitesse au Meeting de Champagne à Reims, sur Blériot XI. Le 7 octobre 1909, le gouvernement décide de décerner à 16 pionniers de l’aviation un brevet de pilote. La délivrance de ces brevets est effectuée par ordre alphabétique et Louis Blériot bénéficie ainsi au brevet n°1. L’instauration du brevet de pilote intervient le 1er janvier 1910. Le 10 octobre 1909, Louis Blériot fonde la Compagnie Générale Transaérienne (CGT). Le 30 octobre 1909, le Français Louis Blériot effectue le premier vol en avion à Bucarest en Roumanie. L’appareil avec lequel il avait accompli son exploit, et qui portait désormais le nom de Calais-Douvres, fut cédé au journal Le Matin pour la somme de 10.000 Francs représentant son prix de construction. Le 13 octobre 1909, le journal Le Matin offre cet aéroplane au Conservatoire des arts et métiers qu’il n’a depuis jamais quitté. La carrière de Blériot en tant que pilote se termina, en décembre 1909, d’une façon assez tragique. Au cours d’une démonstration sur le Blériot XII, exécutée à Constantinople, il se trouva pris dans de violentes rafales de vent, qui le plaquèrent au sol. Le pionnier français victime de son 32e accident (accidents qui lui ont valu le surnom de « roi de la casse » ou « l’homme qui tombe toujours » par la presse), s’en tira avec quelques côtes enfoncées et de nombreuses contusions. Sa décision était prise. Désormais, il ne volera plus que sporadiquement pour se concentrer sur le développement et l’industrialisation de ses machines. En août 1914, Louis Blériot et d’autres industriels reprennent les actifs de la Société de Production des Avions Déperdussin (SPAD), tombée en faillite, pour en faire la Société Pour l’Aviation et ses Dérivés (SPAD). L’ingénieur en charge du bureau d’études, Louis Béchereau, développera plusieurs avions de chasse dont les fameux SPAD S.VII et SPAD S.XIII qui équiperont un grand nombre d’escadrilles françaises. En 1917, les Établissements Blériot aéronautique et SPAD assurent 10% de la production d’avions en France. Blériot achète des sites industriels hors de Paris comme à Suresnes. Pendant la guerre, ce sont des milliers d’avions qui sortiront des ateliers Blériot de Suresnes et, en particulier, plus de 11.000 chasseurs SPAD, essentiellement dotés de moteurs Gnome et Rhône. Blériot devient le banquier de ses sociétés et fait des placements considérables dans l’industrie des loisirs, en particulier à Monte-Carlo. Louis Blériot devient donc un important industriel dans le domaine aéronautique, avec ses usines à Suresnes. Après la guerre, il se lance dans la fabrication de motos, avec un succès très mitigé. Il continue de fabriquer des avions, les avions SPAD, mais comptant sur les commandes de l’État, lequel révisa le contrat à la baisse, Blériot dû bientôt fermer ses usines. En 1936, le gouvernement nationalise les usines Blériot. La Société Blériot aéronautique est absorbée par la Société Nationale des Constructions Aéronautiques du Sud-Ouest (SNCASO). Louis Blériot ne supporta pas cette décision et cinq jours après la date effective, terrassé par le chagrin, il meurt précocement le 1er août 1936, à son domicile au 288, boulevard Saint-Germain, emporté par une crise cardiaque. La France rendra hommage à l’homme de la traversée de la Manche par des funérailles nationales le 5 août 1936, en l’église Saint-Louis des Invalides. Les honneurs militaires lui seront rendus par un détachement du 34e régiment d’Aviation du Bourget. L’éloge funèbre étant prononcé par le ministre de l’Air, Pierre Cot. Il sera inhumé au cimetière des Gonards à Versailles, dans le caveau de famille. Parmi ces nombreux « fous volants » de l’époque, qui éblouissaient le public, en particulier en France, Blériot se distingue comme le « père de l’aéronautique ». Ayant fait fortune en inventant les phares pour permettre aux automobiles de rouler la nuit, il aura réinvesti tous ses bénéfices dans des prototypes qu’il améliore avec le « manche à balai ». Blériot est à l’origine de la « cloche », ancêtre du manche à balai centralisant les commandes et permettant de contrôler l’altitude et le cap de l’avion. Il a aussi eu l’idée d’un « Salon de la Locomotion Aérienne ». Il sera le premier à fabriquer en série des avions, qui serviront à l’aéropostale, au transport aérien, puis... à la Première Guerre mondiale. Et ensuite seulement viendront les lignes commerciales et les applications civiles... Louis Blériot aura fait notablement progresser la construction et l’expérimentation des aéroplanes. En 1911, l’Aéro-club français fera installer une stèle commémorant l’événement du 25 juillet 1909, au lieu-dit « Les Baraques-Plage », pas très loin de la zone de l’envol. Depuis le décès le 1er août 1936 de Louis Blériot, « Les Baraques-Plage » se nomme « Blériot-Plage ». Le monument se trouve actuellement à l’angle de la rue Guynemer, prolongée par la rue Sémaphore, et du CD 940 reliant Calais à Sangatte. La médaille Louis Blériot est délivrée en l’honneur d’un événement en rapport avec l’aviation décernée par la Fédération aéronautique internationale (FAI) depuis 1936 en l’honneur de Louis Blériot. L’avion qui a été utilisé dans la traversée de la Manche est aujourd’hui conservé au Musée des Arts et Métiers à Paris. En mai 1927, Blériot, le pionnier de la Manche, est la première personne que Charles Lindbergh demandera à voir à l’issue de sa traversée de l’Atlantique Nord à bord de son avion Spirit of Saint Louis. Louis Blériot était très attaché aux Hautes-Pyrénées puisqu’il s’éprit de Jeanne Alicia Védère, née en 1883, fille de colonel à la retraite, originaire de Gerde, qu’il épousa le 21 février 1901 à Bagnères-de-Bigorre, alors âgés respectivement de 18 et 29 ans et dont il avait fait la connaissance à Tarbes, lors de son service militaire. Installés boulevard Maillot à Neuilly-sur-Seine, ils vont avoir six enfants, trois garçons, Louis, Marcel, Jean et trois filles, Simone, Ginette et Nelly. Louis est taciturne et renfermé, Alicia, son épouse est bavarde, enthousiaste et pleine d’entrain : un couple complémentaire. Il fut tout de suite adopté en Bigorre, où il effectua de nombreuses visites dans le secteur de Bagnères et de Cauterets. Les aviateurs de son école de pilotage de Pau l’accompagnaient souvent. Les pilotes des avions Blériot survoleront régulièrement le département des Hautes-Pyrénées en 1910 et 1911. Le 3 février 1911, Blériot fait un atterrissage remarqué entre les villages de Gerde et Asté, tout à côté de Bagnères. De quoi donner de nouvelles idées à notre ingénieur Pierre-Georges Latécoère, centralien comme lui, né à Bagnères-de-Bigorre en 1883 ! Malgré des conditions météo épouvantables en ce mois de février, Blériot réussit son atterrissage. Son épouse, les aviateurs Leblanc et Aubrun l’attendaient. C’est ensuite Leblanc qui, dix minutes après, montait sur l’oiseau mécanique et regagnait Pau par la voie des airs. Blériot et sa femme sont rentrés à Bagnères-de-Bigorre en automobile, longuement ovationnés sur leur parcours. En 1913, Louis Blériot et son épouse se sont essayés à la luge et au bobsleigh à Cauterets. Sur une maison de la rue Saint-Blaise à Bagnères-de-Bigorre, est accrochée cette plaque : « L’aviateur Louis Blériot (1872-1936) a habité cette maison avec sa famille Bagnéraise. » Madame Louis Blériot décèdera le 13 mars 1963. Madame Louis Blériot fut de toutes les manifestations et inaugurations aux côtés de son héroïque mari, l’accompagnant ainsi jusqu’en 1936 et le représentant très dignement après sa mort. C’était une jolie femme, toujours vêtue très élégamment et coiffée d’un large chapeau à la mode de l’époque. À cela s’ajoutait son immuable sourire qui la rendait agréable à regarder. Elle se disait la mascotte de son ingénieur, inventeur et pilote aviateur. Il la faisait frémir de peur à chacun de ses essais en vol, par ses nombreuses chutes parfois très sérieuses qui le faisaient appeler "l’homme qui tombe toujours". Madame Louis Blériot s’était rendue à Blériot-Plage le 25 juillet 1959 à l’occasion du cinquantenaire de la traversée de la Manche. Ce sera là sa dernière visite sur les terres qui ont vu le décollage de son illustre mari. Le 13 mars 1963, elle décédait à l’âge de quatre-vingt ans, en son domicile parisien, entourée de l’affection de ses enfants et petits-enfants. Le père Grignon qui avait abrité le Blériot XI de la traversée avait eu ces mots : "Madame Blériot fut, pendant les jours qui ont précédé le départ, une aide précieuse pour son mari avec lequel elle venait chaque jour aux Baraques, se montrant aussi convaincue que lui de sa réussite, croyant en lui et en ses rêves. "
Louis Charles Joseph BLÉRIOT, né le 1er juillet 1872 à Cambrai et mort subitement le 1er août 1936 à Paris, à l’âge de 64 ans, est un constructeur de lanternes d’automobiles, d’avions, de motocyclettes et de chars à voile, et un pilote précurseur et pionnier de l’aviation française. À ses débuts, comme ingénieur diplômé de l’École Centrale des Arts et Manufactures (promotion 1895), il entre chez Baguès, une société d’ingénierie électrique à Paris, puis effectue son service militaire dans l’artillerie à Tarbes au 24e régiment d’artillerie comme sous-lieutenant puis lieutenant de réserve au 36e régiment d’artillerie. Les Établissements Louis Blériot, qu’il a créés en 1903, connaissent un succès certain dans la fabrication de phares à acétylène pour l’industrie automobile alors en pleine expansion. On lui doit l’appellation « phare » pour les éclairages de voitures. Et après avoir fait fortune dans les phares pour automobiles, entre 1905 et 1909, il se lance dans la grande aventure aéronautique et produit une série de 11 prototypes : le Blériot I, le Blériot II, le Blériot III … jusqu’au Blériot XI, qui est celui de la traversée de la Manche. Après plusieurs années de recherches et pas mal de casse, il est parvenu à réaliser un aéroplane léger, solide et fiable. Le Blériot XI est un appareil monoplan à fuselage partiellement entoilé, long de 8 mètres, avec une envergure de 7,20 mètres et qui pèse 310 kilogrammes. Son hélice Chauvière bipale est entraînée par un moteur Anzani à trois cylindres en étoile développant 25ch. Répondant au défi lancé en 1908 par le Daily Mail (journal britannique), Blériot se lance dans l’aventure de la première traversée de la Manche, Et voilà comment, le 25 juillet 1909, Louis Blériot et Hubert Latham, deux pionniers français de l’aviation, se retrouvent au petit matin, prêts à partir de Calais pour une course aérienne France-Angleterre. Et c’est Latham qui paraît avoir les meilleures chances de remporter le pactole de 1000 livres du Daily Mail. Mais, Hubert Latham, son concurrent direct, est victime d’une panne, et c’est Blériot qui gagne (suite à des problèmes techniques, Latham ne réussira à décoller que le 27 juillet avant d’échouer à 500 mètres du but). C’est à Pau que Louis Blériot s’est préparé à ce grand exploit et après un dernier vol d’essai de 11 minutes effectué à 4h15 du matin au-dessus des Baraques, le 25 juillet 1909, le temps semble idéal, Le vent est tombé durant la nuit, et à 4h41 du matin, Louis Blériot s’envole pour l’Angleterre. Très vite, à 4h48, il dépasse le contre-torpilleur accompagnateur Escopette, où son épouse se trouve à bord, guettant son mari dans les airs avec ses jumelles, et 37 minutes après et 35 kilomètres de vol, la Manche est traversée. Ce qui donne une vitesse moyenne d’environ 57 km/h à une altitude de vol de 100 mètres. Ainsi, ce 25 juillet 1909, Louis Blériot est le premier à traverser la Manche par les airs, en décollant au lever du soleil, condition exigée par le Daily Mail, qui est à l’origine du défi et qui lui remettra la somme de 25.000 Francs-or mise en jeu. Malgré une blessure au pied, et ne sachant pas nager, il effectue la traversée, ralliant le lieu-dit Les Baraques près de Calais à Douvres en Angleterre, aux commandes du Blériot XI qu’il a conçu en collaboration avec Raymond Saulnier. La visibilité étant moyenne au départ, il s’oriente sans boussole en s’aidant de la trajectoire des bateaux reliant la France et la Grande-Bretagne, avant de pouvoir distinguer les falaises près de Douvres. La puissance de son moteur lui permet à peine de monter plus haut que ces dernières. Après un virage vers l’est, il revient à l’ouest pour finalement trouver le champ et atterrir sur les côtes anglaises, où l’attend le journaliste français Charles Fontaine muni d’un grand drapeau tricolore qu’il agite, et son photographe Marcel Marmier. À 5h12, après un virage, c’est chose faite : Blériot coupe le moteur sur le sol anglais. En une trentaine de minutes, la traversée a été réalisée mais fidèle à son habitude, Louis Blériot endommage le train de son appareil à l’atterrissage et une pale de l’hélice a été brisée, mais Blériot est sorti indemne. Désormais l’Angleterre n’est plus une île ! La Manche venait d’être vaincue par un plus lourd que l’air. La capitale britannique salue l’exploit de Louis Blériot, devenu mondialement célèbre, avant son retour en France. Un vol qui fera sa gloire, abondamment relayé par la presse de l’époque. Les jours qui suivent ne seront qu’honneurs, réceptions et fêtes. L’événement a un retentissement mondial. Pour Blériot, c’était la consécration mais aussi le soulagement car depuis quelques années, il avait dépensé la quasi-totalité de sa fortune pour concevoir et construire une dizaine de prototypes aux destins plus ou moins heureux. Cette réussite va le propulser et lui éviter la faillite. Du jour au lendemain, les commandes de son Blériot XI affluent du monde entier et l’armée commence sérieusement à s’intéresser à ce nouveau mode de déplacement. La traversée de la Manche réussie, le fidèle Alfred Leblanc lui avance les fonds pour lancer rapidement la fabrication en série du modèle de cette traversée. L’ingénieur va se lancer dans la production, s’installant sur le terrain de Buc, en région parisienne, non loin de Toussus-le-Noble. Après son exploit, le 24 novembre 1909, Blériot crée une école de pilotage à Pau (dont le plus prestigieux élève fut Guynemer) qui fonctionnera jusqu’en novembre 1913. Ville choisie à cause de sa situation tout à fait exceptionnelle et parce qu’il y règne une température idéale, et qu’il a connue lors de son service militaire à Tarbes, et où il s’est marié non loin à Bagnères. Le terrain qu’il choisit est situé sur les landes de Pont-Long à 10 km au nord de Pau, à Lescar. C’est un terrain vague à peu près rectangulaire, long de 1800 mètres et large de 500 mètres environ, couvert d’ajoncs, d’où les eaux s’écoulaient vers le nord-ouest. Il y avait jalonné une ligne médiane via deux pylônes espacés de 1250 mètres, et dégagé, entre cette médiane et les limites du terrain, une piste large de 100 mètres devant les hangars, réduite à 25 mètres vers les extrémités et se refermant sur elle-même en contournant les pylônes. Après l’exploit qui le rendit célèbre dans le monde entier, Blériot participe à la Grande Semaine d’Aviation de la Champagne fin août 1909. Le 28 août 1909, il bat le record du monde de vitesse au Meeting de Champagne à Reims, sur Blériot XI. Le 7 octobre 1909, le gouvernement décide de décerner à 16 pionniers de l’aviation un brevet de pilote. La délivrance de ces brevets est effectuée par ordre alphabétique et Louis Blériot bénéficie ainsi au brevet n°1. L’instauration du brevet de pilote intervient le 1er janvier 1910. Le 10 octobre 1909, Louis Blériot fonde la Compagnie Générale Transaérienne (CGT). Le 30 octobre 1909, le Français Louis Blériot effectue le premier vol en avion à Bucarest en Roumanie. L’appareil avec lequel il avait accompli son exploit, et qui portait désormais le nom de Calais-Douvres, fut cédé au journal Le Matin pour la somme de 10.000 Francs représentant son prix de construction. Le 13 octobre 1909, le journal Le Matin offre cet aéroplane au Conservatoire des arts et métiers qu’il n’a depuis jamais quitté. La carrière de Blériot en tant que pilote se termina, en décembre 1909, d’une façon assez tragique. Au cours d’une démonstration sur le Blériot XII, exécutée à Constantinople, il se trouva pris dans de violentes rafales de vent, qui le plaquèrent au sol. Le pionnier français victime de son 32e accident (accidents qui lui ont valu le surnom de « roi de la casse » ou « l’homme qui tombe toujours » par la presse), s’en tira avec quelques côtes enfoncées et de nombreuses contusions. Sa décision était prise. Désormais, il ne volera plus que sporadiquement pour se concentrer sur le développement et l’industrialisation de ses machines. En août 1914, Louis Blériot et d’autres industriels reprennent les actifs de la Société de Production des Avions Déperdussin (SPAD), tombée en faillite, pour en faire la Société Pour l’Aviation et ses Dérivés (SPAD). L’ingénieur en charge du bureau d’études, Louis Béchereau, développera plusieurs avions de chasse dont les fameux SPAD S.VII et SPAD S.XIII qui équiperont un grand nombre d’escadrilles françaises. En 1917, les Établissements Blériot aéronautique et SPAD assurent 10% de la production d’avions en France. Blériot achète des sites industriels hors de Paris comme à Suresnes. Pendant la guerre, ce sont des milliers d’avions qui sortiront des ateliers Blériot de Suresnes et, en particulier, plus de 11.000 chasseurs SPAD, essentiellement dotés de moteurs Gnome et Rhône. Blériot devient le banquier de ses sociétés et fait des placements considérables dans l’industrie des loisirs, en particulier à Monte-Carlo. Louis Blériot devient donc un important industriel dans le domaine aéronautique, avec ses usines à Suresnes. Après la guerre, il se lance dans la fabrication de motos, avec un succès très mitigé. Il continue de fabriquer des avions, les avions SPAD, mais comptant sur les commandes de l’État, lequel révisa le contrat à la baisse, Blériot dû bientôt fermer ses usines. En 1936, le gouvernement nationalise les usines Blériot. La Société Blériot aéronautique est absorbée par la Société Nationale des Constructions Aéronautiques du Sud-Ouest (SNCASO). Louis Blériot ne supporta pas cette décision et cinq jours après la date effective, terrassé par le chagrin, il meurt précocement le 1er août 1936, à son domicile au 288, boulevard Saint-Germain, emporté par une crise cardiaque. La France rendra hommage à l’homme de la traversée de la Manche par des funérailles nationales le 5 août 1936, en l’église Saint-Louis des Invalides. Les honneurs militaires lui seront rendus par un détachement du 34e régiment d’Aviation du Bourget. L’éloge funèbre étant prononcé par le ministre de l’Air, Pierre Cot. Il sera inhumé au cimetière des Gonards à Versailles, dans le caveau de famille. Parmi ces nombreux « fous volants » de l’époque, qui éblouissaient le public, en particulier en France, Blériot se distingue comme le « père de l’aéronautique ». Ayant fait fortune en inventant les phares pour permettre aux automobiles de rouler la nuit, il aura réinvesti tous ses bénéfices dans des prototypes qu’il améliore avec le « manche à balai ». Blériot est à l’origine de la « cloche », ancêtre du manche à balai centralisant les commandes et permettant de contrôler l’altitude et le cap de l’avion. Il a aussi eu l’idée d’un « Salon de la Locomotion Aérienne ». Il sera le premier à fabriquer en série des avions, qui serviront à l’aéropostale, au transport aérien, puis... à la Première Guerre mondiale. Et ensuite seulement viendront les lignes commerciales et les applications civiles... Louis Blériot aura fait notablement progresser la construction et l’expérimentation des aéroplanes. En 1911, l’Aéro-club français fera installer une stèle commémorant l’événement du 25 juillet 1909, au lieu-dit « Les Baraques-Plage », pas très loin de la zone de l’envol. Depuis le décès le 1er août 1936 de Louis Blériot, « Les Baraques-Plage » se nomme « Blériot-Plage ». Le monument se trouve actuellement à l’angle de la rue Guynemer, prolongée par la rue Sémaphore, et du CD 940 reliant Calais à Sangatte. La médaille Louis Blériot est délivrée en l’honneur d’un événement en rapport avec l’aviation décernée par la Fédération aéronautique internationale (FAI) depuis 1936 en l’honneur de Louis Blériot. L’avion qui a été utilisé dans la traversée de la Manche est aujourd’hui conservé au Musée des Arts et Métiers à Paris. En mai 1927, Blériot, le pionnier de la Manche, est la première personne que Charles Lindbergh demandera à voir à l’issue de sa traversée de l’Atlantique Nord à bord de son avion Spirit of Saint Louis. Louis Blériot était très attaché aux Hautes-Pyrénées puisqu’il s’éprit de Jeanne Alicia Védère, née en 1883, fille de colonel à la retraite, originaire de Gerde, qu’il épousa le 21 février 1901 à Bagnères-de-Bigorre, alors âgés respectivement de 18 et 29 ans et dont il avait fait la connaissance à Tarbes, lors de son service militaire. Installés boulevard Maillot à Neuilly-sur-Seine, ils vont avoir six enfants, trois garçons, Louis, Marcel, Jean et trois filles, Simone, Ginette et Nelly. Louis est taciturne et renfermé, Alicia, son épouse est bavarde, enthousiaste et pleine d’entrain : un couple complémentaire. Il fut tout de suite adopté en Bigorre, où il effectua de nombreuses visites dans le secteur de Bagnères et de Cauterets. Les aviateurs de son école de pilotage de Pau l’accompagnaient souvent. Les pilotes des avions Blériot survoleront régulièrement le département des Hautes-Pyrénées en 1910 et 1911. Le 3 février 1911, Blériot fait un atterrissage remarqué entre les villages de Gerde et Asté, tout à côté de Bagnères. De quoi donner de nouvelles idées à notre ingénieur Pierre-Georges Latécoère, centralien comme lui, né à Bagnères-de-Bigorre en 1883 ! Malgré des conditions météo épouvantables en ce mois de février, Blériot réussit son atterrissage. Son épouse, les aviateurs Leblanc et Aubrun l’attendaient. C’est ensuite Leblanc qui, dix minutes après, montait sur l’oiseau mécanique et regagnait Pau par la voie des airs. Blériot et sa femme sont rentrés à Bagnères-de-Bigorre en automobile, longuement ovationnés sur leur parcours. En 1913, Louis Blériot et son épouse se sont essayés à la luge et au bobsleigh à Cauterets. Sur une maison de la rue Saint-Blaise à Bagnères-de-Bigorre, est accrochée cette plaque : « L’aviateur Louis Blériot (1872-1936) a habité cette maison avec sa famille Bagnéraise. » Madame Louis Blériot décèdera le 13 mars 1963. Madame Louis Blériot fut de toutes les manifestations et inaugurations aux côtés de son héroïque mari, l’accompagnant ainsi jusqu’en 1936 et le représentant très dignement après sa mort. C’était une jolie femme, toujours vêtue très élégamment et coiffée d’un large chapeau à la mode de l’époque. À cela s’ajoutait son immuable sourire qui la rendait agréable à regarder. Elle se disait la mascotte de son ingénieur, inventeur et pilote aviateur. Il la faisait frémir de peur à chacun de ses essais en vol, par ses nombreuses chutes parfois très sérieuses qui le faisaient appeler "l’homme qui tombe toujours". Madame Louis Blériot s’était rendue à Blériot-Plage le 25 juillet 1959 à l’occasion du cinquantenaire de la traversée de la Manche. Ce sera là sa dernière visite sur les terres qui ont vu le décollage de son illustre mari. Le 13 mars 1963, elle décédait à l’âge de quatre-vingt ans, en son domicile parisien, entourée de l’affection de ses enfants et petits-enfants. Le père Grignon qui avait abrité le Blériot XI de la traversée avait eu ces mots : "Madame Blériot fut, pendant les jours qui ont précédé le départ, une aide précieuse pour son mari avec lequel elle venait chaque jour aux Baraques, se montrant aussi convaincue que lui de sa réussite, croyant en lui et en ses rêves. "BORDE Henri (1888-1958)
Peintre et sculpteur
 Henri BORDE, né le 4 septembre 1888 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 10 avril 1958 à Tarbes, à l’âge de 70 ans. Après des études secondaires au Lycée de Mont-de-Marsan, se destinant à la magistrature à l’instar de son père, il abandonne les études de droit pour se consacrer à la sculpture puis à la peinture, qu’il va étudier à Paris. Il commença à peindre en 1910, mais il fut d’abord sculpteur et c’est sous le parrainage du sculpteur originaire de Mont-de-Marsan, Charles Despiau, qu’il exposa au Salon d’Automne. Ce salon qui sera dominé après la Première Guerre mondiale par les œuvres des peintres de Montparnasse : Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Georges Braque et Georges Gimel. En 1909, préférant sa région aux fastes et excentricités de la capitale, il s’installa définitivement à Tarbes « au pays », où il fut professeur à l’École des Arts de la ville (aussi nommée l’École des beaux-arts). Il forma de nombreux élèves, dont Michel Zeller galeriste à Tarbes. Il aménagea son atelier rue Soult et réalisera des commandes publiques : il peindra les voûtes de la cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède avec l’ensemble de ses Anges musiciens et les scènes de la vie religieuse. Il réalisera deux fontaines sur les allées de Tarbes et les monuments aux morts de Juillan, Sarrancolin et Sarriac-Bigorre ainsi que la décoration d’une partie de la grande salle de réunion de la Chambre de commerce de la ville et celle du pavillon des trois B à l’Exposition universelle en 1937. Ses nombreux dessins trahissent la recherche de formes propre au sculpteur. Sa vie se partagera entre Tarbes, sa maison de campagne d’Ibos et le Pays basque, où il fera de fréquents séjours. Sa peinture personnelle, marquée par le classicisme, trouve des accents modernes pour représenter les aspects variés de la Bigorre, tant dans les paysages que dans les scènes de genre qui atteignent souvent une simplicité monumentale. Par-dessus tout, il aimait peindre des paysages, des scènes typiques de sa Bigorre, les gens de son entourage ou d’ailleurs, qu’ils soient de la montagne ou de la campagne, sans oublier ceux de la bourgeoisie tarbaise. Il n’aimait pas qu’on l’encense. Il se plaisait à dire : "La peinture, on n’en parle pas, on la regarde". Plusieurs de ses peintures et de ses œuvres se trouvent réparties dans les musées de Bagnères-de-Bigorre, Bayonne, Pau et Tarbes. Cet artiste complet de la fin de l’épisode romantique, qualifié de moderne, honore la Bigorre. Une place de Tarbes porte son nom (à l’entrée du jardin Massey), un livre lui a été consacré et des hommages publics à son talent lui ont été rendus.
Henri BORDE, né le 4 septembre 1888 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 10 avril 1958 à Tarbes, à l’âge de 70 ans. Après des études secondaires au Lycée de Mont-de-Marsan, se destinant à la magistrature à l’instar de son père, il abandonne les études de droit pour se consacrer à la sculpture puis à la peinture, qu’il va étudier à Paris. Il commença à peindre en 1910, mais il fut d’abord sculpteur et c’est sous le parrainage du sculpteur originaire de Mont-de-Marsan, Charles Despiau, qu’il exposa au Salon d’Automne. Ce salon qui sera dominé après la Première Guerre mondiale par les œuvres des peintres de Montparnasse : Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Georges Braque et Georges Gimel. En 1909, préférant sa région aux fastes et excentricités de la capitale, il s’installa définitivement à Tarbes « au pays », où il fut professeur à l’École des Arts de la ville (aussi nommée l’École des beaux-arts). Il forma de nombreux élèves, dont Michel Zeller galeriste à Tarbes. Il aménagea son atelier rue Soult et réalisera des commandes publiques : il peindra les voûtes de la cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède avec l’ensemble de ses Anges musiciens et les scènes de la vie religieuse. Il réalisera deux fontaines sur les allées de Tarbes et les monuments aux morts de Juillan, Sarrancolin et Sarriac-Bigorre ainsi que la décoration d’une partie de la grande salle de réunion de la Chambre de commerce de la ville et celle du pavillon des trois B à l’Exposition universelle en 1937. Ses nombreux dessins trahissent la recherche de formes propre au sculpteur. Sa vie se partagera entre Tarbes, sa maison de campagne d’Ibos et le Pays basque, où il fera de fréquents séjours. Sa peinture personnelle, marquée par le classicisme, trouve des accents modernes pour représenter les aspects variés de la Bigorre, tant dans les paysages que dans les scènes de genre qui atteignent souvent une simplicité monumentale. Par-dessus tout, il aimait peindre des paysages, des scènes typiques de sa Bigorre, les gens de son entourage ou d’ailleurs, qu’ils soient de la montagne ou de la campagne, sans oublier ceux de la bourgeoisie tarbaise. Il n’aimait pas qu’on l’encense. Il se plaisait à dire : "La peinture, on n’en parle pas, on la regarde". Plusieurs de ses peintures et de ses œuvres se trouvent réparties dans les musées de Bagnères-de-Bigorre, Bayonne, Pau et Tarbes. Cet artiste complet de la fin de l’épisode romantique, qualifié de moderne, honore la Bigorre. Une place de Tarbes porte son nom (à l’entrée du jardin Massey), un livre lui a été consacré et des hommages publics à son talent lui ont été rendus.
 Henri BORDE, né le 4 septembre 1888 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 10 avril 1958 à Tarbes, à l’âge de 70 ans. Après des études secondaires au Lycée de Mont-de-Marsan, se destinant à la magistrature à l’instar de son père, il abandonne les études de droit pour se consacrer à la sculpture puis à la peinture, qu’il va étudier à Paris. Il commença à peindre en 1910, mais il fut d’abord sculpteur et c’est sous le parrainage du sculpteur originaire de Mont-de-Marsan, Charles Despiau, qu’il exposa au Salon d’Automne. Ce salon qui sera dominé après la Première Guerre mondiale par les œuvres des peintres de Montparnasse : Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Georges Braque et Georges Gimel. En 1909, préférant sa région aux fastes et excentricités de la capitale, il s’installa définitivement à Tarbes « au pays », où il fut professeur à l’École des Arts de la ville (aussi nommée l’École des beaux-arts). Il forma de nombreux élèves, dont Michel Zeller galeriste à Tarbes. Il aménagea son atelier rue Soult et réalisera des commandes publiques : il peindra les voûtes de la cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède avec l’ensemble de ses Anges musiciens et les scènes de la vie religieuse. Il réalisera deux fontaines sur les allées de Tarbes et les monuments aux morts de Juillan, Sarrancolin et Sarriac-Bigorre ainsi que la décoration d’une partie de la grande salle de réunion de la Chambre de commerce de la ville et celle du pavillon des trois B à l’Exposition universelle en 1937. Ses nombreux dessins trahissent la recherche de formes propre au sculpteur. Sa vie se partagera entre Tarbes, sa maison de campagne d’Ibos et le Pays basque, où il fera de fréquents séjours. Sa peinture personnelle, marquée par le classicisme, trouve des accents modernes pour représenter les aspects variés de la Bigorre, tant dans les paysages que dans les scènes de genre qui atteignent souvent une simplicité monumentale. Par-dessus tout, il aimait peindre des paysages, des scènes typiques de sa Bigorre, les gens de son entourage ou d’ailleurs, qu’ils soient de la montagne ou de la campagne, sans oublier ceux de la bourgeoisie tarbaise. Il n’aimait pas qu’on l’encense. Il se plaisait à dire : "La peinture, on n’en parle pas, on la regarde". Plusieurs de ses peintures et de ses œuvres se trouvent réparties dans les musées de Bagnères-de-Bigorre, Bayonne, Pau et Tarbes. Cet artiste complet de la fin de l’épisode romantique, qualifié de moderne, honore la Bigorre. Une place de Tarbes porte son nom (à l’entrée du jardin Massey), un livre lui a été consacré et des hommages publics à son talent lui ont été rendus.
Henri BORDE, né le 4 septembre 1888 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 10 avril 1958 à Tarbes, à l’âge de 70 ans. Après des études secondaires au Lycée de Mont-de-Marsan, se destinant à la magistrature à l’instar de son père, il abandonne les études de droit pour se consacrer à la sculpture puis à la peinture, qu’il va étudier à Paris. Il commença à peindre en 1910, mais il fut d’abord sculpteur et c’est sous le parrainage du sculpteur originaire de Mont-de-Marsan, Charles Despiau, qu’il exposa au Salon d’Automne. Ce salon qui sera dominé après la Première Guerre mondiale par les œuvres des peintres de Montparnasse : Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Georges Braque et Georges Gimel. En 1909, préférant sa région aux fastes et excentricités de la capitale, il s’installa définitivement à Tarbes « au pays », où il fut professeur à l’École des Arts de la ville (aussi nommée l’École des beaux-arts). Il forma de nombreux élèves, dont Michel Zeller galeriste à Tarbes. Il aménagea son atelier rue Soult et réalisera des commandes publiques : il peindra les voûtes de la cathédrale Notre-Dame-de-la-Sède avec l’ensemble de ses Anges musiciens et les scènes de la vie religieuse. Il réalisera deux fontaines sur les allées de Tarbes et les monuments aux morts de Juillan, Sarrancolin et Sarriac-Bigorre ainsi que la décoration d’une partie de la grande salle de réunion de la Chambre de commerce de la ville et celle du pavillon des trois B à l’Exposition universelle en 1937. Ses nombreux dessins trahissent la recherche de formes propre au sculpteur. Sa vie se partagera entre Tarbes, sa maison de campagne d’Ibos et le Pays basque, où il fera de fréquents séjours. Sa peinture personnelle, marquée par le classicisme, trouve des accents modernes pour représenter les aspects variés de la Bigorre, tant dans les paysages que dans les scènes de genre qui atteignent souvent une simplicité monumentale. Par-dessus tout, il aimait peindre des paysages, des scènes typiques de sa Bigorre, les gens de son entourage ou d’ailleurs, qu’ils soient de la montagne ou de la campagne, sans oublier ceux de la bourgeoisie tarbaise. Il n’aimait pas qu’on l’encense. Il se plaisait à dire : "La peinture, on n’en parle pas, on la regarde". Plusieurs de ses peintures et de ses œuvres se trouvent réparties dans les musées de Bagnères-de-Bigorre, Bayonne, Pau et Tarbes. Cet artiste complet de la fin de l’épisode romantique, qualifié de moderne, honore la Bigorre. Une place de Tarbes porte son nom (à l’entrée du jardin Massey), un livre lui a été consacré et des hommages publics à son talent lui ont été rendus.BOURDETTE Jean (1818-1911)
Historien régionaliste, enseignant et naturaliste
 Jean BOURDETTE, né le 12 février 1818 à Argelès-Gazost et mort à Toulouse le 29 septembre 1911, à l’âge de 93 ans. Ingénieur agronome, diplômé de l’Institution royale agronomique de Grignon, il passa son enfance à Argelès-Gazost. Auteur connu pour ses travaux d’historien régionaliste consacrés au Lavedan, dont il commença la publication après l’âge de 70 ans, il est surtout réputé pour ses "Notices et Annales du Lavedan". Après une carrière professionnelle à Paris comme enseignant en sciences naturelles, collaborateur scientifique de l’astronome et mathématicien Le Verrier, directeur de la Mission Égyptienne, en 1878 il se retirera à Toulouse devenant membre de la Société botanique de France. Mais il semble que sa reconversion comme botaniste n’ait pas été très active, n’ayant publié que six articles dans ce domaine. Sa passion première étant surtout de faire connaître l’histoire du Lavedan, son pays d’enfance. Ainsi tous ses ouvrages seront consacrés à l’histoire du Lavedan et à quelques autres sites ou entités géographiques de Bigorre. Son œuvre a fait l’objet, en 1992, de plusieurs articles d’auteurs différents rassemblés sur le thème "Autour de Jean Bourdette" et publiés par la "Société d’Études des Sept Vallées". Il s’intéressa aussi à la lexicologie du gascon parlé en Lavedan, en relation avec Miquèu de Camelat, le poète et dramaturge d’Arrens-Marsous. Un manuscrit de quelque 1404 pages en 4 volumes est conservé dans Le musée Pyrénéen de Lourdes, qui s’intitule : Essai de vocabulaire du Gascon en Lavedan. Trois autres ouvrages témoignent aussi de recherches historiques sur d’autres territoires que le Lavedan : Le château et la ville de Lourdes, Notice des Barons des Angles et Notice du Nébouzan. Il est souvent cité comme l’historien du Lavedan. Sa tombe se trouve au cimetière d’Argelès-Gazost. Une rue et une école primaire portent son nom à Argelès-Gazost ainsi qu’une rue à Lourdes.
Jean BOURDETTE, né le 12 février 1818 à Argelès-Gazost et mort à Toulouse le 29 septembre 1911, à l’âge de 93 ans. Ingénieur agronome, diplômé de l’Institution royale agronomique de Grignon, il passa son enfance à Argelès-Gazost. Auteur connu pour ses travaux d’historien régionaliste consacrés au Lavedan, dont il commença la publication après l’âge de 70 ans, il est surtout réputé pour ses "Notices et Annales du Lavedan". Après une carrière professionnelle à Paris comme enseignant en sciences naturelles, collaborateur scientifique de l’astronome et mathématicien Le Verrier, directeur de la Mission Égyptienne, en 1878 il se retirera à Toulouse devenant membre de la Société botanique de France. Mais il semble que sa reconversion comme botaniste n’ait pas été très active, n’ayant publié que six articles dans ce domaine. Sa passion première étant surtout de faire connaître l’histoire du Lavedan, son pays d’enfance. Ainsi tous ses ouvrages seront consacrés à l’histoire du Lavedan et à quelques autres sites ou entités géographiques de Bigorre. Son œuvre a fait l’objet, en 1992, de plusieurs articles d’auteurs différents rassemblés sur le thème "Autour de Jean Bourdette" et publiés par la "Société d’Études des Sept Vallées". Il s’intéressa aussi à la lexicologie du gascon parlé en Lavedan, en relation avec Miquèu de Camelat, le poète et dramaturge d’Arrens-Marsous. Un manuscrit de quelque 1404 pages en 4 volumes est conservé dans Le musée Pyrénéen de Lourdes, qui s’intitule : Essai de vocabulaire du Gascon en Lavedan. Trois autres ouvrages témoignent aussi de recherches historiques sur d’autres territoires que le Lavedan : Le château et la ville de Lourdes, Notice des Barons des Angles et Notice du Nébouzan. Il est souvent cité comme l’historien du Lavedan. Sa tombe se trouve au cimetière d’Argelès-Gazost. Une rue et une école primaire portent son nom à Argelès-Gazost ainsi qu’une rue à Lourdes.
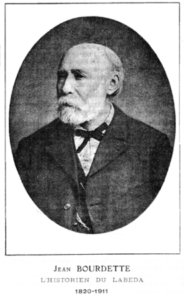 Jean BOURDETTE, né le 12 février 1818 à Argelès-Gazost et mort à Toulouse le 29 septembre 1911, à l’âge de 93 ans. Ingénieur agronome, diplômé de l’Institution royale agronomique de Grignon, il passa son enfance à Argelès-Gazost. Auteur connu pour ses travaux d’historien régionaliste consacrés au Lavedan, dont il commença la publication après l’âge de 70 ans, il est surtout réputé pour ses "Notices et Annales du Lavedan". Après une carrière professionnelle à Paris comme enseignant en sciences naturelles, collaborateur scientifique de l’astronome et mathématicien Le Verrier, directeur de la Mission Égyptienne, en 1878 il se retirera à Toulouse devenant membre de la Société botanique de France. Mais il semble que sa reconversion comme botaniste n’ait pas été très active, n’ayant publié que six articles dans ce domaine. Sa passion première étant surtout de faire connaître l’histoire du Lavedan, son pays d’enfance. Ainsi tous ses ouvrages seront consacrés à l’histoire du Lavedan et à quelques autres sites ou entités géographiques de Bigorre. Son œuvre a fait l’objet, en 1992, de plusieurs articles d’auteurs différents rassemblés sur le thème "Autour de Jean Bourdette" et publiés par la "Société d’Études des Sept Vallées". Il s’intéressa aussi à la lexicologie du gascon parlé en Lavedan, en relation avec Miquèu de Camelat, le poète et dramaturge d’Arrens-Marsous. Un manuscrit de quelque 1404 pages en 4 volumes est conservé dans Le musée Pyrénéen de Lourdes, qui s’intitule : Essai de vocabulaire du Gascon en Lavedan. Trois autres ouvrages témoignent aussi de recherches historiques sur d’autres territoires que le Lavedan : Le château et la ville de Lourdes, Notice des Barons des Angles et Notice du Nébouzan. Il est souvent cité comme l’historien du Lavedan. Sa tombe se trouve au cimetière d’Argelès-Gazost. Une rue et une école primaire portent son nom à Argelès-Gazost ainsi qu’une rue à Lourdes.
Jean BOURDETTE, né le 12 février 1818 à Argelès-Gazost et mort à Toulouse le 29 septembre 1911, à l’âge de 93 ans. Ingénieur agronome, diplômé de l’Institution royale agronomique de Grignon, il passa son enfance à Argelès-Gazost. Auteur connu pour ses travaux d’historien régionaliste consacrés au Lavedan, dont il commença la publication après l’âge de 70 ans, il est surtout réputé pour ses "Notices et Annales du Lavedan". Après une carrière professionnelle à Paris comme enseignant en sciences naturelles, collaborateur scientifique de l’astronome et mathématicien Le Verrier, directeur de la Mission Égyptienne, en 1878 il se retirera à Toulouse devenant membre de la Société botanique de France. Mais il semble que sa reconversion comme botaniste n’ait pas été très active, n’ayant publié que six articles dans ce domaine. Sa passion première étant surtout de faire connaître l’histoire du Lavedan, son pays d’enfance. Ainsi tous ses ouvrages seront consacrés à l’histoire du Lavedan et à quelques autres sites ou entités géographiques de Bigorre. Son œuvre a fait l’objet, en 1992, de plusieurs articles d’auteurs différents rassemblés sur le thème "Autour de Jean Bourdette" et publiés par la "Société d’Études des Sept Vallées". Il s’intéressa aussi à la lexicologie du gascon parlé en Lavedan, en relation avec Miquèu de Camelat, le poète et dramaturge d’Arrens-Marsous. Un manuscrit de quelque 1404 pages en 4 volumes est conservé dans Le musée Pyrénéen de Lourdes, qui s’intitule : Essai de vocabulaire du Gascon en Lavedan. Trois autres ouvrages témoignent aussi de recherches historiques sur d’autres territoires que le Lavedan : Le château et la ville de Lourdes, Notice des Barons des Angles et Notice du Nébouzan. Il est souvent cité comme l’historien du Lavedan. Sa tombe se trouve au cimetière d’Argelès-Gazost. Une rue et une école primaire portent son nom à Argelès-Gazost ainsi qu’une rue à Lourdes.BOUSSEMART Jean-Jacques (1963-XXXX)
Sprinteur spécialiste du 200 mètres, finaliste olympique
 Jean-Jacques BOUSSEMART, né le 11 avril 1963 à Lourdes, est un athlète spécialiste des épreuves de sprint. Licencié au Bordeaux EC, il remporte le 200 m des Championnats de France 1983 dans le temps de 20''60. Il participe aux Championnats du monde d'athlétisme 1983 à Helsinki et se classe huitième de l'épreuve du relais 4 x 100 mètres. En juin 1984, il remporte son deuxième titre national en 20''46, et établit le 1er juillet 1984 à Villeneuve-d'Ascq la meilleure performance de sa carrière sur 200 m avec le temps de 20''41. Sélectionné pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, il se classe sixième de la finale du 200 mètres (20''55) remportée par Carl Lewis et sixième du relais 4 x 100 m. Son palmarès : 22 sélections en équipe de France dont les titres de champion de France scolaire 1979, 1980, 1981 et 1982, champion de France cadet du 200 m en 1980, champion de France junior du 100 m en 1981, du 200 m en 1982, champion de France du 200 m en 1983 et 1984. Ses records personnels : 100 m : 10''33 ; 200 m : 20''41 ; 400 m : 45''73 ; 400 m haies : 50''97 ; 60 m : 6''67. Recordman de France du relais 4 x 200 m. Il exerce actuellement comme professeur d'éducation physique et sportive (EPS) au lycée Gustave Eiffel de Bordeaux. Il aura été 17 fois champion de France, toutes catégories confondues, aura participé à de nombreux championnats du monde et d’Europe et passé douze ans en équipe de France. Sa carrière sera mise sous l’éteignoir en raison d’une fracture de fatigue contractée en 1985. À 22 ans, il devra stopper le sprint et se lancera sur le 400 m, une distance qu’il n’affectionnera pas. Ses parents originaires du nord de la France avaient été instituteurs à Marsous et à Bun puis à Argelès-Gazost. Et leur fils Jean-Jacques restera l’un des rares français à avoir disputé une finale olympique. C’était en 1984 aux JO de Los Angeles.
Jean-Jacques BOUSSEMART, né le 11 avril 1963 à Lourdes, est un athlète spécialiste des épreuves de sprint. Licencié au Bordeaux EC, il remporte le 200 m des Championnats de France 1983 dans le temps de 20''60. Il participe aux Championnats du monde d'athlétisme 1983 à Helsinki et se classe huitième de l'épreuve du relais 4 x 100 mètres. En juin 1984, il remporte son deuxième titre national en 20''46, et établit le 1er juillet 1984 à Villeneuve-d'Ascq la meilleure performance de sa carrière sur 200 m avec le temps de 20''41. Sélectionné pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, il se classe sixième de la finale du 200 mètres (20''55) remportée par Carl Lewis et sixième du relais 4 x 100 m. Son palmarès : 22 sélections en équipe de France dont les titres de champion de France scolaire 1979, 1980, 1981 et 1982, champion de France cadet du 200 m en 1980, champion de France junior du 100 m en 1981, du 200 m en 1982, champion de France du 200 m en 1983 et 1984. Ses records personnels : 100 m : 10''33 ; 200 m : 20''41 ; 400 m : 45''73 ; 400 m haies : 50''97 ; 60 m : 6''67. Recordman de France du relais 4 x 200 m. Il exerce actuellement comme professeur d'éducation physique et sportive (EPS) au lycée Gustave Eiffel de Bordeaux. Il aura été 17 fois champion de France, toutes catégories confondues, aura participé à de nombreux championnats du monde et d’Europe et passé douze ans en équipe de France. Sa carrière sera mise sous l’éteignoir en raison d’une fracture de fatigue contractée en 1985. À 22 ans, il devra stopper le sprint et se lancera sur le 400 m, une distance qu’il n’affectionnera pas. Ses parents originaires du nord de la France avaient été instituteurs à Marsous et à Bun puis à Argelès-Gazost. Et leur fils Jean-Jacques restera l’un des rares français à avoir disputé une finale olympique. C’était en 1984 aux JO de Los Angeles.
 Jean-Jacques BOUSSEMART, né le 11 avril 1963 à Lourdes, est un athlète spécialiste des épreuves de sprint. Licencié au Bordeaux EC, il remporte le 200 m des Championnats de France 1983 dans le temps de 20''60. Il participe aux Championnats du monde d'athlétisme 1983 à Helsinki et se classe huitième de l'épreuve du relais 4 x 100 mètres. En juin 1984, il remporte son deuxième titre national en 20''46, et établit le 1er juillet 1984 à Villeneuve-d'Ascq la meilleure performance de sa carrière sur 200 m avec le temps de 20''41. Sélectionné pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, il se classe sixième de la finale du 200 mètres (20''55) remportée par Carl Lewis et sixième du relais 4 x 100 m. Son palmarès : 22 sélections en équipe de France dont les titres de champion de France scolaire 1979, 1980, 1981 et 1982, champion de France cadet du 200 m en 1980, champion de France junior du 100 m en 1981, du 200 m en 1982, champion de France du 200 m en 1983 et 1984. Ses records personnels : 100 m : 10''33 ; 200 m : 20''41 ; 400 m : 45''73 ; 400 m haies : 50''97 ; 60 m : 6''67. Recordman de France du relais 4 x 200 m. Il exerce actuellement comme professeur d'éducation physique et sportive (EPS) au lycée Gustave Eiffel de Bordeaux. Il aura été 17 fois champion de France, toutes catégories confondues, aura participé à de nombreux championnats du monde et d’Europe et passé douze ans en équipe de France. Sa carrière sera mise sous l’éteignoir en raison d’une fracture de fatigue contractée en 1985. À 22 ans, il devra stopper le sprint et se lancera sur le 400 m, une distance qu’il n’affectionnera pas. Ses parents originaires du nord de la France avaient été instituteurs à Marsous et à Bun puis à Argelès-Gazost. Et leur fils Jean-Jacques restera l’un des rares français à avoir disputé une finale olympique. C’était en 1984 aux JO de Los Angeles.
Jean-Jacques BOUSSEMART, né le 11 avril 1963 à Lourdes, est un athlète spécialiste des épreuves de sprint. Licencié au Bordeaux EC, il remporte le 200 m des Championnats de France 1983 dans le temps de 20''60. Il participe aux Championnats du monde d'athlétisme 1983 à Helsinki et se classe huitième de l'épreuve du relais 4 x 100 mètres. En juin 1984, il remporte son deuxième titre national en 20''46, et établit le 1er juillet 1984 à Villeneuve-d'Ascq la meilleure performance de sa carrière sur 200 m avec le temps de 20''41. Sélectionné pour les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984, il se classe sixième de la finale du 200 mètres (20''55) remportée par Carl Lewis et sixième du relais 4 x 100 m. Son palmarès : 22 sélections en équipe de France dont les titres de champion de France scolaire 1979, 1980, 1981 et 1982, champion de France cadet du 200 m en 1980, champion de France junior du 100 m en 1981, du 200 m en 1982, champion de France du 200 m en 1983 et 1984. Ses records personnels : 100 m : 10''33 ; 200 m : 20''41 ; 400 m : 45''73 ; 400 m haies : 50''97 ; 60 m : 6''67. Recordman de France du relais 4 x 200 m. Il exerce actuellement comme professeur d'éducation physique et sportive (EPS) au lycée Gustave Eiffel de Bordeaux. Il aura été 17 fois champion de France, toutes catégories confondues, aura participé à de nombreux championnats du monde et d’Europe et passé douze ans en équipe de France. Sa carrière sera mise sous l’éteignoir en raison d’une fracture de fatigue contractée en 1985. À 22 ans, il devra stopper le sprint et se lancera sur le 400 m, une distance qu’il n’affectionnera pas. Ses parents originaires du nord de la France avaient été instituteurs à Marsous et à Bun puis à Argelès-Gazost. Et leur fils Jean-Jacques restera l’un des rares français à avoir disputé une finale olympique. C’était en 1984 aux JO de Los Angeles.BRAU Joseph (1891-1975)
Médecin radiologue, colonel honoraire de l’Armée française et résistant, déporté à Buchenwald.
 Joseph BRAU, né le 26 avril 1891 à Trébons et mort le 11 mai 1975 à Seignosse dans les Landes, à l’âge de 84 ans. Il est le cadet d'une famille de quatre enfants : Frédéric, Zéphire, Jean et Joseph. Joseph Brau intègre l'école publique avec deux ans de retard : il ne parle que le patois. Il obtient son certificat d'études secondaires du 1er degré en juillet 1906 à Toulouse, puis son baccalauréat en mars 1910 et son certificat d'études physiques, chimiques et naturelles en juillet de la même année, toujours à Toulouse. Reçu au concours d'entrée à l'École du service de santé des armées, il intègre ce qui deviendra plus tard l'École Santé navale de Lyon. Il obtient son diplôme en juillet 1914 puis soutient une thèse de doctorat en médecine en mars 1917, pendant la Première Guerre mondiale, et se spécialise en électroradiologie. Mobilisé comme médecin chef d’un hôpital auxiliaire dans le Jura le 19 septembre 1939, il y fait son devoir, comme il l’a déjà fait d’août 1914 à octobre 1919, sur divers fronts. Il est démobilisé en août 1940, rentre à son domicile de la région parisienne et s’engage, en 1941, avec son ami et associé à la clinique de la rue des Moulins à Coulommiers, le Dr Pierre Berson, dans le réseau de résistance « Hector » sous les ordres du capitaine Rouard, commandant les compagnies des vallées de la Marne, sous le pseudonyme de « Bertrand ». Combattant volontaire de la Résistance, membre des Forces françaises combattantes, grâce à sa carte professionnelle, il peut circuler dans des zones « interdites » et fournir ainsi aux alliés de précieuses informations comme les positions exactes des emplacements des matériels de lutte antiaérienne. Après le démantèlement du réseau en 1943, suite à une dénonciation, il décide de fuir la France par l’Espagne pour rejoindre Londres, mais il est arrêté à Bedous dans les Basses-Pyrénées, en juillet 1943, avant de pouvoir passer la frontière. Il redoute de ne pouvoir résister à la torture. Il est porteur de trop d'informations concernant la Résistance. Il tente donc de se suicider avec des médicaments et tombe dans un état comateux. Les Allemands le font soigner et le transfèrent au siège de la Gestapo, à Oloron-Sainte-Marie, pour y subir un interrogatoire et face à son refus de signer toute déposition rédigée en allemand, langue qu'il ne connaît pas, il sera emprisonné en août au Fort du Hâ à Bordeaux. En septembre, il est transféré à Compiègne, au Frontstalag 122, avant d’être déporté à Buchenwald dans le convoi I.145, parti le 28 octobre. Il arrive à Buchenwald le 31 octobre 1943, avec le matricule 31299. Après la quarantaine, il a la chance d’être nommé au Revier (baraquement destiné aux prisonniers malades des camps – ce mot était prononcé par les déportés français « revir »), dont il devient le premier médecin français. Le Dr Joseph Brau sait se faire accepter et reconnaître par sa compétence et son dévouement. Avant sa nomination, pour être admis au Revier, il fallait avoir une température élevée. Joseph Brau obtient l’admission de malades sans fièvre, sur la seule autorité de son diagnostic. Pour les déportés qui y sont admis, c’est une chance car, même si le lieu est dépourvu de moyens, les malades y trouvent la possibilité de ne pas participer à l’appel, d’échapper au travail et d’avoir quelques jours de repos qui peuvent leur sauver la vie. L’appareil de radio de Joseph Brau fonctionne au maximum, passant de trois clichés par jour à son arrivée à une cinquantaine à la libération du camp. Le docteur Joseph Brau sait toujours « interpréter » ses radios de façon à sauver le plus grand nombre de déportés du sort qui les attend. Au Revier, durant toute sa période d’emprisonnement, il s’attachera à améliorer l’existence des malades du camp, les conditions de vie des prisonniers et d'en sauver d'autres le plus possible. Dans le cadre du Comité des intérêts français (CIF), il est nommé président du Comité du corps médical français. Au Revier, des conférences médicales dans chaque langue sont organisées tous les samedis pour améliorer l’efficacité des diagnostics et des soins. Joseph Brau a la charge d’organiser les conférences en français. Le 12 avril 1945, le camp de Buchenwald est libéré. Le lieutenant-colonel Joseph Brau, le plus élevé en grade parmi les médecins détenus, est nommé médecin chef chargé de l’administration du Revier et du service de santé du camp par le colonel des Rangers de la troisième armée américaine. Fin avril, il est rapatrié avec les derniers déportés français hospitalisés au Revier, et il rapporte avec lui toutes les archives du Revier concernant les Français, qu’il remet aux autorités gouvernementales de son pays. A son retour, le Docteur Joseph Brau témoigne de la moralité de ses camarades d’infortune chaque fois que cela lui est demandé, en particulier au colonel Frédéric-Henri Manhès et à Marcel Paul, dont les actions dans le cadre du CIF sont, à plusieurs reprises, très sévèrement contestées après la Libération, et établit des certificats médicaux pour les anciens détenus qui le demandent. Revenu dans la vie civile, et en parallèle de son activité de médecin, il poursuit donc activement son militantisme contre le fascisme et celui pour le devoir de mémoire des camps. Il entretient des relations suivies avec nombre de ses anciens camarades d'infortune dont Ernst Busse (futur vice-ministre-président, ministre de l'Intérieur et secrétaire d’État aux Eaux et Forêts du Land de Thuringe), Marcel Paul (ministre de la Production industrielle de novembre 1945 à décembre 1946, dans les gouvernements de Charles de Gaulle, Félix Gouin et Georges Bidault), le colonel Frédéric-Henri Manhès, Albert Forcinal, le Dr Jean Rousset, le Dr Jean Lansac, Nicolas Simon dit « Gandhi », Aloïs Grimm. Il est membre du comité national de la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes (FNDIRP), membre de l'amicale de Buchenwald-Dora et Kommandos, qui deviendra l'Association française Buchenwald-Dora et Kommandos. Il prend sa retraite de médecin radiologue civil en 1956. En 1963, il reçoit à Berlin-Est la Médaille für Kämpfer gegen den Faschismus (médaille de la Lutte contre le fascisme) du Conseil des ministres de la RDA. Ses souvenirs détaillés de résistant et de déporté à Buchenwald sont consignés dans un livre, « Ici, chacun son dû (à tort ou à raison) », écrit en 1973 par Lucien Cariat, instituteur membre du groupe de résistance Vengeance, et dont Marcel Paul a rédigé l’introduction. Après la guerre, en 1955, il est élu conseiller général du canton de La Ferté-sous-Jouarre, dans le département de Seine-et-Marne, et réélu en 1961. Le 31 mars 1973, dans la cour de l'hôtel des Invalides à Paris, le président Georges Pompidou lui remet la Croix de Grand Officier de la Légion d’Honneur. Pendant les trente dernières années de sa vie Joseph Brau a l’habitude de passer tous ses moments de liberté en famille dans les Landes, à Hossegor puis à Seignosse, où il se retire définitivement en 1971, et où il meurt le 11 mai 1975. Durant sa vie, il se verra attribuer de nombreux titres et décorations : la croix de guerre avec palme (1917), une citation à l’ordre de la IVe armée, une citation à l’ordre de la 46e division d’occupation de Haute-Silésie (1921), la croix de guerre des TOE avec étoile d’argent (1922), la médaille commémorative de Haute-Silésie, la médaille coloniale agrafe Maroc (1924), promu chevalier de la Légion d’honneur (1925), la médaille d’argent de l’Académie de médecine, la médaille commémorative d’Orient (1926), le grade de médecin lieutenant-colonel (1940), la médaille commémorative d’Orient avec inscription « Orient », la croix de guerre 1939-1945, promu officier de la Légion d’honneur, une citation à l’ordre du corps d'armée (1947), la croix de guerre avec étoile de vermeil, la médaille d'honneur des épidémies (1948), élevé au rang de médecin colonel (1949), admission à l'honorariat du grade de colonel (1953), titre de Combattant volontaire de la Résistance (1953), attestation d’appartenance aux Forces françaises combattantes du réseau Hector (1956), promu commandeur de la Légion d’honneur en qualité de mutilé de guerre (1961), la croix de Guerre 1939-1945 avec palme, la médaille Kämpfer gegen den Faschismus 1933-1945 du Conseil des ministres de la RDA (1963), la médaille de la Reconnaissance de la FNDIRP (1967), la croix du combattant volontaire 1939-1945 (1968), élevé à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur (1973). La commune de La Ferté-sous-Jouarre a baptisé dans les années 1980 une de ses écoles maternelles du nom du Docteur Brau. Une plaque commémorative rappelant Joseph Brau a été apposée le 18 novembre 1995 sur le mur de l'école. Le samedi 11 avril 2015, à Trébons, en mémoire du Dr Joseph Brau (1891-1975), une plaque commémorative scellée sur la façade de sa maison natale a été dévoilée par Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, préfète des Hautes-Pyrénées, et Yves Pujo, maire de la commune. Le 7 juin 2016, le maire de Seignosse, et les élus de son équipe, ont inauguré une rue d’un nouveau quartier résidentiel de Seignosse, baptisée du patronyme de la famille de cet illustre résistant seignossais, le docteur Joseph Brau.
Joseph BRAU, né le 26 avril 1891 à Trébons et mort le 11 mai 1975 à Seignosse dans les Landes, à l’âge de 84 ans. Il est le cadet d'une famille de quatre enfants : Frédéric, Zéphire, Jean et Joseph. Joseph Brau intègre l'école publique avec deux ans de retard : il ne parle que le patois. Il obtient son certificat d'études secondaires du 1er degré en juillet 1906 à Toulouse, puis son baccalauréat en mars 1910 et son certificat d'études physiques, chimiques et naturelles en juillet de la même année, toujours à Toulouse. Reçu au concours d'entrée à l'École du service de santé des armées, il intègre ce qui deviendra plus tard l'École Santé navale de Lyon. Il obtient son diplôme en juillet 1914 puis soutient une thèse de doctorat en médecine en mars 1917, pendant la Première Guerre mondiale, et se spécialise en électroradiologie. Mobilisé comme médecin chef d’un hôpital auxiliaire dans le Jura le 19 septembre 1939, il y fait son devoir, comme il l’a déjà fait d’août 1914 à octobre 1919, sur divers fronts. Il est démobilisé en août 1940, rentre à son domicile de la région parisienne et s’engage, en 1941, avec son ami et associé à la clinique de la rue des Moulins à Coulommiers, le Dr Pierre Berson, dans le réseau de résistance « Hector » sous les ordres du capitaine Rouard, commandant les compagnies des vallées de la Marne, sous le pseudonyme de « Bertrand ». Combattant volontaire de la Résistance, membre des Forces françaises combattantes, grâce à sa carte professionnelle, il peut circuler dans des zones « interdites » et fournir ainsi aux alliés de précieuses informations comme les positions exactes des emplacements des matériels de lutte antiaérienne. Après le démantèlement du réseau en 1943, suite à une dénonciation, il décide de fuir la France par l’Espagne pour rejoindre Londres, mais il est arrêté à Bedous dans les Basses-Pyrénées, en juillet 1943, avant de pouvoir passer la frontière. Il redoute de ne pouvoir résister à la torture. Il est porteur de trop d'informations concernant la Résistance. Il tente donc de se suicider avec des médicaments et tombe dans un état comateux. Les Allemands le font soigner et le transfèrent au siège de la Gestapo, à Oloron-Sainte-Marie, pour y subir un interrogatoire et face à son refus de signer toute déposition rédigée en allemand, langue qu'il ne connaît pas, il sera emprisonné en août au Fort du Hâ à Bordeaux. En septembre, il est transféré à Compiègne, au Frontstalag 122, avant d’être déporté à Buchenwald dans le convoi I.145, parti le 28 octobre. Il arrive à Buchenwald le 31 octobre 1943, avec le matricule 31299. Après la quarantaine, il a la chance d’être nommé au Revier (baraquement destiné aux prisonniers malades des camps – ce mot était prononcé par les déportés français « revir »), dont il devient le premier médecin français. Le Dr Joseph Brau sait se faire accepter et reconnaître par sa compétence et son dévouement. Avant sa nomination, pour être admis au Revier, il fallait avoir une température élevée. Joseph Brau obtient l’admission de malades sans fièvre, sur la seule autorité de son diagnostic. Pour les déportés qui y sont admis, c’est une chance car, même si le lieu est dépourvu de moyens, les malades y trouvent la possibilité de ne pas participer à l’appel, d’échapper au travail et d’avoir quelques jours de repos qui peuvent leur sauver la vie. L’appareil de radio de Joseph Brau fonctionne au maximum, passant de trois clichés par jour à son arrivée à une cinquantaine à la libération du camp. Le docteur Joseph Brau sait toujours « interpréter » ses radios de façon à sauver le plus grand nombre de déportés du sort qui les attend. Au Revier, durant toute sa période d’emprisonnement, il s’attachera à améliorer l’existence des malades du camp, les conditions de vie des prisonniers et d'en sauver d'autres le plus possible. Dans le cadre du Comité des intérêts français (CIF), il est nommé président du Comité du corps médical français. Au Revier, des conférences médicales dans chaque langue sont organisées tous les samedis pour améliorer l’efficacité des diagnostics et des soins. Joseph Brau a la charge d’organiser les conférences en français. Le 12 avril 1945, le camp de Buchenwald est libéré. Le lieutenant-colonel Joseph Brau, le plus élevé en grade parmi les médecins détenus, est nommé médecin chef chargé de l’administration du Revier et du service de santé du camp par le colonel des Rangers de la troisième armée américaine. Fin avril, il est rapatrié avec les derniers déportés français hospitalisés au Revier, et il rapporte avec lui toutes les archives du Revier concernant les Français, qu’il remet aux autorités gouvernementales de son pays. A son retour, le Docteur Joseph Brau témoigne de la moralité de ses camarades d’infortune chaque fois que cela lui est demandé, en particulier au colonel Frédéric-Henri Manhès et à Marcel Paul, dont les actions dans le cadre du CIF sont, à plusieurs reprises, très sévèrement contestées après la Libération, et établit des certificats médicaux pour les anciens détenus qui le demandent. Revenu dans la vie civile, et en parallèle de son activité de médecin, il poursuit donc activement son militantisme contre le fascisme et celui pour le devoir de mémoire des camps. Il entretient des relations suivies avec nombre de ses anciens camarades d'infortune dont Ernst Busse (futur vice-ministre-président, ministre de l'Intérieur et secrétaire d’État aux Eaux et Forêts du Land de Thuringe), Marcel Paul (ministre de la Production industrielle de novembre 1945 à décembre 1946, dans les gouvernements de Charles de Gaulle, Félix Gouin et Georges Bidault), le colonel Frédéric-Henri Manhès, Albert Forcinal, le Dr Jean Rousset, le Dr Jean Lansac, Nicolas Simon dit « Gandhi », Aloïs Grimm. Il est membre du comité national de la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes (FNDIRP), membre de l'amicale de Buchenwald-Dora et Kommandos, qui deviendra l'Association française Buchenwald-Dora et Kommandos. Il prend sa retraite de médecin radiologue civil en 1956. En 1963, il reçoit à Berlin-Est la Médaille für Kämpfer gegen den Faschismus (médaille de la Lutte contre le fascisme) du Conseil des ministres de la RDA. Ses souvenirs détaillés de résistant et de déporté à Buchenwald sont consignés dans un livre, « Ici, chacun son dû (à tort ou à raison) », écrit en 1973 par Lucien Cariat, instituteur membre du groupe de résistance Vengeance, et dont Marcel Paul a rédigé l’introduction. Après la guerre, en 1955, il est élu conseiller général du canton de La Ferté-sous-Jouarre, dans le département de Seine-et-Marne, et réélu en 1961. Le 31 mars 1973, dans la cour de l'hôtel des Invalides à Paris, le président Georges Pompidou lui remet la Croix de Grand Officier de la Légion d’Honneur. Pendant les trente dernières années de sa vie Joseph Brau a l’habitude de passer tous ses moments de liberté en famille dans les Landes, à Hossegor puis à Seignosse, où il se retire définitivement en 1971, et où il meurt le 11 mai 1975. Durant sa vie, il se verra attribuer de nombreux titres et décorations : la croix de guerre avec palme (1917), une citation à l’ordre de la IVe armée, une citation à l’ordre de la 46e division d’occupation de Haute-Silésie (1921), la croix de guerre des TOE avec étoile d’argent (1922), la médaille commémorative de Haute-Silésie, la médaille coloniale agrafe Maroc (1924), promu chevalier de la Légion d’honneur (1925), la médaille d’argent de l’Académie de médecine, la médaille commémorative d’Orient (1926), le grade de médecin lieutenant-colonel (1940), la médaille commémorative d’Orient avec inscription « Orient », la croix de guerre 1939-1945, promu officier de la Légion d’honneur, une citation à l’ordre du corps d'armée (1947), la croix de guerre avec étoile de vermeil, la médaille d'honneur des épidémies (1948), élevé au rang de médecin colonel (1949), admission à l'honorariat du grade de colonel (1953), titre de Combattant volontaire de la Résistance (1953), attestation d’appartenance aux Forces françaises combattantes du réseau Hector (1956), promu commandeur de la Légion d’honneur en qualité de mutilé de guerre (1961), la croix de Guerre 1939-1945 avec palme, la médaille Kämpfer gegen den Faschismus 1933-1945 du Conseil des ministres de la RDA (1963), la médaille de la Reconnaissance de la FNDIRP (1967), la croix du combattant volontaire 1939-1945 (1968), élevé à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur (1973). La commune de La Ferté-sous-Jouarre a baptisé dans les années 1980 une de ses écoles maternelles du nom du Docteur Brau. Une plaque commémorative rappelant Joseph Brau a été apposée le 18 novembre 1995 sur le mur de l'école. Le samedi 11 avril 2015, à Trébons, en mémoire du Dr Joseph Brau (1891-1975), une plaque commémorative scellée sur la façade de sa maison natale a été dévoilée par Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, préfète des Hautes-Pyrénées, et Yves Pujo, maire de la commune. Le 7 juin 2016, le maire de Seignosse, et les élus de son équipe, ont inauguré une rue d’un nouveau quartier résidentiel de Seignosse, baptisée du patronyme de la famille de cet illustre résistant seignossais, le docteur Joseph Brau.
 Joseph BRAU, né le 26 avril 1891 à Trébons et mort le 11 mai 1975 à Seignosse dans les Landes, à l’âge de 84 ans. Il est le cadet d'une famille de quatre enfants : Frédéric, Zéphire, Jean et Joseph. Joseph Brau intègre l'école publique avec deux ans de retard : il ne parle que le patois. Il obtient son certificat d'études secondaires du 1er degré en juillet 1906 à Toulouse, puis son baccalauréat en mars 1910 et son certificat d'études physiques, chimiques et naturelles en juillet de la même année, toujours à Toulouse. Reçu au concours d'entrée à l'École du service de santé des armées, il intègre ce qui deviendra plus tard l'École Santé navale de Lyon. Il obtient son diplôme en juillet 1914 puis soutient une thèse de doctorat en médecine en mars 1917, pendant la Première Guerre mondiale, et se spécialise en électroradiologie. Mobilisé comme médecin chef d’un hôpital auxiliaire dans le Jura le 19 septembre 1939, il y fait son devoir, comme il l’a déjà fait d’août 1914 à octobre 1919, sur divers fronts. Il est démobilisé en août 1940, rentre à son domicile de la région parisienne et s’engage, en 1941, avec son ami et associé à la clinique de la rue des Moulins à Coulommiers, le Dr Pierre Berson, dans le réseau de résistance « Hector » sous les ordres du capitaine Rouard, commandant les compagnies des vallées de la Marne, sous le pseudonyme de « Bertrand ». Combattant volontaire de la Résistance, membre des Forces françaises combattantes, grâce à sa carte professionnelle, il peut circuler dans des zones « interdites » et fournir ainsi aux alliés de précieuses informations comme les positions exactes des emplacements des matériels de lutte antiaérienne. Après le démantèlement du réseau en 1943, suite à une dénonciation, il décide de fuir la France par l’Espagne pour rejoindre Londres, mais il est arrêté à Bedous dans les Basses-Pyrénées, en juillet 1943, avant de pouvoir passer la frontière. Il redoute de ne pouvoir résister à la torture. Il est porteur de trop d'informations concernant la Résistance. Il tente donc de se suicider avec des médicaments et tombe dans un état comateux. Les Allemands le font soigner et le transfèrent au siège de la Gestapo, à Oloron-Sainte-Marie, pour y subir un interrogatoire et face à son refus de signer toute déposition rédigée en allemand, langue qu'il ne connaît pas, il sera emprisonné en août au Fort du Hâ à Bordeaux. En septembre, il est transféré à Compiègne, au Frontstalag 122, avant d’être déporté à Buchenwald dans le convoi I.145, parti le 28 octobre. Il arrive à Buchenwald le 31 octobre 1943, avec le matricule 31299. Après la quarantaine, il a la chance d’être nommé au Revier (baraquement destiné aux prisonniers malades des camps – ce mot était prononcé par les déportés français « revir »), dont il devient le premier médecin français. Le Dr Joseph Brau sait se faire accepter et reconnaître par sa compétence et son dévouement. Avant sa nomination, pour être admis au Revier, il fallait avoir une température élevée. Joseph Brau obtient l’admission de malades sans fièvre, sur la seule autorité de son diagnostic. Pour les déportés qui y sont admis, c’est une chance car, même si le lieu est dépourvu de moyens, les malades y trouvent la possibilité de ne pas participer à l’appel, d’échapper au travail et d’avoir quelques jours de repos qui peuvent leur sauver la vie. L’appareil de radio de Joseph Brau fonctionne au maximum, passant de trois clichés par jour à son arrivée à une cinquantaine à la libération du camp. Le docteur Joseph Brau sait toujours « interpréter » ses radios de façon à sauver le plus grand nombre de déportés du sort qui les attend. Au Revier, durant toute sa période d’emprisonnement, il s’attachera à améliorer l’existence des malades du camp, les conditions de vie des prisonniers et d'en sauver d'autres le plus possible. Dans le cadre du Comité des intérêts français (CIF), il est nommé président du Comité du corps médical français. Au Revier, des conférences médicales dans chaque langue sont organisées tous les samedis pour améliorer l’efficacité des diagnostics et des soins. Joseph Brau a la charge d’organiser les conférences en français. Le 12 avril 1945, le camp de Buchenwald est libéré. Le lieutenant-colonel Joseph Brau, le plus élevé en grade parmi les médecins détenus, est nommé médecin chef chargé de l’administration du Revier et du service de santé du camp par le colonel des Rangers de la troisième armée américaine. Fin avril, il est rapatrié avec les derniers déportés français hospitalisés au Revier, et il rapporte avec lui toutes les archives du Revier concernant les Français, qu’il remet aux autorités gouvernementales de son pays. A son retour, le Docteur Joseph Brau témoigne de la moralité de ses camarades d’infortune chaque fois que cela lui est demandé, en particulier au colonel Frédéric-Henri Manhès et à Marcel Paul, dont les actions dans le cadre du CIF sont, à plusieurs reprises, très sévèrement contestées après la Libération, et établit des certificats médicaux pour les anciens détenus qui le demandent. Revenu dans la vie civile, et en parallèle de son activité de médecin, il poursuit donc activement son militantisme contre le fascisme et celui pour le devoir de mémoire des camps. Il entretient des relations suivies avec nombre de ses anciens camarades d'infortune dont Ernst Busse (futur vice-ministre-président, ministre de l'Intérieur et secrétaire d’État aux Eaux et Forêts du Land de Thuringe), Marcel Paul (ministre de la Production industrielle de novembre 1945 à décembre 1946, dans les gouvernements de Charles de Gaulle, Félix Gouin et Georges Bidault), le colonel Frédéric-Henri Manhès, Albert Forcinal, le Dr Jean Rousset, le Dr Jean Lansac, Nicolas Simon dit « Gandhi », Aloïs Grimm. Il est membre du comité national de la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes (FNDIRP), membre de l'amicale de Buchenwald-Dora et Kommandos, qui deviendra l'Association française Buchenwald-Dora et Kommandos. Il prend sa retraite de médecin radiologue civil en 1956. En 1963, il reçoit à Berlin-Est la Médaille für Kämpfer gegen den Faschismus (médaille de la Lutte contre le fascisme) du Conseil des ministres de la RDA. Ses souvenirs détaillés de résistant et de déporté à Buchenwald sont consignés dans un livre, « Ici, chacun son dû (à tort ou à raison) », écrit en 1973 par Lucien Cariat, instituteur membre du groupe de résistance Vengeance, et dont Marcel Paul a rédigé l’introduction. Après la guerre, en 1955, il est élu conseiller général du canton de La Ferté-sous-Jouarre, dans le département de Seine-et-Marne, et réélu en 1961. Le 31 mars 1973, dans la cour de l'hôtel des Invalides à Paris, le président Georges Pompidou lui remet la Croix de Grand Officier de la Légion d’Honneur. Pendant les trente dernières années de sa vie Joseph Brau a l’habitude de passer tous ses moments de liberté en famille dans les Landes, à Hossegor puis à Seignosse, où il se retire définitivement en 1971, et où il meurt le 11 mai 1975. Durant sa vie, il se verra attribuer de nombreux titres et décorations : la croix de guerre avec palme (1917), une citation à l’ordre de la IVe armée, une citation à l’ordre de la 46e division d’occupation de Haute-Silésie (1921), la croix de guerre des TOE avec étoile d’argent (1922), la médaille commémorative de Haute-Silésie, la médaille coloniale agrafe Maroc (1924), promu chevalier de la Légion d’honneur (1925), la médaille d’argent de l’Académie de médecine, la médaille commémorative d’Orient (1926), le grade de médecin lieutenant-colonel (1940), la médaille commémorative d’Orient avec inscription « Orient », la croix de guerre 1939-1945, promu officier de la Légion d’honneur, une citation à l’ordre du corps d'armée (1947), la croix de guerre avec étoile de vermeil, la médaille d'honneur des épidémies (1948), élevé au rang de médecin colonel (1949), admission à l'honorariat du grade de colonel (1953), titre de Combattant volontaire de la Résistance (1953), attestation d’appartenance aux Forces françaises combattantes du réseau Hector (1956), promu commandeur de la Légion d’honneur en qualité de mutilé de guerre (1961), la croix de Guerre 1939-1945 avec palme, la médaille Kämpfer gegen den Faschismus 1933-1945 du Conseil des ministres de la RDA (1963), la médaille de la Reconnaissance de la FNDIRP (1967), la croix du combattant volontaire 1939-1945 (1968), élevé à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur (1973). La commune de La Ferté-sous-Jouarre a baptisé dans les années 1980 une de ses écoles maternelles du nom du Docteur Brau. Une plaque commémorative rappelant Joseph Brau a été apposée le 18 novembre 1995 sur le mur de l'école. Le samedi 11 avril 2015, à Trébons, en mémoire du Dr Joseph Brau (1891-1975), une plaque commémorative scellée sur la façade de sa maison natale a été dévoilée par Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, préfète des Hautes-Pyrénées, et Yves Pujo, maire de la commune. Le 7 juin 2016, le maire de Seignosse, et les élus de son équipe, ont inauguré une rue d’un nouveau quartier résidentiel de Seignosse, baptisée du patronyme de la famille de cet illustre résistant seignossais, le docteur Joseph Brau.
Joseph BRAU, né le 26 avril 1891 à Trébons et mort le 11 mai 1975 à Seignosse dans les Landes, à l’âge de 84 ans. Il est le cadet d'une famille de quatre enfants : Frédéric, Zéphire, Jean et Joseph. Joseph Brau intègre l'école publique avec deux ans de retard : il ne parle que le patois. Il obtient son certificat d'études secondaires du 1er degré en juillet 1906 à Toulouse, puis son baccalauréat en mars 1910 et son certificat d'études physiques, chimiques et naturelles en juillet de la même année, toujours à Toulouse. Reçu au concours d'entrée à l'École du service de santé des armées, il intègre ce qui deviendra plus tard l'École Santé navale de Lyon. Il obtient son diplôme en juillet 1914 puis soutient une thèse de doctorat en médecine en mars 1917, pendant la Première Guerre mondiale, et se spécialise en électroradiologie. Mobilisé comme médecin chef d’un hôpital auxiliaire dans le Jura le 19 septembre 1939, il y fait son devoir, comme il l’a déjà fait d’août 1914 à octobre 1919, sur divers fronts. Il est démobilisé en août 1940, rentre à son domicile de la région parisienne et s’engage, en 1941, avec son ami et associé à la clinique de la rue des Moulins à Coulommiers, le Dr Pierre Berson, dans le réseau de résistance « Hector » sous les ordres du capitaine Rouard, commandant les compagnies des vallées de la Marne, sous le pseudonyme de « Bertrand ». Combattant volontaire de la Résistance, membre des Forces françaises combattantes, grâce à sa carte professionnelle, il peut circuler dans des zones « interdites » et fournir ainsi aux alliés de précieuses informations comme les positions exactes des emplacements des matériels de lutte antiaérienne. Après le démantèlement du réseau en 1943, suite à une dénonciation, il décide de fuir la France par l’Espagne pour rejoindre Londres, mais il est arrêté à Bedous dans les Basses-Pyrénées, en juillet 1943, avant de pouvoir passer la frontière. Il redoute de ne pouvoir résister à la torture. Il est porteur de trop d'informations concernant la Résistance. Il tente donc de se suicider avec des médicaments et tombe dans un état comateux. Les Allemands le font soigner et le transfèrent au siège de la Gestapo, à Oloron-Sainte-Marie, pour y subir un interrogatoire et face à son refus de signer toute déposition rédigée en allemand, langue qu'il ne connaît pas, il sera emprisonné en août au Fort du Hâ à Bordeaux. En septembre, il est transféré à Compiègne, au Frontstalag 122, avant d’être déporté à Buchenwald dans le convoi I.145, parti le 28 octobre. Il arrive à Buchenwald le 31 octobre 1943, avec le matricule 31299. Après la quarantaine, il a la chance d’être nommé au Revier (baraquement destiné aux prisonniers malades des camps – ce mot était prononcé par les déportés français « revir »), dont il devient le premier médecin français. Le Dr Joseph Brau sait se faire accepter et reconnaître par sa compétence et son dévouement. Avant sa nomination, pour être admis au Revier, il fallait avoir une température élevée. Joseph Brau obtient l’admission de malades sans fièvre, sur la seule autorité de son diagnostic. Pour les déportés qui y sont admis, c’est une chance car, même si le lieu est dépourvu de moyens, les malades y trouvent la possibilité de ne pas participer à l’appel, d’échapper au travail et d’avoir quelques jours de repos qui peuvent leur sauver la vie. L’appareil de radio de Joseph Brau fonctionne au maximum, passant de trois clichés par jour à son arrivée à une cinquantaine à la libération du camp. Le docteur Joseph Brau sait toujours « interpréter » ses radios de façon à sauver le plus grand nombre de déportés du sort qui les attend. Au Revier, durant toute sa période d’emprisonnement, il s’attachera à améliorer l’existence des malades du camp, les conditions de vie des prisonniers et d'en sauver d'autres le plus possible. Dans le cadre du Comité des intérêts français (CIF), il est nommé président du Comité du corps médical français. Au Revier, des conférences médicales dans chaque langue sont organisées tous les samedis pour améliorer l’efficacité des diagnostics et des soins. Joseph Brau a la charge d’organiser les conférences en français. Le 12 avril 1945, le camp de Buchenwald est libéré. Le lieutenant-colonel Joseph Brau, le plus élevé en grade parmi les médecins détenus, est nommé médecin chef chargé de l’administration du Revier et du service de santé du camp par le colonel des Rangers de la troisième armée américaine. Fin avril, il est rapatrié avec les derniers déportés français hospitalisés au Revier, et il rapporte avec lui toutes les archives du Revier concernant les Français, qu’il remet aux autorités gouvernementales de son pays. A son retour, le Docteur Joseph Brau témoigne de la moralité de ses camarades d’infortune chaque fois que cela lui est demandé, en particulier au colonel Frédéric-Henri Manhès et à Marcel Paul, dont les actions dans le cadre du CIF sont, à plusieurs reprises, très sévèrement contestées après la Libération, et établit des certificats médicaux pour les anciens détenus qui le demandent. Revenu dans la vie civile, et en parallèle de son activité de médecin, il poursuit donc activement son militantisme contre le fascisme et celui pour le devoir de mémoire des camps. Il entretient des relations suivies avec nombre de ses anciens camarades d'infortune dont Ernst Busse (futur vice-ministre-président, ministre de l'Intérieur et secrétaire d’État aux Eaux et Forêts du Land de Thuringe), Marcel Paul (ministre de la Production industrielle de novembre 1945 à décembre 1946, dans les gouvernements de Charles de Gaulle, Félix Gouin et Georges Bidault), le colonel Frédéric-Henri Manhès, Albert Forcinal, le Dr Jean Rousset, le Dr Jean Lansac, Nicolas Simon dit « Gandhi », Aloïs Grimm. Il est membre du comité national de la Fédération nationale des déportés et internés résistants et patriotes (FNDIRP), membre de l'amicale de Buchenwald-Dora et Kommandos, qui deviendra l'Association française Buchenwald-Dora et Kommandos. Il prend sa retraite de médecin radiologue civil en 1956. En 1963, il reçoit à Berlin-Est la Médaille für Kämpfer gegen den Faschismus (médaille de la Lutte contre le fascisme) du Conseil des ministres de la RDA. Ses souvenirs détaillés de résistant et de déporté à Buchenwald sont consignés dans un livre, « Ici, chacun son dû (à tort ou à raison) », écrit en 1973 par Lucien Cariat, instituteur membre du groupe de résistance Vengeance, et dont Marcel Paul a rédigé l’introduction. Après la guerre, en 1955, il est élu conseiller général du canton de La Ferté-sous-Jouarre, dans le département de Seine-et-Marne, et réélu en 1961. Le 31 mars 1973, dans la cour de l'hôtel des Invalides à Paris, le président Georges Pompidou lui remet la Croix de Grand Officier de la Légion d’Honneur. Pendant les trente dernières années de sa vie Joseph Brau a l’habitude de passer tous ses moments de liberté en famille dans les Landes, à Hossegor puis à Seignosse, où il se retire définitivement en 1971, et où il meurt le 11 mai 1975. Durant sa vie, il se verra attribuer de nombreux titres et décorations : la croix de guerre avec palme (1917), une citation à l’ordre de la IVe armée, une citation à l’ordre de la 46e division d’occupation de Haute-Silésie (1921), la croix de guerre des TOE avec étoile d’argent (1922), la médaille commémorative de Haute-Silésie, la médaille coloniale agrafe Maroc (1924), promu chevalier de la Légion d’honneur (1925), la médaille d’argent de l’Académie de médecine, la médaille commémorative d’Orient (1926), le grade de médecin lieutenant-colonel (1940), la médaille commémorative d’Orient avec inscription « Orient », la croix de guerre 1939-1945, promu officier de la Légion d’honneur, une citation à l’ordre du corps d'armée (1947), la croix de guerre avec étoile de vermeil, la médaille d'honneur des épidémies (1948), élevé au rang de médecin colonel (1949), admission à l'honorariat du grade de colonel (1953), titre de Combattant volontaire de la Résistance (1953), attestation d’appartenance aux Forces françaises combattantes du réseau Hector (1956), promu commandeur de la Légion d’honneur en qualité de mutilé de guerre (1961), la croix de Guerre 1939-1945 avec palme, la médaille Kämpfer gegen den Faschismus 1933-1945 du Conseil des ministres de la RDA (1963), la médaille de la Reconnaissance de la FNDIRP (1967), la croix du combattant volontaire 1939-1945 (1968), élevé à la dignité de grand officier de la Légion d’honneur (1973). La commune de La Ferté-sous-Jouarre a baptisé dans les années 1980 une de ses écoles maternelles du nom du Docteur Brau. Une plaque commémorative rappelant Joseph Brau a été apposée le 18 novembre 1995 sur le mur de l'école. Le samedi 11 avril 2015, à Trébons, en mémoire du Dr Joseph Brau (1891-1975), une plaque commémorative scellée sur la façade de sa maison natale a été dévoilée par Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, préfète des Hautes-Pyrénées, et Yves Pujo, maire de la commune. Le 7 juin 2016, le maire de Seignosse, et les élus de son équipe, ont inauguré une rue d’un nouveau quartier résidentiel de Seignosse, baptisée du patronyme de la famille de cet illustre résistant seignossais, le docteur Joseph Brau.BROOKE Alan Francis (1883-1963)
Field Marshal, 1er vicomte Alanbrooke et baron Alanbrooke
 Alan Francis BROOKE, né le 23 juillet 1883 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 17 juin 1963 dans son village d’Hartley Wintney dans le Hampshire, à l’âge de 79 ans. Militaire britannique, il fut promu au grade de Field-Marshal en 1944 et fait baron Alanbrooke de Brookenborough, comté de Fermanagh en 1945, puis vicomte en 1946. De parents d’Irlande du Nord, il passa la majeure partie de son enfance en France, où il fut éduqué. Conformément à la tradition familiale, il étudiera à l’académie royale militaire de Woolwich, en Angleterre, où il obtiendra son diplôme d’officier d’artillerie. Pendant la Première Guerre mondiale, il servira en France avec l’Artillerie royale, terminant le conflit en tant que lieutenant-colonel. Dans l’entre-deux-guerres, il enseigna au Camberley Staff College et à l’Imperial Defence College. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il commanda le deuxième Corps de la Force expéditionnaire britannique sur le continent, qui ne réussit pas à arrêter l’invasion allemande, mais qui assura un important soutien d’artillerie pour les troupes belges, françaises et britanniques, lors de l’évacuation de Dunkerque, en 1940. En juillet 1940, il fut nommé Commandant de l’United Kingdom Home Forces et en décembre 1941, promu au rang de Chief of the Imperial General Staff (CIGS) et président du Comité des chefs d’Etat-Major, un poste qu’il occupera jusqu’en 1946. Il fut également un membre essentiel dans la planification du débarquement en Normandie de juin 1944. Ses désaccords publics avec certaines politiques de Winston Churchill rendirent ses nominations surprenantes, mais elles démontrent le respect de Churchill pour sa capacité de leadership. Il servit de premier conseiller militaire au Premier ministre Winston Churchill, au Cabinet de guerre et aux alliés du Royaume-Uni. Comme CIGS, il fut la tête fonctionnelle de l’armée, et à la tête du Comité des chefs d’Etat-Major, il fut responsable de la direction stratégique globale de l’effort de guerre. Il se vit offrir le commandement des forces britanniques au Moyen-Orient, poste qu’il refusa, pensant qu’il devait rester au Royaume-Uni pour empêcher Churchill de mener le pays dans toutes les aventures militaires hasardeuses. En 1942, il rejoignit le commandement exécutif des alliés occidentaux, le Chief of the Imperial General Staff américano-britannique à Washington. Comme Bernard Montgomery, il sera plus tard amer et déçu de ne pas avoir été choisi pour diriger le débarquement allié en Europe de l’Ouest, poste qui reviendra au général Eisenhower. Décision basée sur le pourcentage d’hommes et de matériels que les États-Unis avaient fourni à l’alliance. Après la guerre, en novembre 1945, en tant que président des chefs d’Etat-Major de la Grande-Bretagne, il rendit visite à Douglas MacArthur au Japon. En 1946, pour ses services militaires, il sera fait vicomte Alanbrooke. En 1949, il sera chancelier de l’Université Queen’s de Belfast, jusqu’à sa mort en 1963. En 2001, la publication de ses mémoires de guerre, War Diaries, non censurées, apporta ses visions jour après jour de l’effort de guerre britannique et, parfois, des critiques directes à propos des décisions de guerre de Winston Churchill ou de la capacité du général Dwight David Eisenhower en tant que Commandant militaire et de la stratégie américaine en général.
Alan Francis BROOKE, né le 23 juillet 1883 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 17 juin 1963 dans son village d’Hartley Wintney dans le Hampshire, à l’âge de 79 ans. Militaire britannique, il fut promu au grade de Field-Marshal en 1944 et fait baron Alanbrooke de Brookenborough, comté de Fermanagh en 1945, puis vicomte en 1946. De parents d’Irlande du Nord, il passa la majeure partie de son enfance en France, où il fut éduqué. Conformément à la tradition familiale, il étudiera à l’académie royale militaire de Woolwich, en Angleterre, où il obtiendra son diplôme d’officier d’artillerie. Pendant la Première Guerre mondiale, il servira en France avec l’Artillerie royale, terminant le conflit en tant que lieutenant-colonel. Dans l’entre-deux-guerres, il enseigna au Camberley Staff College et à l’Imperial Defence College. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il commanda le deuxième Corps de la Force expéditionnaire britannique sur le continent, qui ne réussit pas à arrêter l’invasion allemande, mais qui assura un important soutien d’artillerie pour les troupes belges, françaises et britanniques, lors de l’évacuation de Dunkerque, en 1940. En juillet 1940, il fut nommé Commandant de l’United Kingdom Home Forces et en décembre 1941, promu au rang de Chief of the Imperial General Staff (CIGS) et président du Comité des chefs d’Etat-Major, un poste qu’il occupera jusqu’en 1946. Il fut également un membre essentiel dans la planification du débarquement en Normandie de juin 1944. Ses désaccords publics avec certaines politiques de Winston Churchill rendirent ses nominations surprenantes, mais elles démontrent le respect de Churchill pour sa capacité de leadership. Il servit de premier conseiller militaire au Premier ministre Winston Churchill, au Cabinet de guerre et aux alliés du Royaume-Uni. Comme CIGS, il fut la tête fonctionnelle de l’armée, et à la tête du Comité des chefs d’Etat-Major, il fut responsable de la direction stratégique globale de l’effort de guerre. Il se vit offrir le commandement des forces britanniques au Moyen-Orient, poste qu’il refusa, pensant qu’il devait rester au Royaume-Uni pour empêcher Churchill de mener le pays dans toutes les aventures militaires hasardeuses. En 1942, il rejoignit le commandement exécutif des alliés occidentaux, le Chief of the Imperial General Staff américano-britannique à Washington. Comme Bernard Montgomery, il sera plus tard amer et déçu de ne pas avoir été choisi pour diriger le débarquement allié en Europe de l’Ouest, poste qui reviendra au général Eisenhower. Décision basée sur le pourcentage d’hommes et de matériels que les États-Unis avaient fourni à l’alliance. Après la guerre, en novembre 1945, en tant que président des chefs d’Etat-Major de la Grande-Bretagne, il rendit visite à Douglas MacArthur au Japon. En 1946, pour ses services militaires, il sera fait vicomte Alanbrooke. En 1949, il sera chancelier de l’Université Queen’s de Belfast, jusqu’à sa mort en 1963. En 2001, la publication de ses mémoires de guerre, War Diaries, non censurées, apporta ses visions jour après jour de l’effort de guerre britannique et, parfois, des critiques directes à propos des décisions de guerre de Winston Churchill ou de la capacité du général Dwight David Eisenhower en tant que Commandant militaire et de la stratégie américaine en général.
 Alan Francis BROOKE, né le 23 juillet 1883 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 17 juin 1963 dans son village d’Hartley Wintney dans le Hampshire, à l’âge de 79 ans. Militaire britannique, il fut promu au grade de Field-Marshal en 1944 et fait baron Alanbrooke de Brookenborough, comté de Fermanagh en 1945, puis vicomte en 1946. De parents d’Irlande du Nord, il passa la majeure partie de son enfance en France, où il fut éduqué. Conformément à la tradition familiale, il étudiera à l’académie royale militaire de Woolwich, en Angleterre, où il obtiendra son diplôme d’officier d’artillerie. Pendant la Première Guerre mondiale, il servira en France avec l’Artillerie royale, terminant le conflit en tant que lieutenant-colonel. Dans l’entre-deux-guerres, il enseigna au Camberley Staff College et à l’Imperial Defence College. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il commanda le deuxième Corps de la Force expéditionnaire britannique sur le continent, qui ne réussit pas à arrêter l’invasion allemande, mais qui assura un important soutien d’artillerie pour les troupes belges, françaises et britanniques, lors de l’évacuation de Dunkerque, en 1940. En juillet 1940, il fut nommé Commandant de l’United Kingdom Home Forces et en décembre 1941, promu au rang de Chief of the Imperial General Staff (CIGS) et président du Comité des chefs d’Etat-Major, un poste qu’il occupera jusqu’en 1946. Il fut également un membre essentiel dans la planification du débarquement en Normandie de juin 1944. Ses désaccords publics avec certaines politiques de Winston Churchill rendirent ses nominations surprenantes, mais elles démontrent le respect de Churchill pour sa capacité de leadership. Il servit de premier conseiller militaire au Premier ministre Winston Churchill, au Cabinet de guerre et aux alliés du Royaume-Uni. Comme CIGS, il fut la tête fonctionnelle de l’armée, et à la tête du Comité des chefs d’Etat-Major, il fut responsable de la direction stratégique globale de l’effort de guerre. Il se vit offrir le commandement des forces britanniques au Moyen-Orient, poste qu’il refusa, pensant qu’il devait rester au Royaume-Uni pour empêcher Churchill de mener le pays dans toutes les aventures militaires hasardeuses. En 1942, il rejoignit le commandement exécutif des alliés occidentaux, le Chief of the Imperial General Staff américano-britannique à Washington. Comme Bernard Montgomery, il sera plus tard amer et déçu de ne pas avoir été choisi pour diriger le débarquement allié en Europe de l’Ouest, poste qui reviendra au général Eisenhower. Décision basée sur le pourcentage d’hommes et de matériels que les États-Unis avaient fourni à l’alliance. Après la guerre, en novembre 1945, en tant que président des chefs d’Etat-Major de la Grande-Bretagne, il rendit visite à Douglas MacArthur au Japon. En 1946, pour ses services militaires, il sera fait vicomte Alanbrooke. En 1949, il sera chancelier de l’Université Queen’s de Belfast, jusqu’à sa mort en 1963. En 2001, la publication de ses mémoires de guerre, War Diaries, non censurées, apporta ses visions jour après jour de l’effort de guerre britannique et, parfois, des critiques directes à propos des décisions de guerre de Winston Churchill ou de la capacité du général Dwight David Eisenhower en tant que Commandant militaire et de la stratégie américaine en général.
Alan Francis BROOKE, né le 23 juillet 1883 à Bagnères-de-Bigorre et mort le 17 juin 1963 dans son village d’Hartley Wintney dans le Hampshire, à l’âge de 79 ans. Militaire britannique, il fut promu au grade de Field-Marshal en 1944 et fait baron Alanbrooke de Brookenborough, comté de Fermanagh en 1945, puis vicomte en 1946. De parents d’Irlande du Nord, il passa la majeure partie de son enfance en France, où il fut éduqué. Conformément à la tradition familiale, il étudiera à l’académie royale militaire de Woolwich, en Angleterre, où il obtiendra son diplôme d’officier d’artillerie. Pendant la Première Guerre mondiale, il servira en France avec l’Artillerie royale, terminant le conflit en tant que lieutenant-colonel. Dans l’entre-deux-guerres, il enseigna au Camberley Staff College et à l’Imperial Defence College. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il commanda le deuxième Corps de la Force expéditionnaire britannique sur le continent, qui ne réussit pas à arrêter l’invasion allemande, mais qui assura un important soutien d’artillerie pour les troupes belges, françaises et britanniques, lors de l’évacuation de Dunkerque, en 1940. En juillet 1940, il fut nommé Commandant de l’United Kingdom Home Forces et en décembre 1941, promu au rang de Chief of the Imperial General Staff (CIGS) et président du Comité des chefs d’Etat-Major, un poste qu’il occupera jusqu’en 1946. Il fut également un membre essentiel dans la planification du débarquement en Normandie de juin 1944. Ses désaccords publics avec certaines politiques de Winston Churchill rendirent ses nominations surprenantes, mais elles démontrent le respect de Churchill pour sa capacité de leadership. Il servit de premier conseiller militaire au Premier ministre Winston Churchill, au Cabinet de guerre et aux alliés du Royaume-Uni. Comme CIGS, il fut la tête fonctionnelle de l’armée, et à la tête du Comité des chefs d’Etat-Major, il fut responsable de la direction stratégique globale de l’effort de guerre. Il se vit offrir le commandement des forces britanniques au Moyen-Orient, poste qu’il refusa, pensant qu’il devait rester au Royaume-Uni pour empêcher Churchill de mener le pays dans toutes les aventures militaires hasardeuses. En 1942, il rejoignit le commandement exécutif des alliés occidentaux, le Chief of the Imperial General Staff américano-britannique à Washington. Comme Bernard Montgomery, il sera plus tard amer et déçu de ne pas avoir été choisi pour diriger le débarquement allié en Europe de l’Ouest, poste qui reviendra au général Eisenhower. Décision basée sur le pourcentage d’hommes et de matériels que les États-Unis avaient fourni à l’alliance. Après la guerre, en novembre 1945, en tant que président des chefs d’Etat-Major de la Grande-Bretagne, il rendit visite à Douglas MacArthur au Japon. En 1946, pour ses services militaires, il sera fait vicomte Alanbrooke. En 1949, il sera chancelier de l’Université Queen’s de Belfast, jusqu’à sa mort en 1963. En 2001, la publication de ses mémoires de guerre, War Diaries, non censurées, apporta ses visions jour après jour de l’effort de guerre britannique et, parfois, des critiques directes à propos des décisions de guerre de Winston Churchill ou de la capacité du général Dwight David Eisenhower en tant que Commandant militaire et de la stratégie américaine en général.